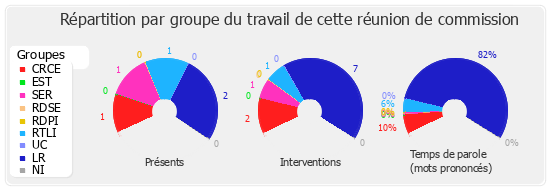Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du 10 septembre 2020 à 10h10
Sommaire
La réunion

En ma qualité de président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, j'ai le plaisir d'accueillir les membres du conseil scientifique, les uns en présentiel, les autres en distanciel, compte tenu des circonstances actuelles. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette réunion d'installation du conseil scientifique. Je salue mes collègues sénateurs et députés, notamment le premier vice-président Cédric Villani. Je veux rendre hommage à son autorité, à son talent et à son goût du travail collectif.
Nous sommes réunis dans la salle René Monory, grand président du Sénat qui a démontré que tous les talents pouvaient conduire à servir l'État, quelle que soit la formation, puisqu'il avait débuté comme garagiste. Cet excellent mécanicien savait faire fonctionner absolument toutes les institutions de la vie publique...
C'est donc dans cette salle que notre excellent collègue Jérôme Bignon participera à sa dernière réunion en tant que sénateur. Nous connaissons sa passion pour la science et pour sa diffusion dans les milieux politiques, afin que les décisions soient mieux éclairées.
Je veux, au nom de l'Office, remercier les membres du conseil scientifique de leur engagement. Au travers de nos sollicitations, vous aurez l'occasion de défendre la science. C'est extrêmement important. À l'origine, lors de la création de l'Office, le conseil comptait 15 membres. Ce nombre est passé à 24, la diversité des questions qui nous sont posées appelant une représentation beaucoup plus large. Le conseil scientifique a fait l'objet en début d'année de son renouvellement triennal - partiel, à l'image de ce qui attend le Sénat fin septembre : environ la moitié des membres ont été nouvellement nommés. Je remercie par ailleurs ceux qui ont accepté d'être reconduits.
L'Office a été créé en 1983, essentiellement pour éclairer le Parlement, dans un esprit d'ouverture, d'écoute et d'universalité, afin de prendre en considération toutes les opinions dans les domaines de la science et de la technologie. Sa composition est bicamérale, elle associe 18 sénateurs et 18 députés, caractéristique suffisamment rare dans nos institutions pour être soulignée. Suivant un principe d'alternance, je céderai - à regret - la présidence à un député à la fin du mois. À cet égard, je rappelle que Cédric Villani a toute la confiance de l'Office.
Nous avons vocation à travailler pour les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne les remplaçons pas. Toutes les commissions peuvent nous saisir. C'est à cette condition que nous engageons des études plus ambitieuses, qui aboutissent en général à des rapports très denses, ayant pour seul objet de donner l'état des connaissances dans tel ou tel domaine. Nous n'avons pas vocation à prendre position. Nous avons vocation à mettre à la disposition des parlementaires tous les éléments d'information qu'ils doivent détenir pour voter de manière responsable.
Nous avons réalisé plus de deux cents rapports, qui constituent un socle de références sans lequel les commissions du Parlement ne peuvent pas travailler.
L'Office a également ouvert son champ d'activité de manière à pouvoir réagir très rapidement lorsqu'un besoin d'éclairage scientifique s'exprime sur une question d'actualité. Votre rôle sera, à cet égard, absolument indispensable pour nous accompagner.
Premièrement, nous organisons des auditions publiques contradictoires sur des sujets d'actualité scientifique ou technologique. Nous l'avons ainsi fait sur un sujet brûlant l'an dernier : le lancinant problème des soudures de Flamanville. Ces auditions publiques, qui se tiennent en général à un rythme mensuel, permettent d'éclairer le Parlement sur les positions respectives des différentes parties prenantes à un sujet.
Deuxièmement, Cédric Villani, qui m'a précédé dans les fonctions de président, a lancé l'idée de notes scientifiques, documents de synthèse de quatre pages qui permettent de suivre l'actualité d'un sujet et constituent une véritable valeur ajoutée pour nos collègues qui travaillent dans les commissions.
Nous publions grosso modo une douzaine de notes scientifiques par an. Nous avons évidemment beaucoup suivi l'actualité en matière de santé depuis l'apparition de la crise du Covid-19. Les dernières notes concernent, par exemple, les enjeux sanitaires du cannabis, les neurosciences et la responsabilité de l'enfant, les satellites et les nouveaux lanceurs ou encore les cryptographies quantiques et post-quantiques.
Les auditions publiques ont porté sur des sujets parfois très conflictuels : les fongicides SDHI ; l'hésitation vaccinale ; les soudures de l'EPR de Flamanville ; les enjeux du conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne ; l'apport des sciences et de la technologie à la restauration de Notre-Dame de Paris, sur l'initiative de Cédric Villani. Sur ce sujet passionnant, la rencontre a montré les capacités prospectives et l'inventivité formidable des restaurateurs, très au-delà des polémiques superficielles dont la presse s'était fait l'écho au moment du débat sur la reconstruction de la cathédrale. Nous avons également travaillé sur des sujets beaucoup plus sensibles politiquement, comme l'expérimentation animale, ou encore sur les perspectives technologiques ouvertes par la 5G. Cette dernière audition a permis d'évoquer les perspectives ouvertes, notamment en matière de connexion des objets, par cette technologie qui fait l'objet de vives critiques.
Quatre études longues sont en cours, dont certaines devraient donner lieu à la publication de rapports dans les prochaines semaines. Les études sont, en règle générale, réalisées conjointement par un député et un sénateur. Ainsi, l'étude sur l'intégrité scientifique a pour rapporteurs Pierre Henriet et Pierre Ouzoulias - je rappelle que ce dernier a aussi travaillé récemment sur les rites funéraires et sur les cultes face au covid-19. Philippe Bolo et Angèle Préville sont rapporteurs d'une étude sur la pollution plastique. Une autre étude, dont les rapporteurs sont Thomas Gassilloud et Stéphane Piednoir, porte sur les conséquences de l'arrêt du projet de réacteur nucléaire Astrid. Enfin, Émilie Cariou et Bruno Sido travaillent sur l'évaluation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR).
Je veux également citer, comme exemple du travail en commun entre députés et sénateurs, le rapport sur les mobilités du futur, véhicules électriques et à hydrogène, réalisé par la députée Huguette Tiegna et le sénateur Stéphane Piednoir.

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre engagement à nos côtés. Nous vous solliciterons le plus souvent possible, car nous avons besoin de ne pas perdre de temps et, pour ce faire, d'être guidés dans la recherche des interlocuteurs, des partenaires et des documents.
L'Office est une équipe de députés et de sénateurs assidus, qui s'entendent bien et ont plaisir à travailler ensemble. Ses membres ont envie de faire progresser la connaissance, par leurs collègues parlementaires, des grands sujets d'actualité. Je vous remercie très sincèrement d'accepter de nous aider dans cette tâche. Vous contribuerez à faire en sorte que nos institutions soient plus clairvoyantes sur les grands sujets de société qui sont en permanence au coeur de l'actualité parlementaire et politique.
L'Office est un bel outil, qui a été bien pensé et qui a vocation à accroître son rayonnement auprès du Parlement et à travailler en lien avec la société. Ainsi, nous avons organisé de nombreuses auditions auxquelles le public pouvait participer en posant des questions qui étaient relayées par les parlementaires. L'Office doit être ce point de rencontre entre science, politique et société.
Les membres du conseil scientifique représentent une diversité d'institutions, de disciplines, d'horizons. J'ai eu le privilège de côtoyer un certain nombre d'entre vous dans diverses instances. Ainsi, j'ai été membre du conseil scientifique d'Universcience quand Claudie Haigneré en était présidente. Dans l'écosystème du plateau de Saclay, j'ai notamment rencontré Valérie Masson-Delmotte ou Béchir Jarraya à NeuroSpin. Quand je travaillais, pour le Gouvernement, au rapport sur l'intelligence artificielle, j'ai eu des interactions avec Raja Chatila ou encore avec Jean-Paul Laumond, sur des sujets liés. J'ai retrouvé Patrick Netter dans le cadre de petits déjeuners organisés entre l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et le Parlement. Voilà deux ans, Robert Barouki a été lauréat du prix Opecst-Inserm pour ses travaux sur le concept d'exposome. Guy Vallancien est l'un des membres actifs et énergiques de la vaillante Académie nationale de médecine. Didier Roux représente ici l'Académie des sciences et l'Académie des technologies. Le conseil scientifique réunit donc une grande variété de talents et de compétences.
Je vous propose de nous lancer sans plus attendre dans le coeur de la discussion. Pour commencer, je vous invite à procéder à un tour de table, qui permettra à chacun de se présenter et d'évoquer les thèmes dont vous estimez que l'actualité nous commande de les considérer en priorité, sachant aussi qu'il y a en ce moment au Parlement une discussion sur l'avenir de la recherche française.
Ce matin, nous avons tous lu dans la presse des articles sur l'effondrement des populations de vertébrés, sujet sur lequel Jérôme Bignon avait rédigé une excellente note scientifique. Chaque année, les rapports de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémique - en anglais : Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) nous alertent sur la perte mondiale de biodiversité. C'est l'un des sujets que nous devons suivre encore et toujours.
Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à rebondir sur ce que les uns et les autres peuvent dire.
Je suis biologiste, immunologiste au centre d'immunologie de Marseille-Luminy, où je dirige une équipe qui s'intéresse au rôle du système immunitaire dans des pathologies inflammatoires, en particulier dans des réponses antivirales. Je m'intéresse également au rôle du système nerveux dans la régulation de cette réponse immunitaire.
La crise du covid-19 nous a conduits à observer la vision du monde scientifique qu'a la société. Je pense qu'il faut renforcer, par l'éducation, la compréhension de ce qu'est la démarche scientifique, de la manière dont on établit des « vérités scientifiques » et des preuves, sur le temps long, et de l'importance de la controverse. De manière globale, la population doit être capable d'esprit critique sur ces sujets.
En écho à vos propos, on peut mentionner les terribles débats sur l'hydroxychloroquine, sur laquelle les convictions d'une grande partie de la population se fondaient essentiellement sur l'émotion, les hésitations sur le port du masque, jusqu'au niveau de l'OMS, ou les considérations sur le temps qu'il faudra pour disposer d'un vaccin... Cela a été source de tensions et de confusions.
Cette préoccupation rejoint le thème de l'intégrité scientifique, sur lequel se penche actuellement l'Office.
Par ailleurs, cette crise nous a aussi ouvert les yeux sur l'importance d'avoir une recherche ouverte, non dirigée et forte, puisqu'il est impossible de connaître à l'avance les enjeux qui vont se présenter à la société. Il importe de se rendre compte que, pour affronter ces enjeux, dont l'impact économique peut être important, il faut qu'il y ait, en amont, des personnes qui recherchent tous azimuts sur des sujets très divers, librement décidés.
Je suis volontaire pour participer à la réflexion que vous menez sur l'intégrité scientifique.
Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Je dirige une unité de l'Inserm qui s'intéresse aux questions de toxicologie, notamment environnementale. Je travaille beaucoup sur l'impact de l'environnement sur la santé.
Vous avez cité le concept d'« exposome », qui désigne l'ensemble des expositions que nous pouvons connaître et leur impact sur notre santé - c'est le complément du génome. Nous sommes assez contents que le terme figure à l'article 1er de la loi de modernisation de notre système de santé. Je pense que beaucoup de nos collègues étrangers sont très jaloux que le sujet des perturbateurs endocriniens s'invite, en France, dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle, alors que, dans nombre de pays, on ne sait même pas ce que c'est.
Il est extrêmement intéressant et utile de réfléchir à l'impact politique de la science, surtout dans le contexte du très ambitieux Green Deal européen. Dans le domaine de l'environnement et de la santé, la science est souvent incertaine ; on est toujours dans des nuances de gris. L'exemple des SDHI le montre bien. Comment une science un peu incertaine peut-elle impacter une politique, elle aussi parfois incertaine ? J'aimerais que l'on puisse développer ce sujet.
Les pandémies ont ramené sur le devant de la scène le sujet des infections, que l'on avait un peu commencé à oublier. Pendant très longtemps, on a opposé facteurs biologiques et produits chimiques. On n'hésitait pas à utiliser des tonnes de composés chimiques pour lutter contre les infections. Le covid-19 prouve que cette opposition est très artificielle, puisque l'on est d'autant plus sensible à cette pathologie que l'on souffre de maladies chroniques - obésité, diabète, hypertension -, elles-mêmes assez dépendantes de problématiques environnementales.
Sinon, la thématique de science ouverte évoquée par Sophie Ugolini me semble tout à fait pertinente.
On recommence notamment à parler des néonicotinoïdes. C'est de toute façon un sujet permanent.

Je suis présidente du centre Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) Bretagne-Normandie, donc responsable d'un ensemble de laboratoires travaillant dans les trois domaines de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Dans le passé, j'ai été chercheuse en biologie végétale : je m'intéressais à la dynamique des génomes végétaux. Depuis quelques années, mon activité est davantage tournée vers la gestion de la recherche, ce qui me donne la possibilité de m'ouvrir à d'autres sujets de recherche.
J'ai, pour ma part, pensé au sujet des pesticides. Aujourd'hui, des décisions sont prises en vue de leur interdiction. Elles sont légitimes et répondent aux attentes de consommateurs, mais comment être sûr que les alternatives ne seront pas pires encore ? Le biocontrôle, c'est aussi des molécules, même si ces dernières sont produites à partir de sources dites « naturelles ». Quelle doit être la marche à suivre ? Quels sont les délais ? Comment s'assurer que l'on a une chance d'aboutir et que l'on ne devra pas revenir en arrière ?
C'est un sujet d'actualité majeur, qu'il me semble très important d'approfondir. Il m'arrive d'avoir des échanges sur ces thématiques avec Christian Huyghe. Je rappelle par ailleurs que Catherine Procaccia et Jean-Yves Le Déaut ont rédigé pour l'Office un rapport sur les impacts de l'utilisation de la chlordécone aux Antilles.
Il serait bon que nous nous remettions au travail sur ces questions. Effectivement, le biocontrôle est une démarche très globale. Il ne s'agit pas de remplacer une molécule par une autre : il faut changer de mode opératoire, d'habitudes, de systèmes de culture...
Ce sujet va être de plus en plus prégnant dans l'actualité parlementaire. Nous devons sans cesse arbitrer entre des interdictions et des autorisations. Or on constate, sur le terrain, que, quand un produit est interdit, il peut être remplacé par des produits encore plus dangereux. Tout cela est très confus pour les parlementaires, qui ont beaucoup de difficultés à disposer d'éclairages objectifs, d'autant que les lobbies industriels se mettent dans le jeu. De ce point de vue, l'Office a un rôle très important à jouer.

Il n'y a pas aujourd'hui de réponse miracle. C'est aussi pour cela que nous avons du mal à vous éclairer. Quoi qu'il en soit, le sujet mériterait une réflexion globale.
Il pourrait également être intéressant de travailler sur le bien-être animal. Ce sujet de société est souvent traité sur le registre de l'émotion, et non de manière rationnelle. Or on commence aujourd'hui à disposer d'éléments un peu plus scientifiques.
Je suis d'autant plus intéressé qu'à titre personnel je défendrai une proposition de loi en ce sens en octobre prochain.

Je rappelle que, si nous ne les mangions pas, beaucoup d'animaux qui nous entourent n'existeraient pas... Ce n'est pas qu'une plaisanterie.
L'Office est nécessairement un lieu de rencontre entre des intérêts matériels identifiés, parfaitement respectables du reste, reflétant la société telle qu'elle s'est organisée, mais qui doit, à un moment ou à un autre, évoluer, pour diverses raisons. Nous sommes les témoins de conflits, mais nous nous efforçons de donner l'état de la situation avec le moins de passion et le plus d'indépendance possible, sachant que nous faisons en permanence l'objet de pressions du système en place. En démocratie, les gens votent en fonction de ce qu'ils sont, et non de ce qu'ils pourraient être demain, si les choses allaient différemment.
Nous aurons l'occasion de reparler du bien-être animal, qui est à la fois un sujet de société, un sujet scientifique, un sujet agricole et un sujet philosophique, qui questionne la place de l'humain dans la nature et le vivant.
Je suis professeur de biologie cellulaire à l'Université de Strasbourg et directeur de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire du CNRS. J'y dirige une unité de recherche qui travaille sur l'immunité des insectes. Ces travaux assez fondamentaux trouvent des applications pour toutes les maladies infectieuses transmises par les moustiques.
Compte tenu de l'impact de l'homme sur l'environnement, des barrières tombent. De nouveaux pathogènes émergents vont continuer à arriver. Beaucoup sont viraux. Il faut réfléchir à la surveillance des viromes présents dans les espèces animales qui peuvent passer à l'homme. Nous y réfléchissons pour ce qui concerne les insectes. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce thème soit mûr pour des discussions au niveau politique.
Le thème du déclin des insectes, qui rendent un nombre important de services aux écosystèmes, me semble plus mûr. L'année dernière, l'Académie des sciences a organisé la première grande conférence sur le thème des insectes, intitulée : « Insectes : amis, ennemis et modèles ». Dans la foulée, le groupe G-science Academies, qui réunit les académies des sciences des pays du G7, a consacré l'une de ses trois déclarations annuelles au déclin global des insectes. Nous y avons travaillé. Cette note est assez intéressante. Elle a été rédigée par les Américains, la réunion ayant eu lieu cette année à Washington, puis elle a été envoyée aux différentes académies, qui constituent des groupes de travail. Nous avons demandé, notamment, que les néonicotinoïdes et les OGM soient mentionnés, mais cela n'a pas été retenu. Nous sommes en train de finaliser un article qui reflète davantage la perception européenne, notamment française, de la situation. Cet article sortira dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Sur cette base, nous pourrons faire quelque chose.
Le déclin des insectes existe-t-il vraiment ? Des articles assez catastrophistes sont parus dans la presse, mais certains étaient des méta-analyses, avec un biais très fort. Il est pertinent d'en parler maintenant, des études vraiment sérieuses étant parues sur le sujet au cours des trois dernières années. Le déclin est réel, mais il doit être nuancé par le fait que beaucoup de ces études ont été réalisées par des équipes européennes et portent sur l'Europe du Nord et de l'Ouest, où la marque anthropique est très forte. Elles ne reflètent pas, par exemple, ce qui se passe sous les tropiques.
C'est plutôt rassurant.
Étudier ce qui se passe exactement a un coût. En effet, on ne peut pas comparer 2020 à 2010, parce que les populations varient naturellement au fil des années. Ensuite, il faut identifier les causes : anthropisation des milieux, pollution liée notamment aux insecticides, réchauffement climatique... Il faut ensuite voir comment on peut influer sur ces effets.
Trois pistes se dégagent : investir et documenter précisément ce qui se passe actuellement avec les insectes et décider de ce que l'on mesure - biomasse ou diversité des espèces ; mettre en place des solutions pour lutter contre ce phénomène de déclin, ce qui implique de préserver des environnements, d'aménager des micro-habitats ; inventer une nouvelle relation de l'homme à l'insecte. C'est sur ce plan que le politique peut jouer un rôle. L'insecte est souvent perçu négativement. Je rappelle cependant que 1 % des espèces sont nuisibles pour les cultures et que 1 % des moustiques qui nous piquent transmettent des maladies. Il faut changer la perception des insectes et insister sur tous leurs effets bénéfiques.

L'Office a rédigé en 2017 une étude sur les biotechnologies, et plus spécifiquement sur CRISPR-Cas9. Cet été, une technique de modification génétique des moustiques, pour limiter la propagation de la malaria en limitant les populations de l'insecte, sans le détruire, a été testée au Brésil et aux États-Unis. Travaillez-vous sur cette question ?
La technique CRISPR consiste à éditer le génome au lieu d'y ajouter un gène étranger. On peut ainsi stériliser le moustique, ce qui est testé en ce moment, mais cela risque également de rendre le moustique résistant à l'infection par un virus ou un parasite. C'est un débat sociétal. De plus, en stérilisant l'insecte, on élimine une espèce mais une autre la remplace, avec des effets indirects sur une chaîne alimentaire. Au Brésil, le fait que le gène modifié pouvait se transmettre à d'autres espèces de moustiques a suscité une controverse.

Il y a cinq ou six ans, de tels essais sur le terrain auraient fait scandale.
Il faut également mentionner le forçage génétique, qui permet de disséminer plus rapidement un gène dans une population. Nous n'en sommes qu'au stade de la recherche fondamentale sur ce sujet. Il faut s'assurer que le système peut être rappelé en cas de problème.
Biologiste, je travaille au sein de l'institut Jacques-Monod sur l'évolution des mouches drosophiles. Le forçage génétique utilise la technologie CRISPR en fabriquant un morceau d'ADN qui se transmet à l'ensemble de la descendance - alors qu'il n'aurait normalement qu'une chance sur deux de le faire. Cette nouvelle technique en développement dans les laboratoires ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière ; elle reste soumise à la réglementation OGM alors qu'elle est plus dangereuse en raison de sa dissémination plus rapide. De plus, il n'y a pas de réglementation à l'échelle internationale ; or les moustiques issus de forçage génétique dans un pays se répandront nécessairement au-delà des frontières. Il n'existe pas de moyens de contrôle. C'est pourquoi il me semble nécessaire de réfléchir à cette problématique.
Plus c'est international, plus c'est long à aboutir, or les technologies évoluent très rapidement.
Il faut également s'assurer que la recherche est conduite sans risque au sein des laboratoires.
On se rappelle comment la myxomatose, introduite en Australie, a fait des ravages dans les populations de lapins du monde entier. Si les États-Unis se lancent dans le forçage génétique de moustiques, les conséquences seront mondiales.
Voici une autre suggestion d'étude, davantage liée à l'actualité. Avec ma collègue Claire Wyart, directrice de recherche à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), j'ai créé le site adioscorona.org pour informer la population sur la pandémie et former le public à la démarche scientifique. Ce site fournit des liens vers les publications, fait le point sur l'état des connaissances et indique les gestes à adopter. Nous sommes une équipe de scientifiques volontaires pour animer le site, et les bonnes volontés sont bienvenues !
Il serait intéressant de creuser la possibilité de tester les eaux usées dans les écoles, collèges et lycées pour s'assurer que le virus n'y circule pas. Le virus est sécrété 20 à 25 jours dans les fèces, soit davantage que la durée de la maladie : le retrouver dans les eaux usées n'indique donc pas nécessairement une circulation active. En revanche l'apparition du virus après plusieurs mois de tests négatifs dans une école est indicative de nouveaux cas. On peut alors prendre des mesures plus contraignantes dans l'établissement concerné. C'est une piste à creuser : la faisabilité, et notamment l'accessibilité des eaux usées, ne me paraît pas certaine. De plus, 7 % des enfants ne vont pas aux toilettes à l'école. Toutefois, de telles mesures permettraient de mieux surveiller les régions où le virus ne circule pas.
Chercheur en physico-chimie, j'ai travaillé 25 ans au CNRS, mais aussi créé des start-ups dans les années 1990 et dirigé le département de recherche et d'innovation du groupe Saint-Gobain pendant douze ans.
Malgré de nombreux rapports recommandant une simplification des transferts de technologie, le monde politique n'a cessé de complexifier le système. Ce serait le bon moment pour reprendre ce dossier et réfléchir à une amélioration du dispositif. Les régions auraient un rôle important à jouer. Il y a une forte divergence entre ce que voit un monde politique satisfait de lui-même et le terrain où les obstacles persistent.
Deuxième sujet, plus prospectif : les méthodes de financement des start-ups. On voit apparaître des capitaux-risqueurs dont les pratiques ressemblent au leverage buy-out (LBO). L'Office pourrait poser ce problème, qui reste peu abordé aujourd'hui.
Le poids accordé au monde industriel dans la transition énergétique me semble insuffisant. La réglementation et la législation ne peuvent pas tout, et la transition énergétique ou écologique ne se fera pas sans impliquer le monde industriel.
À propos de l'intégrité scientifique et de la vérité ou plutôt de la réalité scientifique, il serait opportun que l'Office s'interroge sur les relations entre les conseils scientifiques et le monde politique, assez problématiques dans la période qui vient de s'écouler.
En effet, l'épidémie a soulevé de nombreuses interrogations : que fait le Conseil stratégique de recherche qui n'est plus opérationnel ? Pourquoi faire surgir deux conseils scientifiques auprès du Président de la République ? Pourquoi inclure le monitoring de la recherche dans les prérogatives du nouveau haut-commissaire au Plan alors qu'il devrait relever du Conseil stratégique ?
L'OPECST a récemment mené une audition conjointe avec la commission des affaires économiques sur le transfert de technologie, dans la foulée d'un rapport assassin de la Cour des comptes. Ce sujet sera abordé très superficiellement dans le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), parce que le Gouvernement n'a pas voulu rouvrir le dossier de l'architecture institutionnelle à cette occasion. Mais cette simplification devra être réalisée, en soumettant les formules de transfert apparues au cours de la dernière décennie à l'épreuve des faits.
Ancienne membre de l'administration fiscale et enquêtrice de l'Autorité des marchés financiers, je connais bien les LBO, qui consistent à endetter lors de l'achat l'entreprise visée et à rembourser cette dette par l'activité. Cette pratique fragilise les entreprises, dont certaines font l'objet de LBO successifs tous les trois ou quatre ans. Je suis tout à fait disposée à travailler sur ce sujet.

Les sujets que vous évoquez, de nature opérationnelle, relèvent davantage des commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. En revanche, en appui de vos propos, je déplore l'absence de ministère de l'industrie. Que la transition énergétique soit gérée par un ministère qui n'a pas l'industrie pour préoccupation première, c'est un affaiblissement. Je vous livre ici un avis strictement personnel et un plaidoyer pro domo puisque j'ai moi-même été ministre de l'industrie au siècle précédent... Je n'ai jamais cru que les ministres faisaient de l'industrie, mais j'ai toujours pensé que l'industrie devait avoir un lobby au sein du Gouvernement. Lorsqu'il y a un ministre de l'industrie, on estime qu'il ne sert à rien, mais on le regrette lorsqu'il n'est plus là. Tout cela s'apprend, avec l'expérience !
Chercheuse en science politique à Sciences Po et biologiste de formation, je travaille dans le domaine des politiques du vivant : administration, perception sociale de la matière vivante et de ses transformations. J'essaie de comprendre les mécanismes de politisation : qu'est-ce qui fait surgir la controverse ? Pourquoi est-elle dans certains cas de nature politique ?
La pharmacologie et les médicaments dits biologiques, c'est-à-dire fabriqués à partir de cellules d'organismes vivants, sont susceptibles d'intéresser l'Office. Ces produits sont donneur-dépendants et non standardisables, avec des coûts de fabrication importants et des enjeux réglementaires, notamment depuis le développement des bio-similaires, équivalent des génériques, pour réduire le coût des traitements. Un état de l'art serait bienvenu sur la notion de démonstration d'équivalence pharmaceutique. C'est un débat technique en lien direct avec la construction réglementaire.
Deuxième sujet, l'univers des plantes médicinales et la réglementation de la phytothérapie. Ce sont des produits accessibles sans ordonnances mais qui requièrent l'avis d'un médecin car les substances utilisées peuvent être toxiques. Je songe notamment aux huiles essentielles.
C'est un débat scientifique et de société, dans lequel il faut faire la part du fantasme et du bon usage.

J'ai été membre d'une mission d'information du Sénat sur ce sujet, présidée par Joël Labbé.

La commission des affaires sociales avait de son côté travaillé sur les biosimilaires.
Le rapport annexé au projet de LPPR souligne longuement la nécessité d'amplifier l'apport de la recherche à la société. Certes, la vocation première de l'Office est d'informer le Parlement et non de contribuer au débat public, mais il pourrait se saisir de ce débat public et des médiations scientifiques en tant qu'objets de recherche. En effet, le débat public est le point de passage obligé entre l'expertise scientifique et la décision politique ; il touche à l'articulation des légitimités scientifique et démocratique. Il serait intéressant et nécessaire de se saisir des outils des sciences humaines et sociales pour une approche scientifique de la vie sociale et politique.
Il n'existe pas de lien direct entre le niveau de connaissance scientifique et la confiance dans la science : il n'est pas nécessaire, pour avoir confiance dans la vaccination, d'avoir un Bac +7 en immunologie. Il faut donc comprendre pourquoi et comment se construisent des formes de défiance, mais aussi de confiance, irrationnelles. Cela concerne bien d'autres domaines et sous-disciplines que la vaccination.
L'anti-masque moyen est plus diplômé que la moyenne !
Certains domaines sont plus controversés que d'autres, comme la toxicologie, l'écotoxicologie, la pharmacovigilance, l'épidémiologie. La légitimité de ces disciplines repose sur l'identification de signaux faibles, et l'incertitude y est une composante essentielle de l'expertise. Dans un contexte où la compréhension culturelle du principe de précaution n'est pas évidente, des controverses parfois excessives peuvent surgir. Par définition, la pharmacovigilance établit des scénarios de prospective : une substance peut ne pas présenter de risque à un moment t, mais en présenter un à t+1. Il faut faire la part de cette incertitude constitutive de l'état des connaissances et d'une dissimulation malveillante des résultats. Cela nécessite une compréhension culturelle claire du principe de précaution.
En contexte parlementaire, la notion de principe de précaution est beaucoup plus restreinte et précise que dans le débat public.
La compréhension publique de ce principe pose en effet problème, avec des interprétations excessives qui peuvent aboutir à bloquer l'innovation.
Autre sujet important, la culture scientifique et son institutionnalisation : la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle a mis en exergue la fragmentation croissante de la politique de culture scientifique. Il n'existe pas de lien clair entre les centres de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), les musées et les instituts de recherche et d'enseignement supérieur. Comment donner au public une perception beaucoup plus intégrée de notre culture scientifique ? L'Office pourrait contribuer à cette réflexion.

Cette discussion me rappelle la préparation de la note « Biodiversité : extinction ou effondrement ? », pour laquelle nombre de scientifiques m'ont présenté des données irréfutables. Mais quelqu'un m'a demandé : « Vous êtes-vous interrogé sur le doute ? ». Un collègue sénateur m'a ainsi objecté qu'il avait beaucoup d'oiseaux dans son jardin... C'est la réalité vécue par une personne résidant à la campagne. L'extinction - ou l'effondrement - de la biodiversité est un fait indiscutable, mais qu'en pensent les gens ? Plusieurs scientifiques, dont le sociologue Bruno Latour, m'ont exposé les phénomènes de perte de mémoire et de dissonance cognitive pouvant expliquer le scepticisme. On ne prend pas la peine d'écouter ceux qui doutent ; or il faut les faire entrer dans le débat de façon respectueuse, et non en mettant en question leur intelligence. Comment passer de l'invective à un pas vers l'autre ? C'est un travail passionnant.
Nous avons pu observer ce décalage entre science et société, notamment lors de l'audition sur le compteur Linky : le fossé était immense entre l'opérateur et les associations de citoyens, qui parlaient des langages différents.
Je suis directeur des accélérateurs et de la technologie au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). À ce titre, je suis chargé du Large Hadron Collider (LHC) et du développement des nouvelles technologies qui seront nécessaires au prochain accélérateur, prévu pour 2040. Je suis donc très intéressé par la question des transferts de technologie, en particulier les applications médicales : hadronthérapie, imagerie médicale. Nous avons beaucoup travaillé avec NeuroSpin, qui utilise une technologie issue du développement des aimants du LHC. Ingénieur électrotechnique de formation, je suis également les applications dans le domaine énergétique, et plus particulièrement la transmutation des déchets.
La culture et l'éducation scientifiques sont essentielles à mes yeux. La plus grande réussite du XXe siècle est le réseau électrique, que tout le monde considère pourtant comme acquis. Il faudrait mettre en évidence ces accomplissements auprès des jeunes et des enseignants, et les former à la notion de réseau et de distribution.
Beaucoup d'entre vous insistent à juste titre sur la transmission, le contact et les échanges ; il est vrai que l'annexe au projet de LPPR évoque longuement ces sujets, mais ils ne se retrouvent pas dans le projet de loi lui-même - pour l'instant.
Professeur de pharmacologie, j'ai dirigé un centre régional de pharmacovigilance. J'ai également été doyen d'une faculté de médecine et dirigé le département des sciences de la vie du CNRS. Je préside enfin le groupe de travail sur la LPPR de l'Académie nationale de médecine, créé pour proposer des mesures concrètes que nous avons publiées en décembre 2019.
La proportion des moyens publics dévolus en France à la recherche en biologie-santé est en baisse depuis douze ans. Elle est aujourd'hui inférieure à 20 %, soit la moitié de ce qu'y consacrent nos voisins. Notre groupe de travail a également analysé le positionnement international de la recherche française, en utilisant les indices normalisés de citation. Il apparaît que notre pays est devenu une puissance moyenne en biologie-santé, passant en quinze ans de 4,5 % à 3 % des publications mondiales, soit un recul de la sixième à la neuvième place, entre l'Italie et le Canada. La recherche médicale a reculé dans les mêmes proportions, avec une disparité en fonction des disciplines.
Plus inquiétant encore, dans le domaine de l'innovation en santé-médecine, la France n'est qu'en seizième position ; elle figure à la même place médiocre dans le classement de la réponse au covid-19. Dès le début de la pandémie, l'Académie de médecine a créé un groupe sur le sujet, émettant de fréquentes recommandations reprises par les médias.
L'Académie nous a en effet présenté l'important travail de synthèse qu'elle avait mené.
Nous avons notamment étudié le contexte de la recherche clinique sur le covid-19, en France et ailleurs. Nos conclusions, qui vous ont été présentées le 15 avril, ont été affinées depuis. La crise a été un puissant révélateur de la dispersion des moyens et de la complexité de l'organisation et du financement de notre recherche en biologie-santé. La cacophonie des appels à projets de recherche et l'absence de stratégie globale ont conduit à une multiplication des essais et à un gaspillage inacceptable de moyens, sans aucune chance d'aboutir à des conclusions fiables en raison du nombre trop restreint de patients.
Par contraste, les résultats positifs des essais cliniques sur le covid-19 au Royaume-Uni s'expliquent par la capacité de ce pays à faire travailler simultanément chaque hôpital sur les mêmes essais. Leur évaluation randomisée, Recovery, a commencé avec 12 000 patients à la mi-mars. Dans les cent jours suivants, les chercheurs ont fait trois découvertes concluantes qui ont transformé les soins contre le covid-19 dans le monde entier. Démonstration a ainsi été faite que la dexaméthasone, un stéroïde peu coûteux, réduit la mortalité d'un tiers chez les patients hospitalisés souffrant de graves complications respiratoires.
Sur l'ensemble de la chaîne allant de la recherche fondamentale en biologie, où le Royaume-Uni obtient parmi les meilleurs scores de publication, à la recherche clinique, le système britannique se révèle supérieur. Toute réforme du dispositif français de recherche en biologie-santé doit s'en inspirer. Le manque de continuité de la recherche d'amont à la recherche clinique et d'innovation en France peut être généralisé à d'autres enjeux sociétaux de nature interdisciplinaire.
La lutte contre le covid-19 fait intervenir des solutions thérapeutiques, mais aussi des recherches sur les origines environnementales du passage du virus de l'animal à l'homme, sur le changement climatique, mais aussi la sociologie, avec les modifications des comportements humains liées au confinement, aux barrières physiques ou au télétravail.
Notre système national de recherche, avec sa multitude d'agences et organismes, est-il susceptible de répondre à ces enjeux ? Ne faut-il pas réfléchir à une organisation plus rassembleuse, capable d'engager efficacement des recherches ? Le Royaume-Uni nous offre cet exemple. Depuis deux ans, toutes les agences de financement de la recherche et de l'innovation ont été rassemblées sous une unique bannière : UK Research and Innovation (UKRI). L'Office et son conseil scientifique pourraient se saisir de la possibilité d'une réforme similaire de la recherche en France.

Les trois dernières interventions se complètent. Les sciences humaines, la démocratie participative, spontanée ou gérée par les communicants, et la démocratie institutionnelle ne cohabitent pas aisément. L'Office doit se poser la question de l'appréhension de la science. En tant que parlementaires, nous estimons que le vote et la démocratie représentative sont les moyens les plus mûrs de gérer ce type de problème. À nous de le démontrer.
Monsieur Bordry, l'industrie en tant que telle n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans le système public. Les torts sont partagés : les entreprises estiment que l'État n'apporte que des contraintes, tandis que les groupes français du CAC 40 ont tiré une croix sur un marché français qui ne représente plus que 8 % à 15 % de leur chiffre d'affaires.
Monsieur Netter, l'Office a vocation à expliquer aux parlementaires comment fonctionne la recherche dans notre pays. La multiplicité des organismes est souvent déplorée mais, en allant au bout de ce débat, on finit généralement par suggérer la création d'une nouvelle entité. Changement d'herbage réjouit le veau, et l'assiette du voisin est toujours mieux remplie... En revanche, il est essentiel que notre Office reprenne le travail lancé par Cédric Villani sur le conseil scientifique de l'exécutif dans notre République. La connaissance de la structuration et de la vie de la recherche par les parlementaires est indispensable, tout autant que le refus de la démocratie directe sur certains sujets sensibles, où la médiation parlementaire est un facteur d'apaisement.
En France, les relations entre l'Université et les organismes comme l'Inserm ou le CNRS sont contractualisées. Il faut six comités d'évaluation pour transformer une structure. Résultat : plus de 95 % des structures sont reconduites. Les responsables de laboratoires passent plus de la moitié de leur temps à siéger dans des comités, à produire des rapports, à contrôler et à être contrôlés. Les Anglais ont su mettre en place un système où les chercheurs se consacrent exclusivement à la recherche, mais également à l'innovation. Dès le début de la crise du covid-19, nous aurions dû mettre en place un groupe interdisciplinaire pour travailler sur la recherche, les vaccins et la politique publique.
Ce nouveau virus, en mettant en évidence les balbutiements de la recherche, donne d'autant plus de poids au travail de ma communauté scientifique, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). En effet, sur la base d'une analyse critique des éléments disponibles, nous apportons un cadre de compréhension des controverses. Nous communiquons les connaissances disponibles, avec leurs incertitudes, pour qu'elles soient utilisées en appui à la prise de décision sur le climat.
Je co-préside l'un des groupes de travail du GIEC. Au cours des deux dernières années, nous avons rendu trois rapports spéciaux, sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5°C, sur les océans et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, et sur le changement climatique et les terres émergées. Pour ce dernier rapport, nous avons abordé pour la première fois des sujets couvrant les trois grandes conventions internationales sur la biodiversité, le climat et la désertification.
Nous avons également approché les systèmes alimentaires dans leur ensemble, avec les implications environnementales des pratiques de production, ainsi que la question de la pression sur les terres, qui joue sur les habitats, et de la disponibilité de ces terres pour produire de l'énergie et stocker du carbone. Sur cette thématique, il faudrait dégager plus clairement des priorités en matière de prévention pour la santé et de politiques alimentaires et agricoles. Les deux sujets sont liés : un article publié hier dans la revue Science souligne que le surpoids et l'obésité, qui touchent deux milliards de personnes, sont des facteurs majeurs de vulnérabilité dans la pandémie. Ils sont également liés à la pauvreté chronique. Cela montre l'importance de politiques publiques de prévention maximisant les bénéfices en matière de climat, d'environnement et de santé.
En juillet 2021, nous devrions rendre notre prochain rapport consacré aux bases physiques du changement climatique, qui doit délivrer une information à la fois globale et régionale, en appui de la prise de décision. Nous y explorons aussi les scénarios à fort impact mais faible probabilité d'occurrence, très importants pour la gestion du risque. La présentation de ce rapport sera l'occasion d'un point sur les enjeux du climat pour la France et les stratégies d'adaptation.
Nous avons connu plusieurs années successives avec des vagues de chaleur et des tensions sur l'approvisionnement en eau. La question de la gestion intégrée de l'eau sur le long terme et de son partage entre les milieux naturels, les habitats, les activités agricoles et les usages industriels est appelée à monter en puissance. Sujet annexe, le dépérissement grave de certaines forêts, qui ne suscite pas de réaction suffisante de la puissance publique.
Vous avez abordé la question de la relation entre science et société. Le parent pauvre de la réforme du lycée est l'éducation en sciences de la vie et de la Terre. Or elle est fondamentale pour que les futurs citoyens puissent se positionner et comprendre la démarche scientifique sur des sujets complexes comme la santé humaine, le climat ou la biodiversité. La formation par l'expérimentation, en particulier, est très importante. Nous avons besoin de l'aide de l'OPECST et du Parlement pour renforcer l'éducation sur ces thématiques.
Troisième point : valoriser la reconnaissance du temps passé par les scientifiques dans les milieux scolaires, auprès du grand public et des élus. Cela doit être reconnu comme une mission à part entière des enseignants-chercheurs et du personnel technique des laboratoires. La LPPR doit être l'occasion d'avancer en ce sens. Il faut décloisonner, renforcer la confiance de la société envers les scientifiques et faire en sorte que la recherche réponde aux questions sociétales.
J'ai fait partie d'un groupe de travail inter-académique créé dans le cadre de la crise sanitaire et associant les académies des technologies, des sciences, de médecine, de pharmacie et d'agriculture. Nous avons formulé des recommandations relatives à la prise en compte des objectifs du développement durable dans la gestion de crise et la reconstruction. Plus généralement, nous avons travaillé sur les méthodologies d'étude d'impact en appui à la prise de décision. Quels sont les outils disponibles pour évaluer l'impact d'un projet de loi, par exemple sur la qualité de l'air, de l'eau, des sols, l'exposition aux conséquences du changement climatique, la biodiversité, la santé ou la pauvreté ? À travers ces questions, nous cherchons à construire une prospérité résiliente intégrant l'économique, le social et l'environnemental.
Cela nécessite une mobilisation des compétences de la communauté académique et des besoins de ceux qui prennent les décisions. Des groupes internationaux essaient de mettre en place des méthodes innovantes d'analyse d'impact ; en France, le Haut conseil pour le climat, dont je fais partie, a souligné le manque d'outils pour la mise en cohérence de textes comme la loi agriculture et alimentation (Egalim) ou la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la stratégie nationale bas carbone.
Plus largement, l'éthique de l'expression des scientifiques dans le domaine public doit faire l'objet d'une réflexion. Dans le domaine du climat, des personnalités à la frontière entre science et politique se sont comportées en marchands de doute. Dans la pandémie actuelle, le constat est similaire : des prises de parole individuelles ne représentant pas l'état des connaissances ont pu semer le doute dans le public sans susciter de réaction de grande ampleur. C'est une question importante, difficile et délicate.
Je suis entièrement d'accord avec vous : l'éthique de l'expression scientifique est plus importante que jamais. Quelques interventions ont suffi à déséquilibrer le débat sur le covid-19.
En tant que chirurgien, je n'hésiterais pas à implanter des puces dans le cerveau de patients malades, blessés ou paralysés ; mais dans ce domaine, nous sommes en train de passer de la réparation à l'augmentation. Il y a deux ans, un chercheur chinois a modifié génétiquement deux embryons humains pour les préserver du HIV dont était atteint leur père. Il a été condamné et emprisonné pour ce délire scientifique. Mais plus récemment, Elon Musk a fait implanter des puces dans des cochons. C'est une évidence : nous sommes en train de glisser vers une démarche d'augmentation de la mémoire, de la cognition et du calcul. L'Office ne peut-il être un lieu de réflexion sur ce sujet, pour que la France engage, à terme, une conference of parties sur la génomique et le numérique ? En tant que chirurgien, je pourrais me voir demander, demain, d'augmenter des femmes et des hommes sains.
Il existe en effet une zone grise entre réparation et augmentation. J'ai assisté, à l'Académie des sciences, à des exposés sur l'utilisation des stimulations électriques pour traiter certaines affections du système nerveux. Je me souviens également de ce projet porté par José-Alain Sahel, ancien membre de l'Institut de la vision et membre de ce conseil scientifique, qui consiste à rendre la vue à des non-voyants par un mélange de numérique, de biologie et de chimie. L'Office peut porter ces sujets qui font dialoguer réflexion scientifique et philosophique.
Lorsqu'une puce est implantée dans mon cerveau, son propriétaire - ou un hacker... - peut modifier la personne que je suis. C'est un enjeu majeur d'identité.
Mme Masson-Delmotte a raison de souligner que les sujets de la forêt et de l'eau n'ont pas été abordés de manière globale. L'Assemblée nationale a produit plusieurs rapports, et la Cour des comptes a été saisie pour effectuer des comparaisons internationales. Toutes les forêts d'Europe occidentale sont concernées par ce que vous évoquez. Les parlementaires commencent à alerter les pouvoirs publics, qui pour le moment ne vont pas assez loin car ces questions sont prises en charge par différents ministères. Or, Gérard Longuet le sait bien, un sujet traité par plusieurs ministères n'est traité par personne... L'action publique, comme la recherche, doit être rationalisée.
Neurochirurgien à l'hôpital Foch de Suresnes, je pratique l'implantation de puces cérébrales pour traiter des désordres du mouvement associés à la maladie de Parkinson ou certaines dystonies sévères. Ces opérations relèvent désormais du soin clinique routinier. Dans le monde, 200 000 personnes ont un implant permanent dans leur cerveau qui améliore leur qualité de vie et facilite leur réinsertion sociale, voire professionnelle. C'est une invention française, mise au point par le professeur Benabid il y a vingt-cinq ans.
Je dirige aussi une équipe de recherche en neuroscience au sein de NeuroSpin, sur le campus du CEA de Saclay. C'est un centre d'imagerie à très haut champ magnétique qui permet l'exploration du cerveau et un décodage de sa fonction, avec une résolution inégalée. Nous disposons ainsi de l'IRM au champ magnétique le plus élevé au monde. Je suis enfin professeur de thérapeutique à l'université de Versailles Paris-Saclay.
M. Vallancien a introduit le sujet des neurotechnologies, qui recouvre des technologies électriques, de thérapie génique, moléculaire, optogénétique, ou encore des combinaisons d'intelligence artificielle et de dispositifs médicaux innovants. C'est une véritable révolution qui produit d'importants bouleversements dans le champ des maladies neurologiques graves. En quinze à vingt ans, nous avons réussi à changer profondément le quotidien des patients affectés par ces maladies.
Les neurotechnologies ont deux applications différentes. La première consiste à étudier le cerveau et le système nerveux aux différents âges, ainsi que sa fonction, à travers l'IRM fonctionnel, pour décoder le message neuronal, traduire la pensée en signaux électriques, et communiquer ce message à un exosquelette, un robot, ou un programme informatique par exemple. La résolution obtenue augmente considérablement, grâce aux IRM de NeuroSpin. Nous progressons dans la dissection de l'architecture et de l'anatomie du cerveau.
Le deuxième volet est interventionnel. Nous n'implantons des puces que dans le cerveau de personnes atteintes de maladies graves. Ne cédons pas à l'alarmisme : une neurochirurgie n'est jamais anodine. Il existe cependant un intermédiaire entre ce type d'interventions et ce qui relève de l'augmentation : l'implantation sur des patients atteints de maladies psychiatriques comme des états graves de dépression. Nous revenons à la psychochirurgie, mais avec des outils réversibles, qui ne lèsent pas le cerveau.
Ces technologies, qui sont une chance considérable pour des maladies réputées sans traitement, nécessitent des investissements massifs. La compétition internationale est vive dans ce domaine. La recherche et la médecine française ont leur carte à jouer, mais elles risquent de perdre leur avance. La stimulation cérébrale profonde a été inventée en France, mais les leaders de l'innovation dans la technologie des implants sont désormais ailleurs.
Je suis heureux de constater des complémentarités entre mon intervention et celle de certains collègues.
En effet, et les interventions de Jean-Paul Laumond et Raja Chatila vont venir renforcer cette complémentarité.
Je suis directeur de recherche émérite au CNRS, en poste au département informatique de l'École normale supérieure. Je fais également partie d'une équipe au sein de l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique).
Je conduis depuis 35 ans des recherches en robotique. J'ai ainsi travaillé, dès 1997, sur le parking automatique de robots mobiles avant de m'orienter, voici une quinzaine d'années, vers la robotique humanoïde, concevant des robots anthropomorphes susceptibles de marcher, de monter des escaliers ou de saisir des objets. La robotique, c'est une machine contrôlée par un ordinateur qui doit faire face aux lois de la physique - ce qui ne relève pas, à mon sens, de l'intelligence artificielle.
Je souhaite revenir sur l'éthique de l'expression scientifique. Le discours sensationnaliste faisant de la robotique le futur de l'humanité est très bien accueilli par les médias. Mais ce n'est pas en présentant un robot comme une simple machine articulée obéissant à des ordres que l'on passe à la Une des journaux.
Elon Musk l'a très bien compris !
Il faut trouver un juste milieu entre ce sensationnalisme et une forme de réductionnisme. Cela passe, à mon sens, par la linguistique - en amont de l'éthique. Comment le langage opère-t-il lorsque nous parlons à nos contemporains ? Une thèse croisant linguistique et robotique vient d'être consacrée à ce sujet.
En voici une illustration : j'étais le commissaire scientifique de l'exposition Robots à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous y avons mis en place des ateliers d'argumentation confrontant une dizaine de journalistes avec une dizaine de chercheurs dans des exercices imposés. Cela a permis de mieux comprendre comment le langage opère dans l'imaginaire qui se greffe sur ces technologies. Ce passage par la linguistique évite, à mon avis, de se poser de faux problèmes philosophiques comme le choix à faire, en cas d'accident d'un véhicule autonome, entre un enfant et une personne âgée... Ce sujet de la transmission scientifique comme objet de recherche mériterait d'être exploré. Il ne suffit pas de faire appel à des communicants pour résoudre le problème.
La France est bien placée en recherche robotique, puisqu'elle est classée dans les cinq premières puissances en matière de production scientifique. Il y a de très bonnes sociétés dans des niches, comme la robotique agricole ou médicale, mais nous sommes absents dans la robotique industrielle.
Je voudrais essayer d'analyser avec vous les causes de cette situation.
La recherche en robotique, c'est principalement, dans le domaine du logiciel, d'essayer de maîtriser les lois de la physique pour pouvoir commander des machines qui sont soumises à la gravité. Les machines doivent obéir aux logiciels. On va un peu au-delà de l'intelligence artificielle, qui est du pur traitement de l'information. On peut observer que les progrès réalisés en intelligence artificielle sont exponentiels. Il y a tous les jours de nouvelles applications sur les téléphones portables, mais j'ai coutume de dire que l'on a l'habitude d'utiliser des logiciels qui ne fonctionnent pas. Siri marche très bien pour obtenir une information simple, mais dès que cela devient compliqué... On utilise un logiciel dont on n'a pas précisément défini les conditions d'utilisation, c'est-à-dire que l'on n'a pas qualifié son champ de compétences. C'est pareil pour les GPS, qui peuvent nous mettre dans des situations absurdes. Si vous mettez ces logiciels sur une machine, elle tombe, donc on ne peut pas se satisfaire de cela. Le problème fondamental, c'est la certification des logiciels.
Selon moi, la structure de la recherche dans ce domaine n'est pas adaptée. On a d'excellentes compétences en recherche fondamentale, mais elles sont trop essaimées dans différentes structures, du type CNRS, CEA, etc. Comment traiter numériquement les lois de la physique ? Nous faisons de très belles publications sur le sujet, mais on ne parvient pas à percer sur le marché. Les logiciels que nous développons nous sont enviés à l'extérieur, notamment aux États-Unis, mais on ne parvient pas à aller plus loin pour des questions de certification.
On ne fait pas de la robotique uniquement avec des ordinateurs. On travaille avec des robots qui coûtent cher - autour d'un million d'euros pour un robot acheté au Japon ou en Espagne -, mais on n'a pas les personnels qui vont avec. On a les chercheurs et les doctorants, mais il manque les techniciens et les ingénieurs. C'est pourquoi nous avons lancé une réflexion avec l'Académie des sciences, en coopération avec les Allemands, pour créer un institut dédié à la robotique, mobilisant chercheurs, ingénieurs, techniciens autour de projets pour irriguer le tissu industriel de la filière.
C'est à n'en pas douter l'un des grands sujets sur lequel nous devrons nous pencher.
Je vous remercie de m'avoir invité à faire partie du conseil scientifique placé auprès de l'Office. Je tiens d'emblée à faire une petite mise à jour de mon CV. Depuis quelques jours, je suis professeur émérite, ce qui signifie que je suis à la retraite. Toute ma carrière, j'ai fait de la recherche dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle, d'abord au CNRS puis à l'université Pierre et Marie Curie.
Je me suis plus préoccupé des problèmes de prise de décision et d'apprentissage, en lien avec la perception de l'environnement. Le problème majeur, c'est que le robot interagit avec le monde physique, qui est complexe et incertain. C'est différent de l'intelligence artificielle, qui utilise seulement des données pour les traiter et essayer d'en faire sens.
Depuis peu a été lancée une initiative mondiale, à la suite du rapport de Cédric Villani, qui s'appelle Global Partnership on AI. Je suis co-responsable de l'un des quatre groupes de cette initiative internationale sur l'intelligence artificielle responsable.
J'ai pensé à plusieurs sujets intéressants pour vos travaux.
Il vient d'être dit que la France était à la cinquième place mondiale en matière de recherche robotique. Je précise qu'elle était à la troisième il n'y a pas si longtemps. Que s'est-il passé, surtout par rapport à l'Allemagne, qui a pris de l'avance ? Pourquoi ? Il convient d'analyser la place de la France au sein de l'Europe, compte tenu des contraintes communes et des capacités d'échange. Il faut aussi nous comparer à la Suisse, qui a une stratégie différente.
Le deuxième sujet que je souhaite évoquer, c'est la souveraineté numérique, qui est un sujet fondamental. Nous en avons eu un exemple récent avec les applications de traçage numérique dans le cadre de la crise du covid. Il est à noter que chaque pays européen y est allé de son application. Résultat : l'application allemande a été chargée 18 millions de fois ; l'application française 2,8 millions de fois ; l'application suisse 2,3 millions de fois ; en Italie, c'est 14 % de la population, et, au Royaume Uni, c'est l'échec total.
Toutes ces applications s'appuient sur les smartphones, avec deux systèmes d'exploitation différents, Android et iOS, gérés respectivement par Google et Apple. C'est grâce à ces technologies que les smartphones fonctionnent. Non seulement ces deux géants du numérique imposent le système de fonctionnement, mais ils viennent en plus de sortir leur propre application supranationale de traçage. Or, comme l'a dit M. Vallancien tout à l'heure, celui qui contrôle l'implant contrôle le système.
On pourrait élargir le débat aux liens entre neurosciences et numérique.
En troisième lieu, je pense qu'il nous faut réfléchir à la question de la réglementation de l'intelligence artificielle, comme l'Europe a d'ailleurs commencé à le faire. Cela renvoie à la problématique de l'éthique du numérique, de sa robustesse, de sa transparence. C'est un sujet également évoqué par le rapport de Cédric Villani. Où en est-on aujourd'hui en France et en Europe ?
Je dois dire que les conclusions de mon rapport, après un bon début, ne sont plus suivies aujourd'hui de manière très claire par le Gouvernement. Nous allons essayer d'y remédier.
Il faut reconnaître que les applications de traçage numérique ont été globalement un échec. La France est tout de même le seul pays à tenter d'aller contre l'hégémonie de Google et d'Apple. Néanmoins, vous avez raison de soulever le problème de la souveraineté numérique.
Je suis historien, spécialiste des populations et des sociétés européennes et ultramarines à l'époque moderne. Je m'intéresse tout particulièrement à la famille. Je suis très heureux d'incarner la dimension sciences humaines et sociales (SHS) au sein du conseil scientifique. Je suis par ailleurs directeur de l'un des dix instituts du CNRS, en charge des 300 unités de recherche en sciences humaines et sociales.
Contrairement à une idée reçue, nous sommes parmi les références mondiales dans bien des domaines de cette discipline. C'est le cas en archéologie, en linguistique, en économie. Certains des grands courants de pensée mondiaux sont très ancrés en France.
Sur l'organisation de la recherche en France, la question des moyens est vraiment centrale pour éviter un décrochage. Néanmoins, cette organisation permet de faire de la science remarquable.
L'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS (INSHS) est un excellent lieu d'observation pour suivre les évolutions des relations entre la science et la société. C'est un sujet que la plupart d'entre nous ont abordé, sous des angles différents, avec, en particulier, la question du transfert du monde scientifique vers le monde politique. Il nous faut mettre les citoyens au coeur de notre action, notamment au travers de l'éducation scientifique. Le CNRS a vraiment l'ambition d'apporter une culture scientifique en appui des politiques publiques.
Nous essayons également de développer le modèle de la recherche-action avec différents ministères.
Nous sommes au coeur d'une évolution majeure depuis quelques années. Devant les défis qui nous sont proposés, tels que le changement climatique, la biodiversité, l'immixtion du numérique, on voit apparaître la nécessité d'embarquer les SHS.
Il y deux grandes thématiques que je voudrais aborder.
Tout d'abord, la crise sanitaire que nous traversons, dans ses deux temporalités : l'urgence et le temps long. Celui-ci seul nous permettra de mesurer les conséquences de cette crise, qui nous a déjà montré tout ce qu'il y avait de dysfonctionnel dans nos politiques publiques et notre organisation.
La seconde thématique, c'est tout ce qui tourne autour de la mémoire. Vous le savez, c'est un processus social, où des souvenirs individuels sont formés par des interactions sociales. Pour moi, cette question, qui doit intégrer l'apport des sciences cognitives, est fondamentale. Il y a beaucoup de groupes de travail aujourd'hui sur les attentats de 2015, la mémoire de l'esclavage, les génocides, autant de sujets qui suscitent la controverse, qui ont une forte résonance dans l'espace public, et qui interrogent la relation des citoyens à la République. Il ne faut pas perdre de vue ces questions, y compris, et même surtout, durant la crise sanitaire. Interroger ces mémoires nous permettra de penser le rapport à la cohésion sociale. C'est un défi majeur.
Après le futur, la mémoire. Nous le savons, nous ne pouvons pas nous projeter vers le futur si nous n'avons pas une bonne perception de notre histoire.
Je suis très honorée d'avoir été invitée à participer à ce conseil scientifique, qui repose sur l'interdisciplinarité et la mutualisation des connaissances.
Je travaille à IFP Énergies nouvelles, qui est un établissement public industriel et commercial. C'est un acteur majeur de la recherche dans l'énergie, les mobilités et l'environnement. Je suis aujourd'hui responsable de la coordination de la recherche fondamentale. Je suis également au conseil scientifique du CNRS et à l'Académie des technologies. Je suis chimiste de formation et j'ai beaucoup travaillé sur le développement des procédés de transformation de l'énergie fossile.
J'ai toujours voulu réconcilier la chimie avec la société, car elle n'a pas bonne presse. Or elle a un rôle fondamental à jouer face aux défis environnementaux qui se présentent devant nous. Nous concentrons nos efforts sur la conciliation des problématiques de l'énergie et du climat. À cet égard, je suis ravie que les technologies vertes et la neutralité carbone soient au coeur du plan de relance du Gouvernement. On ressent une ambition très forte de lutter contre le changement climatique, mais la marche est vraiment très haute, notamment pour arriver à un mix énergétique plus diversifié.
La première thématique que je propose est la suivante : comment participer à la réduction de l'empreinte carbone de l'énergie fossile, dont nous aurons toujours besoin ? Le captage et le stockage du CO2 restent à cet égard un levier important. Nous pourrions essayer d'analyser les freins au développement à grande échelle de ces technologies.
C'est effectivement d'actualité !
Par ailleurs, il faut veiller à la cohérence des exigences environnementales et des différents leviers. Les outils d'aide à la décision doivent être développés à partir de bases de données partagées portant sur de multiples critères.
Enfin, il me semble que nous avons besoin d'une ambition forte sur les batteries. Il faut regarder où en est le développement des nouvelles technologies. Il y a un enjeu pour le stockage de l'énergie et le développement des mobilités durables. Dans ce domaine, il ne faut pas oublier le recyclage et la sécurisation des déchets (nickel, cobalt).
Le quatrième sujet que je souhaiterais vous proposer, c'est le rôle de la biomasse dans les énergies renouvelables. Quelles sont les synergies à trouver ? Où en est le développement des raffineries de deuxième génération ?
Enfin, le problème de l'accès à l'eau potable et du traitement des eaux usées pourrait être abordé.
Je vous remercie tout d'abord de m'avoir intégré dans ce conseil scientifique. Je suis professeur à Centrale Supélec, sur le campus de Metz, et je dirige une chaire créée voilà trois ans pour sensibiliser un large public aux technologies de la lumière, que l'on appelle la photonique. Ces technologies représentent un marché mondial de 800 milliards de dollars à l'horizon 2022, sachant que le marché de l'automobile est, lui, de 1 200 milliards de dollars. C'est donc un marché important. En France, on diplôme moins de 500 ingénieurs par an dans cette discipline, ce qui est notoirement insuffisant. Potentiellement, ce marché représente 50 000 emplois en France, et 500 000 emplois en Europe. La place de la photonique dans l'apprentissage constitue donc un vrai sujet.
Dans les grands marchés intéressant la photonique, on trouve les télécommunications, la santé, l'éclairage, les énergies renouvelables et un certain nombre de marchés de niche dans l'intelligence artificielle.
Ce qui me préoccupe d'abord, c'est la place de la technologie dans la recherche et l'innovation. M. Villani ne me démentira pas. J'étais ce matin à un colloque sur le business du numérique. On y a parlé du retard qu'a pris la France sur la technologie des semi-conducteurs, du magnétisme, des composants, qui viennent en appui de nos besoins grandissants en usages. J'ai eu la chance de partager un prix en 2007 avec un inconnu qui s'appelait Marc Zuckerberg, et qui venait de créer Facebook. J'étais récompensé pour mes travaux sur la sécurisation des données à partir de la cryptographie par chaos optique. Qui aurait pu imaginer que, 15 ans après, je ne pourrais pas déployer cette technologie, car, en France, nous n'avons plus aucun producteur de lasers, donc de composants semi-conducteurs ? Il n'y a plus que les Asiatiques qui maîtrisent cette technologie. Il y a donc un véritable enjeu à prendre en compte l'importance de la technologie dans les sciences de l'information.
Nous avons été sensibilisés lors d'une visite au CEA à Grenoble sur l'importance du développement de cette technologie en dur.
Le deuxième sujet qui me passionne, c'est la question de la culture scientifique et technique. Je suis également vice-président de la métropole de Metz en charge de l'enseignement supérieur. À ce titre, j'y porte un intérêt tout particulier, avec un regard plus politique. Il y a un vrai travail à mener. Pendant la crise du covid, j'ai été surpris de voir que l'on avait besoin de reconstituer toute une série de conseils scientifiques.
J'ai des craintes quand je lis qu'Emmanuel Macron a déclaré ce matin qu'il n'avait pas un gouvernement de scientifiques.
On ne sait pas exactement ce qu'il a voulu dire ... (Sourires)
Personnellement, je m'interrogerais sur la nécessité de confier à tout un chacun la possibilité d'appréhender les termes des débats scientifiques qu'il entend. C'est notamment le cas pour les politiques. Nous devons réfléchir à des solutions tous ensemble. J'ai moi-même imaginé un projet pour les collèges, qui s'appelle Illumi, et qui consiste à envoyer des chercheurs réaliser des expériences de physique dans les établissements. Ce projet a été assez compliqué à mettre en place, mais il existe, et j'ai désormais des fonds pour le développer.
Je pense que l'Office doit avoir une réflexion sur l'intérêt de la diffusion de la culture scientifique en France.
C'est effectivement une question capitale.
Je souhaite remercier les membres du conseil scientifique et m'excuser de ne pas avoir pu être physiquement présente à la réunion, mais nous sommes retenus par les journées parlementaires du groupe LaREM. J'ai écouté attentivement toutes les interventions. Nous serons à vos côtés pour faire avancer les sujets scientifiques. La science est un enjeu fondamental pour nos sociétés, comme la crise sanitaire vient de nous le rappeler. En tant que parlementaires, nous avons des difficultés à porter la parole scientifique. Il est donc très important de pouvoir nous appuyer sur vous. Pour ma part, j'avais demandé à l'Office de travailler sur les drones. Merci à vous tous.
C'est un grand plaisir pour moi de donner maintenant la parole à Claudie Haigneré, que je connais et admire depuis longtemps. Elle est une des grandes figures de l'interface science-politique en France et en Europe. Je lui fais confiance pour nous amener droit au but, comme une fusée qui décolle. (Rires)
Mon cher Raja, en ce qui me concerne, je suis une « astronaute émérite », retraitée de l'Agence spatiale européenne. Ce débat a été vraiment très riche et je vous remercie tous de votre écoute et de vos expressions.
Pour conclure, je vais prendre un peu de distance. Ce que je veux proposer au conseil permet d'assurer une forme de convergence.
Vous avez tous beaucoup évoqué la relation science-société, mais vous avez assez peu parlé d'éducation. Il n'y a pas dans notre assemblée de chercheur spécialisé dans les sciences de l'éducation. C'est un sujet tout à fait fondamental : comment développer l'esprit critique et la curiosité ? Nous devons nous pencher sur la place des sciences dans le système éducatif, en intégrant la problématique des inégalités, du manque de diversité.
Ma deuxième idée force, c'est de pousser l'Office à mener une véritable réflexion prospective, avec une méthodologie bien établie. C'est ce que l'on appelle scientific foresight. Pendant la récente crise sanitaire, nous nous sommes aperçus que nous étions complètement démunis. Nous devons apprendre à anticiper tous les scenarii pour permettre aux politiques de mieux se saisir des problèmes auxquels ils doivent faire face. La prospective existe certes, mais l'Office doit sans doute y prendre toute sa part, en s'obligeant à appréhender les problématiques à 360 degrés, du scientifique au juridique, en passant par la technologie. Je le répète, nous devons envisager tous les scenarii pour ne pas être démunis quand la crise survient. Cela oblige à réfléchir à un programme de travail cohérent, en ayant toujours à l'esprit le temps long et la dimension pluridisciplinaire.

Je vais rompre mon engagement de ne pas reprendre la parole, mais je veux apporter quelques précisions.
Nous sommes parlementaires, et nous ne sommes que parlementaires. Le public de l'Office, ce sont les députés et les sénateurs, et il faut travailler pour eux. En même temps, la difficulté, c'est de ne pas remplacer les commissions législatives et les groupes politiques, qui sont parfaitement légitimes à s'interroger sur l'avenir de notre pays.
En revanche, nous sommes parfaitement fondés à nous interroger sur les modalités scientifiques de la prospective. Nous avons besoin de savoir ce que les sciences peuvent nous apporter de plus significatif pour faire face aux défis de notre temps.
Par exemple, les puces existent depuis longtemps déjà, mais nous avons besoin de savoir si c'est un début ou si c'est une asymptote. C'est le rôle de l'Office de nous dire : est-ce une asymptote ou la loi de Moore va-t-elle continuer à fonctionner sans désemparer, au moins à l'échelle d'une génération ?
Nous devons pouvoir fournir à nos collègues parlementaires, qui, par définition, réfléchissent sur l'avenir, les données scientifiques disponibles. Cela peut être dans les sciences humaines, avec, par exemple, l'évolution de la démographie. C'est un travail absolument passionnant.
Soyez assurés que nous allons vous mobiliser et vous faire travailler, mais pas trop... (Rires) L'intérêt de ce tour de table était de mieux vous connaître et d'imaginer ce que nous pourrions vous demander. Vous représentez un immense patrimoine au service du Parlement.
Je n'ai rien à ajouter à cette magnifique conclusion.
La réunion est close à 13 heures.