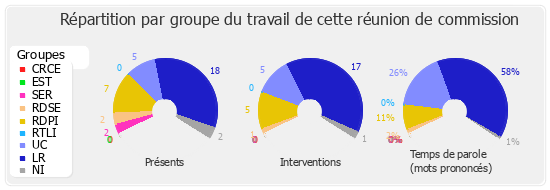Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 21 octobre 2015 à 14h30
Sommaire
- Loi de finances pour 2016
- Compte d'affectation spéciale « financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » - examen du rapport spécial (voir le dossier)
- Mission « engagements financiers de l'état » comptes de concours financiers « accords monétaires internationaux » et « avances à divers services de l'état ou organismes gérant des services publics » et compte d'affectation spéciale « participations de la france au désendettement de la grèce » - examen du rapport spécial (voir le dossier)
La réunion

Je présente pour la deuxième fois le rapport budgétaire sur le compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé). Ce compte, créé en 1936, visait à faire payer à ceux qui avaient l'électricité une taxe pour financer l'électrification du reste de la France. Le législateur aurait dû faire de même il y a quelques années pour le très haut débit.
Les recettes du Facé sont assises sur une contribution due par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, notamment Électricité réseau distribution France (ERDF). En définitive, ce sont les consommateurs qui payent. Le montant de cette contribution s'élèvera à 377 millions d'euros, soit un montant stable depuis 2012. Le taux est recalculé régulièrement, afin de couvrir les crédits prévus sur l'exercice, et il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les clients ruraux payent un peu moins que les urbains.
Les bénéficiaires des aides sont essentiellement les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité (AODE), syndicats d'électrification mais aussi communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le regroupement des syndicats est quasiment achevé. Ces dotations financent les travaux sur les réseaux de distribution d'électricité, avec un taux de prise en charge de 80 % hors taxe ; les dotations sont notamment réparties en fonction des départs mal alimentés (DMA) calculés par EDF.
En 2016, la répartition des crédits sera la même qu'en 2015 : 184 millions d'euros pour le renforcement des réseaux, ce qui a un impact direct sur la qualité de l'électricité distribuée ; 81 millions d'euros pour la sécurisation des réseaux, afin de prévenir les intempéries ; 55,5 millions d'euros pour l'enfouissement, pas uniquement pour des raisons esthétiques car en zone de montagne il y va aussi de la sécurité et de la fiabilité. Enfin, 47 millions d'euros sont destinés à l'extension des réseaux - ce qui est insuffisant pour répondre à la demande. Le renforcement et la sécurisation doivent demeurer prioritaires mais il faut réviser à la hausse la part des travaux d'extension et d'enfouissement, afin d'utiliser tous les crédits disponibles.
Les dysfonctionnements observés en 2014 et 2015 ne doivent plus se reproduire. De très importants retards de paiement ont mis en difficulté nombre de syndicats. Après les problèmes de paiement rencontrés en 2012 - après la réforme du Facé - la situation s'était améliorée en 2013, mais le déménagement du siège en 2014 s'est accompagné du départ de certains agents mis à disposition par ERDF. Il en est résulté de graves problèmes d'organisation. Dans l'Ardèche, la situation s'est améliorée, mais d'autres départements rencontrent encore des problèmes pour percevoir les sommes qui leur sont dues au titre de travaux achevés. Or seulement 10 % des crédits sont débloqués en début de chantier...
Il faudrait peut-être s'orienter vers une gestion en régie du Facé afin de garantir le bon fonctionnement de ce compte spécial et réduire les délais de paiement. Les chefs d'entreprise ardéchois apprécient que les syndicats d'électrification leur donnent du travail.
Je vous propose l'adoption, sans modification, des crédits pour 2016 du compte d'affectation spéciale du Facé - qui est un bel instrument de solidarité et d'aménagement des territoires, sous réserve que son fonctionnement s'améliore. Si tel n'était pas le cas, mon avis serait beaucoup plus réservé l'année prochaine.

Je partage les propos qui viennent d'être tenus. Quel est le surcoût de l'enfouissement par rapport à des travaux sur les réseaux aériens ? La priorité est-elle le remplacement des fils nus par des fils torsadés ou l'enfouissement ?

Les chiffres pour 2016 sont identiques à ceux de 2015, à savoir 55,5 millions d'euros pour l'enfouissement, 39 millions d'euros pour les mises en sécurité, 42 millions d'euros pour le remplacement des fils nus etc. Pour combattre les intempéries, seuls 500 000 euros sont prévus, ce qui est peut-être insuffisant.

Après les élections municipales, les préfets ont pris des arrêtés pour reclasser certaines communes rurales en zones urbaines et inversement. La sécurisation et le renforcement des réseaux sont plus complexes à gérer dans les zones de montagne. Or, compte tenu des densités, des communes rurales de montagne vont passer dans la catégorie urbaine, sans que les caractéristiques des réseaux aient changé. Ne conviendrait-il pas de prendre en compte la loi montagne de 1985 et d'adapter les règlements à la réalité des territoires montagnards ?

La sécurité n'est pas le seul motif de l'enfouissement des lignes : la protection contre les champs magnétiques doit également être prise en compte. Je vous invite à relire mon rapport de juin 2014, sur la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Il traitait, en effet, de cette question.

Je rappelle que le Facé, excellent outil de péréquation et d'aménagement du territoire, a été créé en 1936 par Paul Ramadier, député socialiste de l'Aveyron et alors sous-secrétaire d'État aux mines, à l'électricité et aux combustibles liquides. Il a créé ce fonds car les grandes agglomérations étaient desservies par des régies alors que les campagnes ne l'étaient pas. La taxe, cinq fois supérieure dans les zones urbaines à ce qu'elle était dans le monde rural, a permis d'équiper les campagnes. Comme notre rapporteur spécial, je regrette que ce schéma n'ait pas été repris pour le numérique.
Je ne sais quelle mouche a piqué le ministère ou EDF mais en 2012, le Facé a été déstabilisé, alors qu'il fonctionnait très bien. Je regrette que l'on ne dispose plus des mêmes crédits pour le renforcement et l'extension des réseaux. À l'époque, la fongibilité des crédits nous donnait une plus grande liberté. Je me réjouis de l'accent mis sur la sécurisation des fils nus. Je voterai bien évidemment ce budget.

Merci de nous rappeler régulièrement des morceaux de notre histoire, qui vont de Joseph Caillaux à Paul Ramadier.

Je rappelle régulièrement que le Facé a été créé en 1936 et qu'à l'époque, la solidarité à l'égard du monde rural n'était pas un vain mot. Que nos dirigeants actuels ou futurs en prennent de la graine...
La modification des critères du Facé a pu poser des problèmes, monsieur Bouvard. Dans l'Ardèche, les choses se sont plutôt bien passées avec le préfet mais des communes rurales dont les réseaux étaient parfaits ont été transférées en zone urbaine, et nous avons récupéré des communes précédemment classées urbaines dont les réseaux étaient médiocres. Au total, 700 communes rurales sont passées à l'urbain et 200 communes urbaines sont passées en zone rurale. Certes, il faudrait prendre en compte les spécificités des zones de montagne. Dans ma petite commune où les lignes sont enfouies, nous ne rencontrons plus de problèmes.
Je précise que l'arrêté du 27 mars 2013 prévoit une formule de lissage pour atténuer les variations des droits à subvention d'une année sur l'autre. Les enveloppes des syndicats concernés ne devraient donc pas diminuer brutalement.
Enfin, j'ajoute que la réforme du Facé conduite en 2012 a eu un avantage : celui de donner au Parlement un contrôle sur l'exécution de ce fonds.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification des crédits du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ».
La commission procède ensuite à l'examen du rapport de MM. Bernard Delcros et Daniel Raoul, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Politique des territoires ».

Nous accueillons Mme Annie Guillemot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Et je précise que M. Bernard Delcros est pour la première année rapporteur spécial sur cette mission.

La mission « Politique des territoires » conserve en 2016 un périmètre identique à celui de 2015 avec trois programmes : le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » (Picpat), le programme 162 « Interventions territoriales de l'État » (Pite) et le programme 147 « Politique de la ville », rattaché à cette mission en 2015, et que présentera Daniel Raoul. Pour cette mission, 674 millions d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement, soit une baisse de 2,75 % et 718 millions d'euros en crédits de paiement, soit une baisse de 3,75 %.
Le programme Picpat est doté de 215 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 254 millions d'euros en crédits de paiement, soit une stabilité des premières et une baisse de 4 % des seconds. Il retrace les moyens mis à la disposition du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), issu de la fusion entre la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), le Secrétariat général du comité interministériel des villes et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Les actions prévues pour 2016 s'inscrivent dans la continuité de celles engagées précédemment, comme la prime d'aménagement du territoire (PAT), les pôles d'excellence rurale, les maisons de santé pluridisciplinaires, les maisons de service au public, la revitalisation des centres-bourgs, le plan d'accompagnement du redéploiement des armées ou, encore, les contrats de plan État région (CPER), avec la montée en charge des contrats de nouvelle génération 2015-2020.
Le programme Pite qui relève du Premier ministre et qui est confié à la gestion du ministre de l'intérieur est doté de 22 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 26 millions d'euros en crédits de paiement, soit une baisse respective de 25 % et 22 %. Il correspond à quatre actions interministérielles de portée régionale : la qualité de l'eau en Bretagne, le plan d'investissement en Corse, l'écologie du marais poitevin et le plan en faveur de la Guadeloupe et de la Martinique.
La mission se trouve au coeur de la politique transversale d'aménagement du territoire : les trois programmes ne représentent que 12 % des crédits affectés à cette politique, éclatée en quatorze missions et trente programmes budgétaires. Nous y perdons en lisibilité, en cohérence : il conviendrait d'améliorer la maquette budgétaire. L'année dernière, trois structures avaient été regroupées au sein du CGET et la politique de la ville avait été rattachée à cette mission. Cet effort de rationalisation a fait long feu puisque le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) ou Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) a été remplacé par deux comités interministériels, l'un à l'égalité et à la citoyenneté, qui rappelle le comité interministériel à la ville, et l'autre aux ruralités. Pourquoi ne pas regrouper cette mission avec celle consacrée à l'égalité des territoires et au logement ? Plus généralement, nous souffrons de l'absence de politique contractuelle en faveur de la ruralité. Nous avons su la mettre en place pour la ville, mais en dépit de la création des pôles d'équilibres territoriaux ruraux, la dynamique territoriale fait défaut dans les secteurs ruraux en difficulté. Je présenterai donc demain une proposition de loi afin d'optimiser les crédits disponibles grâce à la contractualisation.
Les vingt-deux dépenses fiscales rattachées au Picpat représentent 442 millions d'euros soit plus que le total des crédits budgétaires : un meilleur ciblage des zones fragiles devrait être possible. Je regrette que nous n'ayons aucune information sur la mise en oeuvre de la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR).
Plusieurs actions sont en voie d'extinction. Il n'est plus possible d'accéder au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) pour réaliser des maisons de santé pluridisciplinaires, pourtant indispensables au maintien d'une offre de soins de premier recours en milieu rural.
Je constate avec satisfaction que le programme 112 intègre les crédits nécessaires à la construction mais aussi au fonctionnement des maisons de services au public, avec 7,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et 7,6 millions d'euros en crédits de paiement. En revanche, je ne trouve pas dans le programme 112 les 300 millions d'euros annoncés pour la deuxième génération des programmes de revitalisation des centres-bourgs et des petites villes, alors que la première génération, qui avait fait l'objet d'un appel à projet, y figurait. Où faut-il chercher ces 300 millions d'euros ?
Dernière observation : les crédits réservés à la politique d'aménagement du territoire diminuent de 10 %, passant de 6 à 5,4 milliards d'euros en 2016. Cela s'ajoute à la diminution des dotations aux collectivités territoriales. C'est pourquoi je vous propose de ne pas adopter les crédits de la mission.

Le programme 147 « Politique de la ville » figure, depuis la loi de finances pour 2015, dans la mission « Politique des territoires » et non plus dans la mission « Égalité des territoires et logement », conséquence de la création du CGET. Je trouve dommage que les problématiques de la politique de la ville, notamment s'agissant de la rénovation urbaine, soient ainsi curieusement déconnectées de celles du logement.
Afin de tenir compte des mesures décidées en mars 2015 par le Comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté, le programme 147 bénéficie d'un budget conforté qui s'appuie sur la nouvelle géographie prioritaire issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, avec 1 500 quartiers prioritaires et 100 zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-territoires entrepreneurs). À cela s'ajoute d'ailleurs l'agence de développement économique France Entrepreneur lancée hier à La Courneuve par le Président de la République.
Les crédits d'intervention de la politique de la ville sont ainsi renforcés, avec 347 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour les actions territorialisées et les dispositifs spécifiques de la politique de la ville relevant de l'action 01 du programme, soit 15 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2015.
L'établissement public d'insertion de la défense (EPIDe) bénéficiera également d'une dotation de fonctionnement majorée de 3,9 millions d'euros, pour atteindre 26 millions d'euros, afin d'augmenter le nombre de places dans cet organisme.
Ainsi, l'ensemble des mesures décidées par le Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté devraient être financées par une enveloppe globale de 55 millions d'euros, selon les annonces du ministère chargé de la ville, dont 18,5 millions d'euros inscrits en loi de finances initiale, le solde devant provenir d'un dégel de crédits en cours d'exercice. Dès 2015, le programme 147 a bénéficié d'un dégel de 31,7 millions d'euros à cette fin.
Globalement, les crédits du programme 147 diminuent de 2,6 % en autorisations d'engagement et de 2,7 % en crédits de paiement, pour atteindre respectivement 437 millions d'euros et 438 millions d'euros. Cette baisse s'explique principalement par la mise en extinction progressive du dispositif d'exonération de charges sociales dans les ZFU, qui n'a pas été une réussite par rapport aux objectifs poursuivis, reconnaissons-le. Il a créé des effets d'aubaine sans améliorer la mixité fonctionnelle que j'appelle de mes voeux.
Les dépenses fiscales rattachées au programme (367 millions d'euros en 2016) ont été redéfinies en loi de finances initiale pour 2015 et dans la seconde loi de finances rectificative pour 2014 : elles visent à assurer, dans les quartiers concernés, une mixité à la fois sociale et fonctionnelle à laquelle je suis particulièrement attaché. Dans les programmes de rénovation urbaine, il est clairement prévu d'attirer les entreprises et les services et pas seulement de construire des logements. L'application de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété a été étendue à l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville alors qu'elle ne visait auparavant que les « quartiers Anru », c'est-à-dire les quartiers couverts par une convention de rénovation urbaine dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (PNRU).
Les crédits de droit commun se monteront pour l'État à 4,2 milliards d'euros de crédits de paiement pour les programmes budgétaires disposant d'une évaluation chiffrée. Leur mobilisation doit désormais se concrétiser localement dans les contrats de ville en cours de signature - au 1er septembre dernier, 73 % d'entre eux étaient signés. De nombreuses mesures en faveur des habitants des quartiers prioritaires, en termes de développement économique et d'emploi, de santé ou de rénovation urbaine sont par ailleurs prévus par le comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté.
Le financement de la rénovation urbaine est intégralement assuré par des crédits extrabudgétaires depuis plusieurs années. Trois conventions ont permis, au cours des derniers mois, de fixer les ressources pour couvrir à la fois la fin du PNRU, dont les engagements s'arrêtent à la fin de cette année, et le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour 2014-2019. La convention pluriannuelle du 2 décembre 2014, conclue entre l'État et Action Logement, a ainsi été doublée par deux conventions conclues par les mêmes protagonistes et l'Anru : l'une du 14 avril 2015, fixant les modalités de financement du PNRU, l'autre signée le 2 octobre pour le NPNRU. Ce dernier disposera de concours financiers à hauteur de 6,4 milliards d'euros, correspondant à 5 milliards d'euros d'équivalents-subventions. Action Logement est le principal « sponsor » de ce programme puisqu'il en financera l'essentiel, avec 3,2 milliards de subventions et 2,2 milliards de prêts bonifiés pour un équivalent subvention de 800 000 euros. Le reste du financement sera assuré par 400 000 euros de la caisse de garantie des logements locatifs sociaux et 600 000 euros de reliquat attendu au titre du PNRU qui proviendront d'ailleurs eux-mêmes largement de la contribution d'Action Logement au titre de ce programme.
Je me félicite que l'équilibre financier du NPNRU soit donc assuré. Il repose toutefois sur l'hypothèse d'un report de 600 millions d'euros du PNRU dont la concrétisation s'avère désormais indispensable. En outre, le niveau de trésorerie dont dispose l'Anru se réduit d'année en année et cette tendance devrait se confirmer pour l'avenir. Pour pallier d'éventuelles difficultés de trésorerie, la convention du 2 octobre prévoit à la fois la possibilité pour Action Logement d'apporter des compléments de trésorerie, pour un montant total de 100 millions d'euros sur la période 2015 à 2019, et un système de préfinancement de 1 milliard d'euros sous forme d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
Tout en se réjouissant que le financement de la rénovation urbaine soit prévu jusqu'en 2019, Action Logement s'étant même engagé à verser, après cette date, 500 millions d'euros jusqu'en 2031, la situation financière de l'Anru reste fragile. Un pilotage fin de la mise en oeuvre des programmes et des capacités financières de l'agence devra donc être assuré. Le directeur que nous avons auditionné est apparu confiant, notamment grâce à l'éventuel recours au prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'adopter les crédits consacrés à la politique de la ville.

Comme l'a dit votre rapporteur spécial, le budget de ce programme 147 s'accroît de plus de 4 %. En outre, je me félicite que les crédits de l'EPIDe, qui porte un programme qui fonctionne bien, augmentent de 17 % afin d'accueillir 1 000 jeunes supplémentaires.
Le financement du NPNRU est assuré avec la contribution d'Action logement et facilité par le prêt de la Caisse des dépôts et consignations. Mais beaucoup de territoires sont en attente et les programmes ne progressent pas assez vite. Or à cela va s'ajouter l'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Comment cela va-t-il toucher nos territoires ?

Il y a quelques années, les maisons de l'emploi avaient suscité l'engouement, avant de tomber dans l'oubli. Les maisons de services au public sont-elles vraiment efficaces ? Je les crois utiles. Mais dispose-t-on d'évaluations ?
Dans la réforme de l'attribution de la PAT, les grands groupes ont été écartés, semble-t-il. Dans ma région, Vallourec et Areva annoncent des plans de réduction des coûts : la politique d'aménagement du territoire sera-t-elle maintenue ?
Enfin, la région Bourgogne a participé à 10 % du financement des programmes de l'Anru dans le cadre du PNRU. Est-ce également prévu pour ce nouveau programme ?

Comme l'a dit Daniel Raoul, il est regrettable d'avoir séparé le programme relatif à la politique de la ville de la mission consacrée au logement. Je déplore l'instabilité du périmètre de ces missions.
Notre rapporteur spécial a évoqué les difficultés de trésorerie que l'Anru pourrait connaître : quels financements pourra-t-on débloquer quand la « bosse » des décaissements maintes fois évoquée se produira ? Quel sera le niveau de trésorerie le plus bas selon les projections ? De débudgétisation en débudgétisation, je regrette que nous soyons contraints d'avoir recours aux avances non seulement de la Caisse des dépôts et consignations mais aussi d'Action Logement après être allé chercher son financement. Il est très dommage de mettre des agences dont le travail est si essentiel dans des situations budgétaires aussi difficiles.

Avec la débudgétisation de l'Anru, la politique de rénovation urbaine n'est plus financée par la solidarité nationale : désormais, c'est Action Logement qui est mise à contribution, ainsi que, ce qui est peut être encore plus étonnant, la Caisse de garantie du logement locatif social - les cotisations de cette caisse ont augmenté de 47 % en trois ans. Ce sont finalement les loyers des plus modestes d'entre nous qui financent l'Anru : quel paradoxe !

Loin d'opposer le rural à l'urbain, l'aménagement du territoire se doit de rapprocher ces deux mondes. C'est pourquoi je regrette que les crédits de cette mission diminuent. La lisibilité des programmes n'est pas non plus optimale...

Notre collègue Daniel Raoul écrit dans son rapport que « le budget est conforté, malgré une baisse optique des crédits ». Parallèlement, Bernard Delcros a relevé que, globalement, les crédits consacrés à l'aménagement du territoire reculent de 6 à 5,4 milliards d'euros. S'agit-il d'une baisse optique ou réelle ? Que pensent les représentants du ministère de cette réduction ?

Quelles sont les prévisions de trésorerie de l'Anru ? Il serait dommage pour les quartiers que les programmes de l'Anru ralentissent. Il n'est pas acceptable de prévoir une recette temporaire de 1 milliard d'euros fournie par la Caisse des dépôts et consignations, pour financer des dépenses structurelles et structurantes. L'Anru est stratégique pour les quartiers les plus fragiles de notre pays.

Vous proposez le rejet des crédits, mais quelles sont vos propositions ? Il existe vingt-deux dépenses fiscales pour un total de 442 millions d'euros, montant nettement supérieur aux crédits budgétaires et vous proposez de les recentrer. Lesquelles connaissent une progression dynamique ? Lesquelles voulez-vous supprimer, et sur quels territoires ?

Je rejoins les conclusions de Bernard Delcros : la politique de l'aménagement du territoire est dispersée, peu visible et le décalage est important entre l'ambition affichée et les moyens : que dire ainsi des 6 millions d'euros pour la revitalisation des centres-bourgs ou des 2 millions d'euros pour les maisons de santé ?

Je partage les propos de Jean-Claude Boulard sur le financement de la politique de renouvellement urbain. Je m'inquiète pour les quartiers classés d'intérêt régional et surtout pour ceux mis en veille, alors qu'ils auraient grand besoin d'être aidés. Dans une ville qui s'est efforcée de disperser son parc social sur tout son territoire, plus aucun site n'est éligible à la rénovation.
Pour les contrats de ville, vous dites que les crédits de droit commun y seront mobilisés, mais cela semble un peu difficile... Nous venons de signer un contrat de ville dans mon agglomération : les collectivités mettent de plus en plus la main à la poche tandis que l'apport de l'État est modeste.

L'an dernier, le Gouvernement nous avait promis la révision de la carte des ZRR. Or nous ne voyons rien venir et ne savons toujours pas quels seront les critères retenus.
Dans les commissariats de massif de montagne, les crédits manquent, les moyens humains également, plusieurs postes restent vacants, alors que nous allons devoir mettre en oeuvre le volet montagne des contrats de plan État-région mais aussi les programmes de coopération européens.
La situation actuelle n'est pas récente : en 2012, on demandait déjà à la Caisse des dépôts et consignations de verser 200 millions d'euros à l'Anru, alors que rien de ce type n'était prévu dans la convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'agence. La Cour des comptes a rendu un rapport en 2014 sur l'Anru, observant des ressources moins diversifiées et plus fragiles qu'à l'époque de sa création. En outre, la Cour des comptes soulignait son niveau de dépendance à Action Logement. N'ayant pas mené les réformes de fond et l'indispensable « opération vérité » sur les comptes de l'Anru, nous voyons se profiler l'impasse de trésorerie, malgré le prêt relais de la Caisse des dépôts et consignations. Nous dépensons par anticipation de l'argent gagé sur des recettes futures qui sont d'ailleurs liées à l'évolution de la masse salariale des entreprises qui cotisent à Action logement... Ce n'est pas satisfaisant. Et ce n'est pas ainsi que nous financerons les dépenses sur une longue durée. Nous devons lancer « l'opération vérité » que les gouvernements repoussent depuis des années. Sinon, nous connaîtrons une impasse de trésorerie - et une difficulté à rembourser le prêt le moment venu.

Les maisons de services sont particulièrement utiles à la réorganisation des territoires ruraux. Il reste bien difficile de les faire vivre et de les animer. Dans mon territoire de 6 000 habitants et treize communes, nous avons trente-cinq maisons de services, les premières ouvertes il y a dix ans. On recense 1 800 visites avec autant de prestations d'accompagnement. Si le dispositif fonctionne bien, c'est au prix d'un gros travail pour faire vivre les maisons de service. Le comité interministériel a décidé d'attribuer une partie des financements à leur fonctionnement. C'est une bonne décision.
Quant à la prime d'aménagement du territoire, elle a été modifiée après la mise en place du nouveau zonage des aides à finalité régionale (AFR), pour tenir compte des réglementations européennes et du recentrage des aides aux petites entreprises. Les crédits ont diminué de 30 à 25 millions d'euros. En théorie, les primes devraient courir jusqu'en 2020.
Je croyais naïvement que la politique des territoires couvrait l'essentiel des mesures prises en matière d'aménagement du territoire. Ce n'est pas le cas. D'où l'intérêt d'avoir créé l'an dernier le CGET et d'avoir rattaché ensemble politique de la ville et politique des territoires. On recense trente programmes et quatorze missions. On gagnerait en efficacité à tout regrouper dans une seule grande mission d'aménagement du territoire.
La baisse des crédits est réelle : sur les quatorze missions, on est passé de 6 milliards d'euros en 2015 à 5,4 en 2016, même en intégrant le milliard annoncé par le Comité ministériel à la ruralité. Sur les 440 millions d'euros que coûtent les niches fiscales, plus de 200 millions d'euros sont des avantages fiscaux en Corse, et 120 millions d'euros sont liés aux ZRR.
Le zonage actuel ne correspond plus à la réalité des territoires et devrait être recentré sur les plus fragiles d'entre eux qui souffrent déjà de la baisse des dotations de l'État. La réforme des ZRR est engagée ; le mécanisme s'adresse désormais aux intercommunalités et non plus aux communes. Les nouvelles intercommunalités devront selon moi être sollicitées. Comment, en effet, fonder un zonage ZRR sur des intercommunalités destinées à changer dans un an ? Il faudrait avoir un peu plus de visibilité en termes de calendrier. Les critères pourraient être recentrés sur la densité de population et le revenu par habitant.
Enfin, en ce qui concerne les moyens donnés aux commissariats de massif, je peux préciser que le CGET perd globalement neuf emplois en 2016.

En réponse à Annie Guillemot, le prêt de 1 milliard d'euros devrait justement permettre d'avancer le lancement du nouveau programme, en particulier pour certaines opérations de démolitions-reconstructions.

Nous regarderons cette question du recyclage. Monsieur Dallier, il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de bosse de décaissement, contrairement à ce qu'on imaginait, elle a été lissée sur plusieurs années pour le PNRU. Les 600 millions d'euros ne seront pas forcément décaissés et seront utilisés pour le NPNRU. Certains programmes ont été abandonnés... malgré parfois des avances versées. Nous en saurons plus à la fin de l'année. La trésorerie devrait être positive de plus de 100 millions d'euros. Monsieur Boulard, on peut discuter à l'infini sur l'avantage d'une convention avec un principal sponsor. L'Anru ne sert que de boîte aux lettres lorsque ses programmes sont alimentés par des crédits d'Action Logement qui sont redistribués en prêts. En tout état de cause, une convention tripartite donne plus de visibilité que des crédits budgétaires attribués tous les ans.
Pour répondre à François Patriat, on attend un effet de levier de un à quatre sur l'Anru. C'est effectivement un appel à la participation des collectivités territoriales. Madame Keller, le financement de la trésorerie est assuré par la convention tripartite signée le 2 octobre dernier. La seule difficulté reste de savoir si les 600 millions d'euros seront bien disponibles. Madame Beaufils, les crédits de droit commun avaient tendance à diminuer, notamment dans les zones urbaines sensibles (ZUS). Les ministères étaient ainsi tentés de baisser leurs dotations, sachant que la politique de la ville intervenait. Désormais, les crédits de droit commun doivent être effectivement inscrits dans les contrats de ville et des conventions interministérielles ont été conclues. Enfin, Monsieur Doligé, la politique de la ville a bénéficié d'une augmentation de crédits de 4,6 % pour les actions territorialisées, et la baisse globale du programme est principalement due à la fin des exonérations de charges sociales dans les ZFU. Tout cela est indiqué dans le rapport.

On m'informe que le CGET vient de demander officiellement au Gouvernement d'affecter 300 millions d'euros, sur le milliard d'euros consacré à la ruralité, au programme 112 de notre mission.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat de ne pas adopter les crédits de la mission « Politique des territoires ».
Puis la commission examine le rapport de MM. Nuihau Laurey et Georges Patient, rapporteurs spéciaux sur la mission « Outre-mer ».

Nous examinons à présent le rapport sur les crédits de la mission « Outre-mer », qui est le premier pour notre collègue Nuihau Laurey.

La mission « Outre-mer » concerne douze territoires situés dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans la mer des Caraïbes, dans l'océan indien et en Amérique du Sud. Cette présence constitue un héritage de l'histoire. Elle est aussi un atout en termes de rayonnement extérieur de la France, qui dispose de la seconde zone économique exclusive derrière les États-Unis.
Pourtant, leur éloignement, leur éclatement géographique, leurs faibles populations disséminées sur de nombreuses îles ou archipels, le caractère limité de leurs marchés locaux, l'obligation de multiplier des équipements coûteux pour assurer les services publics minimums et l'impossibilité de mutualiser les coûts rendent les conditions de vie plus difficiles dans ces territoires. Le développement économique et social varie d'un territoire à l'autre, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6 500 euros pour Mayotte et 28 300 euros pour Saint-Pierre-et-Miquelon contre 31 400 euros en moyenne nationale. En outre, notre pays est classé à la vingtième position en termes de développement humain, le dernier département d'outre-mer se situe à la 104e place.
Le budget alloué à la mission « Outre-mer » est un budget d'intervention qui vise à combler ces handicaps. Pour l'exercice 2016, les autorisations d'engagement diminueront de 3,1 %, alors que les crédits de paiement progresseront de 0,3 %. Le programme 138 « Emploi outre-mer », qui mobilise les deux-tiers des crédits de la mission, verra ses autorisations d'engagement diminuer de 2,2 % et ses crédits de paiement de 1,3 %. Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui représente un tiers des dépenses de la mission, verra ses crédits de paiement progresser de 2,7 %.
Permettez-moi de vous présenter les principales évolutions prévues dans le cadre du projet de loi de finances 2016.
Tout d'abord, la réforme du dispositif des exonérations de charges sociales sera poursuivie, après une première réforme intervenue en 2014 visant à recentrer ce dispositif sur les bas salaires.
Par ailleurs, si le plan logement outre-mer 2015-2020 prévoit la construction ou la réhabilitation de 10 000 logements par an, une diminution des crédits de paiement consacrés à la ligne budgétaire unique (LBU). Cette baisse ne permettra pas d'apurer la dette importante vis-à-vis des bailleurs sociaux.
Les crédits dévolus aux nouveaux contrats de plan État-région ou aux nouveaux contrats de projets ou de développement pour les collectivités d'outre-mer s'élèveront à 137 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une quasi stabilisation par rapport à 2015, et à 161 millions d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation de près de 4 % en 2016.
Les crédits en faveur de la cohésion sociale augmenteront de 12 millions d'euros du fait de la participation temporaire de l'État au financement du régime de solidarité de la Polynésie française.
Enfin, l'objectif fixé par le président de la République de doter le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) de 500 millions d'euros d'ici 2017 ne pourra pas être atteint. Au mois de septembre dernier, nous avons effectué avec Georges Patient un contrôle budgétaire à La Réunion qui nous a convaincus de l'utilité de ce dispositif, dont l'effet de levier est considérable.
La défiscalisation constitue le principal levier d'investissement en faveur du développement économique des outre-mer, avec une dépense fiscale de 3,8 milliards d'euros, en légère hausse par rapport à 2015. Le choix du Gouvernement d'aménager le terme des différents dispositifs de défiscalisation a fait l'objet de multiples critiques. Les acteurs économiques auraient préféré une prorogation, ce qui aurait favorisé l'investissement privé indispensable à la création d'emplois. Nous avons cependant pris bonne note de la volonté du Gouvernement de lancer dès le premier semestre 2016 une réflexion sur les modalités de maintien et de réforme de ces dispositifs après 2017.
Je rappelle que la défiscalisation constitue un levier important pour l'investissement privé outre-mer, comme l'ont souligné nos collègues Éric Doligé et Serge Larcher dans un rapport de 2013.
En conclusion, compte tenu des engagements du Gouvernement concernant la prorogation des dispositifs de défiscalisation, le maintien de certaines dotations aux collectivités, je pense notamment à la dotation globale d'autonomie en Polynésie, et surtout de la relative stabilité des crédits dans un contexte budgétaire contraint, je vous propose l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer ».

Les crédits de la mission « Outre-mer » ont un impact sur le quotidien de plus de trois millions d'ultramarins. Les écarts se creusent avec la métropole. Le PIB par habitant outre-mer est inférieur de plus de 40 % à celui de l'hexagone, le taux de chômage atteint plus de 50 % chez les jeunes, le taux de pauvreté est trois fois plus élevé qu'en métropole, sans parler de l'augmentation de la mortalité infantile et des retards en matière d'éducation.
Ainsi, le budget qui nous est présenté demeure très en deçà des besoins. En 2016, la mission « Outre-mer » sera dotée de 2,08 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 2,06 milliards en crédits de paiement. Elle participera donc de manière substantielle à l'effort de maîtrise des dépenses publiques, puisque le montant des crédits de paiement sera inférieur de 44 millions d'euros au plafond triennal fixé pour 2016 par la loi de programmation des finances publiques.
Les économies résulteront pour l'essentiel d'une nouvelle réforme des exonérations de charges. Dans un contexte de persistance d'un fort taux de chômage outre-mer, cette réforme ne me semble pas pertinente. Si cette mesure devrait être compensée par la montée en charge des dispositifs prévus dans le cadre du pacte de stabilité et de sa déclinaison pour l'outre-mer, il me semble que le choix de la stabilité aurait été préférable.
L'objectif de 10 000 logements construits ou réhabilités par an est louable, mais on peine à voir quelle en sera la traduction budgétaire pour 2016. À cela s'ajoute la question de la répartition entre les collectivités : on constate des sous-consommations dans certains territoires et de grandes tensions dans d'autres...
Je regrette également la baisse des dotations spécifiques qui financent des investissements importants en matière d'infrastructures scolaires en Guyane et à Mayotte, et sont indispensables pour le fonctionnement de la collectivité de Polynésie.
Cependant, on ne peut que se féliciter de la stabilisation des crédits de paiement consacrés au service militaire adapté (SMA), dont les résultats sont extrêmement positifs en matière d'insertion professionnelle. 6 000 volontaires seront ainsi accueillis d'ici la fin de l'année 2017.
Par ailleurs, la stabilisation des autorisations d'engagement et l'augmentation des crédits de paiement devraient accompagner la montée en puissance d'une nouvelle « génération » de contrats.
Enfin, les moyens de la formation en mobilité sont en augmentation, ce qui élargira l'accès des étudiants et des salariés ultramarins à des formations qui ne sont pas dispensées dans leur territoire.
Sans être suffisant, ce budget préserve donc l'essentiel. Par conséquent, je vous propose d'adopter les crédits de la mission « Outre-mer » sans modification.

Les restes à payer sont énormes : 1,64 milliard d'euros à la fin 2014. Avez-vous pu les analyser ? Sur quoi portent-ils ?

Ils résultent d'impayés au titre d'opérations réalisées dans le cadre de la ligne budgétaire unique et des opérations contractuelles. Il existe également une « dette » vis-à-vis des organismes de logement social.

Des dépenses de fonctionnement ou des engagements sur des investissements ?

Nous avons prévu de faire porter notre prochain contrôle sur ces différentes questions qui méritent en effet d'être approfondies.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification des crédits de la mission « Outre-mer ».
Loi de finances pour 2016
Mission « engagements financiers de l'état » comptes de concours financiers « accords monétaires internationaux » et « avances à divers services de l'état ou organismes gérant des services publics » et compte d'affectation spéciale « participations de la france au désendettement de la grèce » - examen du rapport spécial
La commission procède enfin à l'examen du rapport de M. Serge Dassault, rapporteur spécial, sur la mission « Engagements financiers de l'État », les comptes de concours financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » et le compte d'affectation spéciale « Participations de la France au désendettement de la Grèce ».

En tant que rapporteur de la mission « Engagements financiers de l'État », je vous ferai brièvement part de mes observations sur la situation de nos finances publiques avant de vous exposer un certain nombre de pistes qui permettraient, selon moi, de contribuer à une véritable amélioration de notre situation économique et budgétaire.
Le Gouvernement prévoit une croissance de 1,1 % pour 2015 et de 1,6 % pour 2016. Si le Haut Conseil des finances publiques estime, dans son avis rendu le 30 septembre, que l'objectif du Gouvernement est crédible pour 2015, il considère en revanche, je le cite, que « compte tenu de l'accroissement des incertitudes depuis l'été, l'hypothèse d'une croissance de 1,5 % en 2016 ne peut plus être qualifiée de « prudente » ».
S'il l'estime néanmoins « atteignable », ce n'est pas grâce à la politique économique du Gouvernement, mais bien en raison d'un alignement des astres particulièrement favorable : baisse du prix du pétrole, euro faible, politique monétaire exceptionnellement accommodante.
En dépit de tous ces facteurs exogènes positifs, je pense pour ma part que le chiffre de 1,5 % de croissance demeure encore trop optimiste, tant notre économie peine à sortir de sa léthargie. Le contexte international pourrait en outre s'avérer moins porteur que prévu, avec le ralentissement économique des grands pays émergents, en particulier la Chine.
Le 18 septembre 2015, l'agence de notation Moody's a d'ailleurs procédé à une nouvelle dégradation de la note de la dette française, qui est passée de « Aa1 » avec perspective « négative » à « Aa2 » avec perspective « stable ». Elle s'est ainsi alignée sur les autres agences qui avaient dégradé la France au dernier trimestre 2014.
Pour justifier sa décision, l'agence a invoqué « la faiblesse continue » des perspectives de croissance française, faiblesse qui selon elle « devrait perdurer jusqu'à la fin de la décennie » et empêcher toute « réduction significative du fardeau de la dette ».
Cette anémie, selon l'agence, est principalement due aux « contraintes institutionnelles et politiques », ainsi qu'à la « rigidité du marché du travail », en grande partie responsable d'un taux de chômage élevé. Les chefs d'entreprise, sachant qu'ils ne pourront licencier, n'embauchent pas : je le sais bien, moi qui suis chef d'entreprise ! Il n'y a rien à espérer tant que la flexibilité de l'emploi, qui donne de bons résultats aux États-Unis, ne sera pas mise en place chez nous.
En maintenant dans le même temps toute leur confiance à l'Allemagne, qui bénéficie auprès de chacune d'entre elles de la note AAA, les agences de notation ont clairement marqué tout l'écart qui sépare aux yeux des investisseurs un pays capable de dégager un excédent budgétaire d'un pays incapable de s'attaquer sérieusement au redressement de ses finances publiques.
J'en viens au budget 2016 proprement dit.
À la fin août 2015, l'encours de la dette négociable de l'État s'élevait à 1 574 milliards d'euros en valeur actualisée. Selon le projet annuel de performances pour 2016, l'encours de la dette de l'État passera l'an prochain de 1 584 à 1 647 milliards, soit une augmentation de 3,9 %. Certes, la progression de l'encours ralentit par rapport au paroxysme de la crise économique et financière de 2008-2009. Cependant, entre la fin 2008 et la fin 2016, celui-ci aura augmenté de 630,5 milliards d'euros : 62 % !
À la fin août 2015, l'encours de la dette négociable de l'État s'élevait à 1 574,1 milliards d'euros en valeur actualisée. Selon le projet annuel de performances pour 2016, l'encours de la dette de l'État passera de 1 584,6 milliards d'euros fin 2015 à 1 647,1 milliards d'euros fin 2016, soit une augmentation de 3,9 %.
Certes, la progression de l'encours de la dette nominale ralentit par rapport au paroxysme de la crise économique et financière de 2008-2009.
Toutefois, je tiens à souligner qu'entre la fin 2008 et la fin 2016, l'encours de la dette de l'État devrait avoir augmenté de 630,5 milliards d'euros, soit une très forte hausse de 62 %.
Alors qu'il devrait s'attaquer frontalement à ce problème en réduisant massivement les dépenses publiques, le Gouvernement se limite à freiner leur croissance tendancielle, se résignant à maintenir un déficit quasiment inchangé en 2016 (72 milliards d'euros) par rapport à 2015 (73 milliards d'euros).
Notre besoin de financement atteindra 200,2 milliards d'euros, soit 4,3 % de plus qu'en 2015. Ce montant correspond au déficit budgétaire, soit 73 milliards d'euros, et au refinancement de 127 milliards d'euros de dette arrivant à échéance en 2016. Le besoin de financement sera couvert par un emprunt de 187 milliards d'euros. Le solde sera financé par 10,7 milliards d'euros de disponibilités du Trésor et 2 milliards d'euros de recettes de cession de participations de l'État.
La charge de la dette, qui représente 99 % des crédits de la mission que je vous présente aujourd'hui, pèsera une nouvelle fois très lourd dans le budget de notre pays, avec 44,5 milliards d'euros, soit 11,6 % des dépenses de l'État en 2016, en hausse de 2,1 milliards d'euros par rapport à 2015.
Elle constituera en termes de crédits de paiement le deuxième poste budgétaire de l'État après la mission « Enseignement scolaire », dotée de 48 milliards d'euros mais très loin devant la mission « Défense » (31,7 milliards d'euros) ou bien encore la mission « Recherche et l'enseignement supérieur » (25,9 milliards d'euros), qui constituent pourtant des priorités pour garantir, respectivement, notre sécurité et l'amélioration du taux de croissance potentielle de notre pays.
Les taux des obligations françaises sont restés historiquement bas en 2015, à court comme à moyen et long termes, ce qui a une nouvelle fois rendu indolore l'augmentation de l'encours de la dette de l'État.
Ce phénomène a été amplifié par l'annonce le 22 janvier 2015 puis par le lancement effectif le 9 mars 2015, par la Banque centrale européenne (BCE) de sa politique d'achats d'actifs du secteur public (Public Sector Purchase Programme) qui a conduit l'Eurosystème à acheter 60 milliards d'euros d'actifs d'États de la zone euro par mois dans le but d'amplifier la diminution des taux d'intérêt de long terme pour stimuler la croissance.
Cette situation exceptionnelle ne devrait plus durer longtemps. L'Agence France Trésor, dont j'ai entendu le directeur général, prévoit que les taux à 10 ans vont augmenter progressivement dans les mois qui viennent et pourraient atteindre 1,4 % fin 2015 puis 2,4 % fin 2016, en lien avec l'amélioration de la conjoncture économique.
En outre, une hausse imprévue de 100 points de base des taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe de la dette française provoquerait dès 2016 un alourdissement de la charge de la dette de 2,1 milliards d'euros, puis 4,8 milliards d'euros en 2017, 6,9 milliards d'euros en 2018, etc.
Le risque d'une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt doit donc être pris au sérieux par le Gouvernement et conduire ce dernier à enfin adopter des mesures crédibles de réduction des dépenses de l'État, à même de rassurer les investisseurs et de restaurer notre crédibilité budgétaire.
Je vais vous faire maintenant quelques propositions dans ce sens.
D'abord, l'État devrait se doter de règles de bonne gestion budgétaire - autrement dit, appliquer la règle d'or, qui obligerait à présenter des budgets équilibrés. Il faudrait préparer les budgets avec une croissance prévisionnelle voisine de 0 %, ne réservant que de bonnes surprises. Il serait également bon de plafonner la dette, si possible via la Constitution, et d'éliminer drastiquement tous les dispositifs prévus dans le cadre du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et du Pacte de responsabilité, qui ne sont pas financés. Il faudrait réaliser de véritables économies sur les dépenses sociales, en supprimant par exemple l'Aide médicale d'État aux étrangers ou le RSA, qui risquent d'exploser avec l'afflux des migrants sur notre territoire.
Le Gouvernement devrait aussi arrêter de fabriquer des fonctionnaires à vie, en embauchant des personnes que l'État devra ensuite payer pendant soixante ans ! Mieux vaudrait les embaucher pour quinze ans, puis les reconduire dans leur poste si l'on a besoin d'eux. De même les fonctions publiques territoriale et hospitalière se retrouvent en difficultés pour financer les agents depuis que les dotations sont en baisse. Appliquons la règle du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite !
Il est urgent de mener une vraie politique de croissance en réduisant les impôts des entreprises et des entrepreneurs. En taxant les riches, on fait fuir les investisseurs. Nous les jetons dehors !

Les jeunes, eux aussi, s'en vont. Ne restent que les fonctionnaires, les chômeurs et les retraités.
Il faudrait aussi supprimer les 35 heures qui paralysent notre économie, car elles coûtent 21 milliards d'euros à l'État sur un budget de 35 milliards d'euros consacré aux politiques de l'emploi.

Enfin, on ne pourra pas équilibrer notre budget sans réformer notre système d'imposition en remplaçant l'impôt sur le revenu à taux progressif par un impôt proportionnel à taux fixe, payé par tous les contribuables, c'est-à-dire une Flat tax.
Ces réformes ne sont ni de droite, ni de gauche, ce sont des réformes de bon sens dans l'intérêt de la France.
Je vous propose cependant d'adopter les crédits de cette mission, car la France doit respecter ses engagements à l'égard de ses créanciers.
Mission « engagements financiers de l'état » comptes de concours financiers « accords monétaires internationaux » et « avances à divers services de l'état ou organismes gérant des services publics » et compte d'affectation spéciale « participations de la france au désendettement de la grèce » - examen du rapport spécial

J'ai lu dans votre note de présentation que la direction générale du Trésor et la direction du budget avaient modifié certaines de leurs procédures pour tenir compte des recommandations formulées par notre ancien rapporteur spécial Jean-Claude Frécon dans son rapport de contrôle du compte de concours financiers « Avances aux services de l'État et aux organismes gérant des services publics » publié en 2014. Qu'en est-il exactement ?
Mission « engagements financiers de l'état » comptes de concours financiers « accords monétaires internationaux » et « avances à divers services de l'état ou organismes gérant des services publics » et compte d'affectation spéciale « participations de la france au désendettement de la grèce » - examen du rapport spécial

Vous annoncez une augmentation de la charge de la dette de 2,1 milliards en 2016. Pourtant, dans le document, on parle d'une charge de la dette de 44,5 milliards en 2016 contre 44,3 milliards l'an dernier, soit une augmentation de 200 millions.
J'avais déjà demandé un travail spécifique sur l'évolution de la dette, qui prenne en compte le déficit budgétaire de l'État, mais aussi d'autres éléments, comme la dotation au Mécanisme européen de stabilité. Un tableau d'ensemble année par année serait très utile.

La dette n'est pas nouvelle. Elle court depuis trente ou trente-cinq ans. C'est une dérive de long terme. Le plafond de la dette, en revanche, est une notion nouvelle. Dans certains pays, le Gouvernement a besoin de l'accord du Parlement pour dépasser ce plafond, comme aux États-Unis où le Congrès s'est réuni à trois reprises ces dernières années pour examiner une telle demande. La règle d'or dont on parlait tant au début du mandat présidentiel a disparu du débat politique. Comment faire pour fixer un plafond de la dette ? Faut-il qu'il corresponde à un pourcentage du PIB ? Notre ancien rapporteur général disait que la dette publique avait atteint un niveau insoutenable lorsqu'elle était à 80 % du PIB. On est désormais presque à 100 %.

Dans un tableau que présente votre rapport, je lis que 100 millions d'euros sont inscrits au projet de loi de finances 2016 au titre du programme 344 « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats structurés à risque ». Pourquoi ces crédits ont-ils doublé par rapport à l'année 2015 ?

Je lisais dans votre rapport que la dette de l'État était détenue à 64 % par des non-résidents. Quelle est la part, dans cette catégorie, des fonds souverains et celle des fonds privés ?

Petite précision : le plafond de la variation nette appréciée en fin d'année de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d'euros, ainsi qu'il est inscrit dans l'article d'équilibre qui est soumis à notre vote.

Notre collègue Jean-Claude Frécon avait formulé dans son rapport deux recommandations destinées à améliorer la procédure d'octroi et de remboursement des avances du Trésor dans le cadre de ce compte de concours financiers.
Sa première recommandation portait sur la définition d'une doctrine d'octroi des avances. Cette doctrine a été déterminée par une circulaire commune de la direction générale du Trésor et de la direction du budget qui insiste notamment sur le caractère limitatif des crédits du compte de concours financiers, précise le taux dont sont assorties les avances et analyse leur procédure d'octroi.
La seconde recommandation portait sur l'amélioration du suivi de la gestion des avances du Trésor et proposait de renforcer le rôle de l'agence. Jusqu'ici l'AFT participait à l'instruction de toute nouvelle demande d'avance mais n'était pas consultée en cas de modification dans l'exécution de l'avance (notamment de modification de l'échéancier de remboursement) ; la circulaire du 27 juillet 2015 prévoit qu'elle sera désormais systématiquement consultée et que « toute modification du plan de remboursement initial doit être exceptionnelle et donner lieu à une saisine conjointe de l'AFT et de la direction du budget. »
Le plafond de la dette qui existe aux États-Unis est très sérieux : M. Obama a dû demander au Congrès l'autorisation de le dépasser. Là-bas, quelqu'un contrôle... quant à nous, nous augmentons l'encours de notre dette de 60 à 80 milliards par an et personne ne s'en soucie ! Nous devrions instituer un plafond à 1 800 ou 1 900 milliards et nous y tenir. Sinon, jamais nous ne parviendrons pas à un déficit de 2,7 % du PIB en 2017...

Le Gouvernement fait continuellement des fausses promesses. Il faudrait quelque chose qui l'engage, si possible inscrit dans la Constitution, sans quoi nous arriverons un jour à 3 000 milliards de dette !
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Engagements financiers de l'État ».
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits des comptes de concours financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » ainsi que du compte d'affectation spéciale « Participations de la France au désendettement de la Grèce ».
La réunion est levée à 16 h 40.
La réunion est ouverte à 14h 30.