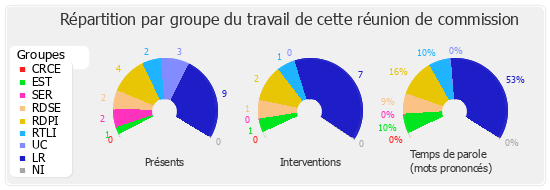Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 23 novembre 2016 à 17h00
Sommaire
La réunion
Audition de Mme Ségolène Royal ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le climat
Audition de Mme Ségolène Royal ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le climat

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour faire le point sur la mise en oeuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Promulguée le 17 août 2015, essentielle pour le respect de nos engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris, cette loi avait mobilisé nos deux commissions et leurs rapporteurs - Louis Nègre pour le développement durable, Ladislas Poniatowski pour les affaires économiques - pendant de longs mois au premier semestre 2015.
Dix-huit mois plus tard, il nous paraît indispensable de pouvoir faire un premier bilan de son application.
Le président Jean-Claude Lenoir vous parlera, je n'en doute pas, de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), enfin publiée, et de ses vicissitudes... Pour notre commission, Louis Nègre vous interrogera sur la mobilité et les transports. En ce qui me concerne, je voudrais m'arrêter sur deux ou trois sujets qui me paraissent particulièrement importants.
La loi a fixé des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique, que ce soit pour le développement des énergies renouvelables (32 % dans le mix énergétique à horizon 2030), la réduction de la consommation énergétique (de 50 % à horizon 2050) ou encore la réduction et le retraitement des déchets.
Nous les avons pour la plupart acceptés et votés. Les collectivités, déjà très investies, sont prêtes à s'engager dans cette transition, qu'elles savent source de richesses et d'emplois. Cependant, comment peuvent-elles le faire sans moyens financiers ou sans retour d'une part de fiscalité écologique qui pourrait être fléchée vers leurs actions ?
Deux échelons territoriaux seront en première ligne : les régions qui vont devoir élaborer les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui doivent mettre en place les plans climat air énergie territoriaux (PCAET).
On a évalué que si la rédaction d'un tel document de planification reviendra pour les collectivités à environ 1 euro par habitant, sa mise en oeuvre effective sur le territoire pourrait coûter entre 100 et 200 euros par habitant. Où trouver ces sommes, alors même que les EPCI à fiscalité propre ont vu leurs dotations se réduire au cours des dernières années ?
Le Fonds territoires à énergie positive permet certes à certains territoires de bénéficier d'une aide spécifique. Mais il s'agit bien souvent - et tant mieux ! - de territoires déjà engagés dans une démarche de transition. Qu'en sera-t-il pour tous les autres, ceux qui, moins avancés aujourd'hui, voudront néanmoins s'engager ? Et quelle garantie de pérennité pour cette aide ?
Autre exemple de financement insuffisant : le Fonds chaleur. Depuis 2014, vous nous annoncez, madame la ministre, son doublement. Or, ce n'est toujours pas le cas, il reste plafonné à un peu plus de 200 millions d'euros par an.
Pourtant, ce fonds a prouvé son efficacité : entre 2009 et 2015, il a permis de financer 3 600 installations et 1 700 km de réseaux de chaleur, soit 4,7 milliards d'investissement pour un peu plus d'1 milliard apporté. Et ces réseaux ont le grand avantage de distribuer près de 50 % d'énergies renouvelables. Ils sont donc un excellent outil pour mettre concrètement en place la transition énergétique. Nous regrettons que l'augmentation annoncée n'ait pas eu lieu.
Un dernier exemple de notre déception : la réforme de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) contenue dans le projet de loi de finances rectificative présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Elle nous semble avoir essentiellement pour objectif d'apporter des recettes au budget de l'État plutôt que de chercher réellement à améliorer la gestion des déchets par les collectivités.
Un cycle se termine avec la fin de la présidence française de la COP. Vous avez joué un rôle majeur pour obtenir la ratification de l'Accord de Paris, dans un délai très court. Nous souhaitons que la dynamique engagée perdure au-delà de la COP22 à Marrakech. Le rôle de la France est essentiel. Il y a une obligation morale à ce que l'État accompagne les collectivités locales qui sont en première ligne dans la mise en oeuvre de cette transition énergétique.

Comme vous vous en souvenez, lors de l'examen de la loi de transition énergétique, le Sénat avait plaidé pour un mix électrique résolument décarboné assis sur ses deux pieds, le nucléaire et les énergies renouvelables - que nous avions défendus, n'en déplaise à certains, tout aussi résolument l'un que l'autre. Je rappelle que c'est à l'initiative du Sénat qu'avait été introduit le principe d'un relèvement progressif de la taxe carbone sur les énergies fossiles, le tout en parfaite cohérence avec notre vision d'une société décarbonée et l'objectif, partagé, de lutte contre le changement climatique.
Or, certaines décisions du Gouvernement en la matière, passées ou à venir, nous interpellent. Ainsi, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), censée décliner opérationnellement les objectifs de la loi, fait-elle largement l'impasse sur le nucléaire, puisque l'essentiel des décisions à prendre est renvoyé à l'après-2019... Nous comprenons d'autant mieux vos difficultés que nous avions nous-mêmes présenté comme inatteignable l'objectif des 50 % d'électricité nucléaire à l'horizon 2025...
Ce qui m'amène à la question de la fermeture de la centrale de Fessenheim, la seule à être mentionnée spécifiquement dans la PPE et dont nous découvrons, au détour d'une page du projet de loi de finances rectificative pour 2016 que le Gouvernement propose d'ouvrir 446 millions d'euros sur le programme « Service public de l'énergie » - sans d'ailleurs aucun rapport avec son objet premier, qui est de financer la péréquation tarifaire et les tarifs sociaux - pour, et je cite la seule phrase d'explication, « assurer l'engagement du protocole relatif à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ». Pouvez-vous nous en dire plus ? En particulier, ce montant correspondrait-il à la seule part fixe de l'indemnité ou inclurait-il tout ou partie de la part variable fonction de l'évolution des prix de marché de l'électricité ? Comment seraient financés ces 446 millions d'euros et pourquoi faudrait-il les inscrire dès 2016 alors que la fermeture ne devrait intervenir, au mieux, qu'au dernier trimestre 2018, avec la mise en service de l'EPR de Flamanville ?
J'aborderai, enfin, deux autres sujets d'inquiétude qui témoignent, madame la ministre, de notre intérêt pour toutes les énergies décarbonées.
En premier lieu, le Gouvernement prévoit, dans un texte que nous examinerons prochainement, d'interdire la valorisation des garanties d'origine, qui attestent du caractère vert de l'électricité achetée, pour les installations bénéficiant déjà d'un soutien public. Or, comme la plupart, sinon tous les acteurs concernés (producteurs, fournisseurs et consommateurs), nous ne comprenons pas comment une telle mesure favoriserait le développement des énergies renouvelables en supprimant toute traçabilité de l'électricité verte ; pourriez-vous justifier la position du Gouvernement sur cette question ?
En second lieu, nous avons compris que les discussions avec la Commission européenne sur l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques se poursuivaient et que la Commission prônait en particulier une sorte d' obligation de résultat - en clair, qu'EDF perde un certain nombre de ces concessions, ce qui poserait justement question du point de vue du droit de la concurrence... En réponse, l'État réfléchirait, selon nos informations, à la mise sur le marché d'une partie de la production hydroélectrique d'EDF, un peu sur le modèle de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) pour le nucléaire. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette hypothèse et nous préciser quand les premières procédures pourraient être lancées et combien de concessions seraient concernées ?
ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. - Je suis très heureuse de venir vous rendre des comptes sur l'application de la loi de transition énergétique. La COP 22 s'est achevée dans la continuité de la COP21 où la France a joué un rôle majeur. Désormais, 77 % des émissions de gaz à effet de serre sont couvertes par les ratifications de 112 pays. La France a été sollicitée par le Maroc, mais aussi par les Iles Fidji qui présideront la prochaine COP, pour continuer à monter en puissance sur les ratifications, et pour aider à renforcer les coalitions et à garantir la mise en place des financements, grâce à l'efficacité de son réseau diplomatique qui a fait ses preuves. J'engagerai la même démarche que pour la COP21, en demandant au gouvernement de chaque pays son agenda en matière de ratification des accords pour mettre en oeuvre la transition énergétique, la stratégie bas carbone et la PPE.
Si la France a été crédible pour conduire les négociations de la COP21, c'est parce qu'elle a su s'appliquer à elle-même les principes qu'elle demandait aux autres pays de respecter. Je tiens à saluer une nouvelle fois la qualité des travaux de la Haute Assemblée sur la transition énergétique, dans les commissions et dans le débat parlementaire. Nous avons réussi à proposer un mix énergétique satisfaisant pour tous, de sorte que le Sénat a voté à l'unanimité la ratification de l'Accord de Paris, construisant ainsi une image solide de la France. Les entreprises françaises se positionneront d'autant plus facilement sur le marché mondial de la transition énergétique.
Dix-huit mois après la promulgation de la loi, la quasi-totalité des textes sont publiés. Jamais l'on n'a observé une telle rapidité dans l'histoire législative et réglementaire sur un texte aussi complexe et aussi dense. La totalité des dix-huit ordonnances, correspondant à 55 habilitations, a été soumise au Conseil d'État. La dernière ordonnance passera en conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Il s'agit de celle sur les réseaux fermés de distribution d'électricité.
Les ratifications avancent rapidement. Le projet de loi de ratification des ordonnances sur les énergies renouvelables et l'autoconsommation est actuellement en examen au Parlement. 98 % des décrets portant sur un nombre exceptionnel de 162 mesures regroupées dans 96 textes sont mis en signature, et 85 % sont déjà publiés. Cela a nécessité un travail considérable pour les agents du ministère, dont je salue la constance et la ténacité.
Les cinq grands outils de planification sont en place. La stratégie nationale bas-carbone, publiée en novembre 2015, constitue la base de la contribution française de l'Accord de Paris. Elle a nécessité des discussions avec l'ensemble des filières industrielles et économiques. Les programmations pluriannuelles de l'énergie sont publiées pour la métropole, pour la Corse et pour la Réunion. Les autres PPE des outre-mer sont en cours d'élaboration et seront prochainement soumises à consultation. La PPE pour la France métropolitaine va de pair avec une stratégie nationale de développement de la mobilité propre. Le plan de réduction des polluants atmosphériques est en cours de consultation obligatoire et devrait sortir dans quelques semaines. Enfin, la stratégie nationale de recherche énergétique est actuellement en examen au Conseil national de la transition écologique et devrait être prochainement publiée.
L'application de la loi a fait l'objet d'une intense concertation avec les parties prenantes. Nous avons co-construit ce texte dans le débat parlementaire et les textes d'application ont également été co-construits avec les acteurs concernés. Pour la première fois, la stratégie énergétique de la France a fait l'objet d'un débat ouvert avec la société civile. L'élaboration de la PPE a donné lieu à des réunions de travail impliquant les secteurs économiques concernés et la concertation publique a produit 5 000 contributions que j'ai toutes examinées, personnellement. Certaines d'entre elles ont été intégrées au texte.
L'efficacité énergétique est le premier pilier de la loi de transition énergétique. L'objectif fixé est de réduire la consommation finale de 20 % entre 2020 et 2050. J'ai annoncé au début du mois de novembre le doublement des objectifs pour la prochaine période, avec les certificats d'économies d'énergie. L'objectif sera de 1 200 TWh cumulés pour les certificats classiques contre 700 pour la période qui prend fin, et de 400 TWh pour les certificats dédiés à la lutte contre la précarité énergétique. Les travaux réalisés grâce à ces certificats d'économies d'énergie réduiront de 10 milliards d'euros par an la facture énergétique des ménages, des entreprises ou des organismes publics. Ces objectifs seront fixés par décret en Conseil d'État pour donner de la visibilité aux fournisseurs d'énergie concernés.
Les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour la rénovation ont été renforcées avec le produit des quotas carbone et le soutien exceptionnel du Fonds de financement pour la transition énergétique, afin de porter de 70 000 à 100 000 le nombre de logements rénovés en cours d'année. La loi a mis en place d'autres moyens pour lutter contre la précarité énergétique. Le chèque énergie est en cours d'évaluation après une expérimentation dans quatre départements. Nous avons défini un critère de décence du logement que j'ai transmis pour examen au Conseil d'État. Le texte fixant les critères minimaux de performance énergétique dans les logements HLM est publié. Enfin, le dispositif du Fonds de garantie pour la transition énergétique qui facilite les prêts aux ménages modestes est en place.
Dans le domaine du bâtiment, 12 décrets sur 16 sont publiés, dont 4 sont encore à l'examen en Conseil d'État. Le décret sur la rénovation des immeubles tertiaires et celui sur l'exemplarité des bâtiments publics devraient être prochainement publiés. Pour ce qui est de la construction neuve, la France vise une première mondiale en préparant une réglementation environnementale du bâtiment pour les bâtiments à énergie positive et les bâtiments bas carbone. Dans les territoires à énergie positive, les architectes vont déjà au-delà de la norme en construisant des bâtiments qui produisent au moins autant d'énergie qu'ils en consomment.
Un autre décret précise que les projets exemplaires peuvent bénéficier d'un bonus de constructibilité. Une expérimentation a été lancée la semaine dernière pour préciser les futurs standards réglementaires. Mieux vaut en effet procéder par incitation que d'imposer des normes impossibles à tenir. La loi fixe la date de 2018 pour que tous les nouveaux bâtiments soient à énergie positive et bas carbone.
La remise aux normes des constructions existantes a été un chantier considérable pour répondre au défi du bâtiment économe. La loi fixe comme objectif que la totalité du parc de bâtiments soit aux normes basse consommation à l'horizon 2050. La réglementation thermique s'appliquant aux bâtiments existants a été révisée en ce sens.
Les travaux d'isolation thermique ont aussi fait l'objet d'un décret publié depuis six mois. Il prévoit l'isolation thermique et acoustique en cas de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire les fameux « travaux embarqués ».
Enfin, le décret sur les travaux de rénovation énergétique dans le secteur tertiaire, qui vise une réduction de la consommation d'énergie de 60 % à l'horizon 2050, a également été publié.
La loi renforce l'information des ménages en matière de performance énergétique. Le texte sur l'obligation des compteurs individuels de chaleur dans les immeubles collectifs a été publié, malgré une résistance extravagante du secteur. Dans les copropriétés où les compteurs individuels sont installés, on observe 40 % d'économies d'énergie, du jour au lendemain. Quand les gens paient ce qu'ils consomment, ils n'oublient pas de couper le chauffage quand ils partent. Les progrès technologiques se multiplient, avec le développement d'installations simples et peu coûteuses de réglage du chauffage à distance, notamment dans le cadre de la Greentech que j'ai créée pour favoriser les start-ups.
Le carnet numérique de suivi d'entretien a fait l'objet d'une expérimentation avec les professionnels du bâtiment. Les premières conclusions seront rendues le 22 décembre prochain.
Venons-en aux transports propres et à la qualité de l'air. L'appel à projets relatif aux transports urbains a bénéficié d'une enveloppe de 450 millions d'euros de la part de l'État. Une centaine de projets destinés à favoriser les transports collectifs en site propre ont été identifiés sur l'ensemble du territoire. J'ai eu le plaisir d'inaugurer le premier transport urbain par câble, à Brest. Huit autres villes se sont engagées dans cette direction.
S'agissant des bus, les motorisations hybrides et électriques ont bénéficié d'une aide renforcée. La France s'est dotée d'une nouvelle législation avec l'indemnité kilométrique vélo, créée par l'article 50. Il est désormais possible aux employeurs volontaires de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés utilisant le vélo pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Le ministère de l'Environnement a ouvert la voie en appliquant de manière expérimentale cette décision à ses employés. Une réduction d'impôt est également prévue pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à disposition de leur personnel (à l'article 39).
L'article 55 s'applique également avec les plans de déplacement spécifiques aux territoires ruraux, et notamment les plans de mobilité rurale. Un guide méthodologique est disponible depuis juillet 2016 pour apporter une aide à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de ces plans.
La loi favorise les plans de mobilité dans les entreprises. Obligatoires à partir du 1er janvier 2018, ces plans montent en puissance, notamment dans les entreprises de plus de 100 salariés. Une journée de mobilisation est prévue à laquelle participeront des associations d'entreprises engagées dans ce mouvement au nom de la qualité de travail de leurs salariés. Un crédit exceptionnel de 30 millions d'euros a été accordé à toutes les entreprises qui ont recours au transport combiné pour toutes leurs marchandises, avec l'objectif d'éviter la circulation de 900 000 poids lourds et 760 000 tonnes de CO2.
Quant au transport maritime, le schéma national d'orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin a été mis en place. Différentes initiatives ont vu le jour dans les grands ports du Havre, de Marseille, de Nantes et de Dunkerque. La France a été extrêmement réactive sur le gaz naturel liquéfié. Un appel à projets visant à sélectionner les projets de ports à énergie positive a été publié à l'été 2016 et les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 30 novembre prochain. Il rencontre déjà un vif succès.
L'article 59 relatif à la teneur en soufre des combustibles marins a fait l'objet d'une ordonnance qui a été publiée. Nous réaliserons cette année 630 contrôles dans les ports français, dont 189 comporteront des prises d'échantillons de carburant. Au 30 septembre, 466 contrôles avaient déjà été effectués pour 7 infractions constatées qui font l'objet de poursuites judiciaires.
Le déploiement de la route solaire dans le département de l'Orne est une innovation française remarquable. Le premier kilomètre sera prochainement achevé en circuit court. Il y en aura d'autres, puisque la construction de 1 000 kilomètres de routes solaires a été annoncée à partir de l'expérimentation de ce laboratoire grandeur nature.
Nous assistons aussi à un changement d'échelle du déploiement de la mobilité électrique, puisque nous avons un objectif d'un million de points de charge publics et privés en trois ans, les points de charge privés bénéficiant du crédit d'impôt, ce que beaucoup ignorent.
Les décrets relatifs à l'achat de véhicules à faibles émissions pour renouveler les flottes de l'État et des collectivités locales sont en cours d'examen au Conseil d'État. Ces véhicules propres représenteront au minimum 50 % de la flotte de l'État et 20 % de celle des collectivités locales. Les industriels français devraient se positionner rapidement sur ce créneau et baisser leurs prix au vu de l'augmentation du nombre des commandes.
La loi prévoyait la création de zones à circulation restreinte. Il a donc fallu inventer un dispositif incontestable, à savoir les certificats qualité de l'air, qui ont été mis en place pour la première fois à Grenoble. Les maires auront la possibilité d'arrêter des zones à circulation restreinte, soit de manière permanente, soit en cas de pic de pollution, disposant ainsi d'un critère de sélection qui correspondra à la propreté du véhicule et non plus à sa plaque d'immatriculation. À ce jour, 100 000 certificats ont été commandés sur Internet.
Enfin, il faut mentionner la décision d'ajuster progressivement en cinq ans la déductibilité de la TVA sur les véhicules essence d'entreprises pour l'aligner avec les véhicules diesel.
Le titre de la loi qui concerne l'économie circulaire et la consommation durable a engagé la France dans un défi majeur : passer d'un modèle économique linéaire à un modèle économique circulaire intégrant l'ensemble du cycle de vie des produits, dès leur production éco-conçue, pendant la phase de consommation jusqu'à la gestion des déchets. Il a fallu 13 décrets d'application de ce titre. Plusieurs mesures étaient d'application immédiate, comme l'objectif de réduction des déchets défini à l'article 70, dont la diminution de la moitié de la mise en décharge prévue d'ici 2025, mais aussi la généralisation du tri à la source des bio-déchets, la généralisation du tri de tous les emballages en plastique et la définition de la pénalisation de l'obsolescence programmée.
La lutte contre les déchets marins générateurs d'un continent de plastique est amorcée, avec l'article 75 qui interdit progressivement l'utilisation des sacs en plastique à usage unique. Ce qui paraissait anodin est devenu mondial, puisqu'à la Conférence de Paris sur le climat, comme à celle de Marrakech, plusieurs pays ont rejoint la France dans l'interdiction des sacs en plastique. Ces déchets sont un fléau, puisque 70 % des poissons et 90 % des oiseaux marins ont du plastique dans l'estomac. Au 1er juillet 2017, l'utilisation des sacs en plastique pour les fruits et légumes sera également interdite. Certaines entreprises françaises se sont déjà engagées dans la filière de fabrication de sacs biosourcés et biodégradables.
L'article 96 qui prévoit la généralisation du tri des déchets par les entreprises et les administrations est appliqué. L'article 93 qui prévoyait l'obligation pour les entreprises du bâtiment de récupérer leurs déchets a été assoupli, de manière à ce que les entreprises puissent se regrouper. Là encore, le texte d'application est pris. On observe l'existence d'un gisement très important en quantité, qui donne lieu au développement de nouvelles technologies pour réutiliser les déchets du bâtiment dans les travaux plutôt que de les mettre en décharge.
La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants publics des collectivités territoriales et de l'État est engagée, avec des actions de sensibilisation menées dans les écoles, les hôpitaux, ou les entreprises de restauration à domicile.
L'article 90 prévoit que les producteurs mettent à disposition des consommateurs l'ensemble des principales caractéristiques environnementales de leurs produits. Il n'a pas été simple à rédiger. Le dispositif français d'affichage environnemental utilisable de manière volontaire par les producteurs, dans un premier temps, sera déployé progressivement pour les produits des secteurs de l'ameublement, du textile et de l'hôtellerie. Des accords existent également avec les filières industrielles de produits alimentaires et d'appareils électroniques.
Les énergies renouvelables sont un élément essentiel de la PPE qui prévoit une augmentation de plus de 50 % en 2023 par rapport à 2015. Ces objectifs ont été déclinés filière par filière dans la stratégie bas-carbone, puis repris dans la PPE publiée le 28 octobre.
L'objectif est de fermer les centrales à charbon d'ici 2023, de doubler la capacité de l'éolien et de tripler la capacité du solaire. Pour y parvenir, j'ai réformé les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques, avec la mise en place du complément de rémunération accompagnant une meilleure intégration des installations de production des énergies renouvelables au marché. J'ai également accéléré la parution des appels d'offres pour le déploiement des énergies renouvelables et simplifié les procédures pour limiter les contentieux. Pour le photovoltaïque, la visibilité donnée sur les prochaines années consolide les filières industrielles. L'appel d'offres pluriannuel, qui sécurise les investissements, a porté sur des installations solaires, au sol, pour un volume de 3 000 mégawatts répartis en six tranches s'étalant sur trois ans, et sur les bâtiments, pour un volume de 1 350 mégawatts, en neuf tranches sur trois ans. Des appels d'offres ont également porté sur les fermes au sol et les projets sur bâtiment à hauteur de 1 100 mégawatts en 2016. Conformément à la loi, tous les nouveaux appels d'offres lancés cette année comportent une prime incitant au financement participatif.
Par ailleurs, le nouveau cadre réglementaire de l'autoconsommation est mis en place. Les résultats du premier appel d'offres, publiés il y a quelques jours, désignent 72 lauréats, pour un volume 20,59 mégawatts, qui bénéficieront d'une prime moyenne de 41 euros par mégawattheure. Sur l'ensemble des dossiers lauréats sur des projets photovoltaïques, 28 ont opté pour un investissement participatif. Quant au taux d'autoconsommation de cette énergie produite, il avoisine les 98 %.
Dans le cadre du Fonds chaleur, nous avons lancé un nouvel appel à projets biomasse-chaleur dans l'industrie, l'agriculture et le tertiaire, rebaptisé « énergie bio », en septembre 2016 pour une remise des offres jusqu'au 31 janvier 2017. Doté de 55 millions d'euros consacrés à l'approvisionnement en biomasse des chaufferies, l'appel à manifestations d'intérêt « Dynamic Bois », conçu avec la profession, lancé en 2015, est reconduit en 2016. Il a accompagné 40 projets structurants destinés à alimenter des chaufferies, soutenus à hauteur de 3 millions de tonnes de bois, la qualité des peuplements destinés au chauffage étant également améliorée sur près de 40 000 hectares.
Portée par le soutien massif aux énergies renouvelables, cette programmation pluriannuelle de l'énergie n'oppose pas les énergies entre elles, mais, au contraire, précise la part de chacune à l'horizon 2018 puis 2023. Elle donne des fourchettes de diminution de la part du nucléaire, conformément au scénario de consommation étudié en concertation avec la filière. Elle fournit aussi les outils de réduction de la consommation d'énergie dans le bâtiment et les transports et fixe les ambitions de développement et d'organisation des réseaux de distribution, pour mettre en place un système énergétique plus intelligent et plus décentralisé.
Nous avons également réglé le problème de la sûreté nucléaire, puisque l'ensemble des textes d'application - ordonnances et décrets du titre VI - ont tous été publiés. Ainsi, l'article 124 améliore l'information et la transparence vis-à-vis des citoyens, renforce le rôle de la commission locale d'information et réforme la composition de celle-ci notamment pour l'ouvrir à des ressortissants de pays frontaliers.
Le décret relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance a été publié le 28 juin 2016.
Par ailleurs, l'ordonnance portant diverses dispositions en matière nucléaire a été publiée le 10 février 2016. Elle renforce les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en la dotant d'outils plus gradués tels que les amendes et les astreintes administratives. Parallèlement, dans le projet de loi de finances pour 2017, j'ai renforcé les moyens de l'ASN et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en créant 30 postes au sein de la première, et 20 postes au sein du second. Étant donné l'avancée en âge des réacteurs, un travail bien plus important repose sur leurs épaules.
Tous ces dispositifs ont besoin d'une orientation financière vers l'économie bas carbone. L'article 173 de la loi de transition énergétique prévoit des obligations de reporting pour les investisseurs, qui doivent désormais prendre en compte des critères liés à la lutte contre le changement climatique dans leur stratégie d'investissement ainsi que dans les rapports aux actionnaires. J'ai observé avec satisfaction que cet article faisait référence, sur la scène internationale, dans les business dialogues et les finance dialogues - les entreprises s'en sont saisies. Je précise que la France est le seul pays à avoir intégré ces obligations dans sa législation.
Pour valoriser les bonnes pratiques, j'ai créé plusieurs instruments volontaires, dont deux labels distinguant les fonds d'investissement verts et les projets de financement participatif verts, ainsi que des prix du meilleur reporting extra-financier des investisseurs.
Vous avez évoqué le prix du carbone. La loi fixe la trajectoire : 56 euros la tonne en 2020 ; 100 euros la tonne en 2030. Un délai sera nécessaire pour mettre en place la taxe sur le carbone pour la production électrique en France. L'objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie reste la fermeture des centrales à charbon d'ici 2023.
J'en viens aux innovations de croissance verte et de croissance bleue. J'ai veillé à ce que la loi de transition énergétique, les stratégies bas-carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie soient accompagnées d'outils opérationnels pour les territoires, les entreprises et les citoyens.
Quelque 400 territoires à énergie positive sont soutenus suivant les titres de la loi - efficacité énergétique, économie circulaire, transports propres ou encore énergies renouvelables. Les territoires s'en sont saisis. Leur créativité, leur liberté d'action, leurs initiatives sont remarquables.
Derrière cette transition énergétique se trouve un potentiel formidable de création de start-ups, de nouveaux services et produits. J'ai créé la Greentech verte en faveur de ces initiatives. Elle a récompensé 200 lauréats dans chacun des domaines que je viens d'évoquer, y compris celui de la prévention des risques.
De grands démonstrateurs industriels se sont illustrés dans le programme des investissements d'avenir. Là aussi, les trois quarts de ces investissements appartiennent à la croissance verte, en particulier les énergies renouvelables en mer telles que l'éolien flottant - quatre lauréats de fermes pilotes de ce secteur ont été désignés. La France sera très en avance sur ces nouvelles technologies, notamment grâce aux hydroliennes sous-marines, dont celles de DCNS.
Grâce à la France, la question de l'océan a été intégrée dans les négociations climatiques et dans l'accord de Paris. Le soleil ne se couche jamais sur la France, premier territoire maritime au monde. Ce matin, l'arrêté de création de l'aire maritime protégée de l'atoll de Clipperton a été publié au Journal officiel. Elle complète celles des terres australes françaises. La France est le premier pays à compter autant d'aires marines protégées.
Mon discours a été long, parce que je souhaitais vous rendre des comptes sur des sujets que vous connaissez bien. Merci de toutes vos contributions et actions, tant au Sénat que dans vos territoires.

Je me félicite de la loi de transition énergétique, que j'ai appellée « Grenelle 3 », qui s'inscrit dans une démarche d'intérêt général pour notre pays, et du travail de co-construction qui a présidé à nos échanges, aboutissant à un résultat positif.
Je constate des avancées significatives en matière de mobilité propre. Le transport urbain par câble est facilité, notamment grâce au Groupement des autorités responsables de transport (Gart). Le soutien au développement des véhicules électriques, comme l'indemnité kilométrique pour le vélo, sont très positifs pour nos centres-villes. Le plan de mobilité rurale montre que le Sénat n'a pas oublié la ruralité. Vous avez évoqué le troisième appel à projets. Quid du quatrième ?
La commission du développement durable a débattu ce matin du prix du CO2 avec MM. Mestrallet et Grandjean. L'État et les entreprises ont pris conscience qu'un signal-prix significatif était le seul moyen susceptible de faire évoluer les comportements. Ce prix est fixé à environ 5 euros en France quand il est à 26 livres sterling au Royaume-Uni et à plus de 100 euros en Suède. Concrètement, parviendrez-vous à faire évoluer l'Union européenne ? M. Mestrallet estime que l'échelon européen est le plus pertinent.
J'apporterai un simple témoignage sur l'économie circulaire, en tant que rapporteur ayant eu affaire aux lobbies des sacs en plastique, de l'obsolescence programmée, du gaspillage alimentaire : cela n'a pas été simple ! Je constate, dans la vie de tous les jours, la réussite de ces mesures.

Financièrement, madame la ministre, vous aurez des difficultés à tenir vos engagements. Je vous propose une mesure d'économie : ne fermez pas la centrale de Fessenheim. Les 446 millions d'euros que vous évoquez ne correspondent à rien. Les 4 milliards d'euros évalués par EDF sont peut-être surdimensionnés, puisqu'ils s'appuient sur une centrale qui aurait duré dix ans de plus et l'indemnisation qu'ils devront verser à leurs partenaires étrangers. On ne sait pas à quoi ces chiffres, pourtant très importants, correspondent.
J'ai été désigné rapporteur des ordonnances qui seront examinées en janvier, sans doute car je suis favorable aux ordonnances lorsque la réactivité est nécessaire. Quand le Parlement fait passer un texte de 40 à 370 articles, il faute. Ces ordonnances sont accompagnées par des articles de loi sur la traçabilité de l'énergie verte. J'auditionnerai nombre d'acteurs en janvier. Je ne parviens en effet pas à me forger une opinion sur le désaccord qui oppose la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'administration ministérielle. Un autre article porte sur le raccordement de l'énergie renouvelable sur le réseau électrique. Vous en profitez pour modifier la loi de transition énergétique. Ce n'est absolument pas normal que votre administration propose une solution contraire à la loi.
Enfin, je vous applaudis sur les bornes électriques, puisque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a très bien accompagné l'ensemble des syndicats d'électricité qui les installent. Les règles de l'Ademe sont très bonnes. Néanmoins, les projets coûtent plus cher que prévu dans la mesure où les bornes sont de plus en plus performantes. Accompagnez-nous dans ces dépassements.
Monsieur Nègre, merci d'avoir beaucoup oeuvré en faveur de l'économie circulaire. Le quatrième appel à projets est en cours d'élaboration.
Non. Je vais étudier comment accélérer le processus.
Monsieur Nègre, vous avez dit l'essentiel sur le prix du carbone, après avoir auditionné les auteurs du rapport sur le sujet. Il a fédéré la coalition pour le prix du carbone qui rassemble plusieurs dizaines de pays, d'entreprises, de territoires, qui s'appliquent un prix du carbone en interne, afin de rentabiliser leurs investissements. Engie en est l'exemple. Cette décision surprenante a fait basculer les négociations climatiques dans une dynamique positive.
Monsieur Poniatowski, vous m'interrogez sur Fessenheim. Les discussions avec EDF pour l'élaboration conjointe d'une formule de calcul de l'indemnisation s'achèvent. Cette formule s'appuie sur plusieurs paramètres, dont l'évolution du prix de l'électricité. L'indemnité sera versée en plusieurs étapes : 96 millions d'euros à la fermeture de la centrale, 350 à 390 millions d'euros, selon les modalités de paiement, en 2021, ainsi que, jusqu'en 2041, une part variable reflétant le manque à gagner pour EDF, le cas échéant, qui sera déterminée en fonction de l'évolution des prix et de la production constatée du parc de centrales 900 MW hormis Fessenheim.
Le projet de protocole a fait l'objet d'une prénotification à la Commission européenne afin qu'elle confirme qu'il ne s'agit pas d'une aide d'État. Le Gouvernement publiera le décret d'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim au plus tard début 2017. La fermeture sera effective d'ici la mise en service de l'EPR de Flamanville, en application du plafonnement prévu par la loi de transition énergétique.
Je précise que les deux réacteurs sont à l'arrêt. Au cours des débats, certains assuraient que la fermeture de Fessenheim priverait l'Alsace d'électricité...
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance réduit le coût des raccordements pour les énergies renouvelables. Monsieur Poniatowski, si vous pensez avoir décelé une contradiction, faites des propositions. Je suis tout à fait demandeuse d'améliorations. C'est l'intérêt d'un débat sur la ratification que d'être enrichi par vos travaux.
Il est étrange que les prix des bornes électriques augmentent alors que le marché mondial se déploie. J'ai découvert récemment le problème, soulevé par l'entreprise américaine Tesla, de la non-polyvalence des bornes. Aujourd'hui, elles doivent toutes l'être.

Je reçois de nombreuses visites de présidents de syndicats intéressés par les bornes de mon territoire, qui sont polyvalentes.
La polyvalence est indispensable pour faire baisser les prix.

Une ratification européenne de l'accord de Paris, en un temps aussi court, est un tour de force, car nous avions toutes les raisons d'être pessimistes. Il est important que la France conserve un leadership diplomatique dans la réévaluation des contributions nationales (NDC) qui dessinent un scénario de hausse de 3°C, ce qui serait intolérable.
Nous sommes confrontés à une difficulté : les émissions de CO2 européennes ne baissent plus. Les bons chiffres d'émissions mondiales sont dus à la Chine et aux États-Unis. Cela doit nous alerter. Comme M. Maurey, je pense que les territoires sont au coeur de la réponse. Lors de l'examen de la loi de transition énergétique, les collectivités territoriales ont soutenu les PCAET obligatoires pour toutes les intercommunalités. Or, sans financement, ces plans ne se mettent pas en place. Il faut envoyer un signal financier.
Nous avons formulé une proposition opérationnelle, à laquelle l'Association des maires de France était favorable, tout comme l'Association des régions de France et France Urbaine, présentée à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le ministère des finances s'y est opposé. Il s'agit de subventionner les PCAET à hauteur de 10 euros par habitant pour les intercommunalités, et 5 euros par habitant pour les régions. Votre soutien nous serait précieux auprès du ministère des finances, qui refuse de rendre aux territoires la cagnotte qu'avec MM. Poniatowski et Lenoir, nous avons accrue grâce à l'augmentation de la contribution climat-énergie.

Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une belle loi de transition énergétique dont le but était de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer l'indépendance énergétique de la France, et un sénateur élu en 2014 dans l'Hérault, qui croyait en ces objectifs portés haut par une ministre très engagée. Quelle ne fut pas la déception de ce sénateur lorsqu'il constata le décalage persistant entre le rêve de cette loi et la réalité. Les administrations toutes puissantes de son département s'arrogeaient tous les pouvoirs car elles avaient le noble rôle de protéger la planète. Ce mauvais conte décrit le quotidien de mon département. Les entreprises peinent à développer des projets de développement durable, surtout dans le photovoltaïque, à cause d'une herbe rare rapportée par une benne sur une friche industrielle ou d'une espèce rare de volatile qui a décidé de nidifier à deux kilomètres d'un projet instruit depuis huit ans. Aujourd'hui, l'espèce en voie de disparition, c'est l'élu rural. Opposer administration et élus ne sert à rien, mais l'interprétation de la loi par les administrations diffère suivant les territoires. Madame la ministre, donnez des directives aux administrations pour qu'elles nous écoutent.

Madame la ministre, donnez-nous les premiers résultats des appels à projets « territoires zéro déchet zéro gaspillage » et « territoires à énergie positive », qui ont connu un très grand succès.
Le comité pour la fiscalité écologique et le Conseil national des déchets ont beaucoup travaillé sur la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et formulé des propositions incitatives. Le ministère des finances nous a opposé leur trop grande complexité - il n'est pourtant pas lui-même réputé pour sa simplicité. Je regrette beaucoup que les collectivités territoriales qui ont fourni de gros efforts en matière de gestion des déchets ne bénéficient pas d'une TGAP plus faible.
Les constructeurs automobiles de certains pays progressent rapidement sur l'hydrogène, qui a pour particularité de se stocker. Je n'aimerais pas que les Français accusent du retard, comme cela a été le cas dans l'électrique par rapport aux Japonais ou aux Allemands. Le stockage de l'hydrogène est simple et non dangereux.

Mes questions portent sur le budget 2017 et tout d'abord sur la compensation de la hausse de la taxe carbone. Lors de la discussion sur la loi de transition énergétique, madame la ministre, vous aviez plaidé pour une fiscalité écologique incitative et non punitive. Nous avions inscrit dans la loi que la hausse de la taxe carbone serait intégralement compensée par la baisse d'autres prélèvements afin de ne pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages ni sur la compétitivité des entreprises. Or, même si une partie de cette hausse était compensée par la stabilisation de la fiscalité électrique, ce qui est déjà contestable, le relèvement de la taxe carbone se traduira par 196 à 440 millions d'euros de prélèvements supplémentaires sur la facture énergétique des consommateurs en 2017 et plus encore en 2018 et 2019. Comment le Gouvernement entend-il respecter la loi ? Les quatre premiers milliards d'euros de la taxe carbone avaient, du reste, étaient compensés par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et la TVA à taux réduit. J'ajoute que l'exonération des produits de la biomasse de la hausse de la taxe carbone n'est pas non plus respectée.
Le Gouvernement avait annoncé que le Fonds de financement de la transition énergétique serait doté de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, or les crédits ouverts en loi de finances rectificative pour 2015 et 2016 n'atteindront que 750 millions d'euros au total. Le Gouvernement a-t-il renoncé à tenir ses engagements initiaux ? Comment les 500 millions d'euros ouverts dans le collectif de cette année seront-ils financés ?
Entre 2015 et 2016, le coût du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) aura plus que doublé, de 900 millions d'euros à près de 2 milliards d'euros. Or, si l'on peut y voir la marque de son succès, il nous est impossible, faute d'évaluation, d'en mesurer les effets réels sur la performance énergétique des bâtiments, et ce, alors même que le nombre de ses bénéficiaires aurait diminué, à 660 000 ménages en 2015, contre 728 000 en 2014. Cette concentration de la dépense fiscale sur un nombre plus réduit de ménages ne serait-elle pas le signe que le CITE n'incite pas les ménages les plus modestes à faire des travaux, voire qu'il aide des ménages qui auraient réalisé des projets même sans ce dispositif ?

Dans trois jours, l'usine marémotrice du barrage de la Rance fêtera le cinquantenaire de son inauguration par le général de Gaulle. À l'époque de la convention entre l'État et EDF, il n'était pas question d'écologie. Depuis, une sur-sédimentation de l'ensemble de l'estuaire pose de grands problèmes. Élus et habitants peinent à faire avancer ce dossier, depuis des années. L'argent public est rare à l'échelon étatique comme territorial, la situation d'EDF est connue, et le prix de l'électricité produite par le barrage de la Rance est racheté au prix du marché. Ne peut-on fixer un prix écologique à cette production d'électricité afin d'aider à financer la gestion des sédiments de la Rance ?

Madame la ministre, je vous adresse mes félicitations pour ce budget, reconnu comme sérieux par tous ceux ici présents et qui va nous aider à passer le cap de la transition énergétique.
Nous sommes satisfaits de la mise en place du chèque énergie afin de permettre aux millions de familles modestes de régler leurs factures de chauffage lorsqu'elles rencontrent des difficultés et de les aider à réaliser des travaux. Savez-vous comment va évoluer ce chèque énergie ? C'est un outil de la transition énergétique, car celle-ci ne doit pas être seulement une affaire de bobos : les familles modestes doivent également pouvoir y prendre part.
Vous faites beaucoup pour la mobilité propre dans votre budget. La France ne doit-elle pas s'interroger sur la difficulté de basculer de la route vers le fer ? En Allemagne, comme dans de nombreux pays d'Europe, le ferroutage progresse.

Madame la ministre, beaucoup de choses ont été dites par mes collègues et vous nous avez fourni beaucoup d'informations sur le suivi de la loi de transition énergétique. Je vous félicite, ainsi que vos équipes : vous avez mené un travail abouti, avec en particulier la publication de nombreux décrets. C'est rare et l'on voudrait bien qu'il en soit ainsi pour tous les textes de loi.
Chaque fois que cela a été possible, un effort considérable a été fait pour aller bien au-delà de la réglementation thermique (RT) 2012 lors de la construction d'immeubles publics, en particulier dans le secteur HLM. Comment pourrait-on, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, inciter fortement le promoteur privé à aller au-delà ? J'ai en tête l'exemple très précis d'un promoteur qui a refusé, en raison du surcoût, de tirer la fibre jusqu'aux appartements, alors que celle-ci était disponible au pied de l'immeuble. Pareillement, pourquoi ne pas installer une prise électrique dans les parkings, même à titre optionnel ?

Madame la ministre, à sa demande, je vous transmets les excuses de notre collègue Roland Courteau, contraint de quitter précipitamment le Sénat.
En ce qui me concerne, je voudrais savoir quel regard vous portez sur le rapport de la Cour des comptes, qui cible des incohérences et l'efficacité incertaine de dépenses fiscales en faveur du développement durable et qui s'interroge sur l'accumulation de dispositifs fiscaux dont le suivi n'est pas assuré. En effet, les aides fiscales qui comptent, d'une part, les dispositifs spécifiquement en faveur de l'environnement tels que les exonérations dans certaines zones protégées, et, d'autre part, des mesures aux effets favorables pour l'environnement telles que les aides à l'isolation des logements, se sont multipliées ces dernières années. On compte aujourd'hui plus de 90 dispositifs. Pouvez-vous nous confirmer votre volonté de réduire leur nombre pour une meilleure cohérence ? Comptez-vous mettre en oeuvre des propositions permettant le suivi et l'évaluation de ces dépenses fiscales et supprimer aussi des dispositifs contradictoires ? Enfin, sur ce même sujet, mais plus précisément, on relève que les aides aux réseaux de chaleur et à la méthanisation comptent parmi les dispositifs dont l'efficacité semble bien établie. Pouvez-vous également dresser un bilan positif des aides aux agrocarburants, à l'éolien et au solaire ?

J'aborderai deux points. D'abord, l'implantation des éoliennes. Je ne critique pas les mesures que vous avez mises en place, mais je veux dénoncer ici ceux qui essaient d'en profiter au maximum en déformant votre ambition originelle.
Les communes sont démarchées constamment par des marchands, elles acceptent souvent de donner suite pour des raisons financières, et l'on voit apparaître des forêts d'éoliennes inesthétiques. Ne faut-il pas revoir les schémas régionaux, peut-être définir des zones d'implantation plus précises d'éoliennes et répartir les taxes autrement, comme cela se fait pour le nucléaire ?
Le second point porte sur l'international. Avec le président Maurey, nous nous sommes rendus quelques jours après vous dans l'océan Arctique, où nous avons constaté les effets catastrophiques du réchauffement climatique - fonte des icebergs, disparition de la banquise, hausse prévisible du niveau des mers. Ce qui m'inquiète, c'est le développement des activités commerciales rendues possibles par ces phénomènes, par exemple la venue de paquebots touristiques, l'extraction de pétrole offshore au moyen de bateaux notamment russes plus ou moins fiables. D'après ce que l'on me dit, c'est Total qui récupère le pétrole à Rotterdam, se donnant ainsi une image propre.
Comment freiner ces actions qui n'ont qu'une finalité financière et ignorent les conséquences négatives pour notre climat ?

Ma première question est plutôt une suggestion, et la seconde un voeu.
La loi de transition énergétique intègre un certain nombre de contraintes en termes de performance énergétique des bâtiments. Je souhaiterais qu'on étudie la possibilité d'aller plus loin, notamment s'agissant de l'origine des matériaux utilisés pour leur construction, en incitant davantage encore à l'utilisation de matériaux biosourcés, les seuls à même de promouvoir la production locale et de s'inscrire dans le cadre de l'économie circulaire. Je pense en particulier au chanvre, sur le marché duquel se sont positionnées des coopératives, et également au bois. Puisque les particuliers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, peut-être pourrait-on orienter celui-ci vers ces matériaux biosourcés.
De même pourrait-on envisager de « récompenser » les collectivités locales, qui doivent être exemplaires, comme l'État, qui vont au-delà de la RT 2012 en promouvant les bâtiments à énergie positive en leur accordant une bonification de dotation d'équipement des territoires ruraux.
Par ailleurs, s'agissant de la TGAP déchets, je souhaiterais qu'on étudie la possibilité d'attribuer les fonds collectés à l'Ademe ou de les engager au profit d'actions en faveur du développement durable, plutôt que de les intégrer au budget de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui en grande partie.

Pour ma part, j'aborderai trois sujets.
Premier sujet, cette route solaire que vous allez prochainement inaugurer. Une inquiétude s'est manifestée récemment - et je porte ici la voix du département de l'Orne - au sujet du rachat de l'électricité produite par cette route solaire. Je sais que l'affaire est en bonne voie.
Deuxième sujet, que m'a communiqué l'un de nos collègues qui n'est membre d'aucune de nos deux commissions : les concessions hydroélectriques. Il appelle particulièrement votre attention sur les intentions du Gouvernement s'agissant de la prorogation éventuelle des concessions du Lot et de la Truyère. Ces sujets dépassent les clivages politiques et concernent beaucoup d'élus. Au-delà des appels d'offres qui ont été lancés pour des installations de petite hydraulique, le Gouvernement envisage-t-il de lancer rapidement des projets d'envergure dans le domaine de l'hydroélectricité ?
Troisième sujet : un projet en cours de réalisation à Marie-Galante, à la Guadeloupe, auquel les élus tiennent beaucoup. Certains se sont inquiétés de savoir si ce projet n'était pas concurrencé, avec le concours du ministère de l'agriculture, par un projet faisant appel à des ressources en bois en provenance du Brésil.

Comme vous le savez, lorsqu'une commune est membre d'une intercommunalité à fiscalité unique, l'essentiel des ressources fiscales générées par les installations éoliennes est attribué à l'EPCI, rendant l'effet incitatif beaucoup plus faible pour les communes. Or avec la nouvelle carte de l'intercommunalité qui va se mettre en place le 1er janvier prochain, beaucoup de communes qui avaient des projets d'éoliennes - je pense en particulier à l'Eure - se rendent compte que, parce qu'elles vont intégrer une communauté de communes à fiscalité unique, elles ne toucheront quasiment rien. Il faudrait qu'on puisse imaginer dans une prochaine loi de finances un mécanisme afin d'éviter de bloquer les projets. Le risque est que les communes referment les dossiers, les élus étant tout autant motivés par les retombées fiscales de ces projets que par leur aspect écologique.
Merci pour la variété de vos questions, qui reflètent en effet beaucoup de préoccupations territoriales, avec ce lien entre l'échelon national et l'échelon territorial, lien clé pour réussir la transition énergétique.
Je remercie Ronan Dantec pour ses différentes observations, qui contribuent à la réflexion. Je vous remercie de votre engagement, dans le cadre de la fédération des territoires, dans la COP21 et dans la préparation de la COP22. Avec le renouveau du climato-scepticisme aux États-Unis, si les territoires, les entreprises et les villes se mettent en mouvement, alors la transition énergétique sera au rendez-vous. Il est donc très important de conserver cette dynamique territoriale.
Henri Cabanel a souhaité être davantage écouté par l'administration. S'il y a eu un déficit de dialogue sur des dossiers précis, faites m'en part. Pour réussir la transition énergétique, il faut un partenariat de qualité, que chacun comprenne les enjeux, et qu'il n'y ait pas de malentendus sur les projets et sur les procédures.
Gérard Miquel, qui s'est beaucoup impliqué sur l'économie circulaire et sur le traitement des déchets, m'a interrogée comme d'autres, sur la TGAP. Cette question relève de Bercy, mais il n'empêche que si la TGAP pouvait être incitative, ce serait l'idéal : l'effet de levier serait alors important. Le défi peut encore être relevé. Avec la dynamique créée par l'entrée en vigueur de la loi de transition énergétique, notamment dans son volet économie circulaire, je vous invite à faire des propositions sur ce sujet que je pourrai relayer. Désormais, la loi fixe des objectifs à atteindre avec la stratégie bas-carbone, avec la fixation de seuils en matière de recyclage et de valorisation des déchets. Aussi, il paraît logique que la politique fiscale tienne compte de ces nouveaux objectifs.
Monsieur Sido, vous avez évoqué le fonds de financement de la transition énergétique. Sur 1,5 milliard d'euros, 750 millions ont d'ores et déjà été financés, ce qui est considérable. Je veille à ce que la demande en crédits de paiement n'excède pas les engagements. À ce jour, aucun des projets territoires à énergie positive n'a à souffrir d'un manque de financement, dans quelque filière que ce soit - j'évoquais tout à l'heure « Dynamic Bois », qui est financé grâce au fonds de transition énergétique. Bien évidemment, si les crédits de paiement deviennent insuffisants, je ferai en sorte qu'ils soient débloqués. Je signe d'ailleurs prochainement une nouvelle vague de projets territoires à énergie positive et ces projets sont financés. Et je rappelle que la Caisse des dépôts a ajouté à ce fonds de financement de la transition énergétique les prêts à 0 % sur 20 à 30 ans. Tous les bâtiments publics peuvent bénéficier de ces prêts, avec un retour sur investissement très intéressant grâce aux économies d'énergie.
Par ailleurs, vous avez évoqué le doublement du crédit d'impôt. C'est formidable ! Heureusement que le ministère des finances n'avait pas été informé à l'avance de son efficacité ! Ce crédit d'impôt a rencontré le succès pour deux raisons. D'abord, j'ai unifié les taux. Ce crédit d'impôt avait été conçu de telle sorte qu'il ne soit pas vraiment utilisé : premièrement, on comptait auparavant deux ou trois taux différents en fonction de la nature des travaux, alors que ce taux est désormais unique, quels que soient les travaux ; deuxièmement, il fallait cumuler les travaux, alors que les gens n'ont pas forcément les moyens d'isoler leurs combles en même temps qu'ils installent du double vitrage. C'est ce qui explique la montée en puissance de ce crédit d'impôt.
Si, comme vous le dites très justement, le nombre des bénéficiaires a diminué, c'est parce qu'a été renflouée l'Anah, qui attribue des aides aux ménages modestes qui font des travaux d'isolation. Sur les 750 millions d'euros du fonds de financement de la transition énergétique, j'ai accepté que 50 millions d'euros soient consacrés au renflouement de l'agence, qui mène une action dynamique et efficace. Les préfets et les élus s'activent beaucoup pour utiliser ce fonds.
Monsieur Vaspart, vous avez rappelé l'inauguration, il y a 50 ans, par le général de Gaulle de l'usine marémotrice de la Rance. Je suis fascinée quand je vois les films en noir et blanc consacrés à la construction des barrages hydroélectriques. On se demande comment faisaient ces ouvriers, alors que les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas - d'où le nombre très élevé d'accidents du travail. C'était une aventure extraordinaire et il existe une culture autour de ces installations.
Vous avez tout-à-fait raison au sujet de la sur-sédimentation. Je vous annonce que j'ai lancé une inspection sur ce sujet afin de proposer un modèle économique viable à partir de la vente d'énergie. De la même façon que les factures d'électricité intègrent le coût du démantèlement des centrales nucléaires, le prix de vente de l'énergie hydroélectrique devrait intégrer le coût d'entretien des barrages et du traitement de la sur sédimentation. C'est le bon sens. J'espère que le rapport qui me sera remis rapidement permettra d'apporter des solutions. Si vous pouvez contribuer à ces travaux, j'en serai enchantée, car je suis décidée à aller vite.

Le Normand que je suis remercie le Breton qui s'est exprimé sur ce sujet : les sédiments en question contribuent largement à l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel, lequel est situé en Normandie, comme chacun sait...
Marcel Bourquin m'a interrogé sur l'évolution du chèque énergie. Celui-ci est en cours d'expérimentation dans quatre départements. La dépense publique en faveur du chèque énergie augmente, qui passe de 400 millions d'euros à 650 millions d'euros. On compte potentiellement 1 million de bénéficiaires supplémentaires - lorsqu'il sera généralisé -, toutes les énergies - par exemple le fioul - étant désormais couvertes, non plus seulement l'électricité et le gaz. Pour un certain nombre de personnes, le chèque énergie a été un peu moins profitable que le tarif social, pour la simple raison qu'il était possible auparavant de cumuler le tarif social de l'électricité avec le tarif social du gaz.
L'objectif de cette expérimentation était de savoir s'il était nécessaire de réajuster le dispositif. Je considère qu'il faut maintenir les acquis : le chèque énergie ne peut pas être moins avantageux pour les ménages précaires que le tarif social. En même temps, il faut favoriser les travaux d'économie d'énergie, notamment l'isolation des combles, le remplacement des radiateurs trop consommateurs d'énergie. C'est pourquoi nous allons à la fois améliorer le dispositif du chèque énergie pour qu'il n'y ait pas de perdant, maintenir son élargissement à toutes les formes d'énergie, en l'orientation vers les travaux d'économie d'énergie. Au bout du compte, il faut que la facture baisse ! C'est ainsi que j'ai parlé tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie, grâce auxquels je souhaite instaurer une plus transparence sur les flux financiers, de manière notamment que la plus grande partie d'entre eux soient ciblés vers la précarité énergétique.
Évelyne Didier est beaucoup intervenue durant le débat parlementaire sur la question de la pollution, et sur celle des déchets, et je l'en remercie.
Madame Bataille, je vous remercie de m'avoir transmis le message de Roland Courteau. Vous m'avez interrogée sur le rapport de la Cour des comptes au sujet de l'accumulation de dispositifs fiscaux dont la pérennité ne serait pas assurée. Il me paraît important de remettre de la cohérence. Ainsi, jamais on n'aurait pensé que le CITE serait aussi efficace. Dans le même temps, la stabilité des dispositifs fiscaux est essentielle : je me suis battue pour que le CITE ne soit pas modifié. Car si l'on commence à y toucher, cela déstabilisera en particulier les artisans. Il faut trouver un juste équilibre entre la rationalité des dispositifs fiscaux et leur stabilité.
Monsieur Fouché, il existe sur le territoire dont vous êtes l'élu des associations extrêmement virulentes dans leur combat contre l'éolien. Le problème de la répartition des taxes est un vrai sujet : il faut un retour sur le territoire sur lequel sont implantées ces éoliennes. Très étrangement, l'acceptabilité sociale des éoliennes est très variable d'un territoire à l'autre : dans certains, leur implantation ne pose aucun problème, ils relèvent presque de l'esthétique paysagère, tandis que dans d'autres, souvent en raison de la présence d'une association virulente ou pour d'autres raisons, l'acceptabilité est très faible.
Il serait intéressant d'ailleurs que des chercheurs se penchent sur ce sujet.
Le processus de concertation est-il en cause, bien mené dans certains territoires, moins bien dans d'autres ? Je ne sais pas, mais il ne faut pas hésiter à réajuster les schémas régionaux si nécessaire.
Peut-être faudrait-il évaluer les critères de décision.
Vous avez évoqué ensuite la fonte des glaces en Arctique. L'exploitation des ressources étant rendue possible avec la fonte des glaces, des convoitises tous azimuts se font jour, et, en l'absence de règles, le risque existe d'une surexploitation anarchique. Une communauté de pays autour du cercle arctique commence à poser des règles et cette question est étudiée avec beaucoup d'attention au sein de la coalition océan et climat qui s'est constituée pendant la COP21 et la COP22. Sont visés non seulement le transport de marchandises permis par l'ouverture de ces nouvelles routes, mais aussi ces hôtels flottants et l'exploitation des ressources minières ou fossiles.
Monsieur Mandelli, vous avez évoqué les problèmes de financement. Le fonds de transition énergétique, le crédit d'impôt, le prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts, les investissements d'avenir, le bonus fonds chaleur dans les territoires à énergie positive, les tarifs de rachat de l'électricité renouvelable : je n'entends pas de revendications particulières en faveur d'un plus grand nombre de financements.

Ma question portait sur une possible incitation à utiliser des matériaux biosourcés plutôt que des matériaux classiques pour la construction des bâtiments. J'ai cité l'exemple du chanvre, pour lequel il existe des filières locales.
Les bâtiments à énergie positive bénéficient d'un bonus de constructibilité. Le bilan carbone des bâtiments qui utilisent des matériaux d'isolation de proximité et biosourcés est plus positif.

Si j'ai bien compris, M. Mandelli voudrait qu'on incite à l'utilisation de matériaux locaux pour favoriser les filières locales.
Avec le fonds de transition énergétique, il faut voir ce que nous pouvons faire pour favoriser les circuits courts.
Il y a aussi beaucoup de résistance à l'homologation, mais cela se voit dans tous les domaines. Prenons par exemple l'interdiction d'emploi du Roundup dans les jardins. Chez moi, à Melle, on distribuait gratuitement du purin d'ortie, par lequel il peut être remplacé, tous les dimanches au marché ; en un quart d'heure, tout était épuisé. Je me suis dit qu'on pouvait homologuer ces produits ; or c'était sans compter sur la résistance très forte des fabricants de produits chimiques. Mais c'est fait.
On rencontre la même résistance des filières professionnelles avec les bâtiments biosourcés, lesquelles ne veulent pas voir perturber les filières d'importation, de production et de distribution et craignent un effet de substitution, que les gens ne préfèrent ces matériaux biosourcés. Vous avez raison, il faut surmonter ces résistances à l'homologation des bâtiments biosourcés et nous allons nous y atteler.
J'en termine avec la route solaire. Comme c'est nouveau, il faut fixer un tarif et imaginer un mécanisme de raccordement. Nous sommes donc obligés de créer quelque chose à partir d'un produit nouveau. L'entreprise à l'origine de cette route était d'ailleurs présente à la COP22 à Marrakech. Si cela fonctionne, comme je le pense, un marché considérable s'ouvre à elle.
S'agissant des concessions hydroélectriques sur le Lot et la Truyère, une question identique m'a été posée à l'Assemblée nationale. Je suis en discussion serrée avec la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Nos négociations prennent un tour positif et s'il est possible de prolonger les concessions, je le ferai bien volontiers. Il faut garder la maîtrise publique de ces équipements.
S'agissant du projet de Marie-Galante, le bilan carbone de l'importation du bois brésilien est scandaleux, alors qu'il est possible d'utiliser la biomasse issue des déchets de canne à sucre pour produire de l'énergie.
Pareillement, les algues brunes des Sargasses, véritable fléau, sont une source de pollution des Antilles et de Marie-Galante. Est-il possible de récupérer une partie de ces algues pour les transformer en biomasse ? Sur le plan technologique, il existe une difficulté pour retirer l'eau et le sable qu'elles contiennent, mais j'ai bon espoir que ces déchets végétaux permettent un jour d'alimenter les usines de production de gaz.

Madame la ministre, je vous remercie d'avoir consacré ces deux heures de débat interactif à nos deux commissions.
La réunion est close à 18 h 55.