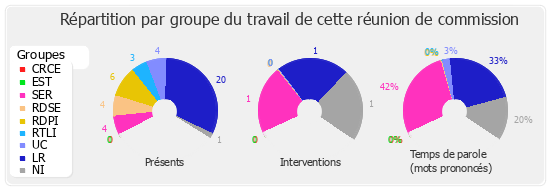Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 15 février 2017 à 16h40
Sommaire
- Audition conjointe sur la russie de m. thomas gomart directeur de l'institut français des relations internationales ifri et de mme tatiana kastouéva-jean directrice du centre russie-cei de l'ifri (voir le dossier)
- Audition de m. jean-marc ayrault ministre des affaires étrangères et du développement international sur le brexit et la refondation de l'union européenne (voir le dossier)
La réunion
Audition conjointe sur la russie de M. Thomas Gomart directeur de l'institut français des relations internationales ifri et de Mme Tatiana Kastouéva-jean directrice du centre russie-cei de l'ifri
Audition conjointe sur la russie de M. Thomas Gomart directeur de l'institut français des relations internationales ifri et de Mme Tatiana Kastouéva-jean directrice du centre russie-cei de l'ifri

Merci. La situation est complexe et entre la Chine, l'Afrique et l'élection de M. Trump - sans parler du Brexit - c'est à n'en pas douter une nouvelle donne qui s'installe sous nos yeux.
Présidence de MM. Jean-Pierre Raffarin, président de la commission des affaires étrangères et Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes -
La réunion est ouverte à 16 h 40.
Cette audition est commune avec le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne et la commission des affaires européennes.

Cette réunion conjointe avec la commission des affaires européennes a lieu dans le cadre de notre groupe de suivi sur le Brexit, qui s'est saisi de deux grands sujets : la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais aussi les grands axes, dans cette perspective, d'une refondation de l'Europe. Notre groupe de suivi vient d'adopter son rapport d'étape sur le Brexit. Nous avons eu de nombreux contacts, y compris en Allemagne et au Royaume-Uni.
Nous entendons tenir une position forte. Loin de l'idée que le Brexit serait un problème pour l'Union européenne, nous affirmons clairement que ce problème est celui du Royaume-Uni, quand notre souci est bien plutôt celui de l'unité de l'Europe. Gardons-nous de nous laisser prendre en otage par ce débat. Lorsque Mme May dit qu'il n'y aura pas de deal en cas de mauvais deal, nous ne voyons pas là une menace. Nous sommes certes attachés à préserver de bonnes relations avec le Royaume-Uni, qui engagent en particulier des questions de défense et de sécurité, et c'est pourquoi nous souhaitons un bon accord, mais sans pour autant donner le sentiment que nous serions les victimes d'une absence d'accord. Ne soyons pas faibles dans cette négociation difficile. Clairement, le nouveau statut du Royaume-Uni dans l'Europe ne saurait être meilleur demain qu'il n'était hier.

Après le Brexit, il faut repenser le fonctionnement de l'Union européenne, et affirmer une stratégie. Les Etats-Unis, la Russie rêvent d'une Europe affaiblie, divisée. Nous voulons, au rebours, une Europe puissance, une Europe stratège, qui sache aussi rendre plus de poids aux parlements nationaux, en vertu du principe de subsidiarité. Nous voulons un couple franco-allemand qui, une fois passés les recadrages électoraux qui vont s'opérer de part et d'autre du Rhin, retrouve un nouvel élan. Nous voulons des avancées concrètes sur les politiques clé que sont l'énergie, le numérique, mais aussi sur la politique de la concurrence qui, écrite il y a près de soixante ans, au lendemain de la signature du traité de Rome, ne correspond plus à l'économie du XXIème siècle. Nous souhaitons, à la faveur de cette rencontre, monsieur le ministre, connaître votre appréciation sur le fonctionnement actuel et futur des institutions de l'Union européenne.
Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Le travail du Parlement est essentiel, parce que la question de l'avenir de l'Union européenne se pose de toute façon : la décision britannique n'est qu'une circonstance stimulante.
Face aux risques qui sont devant nous, dans le monde incertain voire dangereux où nous vivons, alors que les grandes lignes de la politique internationale de la nouvelle présidence américaine restent encore floues, tandis que l'attitude de la Russie est celle que l'on connaît et que des rééquilibrages s'opèrent, notamment dans les relations avec la Chine, quelle place pour l'Europe ?
Oui, l'Europe est en danger, mais les peuples européens, qui semblent, avec la montée des partis populistes, s'en détourner, n'ont pas été saisis par la contagion immédiate du Brexit, auquel ils ont, au contraire, opposé un réflexe de défense, de survie. Ceux qu'on aurait pu penser tentés d'emprunter le même chemin n'ont pas voulu prendre ce risque. Cela ne veut pas dire, pour autant, que tout est réglé : il existe une attente forte, à laquelle nous devons répondre.
Pour avoir vécu le référendum de 2005, nous savons quelles sont les interrogations de nos concitoyens, mais en cette fin de cycle, marquée par le retour des nationalismes, nous avons plus que jamais besoin de consolider l'ensemble européen qui a permis, après la seconde guerre mondiale, de garantir la paix, de construire la prospérité, de réunifier les peuples européens divisés, et qui porte une espérance, une flamme qu'il nous faut retrouver. Telle est notre responsabilité.
Lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a un an, j'ai rencontré mon homologue allemand d'alors, Frank-Walter Steinmeier. Nos échanges nous ont convaincus de la nécessité d'une initiative franco-allemande, qui fut livrée sous forme d'une contribution publique, au moment du Brexit, mais dans l'élaboration de laquelle nous nous étions engagés bien avant. Le débat sur la Défense européenne a repris - et les déclarations du président américain sur l'Otan le rendent d'autant plus d'actualité - aboutissant à un certain nombre de décisions adoptées par le Conseil européen, pour lesquelles, là-aussi, des initiatives franco-allemandes avaient été présentées.
Le fait est que tout le monde regarde du côté du couple franco-allemand. Et si l'on nous reproche parfois de décider pour les autres, on s'inquiète, par-dessus tout, lorsque nous restons silencieux. C'est là une réalité singulière, liée à l'histoire, puisque tout est parti de la main tendue à l'Allemagne par la déclaration Schuman. On connaît la suite, mais on sait aussi que depuis lors, l'Europe a dû faire face à de nouveaux enjeux. Je pense, récemment, à la crise migratoire, à la montée de la menace terroriste à laquelle nous devons répondre dans la durée.
Tout est prêt pour que la négociation sur le Brexit commence. Rien ne peut réellement commencer tant que les Britanniques n'ont pas officiellement demandé à quitter l'Union, mais Mme May s'est engagée à activer l'article 50 du traité d'ici la fin mars, peut-être même dès le Conseil européen des 9 et 10 mars si la procédure parlementaire engagée le permet, c'est un gage.
Dans cette attente, nous avons fixé, dès le 29 juin, après le vote britannique, des principes clairs, rappelés le 15 décembre dernier : il ne saurait y avoir de négociation bilatérale ou sectorielle en-dehors du cadre fixé par l'article 50 du traité. Tout accord sur la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devra reposer sur un équilibre entre droits et obligations ; en particulier, le maintien d'une participation du Royaume-Uni au marché unique devra obligatoirement passer par l'acceptation des quatre libertés, y compris la liberté de circulation des travailleurs. Pour promouvoir ces principes, l'entente franco-allemande a été, là aussi, essentielle.
Nous nous sommes également accordés sur les principales méthodes de travail qui présideront aux négociations, afin que celles-ci soient efficaces et transparentes. Cette organisation permettra à chaque institution de jouer pleinement son rôle. Dès la notification par le Royaume-Uni, le Conseil européen adoptera des orientations qui fixeront les principes de négociation de l'Union européenne. Une réunion extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement pourrait être organisée à cette fin, probablement début avril. Puis la Commission présentera des recommandations au Conseil des ministres de l'Union européenne, lequel adoptera une décision autorisant l'ouverture des négociations, ainsi que des directives de négociation, et désignera la Commission comme négociateur de l'Union.
A la tête de l'équipe de négociation, Jean-Claude Juncker a désigné notre compatriote Michel Barnier, dont vous connaissez l'expérience tant sur la scène nationale que comme ancien commissaire européen à la politique régionale puis en charge du marché intérieur. Je pense, au terme d'un échange que j'ai eu avec lui, qu'il est sur le bon chemin : sa méthode est rigoureuse et il attend un mandat aussi clair que possible afin de poursuivre son travail. Je me félicite de ce choix.
Des dispositions spéciales ont également été prises afin que chaque institution joue pleinement son rôle. Un groupe de travail dédié sera créé à Bruxelles, qui permettra aux Etats membres d'être informés en permanence des travaux menés par l'équipe de Michel Barnier, le Parlement européen étant également informé à échéances régulières.
A l'échelon national, nous nous sommes organisés. Le secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) conduit depuis l'été un important travail de cartographie des intérêts français tant au titre de la négociation de retrait qu'à celui du cadre des relations futures. Le ministère des affaires étrangères et des relations internationales a créé, quant à lui, une task force dédiée, pilotée par la direction de l'Union européenne. Nous disposons donc des outils pour défendre les intérêts français. Pouvoir compter sur le SGAE, qui mène un travail interministériel dans des conditions remarquables, est sans conteste un avantage, sur lequel tous les gouvernements ne peuvent pas compter.
En dépit du début de clarification que j'évoquais, il ne faut pas sous-estimer, cependant, les contradictions qui marquent la position britannique. Certains y verront une simple tactique, mais j'ai pu observer, au cours des mois passés, que cette position est bel et bien entachée de beaucoup de confusion, de divisions, y compris au sein des différentes familles politiques. Dès le 17 janvier, cependant, il y a eu un début de clarification, confirmé par le livre blanc présenté au Parlement.
Si Mme May maintient sa position, cela signifie clairement que le Royaume-Uni renonce au marché intérieur, car nous avons été clairs : dès lors qu'elle affiche un refus du principe de libre circulation des personnes et rejette la juridiction de la Cour de justice européenne, le Royaume-Uni doit sortir du marché intérieur. Pour autant, il faut rester vigilants, car Mme May souhaite négocier un accord de libre-échange qui ressemble à s'y méprendre à un accès sur mesure au marché intérieur. Les difficultés commencent. Elles commencent enfin, serais-je tenté de dire, mais il ne faut pas les sous-estimer.
La volonté de quitter l'Union douanière pour conclure des accords de libre-échange avec des Etats tiers a également été exprimée, mais elle s'accompagne du souhait de bénéficier de certains avantages de l'Union douanière. Il nous faudra donc le rappeler inlassablement : les quatre libertés ne sont pas divisibles et doivent être pleinement acceptées, à chaque étape. Il y va de nos intérêts, de ceux de l'Europe et de son avenir. Il ne faut pas être naïfs, et laisser Mme May se livrer à ce que l'on a appelé le « cherry picking ». Lorsque Boris Johnson nous accuse de vouloir punir la Grande Bretagne, je me récrie ! Tel n'est pas notre état d'esprit. Il ne s'agit pour nous de rien d'autre que de préserver l'avenir de l'Europe, et Mme Merkel, avec ses mots, ne dit pas autre chose : pas de négociation particulière, dit-elle en s'adressant à tous les Etats de l'Union, mais aussi aux Etats-Unis, pour parer à la tentation de négocier des accords de défense avec des contreparties. L'Allemagne comme la France adresse aussi le message aux organisations professionnelles, car la tentation est grande, dans des secteurs comme celui des services ou de l'automobile, de s'arranger avec ses homologues britanniques, pour demander ensuite à l'Union européenne d'avaliser. Cela serait dangereux : il nous faut garder une vision globale du processus de négociation.
Nous devons être clairs : quand on décide de ne plus appartenir à un groupe, on ne peut plus bénéficier des avantages qu'il offre. Il existe des règles, des engagements. Les Etats membres ont réussi, jusqu'à présent, à maintenir l'unité : il faut la préserver dans la durée.
Confrontés au Brexit et à la persistance des crises - menace terroriste, crise migratoire, montée des nationalismes, remises en cause du projet européen - nous devons faire face. Certains aujourd'hui voient l'Union européenne, comme une machine de guerre conçue pour concurrencer économiquement les Etats-Unis, en oubliant qu'elle a été conçue pour reconstruire l'Europe, et qu'elle a permis d'assurer la paix sur le continent, ce que tous les présidents américains avant M. Trump ont appuyé. Comme je l'ai dit et le redirai à mon homologue Rex Tillerson, il est de l'intérêt des Etats-Unis que l'Europe se porte bien et contribue à l'équilibre du monde.
Quelles que soient les réponses que l'Union européenne ait apportées à l'érosion de la confiance des peuples, les citoyens européens ont eu le sentiment, de sommet en sommet, que les annonces ne se concrétisaient pas. Cela ne veut pas dire, pour autant, que les Européens veulent moins d'Europe. Ce qu'ils veulent, ce sont des réponses concrètes, et pas de simples proclamations. Ce qui s'est fait à Bratislava en septembre et que le sommet de La Valette, le 3 février, a confirmé, va dans le bon sens. Les Vingt-sept ont dit leur volonté d'aller de l'avant. « Ce qui se joue, c'est le destin même de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement le regard sur le passé qu'il faut porter, c'est une volonté pour l'avenir qu'il faut définir » a déclaré, à Malte, le Président Hollande. Il importe que les chantiers ouverts soient confirmés le 25 mars prochain, à l'occasion du 60ème anniversaire de la signature du traité de Rome.
Nous avons besoin d'une unité dans le verbe, dans l'expression politique, mais aussi dans l'action. L'Europe, tout d'abord, doit véritablement protéger ses citoyens, ce qui passe par la maîtrise de nos frontières extérieures. Elle doit aussi assurer notre sécurité, en organisant notre propre défense, non pas contre l'Alliance atlantique mais en complément de celle-ci. Nous y parviendrons en renforçant nos capacités, en coordonnant nos programmes, en nous dotant d'instruments de planification, en augmentant nos moyens financiers - la création d'un fonds a été décidée, il faut le mettre en oeuvre -, en favorisant une politique industrielle et de recherche européenne. Nous sommes engagés dans cette voie, il faut poursuivre.
L'Europe est une puissance économique, c'est une puissance commerciale, exportatrice, une puissance qui compte plus de 570 millions d'habitants. Il est normal que cet ensemble préserve ses intérêts dans les négociations commerciales, en faisant valoir le principe de la réciprocité. Certaines mesures ont déjà été prises. Je pense, en matière de concurrence, aux réactions suscitées par les exportations d'acier chinois. Il faut ouvrir d'autres chantiers encore, mais en se gardant d'un danger, celui du repli. Je suis frappé par les débats autour de l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Autant nous avons été en désaccord avec les Américains sur le projet de traité avec les Etats-Unis, le TTIP, trop déséquilibré, autant le Canada s'est montré beaucoup plus réceptif dans la négociation, tandis que l'Europe a su, de son côté, faire évoluer ses positions et se montrer plus exigeante sur certains points : accès à tous les marchés publics, protection de l'origine géographique des produits, préservations de nos normes sociales et environnementales - on ne saurait prétendre que nous allons être inondés de produits OGM en provenance du Canada, car nous avons obtenu le contraire. Quant à la gestion des conflits, il a été décidé qu'elle ne passerait pas par les tribunaux arbitraux, privés, avec les risques de conflit d'intérêts qu'ils comportent aujourd'hui, mais serait confiée aux magistrats indépendants des tribunaux publics. C'est une avancée qui fera référence dans d'autres négociations.
Il ne suffit pas de suspendre les négociations sur le TTIP, mais encore faut-il, au-delà, savoir ce que l'on veut. Veut-on mettre fin aux relations économiques internationales, aux exportations ? Si l'on entend, au rebours, poursuivre les échanges économiques internationaux, cela ne saurait se faire sans règles. Nous devons être capables de bien préserver nos intérêts, et les plus libéraux des gouvernements en Europe sont en train d'évoluer, en particulier depuis la crise de 2007.
L'Europe doit être porteuse d'un projet politique et pas seulement économique et commercial. A nous Européens de porter à l'échelle de ce monde incertain la nécessité de la régulation mondiale. Le G20, sous la présidence de l'Allemagne, a retenu, notamment grâce aux propositions françaises, un agenda très chargé. L'Afrique y figure : c'est un sujet mondial, qui appelle le règlement de questions aussi lourdes que la sécurité, le développement, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'énergie. Des questions dont tout le monde doit se préoccuper, car elles appellent des solutions internationales. Aller vers moins de régulation mondiale, c'est aller vers le danger. Nous devons être porteurs de cette exigence. Certaines décisions ont déjà été prises par le G20, sur les paradis fiscaux, l'évasion et la fraude fiscale, notamment, mais craignons un retour en arrière, alors qu'il faudrait aller plus loin, vers un projet de civilisation, que l'Europe peut et doit porter.
Je ne suis tenté ni de proposer, pour sortir de la crise de confiance que traverse l'Europe, un nouveau traité ni d'appeler à une révolution institutionnelle. Non point qu'il ne faille rien changer à l'équilibre des institutions, ni aux relations avec les parlements nationaux, qui vous préoccupent à juste titre, mais j'estime que c'est quand s'exprime une volonté politique que les choses évoluent. Un exemple : en matière de lutte contre le terrorisme, le processus de décision s'est accéléré face au danger, et une décision sur le PNR (Passenger Name Record) a enfin vu le jour. Je pense de même aux gardes-frontières européens, au renforcement de Frontex : en six mois, des décisions ont été prises sur des sujets qui faisaient l'objet de débats depuis des années. Preuve que ce qu'il faut à l'Europe, c'est moins de technocratie et plus de politique. Cessons de déléguer à l'excès à l'administration et prenons, comme politiques, nos responsabilités, agissons, engageons-nous. C'est ainsi que l'on retrouvera la confiance. Peut-être faudra-t-il envisager, dans la durée, une refonte des traités, mais en faire une question préalable serait périlleux.
Permettez-moi, pour finir, d'évoquer un échange que j'ai eu avec M. Kaczyñski, chef du parti au pouvoir en Pologne, qui m'a dit n'être ni du côté de Trump, ni du côté de M. Farrage, ni de celui de Mme Le Pen, mais être un patriote polonais, favorable à la justice sociale. L'Europe ne fonctionne pas, a-t-il ajouté, car les Etats et les parlements nationaux y manquent de pouvoir. Et d'appeler à un nouveau traité, qui soumettra toute décision européenne à l'approbation nationale. Telle n'est pas ma conception, je vous le dis tout net.
En revanche, nous pouvons construire une Europe plus efficace, mieux liée aux enjeux du futur, renforcer la zone euro - en tout état de cause, nous avons besoin de plus de politique et de plus de volontarisme.

Nous avons besoin de plus de clarté, également, de politiques énoncées plus clairement.

A Londres, plusieurs de nos interlocuteurs nous ont déclaré qu'ils préféraient pas d'accord, plutôt qu'un mauvais accord. Or, les experts précisent que la facture des seuls engagements pris par la Grande-Bretagne pourrait représenter entre 40 et 60 milliards d'euros ; comment sortir de cette contradiction entre des Britanniques qui veulent sortir de l'Europe sans payer - parce que leur vote s'explique pour beaucoup par leur volonté de ne plus payer pour les Européens - et les Vingt-Sept, qui ne veulent pas payer à la place des Britanniques pour les programmes déjà lancés ?
Paul Magnette, ensuite, ministre-président de Wallonie, a récemment déclaré que pour sauver l'Europe, il faudrait peut-être que ceux qui la critiquent la quittent, au premier chef les pays de l'est européen : qu'en pensez-vous ?

Le caractère indissociable des quatre libertés est trop souvent présenté comme un dogme, alors qu'il faut expliquer leur avantage. Ainsi, la liberté de services et d'installation des salariés a constitué un moyen de mutualiser les compétences et d'amortir les chocs d'emploi - depuis 2008, les salariés européens qui ont changé de pays de résidence représentent le quart du nombre de chômeurs européens, il faut le faire savoir. Ceux qui sont allés en Grande-Bretagne ne doivent pas perdre les acquis obtenus pendant que la Grande-Bretagne était partie intégrante de l'Union, il faut y veiller très attentivement dans la négociation, y compris dans les règles de certains fonds de pension britanniques. La mobilité est un acquis, il ne faut pas la pénaliser.
Que se passera-t-il, ensuite, après le Brexit ? L'accord passé entre la Grande-Bretagne et l'Union sera-t-il dans tous les cas ratifié par les parlements nationaux ? Dans quel calendrier ?

Le Brexit défie la cohésion des Vingt-Sept, parce qu'ils ont des intérêts divergents sur les thématiques qui vont être abordées : comment préserver cette cohésion, tout en poursuivant notre intérêt national ? Quelle initiative le couple franco-allemand vous paraît-il pouvoir prendre pour l'Europe ? Je plaide pour un parlement mixte, qui harmoniserait les normes en matière économique, de droit du travail, en matière fiscale... et qui trouverait sa place naturelle à Strasbourg.
Le Gouvernement est très engagé pour défendre les sessions du Parlement européen à Strasbourg, nous avons refusé par exemple que le vote du budget ne s'y tienne pas - c'est un symbole mais un acte politique, nous refusons de laisser s'installer un état de fait où les équipements à Strasbourg seraient délaissés.
Je crois au dialogue, au contact. Sigmar Gabriel est venu à Paris dès le lendemain de sa nomination; je l'ai senti ému par ses nouvelles fonctions, je l'ai amené au salon de l'horloge, de façon informelle - c'est intéressant d'entretenir des liens forts, directs, surtout quand les bases peuvent être remises en cause.
Les pays de l'est européen n'auraient qu'à partir, s'ils ne sont pas contents de l'Union européenne ? Je ne partage pas ce point de vue de Paul Magnette, je crois que nous devons faire de la pédagogie, parler à ces pays - qui sont, en plus, ceux qui bénéficient le plus des programmes européens de soutien. J'ai reçu les représentants des trois Etats baltes à Paris, pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la reprise de nos relations internationales... Nous n'y avons bien sûr pas tout réglé, mais elle a été vécue comme une étape importante. Le général de Gaulle n'avait pas accepté l'annexion des Etats baltes par l'URSS, le président Mitterrand a renoué les relations dès que cela était possible : les Baltes ne l'ont pas oublié. Les choses sont plus difficiles avec l'actuel gouvernement polonais, mais la société civile polonaise se mobilise : c'est un facteur d'espoir. Il faut dialoguer, accepter qu'il y ait des divergences. Quant à la Roumanie, le décret dont on parle a constitué une faute politique, mais l'opinion ne l'accepte pas, la mobilisation actuelle est aussi un facteur d'espoir. Vous noterez que Paul Magnette, en engageant le débat sur le Ceta au Parlement wallon, a obtenu des améliorations dans le sens que les Wallons souhaitaient : quand le débat citoyen est suffisamment préparé, il obtient des résultats, c'est une leçon à retenir.
Certains de vos interlocuteurs britanniques vous disent qu'ils préfèrent pas d'accord, plutôt qu'un mauvais accord ? C'est une opinion, mais la réalité est qu'un accord est dans l'intérêt de tous. La sortie de l'Union entraîne un prix à payer, il y aura une négociation, la cohérence des Vingt-Sept sera nécessaire.
Le caractère indissociable des quatre libertés n'est pas un dogme, vous avez raison de rappeler qu'il faut dire pourquoi - et je vous rejoins sur les droits acquis, en particulier pour les retraites.
Quant à la ratification de l'accord passé entre l'Union et la Grande-Bretagne, cela dépendra du contenu du texte - voyez dans le Ceta, certains éléments doivent faire l'objet d'une ratification, d'autres pas.
L'harmonisation des normes franco-allemandes ? Oui, il y a de quoi faire, un travail concret sur le plan social, fiscal, bancaire... mais c'est un travail à organiser.
Avec l'Irlande, il faudra trouver une solution, le problème est particulier; je m'y rendrai prochainement, je crois que nous devons aider les Irlandais à passer ce moment d'angoisse tout à fait compréhensible. Ceux qui ont organisé le référendum sur le Brexit ont pris un grand risque pour leur pays - l'Ecosse, ainsi, envisage un référendum sur le maintien dans l'Union européenne.

Le Brexit a-t-il un impact sur les accords militaires de Lancaster House ?
Non, il n'a pas d'incidence sur l'ensemble des traités bilatéraux. Les traités de Londres, dits de Lancaster House, doivent être préservés.

Vous rejoignez notre analyse sur le fond, consistant à dire que le Brexit nous oblige à réfléchir aux voies d'une refondation européenne, qui passe par le fait de replacer la construction européenne au centre de notre agenda politique et à refuser que les Américains ne jouent des divisions européennes. Nous cherchons les moyens de réconcilier l'opinion avec l'idée européenne - ce sera l'objectif de nos deux rapports. Le Brexit accélère un mouvement que nous savions nécessaire. Je vous remercie pour vos propos.
La réunion est close à 17 h 35.