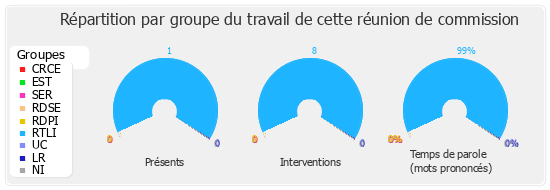Mission d'information sur la pénurie des médicaments et des vaccins
Réunion du 6 juillet 2018 à 9h30
Sommaire
La réunion

Notre mission d'information poursuit ses travaux par une audition conjointe des représentants de plusieurs organismes représentatifs de la profession de pharmacien, dont l'Académie nationale de pharmacie, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, et deux syndicats de pharmaciens : l'Union des syndicats de pharmacies d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Cette table ronde est l'occasion d'échanger avec les pharmaciens, qui sont en première ligne face au problème des ruptures de stock et d'approvisionnement de médicaments essentiels. Je sais que vous n'avez pas attendu l'intervention des pouvoirs publics pour vous organiser dans ce domaine, puisque votre profession a mis en place, dès 2013, le portail DP-Ruptures, qui permet aux pharmaciens équipés de ce module d'effectuer automatiquement une déclaration de rupture d'un médicament dont ils ne peuvent plus s'approvisionner dans un délai de 72 heures. Votre recul nous est donc particulièrement précieux afin d'apprécier la qualité de la circulation de l'information entre tous les acteurs de l'offre et de la distribution et de mesurer la réactivité de chacun.
Je cède la parole au rapporteur de notre mission, notre collègue Jean-Pierre Decool, qui vous précisera les principaux éclairages que nous attendons de cette table ronde.

Vous avez tous déjà reçu un questionnaire fourni qui pourra servir de trame à cette audition. Je souhaite vous poser quelques questions complémentaires.
Estimez-vous que votre coopération avec les autorités sanitaires et, notamment, avec l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est bonne en situation de ruptures de stock ?
En dehors des ruptures de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ou MITM, recensées par l'ANSM, quelles sont les situations de rupture qui vous paraissent les plus problématiques ?
Les dépositaires de médicaments, qui sont des acteurs peu connus de la chaîne de distribution, ont-ils selon vous un rôle ou une influence dans les phénomènes de pénuries ?
Quelles sont, d'une manière générale, vos préconisations pour prévenir durablement les situations de rupture de stock ?
Plus de mille incidents avaient déjà été relevés par l'enquête conduite par notre syndicat en 2011 ; en 2017, 39 % des 1900 pharmaciens sondés déclaraient une rupture permanente de dix à vingt lignes de médicaments, et 27 % recensaient vingt à trente incidents dans leur pharmacie. Ce phénomène ne s'est donc pas réduit, en dépit des dispositions qui ont été prises au cours des cinq ou six dernières années. L'ANSM vient de relever 530 MITM en rupture d'approvisionnement, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2016. Les pharmaciens passent 25 minutes en moyenne chaque jour à trouver des solutions en cas de rupture.
Les choses ont malgré tout progressé pour la transparence de la situation. Les laboratoires qui fabriquent les médicaments les plus sensibles et sans alternative thérapeutique doivent tenir des engagements de stock minimum et doivent déclarer les ruptures de long terme à l'ANSM. Cela permet aux professionnels de santé de prendre des dispositions avec le patient de manière anticipée.
En revanche, les microruptures sur la fin de la chaîne d'approvisionnement - entre le laboratoire, le grossiste-répartiteur et le pharmacien - n'ont pas été réglées. On observe un jeu de défiance des acteurs. Les laboratoires soupçonnent les grossistes-répartiteurs d'exportations parallèles ; ceux-ci s'en défendent, mais revendiquent aussi la liberté de circulation des marchandises en Europe. Pour éviter cette perte de revenus, les laboratoires limitent l'approvisionnement des grossistes, d'une manière qui n'est jamais conforme aux besoins réels des pharmaciens et des patients : cela contribue à créer des difficultés, notamment en fin de mois.
Les pouvoirs publics avaient proposé une liste de médicaments interdits d'exportation parallèle, mais ce texte n'a jamais été publié. En effet, les laboratoires trouvent cette liste trop courte, alors que les grossistes la trouvent trop longue. Il y a donc, en tout état de cause, un manque de transparence dans la fluidité de l'approvisionnement.
Imposer la transparence, voilà ce qu'il faut faire, car elle conduira à la vertu. Chaque acteur de la chaîne doit être obligatoirement connecté au portail « DP-Ruptures » - aujourd'hui géré sur une base volontaire- et l'alimenter. Il nous faut pouvoir retracer le devenir de chaque boîte de médicament, et, dès lors qu'un incident dure plus de trois jours, pouvoir comprendre l'origine de la rupture.
Les dépositaires sont souvent montrés du doigt en ce qu'ils contribueraient à la déstabilisation du marché. Ils doivent être soumis aux mêmes règles de transparence que les autres acteurs ; seulement ainsi pourra-t-on juger de leur responsabilité sans les stigmatiser indûment.
Les ruptures de stock dégradent l'image de la chaîne de distribution pharmaceutique auprès des patients. Ils ne peuvent comprendre comment de tels incidents peuvent se produire dans un pays aussi organisé que le nôtre - alors même que nous essayons par ailleurs d'améliorer l'observance des traitements. C'est une autre raison de réparer cette chaîne, qui est pourtant performante.
L'exercice quotidien du métier de pharmacien officinal est particulièrement difficile en période de rupture. Le 3 juillet dernier, j'ai rapporté une liste de cinquante-neuf lignes en rupture. Ces ruptures résultent de deux types de raisons : les manques dus aux fabricants, et les manques par contingentement. On peut imaginer que les premiers proviennent d'un problème d'approvisionnement en matières premières, mais les seconds sont plus difficiles à comprendre, d'autant qu'ils affectent des médicaments prescrits pour des pathologies chroniques comme le diabète. Nous consacrons alors beaucoup de temps à la gestion de la rupture, notamment en contactant le médecin. On devrait pouvoir mieux prévoir les besoins dans ces cas de figure, d'autant plus quand il s'agit de médicaments nouveaux et donc sans alternative thérapeutique. Pour les molécules anciennes qui figurent sur la liste des génériques, c'est plus facile.
Concernant notre relation avec l'ANSM, les informations figurent sur son site Internet ; il faut cependant bien souvent aller à leur recherche, alors que le temps officinal est de plus en plus précieux. L'envoi direct d'alertes est plus commode en ce qu'il nous permet de voir instantanément la difficulté.
Dans les cas urgents, quand on promet au patient un médicament dans les 24 heures, nous passons un temps important à trouver le laboratoire qui nous permettra de substituer, si c'est possible, une molécule à une autre. Lorsque ce n'est pas possible, il arrive que nous devions recourir à deux dénominations communes internationales (DCI) au lieu de l'unique médicament dont le patient a l'habitude : il faut alors prendre le temps d'expliquer la substitution opérée, sans compter que cela multiplie le nombre de comprimés à prendre pour des patients souvent âgés et atteints de pathologies chroniques, qui en consomment déjà parfois dix chaque jour.
Tout cela entraîne des problèmes d'observance, des risques iatrogéniques, des coûts supplémentaires pour la collectivité, et une perte de temps pharmaceutique pour l'accompagnement de ces situations. L'image de l'ensemble de la chaîne pharmaceutique s'en trouve dégradée, alors même que le système français est de grande qualité.
La transparence est pour nous une priorité. Le secteur se tend, du fait de la concentration mondiale des sites de fabrication de principes actifs ; et lorsqu'un problème survient, nous devons être en mesure d'en expliquer la raison, puisque nous sommes, dans la chaîne d'approvisionnement, au contact direct des patients. Que pouvons-nous dire lorsqu'un vaccin est indisponible alors que le discours des autorités sanitaires vise à promouvoir la vaccination ? Les patients ne le comprennent pas toujours, et c'est bien normal. Dans de telles situations, nous sommes désarmés.
D'autres ruptures sont dues à des raisons très ponctuelles. Ainsi, un pic de pollen a entraîné au mois d'avril une rupture momentanée de certains antihistaminiques du fait de l'augmentation massive de la demande. Les fabricants ne peuvent pas toujours suivre. Quand on peut substituer d'autres médicaments, ce n'est pas grave, mais nous sommes démunis quand un patient ne peut tolérer certains excipients.
Mme Marie-Christine Belleville, membre de la 4e section de l'Académie nationale de pharmacie. - Nous venons de publier, le 20 juin dernier, un rapport sur ce sujet, qui nous préoccupe depuis longtemps. On a observé une bascule en 2007 et 2008. La pénurie de matières premières à l'échelle mondiale a fait l'objet d'une première séance thématique de notre académie en 2011 : ce problème est d'autant plus sérieux que 80 % des substances actives sont fabriquées en Chine et en Inde. Une autre séance a été consacrée, en 2013, aux causes des phénomènes de pénurie.
C'est un problème polymorphe qui requiert des solutions plurielles. Le rapport que nous vous présentons porte moins sur l'officine que sur l'hôpital, dans la mesure où nous avons été largement alertés par les oncologues et les infectiologues, mais les problèmes rencontrés par les deux secteurs sont superposables.
Nous continuons par ailleurs à travailler sur la question de la disponibilité des médicaments en officine dans la mesure où les patients nous y poussent. Nous devons les aider à mieux comprendre les ruptures. Nous avons relevé au cours de nos auditions une mise sous tutelle de l'industrie pharmaceutique en matière de communication : les documents diffusés par l'ANSM sont très stéréotypés, alors que l'on pourrait sans doute disposer de davantage d'éléments. Comparons avec le Canada : plus d'éléments y sont diffusés par les industriels ; c'est donc faisable. Nous allons également continuer à travailler sur la question des exportations parallèles.
L'Académie nationale de pharmacie regroupe environ 350 pharmaciens : 120 membres titulaires, auxquels s'ajoutent 230 correspondants et un grand nombre de membres honoraires - l'honorariat étant ouvert à partir de 70 ans. Nos six sections représentent tous les aspects de la pharmacie.
Notre groupe de travail a été réactivé en mai 2017. Nous avons procédé à des auditions et des vérifications pour l'établissement de notre rapport.
Notre premier constat est le manque de coordination entre les différents acteurs publics (ANSM, DGOS, ministère de l'industrie, CEPS, HAS...). Le deuxième est la forte dépendance de l'Europe, et donc sa fragilité, quant à l'approvisionnement en matières premières. Cette dépendance persiste et s'accroîtra encore.
On observe une augmentation de la demande mondiale de médicaments, avec un phénomène de croisement des courbes en 2013 entre la demande des pays développés et celle des pays émergents. La consommation mondiale d'antibiotiques, par exemple, diminue de 4 % dans les pays riches, mais augmente de 65 % en moyenne dans les pays émergents depuis 15 ans. Or il y a peu de sites de production de médicaments, notamment pour les antibiotiques, les médicaments dérivés du sang ou encore les vaccins. Ce dernier secteur compte très peu d'opérateurs de production.
Il faut absolument un pilotage durable au plus haut niveau, tant national qu'européen. Des mesures d'urgence doivent certes être prises au cas par cas ; mais nous avons également besoin de mesures structurelles sur le long terme.
Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en France étant resté stable sur les dix dernières années alors que de nombreuses molécules innovantes, notamment en oncologie, ont été mises sur le marché, la part de financement disponible pour les anciens produits qui restent indispensables a mécaniquement diminué. Cette tendance risque encore de s'accentuer au cours des prochaines années. Il nous faut travailler à résoudre cet énorme problème.
À l'hôpital se pose aussi le problème des produits injectables. Le nombre de sites de production de ces produits baisse au niveau international. Les petits médicaments abandonnés, en rupture de production, représentent un autre problème : il s'agit non plus seulement de ruptures de stock, mais bien d'indisponibilité à long terme de certains médicaments, phase ultime de ces tendances aboutissant à l'arrêt de commercialisation de certains produits, notamment pour des raisons de rentabilité. Certaines situations cliniques rares ne sont plus du tout couvertes.
Environ 62 % des ruptures, à l'hôpital, concernent les antibiotiques, l'oncologie et l'anesthésie-réanimation, soit les produits les plus indispensables ! L'Europe entière est confrontée au même problème. Une nouvelle étude, annoncée par les pharmaciens hospitaliers, a été terminée en juin 2018 et est en cours de dépouillement.
J'en viens aux causes. Ce sont les facteurs économiques, tout d'abord : le prix des médicaments anciens est souvent trop bas par rapport aux coûts de production, qui augmentent de manière importante du fait des obligations liées aux pratiques de fabrication et au respect des normes environnementales. On observe dès lors un effet de ciseaux. La France est par ailleurs défavorisée par un différentiel de prix, qui ne concerne pas que les médicaments innovants : certains médicaments anciens sont moins chers en France que dans d'autres pays, notamment en Allemagne.
La faiblesse des stocks est un autre facteur, que l'on ne peut imputer à la volonté des acteurs concernés. Ils sont en tension du fait de la hausse de la demande mondiale. On ne peut reprocher aux officines de limiter leur stock dans le contexte actuel, notamment sur des produits onéreux.
Les problèmes rencontrés à l'hôpital résultent en partie des procédures d'achat mises en oeuvre depuis le programme PHARE, qui tendent à devenir de plus en plus importantes, voire géantes. Certaines procédures couvrent la France entière et concernent la majorité des hôpitaux. Dans de telles situations, l'opérateur ne peut pas suivre, sans que d'autres industriels puissent compenser dans les mêmes proportions.
La fragilité de l'Europe pour la production de substances actives est elle aussi préoccupante, et devient même dramatique. La Chine a mis en place un programme environnemental en 2013 : 80 000 usines ont été fermées en 2017. Or l'une de ces usines fabriquait l'acide clavulanique utilisé pour la production d'Augmentin®, d'où une pénurie de ce produit à l'échelle mondiale. De tels problèmes affectent également les matières premières de synthèse nécessaires à la fabrication des principes actifs, qui sont également produites en Chine. Il faut donc une action politique forte en France, au niveau du Premier ministre, afin de mettre en oeuvre une politique industrielle et de préserver nos approvisionnements. Il en va de notre indépendance sanitaire et de la protection de la santé publique.
En matière de production de médicaments, il est difficile d'anticiper les besoins. La production d'un vaccin représente par exemple trois ans de travail (à l'exception du cas particulier du vaccin contre la grippe, produit en six mois). Il suffit ainsi que dix-sept pays dans le monde, dont les États-Unis, réinscrivent le vaccin de la coqueluche dans leur programme vaccinal pour que l'on en manque en Europe : il ne suffit pas de claquer des doigts pour en produire de nouveaux.
Il existe également un problème de différenciation retardée. Aux États-Unis, les produits peuvent être répartis au dernier moment sur le territoire dans la mesure où ce sont les mêmes formules et la même langue qui sont utilisées. En Europe, les formules diffèrent légèrement d'un pays à l'autre -surtout pour les produits anciens, qui ne sont pas passés par une procédure centralisée- et les langues sont différentes, ce qui oblige à la production de notices différenciées ; ainsi un produit valable pour la France ne l'est-il pas forcément pour la Belgique.
On observe par ailleurs que les centres de décision économique à l'échelle mondiale se décalent de plus en plus vers les États-Unis - les producteurs préfèrent produire dans le pays qui achète au meilleur prix...
On observe également une complexification progressive du cadre réglementaire des variations techniques d'AMM. Il faut trois ans pour changer la taille d'un lot, selon une mécanique excessivement complexe, car le cadre européen n'est pas si harmonisé qu'on le croit ; le contenu des dossiers demandés diffère selon les pays, et certains États mettent deux mois pour examiner leur recevabilité quand d'autres en prennent trente. Pendant ces périodes, la possibilité de recourir à des stocks additionnels est limitée dans la mesure où la période de validité avant péremption dure généralement deux ans. Les premiers pays ayant accepté la modification du produit seront dès lors les mieux servis.
Un autre aspect majeur réside dans les exigences de qualité. Le programme américain de compensation et d'atténuation des ruptures, mis en place en 2013, donne d'excellents résultats, puisque l'on est passé de 100 % à 10 % de rupture en matière de qualité ; c'est ce que l'on appelle la flexibilité réglementaire. Parallèlement, on observe en France, depuis 2015, un durcissement de la réglementation et un manque de reconnaissance mutuelle des inspections ; ainsi certains industriels nous ont-ils indiqué avoir soixante-dix inspections par an, dont certaines sont divergentes.

Quelle est la genèse de la fabrication des médicaments ? Les fabricants de matières actives sont plutôt concentrés en Asie. Est-ce parce que nous avons perdu la technicité dans ce domaine ou parce que les contraintes sociales ou environnementales y sont moindres ?
Les normes se sont durcies en Europe, notamment s'agissant des produits d'oncologie et anti-infectieux, parce qu'il s'agit de produits hyper-sensibles, ce qui justifie une protection renforcée de l'opérateur et de l'environnement. Or, en raison de la baisse de prix des médicaments, l'industrie a cherché des lieux où le coût du personnel était moins important. Dans les années 1990 et 2000, la Chine et l'Inde offraient des coûts de production moins élevés -c'est peut-être moins vrai aujourd'hui- et étaient moins regardantes sur l'écologie, d'où le basculement qui s'est produit. Si l'on veut réindustrialiser en France pour y produire des substances actives, il faudra retravailler certaines synthèses pour rendre leur production écologiquement acceptable, ce qui représente, là aussi, trois ans de travail. Au-delà de ce problème d'encadrement normatif, il s'agit aussi, malheureusement et en définitive d'un problème économique : il ne faut pas se le cacher.
Oui. D'ailleurs, en 2012, les États-Unis ont pris des mesures pour parer aux difficultés liées à la production chinoise. Les Chinois sont d'excellents commerçants mais ils peuvent mettre fin du jour au lendemain à une production qu'ils n'estiment plus rentable. Pour éviter ce phénomène, les États-Unis ont adopté la loi sur les génériques « Generic Drug User Fee Amendments » (GDUFA), qui instaure une taxe d'accréditation. Ainsi, le coût initial de l'entrée sur le marché incite à y demeurer plus longtemps pour amortir cette taxe. Ils ont également créé un système de qualification d'inspection. J'avais proposé cette option en 2013, voilà plusieurs années, mais il m'avait été rétorqué que cela était impossible ; pourtant, les auditeurs privés américains s'avèrent assez qualifiés pour mener leurs travaux à bien.
La Chine et l'Inde sont devenues les laboratoires pharmaceutiques du monde pour les matières premières. Cela tient à plusieurs facteurs : certes, leurs coûts de production sont plus faibles et leurs normes environnementales sont peut-être moins exigeantes, mais ce sont aussi et surtout les meilleurs façonniers au monde - et c'est là l'explication majeure à retenir. Aujourd'hui, ceux qui savent faire sont en Chine et, surtout, en Inde. À Bombay, il y a ainsi 5 000 entreprises pharmaceutiques, de la plus artisanale à la plus moderne.
Si l'on décide de relocaliser en France la production de certaines matières premières de médicaments, il faudra réapprendre à fabriquer ces substances. D'où l'urgence qu'il y a à se poser la question de la stratégie nationale. Dans un monde globalisé, où la fabrication d'un produit fait appel à des productions localisées dans différents pays, on ne maîtrise pas la totalité de la chaîne de production.
Nous ne disposons peut-être pas des mêmes capacités, mais nous avons d'excellents chimistes : nous en avons encore sous le pied, si j'ose dire. Le savoir-faire technique ne constitue pas selon moi le problème principal : il s'agit plutôt d'une question économique. D'ailleurs et de manière paradoxale, deux cent millions de Chinois aisés préfèrent recourir à l'industrie française ou européenne et font fabriquer certaines principes actifs en Europe.
Je représente la section industrielle du Conseil de l'Ordre. En matière de production, les situations diffèrent en fonction du cycle de vie des produits. Aujourd'hui, l'industrialisation est globale, mondialisée, et la question de l'approvisionnement des matières premières est un élément clef. C'est vrai, il y a de moins en moins de producteurs de matière première, ce qui implique une tension sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. Néanmoins, si nous ne produisons pas l'ensemble de nos matières premières, nous en produisons certaines, notamment pour les produits en développement, dans la première partie de leur cycle de vie. En revanche, effectivement, plus le produit devient mature, plus on achète les matières premières auprès de fournisseurs.
Je veux revenir sur les distributeurs en gros. Les dépositaires sont des prestataires de l'industrie pharmaceutique. On entend dire qu'ils ne sont pas transparents, mais ils font ce que leurs donneurs d'ordre leur disent de faire. On ne peut les soupçonner de prendre des initiatives conduisant à des pénuries.
Quant aux grossistes-répartiteurs, ils ont des obligations de service public : ils doivent en permanence disposer de 90 % des médicaments vendus sur le territoire et d'un stock représentant quinze jours de vente sur leur zone de chalandise déclarée.
Notre coopération avec l'ANSM est de bonne qualité, mais elle est sans doute perfectible. Nous souhaiterions en effet que, en plus de la liste des médicaments en rupture ou risques éventuels de rupture - qui ne se réalisent pas forcément -, nous soyons informés du nombre de molécules réellement en rupture. Cela nous permettrait de comparer les estimations de l'ANSM avec les nôtres.
Nous souhaitons aussi et surtout connaître les raisons de la rupture de stock d'un médicament. Est-ce lié à une pénurie, à l'augmentation de la demande, ou encore à l'arrêt d'une chaîne de production en raison d'une contamination ? Certains médicaments peuvent être en rupture en période d'épidémie, mais ce n'est pas un problème de production, cela tient plutôt à une demande ponctuelle plus importante que prévu.
Ensuite, en cas de situation de rupture problématique, il faudrait que nous puissions disposer de suffisamment d'éléments pour améliorer notre communication vis-à-vis des patients. S'il sait ce qui se passe réellement, le pharmacien peut mieux informer le patient.
Il y a deux facteurs à ces ruptures. Il y a, d'une part, un aspect industriel, lié à la concentration de la production voire des essais cliniques, et à une optimisation des stocks qui entraîne des tensions inacceptables s'agissant du secteur de la santé.
Il y a, d'autre part, les relations entre les laboratoires, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens, facteur non négligeable dans la réalisation des ruptures. Si, malgré son obligation de service public, le grossiste-répartiteur ne dispose pas du produit demandé, il ne peut pas en distribuer plus ni en stocker davantage. Il arrive d'ailleurs que des laboratoires décident de limiter l'approvisionnement des grossistes pour prévenir les exportations parallèles. Ainsi, même si le produit n'est pas en rupture au laboratoire, il peut l'être pour la chaîne de distribution si la fluidité de l'approvisionnement a été défaillante. Seule la transparence peut nous permettre de remédier à de telles situations et le portail DP-Ruptures peut y contribuer, sous réserve que tous les acteurs y participent et que les informations existantes soient exploitées.
Je précise par ailleurs que la concentration de la production des matières premières à l'étranger ne concerne pas que les génériques : toutes les matières premières sont fabriquées dans ces pays.

Du reste, ce sont les mêmes pour les princeps et pour les génériques.
L'un des objectifs de la mission d'information est de comprendre si des stratégies d'optimisation financière et économique - je le dis sans jugement, nous vivons dans un monde capitaliste et les laboratoires ont, comme toute entreprise, pour premier objectif de faire du profit - ont des conséquences en matière de santé publique. En vous écoutant, je ne suis pas rassuré, car l'organisation de la production, avec cette concentration de la fabrication des matières premières en Chine et en Inde, fragilise le reste du monde. Les causes en sont nombreuses ; il y a une dimension économique, mais cela également trait à l'acquisition, par ces pays, d'une compétence qu'il ne serait pas simple de relocaliser.
Il y a aussi la question de la distribution. J'ai découvert, pour ma part, l'existence des dépositaires ; nous connaissons tous les laboratoires, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens, mais moins ces acteurs, qui n'ont pas fait l'objet de dispositions dans le cadre des derniers PLFSS. Si je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle important dans les situations de pénurie, il reste une question sous-jacente sur les grossistes-répartiteurs. Lorsqu'un laboratoire leur vend des médicaments, ils en deviennent propriétaires puis les redistribuent. Exportent-t-il une partie de ce stock pour en obtenir une marge plus importante sur des marchés étrangers ?
Dernière question, les pharmaciens n'achètent pas tous les médicaments via les grossistes répartiteurs ; ont-ils des lignes directes avec les laboratoires ? Quel mode de relation entretiennent-ils avec eux ?
Je veux réagir sur la stratégie industrielle et commerciale des entreprises. Une des missions des entreprises du médicament est de mettre leurs produits à la disposition des patients : il n'y a pas l'ombre d'un doute à avoir sur leur volonté d'y satisfaire. Les pharmaciens responsables ont l'obligation d'assurer un approvisionnement « approprié et continu », en vertu du code de la santé publique : c'est une spécificité française. L'organisation de difficultés d'approvisionnement du marché en raison de facteurs économiques n'est pas une situation observable aujourd'hui en France.
Les dépositaires agissent au nom et pour le compte de l'exploitant. Le traitement de la volumétrie des commandes est placé sous la responsabilité du donneur d'ordre, c'est-à-dire de l'industriel qui commercialise les médicaments et les vaccins.
Je pense que les grossistes-répartiteurs commencent à retravailler sur leurs systèmes de gestion et d'information interne.
S'agissant des contingentements, chaque industriel fournit en début de mois une quantité donnée de produits. Les produits arrivent tous en même temps chez le grossiste-répartiteur. Certains peuvent apparaître comme manquants dans les terminaux informatiques uniquement parce qu'ils n'ont pas encore été enregistrés dans le système d'information.
C'est cela. Autre cas, les médicaments soignant des pathologies graves ou chroniques mais concernant de petites populations. Si autrefois les grossistes répartiteurs servaient toute la collection dans l'ensemble des 200 agences, ils ne servent désormais qu'une seule agence dans une zone géographique lorsqu'une spécialité est trop rare. Il arrive qu'une seule pharmacie dans un secteur ait besoin d'un produit donné : cela pose un problème de répartition des produits. J'ai pu observer que les grossistes pouvaient indiquer aux officines que leur produit se trouvait par exemple à Montauban, alors que son agence habituelle se trouve à Agen ; il faut alors le temps de le transférer d'une agence à l'autre. C'est plus difficile qu'on ne le croit. On ne parle pas ici de Doliprane®...
Les grossistes-répartiteurs peuvent avoir des stratégies de distribution sélective pour les produits les plus onéreux, dont certains passent plus vite en Allemagne qu'on le voudrait. Je crois cependant qu'il y a des efforts faits chez les répartiteurs, même si tout n'est pas parfait.
Les officinaux sont quant à eux de plus en plus attentifs lorsque la date à laquelle le patient va venir chercher son produit se rapproche.
Les grossistes-répartiteurs sont approvisionnés au prorata de leur part de marché. Ils ont donc normalement la bonne quantité de chaque produit. Là où cela se corse, c'est qu'ils ont des jours précis de commande auprès des laboratoires : c'est ce que l'on appelle le cadencement. Si vous oubliez de passer votre commande le lundi, vous ne pouvez pas le faire le mardi. Si par ailleurs le lundi tombe le 14 juillet, la commande n'est pas prise en compte. Ce cadencement ajoute des jours supplémentaires à la rupture.
Les livraisons peuvent avoir été faites chez le grossiste-répartiteur, mais pas encore déballées et mises en stock. Il y a des délais qui ne sont pas nécessairement compressibles. Tout n'est pas dû à une rupture de produit en soi : il y a des cas dus à des mécanismes pervers de gestion, qui entraînent des retards.
Les exportations parallèles existent bel et bien : si ce n'était pas le cas, leur interdiction n'aurait posé de problème à personne. Il suffit de lire le rapport de l'Autorité de la concurrence de 2014. Je ne dis pas qu'elles sont les seules causes de tension ; mais elles provoquent une perte de confiance dans les acteurs de la chaîne du médicament. Le grossiste-répartiteur est un logisticien ; il a des obligations qu'il ne respecte pas toujours. Certaines officines en milieu rural doivent ainsi payer des frais de livraison lorsqu'elles font appel à un autre grossiste-répartiteur que celui ou ceux auxquels elle fait appel habituellement : ce ne sont pas de bonnes pratiques.

Une officine peut donc avoir plusieurs grossistes-répartiteurs ? Comment le choix se fait-il ?
Cela dépend d'accords de services, de la proximité, du nombre de livraisons par jour. Il vaut mieux pour une officine travailler avec au moins deux grossistes-répartiteurs, sinon trois, car ils n'ont pas les mêmes ruptures. Le grossiste répartiteur a une obligation de service public qui n'est pas respectée lorsqu'il impose à une officine des frais de livraisons, alors qu'il dispose déjà d'une marge pour se rémunérer.
Les pharmaciens peuvent s'adresser directement aux industriels, via un dépositaire ou non. Cela relève de choix de gestion de la part des entreprises : traditionnellement, nous travaillons beaucoup en direct avec certains laboratoires comme Sanofi. Heureusement que nous avons un approvisionnement pluriel, sans quoi nous serions dans de plus grandes difficultés encore ! Ce qui pose problème, c'est quand le laboratoire vous impose de travailler en direct, sous prétexte qu'il s'agit d'un médicament onéreux ou que la population concernée par un produit est faible. Dans ce cas, si vous commandez le vendredi, vous n'aurez le médicament que le mardi : la qualité de l'approvisionnement se trouve dégradée.
Ils ne veulent pas donner aux grossistes un produit s'il est rare et cher, quand bien même il est indispensable. Mais ils pourraient au moins le donner à un établissement central, s'ils ne veulent pas le donner à l'ensemble d'entre eux : cela permet d'approvisionner dans la nuit l'établissement local qui en formule la demande et de revenir à des délais raisonnables. Ces pratiques des laboratoires nous causent un travail supplémentaire, car la commande n'est pas automatisée.
Le pharmacien d'officine est un professionnel de santé de premier recours, qui doit faire preuve d'accessibilité et de disponibilité. Nous aussi sommes responsables d'un service public, en coopération avec les grossistes-répartiteurs. Il est important de rappeler la place qui est la nôtre dans la prise en charge de la santé publique.
Nous passons normalement commande le soir avant la fermeture pour une livraison le lendemain matin. Grâce au DP-ruptures, nous pouvons être informés que la livraison n'interviendra qu'un ou deux jours plus tard, par exemple parce que l'agence locale doit être approvisionnée par l'agence régionale : cela nous permet d'anticiper l'accompagnement du patient dans la délivrance de son traitement. Il y a une différence entre un « manque labo », un « manque quota » ou un « manque rayon », et il est important de pouvoir en être informés au quotidien.
Je remercie les grossistes-répartiteurs lorsqu'ils peuvent nous fournir des dotations de Pneumovax®. Ce produit devait normalement être disponible en septembre 2017, mais nous devons gérer des listes d'attente, presque des tickets de rationnement ! Il est inacceptable d'avoir vingt à trente patients fragiles en attente, qui sont concernés par les modifications du calendrier vaccinal, et de devoir demander à la protection maternelle et infantile (PMI) la plus proche si elle ne peut pas en prendre en charge un ou deux... Nous sommes heureux quand les grossistes-répartiteurs nous trouvent deux ou trois vaccins et que nous pouvons dire à quelques patients qu'ils n'attendront pas davantage. Le choix du grossiste-répartiteur est un choix d'affinité, de proximité et de facilité commerciale.
Il résulte cependant des questions de logistique et de gestion évoquées par les collègues des différences d'image entre officines qui n'ont pourtant rien à voir avec la compétence de leurs praticiens. Quand on est au contact avec les patients, c'est difficile à vivre : il faut en tenir compte.
L'achat direct au laboratoire peut être une bonne idée si l'on souhaite passer une commande importante. Il existe cependant plusieurs cas de figure. L'OFEV®, par exemple, est un médicament d'exception contre la fibrose pulmonaire, prescrit uniquement par un spécialiste hospitalier, et que nous pouvons commander uniquement auprès du laboratoire pour une livraison le lendemain matin. Pour ce type de produit, nous anticipons afin de mettre en place un accompagnement supplémentaire du patient, et prenons garde à intégrer le week-end dans nos prévisions de commande. Pour d'autres médicaments comme l'Humira®, il existe deux formes galéniques différentes : de manière surprenante, le stylo injectable est disponible par commande directe auprès du laboratoire, tandis que la seringue est distribuée par les grossistes-répartiteurs. Cela nous permet de passer des commandes directes lorsque la forme seringue est en rupture. Nous sommes cependant obligés à un exercice intellectuel permanent pour prévenir et gérer les difficultés d'approvisionnement, et devenons ainsi logisticiens.
Les patients commencent à être confrontés à ces ruptures : ils nous appellent à l'avance. Mais le système français est arrivé à saturation. Il a le mérite de permettre la confiance des patients dans les médicaments, car il n'y pas de médicament contrefait, grâce au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Mais attention ! Un patient sur deux télécharge des applications de santé ; on parle de plus en plus de télémédecine ; 75 % des patients de plus de 12 ans ont un smartphone. Si le système français réglementé n'est plus capable de satisfaire leurs besoins, les patients achèteront leurs médicaments sur Internet. C'est un risque de santé publique qu'il faudra prendre en compte.

En vous écoutant, nous avons bien conscience que le métier de pharmacien est un peu plus compliqué que de tirer un tiroir pour y prendre une petite boîte et la mettre sur le comptoir....

Merci d'avoir rappelé que les pharmaciens participaient au service public. L'apparition du pollen a suscité une pénurie... ?
Oui, une épidémie d'allergie a provoqué une tension. Certains produits étaient en rupture, mais nous avons pu nous en sortir grâce aux génériques. Cependant, à l'heure actuelle, trois génériqueurs sont encore en rupture.

On estime le taux général de contrefaçons à 10 à 15 %. Vous avez la certitude qu'il n'y en a jamais dans les médicaments ?
La chaîne d'approvisionnement repose sur plusieurs professions réglementées. Nous commandons auprès des grossistes-répartiteurs, qui, eux, se fournissent auprès des industries pharmaceutiques. Cette chaîne garantit la non-falsification des médicaments.
Dans le circuit classique, aucun médicament contrefait n'est introduit. Je ne dis pas que l'Europe n'est pas exposée, mais certainement pas comme l'Afrique. Si vous achetez des médicaments sur Internet, vous êtes nécessairement exposé à ce risque...
Si, mais comment interdire un achat sur un site étranger ? C'est une vraie faille. L'Europe a récemment introduit le principe de la sérialisation pour sécuriser encore davantage le circuit de distribution des médicaments et dispositifs médicaux. Il faudrait cependant que toutes les transactions, quelle que soit leur localisation, et pas seulement la transaction finale, soit suivies. D'une manière générale, le système fonctionne cependant très bien.

La vente sur Internet est un sujet à lui tout seul. Je peux acheter du Pneumovax® sur Internet ?
Non, il est en rupture.
Si vous en trouvez, je ne vous conseille pas de l'acheter : c'est forcément une contrefaçon.
Nous sommes tous d'accord sur la robustesse de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Il n'est pas possible d'introduire un produit contrefait dans la chaîne.
A ce jour, pas un seul n'a été détecté en France dans la chaîne de distribution. Sur Internet, c'est un sur deux.
Les ruptures sont un vrai problème à l'hôpital. Dans mon établissement, j'en ai recensé 53 dans toutes les classes, depuis le début de l'année 2018. Ce sont les mêmes que celles qui ont été citées auparavant. Nous nous fournissons en lien direct avec les laboratoires ; les grossistes-répartiteurs ne représentent qu'à peine 1 % de nos achats - du dépannage pour l'essentiel.
Nous subissons ruptures et contingentements de plein fouet, sans avoir le plus souvent de solution alternative. Notre politique d'appels d'offres, via le plan Phare (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables) a permis de fortes baisses de prix. Un médicament génériquable sous brevet qui perd ce dernier perd 80 à 90 % de son prix du jour au lendemain ; c'est ce qu'on appelle la falaise du brevet. Au renouvellement de l'appel d'offres, le prix chute avec l'arrivée des génériques. Il faut bien comprendre la contrepartie de ce système : le laboratoire titulaire du brevet se retire de la procédure d'achats, les génériqueurs se font concurrence, puis il n'en reste qu'un.
Le Fluorouracile® est un MITM indispensable pour de nombreuses chimiothérapies. Comme son prix est au plus bas, les fabriquant préfère le vendre aux Etats-Unis, où il est vendu beaucoup plus cher. C'est par ailleurs un produit difficile à fabriquer et fréquemment concerné par des rejets de lots. Pour les oncologues, cela impose de changer de protocole, mais un rapport de l'Académie montre que cela ne donne pas les mêmes résultats cliniques, ce qui occasionne une perte de chances pour les patients...

Si je comprends bien, il y avait monopole d'un médicament princeps, puis concurrence entre génériques, puis monopole d'un générique. Mais pourquoi cela occasionne-t-il une rupture ?
Le marché est très tendu. S'il y a un défaut de fabrication chez le producteur ayant gagné l'appel d'offres, il ne peut plus livrer. S'il y a un autre producteur pour un MITM, l'ANSM lui dira de livrer tout le monde, mais comme il ne pourra le faire correctement, il perdra ses propres contrats... C'est un effet domino !

Mais pourquoi y a-t-il plus de tension que lorsqu'il n'y avait qu'un seul princeps ?
À l'appel d'offres, nous ne retenons qu'un seul acteur qui est dès lors seul responsable de l'approvisionnement. Les autres l'intègreront dans leurs prévisions. Lorsque l'ANSM se retourne vers eux, soit il n'y a plus de chaîne de production, soit elle est insuffisante. Au stade du princeps, il y a un outil industriel qui permet de répondre à la demande. Ce n'est plus le cas dès lors que le marché devient plus fragmenté.
L'information du médecin est aussi très importante. Or, les médecins sont peu ou mal informés par les autorités de santé. L'anticipation permettrait d'amorcer un dialogue avec les patients sur les alternatives thérapeutiques.
Dans le circuit national, il n'y a pas de cas avéré de contrefaçon : il est étanche et, malgré les déremboursements récents, beaucoup de médicaments restent remboursables, ce qui ôte l'attrait de l'achat sur Internet. Chez nos voisins, on a enregistré trois cas de médicaments contrefaits, découverts par les patients qui, en ouvrant leur boîte, s'aperçoivent que les comprimés n'ont pas l'aspect usuel. Les trois cas sont en Allemagne.
L'Angleterre et la Suisse sont aussi touchées.
C'est lié à la distribution parallèle, qui est parfois doublée par la contrefaçon.
Quant à l'export parallèle, c'est une réalité. C'est d'ailleurs une activité parfaitement légale pour les grossistes-répartiteurs.
C'est indiqué noir sur blanc sur leurs autorisations d'ouverture d'établissements pharmaceutiques. Mais ces flux sont très marginaux. Par ailleurs, même si les grossistes-répartiteurs représentent moins de 1 % de l'approvisionnement des hôpitaux, ceux-ci ressentent fortement - comme les officines - les ruptures.
N'oublions pas les pharmaciens des territoires et départements d'outre-mer, qui voient s'ajouter au délai de mise à disposition le temps de transport.
C'est vrai aussi lorsqu'un médicament est produit à l'étranger.
Lorsqu'un MITM vient à manquer sur le territoire, l'ANSM en importe. Sont ensuite délivrées des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) nominatives, les produits étant délivrés par les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux. À l'hôpital, cela ne pose pas de problème mais pour un patient qui va habituellement à la pharmacie, ce nouveau circuit de distribution peut perturber ses habitudes et le déstabiliser. Aussi avions-nous demandé à ce que les pharmaciens d'officine puissent également délivrer des ATU, mais ce n'est toujours pas possible.

Les ATU n'ont plus de secret pour nous ! Elles imposent d'aller acheter le médicament dans une pharmacie d'hôpital.
La réglementation l'impose en effet. Pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM), les industriels importent des équivalents étrangers, et il peut arriver que des produits de ville ne soient plus disponibles qu'à l'hôpital.
La loi de santé publique de 2016 comporte une disposition à cet égard, que l'on n'a pas encore fait vivre. C'est pourtant une demande forte des associations de patients : aller à l'hôpital, c'est être un peu plus malade.

Nous avons beaucoup parlé de transparence. Quelles sont vos préconisations ?
Le conseil de l'ordre veut non seulement de la transparence mais aussi une meilleure information, pour une meilleure compréhension. Il importe que chaque acteur puisse comprendre avec précision chaque situation. Quelle que soit la durée d'une rupture, ses causes peuvent sans doute être mieux identifiées et cette information mieux partagée.
Le pharmacien d'officine devrait être autorisé, en cas de rupture avérée, à recourir à un médicament équivalent, pourvu qu'il en informe le médecin. Il faudrait aussi un coordonnateur national auprès du Premier ministre, qui pourrait anticiper les ruptures, car ce phénomène, en devenant chronique, revêt une importance stratégique.
Plutôt que de pallier les effets des ruptures, il faut mieux les anticiper en traitant leurs causes. D'abord, il faut une stratégie européenne de fabrication et de constitution de stocks-tampons, en concertation avec les industriels. Puis, il faut prévenir les ruptures occasionnées par la chaîne de distribution. L'outil actuel DP-Ruptures, automatisé, fonctionne bien, et bénéficie de la légitimité de l'Ordre. Encore faut-il qu'il soit alimenté par une information exhaustive, et que celle-ci soit traitée convenablement, sans volonté de substitution. Cela réduirait de 30 % à 40 % les cas de rupture.
Il me semble par ailleurs qu'au Québec, les pharmaciens peuvent déjà proposer un médicament équivalent en cas de rupture. Ils perçoivent pour cela une rémunération supplémentaire, car c'est une responsabilité en plus. Cette possibilité va plus loin que la faculté de substitution de génériques : il s'agit ici de changer de molécule.
Oui, ils le peuvent, depuis 2015 au moins. Pour nous, une coordination au plus haut niveau est indispensable. Il faut également un plan d'action sur chaque produit, qui soit public et suivi, et la cause de chaque rupture doit être communiquée. Les appels d'offre des hôpitaux doivent être revus pour rester régionaux. Sinon, la pénurie au centre frappe tous les autres établissements.
Il faut anticiper les ruptures, en détectant les hausses de pathologies chroniques, les épidémies et les évolutions dans les recommandations de prise en charge. Il faut aussi davantage de transparence : les pharmaciens d'officine ont beaucoup souffert de la polémique sur le Levothyrox®. C'est la première fois que les patients ont été ainsi montés contre leurs pharmaciens par les médias ! À telle enseigne que, le lendemain, certains sont revenus s'excuser. Enfin, à préconisation identique, les pharmaciens doivent pouvoir remplacer un médicament par un autre médicament équivalent.
Nous pouvons substituer un générique à un médicament. Mais proposer une autre molécule pour la même indication est autre chose.
On le fait à l'hôpital en cas de rupture.

C'est qu'il y a une plus grande proximité entre pharmaciens et médecins.
Oui, à travers le comité des médicaments.
Il faudrait peut-être développer une telle proximité en ville.
Proposer un équivalent a un impact sur le coût pour l'assurance-maladie, et il faut en informer le médecin. L'ANSM peut former à cela.
On pourrait accroître la rapidité d'information des professionnels. Les industriels ne communiquent pas directement envers les patients, car la communication professionnelle de santé est verrouillée par les autorités - ce qui est bien légitime.
Je signale toutefois que les professionnels de santé ne sont pas très versés dans l'écrit. Pour le Levothyrox®, 240 000 courriers leur ont été par trois fois envoyés, sans beaucoup d'effet.
Nous avons réuni en septembre les médecins et les pharmaciens, et cela a apporté un apaisement certain, après l'emballement médiatique.
Il faudrait renouveler ce type d'initiative, mais en amont.

J'ai vécu la crise du Levothyrox® de très près. J'espère qu'elle ne rebondira pas après les analyses en cours.
Les pharmaciens hospitaliers n'ont pas noté d'effets indésirables tant que les patients n'étaient pas au courant de ce que les médias disaient.

J'ai l'expérience inverse, et bien documentée ! Je comprends bien que la situation des pharmaciens d'officine n'est pas facile dans cette affaire. Les ruptures concernent-elles également les médicaments chimiques et biologiques ?
Uniquement les médicaments chimiques. Les médicaments biologiques de référence, pas plus que les biosimilaires, n'ont connu de rupture. Heureusement, car le changement de traitement serait complexe.
La zone la plus fragile, dans leur production, est dans les premières années. Les autorisations de mises sur le marché n'arrivent pas toutes en même temps, mais elles peuvent générer des tensions fortes. Et, pour des produits biologiques, l'exigence de qualité est une fragilité. Pour les biosimilaires, les mêmes conditions prévalent.
Les biosimilaires sont introduits à l'hôpital pour faire des économies, comme ce fut le cas pour les génériques, même si l'écart de prix n'est pas le même. Et les médecins hospitaliers adaptent leurs prescriptions aux appels d'offre.
Deux sujets relèvent d'une stratégie nationale : la relocalisation, à long terme, et les mécanismes de détermination des prix des MITM - d'autant que le plan de M. Trump nous promet de sérieuses négociations avec les États-Unis.

Les décisions du président des États-Unis font peser une menace non seulement sur les approvisionnements en médicaments, mais sur le commerce mondial en général.
Notre commission des affaires sociales a décortiqué le sujet du prix des médicaments sous tous ses aspects.
Pour ce qui concerne les pénuries, nous avons bien conscience de l'existence de médicaments anciens dont l'utilité thérapeutique reste néanmoins très importante, et dont les laboratoires arrêtent la fabrication, leur prix étant si bas qu'ils ne trouvent plus d'intérêt à les vendre. La même molécule, d'ailleurs, réapparaît parfois sous un autre nom, vendue cinq ou dix fois plus cher ! Autrement dit, il pourrait être économique d'augmenter certains prix.
Tout à fait. Il faudrait que le CEPS (comité économique des produits de santé) le comprenne.

Mais le CEPS, hélas, ne se préoccupe que des médicaments dits innovants.
Mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre participation ; vous nous avez donné beaucoup d'éléments dont j'espère que nous saurons tirer le meilleur parti. Il n'y a pas de solution miracle, mais peut-être ferons-nous avancer les choses.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Audition de M. Emmanuel Déchin délégué général de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique csrp et de M. Hubert Olivier vice-président de la csrp et président-directeur général d'ocp répartition
Audition de M. Emmanuel Déchin délégué général de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique csrp et de M. Hubert Olivier vice-président de la csrp et président-directeur général d'ocp répartition

Notre mission d'information poursuit ses travaux par l'audition de MM. Hubert Olivier, vice-président de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) et président-directeur général de l'entreprise OCP Répartition, et Emmanuel Déchin, délégué général de la CSRP. Elle sera l'occasion d'échanger sur le rôle essentiel des grossistes-répartiteurs dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments et vaccins des 22 000 officines réparties sur le territoire national. Ils assurent l'approvisionnement continu du marché français, afin de répondre aux besoins des patients et participe, à ce titre, à la prévention et à la gestion des ruptures de stock.
Eu égard à ces obligations de service public, le juste niveau de rémunération de la distribution, en particulier pour les médicaments génériques, apparait déterminant - ce sujet n'est pas à proprement parler celui de la pénurie, mais nous y avons été sensibilisés. Nous serons également attentifs à votre évaluation de la collaboration entre grossistes-répartiteurs, laboratoires exploitants, officines et pouvoirs publics dans la prévention et la gestion des situations de pénurie, et à votre sentiment sur certaines pratiques économiques, du côté de l'offre comme de la distribution, pouvant induire des risques de ruptures.

La matinée a d'ores et déjà été très riche ; n'appartenant pas au monde de la santé, je fais de nombreuses de découvertes. Mon regard, en tant que membre de la commission des affaires économiques, est un peu différent de celui de notre président, membre de la commission des affaires sociales.
Vous avez déjà reçu un questionnaire fourni, qui pourra servir de trame à cette audition. Je souhaite vous poser, très brièvement, quelques questions complémentaires. Estimez-vous efficace votre coopération avec les autorités sanitaires, notamment avec l'ANSM, lors d'une rupture de stock ? Pourriez-vous nous fournir quelques précisions sur le rôle des dépositaires de médicaments dans la chaîne de distribution et sur la manière dont ils contribuent, ou non, à prévenir les situations de rupture ? Quelle est votre appréciation des différents dispositifs mis en place par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en particulier des obligations qui incombent à votre profession ?
Vous représentez un maillon important de la chaîne du médicament ; nous sommes impatients d'entendre vos propositions pour remédier aux pénuries.
Nous vous remercions de votre invitation et allons tenter de vous éclairer sur le fonctionnement de notre métier.
La CSRP agit sur la distribution des médicaments en ville et, très minoritairement, vers l'hôpital, où nous traitons moins de 1 % des flux. Or, si le phénomène des pénuries est extrêmement problématique, il l'est surtout à l'hôpital, s'agissant notamment des anticancéreux et des antibiotiques.
Notre métier consiste à acheter les produits de santé auprès des laboratoires, à les stocker puis à les vendre aux officines de ville. Nous travaillons sur une gamme extrêmement large de plus de 35 000 références.
Il convient de distinguer ruptures de médicaments et situations de pénurie. Il n'existe pas de définition uniforme des ruptures ; d'après les textes, il y a rupture lorsqu'un pharmacien se trouve dans l'incapacité de délivrer un produit pendant 72 heures. Nous voyons les choses différemment et qualifions de rupture la situation où un produit n'est pas disponible au moment où nous le commandons. Les ruptures ainsi définies sont fréquentes ; leur durée peut être très courte, mais aussi relativement longue. Il y a a contrario pénurie lorsqu'un produit est durablement indisponible : les patients ne peuvent plus être traités et se pose un véritable problème de santé publique, qui ne peut être réglé que par le recours à un traitement alternatif ou par un report du traitement. Les pénuries, heureusement pour notre pays, sont beaucoup moins fréquentes que les ruptures. En matière de distribution de médicaments en ville, les pénuries concernent avant tout les vaccins. Pour le reste, il n'arrive pour ainsi dire jamais que nous soyons durablement sans solution.
Nous sommes approvisionnés - je parle de l'ensemble de notre profession - à hauteur de 85 % en moyenne des quantités que nous commandons auprès des laboratoires : 15 % des unités sont donc manquantes dès la commande. En aval, le chiffre est de 95 % : sur le total des produits commandés par les pharmacies françaises, la proportion de ceux que nous ne sommes pas en mesure de leur livrer est donc seulement de 5%.
Notre métier s'inscrit dans le cadre d'obligations de service public - nous sommes dans l'obligation de détenir en permanence au moins 90 % des références de médicaments existants et au moins deux semaines de stocks de consommation courante. L'existence même de la répartition pharmaceutique permet de diviser par trois les quantités manquantes entre ce qui est commandé aux laboratoires et ce qui est livré aux officines. Grâce à la répartition, la chaîne de distribution est donc relativement efficace.
Ces chiffres ne signifient pas que les 5 % de médicaments que nous ne pouvons livrer se traduisent immédiatement en ruptures du point de vue des patients : tout dépend des stocks des officines, que nous ne maîtrisons pas. Il se peut qu'une rupture courte ne soit pas perçue par les patients ; en revanche, si la durée de la rupture au sens de l'acteur intermédiaire que nous sommes est longue, cette situation peut tomber dans la définition des ruptures telle qu'elle s'applique au niveau des officines, c'est-à-dire 72 heures d'indisponibilité.
Les ruptures concernent la quasi-totalité des classes thérapeutiques, presque tous les types de produits et un très grand nombre de laboratoires : le phénomène est général. Il peut s'agir d'un produit générique, auquel le pharmacien peut substituer une autre marque, ou de produits de grande consommation médicale, type paracétamol, pour lesquels il existe différents fournisseurs. Cette année, des ruptures sont intervenues, au début du printemps, sur les antihistaminiques, mais la reconstitution des stocks s'est faite très rapidement et personne n'en a entendu parler.
L'essentiel des difficultés que nous traitons est donc invisible du point de vue de la santé publique. Une exception - il s'agit probablement de notre principale difficulté : 10 % des produits que nous traitons, qui représentent 50 % de la valeur du marché, sont des produits « sous quota » ou « sous contrainte d'allocation », pour lesquels le laboratoire définit la quantité qu'il livre aux répartiteurs. Ces produits sont compliqués à gérer ; les pharmaciens le savent et adaptent leurs comportements d'achat aux contraintes de quantité. Nous devons donc fréquemment traiter des situations de non-disponibilité de produits sous quota.
La mise sous quota ressort d'une décision du laboratoire : 600 spécialités pharmaceutiques, sur 10 000, sont soit sous quota soit sous contrainte d'approvisionnement, soit 10 % du volume et 50 % de la valeur du marché. Les médicaments concernés sont en général d'un prix élevé ; ils peuvent être d'intérêt thérapeutique majeur. Dans ce genre de situations, le produit est en général disponible en début de mois ; il l'est moins en fin de mois.

La France est-elle davantage exposée que ses voisins européens aux phénomènes de pénurie ?
A défaut de disposer d'éléments chiffrés, nous savons que la situation française n'est pas isolée. Par exemple, les pénuries de génériques sont assez fréquentes en Grande-Bretagne - les génériques y sont achetés par appels d'offres, ce qui peut concentrer le marché sur un ou deux laboratoires et fragiliser l'approvisionnement. Nous ne pouvons pas vous renseigner de façon précise ; les ruptures relèvent avant tout d'enjeux industriels de fabrication, et les laboratoires sont internationaux.

Des textes législatifs ont été produits ; chacun souhaite leur application. Quelles sont vos obligations, en tant que grossistes-répartiteurs, en matière de signalement des difficultés d'approvisionnement ?
Les principales obligations des grossistes-répartiteurs sont permanentes et ressortent de leur mission de service public en matière de stockage, de modalités de livraison et d'astreinte. Elles assurent efficacement et sans discrimination la livraison des officines. Nous devons approvisionner le marché français de façon appropriée et continue, mais également signaler toute rupture de stock qui n'aurait pas fait l'objet d'une information de l'ANSM ou d'un laboratoire.

Votre profession est régulièrement mise en cause au sujet des pénuries, au motif qu'elle exporterait certains médicaments aux dépens des pharmacies françaises. Sachez que je n'ai nul grief contre les grossistes-répartiteurs, dont j'ai pu observer, dans mon département, la compétence et le sens de l'intérêt général. Je suis également sensible à vos arguments économiques s'agissant notamment des médicaments génériques. Mais vous arrive-t-il parfois de privilégier l'exportation pour une raison commerciale ? Quel est l'impact de la demande européenne sur le marché français ?
Cette accusation revient effectivement souvent en situation de pénurie... Elle est cependant très éloignée du coeur du problème !

Il est exact que vous n'intervenez que pour 1 % des ruptures, fréquentes, de produits à l'hôpital...
Absolument ! Si les grossistes-répartiteurs étaient responsables des ruptures d'approvisionnement, comme expliquer leur fréquence à l'hôpital, notamment sur des anticancéreux, où nous n'intervenons pas ? Avant d'épouser la profession il y a six ans, j'exerçais dans l'industrie pharmaceutique, où il était habituel car arrangeant de faire peser la responsabilité des ruptures sur les grossistes-répartiteurs. Fort heureusement, les opinions ont évolué et il est désormais reconnu que les ruptures résultent d'une multiplicité de facteurs liés à la fabrication des produits, notamment l'accès contrarié à des principes actifs en provenance d'Asie et le recul des capacités de production des laboratoires, qui causa par exemple récemment une rupture en Ibuprofène.
Vous avez eu la gentillesse de le souligner : nos entreprises sont engagées et responsables ; elles agissent dans un cadre légal précis au service de l'approvisionnement du marché français. Leur activité d'export, qui ne porte que sur des stocks additionnels, apparaît donc largement secondaire, bien qu'elle s'avère plus rémunératrice. Du reste, notre profession connaît d'inquiétantes difficultés financières, comme le soulignait récemment la Cour des comptes. Malgré l'export, nous ne dégageons aucun bénéfice : les autorités ne nous donnent pas les moyens d'assurer la mission de service public de distribution de médicaments qui nous a été confiée.

Pour quelle raison vendez-vous les médicaments plus cher à l'export ? Quelle est, par ailleurs, la part de cette activité dans le chiffre d'affaires de votre profession ?
L'Autorité de la concurrence, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et la Cour des comptes se sont tour à tour penchées sur notre activité d'exportation, qui ne représente guère que 2 % du chiffre d'affaires. Notre marge est supérieure à l'export car les prix des médicaments sont plus élevés dans nombre de pays européens, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne.

À l'étranger, vendez-vous directement les médicaments aux officines ou passez-vous par des intermédiaires ?
Nous traitons avec des importateurs.
Les obligations de service public des grossistes-répartiteurs font l'objet de contrôles réguliers des agences régionales de santé (ARS) et de l'ANSM. Or, nul professionnel n'a encore été mis en cause sur le grief d'une priorité donnée à l'export.
N'oubliez pas qu'à notre mission de service public s'ajoutent les obligations prévues par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a créé les plans de gestion des pénuries (PGP) dans le cadre desquels l'exportation de certains produits peut être temporairement interdite.

S'agissant de votre activité d'exportation, les stocks additionnels de produits sont-ils calculés sur le fondement de la demande des officines ou fixés par une obligation réglementaire ?
Ils sont fonction de la demande sur le marché français.

Les représentants des pharmaciens, que nous avons entendus précédemment, nous ont exposé le fonctionnement du dispositif de dossier pharmaceutique relatif aux ruptures de stock, dit DP-Ruptures. Les grossistes-répartiteurs y participent-ils ?
Le dispositif DP-Ruptures, efficace, permet aux 14 000 officines qui y participent de signaler les médicaments en rupture, soit environ 300 produits indisponibles chaque mois, pour une durée moyenne de quarante jours. Il rassemble uniquement les laboratoires, les officines et l'ordre des pharmaciens.

Compte tenu de votre positionnement, vous portez certainement un regard sur les différents acteurs de la chaîne du médicament. Quelles seraient vos préconisations pour améliorer l'approvisionnement du marché ?
Il convient manifestement de renforcer le partage de l'information entre laboratoires, officines et grossistes-répartiteurs afin d'améliorer sa transmission aux professionnels de santé. Nous souhaiterions à ce titre être intégrés au dispositif DP-Ruptures.
Veillons cependant à ne pas créer d'effets pervers, notamment un sur-stockage de produits par les officines dès lors qu'un risque de rupture serait annoncé. L'objectif est, au contraire, de retarder le plus possible la survenue d'une rupture, puis de partager les informations pertinentes entre tous les acteurs de la chaîne afin de la gérer au mieux.
Enfin, ainsi que nous l'avons indiqué à l'ANSM, il nous semble utile de mettre en oeuvre un mécanisme logistique destiné au retour du produit sur le marché. De fait, lorsqu'un médicament est à nouveau disponible, le laboratoire va livrer sans distinction les 186 grossistes-répartiteurs installés en France métropolitaine. En cas d'urgence, le retour d'un produit sur le marché pourrait être accéléré en limitant sa distribution, dans un premier temps, aux établissements pivots de répartition : cela permettrait de gagner plusieurs jours. Il s'agirait d'un dispositif très technique et logistique, mis en place en aval d'un PGP, et visant à assurer un réapprovisionnement du marché sur une période courte.
Nous partageons, par ailleurs, l'esprit des propositions pertinentes portées par l'Académie de pharmacie.

Sauf erreur de ma part, il existe entre vingt-cinq et trente établissements pivots de répartition sur le territoire national.

Pourriez-vous fournir à notre mission un tableau retraçant les principaux risques et ruptures effectives de médicaments et de vaccins des dernières années ?
De telles données appartiennent à chaque grossiste-répartiteur et nous ne les agrégeons pas. En moyenne, nous estimons que, chaque mois, 300 à 500 références de médicaments, sur un total de 11 000, se trouvent en rupture sur le marché français. Mais une analyse plus fine, dont je doute d'ailleurs de l'utilité -il s'agit de données de gestion pour un instant donné, et non d'éléments d'évaluation- nécessiterait un décompte beaucoup plus sophistiqué... Pour ce qui concerne l'entreprise que je dirige, par exemple, la rupture la plus importante des six derniers mois a concerné l'aspirine, puis le Lovenox® et un vaccin. Rappelez-vous néanmoins que pénurie et rupture ne doivent pas être confondues !

Notre mission d'information traite également des vaccins. Pourriez-vous nous en dire davantage ?
Toujours pour mon entreprise, des vaccins contre les infections à pneumocoques, le tétanos, l'hépatite B et le papillomavirus, en provenance de différents fabricants, ont enregistré une rupture au cours des six derniers mois, ce qui ne signifie toutefois nullement que toutes les officines aient été concernées.

Un précédent intervenant nous indiquait que les ruptures concernaient les médicaments chimiques et non les biologiques, dont ressortent pourtant les vaccins. Qu'en pensez-vous ?
Nous n'avons jamais fait une telle distinction, ni entendu pareille affirmation.
Les chiffres doivent être maniés avec précaution car ils ne disent pas tous la même chose. À titre d'illustration, la liste de l'ANSM comprend 150 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) : 50 en rupture, 50 en tension et 50 en situation de retour sur le marché. DP-Ruptures, pour sa part, fait apparaitre en continu les ruptures en officine, correspondant à 72 heures sans possibilité de dispenser un produit, durée pouvant varier à l'initiative du pharmacien, dans au moins 5 % des pharmacies. Quant aux chiffres du CSRP, ils n'ont d'autre utilité que de nous permettre de piloter notre activité.
La liste de l'ANSM comprend 150 références de MITM, tandis que DP-Ruptures fait état d'environ 300 signalements mensuels tous produits confondus, dont, logiquement, les 50 MITM en rupture listés par l'ANSM.

L'ANSM ne fait, me semble-t-il, aucune distinction entre pénurie et rupture.
Elle agrège seulement les signalements des laboratoires sur les MITM en rupture ou tension, dans un souci d'informer les professionnels de santé et de trouver des solutions alternatives.

L'affaire du Levothyrox® a-t-elle engendré des difficultés d'approvisionnement particulières ?
Nous avons dû répondre à une demande complexe de mise sur le marché de quantités limitées dans des délais contraints, dans un contexte où les pharmaciens, malgré la pression des patients concernés, ne devaient pas conserver de stock. Nous avons donc réalisé un approvisionnement sur mesure des 22 000 officines.
Les laboratoires et l'ANSM nous l'ont conjointement demandé.

Quelles en furent les conséquences pour les patients ? Les besoins ont-ils tous été satisfaits ?
Nous ne pouvons distribuer que les quantités qui nous sont fournies au choix des pouvoirs publics et des laboratoires... Dans le cas du Levothyrox®, seule une minorité de patients devait repasser sous l'ancienne formule.
Lorsqu'aucun problème ne se pose, personne ne s'intéresse à nous, puis on nous redécouvre à la faveur d'un événement comme le Levothyrox®... Les laboratoires, qui pour certains distribuent eux-mêmes leurs produits phares, comme les pharmaciens, nous oublient vite. Nous aimerions que notre rôle soit reconnu et apprécié sur la durée. S'il n'existe pas, en France, de désert pharmaceutique, il faut en remercier les grossistes-répartiteurs et prendre en considération leurs difficultés économiques.

L'ancienne formule du Levothyrox® est-elle bien fabriquée par le même laboratoire ? Il existe, en outre, quatre autres médicaments de même type fabriqués par d'autres laboratoires, n'est-ce pas ?
Absolument !

Lorsque plusieurs pharmacies vous demandent d'être livrées d'une ancienne formule de Levothyrox® mais que vous ne disposez que de quantités limitées, sur quels critères choisissez-vous entre officines ?
Nous ne le pouvons pas ! S'agissant du Levothyrox®, nous n'avons livré qu'une à deux boîtes par officine.

Tous les patients disposant d'une ordonnance pour l'ancienne formule ont-ils pour autant pu en bénéficier ?
Oui, mais le cas du Levothyrox® demeure unique.

Nous vous remercions pour ces précisions.
La réunion est close à 12 h 35.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.