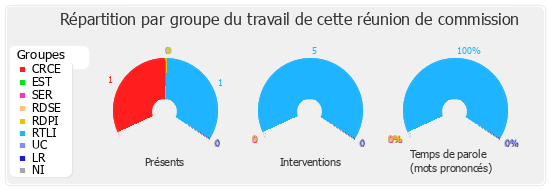Mission d'information sur la pénurie des médicaments et des vaccins
Réunion du 6 juillet 2018 à 15h30
Sommaire
- Audition de m. emmanuel déchin délégué général de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique csrp et de m. hubert olivier vice-président de la csrp et président-directeur général d'ocp répartition (voir le dossier)
- Audition de mmes céline perruchon sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins de la direction générale des soins dgs martine bouley chargée de dossier au sein du bureau du médicament de la dgs emmanuelle cohn cheffe du bureau de la qualité et sécurité des soins de la direction générale de l'organisation des soins dgos et m. raphaël ruano responsable du programme achats de la dgos (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Emmanuel Déchin délégué général de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique csrp et de M. Hubert Olivier vice-président de la csrp et président-directeur général d'ocp répartition
Audition de M. Emmanuel Déchin délégué général de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique csrp et de M. Hubert Olivier vice-président de la csrp et président-directeur général d'ocp répartition
Audition de mmes céline perruchon sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins de la direction générale des soins dgs martine bouley chargée de dossier au sein du bureau du médicament de la dgs emmanuelle cohn cheffe du bureau de la qualité et sécurité des soins de la direction générale de l'organisation des soins dgos et M. Raphaël Ruano responsable du programme achats de la dgos

Je remercie nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Cette audition devrait notamment nous permettre de mieux comprendre comment le ministère conçoit son rôle de régulateur et de coordinateur des acteurs du secteur - industriels, distributeurs et professionnels de santé - pour faire face efficacement aux situations de pénurie, aux stades de l'information, de la prévention et de la résolution. Au fil de nos auditions, nous avons pu mieux percevoir l'ampleur de la tâche.

N'étant pas issu du monde médical, je découvre chaque jour, dans le cadre de cette mission d'information, de nouvelles facettes importantes de vos fonctions. Nous allons vous poser un ensemble de questions dont vous avez reçu la trame, mais nous serions aussi heureux de recevoir vos contributions écrites pour alimenter nos réflexions.
Les situations de pénuries de médicaments et de vaccins ont-elles un coût pour les finances de l'assurance maladie ? À combien l'estimez-vous ?
Pourriez-vous nous faire un premier bilan de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi « Santé » de janvier 2016 ?
Y a-t-il des travaux actuellement en cours au sein du ministère de la santé sur le sujet des pénuries de médicaments ? Devons-nous nous attendre à des mesures législatives ou réglementaires dans un avenir proche ?
Quel est le regard du ministère de la santé sur les stratégies industrielles mises en oeuvre par les laboratoires, qui peuvent être à l'origine de pénuries ? La mise en place de dispositifs contraignants, voire coercitifs est-elle à 'l'étude ?
En 2008, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a reçu 44 signalements de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement ; en 2013, elle en a reçu 453, notamment pour des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. C'est une augmentation très marquée, mais il faut également prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires. Dès 2012, une première série de mesures obligeait les industriels à déclarer les ruptures d'approvisionnement et à mettre en place des centres d'appel ; en 2016 a été introduite l'obligation pour les fabricants de définir des plans de gestion de pénurie pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, dont la mise en place est suivie par l'ANSM et assortie de sanctions en cas de non-respect du plan. Cela permet d'anticiper les risques de rupture, notamment liés à un arrêt volontaire de production ou à un problème survenu dans la chaîne de production.
Ces chiffres doivent s'analyser aussi dans un contexte de mondialisation de la production et de la commercialisation des médicaments, avec des sites, voire des établissements en cours de regroupement mais aussi une chaîne de production vulnérable et complexe, notamment pour les vaccins, et soumise à divers aléas de fabrication. Ce n'est pas un phénomène propre à la France, c'est pourquoi il convient de multiplier les rapprochements au niveau européen pour partager les solutions envisagées.
Le coût des pénuries pour l'assurance-maladie ne peut pas être évalué précisément pour le moment. Les facteurs de coût sont la nécessité d'importer les médicaments qui ne sont pas produits sur le territoire national, mais surtout la gestion de la pénurie, qui représente un coût pour l'ANSM chargée de cette gestion, pour les établissements de santé contraints de mettre en place des procédures ad hoc, pour les administrations qui doivent informer les établissements, les agences régionales de santé (ARS) et les professionnels. Nous essaierons de vous donner des informations chiffrées sur ce point.
Les mesures prévues dans la loi « Santé » 2016 ont été mises en place en janvier 2017, ce qui nous donne un recul limité pour leur évaluation. Nous avons néanmoins commencé la réflexion, aux côtés de l'ANSM, en sollicitant également le LEEM (Les Entreprises du médicament) sur son ressenti vis-à-vis des plans de gestion. Un premier bilan partiel a néanmoins été établi par l'ANSM sur une vingtaine d'antibiotiques. Il apparaît que les plans de gestion des pénuries mis en place par les industriels mériteraient une harmonisation, ou du moins un échange sur les attendus. Faut-il établir un plan de gestion-type ou simplement un guide pratique de gestion des pénuries ? La question n'est pas encore tranchée et les réflexions se poursuivent.
La France tente faire partager ses positions au niveau européen. L'ANSM a participé à un groupe de travail de l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency - EMA), réfléchissant notamment à la question de l'exportation parallèle des médicaments par les grossistes-répartiteurs. La DGS a eu l'occasion de présenter les plans de gestion mis en place en France en novembre 2016 à Bratislava, lors d'une conférence consacrée aux ruptures d'approvisionnement. La définition d'une pénurie, d'une rupture d'approvisionnement ou d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur varie en fonction des États. Les plans de gestion des pénuries, qui ne sont qu'un élément de notre dispositif, ont été salués comme une avancée lors de cette conférence.
Les pénuries de médicaments feront partie des thèmes évoqués dans le cadre des travaux préparatoires au prochain Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), présidé par le Premier ministre, qui aura lieu la semaine prochaine.
Je ne peux à ce stade vous apporter de réponse concernant les dispositions législatives et réglementaires qui pourraient être prises. L'ensemble des acteurs, les industriels comme les autorités compétentes, s'approprient le dispositif. De ce point de vue, un changement des règles serait peut-être prématuré.

Dans quelle mesure la tendance des industriels à produire en flux tendus vous semble-t-elle influer sur l'augmentation des situations de pénurie de médicaments ?
Outre le renforcement des mesures de prévention et la responsabilisation des acteurs de l'offre et de la distribution, une action sur les prix des médicaments vous semble-t-elle incontournable pour mettre un terme à la multiplication des pénuries, en particulier pour les médicaments génériques ? Peut-on envisager de revaloriser le prix de certains médicaments anciens pour prévenir les arrêts de commercialisation et préserver la multiplicité des fournisseurs ?
Quelle évaluation faites-vous du commerce parallèle de médicaments dans le marché intérieur européen et quel est, selon vous, son impact sur le marché du médicament en France ? Certains distributeurs ont-ils tendance à privilégier les marchés européens et étrangers plus attractifs ?
L'ANSM et les services du ministère procèdent-ils à une évaluation des plans de gestion de pénurie élaborés et mis en oeuvre par les industriels pour faire face à une situation de pénurie ? L'État a-t-il les moyens d'apprécier l'adéquation du plan de gestion de pénurie à la gravité de la pénurie et, dans le cas où il jugerait ce plan insuffisant, peut-il contraindre l'entreprise à revoir son plan ?
Dans quelle mesure les services de l'État pourraient-ils renforcer la communication auprès des professionnels de santé et du grand public sur les plans de contingentement des stocks qu'il met en place pour faire face à un risque de pénurie de vaccin ? On se souvient de la pénurie de vaccin contre l'hépatite B en 2017, qui a surpris certains professionnels et associations de patients sans doute en raison d'un manque d'information.
Enfin, pensez-vous que l'État doive mettre en place un laboratoire public du médicament ?
Le flux tendu est une stratégie de production dans un contexte international très concurrentiel. Plus le flux est tendu et la production complexe, plus le risque de pénurie est élevé. Le moindre problème de production, la moindre inflexion du marché accroissent le risque de rupture, même si ce n'est pas le seul facteur.
Nous réfléchissons aux actions à mener sur les génériques et les médicaments anciens. Cela soulève toutefois un problème d'équité, car la fixation des prix obéit aux mêmes règles pour l'ensemble des médicaments.
L'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui sont très impactés par l'exportation et le commerce parallèle, ont pris des mesures pour y remédier.
La France dispose d'un arsenal juridique très protecteur, qui soumet notamment les grossistes à une obligation de service public. Nous sommes par exemple le pays le plus exigeant en termes de stocks - les grossistes doivent disposer de quinze jours de stock pour les neuf dixièmes de leurs médicaments. Ce stock tampon permet d'atténuer les effets de l'exportation.
Aux termes de la loi « Santé » de 2016, les grossistes doivent d'abord s'acquitter de leur obligation de service public, et il leur est interdit d'exporter en cas de rupture.
L'ANSM réalise des campagnes d'inspection et applique des sanctions administratives et bientôt financières aux grossistes pris en défaut.
Nous sommes donc beaucoup moins impactés par le commerce parallèle que d'autres pays, en particulier du Sud.
Les laboratoires ont la possibilité de renégocier les prix des vieux produits, notamment quand ils jugent que leur attractivité n'est pas suffisante. Cela permet d'éviter un certain nombre de pénuries.
Nous avions relayé largement l'information relative à la pénurie de vaccin contre l'hépatite B en diffusant des notes d'information auprès des établissements de santé pour expliquer le contingentement, et en prévenant les officines de ville.

Vous n'avez pas répondu à ma question relative au laboratoire public du médicament...
Les pénuries touchent principalement de vieux médicaments, et surtout des médicaments injectables. Or leur production étant soumise à des normes très contraignantes, elle requiert des installations spécifiques et du personnel formé. Cela ne s'improvise pas...
L'intérêt de l'État est plutôt de renforcer son rôle de régulateur et de coordinateur entre autorités compétentes que de développer un rôle d'industriel où il pourrait se trouver en difficulté au sein d'un marché très concurrentiel.

De quelles mesures d'urgence contraignantes nos autorités sanitaires disposent-elles ?
L'élaboration d'un plan de gestion des pénuries est déjà une obligation assortie de sanction.

En cas de pénurie, le recours à des médicaments de substitution impose parfois au personnel médical de se livrer à une « gymnastique » médicale qui est source de sur-risque.
Les industriels sont désormais contraints de communiquer en amont sur l'éventualité d'une rupture.
Dans la plupart des cas, pour remédier à ces ruptures nous avons recours à des autorisations d'importation de produits comparables, c'est-à-dire des mêmes produits destinés à un autre marché. Il s'agit donc en règle générale du même principe actif, du même dosage, des mêmes modalités d'administration et des mêmes posologies, ce qui permet de minimiser le risque vous évoquez.

Je constate que la moralité n'est pas toujours la préoccupation première d'un certain nombre d'acteurs. Or la santé et l'humain devraient être au centre de leur démarche. Comment peut-on cultiver la politique du risque zéro ?
Les choses évoluent au niveau européen. Sous la pression des États membres, l'EMA et la Commission européenne s'emparent du sujet.
Je rappelle que toutes nos réglementations se fondent sur les articles 81 et 23 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001.
Je serais un peu moins pessimiste. Le Portugal, qui souffrait d'une importante exportation parallèle vers l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du Nord, a mis en place une réglementation et un module d'inspection ayant pouvoir de sanction qui ont permis de résoudre les problèmes de pénurie.
Ce n'est donc pas forcément un voeu pieux, mais c'est un voeu qui se construit !

Notre mission d'information n'est pas là seulement pour réaliser un état des lieux, mais pour ouvrir des pistes afin de sortir des difficultés que nous rencontrons.
Que pensez-vous d'un prix socle des médicaments destinés aux hôpitaux ?
L'Algérie a récemment réalisé un travail de remise à niveau interne de sa production de médicaments. Cette expérimentation pourrait-elle être élargie à la France ? J'évoquais précédemment des laboratoires publics, notamment au Brésil, qui ont fait des expérimentations très concluantes sur le sida. Sortons de nos cadres de pensée et généralisons les expériences qui peuvent l'être.
Dès que les prix atteignent des seuils bas, certains industriels sortent du jeu. Les stratégies sont européennes davantage que mondiales, et l'attractivité de la France est remise en question. Dans certains cas, l'industriel refuse d'aller plus loin en raison des stratégies financières de son groupe, sauf renégociation. Un faible niveau de prix a ainsi une influence sur les comportements et donc les ruptures potentielles. Il est difficile de déterminer le juste prix. C'est visible dans le cas des prix administrés, qui ont un caractère incitatif...
Tout comme moi. Un prix trop bas engendre un risque de fuite et donc de rupture, même si la France et l'Allemagne sont des pôles d'activité importants. Il y a de nouveaux marchés émergents, comme les pays de l'Est. Nous devons établir un rapport de force équilibré pour discuter du bon niveau de prix, mais la mise en oeuvre concrète n'est pas facile.
Dans notre politique d'achats, nous devons davantage réfléchir aux leviers pouvant être utilisés sur les marchés des médicaments concurrentiels - pour les médicaments monopolistiques, le rapport de force nous est extrêmement défavorable, d'où des prix administrés. Nous le faisons déjà en partie.
Depuis quelques années, la massification croissante des achats décidée en 2006 pour faire des économies d'échelle, avec des contrats nationaux - qui ont eu certains bénéfices - est remise en question. Lorsque les contrats globaux conduisent les industriels à devoir livrer des quantités très importantes sur l'ensemble du territoire, ils sont rapidement en difficulté et ont un risque de rupture. En effet, les stratégies des laboratoires sont européennes. Des quotas de production annuels sont attribués à la France. Dès que la demande avoisine ces quotas, la tension entre la vente et la production accroît la probabilité de rupture de stock.
Nous avons adopté des recommandations pour limiter la massification des contrats pour les médicaments concurrentiels, afin de réduire les risques de rupture et ouvrir l'accès des contrats à d'autres compétiteurs, comme les fabricants de génériques, qui ne savent pas répondre à des appels d'offres nationaux mais pourraient répondre à des appels d'offres régionaux. Cette multiplication des acteurs réduit le risque. Certes, cela ne résout pas le problème de pénurie de matières premières communes à différents produits...
Auparavant, nous ne référencions qu'un seul industriel. Dès qu'il avait des difficultés à livrer les quantités nécessaires, celui-ci se retrouvait seul face à l'hôpital. Nous sommes en train de définir une nouvelle stratégie optimisée d'achats avec des référencements multiples : dès lors qu'un fournisseur serait en difficulté, nous aurions l'outil contractuel pour activer une deuxième source. Certes, il y a des effets de bord...

Pourriez-vous nous transmettre un tableau retraçant les principales ruptures de stock et risques de rupture de stock depuis dix ans, en précisant les causes de ces difficultés et les solutions apportées ?
Nous pouvons le demander à l'ANSM mais il n'est pas sûr qu'elle puisse vous fournir des chiffres à dix ans, en raison de l'état des systèmes d'information à l'époque, qui ne se sont adaptés qu'à partir du moment où des mesures plus contraignantes ont été mises en place, soit vers 2012-2013.

Il nous serait utile d'avoir aussi ces informations pour les médicaments qui ne sont pas d'intérêt thérapeutique majeur.
L'ANSM ne suit que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. C'est par le Dossier pharmaceutique-Ruptures que nous pouvons disposer de ces informations, qui seront aussi partielles car le DP-Ruptures est rempli par ses adhérents : plus de 12 000 officines, deux tiers des établissements pharmaceutiques.
La présence de sites de fabrication en France fait partie des critères que nous prenons en compte dans la négociation de prix administrés auprès d'industriels. Nous accorderons un prix supérieur aux laboratoires lorsqu'ils produisent en France ou lorsqu'ils investissent en France - même si c'est un levier assez faible. La plupart des laboratoires pharmaceutiques sont internationaux, et les sites français ne sont pas très attractifs...
C'est le but des mesures du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS). Nous avions bien identifié ce problème pour les anciens médicaments. Nous avons organisé des réunions avec le LEEM, l'association « GEnérique Même MEdicament » (Gemme), l'ANSM et la DGS.
Nous envisageons aussi - comme le signalait également le rapport de l'Académie nationale de pharmacie - de faciliter les démarches pour fluidifier le marché, à travers une convergence des conditionnements primaires et des notices des médicaments anciens à l'échelle européenne. Un pays a un dosage à 90 milligrammes, un autre à 100 milligrammes, sans une différence majeure d'effet thérapeutique. C'est pour cela que les importations sont plus compliquées à organiser, car les prescripteurs doivent s'adapter à ces petits changements. Cela change les mentalités. Cette piste favoriserait les échanges et l'harmonisation. Nous devons creuser rapidement cette piste, notamment avec des notices multilingues.