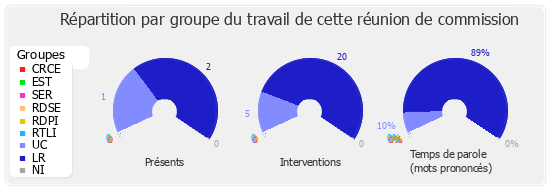Commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A
Réunion du 7 avril 2010 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. philippe foucras médecin généraliste président du formindep (voir le dossier)
- Audition de m. christophe lannelongue inspecteur général des affaires sociales auteur d'un rapport de l'igas sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers et de m. etienne dusehu ancien conseiller général des établissements de santé (voir le dossier)
- Audition de m. didier tabuteau conseiller d'etat directeurde la chaire « santé » à l'institut d'études politiques iep de paris directeur du centre d'analyse des politiques publiques en santéà l'ecole des hautes études de santé publique ehesp (voir le dossier)
La réunion
La commission d'enquête a entendu M. Philippe Foucras, médecin généraliste, président du Formindep.
a, tout d'abord, indiqué qu'il n'avait aucun lien d'intérêt avec une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits de santé. Il est médecin généraliste et responsable de l'association « Formindep », dont l'objet est la recherche d'une formation et d'une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes.
Procédant à l'aide d'une vidéoprojection, M. Philippe Foucras a débuté son propos par une citation de Christian Vigouroux, conseiller d'Etat et président de la commission déontologie et expertise de la Haute Autorité de santé (HAS), qui a déclaré, lors des rencontres de la HAS du 10 décembre 2009 que : « La puissance d'influence de l'industrie pharmaceutique en fait un des lobbys les plus efficaces et parfois les plus impérieux dans les rapports avec les pouvoirs publics et les caisses de sécurité sociale. Ceci en France comme en Europe. Tel est le constat que trente ans d'administration dans plusieurs domaines de l'action publique m'ont amené à formuler ».
a ensuite présenté, à travers des exemples concrets non directement liés à la gestion de la grippe A (H1N1), un instrument d'influence très utilisé par l'industrie pharmaceutique : les leaders d'opinion.
Les leaders d'opinion constituent en effet un outil essentiel pour les firmes pharmaceutiques pour informer les professionnels de santé sur les produits de santé qu'elles produisent. Il a cité l'exemple d'une entreprise spécialisée dans la lutte contre le cancer qui définit les leaders d'opinion comme « des scientifiques référents dont le comportement est susceptible d'exercer une influence sur la pratique et les prescriptions médicales des oncologues et pathologistes » et les présente sur son site Internet comme indispensables pour faire connaître et imposer les tests de diagnostic de l'entreprise auprès des professionnels de santé.
a ensuite cité une société de communication qui propose notamment ses services aux firmes pharmaceutiques. Pour illustrer l'efficacité de son action, la société présente sur son site Internet la méthode retenue et les résultats obtenus pour promouvoir un produit de santé utilisé dans l'instabilité vésicale.
La méthode a consisté à développer des relations avec des enseignants, leaders d'opinion, en urologie, gynécologie et gériatrie, à crédibiliser l'engagement à long terme de l'entreprise développant le produit et, enfin, à initier un débat médical sur la prise en charge de l'instabilité vésicale.
Les résultats obtenus sont mesurés par le nombre d'articles publiés à ce sujet. Une recherche sur Internet permet de sélectionner pas moins de 249 occurrences de ce médicament. Par ailleurs, grâce aux actions menées par l'entreprise de communication, des universitaires ont été contactés pour faire des conférences ou présider des congrès internationaux et promouvoir, à ces occasions, le produit en question, dont la part de marché a ainsi atteint 30 % dans les deux premières années de son lancement.
Ces « leaders d'opinion » peuvent aussi être amenés à apporter leur expertise aux décideurs politiques. Ainsi un des leaders d'opinion recrutés par l'entreprise de communication pour le médicament précité a participé à l'élaboration d'un rapport remis à M. Philippe Bas, alors ministre de la santé, qui mentionnait, pour le regretter, le non-remboursement de certains médicaments, dont le produit en question. Ce dernier a ensuite été inscrit sur la liste des spécialités remboursables, alors même que son efficacité a été controversée.
a indiqué qu'il ne s'agit pas de remettre en cause l'honnêteté des experts, mais de comprendre comment s'exercent certains mécanismes d'influence. Citant des déclarations d'experts membres du Comité de lutte contre la grippe, et qui se disent persuadés que les liens qui les unissent aux entreprises pharmaceutiques ne nuisent pas à leur indépendance, il a rappelé qu'il convient de distinguer les influences conscientes des influences inconscientes, ces dernières étant d'autant plus efficaces que l'on pense ne pas y être exposé.
De façon plus générale, M. Philippe Foucras a indiqué que tout expert est un leader d'opinion potentiel.
a enfin présenté l'exemple de l'extension des modalités de prescription de l'oseltamivir recommandée le 9 décembre 2009 par la direction générale de la santé (DGS). Selon M. Philippe Foucras, cette décision est révélatrice de la gestion globale de la pandémie grippale et la recommandation de la DGS ne repose pas sur des preuves scientifiques. Dans ce cas, il convient de s'interroger sur les autres fondements qui auraient pu conduire à cette décision : des raisons politiques, commerciales ou une logique de communication ?

a estimé important que les personnes mises en cause dans la présentation par le docteur Foucras du problème des liens d'intérêt entre experts et industries aient la possibilité de faire connaître leur point de vue devant la commission d'enquête.

a ensuite souhaité connaître l'appréciation du docteur Foucras sur les opinions émises par plusieurs des experts entendus par la commission d'enquête, qui jugeaient impossible de prévoir la virulence de la pandémie en France à partir de l'exemple de l'hémisphère sud, notant qu'elles contredisaient les propos tenus par M. Foucras dans la presse.

a souligné que l'institut national de veille sanitaire (InVS) avait fait état de la remarquable stabilité du virus.
a répondu que fin novembre, lors de ses déclarations à la presse, on disposait de suffisamment d'éléments pour affirmer que le virus n'avait pas muté en passant d'un hémisphère à l'autre. Dès le mois d'août, à La Réunion, les médecins généralistes avaient noté un faible impact du virus en termes de santé, et l'on aurait pu s'inspirer de l'exemple de l'Australie, qui avait pris des précautions de niveau modéré.

a rappelé le caractère tardif du constat de la stabilité du virus et a noté que les cas traités par les médecins généralistes n'étaient peut-être pas totalement représentatifs de la virulence du virus, les cas les plus graves étant traités à l'hôpital.
a déclaré que les généralistes avaient constaté la faible intensité du virus en métropole dès septembre. On assistait, en fait, plus à une « surconsultation » par peur de la grippe qu'à une multiplication des symptômes grippaux. Il n'est pas niable qu'il y a eu des syndromes graves dans une population généralement peu touchée par la grippe, mais le segment de population qui relève de la consultation des généralistes montrait que les cas graves n'étaient pas significatifs.

a demandé des précisions sur un autre propos de M. Foucras reproduit dans la presse et qui tendait à considérer comme « marginales » les différences épidémiologiques entre le virus pandémique et le virus saisonnier.
a signalé qu'en tant qu'acteur des soins primaires, les médecins généralistes voient la population dans sa globalité. A ce titre, ils pouvaient légitiment s'interroger sur la pertinence des outils retenus par rapport à l'objectif de lutte contre la pandémie. L'efficacité de la vaccination a de fait été très modérée et l'efficacité de l'oseltamivir pour lutter contre le virus pandémique n'est pas prouvée. Dès lors, leur utilisation massive n'était pas forcément rationnelle étant donné le rapport bénéfice-risque. En effet, plus on utilise un produit de santé, plus on risque de faire apparaître ses effets secondaires.

a également relevé une déclaration du docteur Foucras faisant état des effets secondaires ressentis par les médecins vaccinés. S'agit-il d'une remise en cause des procédures qui ont été suivies pour autoriser la mise sur le marché des vaccins ?
a précisé que son propos se fondait sur les informations transmises par ses confrères inscrits sur une liste de diffusion du collectif Formindep, dont la plupart avait en effet ressenti des effets secondaires après avoir été vaccinés.

a souhaité savoir si les effets secondaires relevés étaient graves et si un seul cas de syndrome de Guillain Barré avait été attribué à ce jour à la vaccination.
a indiqué qu'à sa connaissance la réponse à ces questions était négative. Il a également souhaité relativiser ses propos, tels qu'ils avaient été rapportés par la presse et a indiqué qu'il ne les formulerait plus aujourd'hui de la même manière.

a dit avoir eu connaissance du témoignage d'un médecin faisant état d'une conséquence grave liée à la vaccination.

a rappelé que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) examinait chaque cas rapporté et en a assuré la publicité au titre de la pharmacovigilance.

a remarqué que c'était précisément parce qu'il avait eu l'impression que l'AFSSAPS n'avait pas pris en compte son cas que ce médecin le lui avait signalé.

a demandé des précisions sur les critiques du Formindep à l'encontre de la recommandation de prescription de Tamiflu à titre préventif.
a constaté qu'aucune étude scientifique n'avait été produite à l'appui de cette extension de l'indication du Tamiflu, malgré des demandes répétées. Le seul élément disponible est une étude de l'InVS de juin 2009 comparant des situations en Argentine et au Chili.

a signalé que le laboratoire Roche a remis à la commission d'enquête, lors de son audition, un article publié en février 2010 sur l'exemple du Chili.
a estimé que la lecture de cet article ne présente plus aujourd'hui qu'un intérêt intellectuel. Il aurait été plus important d'en disposer au moment où le changement d'indication a eu lieu. Les médecins ont le devoir de soigner leurs patients selon les connaissances scientifiques et non pas sur des a priori. Seuls sont bien documentés les effets secondaires du Tamiflu notamment au Japon.
a affirmé que des cas de défenestration d'adolescents japonais avaient été liés au Tamiflu et que le risque psychiatrique qu'il comporte doit figurer, aux Etats-Unis, sur l'emballage de ce médicament.

a demandé pourquoi le Formindep estime que l'AFSSAPS a délégué la pharmacovigilance du Tamiflu au laboratoire producteur alors que le directeur général de l'agence a estimé que c'était la procédure normale qui avait été suivie.
Se référant au document publié par l'AFSSAPS sur l'extension d'indication du Tamiflu, M. Philippe Foucras a relevé que l'agence notait à plusieurs reprises l'absence de données cliniques puis donnait un avis favorable à l'extension de l'indication du médicament sans avancer de raison probante.

a souligné que les laboratoires Roche avaient invoqué l'urgence pandémique comme fondement de l'extension de leur autorisation de mise sur le marché.
a considéré qu'une telle procédure n'était justifiée que face à un risque pandémique majeur et pour un médicament ayant des effets importants pour la protection de la santé. Or aucune de ces deux conditions n'était en l'occurrence remplie.

a jugé inquiétant que l'Etat ait constitué des stocks aussi importants d'un médicament dont l'efficacité n'est pas prouvée.

a précisé que l'extension de l'indication du Tamiflu n'avait porté que sur son usage préemptif et non sur son usage curatif, qui est reconnu.

a estimé que l'efficacité du Tamiflu était encore un sujet de controverse.
a souligné que la méta-analyse conduite par l'association Cochrane sur l'efficacité de l'oseltamivir dans la lutte contre la grippe saisonnière avait montré que les résultats étaient discutables. Une étude indépendante avait été demandée mais elle n'a pas été réalisée.

a demandé quelles étaient les propositions de Formindep pour lutter contre les conflits d'intérêt.
a considéré qu'il ne faut pas se priver du conseil des experts reconnus mais le placer à sa juste valeur. Le recours à des experts indépendants et à l'expertise de terrain des fournisseurs de soins primaires devrait également être pris en compte pour éviter une mono-analyse. Il est important de développer différents niveaux d'analyse et surtout d'élaborer une expertise interne dotée de moyens adéquats.
Audition de M. Christophe Lannelongue inspecteur général des affaires sociales auteur d'un rapport de l'igas sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers et de M. Etienne duSehu ancien conseiller général des établissements de santé
Audition de M. Christophe Lannelongue inspecteur général des affaires sociales auteur d'un rapport de l'igas sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers et de M. Etienne duSehu ancien conseiller général des établissements de santé
La commission d'enquête a ensuite entendu M. Christophe Lannelongue, inspecteur général des affaires sociales, co-auteur d'un rapport de l'IGAS sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers, et M. Etienne Dusehu, ancien conseiller général des établissements de santé, ancien conseiller national de l'Ordre des médecins, qui a également collaboré à la rédaction de ce rapport.
a d'abord présenté les résultats généraux de l'enquête menée par l'IGAS au cours de l'année 2008.
Ils ont fait apparaître de fortes disparités des rémunérations, tant pour les médecins libéraux que pour les praticiens hospitaliers. Les écarts importants pour les praticiens qui ont une activité libérale sont inter et intra-disciplinaires et rendent compte de l'impact croissant des dépassements d'honoraires. Pour les praticiens hospitaliers salariés sous statut public ou Participants au Service Public Hospitalier (PSPH), ces disparités rendent compte de l'effet des rémunérations indemnitaires, notamment de la permanence des soins, de l'impact des activités libérales à l'hôpital public et, enfin, de la rémunération complémentaire apportée par les entreprises, notamment au titre de travaux de formation et de recherche.
a présenté, à titre liminaire, les méthodes d'enquêtes de la mission de l'IGAS sur les rémunérations complémentaires, qui sont très diverses, tant dans leurs modalités que dans leur contenu. L'IGAS a cependant cherché à les appréhender indirectement. Cette recherche entrait dans le champ de la mission de l'IGAS, puisque la lettre de mission de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports, stipulait que les travaux à conduire devaient embrasser l'ensemble des rémunérations des médecins.
L'expertise en milieu hospitalier, encadrée par les règles prévues par le code de la santé publique, donne lieu à des extensions d'activité en termes de conseils aux industriels dont les rémunérations ne sont, quant à elles, pas encadrées.
L'IGAS avait obtenu du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) le fichier récapitulatif des contrats qui lui sont communiqués. Ce fichier récapitulatif ne comporte pas d'informations systématiques et coordonnées sur les contrats. Il a deux origines : les contrats adressés au CNOM parce qu'ils concernent plusieurs départements ou tout le territoire national ; ceux qui lui sont transmis par les conseils départementaux quand ils ont besoin d'une expertise dont ils ne disposent pas en leur sein. Il est donc très hétérogène, et son interprétation doit être faite avec prudence, d'autant que les informations disponibles sont restreintes.
L'IGAS a exploité les données recueillies sur un échantillon de 6 675 déclarations transmises au CNOM au cours des années 2006, 2007 et des neuf premiers mois de l'année 2009.
Son travail a été mené sur la base d'une typologie distinguant quatre catégories d'activités ayant donné lieu à rémunération : les activités d'intervention dans des colloques ou de formation, celles de conseil aux entreprises, les contributions scientifiques et l'expertise. La distinction entre ces deux dernières catégories a pris en compte les imprécisions des informations sur certains contrats d'expertise.
Le profil de distribution des courbes de rémunérations des activités d'expertise et de contributions scientifiques se superposent grossièrement. Elles sont significativement plus élevées que la rémunération des activités d'enseignement, lesquelles ne précisent ni la durée de l'enseignement, ni la valeur ajoutée de production personnelle de l'auteur. On ne peut donc établir de correspondance entre la somme versée et le travail fourni.
La moyenne et la médiane sont significativement différentes pour les quatre catégories de rémunération ainsi identifiées, sans qu'il soit possible d'expliquer cet écart par des outils statistiques.
Outre ces éléments, il a disposé de l'analyse du président de la commission des relations médecins-industrie du CNOM, lequel a indiqué aux auteurs du rapport que certains médecins hospitaliers cumulent les contrats en tant que coordonnateurs d'études, experts ou conseillers scientifiques consultants auprès de plusieurs industriels. Ces cumuls de contrats peuvent représenter une masse d'honoraires dépassant leur rémunération hospitalière ou hospitalo-universitaire, et occuper une part de leur temps très supérieure à ce qui est raisonnable et autorisé.
a souligné que l'organisation actuelle du recueil des données ne permet pas d'identifier le complément de rémunération apporté, ni la quantité de travail correspondante. Seules les déclarations fiscales individuelles de chacun des praticiens sont aujourd'hui de nature à apporter ces informations. La pratique de conseil et d'expertise recouvre manifestement des situations dont le contenu est aussi hétérogène que leur rémunération. La nature de ces activités n'est actuellement connue que des intéressés et de leurs employeurs.
a indiqué que les inspecteurs de l'IGAS avaient examiné plus particulièrement les fonctions qu'exercent les médecins dans le cadre de la recherche clinique, notamment celles des médecins investigateurs qui dirigent, suivent et contrôlent les essais cliniques, tout en étant chargés des relations avec les patients.
Les conventions de droit privé entre les laboratoires et les médecins investigateurs précisent la rémunération de ces derniers, calculée à partir d'une somme fixe pour chacun des patients inclus dans l'essai clinique. Cette convention doit être communiquée au conseil départemental du lieu d'exercice du praticien, ou au conseil national si l'essai associe des investigateurs relevant de différents centres. Elle doit aussi être communiquée aux directeurs d'établissement, mais cette disposition semble inégalement respectée : l'exemple des hospices civils de Lyon a fait apparaître que seulement 10 % des conventions concernées étaient adressées à la direction de l'hôpital.
Les conventions prévoient des rémunérations de l'ordre de 1 500 à 2 500 euros par patient inclus dans l'essai clinique, qui peuvent atteindre 5 000 euros par patient dans les secteurs de la cardiologie et de la réanimation. Il s'agit donc de revenus conséquents pour les professionnels.
La rémunération du médecin investigateur est personnelle et elle peut donc lui être versée directement, sans transiter par la direction de l'hôpital. Elle peut aussi être versée, en totalité ou en partie, sur le compte d'associations de la loi de 1901 constituées pour améliorer le fonctionnement des services où exercent les médecins investigateurs.
Une très forte opacité entoure tant le partage entre la part versée au médecin et celle qui revient à l'association, que l'emploi des fonds par les associations.
Ces associations loi 1901 sont soumises au contrôle de commissaires aux comptes et à celui de l'administration fiscale. Mais assez peu d'informations sont disponibles sur leur utilisation des fonds, d'autant plus qu'elles sont nombreuses et spécialisées sur un service, des praticiens ou certains essais cliniques. Par exemple, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, pour 500 protocoles de recherche, 128 associations étaient domiciliées dans ce CHU, parmi lesquelles 70 avaient explicitement pour objet le financement de la recherche.
Un rapport plus ancien de l'IGAS, mais malheureusement toujours d'actualité, avait constaté que ces associations peuvent permettre de couvrir des dépenses jugées difficiles à financer dans le cadre de la gestion classique de l'hôpital. En fait, ce rapport avait montré que l'opacité du fonctionnement de ces associations peut donner lieu à des dérives, dans l'utilisation que font certains praticiens de ce support associatif pour des dépenses personnelles de quasi-rémunération.
Il avait également souligné que le système de rémunération du médecin investigateur comportait également le risque de défavoriser l'établissement qui accueille le médecin investigateur. Une convention hospitalière passée entre le laboratoire et l'établissement doit normalement compenser les surcoûts générés pour cet établissement par l'essai clinique, par exemple les soins supplémentaires, la logistique mise en oeuvre, le suivi des patients. Mais ce système organise un conflit d'intérêts entre la rémunération du médecin investigateur et le financement des surcoûts de l'établissement. Dans la pratique, la répartition des fonds versés par le laboratoire est décidée au cas par cas, avec de fait une forte influence du médecin investigateur.
a indiqué que des négociations se tenaient entre le laboratoire et l'hôpital mais que, d'une certaine manière, elles étaient la résultante d'une négociation entre le laboratoire et le médecin pour sa rémunération.
La part de la rémunération consacrée à la compensation des surcoûts pour l'hôpital est donc plus un solde qu'une véritable appréciation objective de ces surcoûts, qui est d'ailleurs malaisée en l'absence de comptabilité analytique dans de nombreux hôpitaux, d'autant plus qu'il faudrait pouvoir isoler les soins « normaux » du supplément de soins ou de coûts logistiques lié à l'essai clinique.
Ces constats ont été à nouveau validés par le rapport public de l'IGAS de novembre 2009, établi par Pierre-Louis Bras et Gilles Duhamel, sur le financement de la recherche, de l'enseignement et des missions d'intérêt général dans les établissements de santé. Dans ce rapport, l'IGAS avait conclu que l'organisation actuelle n'est pas favorable à un financement transparent et dynamique de la recherche. Non seulement elle induit un conflit d'intérêts entre le médecin investigateur et l'hôpital, mais elle peut aussi favoriser la recherche clinique, mieux rémunérée, au détriment de la recherche fondamentale qui ne donne lieu qu'à la rémunération principale du praticien hospitalo-universitaire.
Au terme de ce constat sur le financement de la recherche et les essais cliniques, M. Christophe Lannelongue a détaillé plusieurs préconisations du rapport de l'IGAS sur la rémunération des médecins.
Tout d'abord, il convient de mettre l'Ordre des médecins en situation de connaître toutes les rémunérations versées aux médecins.
Actuellement, l'absence de fichier national rend impossible une visibilité réelle sur les rémunérations versées par les entreprises aux praticiens. Il n'est donc pas possible de repérer d'éventuels cumuls de rémunérations. Cette situation interdit à l'hôpital de connaître la rémunération ou certaines activités de ses collaborateurs, et elle peut aussi poser un problème en matière d'orientation de la politique de la recherche et d'allocation des ressources.
La mission a donc préconisé une modification des dispositions législatives sur la transmission d'informations au CNOM, tendant à lui permettre de constituer un fichier national et à obliger les échelons locaux à transmettre au niveau national les données qu'il recueille. Ces informations devraient être transmises à l'établissement employeur du médecin et donner lieu à des études pour une meilleure gestion de la politique de recherche et de rémunération des médecins. Cette réforme serait également conforme aux intérêts de l'industrie pharmaceutique : en matière d'essais cliniques, la France est fortement concurrencée par de nombreux pays, notamment de l'Est de l'Europe, et le coût des essais cliniques est un des facteurs qui oriente les choix géographiques.
C'est dans ce cadre qu'à été constitué, à l'initiative des pouvoirs publics et de l'industrie, un groupement d'intérêt public (GIP), le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS). Le CeNGEPS a pour rôle de rationaliser et de standardiser le coût des essais cliniques pour garantir la compétitivité de la France.
En dernier lieu, l'IGAS recommande l'information systématique des directions des établissements publics sur les rémunérations et les activités des praticiens hospitaliers.
L'objectif est d'accroître la transparence et l'équité sur les contributions réelles des médecins investigateurs à la performance de l'hôpital. Dans un contexte de financement à l'activité, les hôpitaux publics doivent être en mesure de gérer les activités des praticiens au mieux de l'ensemble des missions qu'ils mettent en oeuvre.
Le statut actuel des praticiens hospitaliers leur interdit de recevoir aucun émolument au titre d'activités exercées en dehors de l'établissement d'affectation, mais cette disposition ne s'applique pas aux consultations et aux expertises demandées par une autorité administrative ou judiciaire ou des organismes privés. Cette règle doit s'appliquer dans des conditions fixées par un arrêté ministériel qui n'est cependant jamais paru.
Par conséquent, les praticiens hospitaliers sont tenus de déclarer à leur directeur d'établissement leurs activités de recherche, mais il n'est pas précisé si cette déclaration doit concerner les conventions financières.
Il conviendrait donc de prévoir qu'en dehors de toute activité libérale, les activités rémunérées effectuées par un médecin à temps plein soient déclarées à la direction de l'établissement. Cette obligation d'information devrait aussi s'appliquer aux organismes publics de recherche employant des médecins.
Une troisième proposition de la mission est de mettre en place, dans chaque CHU, une fondation hospitalo-universitaire de recherche cogérée par l'hôpital et les médecins, afin d'améliorer la transparence des flux financiers entre l'industrie, les établissements et les praticiens.
Ces fondations pourraient être mises en place dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) du 10 août 2007 qui a prévu la possibilité de créer des fondations universitaires.
Par ailleurs, la mission confiée au professeur Marescaux sur l'avenir des CHU a également abouti à la proposition de mettre en place des instituts hospitalo-universitaires. Le professeur Marescaux a du reste récemment proposé à la ministre de la santé et des sports la création de cinq fondations hospitalo-universitaires dans le cadre du grand emprunt.
a précisé en conclusion que ces propositions ne sont qu'une partie de celles formulées par la mission de l'IGAS sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers. Le rapport de l'IGAS a en effet pour objet principal d'améliorer la gestion en créant dans chaque service un plan d'activité permettant de répartir, pour six mois ou un an, les activités des médecins entre les soins, l'enseignement et la recherche. Il s'agit de garantir que chaque médecin contribue de manière équilibrée aux missions de son service. Le dispositif serait encadré par ce que la mission de l'IGAS a appelé des valences, c'est-à-dire des choix de spécialisation sur des périodes de trois à cinq ans permettant aux médecins de voir reconnaître leur spécialisation dans leur parcours de carrière et leur rémunération.

a demandé si le fichier national qu'il était proposé de créer serait public.
a indiqué que la mission avait eu accès à un fichier anonymisé, ce qui ne posait pas de difficulté en soi pour l'exploitation des données. Le problème rencontré avait été le manque de temps, voire de données, pour faire des analyses par spécialité, qui auraient pu être réalisées à condition de disposer d'informations sur les spécialités des médecins. Un fichier national respectant l'anonymat des praticiens concernés permet de réaliser un certain nombre d'études. Par ailleurs, une transmission à l'autorité qui emploie le médecin est nécessaire, en tant qu'élément de régulation.

a indiqué que sa proposition d'un fichier national s'inscrivait dans la perspective de l'application d'une disposition de loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : un médecin qui a des liens d'intérêts avec un laboratoire doit les faire connaître lorsqu'il s'exprime en public ou écrit un article. Cette disposition n'est pas appliquée. Un fichier national public faciliterait l'application de ce texte, ainsi que son contrôle.

s'est interrogé sur la création d'une instance spécifique chargée du contrôle des liens d'intérêt et des procédures de gestion des conflits.
Il a également demandé si toutes les catégories de conventions soumises au dispositif de la loi de 2002 (conventions « d'hospitalité », activités de conseil, activités de formation, collaboration scientifique, expertises et études) comportaient les mêmes risques en matière d'indépendance des experts.
a estimé, à titre personnel, que l'ensemble des rapports entre les médecins et l'industrie pharmaceutique peuvent poser problème. En effet, ils créent dans tous les cas un lien de dépendance directe ou indirecte qui peut se traduire financièrement par une rémunération.

a demandé s'il était souhaitable d'obliger les entreprises industrielles à publier la liste des experts qu'elles rémunèrent, au moins pour certaines fonctions, en particulier les fonctions de conseil.
Serait-il également souhaitable d'interdire aux personnes qui conseillent une entreprise privée de siéger dans une instance d'expertise publique et de conseiller, à quelque titre que ce soit, les autorités politiques et administratives ?
Enfin, il est parfois avancé que tant les entreprises privées que les autorités administratives consultent les mêmes experts en raison de la qualité de ces derniers. Or, la préparation de la pandémie annoncée a donné l'impression d'être dominée par une « pensée scientifique unique » privilégiant une vision plutôt catastrophiste et qui s'est révélée erronée. Doit-on en conclure que le recours à un « vivier » unique et commun d'experts n'est pas, comme on le pense, une garantie de la qualité de l'expertise ?
A propos de l'expertise, M. Christophe Lannelongue a indiqué que la mission avait travaillé sur la base d'un rapport qu'avait commandé la direction générale de la santé (DGS) à Mme Marie-Dominique Furet sur les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics au sens large (administrations centrales, grandes agences) font appel à l'expertise médicale. Ce rapport montrait l'apport considérable des praticiens à la qualité de la décision publique.
Dès lors, la mission avait étudié les conditions dans lesquelles ces praticiens étaient rémunérés, et comment s'articulaient leurs responsabilités en tant qu'experts pour les pouvoirs publics et leurs activités au sein de l'hôpital public. Elle a constaté que les conditions de rémunération étaient assez mal définies et peu homogènes, un même travail pouvant être apprécié et valorisé très différemment.
Par ailleurs, il n'avait pas été observé de rémunérations excessives. Les rémunérations de ce type d'expertises par les pouvoirs publics en France sont plutôt inférieures à celles pratiquées dans les autres pays européens.
En revanche, on constate aussi l'absence d'échange d'informations entre les autorités publiques recourant aux expertises et les hôpitaux publics employant ces praticiens, alors qu'une partie de l'activité des médecins hospitaliers est ainsi consacrée à d'autres employeurs, sans contrepartie pour les hôpitaux publics.
Des travaux ont ainsi été conduits avec la direction générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui avait attiré l'attention de la DGS sur le fait que beaucoup de praticiens font des expertises pour le compte des pouvoirs publics. Cependant, les vérifications effectuées ont été très peu concluantes, puisque n'étaient apparus que quelques cas d'emplois équivalent temps plein. Ce point n'a donc pas été approfondi dans le rapport de la mission, qui a seulement suggéré une rationalisation des rémunérations et un meilleur partage de l'information entre le ministère, les agences et les hôpitaux publics.
En ce qui concerne la publication des listes d'experts, M. Christophe Lannelongue a souligné que le plus important était, pour les membres de la mission, de pouvoir disposer en un endroit unique d'une vision globale de l'emploi des ressources dans l'hôpital et de son engagement en matière de recherche, afin d'avoir une approche du financement de la recherche par projet.
Le souci est de mettre les hôpitaux universitaires en situation de piloter au mieux l'effort de recherche, par un équilibre entre les fonctions de l'hôpital comme lieu de production de soin et pôle d'excellence.

a réitéré sa question sur l'intérêt de la création d'une instance spécifique chargée du contrôle des liens d'intérêt.
a répondu que l'objectif était de redonner au Conseil de l'ordre la capacité de faire son travail.

a rappelé que, lors de leur audition par la commission d'enquête, les représentants du CNOM avaient indiqué que, sur la base de la législation actuelle de 2002, ils n'étaient pas en situation de faire leur travail, faute de disposer des informations des conseils départementaux.
a estimé que le nombre de 5 000 conventions ainsi traitées correspond à un volume d'informations qui paraît relativement maîtrisable. Selon lui, s'il était possible de disposer d'un système d'information permettant de travailler sur la base de coûts standardisés, les comportements anormaux pourraient être repérés, ce qu'a favorisé la création du CeNGEPS.
Toutefois, il a fait part de sa conviction que, comme dans le domaine des activités libérales, les comportements anormaux en matière de rémunérations accessoires à l'hôpital public sont peu nombreux. Les comportements jugés critiquables sont ceux de praticiens qui cumulent un très haut volume de rémunérations en provenance de l'industrie, et pour lesquels on peut se demander s'ils sont, par ailleurs, en capacité d'accomplir les missions pour lesquelles ils sont rémunérés par l'hôpital public. Les enquêteurs ont examiné un petit nombre de CHU, mais certains de ces établissements, très prestigieux, concentrent des équipes de renommées internationales. Les comportements pouvant être qualifiés d'extrêmes y sont apparus excessivement peu nombreux. Dans ce contexte, un système d'information ouvrant également la possibilité d'utiliser les standards mis au point par les industriels permettrait tout à fait de détecter les comportements « aberrants ».

a souhaité connaître l'appréciation portée sur les Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC).
a indiqué que cette question avait été abordée par le rapport public de l'IGAS de novembre 2009 de Pierre-Louis Bras et Gilles Duhamel sur le financement de la recherche, de l'enseignement et des missions d'intérêt général dans les établissements de santé.
Ce rapport établit un constat critique sur les modes de financement de la recherche et les autres missions d'intérêt général. En particulier, le mode de financement actuel introduit une forme de concurrence entre les activités de soin et de recherche. Comme les médecins sont intéressés à certaines formes de recherche et à certains actes de soin, la répartition de leurs activités peut être biaisée par des modes de rémunération qui ne favorisent pas un bon équilibre entre le soin et la recherche.
Aussi convient-il de développer un mode de financement par projet, au lieu de l'actuel mode de financement des missions d'intérêt général, trop forfaitaire et déconnecté de la réalité des projets et de leur mise en oeuvre. Ce dispositif devrait s'accompagner d'une forme d'intégration de tous les coûts des projets de recherche, y compris la rémunération additionnelle des médecins pour la conduite de ces activités de recherche.
Ces conclusions rejoignent donc celles de la mission de l'IGAS sur la rémunération des médecins, dont elles confortent les interrogations et les critiques sur les impacts défavorables du mode de rémunération des essais cliniques sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général à l'hôpital.

a souhaité savoir si des travaux avaient été menés pour certaines spécialités.
Après avoir précisé adhérer totalement à la proposition de créer un fichier national, elle s'est demandé s'il ne fallait pas également inclure les publications de référence.
Les études menées ont-elles inclus des équipes qui, comme celles de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), peuvent être aussi installées dans des hôpitaux ?
Des comparaisons ont-elles pu être établies avec d'autres pays européens, afin notamment d'apprécier le risque éventuel de pénaliser les équipes françaises ?
Enfin, les directeurs d'hôpitaux ont-ils actuellement connaissance des activités associatives à l'intérieur de leur hôpital ?
Sur ce dernier point, M. Christophe Lannelongue a indiqué que, chaque fois que la mission avait interrogé des directeurs d'hôpitaux, ces derniers avaient été surpris par le nombre d'associations et leurs activités, dont ils ne peuvent connaître que les aspects financiers. Par ailleurs, certaines associations sont « délocalisées » et domiciliées hors de l'hôpital, échappant alors au contrôle des directeurs.
Il a regretté l'absence de données comparatives. Des travaux de l'OCDE sur les rémunérations des médecins par spécialités ont été publiés dans le rapport, mais ils ne permettent pas de distinguer les revenus liés aux activités de recherche. C'est d'autant plus dommageable que l'on a toutes les raisons de penser que ces activités de recherche sont correctement rémunérées dans les pays directement en compétition avec la France. En effet, une forte pression est exercée sur les centres de recherche français pour débaucher des praticiens, notamment à l'AP-HP, comme l'a montré le cas d'un praticien de l'hôpital Henri Mondor à qui le Royal College de Londres a fait des propositions très avantageuses.
En ce qui concerne les équipes INSERM, la participation des médecins universitaires à ces équipes n'entraîne pas de supplément de rémunération. Il est considéré que ce temps de recherche s'inscrit dans le statut hospitalo-universitaire, bien que celui-ci ne constitue pas un vrai cadre d'emploi pour le développement des activités de recherche. De fait, il ne permet pas de rémunérer l'activité de jeunes chercheurs, ni d'isoler la recherche d'autres activités, par exemple d'enseignement ou de gestion.
A propos du fichier national, il a estimé effectivement important d'inclure les publications de référence. Par ailleurs, il n'a pas été possible de travailler par spécialité. Le fichier du CNOM avait permis d'amorcer des études qu'il faudrait sans doute approfondir en distinguant les spécialités, ce qui est dommage car un des problèmes majeurs du système de rémunération des médecins en France est cette différenciation par spécialité.

a souhaité revenir sur la proposition des fondations, alors qu'il existe actuellement une mode dans les CHU où, lorsqu'un médecin part à la retraite, il est mis en place un système d'institut à l'intérieur même de l'hôpital, avec des fonds publics et privés. Elle a exprimé sa crainte que l'idée de fondation puisse, à terme, créer des instituts plus lourds et plus complexes.

a observé que la représentation nationale avait voté les dispositions permettant la création de fondations dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
a expliqué qu'il pourrait être souhaitable de mettre en place, au lieu, par exemple, des 128 associations du CHU de Nice, une structure unique qui serait l'interface obligatoire entre l'industrie et les médecins, et qui organiserait les flux financiers entre l'industrie, l'hôpital et les praticiens.
Ces fondations ne supprimeraient pas tout intéressement des équipes de recherche, mais permettraient d'introduire de la transparence et d'assurer un minimum de contrôles conjoints par l'hôpital et les médecins sur la répartition des rémunérations.

a demandé des précisions sur la proposition de créer cinq instituts hospitalo-universitaires dans le contexte du grand emprunt.
a indiqué que, pour la mission, il semblait possible d'appliquer le dispositif des fondations dans le cadre des cinq instituts hospitalo-universitaires qui pourraient être mis en place à la suite des travaux de la commission « Marescaux », car on disposera d'une structure pour organiser le travail de recherche de nombreux praticiens en associant l'hôpital, l'université et l'industrie.

a observé que la transparence exige que le grand emprunt finance des projets bien identifiés, dûment connus.
a estimé que les fondations seraient un facteur de transparence. En effet, dans une logique de financement de projets de recherche, il est possible d'identifier des coûts complets permettant d'établir des comparaisons et de rationaliser les rémunérations.

a souhaité savoir si la mission de l'IGAS connaissait le nombre et le budget moyen des associations loi 1901 dans les hôpitaux.
a répondu que, en l'absence de recensement, le travail effectué au CHU de Nice avait fait apparaître 500 protocoles de recherche et 128 associations, dont le financement et la structure financière étaient très divers.
Les montants financiers s'échelonnent entre quelques milliers et des centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Mais, comme l'ont indiqué la plupart des chefs de service rencontrés, les associations sont effectivement utilisées pour faciliter la gestion, par exemple le paiement de déplacements dans le cadre de congrès ou l'achat d'équipements informatiques.

s'est interrogé sur le choix comme exemple du CHU de Nice, observant que le proche hôpital de Monaco pouvait faire des propositions aux praticiens de ce CHU.
a indiqué que l'enquête avait porté sur sept CHU, dont deux de l'AP-HP (Pitié-Salpêtrière et Henri Mondor) et ceux d'Amiens et de Poitiers.
Cet échantillon a été jugé représentatif de l'ensemble des CHU. Les données du rapport traduisent une réalité commune à tous ces CHU, celui de Nice n'étant pas une exception sur les questions de rémunération et de financement de la recherche.
est convenu que la rémunération des praticiens de l'hôpital est sensiblement supérieure à celle des praticiens du CHU de Nice.

a souligné que même lorsqu'un institut est fondé sur un projet, ce projet n'est pas toujours pérenne, puisqu'il est parfois élaboré dans le cadre de la carrière d'un médecin. Au départ du médecin, parfois à l'étranger, l'institut perd sa raison d'être.
Audition de M. Didier Tabuteau conseiller d'etat directeurde la chaire « santé » à l'institut d'études politiques iep de paris directeur du centre d'analyse des politiques publiques en santéà l'ecole des hautes études de santé publique ehesp
Audition de M. Didier Tabuteau conseiller d'etat directeurde la chaire « santé » à l'institut d'études politiques iep de paris directeur du centre d'analyse des politiques publiques en santéà l'ecole des hautes études de santé publique ehesp
La commission d'enquête a enfin entendu M. Didier Tabuteau, conseiller d'Etat, directeur de la chaire « santé » à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, directeur du Centre d'analyse des politiques publiques en santé à l'Ecole des hautes études de santé publique (EHESP).
A titre liminaire, M. Didier Tabuteau a précisé qu'il n'était pas actuellement en fonction au Conseil d'Etat, mais en position de disponibilité. Ajoutant qu'il n'était pas professionnel de santé et n'appartenait à aucune commission, il a également tenu à porter à la connaissance de la commission d'enquête le partenariat entre l'IEP de Paris, pour le fonctionnement des chaires d'enseignement, et diverses entreprises parmi lesquelles le groupe IPSEN et Sanofi - Aventis, ainsi que l'Association française contre les myopathies (AFM).
Abordant ensuite la question de la déontologie de l'expertise, il a rappelé que ce problème a émergé en France au début des années 1990, au moment de la création de l'Agence du médicament.
La création de cette Agence visait, non sans témérité, à atteindre trois objectifs : l'excellence scientifique, l'efficacité administrative, la déontologie de l'expertise.
Mais cette dernière ne faisait alors l'objet d'aucun système de règles concernant la prévention des conflits d'intérêts ou la déclaration des liens d'intérêt. Il a cependant été possible, sans texte, au niveau du règlement intérieur de l'Agence, d'imposer une obligation de déclaration d'intérêt à tous les experts participant aux différents groupes de travail ou commissions. M. Didier Tabuteau a précisé qu'il avait lui-même expliqué dans les différentes commissions pourquoi cette « règle du jeu » paraissait souhaitable et qu'il avait eu le sentiment que cette obligation avait plutôt été ressentie comme un soulagement par l'immense majorité de ses interlocuteurs.
Ces règles, après avoir été étendues en 1998 à toutes les agences sanitaires, ont été à l'origine des dispositions, introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, qui sont aujourd'hui applicables aux membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La question de la déontologie de l'expertise, a souligné M. Didier Tabuteau, s'est posée dans un contexte difficile, après le drame du sang contaminé qui a conduit la France, en quelque sorte, à « prendre en marche » le train anglo-saxon.
Il a fallu « acclimater » ce système : c'est ainsi que la construction réglementaire prévue pour l'Agence du médicament a été élargie à toutes les agences sanitaires avant d'être généralisée, en tout cas dans la sphère de la santé et de la sécurité sociale, par la loi de 2002.
Cette première étape était en quelque sorte celle de la sortie de la préhistoire, car il n'existait auparavant que les dispositions du code pénal interdisant de prendre partie dans une affaire où on a un intérêt. Ce nouveau droit s'est progressivement disséminé, sans doute plus vite que la mise en place des mécanismes permettant son contrôle et son fonctionnement. L'on est donc entré dans une deuxième phase, où il faut parfaire l'application de ces règles : c'est là-dessus que se concentre aujourd'hui l'attention.
a précisé, à ce propos, que pour lui, la déontologie de l'expertise doit reposer sur deux dispositifs.
Outre l'impartialité subjective, celle qui doit garantir que l'expert se prononce, en son âme et conscience et qu'il rend, en tout indépendance d'esprit, l'avis que l'on est en droit d'attendre de lui compte tenu de ses connaissances, il faut en effet veiller à l'impartialité objective, qui dépend de la façon dont le système permet à l'expert d'exprimer son expertise.
C'est pour cela que l'efficacité administrative est importante : le bon fonctionnement des règles déontologiques dépend aussi du bon fonctionnement des structures. La dualité de l'expertise y contribue : il faut qu'à l'expertise interne, qui était un des enjeux de la création des agences de sécurité sanitaire, s'ajoute une expertise externe faisant appel à des personnes extérieures, des praticiens, des hospitaliers, des chercheurs, y compris des chercheurs travaillant pour l'industrie.
La diversité, le renouvellement de l'expertise sont aussi importants : l'appartenance à un même corps, à une même spécialité peut être un danger. Le fait de ne pas oser contredire quelqu'un simplement parce que l'on a du respect pour ses compétences peut aussi biaiser l'expertise. C'est pourquoi il est important de diversifier l'origine des experts, de les renouveler, de faire appel, y compris dans des champs très scientifiques, à des sociologues, à des associations de patients, ce qui favorise le débat contradictoire et permet d'organiser une sorte de « contrôle social ».
a enfin complété le rappel des textes en vigueur en évoquant la mesure, également prévue par la loi de 2002 et qu'il avait personnellement soutenue, qui fait obligation à toute personne s'exprimant publiquement sur un produit de santé de faire connaître au public ses liens éventuels avec des entreprises produisant ou exploitant de tels produits.

a regretté que le décret d'application de cette disposition ne soit paru qu'en 2007, M. Didier Tabuteau, tout en s'associant à ce regret, a remarqué que le texte aurait pu être d'application directe, le décret ne lui apportant pas grand-chose.
Reprenant le cours de son exposé, il a souligné qu'il y avait sans doute de nouvelles étapes à franchir pour mieux assurer le respect de la déontologie, comme l'indiquent les travaux du Sénat allant dans le sens d'un « Sunshine Act » à la française. On peut aussi envisager la possibilité de prévoir que les laboratoires fassent état des conventions qu'ils passent, des liens d'intérêt qu'ils nouent avec des professionnels. Il est à noter, à cet égard, qu'une disposition de cette nature a été intégrée à la loi américaine de réforme du système de santé.
a dit qu'il lui semblait avoir lu dans la presse que le président du syndicat professionnel des entreprises du médicament (LEEM) n'était pas favorable à une telle disposition.
a répondu qu'en revanche l'industrie américaine et les professionnels semblaient dans l'ensemble approuver cette mesure, qui sera applicable en 2013 mais que certains appliquent déjà par anticipation. Il a souligné qu'elle avait l'intérêt de dédramatiser les relations qui peuvent exister, très légitimement, entre des experts, des entreprises, des professionnels du secteur de la santé.
Une autre amélioration envisageable serait de consolider toutes les instances d'expertise. Il n'est pas souhaitable en effet d'encourager les groupes ou comités informels qui ont longtemps été nombreux dans le secteur de la santé : la meilleure façon de garantir la transparence, lorsque l'on met en place un comité, c'est de l'institutionnaliser, de le doter de règles, de nommer ses membres.
a également rappelé la nécessité de valoriser les fonctions d'expertise dans les carrières d'enseignement et de recherche. En ne le faisant pas, on ne rend pas justice à des personnes qui se dévouent pour la collectivité.
Il faut aussi, très simplement, envisager un dispositif qui permette aux experts de se déplacer, d'aller dans des congrès, de participer à certaines manifestations. Si la puissance publique a besoin d'experts pour des décisions lourdes en matière de santé publique, il faut qu'elle s'organise pour qu'ils aient les moyens d'être au meilleur niveau scientifique. C'est une réflexion à avoir. Il y a, c'est vrai, d'autres façons de faire, mais ce ne sont sans doute pas les meilleures.
a également estimé souhaitable que le non-respect des règles de déclaration d'intérêt ne donne pas lieu à sanction pour les seuls professionnels mais aussi pour les entreprises qui ont des liens avec eux. Il serait en effet concevable que les contrats qu'elles passent avec un expert comportent une clause les obligeant à mentionner ces liens. Ce parallélisme pourrait être efficace, car les entreprises ne voudraient sans doute pas prendre le risque d'être sanctionnées, et il ne serait pas choquant. Enfin, s'il y avait un « Sunshine Act » français, son application ne devrait pas se limiter aux professionnels de santé mais être étendue à l'ensemble des intervenants dans ce domaine, comme cela a été prévu, pour les expressions publiques, pour tous les membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il n'y a en effet aucune raison de stigmatiser des professionnels de santé.
En conclusion de son exposé, M. Didier Tabuteau a avancé l'opinion que les progrès nécessaires dans l'application et le contrôle des règles déontologiques, et dans le débat sur ces questions, justifieraient que l'on développe largement la formation sur ces sujets. Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, le législateur a prévu que les experts médicaux intervenant dans les procédures d'indemnisation reçoivent une formation juridique et médico-légale les préparant à de telles fonctions. Il devrait en être de même en matière de déontologie. L'expertise aussi s'apprend. Lorsque quelqu'un rentre dans la « carrière d'expert », quand il est nommé pour la première fois dans une instance, il ne serait pas choquant qu'il reçoive une formation sur les règles juridiques et sur les dispositifs applicables, sur leur fonctionnement et leur justification.
Un débat a suivi.

Soulignant que l'exposé de M. Didier Tabuteau apportait déjà beaucoup de réponses aux interrogations que se posait la commission d'enquête, M. Alain Milon, rapporteur, l'a interrogé sur les enseignements de la gestion de la grippe en matière de liens entre les agences sanitaires, les experts et les décideurs politiques. Quelles sont les conditions d'une expertise publique efficace et socialement reconnue ? Notre système d'agences sanitaires et d'instances de conseil répond-il aux principes définis par M. Didier Tabuteau ? Faut-il interdire aux experts qui conseillent les entreprises de siéger dans les instances publiques nationales et internationales, telle l'OMS ?
Sur les liens entre agences sanitaires, experts et décideurs, M. Didier Tabuteau a estimé qu'il convenait d'être prudent. Lorsqu'on n'est pas à l'intérieur d'un dispositif, on le perçoit inévitablement de façon très déformée et il est donc difficile de porter sur lui des jugements, surtout sur des sujets importants. Il a également relevé que la situation d'aujourd'hui est très différente de celle de la fin des années 1980 ou du début des années 1990, lorsqu'il n'existait pas ou peu d'instances d'expertise. Il fallait alors, chaque fois qu'une question se posait, constituer un dispositif d'expertise.
Tel n'est plus le cas : on dispose aujourd'hui d'un réseau d'expertise et d'instances complet et assez dense, et le plus important, désormais, est sans doute de l'utiliser dans les compétences qui lui ont été dévolues, qui ont été données à chacun de ses éléments par leurs textes constitutifs. Lorsqu'un problème se pose, on saisit l'instance compétente. Lorsqu'il y a une crise à gérer, on doit pouvoir établir une sorte de « main courante » de la sécurité sanitaire, permettant de suivre un processus très clair, bien encadré et qui soit lisible de l'extérieur. C'est très important pour assurer la crédibilité de l'expertise, qui est différente de sa « scientificité », en permettant à chacun, y compris au public et à la presse, de savoir comment se déroule la gestion du processus.
Ce n'est pas facile à faire et l'on peut être tenté, sous la pression ou dans l'urgence, d'agir de façon non formalisée. Mais cela nuit à la crédibilité et cela a surtout un autre inconvénient : celui de ne pas permettre, au bon moment, aux contradicteurs de s'exprimer.
Or, a souligné M. Didier Tabuteau, la leçon que l'on peut retenir de l'expérience des crises, c'est que la contradiction est indispensable. Les meilleurs systèmes d'expertise peuvent se tromper, on le sait, et les réactions d'associations, de chercheurs dissidents, d'autres organisations pourront apporter des éléments qui permettront de changer la vision que l'on a des choses. Plus on explicite ce que l'on fait, pourquoi on le fait, plus on offre de chances aux opinions divergentes de s'exprimer. On peut les prendre en compte ou non, car les responsables doivent garder leur capacité de décision et de gestion, mais il est important de permettre, à chaque étape, à l'ensemble du corps social de réagir.
a indiqué, à ce propos, qu'il avait signé un appel paru dans la presse en septembre 2009, non pas pour remettre en cause le dispositif appliqué, mais pour demander qu'il y ait un débat public et des explications sur les décisions prises.
C'est sans doute dans cette direction que l'on peut chercher à améliorer la gestion des crises, et l'on se trouve là au coeur du lien entre les agences, les experts et les décideurs.

En réponse à une question de M. François Autain, président, M. Didier Tabuteau a indiqué que l'appel qu'il avait signé n'avait, à sa connaissance, pas eu d'effet.
Répondant ensuite à la question du rapporteur sur l'opportunité d'interdire aux experts conseillant des entreprises de siéger dans des instances publiques nationales et internationales, M. Didier Tabuteau, après s'être dit incompétent pour traiter du cas de l'OMS, dont il n'avait pas eu l'occasion de connaître les modalités de fonctionnement, a estimé impossible de poser le principe d'une telle interdiction. On ne peut, par exemple, évaluer une nouvelle approche thérapeutique en écartant tous ceux qui en ont eu l'expérience. Mais on peut, alors, élargir la méthodologie de l'évaluation, y associer d'autres scientifiques, sans écarter pour autant les experts de haut niveau qui sont intervenus sur le champ, d'autant moins qu'il n'y a, a priori, pas de raison de présumer leur absence de neutralité.
Il convient en outre, a-t-il précisé, de rappeler que tous les liens d'intérêts ne sont pas de même nature. Faire de la formation, participer à un essai clinique, ce n'est pas la même chose qu'être un expert exerçant auprès d'une entreprise un rôle de conseil ou de consultant largement « engagé » ou quasi-salarié. Ce dernier cas, à la différence des autres, peut effectivement poser un véritable problème en cas de participation à des travaux d'expertise pour les pouvoirs publics.

a ensuite souhaité interroger M. Didier Tabuteau sur la problématique de la précaution et de la prévention. A-t-il estimé que la gestion de la pandémie correspondait à une application excessive du principe de précaution ? Quelle aurait dû être, selon lui, la méthode d'évaluation du risque pandémique ?

Après une intervention de M. François Autain, président, qui a douté que l'on puisse se référer à un principe de prévention, au demeurant non prévu par la constitution, M. Didier Tabuteau s'est tout d'abord déclaré incapable de répondre à la dernière question du rapporteur, dont il a jugé qu'elle était fort intéressante mais relevait de la compétence d'un épidémiologiste.
En ce qui concerne le principe de précaution, il en a distingué deux acceptions. En matière d'environnement, il y a le « principe de précaution » tel que le définit depuis 2005 la Constitution. En matière de santé publique, il faut plutôt parler d'une « obligation de précaution » qui est beaucoup plus ancienne. La loi confiait déjà aux corps municipaux, en 1790, le soin de prendre les précautions convenables pour prévenir certains événements et y porter remède. La loi de 1884 a confirmé les obligations sanitaires de l'autorité municipale.
La notion de précaution est ainsi incluse dans la santé publique depuis l'origine. Cette obligation de précaution en matière de santé est liée à l'appréciation du rapport bénéfice-risque : il incombe au décideur d'évaluer la situation et de chercher à prendre la décision permettant d'optimiser ce rapport.
Cette « obligation » impose aussi que les moyens soient proportionnés au risque identifié. Est-ce que l'on identifie correctement le risque ? C'est une autre question - que l'on s'est posée à propos de nombreux problèmes de santé publique, par exemple la vache folle.
La question de l'évaluation du risque est déterminante, car c'est elle qui permet de savoir si « on en a trop fait » ou pas. Mais peut-on déjà, dans le cas de la pandémie grippale, répondre à cette interrogation ?
Sur la distinction entre précaution et prévention, M. Didier Tabuteau a déclaré que l'on pourrait fort bien admettre que lorsqu'un risque est certain, on est dans le domaine de la prévention et, sinon, dans celui de la précaution. Le problème est qu'en matière de santé publique, on n'est jamais dans une situation de certitude dans tous les domaines. On peut donc penser que « l'obligation de précaution », qui impose d'essayer d'évaluer le mieux possible les bénéfices et les risques, est l'attitude la plus efficace dans le domaine de la santé publique. Mais on n'a pas toujours tous les éléments nécessaires pour peser les bénéfices et les risques de manière totalement rationnelle.

a alors demandé à M. Didier Tabuteau s'il partageait l'opinion émise par le professeur Gentilini selon laquelle « le principe de précaution doit protéger la population avant de protéger les décideurs », opinion qu'il préférait ne plus exprimer personnellement, la ministre de la santé ayant considéré comme une insulte qu'il en fasse état devant elle.
Notant que le professeur Gentilini faisait partie des « experts dissidents » qui étaient allés à l'encontre des avis exprimés par l'ensemble de la communauté scientifique et qu'il avait eu le tort d'avoir eu raison, il a demandé si l'on ne pouvait pas faire le reproche aux autorités sanitaires de n'avoir pas suffisamment pris en compte l'opinion de ceux qui, très tôt, s'étaient émus de la dramatisation de la situation et de l'importance donnée à cette épidémie. N'a-t-on pas cherché à les marginaliser ou à les décrédibiliser plutôt qu'à les intégrer à la réflexion ?
a relevé à cet égard, qu'au début de la crise le discours officiel se référait volontiers au principe de précaution qui, selon lui, ne s'applique que lorsqu'on fait face à un danger que l'on ne connaît pas, dont on ignore la gravité et même l'échéance. La prévention, en revanche, correspond à l'ensemble des mesures que l'on peut prendre quand on connaît la nature et la gravité de la menace, et que l'on a une idée du moment où elle se manifestera. On doit alors tenir compte du rapport bénéfice-risque, mais aussi du rapport coût-efficacité.
Il semble que dans le cas de la grippe, on était davantage dans le domaine de la prévention que dans celui de la précaution. Mais le résultat est là : on a acheté 94 millions de doses de vaccins pour en utiliser six. C'est pour le moins, quoi qu'on en dise, une erreur de prévision.
Notant que M. Didier Tabuteau avait évoqué, dans un de ses écrits, « la pusillanimité d'un pouvoir traumatisé par le sang contaminé ou la canicule et tétanisé par des mesures de réorganisation du système de soins ou d'équilibrage des comptes sociaux », M. François Autain, président, a relevé qu'en l'occurrence, en dépit du souci du rééquilibrage des comptes, on n'avait pas hésité à dépenser des sommes colossales équivalant au déficit annuel des hôpitaux publics.
Il a dit avoir le sentiment que l'on parlait moins de précaution, de sécurité sanitaire, de transparence, d'évaluation, que de grands thèmes moraux, comme l'éthique. Effectivement, quand on invoque l'éthique, il n'y a plus d'arguments. On peut acheter des vaccins pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de se faire vacciner. Peut-être aurait-on quand même pu essayer de mieux ajuster les commandes à la demande. Les critères retenus n'étaient apparemment pas les bons et il aurait peut-être été préférable de procéder à un sondage.
On peut donc se poser bien des questions. C'est peut-être le professeur Floret qui a eu la bonne réponse en définissant la décision d'achat des vaccins, prise avant l'avis du Haut Conseil de santé publique (HCSP), comme une décision politique. Et c'est peut-être pour cela que l'on a du mal à situer cette décision dans le cadre d'une réflexion de santé publique.

Faisant suite aux propos du président, M. Alain Milon, rapporteur, a demandé si la préparation à des risques de grande ampleur empêchait de voir des risques de moindre ampleur.
Observant que les questions posées, qui ont trait à l'adaptation d'un système de santé moderne aux crises - pour les prochaines fois car il y aura des prochaines fois, étaient celles que se posaient tous les analystes de la santé, M. Dider Tabuteau a considéré que, pour sa part, il ne pourrait faire que des analyses rétrospectives sur la base des informations dont il dispose, c'est-à-dire essentiellement celles parues dans la presse, puisqu'il n'avait en rien participé au processus de décision.
Ces informations, jusqu'en juillet, août et septembre, semblaient quand même indiquer que l'on était en présence d'une menace sérieuse. Certaines étaient plus alarmistes que d'autres, mais on pouvait se poser des questions sur la mortalité directe, la virulence du virus, le niveau du recours aux soins intensifs en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Clairement, ce n'était pas la grippe espagnole, mais on semblait être sur un sujet sérieux, au moins aussi sérieux et peut-être plus qu'une grippe saisonnière.
Donc, au vu des éléments connus, en tout cas de ceux publiés dans la presse, aux dates auxquelles ont été passées les commandes de vaccins, il paraît difficile de dire que l'on est dans une démarche excessive a priori, voire complètement délirante. Peut-être aurait-on dû passer des commandes un peu moins importantes mais, faute d'informations plus précises, on ne peut guère formuler d'autre jugement.
En revanche, on peut avoir beaucoup plus de réactions vis-à-vis de l'organisation du dispositif de vaccination car, en ce domaine, on a sans doute raté l'occasion, dans un système de santé moderne, de mobiliser les associations et le corps médical sur des missions de santé publique nouvelles, ce qui aurait peut-être pu changer l'appréciation portée, après coup, sur la vaccination - même si, bien sûr, cela n'aurait rien changé quant à la gravité de la grippe.
En conclusion, M. Didier Tabuteau a estimé que l'on ne pouvait, jusqu'à l'été, juger que les décisions prises avaient été fantaisistes, ni porter d'appréciation précise sur le nombre de vaccins à commander, ni trouver anormal de vouloir faire en sorte que toute personne qui souhaite être vaccinée puisse l'être.

En réponse à une question de M. François Autain, président, il s'est dit persuadé que le dispositif de la vaccination avait certainement eu un effet majeur sur « l'acceptabilité » de celle-ci. Il a par ailleurs estimé qu'en situation d'incertitude, seul le politique est légitime pour prendre les décisions. Il est le seul à pouvoir prendre une décision de « risque » - qu'il soit sanitaire ou financier - avec la légitimité du suffrage universel. C'est aussi la même chose dans le cas des décisions de prévision. L'expert ne doit en aucun cas devenir le paravent du politique. Il y a une responsabilité incessible du politique.
a noté qu'en septembre, lorsque le risque est apparu moins grave, le nombre de vaccins commandés aurait pu apparaître plus disproportionné. N'aurait-il donc pas fallu faire dès septembre ce que l'on a fait en janvier ?
a noté qu'en septembre, octobre et novembre, il y avait, semble-t-il, beaucoup de gens qui souhaitaient être vaccinés, et que ce qui lui paraissait le plus regrettable, en termes de santé publique, c'est que l'on n'ait pas été en position de répondre à cette demande.

a remarqué que cette situation ne tenait pas seulement à l'organisation de la vaccination mais aussi au rythme de livraison des vaccins, en particulier à l'arrivée tardive des vaccins destinés aux enfants. Compte tenu des délais incompressibles de mise à disposition des vaccins, doit-on considérer le vaccin comme le moyen le plus efficace pour contenir ou enrayer une épidémie ? D'autres moyens ne sont-ils pas finalement plus efficaces ? Dès lors, la vaccination n'apparaît-elle pas comme une « mesure de précaution » totalement disproportionnée ?
est convenu que la vaccination n'était qu'un élément d'un dispositif plus global. Mais il a estimé que si le dispositif de vaccination avait été « construit » autrement, en associant les professionnels de santé, la vaccination aurait pu être plus rapide et concerner une population plus importante. Il a donc affirmé rester persuadé que l'on avait manqué une occasion, et réitéré son regret que l'on ait « défini le 21 juillet la médecine de premier recours et, le 21 août, la médecine de dernier recours ».
C'est là un sujet de réflexion important pour l'avenir. Comment faudra-t-il, dans la perspective d'une prochaine crise, s'organiser pour faire une politique de santé publique moderne dans un pays ayant un système de santé développé ? C'est peut-être d'abord cette occasion manquée qu'il faut déplorer, et d'abord sur ce point qu'il faut mener une réflexion critique.
La question de la réponse aux risques de petite et de grande ampleur est aussi une vraie question. On a pu se demander s'il ne conviendrait pas d'avoir une direction chargée de la santé publique et une autre chargée de la sécurité sanitaire : c'est une boutade, mais qui exprime bien que la pression qu'exerce sur le système de santé une menace ponctuelle grave - la méningite par exemple - ou une menace de plus grande ampleur - une pandémie grippale - a des conséquences sur des politiques « au long cours » d'importance majeure, telle la lutte contre le cancer ou l'obésité, qu'on ne peut mener que dans la durée et qui sont de ce fait très difficiles à gérer.
Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la politique de santé publique qu'il faut conduire au quotidien et la gestion des problèmes de sécurité sanitaire qui peuvent devenir « envahissants », ou sur lesquels ont peut avoir tendance, par moment, à se focaliser en négligeant d'autres sujets beaucoup plus importants.

a ensuite interrogé M. Didier Tabuteau sur les conséquences que pourrait avoir la gestion de la crise sur l'attitude des Français à l'égard de la vaccination.
a estimé que l'on pouvait considérer que la vaccination avait été « malmenée », mais sans doute moins que la santé publique en général, alors que la crise grippale offrait une occasion au système de santé publique de « franchir une étape de maturité ».

évoquant un ouvrage sur l'affaire du sang contaminé que son titre définissait comme « une défaite de la santé publique », s'est demandé si l'on ne pourrait pas caractériser la pandémie grippale comme « une occasion manquée pour la santé publique ».

a souligné que les analyses à faire de la crise grippale ne devraient pas non plus négliger le rôle d'internet qui a montré qu'il permettait de donner à l'information non scientifique une audience et une crédibilité qui éclipsaient celles de l'information scientifique.

a demandé des précisions sur la formation que M. Didier Tabuteau estimait souhaitable de dispenser aux experts. Qui pourrait être chargé de la dispenser ? En quoi consisterait-elle ?
a indiqué que l'on peut envisager deux types de formations spécifiques nécessaires aux experts. Il y a d'abord une formation à la méthodologie de l'expertise dans les domaines ou les secteurs où chaque expert intervient, l'acquisition des compétences qui font de l'expertise un « métier à part ». Ce n'est pas celle-ci qu'il a évoquée, mais la formation « déontologique », la formation au droit de l'expertise, aux missions de service public auxquelles participent tous les experts, quels que soient leur spécialité ou leur niveau d'intervention. Une telle formation pourrait être organisée dans des grandes écoles, et notamment à l'EHESP, mais aussi à l'université, sous forme de modules très généraux et susceptibles de s'adresser à des experts participant à des instances de toute nature. Elle porterait sur les principes fondamentaux de la déontologie de l'expertise, sur la notion d'intérêt général, sur les principes du service public et de la participation à des missions de service public.

a enfin posé une question sur les pays européens qui avaient refusé d'organiser une vaccination anti-pandémique. Il a souhaité savoir quelles réflexions leur décision inspirait à M. Didier Tabuteau, en tant que spécialiste de la santé publique. Faut-il penser que cette décision, comme cela a été annoncé, était en fait motivée par un manque de financements disponibles ? Et, si tel est le cas, est-ce à dire que les pays qui ont des moyens peuvent choisir de les gaspiller ?
a indiqué qu'au risque de décevoir le président François Autain, il était incapable de porter un jugement sur des décisions dont il ignorait sur quels fondements et dans quel contexte elles avaient été prises.