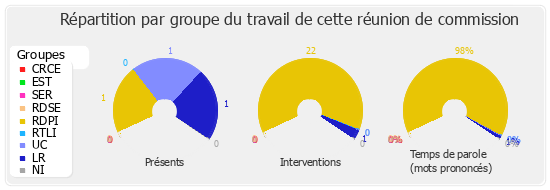Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables
Réunion du 7 mars 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Après le scandale du Mediator, nous avions presque prédit que si un problème nouveau devait surgir, il toucherait les dispositifs médicaux. Est venue l'affaire des prothèses, à laquelle cette mission fait suite : il est urgent de se pencher sur la sécurité de tous ces produits de santé qui font l'objet d'actes médicaux ou d'interventions à visée esthétique. Nos travaux doivent déboucher, d'ici la mi-juillet, sur des recommandations.

Je souhaite vous poser trois séries de questions. La première porte sur l'état du marché de ces produits.
Est-il possible d'évaluer le volume des dispositifs médicaux commercialisés sur le marché français et son chiffre d'affaires ? Même question pour les seuls produits à visée esthétique. Comment les autorités sanitaires françaises parviennent-elles à concilier, dans la régulation de ce marché, les exigences de sécurité propres à chaque spécialité de produits et l'encouragement à l'innovation et la recherche ?
Observe-t-on une tombée significative des brevets sur les dispositifs médicaux et, en conséquence, une montée en puissance d'équivalents « génériques » ? Si oui, quelles sont les spécialités les plus concernées ?
Quel est le taux de pénétration des dispositifs médicaux fabriqués à l'étranger sur le marché français ? Quelles sont les spécialités les plus concernées ? Les produits à visée esthétique le sont-ils davantage que d'autres spécialités ayant recours aux dispositifs médicaux ?
Quel est le cycle de vie moyen d'un dispositif médical ? Cette donnée varie-t-elle sensiblement en fonction de la spécialité concernée ?
A votre première question, ma réponse est non. On ne peut évaluer le volume d'un marché de la valeur duquel nous n'avons qu'une vision très partielle. En témoigne la béance entre les chiffres livrés par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) en novembre 2010 - 21 milliards de d'euros - et ceux du Ceps - 6,8 milliards. Ceci est largement imputable à notre ignorance tant de la valeur que du volume des dispositifs achetés par l'hôpital public. Nous ne retraçons donc que ce qu'achètent les cliniques privées et qui est remboursé par l'assurance maladie. On peut cependant penser que la valeur de la dépense, pour l'hôpital public, est largement égale à celle qui provient des cliniques.
Tempérons cependant notre frustration : le contenu des lignes de produits changeant d'année en année, il n'est guère de suivi possible. Chaque année, des produits en sortent et d'autres sont inscrits sur la liste en sus des prestations prises en charge par l'assurance maladie. C'est un peu comme l'élève de CM2 devant le problème de la baignoire qui fuit. L'évolution globale de la valeur ne donne guère les moyens de mesurer les besoins physiques qu'elle vient satisfaire. A quoi s'ajoute le problème d'une double entrée sur le marché : à l'entrée sous marque, qui fait l'objet d'une évaluation de la HAS, le prix étant ensuite fixé par nos soins, s'ajoute l'entrée en ligne générique, purement déclarative, dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) tient le fichier, sans qu'il soit possible, cependant, de bien discerner combien de produits sont inscrits chaque année et leur valeur. L'entrée sous la ligne générique est, de surcroît, dispensée d'évaluation. Alors que l'entrée en générique est la règle et l'entrée en marque l'exception, nous avons été conduits à inverser la logique, parce que les produits sont traçables et ont fait l'objet d'une évaluation.
Les produits esthétiques sont à cheval entre le remboursable et le non remboursable, en vertu d'un double usage, soit en tant que médicament, soit en tant que produit à visée esthétique. Je pense, par exemple, au Botox, ce qui complique, là aussi, le suivi.
Le taux de pénétration des produits de fabrication étrangère est élevé, à quelques exceptions près, comme les prothèses de hanche. Les produits esthétiques, en cette matière, ne se singularisent pas.
La question des tombées de brevet, capitale pour le médicament, n'est pas ici opératoire : le cycle de vie des dispositifs de santé est très réduit, deux à trois ans tout au plus, si bien que la durée du brevet est toute théorique et que son terme ne fournit pas l'occasion de baisser les prix. L'occasion, pour les produits sous marque, vient plutôt des me too, ces produits très voisins qui suivent toujours un premier lancement. Quant au prix d'un générique, il faudrait, pour le baisser, appréhender une ligne entière, laquelle peut regrouper des produits très divers.
Vous m'interrogez sur les évolutions technologiques. Elles sont rapides, tous les implants étant loin d'avoir atteint la maturité technologique légendaire de la canne anglaise. Plaisanterie à part, les évolutions les plus rapides sont celles qui touchent à l'électronique, comme en matière d'implants cochléaires. Les évolutions peuvent tenir aux techniques de pose : c'est le cas pour les stents actifs. Les défibrillateurs, aussi, mériteraient d'être cités.

Ma deuxième série de questions a trait à l'évaluation des dispositifs médicaux et du rapport bénéfices-risques.
Quelle a été l'évolution, au cours des dix dernières années, de la dépense de l'assurance maladie au titre de la prise en charge des dispositifs médicaux ? Comment s'expliquent les évolutions de ce poste de dépenses et varient-elles en fonction des spécialités ? Observe-t-on une augmentation de la population concernée par la pose de dispositifs médicaux implantables ?
De quels éléments les autorités françaises, Ceps et HAS, tiennent-elles compte pour déterminer un prix de marché acceptable et moduler la prise en charge correspondante ?
La décision de remboursement d'un dispositif médical est-elle bien subordonnée à la communication régulière d'évaluations cliniques avant et après la mise sur le marché ? A quel délai les bénéfices sont-ils réévalués après autorisation de mise sur le marché ? Quelle est la fréquence des révisions de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ?
Quels sont les éléments de contrôle préalable à l'inscription d'un générique sur la LPPR ? La déclaration obligatoire auprès de l'Afssaps est-elle la seule procédure nécessaire à une première inscription ? L'évaluation médico-technique par la Commission nationale des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) n'intervient-elle qu'après la première inscription ?
Les délais d'évaluation nécessaires à la conduite d'études cliniques fiables sont-ils compatibles avec 1'obsolescence rapide de certains types de dispositifs médicaux ?
En cas de défectuosité d'un implant, dans quelle mesure l'assurance maladie prend-elle en charge son explantation et son éventuel remplacement ? Est-elle en mesure d'imposer, alors, le choix de la marque, en fonction des données cliniques disponibles ?
Au vu des incidents récents, qui ont concerné tant des dispositifs pris en charge, comme les prothèses de hanche, que des dispositifs non remboursables, comme les prothèses mammaires PIP, ne pensez-vous pas nécessaire de revoir en profondeur la méthodologie des essais cliniques devant déterminer le rapport bénéfices-risques de ces produits ? Si oui, quels principes devraient être retenus pour améliorer le niveau des preuves scientifiques des essais dans l'intérêt du patient ? Quelles instances seraient appelées à s'impliquer dans cette refonte méthodologique ?
Que recommandez-vous pour renforcer les études cliniques sur les dispositifs médicaux les plus critiques et harmoniser les exigences au niveau européen ? Seriez-vous favorable à la création d'un comité d'experts communautaire chargé de superviser les organismes nationaux et de mettre au point une méthodologie indépendante et transparente d'évaluation clinique ?
Existe-t-il un accompagnement spécifique et une surveillance particulière pour les dispositifs innovants à fort bénéfice clinique qui n'ont pu bénéficier d'une évaluation très approfondie ?
Ne serait-il pas bon de faire précéder toute première inscription au titre de la description générique sur la LPPR par une évaluation médico-technique par la CNEDiMTS ? Et rapprocher les missions de cette dernière de celles de la commission de la transparence pour les médicaments ?
Quels sont, enfin, les éléments de l'accord-cadre conclu fin 2011 sur les études post-inscription conduites conjointement par le Ceps et la CNEDiMTS ?
Sur ce tableau retraçant les évolutions sur dix ans, de 2001 à 2010, des remboursements par l'assurance maladie, vous voyez que le taux moyen de remboursement porte sur la part remboursable, non sur le prix réel, ce qui relativise certains pourcentages qui apparaissent élevés, notamment pour les dépenses d'optique. Les prothèses internes ne font pas figure d'exception : une évolution du taux de remboursement de 160 % sur dix ans, dans une fourchette qui va de 102 % pour les pansements, à 270 % pour les appareils respiratoires. Ce qui fait, en revanche, exception, c'est l'évolution de la dépense, nettement supérieure à l'évolution d'ensemble des dépenses d'assurance maladie. Je répète cependant que les lignes ne sont guère comparables d'une année sur l'autre ; les chiffres ne donnent qu'une mesure en volume, pour peu que l'on considère qu'il y a autant d'entrées que de sorties.
Pour l'évaluation du prix, nous prenons en compte trois critères. L'amélioration du service attendu rendu, tout d'abord, que déterminent la HAS et le CNEDiMTS. Nous demandons ensuite - ce qui n'est pas le cas pour le médicament - au fabricant ou à l'importateur de fournir une décomposition du prix de vente, pour apprécier le bien fondé de sa demande, que nous comparons, enfin, avec les prix pratiqués à l'étranger. La procédure est globalement satisfaisante.
Nous sommes de plus en plus sensibles à la fixation d'un prix limite de vente, pour éviter un reste à charge subreptice aux assurés. D'où l'intérêt que nous portons, en retour, au prix de cession à l'hôpital et à l'officinal, afin d'éviter un grignotage des marges.

La décomposition du prix vous est-elle un indice pour détecter une éventuelle malfaçon ?
Non, pour faire une distinction, il faudrait que l'Afssaps en fasse une au départ. Pour les prothèses mammaires, le CNEDiMTS avait déclaré qu'elles se valaient toutes. Ce n'était pas l'avis des associations, ni des fabricants, si bien que nous n'avons pu fixer un prix unique, et avons dû renvoyer le dossier au CNEDiMTS.
Les réévaluations ont lieu tous les cinq ans, sachant que le CNEDiMTS a la faculté de resserrer l'intervalle, comme cela lui est arrivé pour les valves aortiques percutanées qui ont bénéficié d'un saut technologique important. Mais ses moyens sont limités, et la charge de travail que donne la réévaluation d'ensemble de la LPPR est lourde : il reste beaucoup à faire d'ici 2016, terme fixé par la loi de 2004.
Le marquage CE souffre d'une faiblesse préoccupante, dont fait état un article du New England Journal of Medicine paru le 1er mars, qui compare la procédure aux Etats-Unis et au sein de l'Union européenne. De fait, il n'est pas homogène : certains Etats le délivrent beaucoup plus facilement que d'autres.
La déclaration préalable à l'Afssaps pour les génériques ? Il n'y a pas moyen d'y échapper. La question est plutôt la suivante : à quand un fichier opératoire des génériques, sachant que la masse des dispositifs médicaux évolue beaucoup plus lentement que celle des génériques.
La question des délais d'évaluation, en revanche, soulève un vrai problème, notamment pour les études postérieures à la mise sur le marché. C'est la rançon de progrès très rapides. D'où la priorité à donner à toute mesure susceptible de rendre les études post AMM plus efficaces et plus rapides.
La prise en charge de la remédiation par l'assurance maladie en cas de défectuosité ? C'est d'abord la responsabilité du fabricant qui est en jeu, même si je conviens qu'elle est parfois difficile à établir. On touche là du doigt une faiblesse du système d'information et de traçabilité.
L'assurance maladie prend alors bien évidemment le relais, en dernière instance.
En tout état de cause, l'assurance maladie peut agir par subrogation, mais pas intervenir en lieu et place des responsables. Elle ne peut imposer, alors, le choix d'une marque, tant les dispositifs sont nombreux. J'en veux pour preuve l'article récent du Pr Mimoun dans Le Monde, qui dit n'avoir jamais posé de prothèse PIP et attendre toujours une préconisation de l'Afssaps. Il est d'autant plus difficile pour les autorités de classer les prothèses que les progrès technologiques sont rapides.
Le problème n'est pas tant technique que de capacité d'évaluation au jour le jour. L'article du New England Journal of Medicine sur des défibrillateurs dont je ne sais pas s'ils sont sur le marché français évoque certains problèmes. Les autorités chargées de l'évaluation ont du mal à suivre.
La méthodologie des essais cliniques est sans doute à revoir. Il faut aussi trouver un équilibre entre les contrôles ex ante et ex post. Une grande partie de l'innovation est le fait de petites entreprises incapables de supporter les frais d'un dossier de demande d'AMM. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, il faut arbitrer entre l'encouragement à l'innovation et la prise en compte des risques. Un contrôle ex ante trop exigeant freinerait l'innovation. Lors de son audition par votre mission d'information, M. Maraninchi a suggéré que, comme pour le médicament, un pharmacien responsable soit désigné qui, vu la taille des entreprises, répondrait probablement pour plusieurs d'entre elles : il faudrait voir si les entreprises sont capables de s'organiser pour créer des centres de gestion de pharmaciens responsables. Si le contrôle ex ante doit être mesuré, il faut en revanche renforcer le contrôle ex post. La Commission européenne veut justement harmoniser les tâches des organismes notifiés, imposer une tarification commune et des contrôles inopinés.

Si je comprends bien, il faudrait accepter de prendre un risque pour ne pas brider l'innovation, et préférer le contrôle ex post au contrôle ex ante.
Avec trop de contrôles ex ante, on freinera l'innovation. Ce sera une perte invisible mais néanmoins une perte de chance pour les malades. Il faut donc que les contrôles ex post soient beaucoup plus lourds. A côté des organismes notifiés, l'assurance maladie a aussi un rôle à jouer.

Contrairement à ce qui se passe en Europe, aux Etats-Unis on privilégie l'innovation, quitte à laisser les risques au second plan. Des élus y reprochent parfois aux fonctionnaires d'être trop tatillons... N'y a-t-il pas une voie moyenne ?
Je ne suis pas convaincu qu'en la matière, l'Europe et les Etats-Unis s'opposent comme vous le dites. Les outils dont s'est dotée l'administration - inscription des dispositifs médicaux, carte sanitaire pour les équipements lourds - ont été conçus naguère pour diffuser le progrès plutôt que pour le contrôler. Ils sont devenus inadaptés, depuis que l'on s'inquiète davantage des risques.
Bien sûr. Le domaine des dispositifs médicaux, je l'ai dit, se caractérise par le fait que la balance bénéfices-risques n'y est pas la même que pour les médicaments. M. Maraninchi estime que les petites entreprises n'ont qu'à s'allier avec les plus grosses, et que l'artisanat n'a pas sa place ici. Il est indéniable qu'une restructuration du secteur est indispensable - elle permettrait aussi d'obtenir des gains de productivité et des baisses de prix, dix fois moins rapides aujourd'hui que dans le domaine du médicament - mais cela prendra du temps.
S'agissant des produits fortement innovants, le mieux serait de conclure l'équivalent des contrats de partage de risques pour les médicaments, et de procéder à une réévaluation rapide, pour suivre pas à pas ces produits.
En ce qui concerne l'évaluation médico-économique, le Ceps et la HAS ont récemment lancé une procédure d'avis flash, conforme aux délais réglementaires d'évaluation.
J'en viens à la question des études ex post. Nous avons conclu en décembre un accord-cadre sur les dispositifs médicaux avec fabricants et importateurs. Nous voulions associer étroitement la CNEDiMTS à nos travaux, afin de constituer un guichet commun d'études post-AMM et de rendre le contrôle moins coûteux, plus sûr, plus cohérent et plus rapide - même si nous ne rattraperons peut-être pas le rythme d'obsolescence de certains dispositifs médicaux... Fabricants et importateurs s'en sont félicités.
L'accord-cadre prévoit aussi la mise en place d'un système d'information. Tout reste à faire. Nous allons voir ce qui est utilisable dans les bases de données de l'assurance maladie, ce que l'on peut obtenir des fabricants et importateurs ou acheter sur le marché. Nous n'atteindrons jamais à la qualité du système d'information sur les médicaments, mais les marges de progression sont considérables. Enfin, l'accord édicte ou précise les règles relatives au dépôt des données, à l'évaluation, aux auditions, aux procédures contradictoires, aux éventuelles sanctions. Sur vingt-neuf organisations professionnelles ou syndicales, vingt-six l'ont déjà signé. Il faudra cependant le modifier par avenant pour tenir compte des nouvelles règles applicables à la publicité, votées dans le cadre de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament.

Quelle appréciation portez-vous sur les registres existant à l'étranger qui permettent de retracer le parcours de dispositifs médicaux ou de produits à visée esthétique ? Que recommandez-vous pour améliorer la traçabilité des produits cosmétiques injectables ?
Pourquoi se limiter aux produits injectables ?

C'est là où l'évolution est la plus sensible, les lacunes de la réglementation les plus évidentes.
Peut-être, mais on vend aussi dans les grandes surfaces des produits de blanchiment des dents qui contiennent des principes actifs... Cela dit, un registre des produits injectables serait certainement très utile. Nous sommes déjà en mesure de suivre la consommation des produits remboursables, qui ont un statut de médicament - hormis leur usage non remboursé. Cela relève de la mission de sécurité sanitaire de l'Afssaps. La technique du registre est d'efficacité décroissante à mesure que le nombre de personnes concernées s'accroît. Le registre est une culture, que nous avons du mal à importer en France. Nous peinons à obtenir des résultats même lorsque ne sont enregistrés que deux cents à deux cent cinquante patients. Comment donc concevoir un registre de dix mille ou vingt mille personnes ?

Je peine à comprendre : vous reconnaissez l'utilité des registres, tout en avouant que les résultats sont maigres... Où placez-vous le curseur ?
Il faut user de plusieurs outils à la fois. Pour ce qui est des prothèses implantables, pourquoi ne pas communiquer au patient le numéro de référence, le code et le nom de l'entreprise ? En cas de rappel, les gens sauraient s'ils sont concernés. Ce serait moins facile pour les produits injectables... On pourrait aussi exiger des laboratoires qu'ils déclarent à l'Afssaps l'évolution de leur production. Mais jusqu'à quel degré de précision aller ?

Un registre permettrait au moins aux opérateurs de suivre le devenir d'un produit.
Ce serait l'équivalent du tableau des substances vénéneuses.
L'Australie, c'est loin. La Suède encore plus - si l'on considère la politique de santé publique et la culture épidémiologique. En France, nous ne nous préoccupons de ces questions que depuis une quinzaine d'années. On comprend aisément pourquoi le système de pharmacovigilance ne fonctionne pas : lors des assises du médicament, j'ai entendu des médecins libéraux expliquer que le contrôle n'était pas leur métier ! C'est un problème de formation.
Ça l'est mais ce n'est pas encore intériorisé. Faute d'un registre, une cohorte représentative serait un outil d'alerte plus léger mais très efficace.

Au vu de l'information médicale qui circule sur Internet et les réseaux sociaux, doit-on craindre le développement de trafics illégaux ?
Sans doute, pour les dispositifs médicaux comme pour les médicaments contrefaits.

Pourquoi ne pas créer un site Internet qui mette à la disposition du public une information transparente et indépendante, comme l'a fait le gouvernement de l'Etat de Victoria en Australie avec le Better Health Channel ?
Nous pourrions nous rapprocher d'un tel système, pour responsabiliser les consommateurs. Ce ne serait pas très coûteux. Il existe déjà une banque de données européenne, nommée Eudamed, qui recense les fabricants, les produits et les événements indésirables, mais elle n'est pas accessible aux particuliers. Peut-être faut-il en élargir l'accès, pour faire prendre conscience aux patients des risques qu'ils prennent en agissant seuls.

Voyez-vous quelque chose à ajouter en ce qui concerne les produits à visée esthétique ?

Si un dispositif implanté se révèle défectueux, son ablation et l'implantation d'un nouveau dispositif sont-ils pris en charge par l'assurance maladie ?
Oui, mais la vertu exige que les fabricants en assument les frais à mesure de leur responsabilité. L'assurance maladie n'acquitte que le solde. En général les fabricants obtempèrent, sachant que, s'ils ne paient pas, l'administration considérera avec moins d'aménité le développement ultérieur de leurs activités...

Ils pourraient arguer que le produit a été certifié et qu'il était impossible de prévoir les complications dix ou vingt ans à l'avance.
Mais un fabricant ne peut se permettre de fâcher l'administration, qui est chargée d'autoriser ou non la mise sur le marché de ses nouveaux produits.
La plupart du temps, les entreprises sont rachetées. En revanche, une rupture de gamme est possible : on se retrouve alors avec un défibrillateur et une console inadaptée.
Si l'on veut les bénéfices de l'innovation, il faut accepter une part de risque, ce à quoi nous ne sommes pas bien préparés.

Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Notre mission d'information, qui porte sur les dispositifs médicaux et les interventions à visée esthétique, doit rendre ses conclusions à la mi-juillet. Lors du scandale du Mediator, le Sénat s'était inquiété de l'éventualité d'un prochain scandale touchant les dispositifs médicaux. L'histoire, hélas, lui a donné raison.
La loi « Mediator », relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé concerne aussi les dispositifs médicaux, et le scandale des prothèses PIP, s'il a éclaté depuis son entrée en vigueur, porte sur des faits antérieurs, tout comme celui des prothèses de hanche récemment révélé par Le Figaro.
Mais il faut aller plus loin. Nora Berra et moi-même avons demandé en décembre que l'explantation des prothèses PIP soit proposée à toutes les femmes concernées, même sans signe clinique de détérioration, à titre préventif et sans caractère d'urgence. M. Jean-Claude Mas me l'a reproché... Certains de mes homologues européens s'en sont aussi étonnés, mais il fallait tenir compte du risque de rupture et du pouvoir irritant du gel, ainsi que de la dimension psychologique de ce dossier. J'estime que cette décision s'imposait devant le nombre de cas de ruptures. Notons cependant que, selon l'avis rendu fin décembre par l'Institut national du cancer, il n'existe pas de risque accru de lymphome. Le comité de suivi national a fait le point le 6 février sur l'organisation des soins ; le prochain aura lieu le 14 mars ; la collaboration est excellente, et je salue l'esprit de responsabilité des professionnels de santé dans la détermination de leurs honoraires - mais je ne me contenterai pas de déclarations d'intention. Nous n'avons pas connaissance à ce jour de tensions dans l'organisation des soins. La gestion des rendez-vous pour les consultations est satisfaisante, et des explantations sans caractère d'urgence ont été programmées ; certaines auront lieu dans les prochaines semaines.
Nous avons pris connaissance en février du rapport de la Direction générale de la santé (DGS) et de l'Afssaps. Il en ressort que l'explantation est nécessaire, et que l'on a affaire à une tromperie de grande ampleur qui a ahuri les autorités sanitaires et les professionnels de santé, et dont les premières victimes sont les femmes. Ce scandale illustre les faiblesses du système de contrôle et de vigilance qui prévalait avant la loi « Mediator » de décembre 2011.
Pour garantir la sécurité d'emploi des dispositifs médicaux, un contrôle rigoureux est nécessaire, depuis l'autorisation de mise sur le marché jusqu'au suivi clinique des patients. Au plan national, les systèmes d'inspection et de matériovigilance doivent être renforcés ; l'Afssaps doit disposer de contrôleurs plus nombreux, procéder à des contrôles plus fréquents et plus efficaces. Au plan européen, il faut revoir la directive 93/42/CEE en ce qui concerne les données fournies par les fabricants, l'évaluation antérieure à la mise sur le marché, les contrôles chez les fabricants et dans les établissements d'implantation, le partage de l'information entre les autorités, le fonctionnement des organismes qui délivrent des certifications. Avec mes homologues belge, autrichien, luxembourgeois, slovène et letton, j'ai écrit en ce sens au commissaire John Dalli.
Nora Berra et moi-même avons également demandé à l'Afssaps la liste des dispositifs médicaux implantables à risque et le programme d'inspections pour 2012. Nous avons demandé à la DGS et à l'Afssaps de faire des propositions de refonte du système de vigilance, avec l'aval de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) : tout incident doit être déclaré et le lanceur d'alerte doit se sentir protégé. Nous attendons d'ici deux mois un rapport sur l'état des lieux et les perspectives d'utilisation des prothèses mammaires en silicone, dix ans après la levée du moratoire en France.
Nous avons tous pour rôle d'assurer la sécurité sanitaire des Français, et votre mission d'information peut apporter une contribution essentielle à nos réflexions. C'est pourquoi j'aimerais en savoir plus sur votre calendrier.

Une mission d'information est normalement constituée pour six mois, mais le mois d'août n'étant pas le bon moment pour rendre notre rapport, nous prévoyons d'en avoir fini avant le 14 juillet.
J'espère que nous nous reverrons d'ici là, pour que je vous fasse part des mesures réglementaires que je compte prendre.

Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas adopté une procédure d'autorisation de mise sur le marché des dispositifs invasifs les plus risqués, comme c'est le cas aux Etats-Unis notamment pour les implants mammaires? Comment expliquez-vous que le système de contrôle et d'évaluation clinique soit plus rigoureux outre-Atlantique ?
Je ne saurais répondre au nom des autorités européennes, n'étant pas moi-même satisfait des règles en vigueur. Le contrôle des médicaments a longtemps été insuffisant, pour les dispositifs médicaux ; comme on dit en bon patois picard, c'était un no man's land. On peut tenter de l'expliquer. Tout d'abord, ces produits sont nombreux et variés ; même si l'on se limite aux dispositifs invasifs, le champ reste beaucoup plus large que celui des médicaments. Le rapport publié par l'Igas en novembre 2010 sur l'évolution et la maîtrise des dépenses relatives aux dispositifs médicaux recensait pas moins de 800 000 produits ! En outre, la plupart des pays étaient dénués de toute expertise en matière d'évaluation, ce qui interdisait la mise en place d'un régime même partiel d'autorisation. Enfin, la place des dispositifs thérapeutiques invasifs ou implantables s'est considérablement accrue ces dernières années.
Sous l'impulsion de la France, la directive a été modifiée une première fois pour revoir les règles de l'évaluation clinique, mais cette réforme n'est entrée en vigueur qu'en mars 2010. Elle reste d'ailleurs très insuffisante, en raison de l'organisation très déconcentrée de la certification de conformité, de son opacité et des limites du contrôle a posteriori. Il faut aller vers une AMM explicite.
Oui, du moins pour les dispositifs les plus risqués. N'est-il pas légitime qu'une valve cardiaque soit soumise au même contrôle qu'un médicament ?

Vous seriez donc favorable à une AMM délivrée par une autorité nationale ou européenne, et au renforcement du contrôle des organismes notifiés ?
Oui en ce qui concerne les produits de classe III, ceux qui font courir le plus de risques car ils restent plusieurs années dans le corps humain. L'autorisation doit être délivrée par une structure indépendante et fondée sur une évaluation collégiale, reposant sur des données cliniques comparatives, contradictoires et vérifiables. Il faut aussi mettre en place une structure de coopération permanente entre les autorités compétentes. C'est ce qui a fait défaut dans le cas du Mediator. L'organisme chargé de délivrer l'AMM pourrait être soit l'Agence européenne du médicament - ce qui aurait le mérite de la simplicité, mais le contrôle des médicaments a ses caractéristiques propres - ou une commission ad hoc placée auprès de la Commission européenne. Il faut plus d'Europe, mais je ne veux pas d'une Europe qui me laisse pieds et poings liés et qui m'empêche de mener des contrôles complémentaires au niveau national : de même, si l'AMM des médicaments est délivrée au niveau européen, j'ai changé les règles relatives au remboursement pour ne pas dépendre exclusivement des décisions européennes.

Comment faire pour qu'un contrôle plus strict ne bride pas l'innovation ? Quid de la contradiction entre innovation et risque ?
Je n'ai pas coutume de vous entendre poser ce genre de question !

En tant que rapporteur, je dois vous interroger sur tous les aspects du problème. Cela ne fait pas de moi un défenseur des fabricants.
Soit. Je ne vois pour ma part aucune contradiction entre innovation et risque. Qu'est-ce qu'un produit innovant qui mettrait en danger la vie ou la santé humaine ? D'ailleurs, je ne veux pas que l'on arbitre entre ces deux impératifs au détriment des patients. En renforçant les contrôles, on renforce aussi l'image du fabricant.

Les exigences de matériovigilance inscrites dans les directives de 1990 et 1993 sont-elles correctement transposées en droit français ? Existe-t-il en France et dans les autres Etats membres une base de données centralisée et opérationnelle permettant aux praticiens et aux patients de notifier aux autorités compétentes tout dysfonctionnement observé sur des dispositifs médicaux ? Comment se fait-il que la base de données européenne prévue par l'article 14 bis de la directive de 1993 n'ait pas été créée ?
Le droit français, en la matière, est plus exigeant que le droit européen. Celui-ci ne fait pas obligation aux professionnels de santé de signaler les dysfonctionnements ; en France, il existe un système de matériovigilance. La directive n'impose aucun délai de déclaration, alors que le code de la santé publique impose de déclarer tout problème « sans délai ». La notion d'incident est comprise en un sens très étroit dans la directive ; c'est tout le contraire en droit français.
La directive n'impose pas non plus la création d'une base de données regroupant les déclarations des praticiens et des patients. Elle exige seulement que les Etats prennent des mesures pour que tous les incidents et rappels soient enregistrés et évalués de manière centralisée. Malgré cela, la sous-notification est manifeste ; comme je l'ai dit, j'ai demandé à la DGS et à l'Afssaps de réfléchir à la refonte de notre système de vigilance. En 2011, l'Afssaps a reçu 11 697 signalements, qui ont été évalués en fonction de leur criticité, c'est-à-dire de leur gravité et de leur fréquence.

Seriez-vous favorable à la création d'un registre des dispositifs de classe III, comme il en existe en Australie et dans certains pays nordiques, pour suivre ces produits au niveau des professionnels et des patients ? Il y a des choses que l'on ne sait pas lors de la mise sur le marché, ne serait-ce que parce qu'une étude clinique préalable porte sur un nombre de personnes plus faible que les patients concernés par la suite.
Oui. Il faut aussi associer les sociétés savantes.

Ce registre devrait-il être organisé par produit - ce qui serait limitatif - ou par groupe de produits ?
L'un ou l'autre pourrait convenir. J'ai demandé à l'Afssaps de faire des propositions. Le système doit être rationnel au plan scientifique et médical.
Non, je suis le premier à le dire. Mais dans le cas des prothèses PIP, nous avons eu affaire à un escroc qui montrait aux contrôleurs des produits conformes à la réglementation, et qui en vendait d'autres issus d'une autre chaîne de fabrication. Il faut donc rivaliser d'ingéniosité avec les fabricants malhonnêtes, et procéder aussi à des contrôles sur les sites d'implantation.

Avons-nous les moyens de multiplier les contrôles ? J'ai cru comprendre qu'il n'y avait que cinq contrôleurs.
Il y en a dix, il en faut davantage. On peut envisager de faire appel au corps d'agents des agences régionales de santé (ARS). Quoi qu'il en soit, il faut procéder à des contrôles vraiment inopinés, jusque dans les lieux d'implantation, en les renouvelant fréquemment pour certains produits.

Estimez-vous qu'il faille systématiser les enquêtes cliniques périodiques après la mise sur le marché d'un dispositif médical critique de classe III ?

Faut-il conditionner le renouvellement des certifications de conformité à la publication périodique d'essais cliniques ?

Pour tous les dispositifs médicaux, ou seulement pour ceux qui sont inscrits sur la liste ?
Pour les dispositifs inscrits, dans un premier temps. Mais le mieux serait ensuite de généraliser ces règles. N'oublions pas que nous venons de loin. Dorénavant, les dispositifs médicaux doivent être considérés comme des produits de santé à part entière, soumis à un contrôle aussi rigoureux que les médicaments.

D'un pays à l'autre, les instances chargées du contrôle communiquent-elles assez ? N'est-il pas surprenant que des prothèses de hanche défectueuses aient continué à être commercialisées en France alors que des anomalies avaient été constatées aux Etats-Unis et en Australie depuis 2007 ?
A quoi pensez-vous ? Les prothèses dont il était question dans le premier article du Figaro ont été retirées du marché français en juillet 2010. Deux jours seulement après que l'alerte a été donnée, l'agence française proposait un nouveau protocole de surveillance pour les 380 patients concernés. A leur égard, j'ai demandé que le suivi soit le plus fin possible ; les médecins avaient pris contact pendant l'été avec les patients, mais il fallait s'assurer que ceux-ci avaient effectivement été informés. Quant aux autres prothèses en métal, un autre article a évoqué des risques mesurés ; les soixante-dix mille porteurs doivent se rassurer.

Les Australiens, grâce à leur registre, sont les premiers à avoir détecté ce problème.
J'en viens à l'encadrement des interventions à visée esthétique. Combien y a-t-il en France d'installations de chirurgie esthétique ayant bénéficié d'une accréditation délivrée par le directeur général de l'Agence régionale de santé ?
Une enquête de la Direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques (Drees) est en cours à la suite de l'instruction du 9 février. J'attends ses résultats courant mars.

Combien d'accréditations n'ont pas été renouvelées au terme de la période initiale de cinq ans ?
Je dois vous faire la même réponse. La chirurgie esthétique est en plein développement. Comme tous les domaines qui concernent la santé humaine, celui-ci doit être soumis à un contrôle rigoureux, afin que nous ne soyons pas rattrapés plus tard par un scandale. Le « laisser-faire » ne saurait prévaloir.

L'interdiction de la publicité en faveur des installations de chirurgie esthétique est-elle respectée en France ?
Il existe des contrôles et un appareil de sanctions. Il n'y a pas de publicité à la télévision ou à la radio ; le risque concerne plutôt les nouveaux supports de communication, en particulier Internet.
Il faut donc renforcer la réglementation, surveiller les insertions sur Internet, les pseudo-sites techniques, les sites d'information des établissements ou d'offres commerciales, les avis de prétendus clients. Longtemps, les ARS n'ont pas été équipées pour assurer une surveillance systématique d'Internet. Nous y travaillons. Il faut aussi prendre garde aux journaux gratuits, à la presse hebdomadaire. Les sanctions existent, et peuvent aller jusqu'au retrait d'autorisation. L'Ordre des médecins a aussi son rôle à jouer.

J'ai toujours été circonspect à cet égard...
Le problème est réel : on m'a dit qu'aux Etats-Unis, on avait plus de chances de mourir d'une liposuccion que d'un accident de la route.
Il existe même là-bas une série télévisée consacrée à ce sujet... Dans ce domaine, les Etats-Unis ne sont pas un modèle.

Quelle est la réglementation applicable aux actes de médecine esthétique - injection de produits de comblement, de toxine botulique, utilisation du laser, blanchiment des dents, etc. ? On vend des appareils à lumière pulsée jusque dans les magasins d'électroménager et les « bars à sourire » se développent... Ne faudrait-il pas mieux encadrer ces pratiques et obliger les médecins à les déclarer ? Faut-il mieux réglementer la publicité ?
Sans doute, mais notre volonté de réglementer se heurte à la résistance des intéressés. Le décret d'avril 2011 sur la lipolyse a été suspendu le 17 juin 2011 par le Conseil d'Etat pour des raisons de forme. La décision sur le fond a été rendue le 17 février. L'article premier a été rétabli : les techniques de lyse adipocytaire invasives, considérées comme présentant un risque grave pour la santé humaine, demeurent donc interdites. Mais l'article 2, relatif aux techniques non invasives, a été annulé, le Conseil estimant que leur dangerosité n'était pas prouvée. Voyez avec quelle minutie les textes réglementaires doivent être rédigés ! Toutefois, les études que j'ai demandées à la HAS devraient permettre d'ici la fin du premier semestre de publier un nouveau décret sur les techniques non invasives.

Ne faut-il pas donner à l'Afssaps une compétence explicite pour contrôler les produits cosmétiques injectables et les dispositifs à visée esthétique ?
Ne laissons pas croire que rien n'est fait. Tout d'abord, les produits cosmétiques ne s'injectent pas. Ensuite, ils entrent déjà dans le champ de compétences de l'Afssaps. Les dispositifs esthétiques sont souvent des dispositifs médicaux, sur lesquels l'Agence est compétente. Elle a d'ailleurs mené récemment une campagne d'inspection chez les fabricants de produits de comblement de rides. Cette compétence pourrait en effet lui être explicitement confiée. J'ajoute que tous les professionnels de santé ont l'obligation de signaler tout problème grave portant sur un dispositif médical.
Encore faut-il éviter l'éparpillement des données. J'y insiste : les sociétés savantes ont un rôle à jouer pour relayer les messages de sensibilisation, les mesures et les recommandations. Des consultations sont en cours avec elles sur une fiche de signalement portant spécifiquement sur les dispositifs de comblement de rides.

La réglementation est indispensable. Au nom de la liberté du commerce, on ne peut pas laisser injecter de l'oxygène pur pour lutter contre les effets de l'âge.
Ces produits sont à la frontière entre deux systèmes de protection, c'est là la difficulté.
La loi HPST renforçait les règles. Que ne l'avez-vous votée ?

Elle était insuffisante, et les mesures d'application prévues manquaient de précision.

Envisage-t-on de créer un site Internet pour fournir au public une information transparente et indépendante sur les dispositifs médicaux et les actes à visée esthétique, comme l'a fait le gouvernement de l'Etat de Victoria en Australie ?
Je ne connais pas le modèle australien aussi bien que vous. Cela étant, je suis favorable à la création d'un site Internet sur les dispositifs médicaux. Pour tout ce qui concerne la médecine esthétique, nous ne le ferons peut-être pas dans un premier temps, mais nous ne pourrons rester sans rien faire. Nos concitoyens veulent être informés. Faute de site institutionnel, ils consulteront des sites privés où l'information n'est pas toujours fiable. Puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique, il faut une base de données publique.

Faut-il renforcer les règles relatives aux relations et liens d'intérêts entre les professionnels de santé d'un côté, les fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux de l'autre ?
C'est déjà fait, grâce à la loi Mediator que vous n'avez pas non plus votée.
Les liens d'intérêts sont pris en compte dès le premier euro en ce qui concerne tous les produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux. Je vous remercie d'avoir fait référence aux « liens d'intérêts » plutôt qu'aux « conflits d'intérêts ». Peut-être vous ai-je convaincu...

Les liens d'intérêts occasionnent souvent des conflits d'intérêts, mais passons...

Je reviens sur l'arbitrage entre innovation et sécurité. Il semble que les petites entreprises, qui sont à l'origine des innovations les plus remarquables dans le domaine des dispositifs médicaux, n'aient pas les moyens de procéder elles-mêmes à un contrôle ex ante poussé. Et un contrôle ex post ne peut suivre le rythme de l'innovation. Qu'en pensez-vous ?
Il n'y a pas d'alternative entre ex ante et ex post, on peut aussi concevoir un contrôle quasi permanent. Quant à l'évaluation ex ante, les entreprises qui n'ont pas les reins assez solides n'ont rien à faire sur le marché. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé, qui doivent être contrôlés comme les médicaments. Peut-être y aura-t-il à l'avenir moins d'argent à gagner dans le secteur... L'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale impose des règles claires.
Les secteurs public et privé ont intérêt à collaborer. Grâce à une sorte de fonds stratégique d'investissement pour les dispositifs médicaux, il serait possible de développer une industrie française dans ce domaine. Toute considération économique mise à part, cela améliorerait la traçabilité des produits. Une mission à ce sujet a été confiée à M. Jacques Lewiner, j'attends ses conclusions dans quelques semaines.

Quelques auditions nous ont alertés sur l'ampleur du phénomène et le manque de données quant au nombre de personnes concernées, au reste considérées davantage, dans le domaine esthétique comme des clients que comme des patients. Je devrais d'ailleurs le dire plutôt au féminin.
Ces dossiers ont fait la une des médias, mais cela ne veut pas dire pour autant que le système tel que le Mediator nous a amené à le transformer ne fonctionne pas. Il est vrai que l'on a longtemps manqué de systèmes de vigilance sur les dispositifs médicaux. Il nous faut non seulement rattraper le retard, mais prendre de l'avance. Tout cela touche, au fond, à la santé puisqu'il s'agit bien de dispositifs implantés dans le corps des patients. Nous avons tous intérêt à un meilleur contrôle, y compris les fabricants car la sécurité est un bon atout pour l'exportation.
L'expérience PIP est celle d'une présomption de fraude caractérisée. L'entrepreneur n'est d'ailleurs pas sorti sous caution : il est en prison, et je ne le plains pas. Il faut que la Justice passe. Dans l'affaire du Mediator, vous allez voir que le jugement aura lieu très bientôt.
Il reste que notre système de contrôle et d'inspection doit changer. J'aimerais que nous revenions devant vous, dans les semaines qui viennent, pour éviter de vous laisser tirer, comme dans l'affaire du Mediator, des conclusions décalées au regard des mesures opérationnelles décidées.
L'esthétique n'est pas seulement une question de santé, mais de société : elle engage l'image de soi, à tout âge. Chacun est en droit d'accéder à une information fiable, pour prendre des décisions éclairées. La logique est la même que pour les dispositifs médicaux, on doit donc viser la même cohérence.