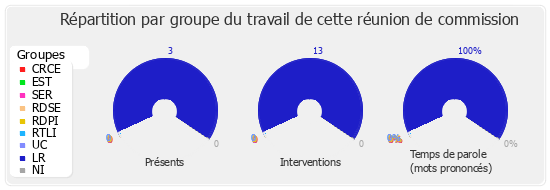Mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe
Réunion du 25 avril 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mme anna lipchitz conseillère technique chargée de la politique commerciale au cabinet de mme nicole bricq ministre du commerce extérieur (voir le dossier)
- Audition de mm. jean-pierre kieffer président et frédéric freund directeur de l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir oaba (voir le dossier)
- Audition de m. pierre buisson président et mme anne daumas directrice du syndicat national des vétérinaires libéraux (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Anna Lipchitz conseillère technique chargée de la politique commerciale au cabinet de Mme Nicole Bricq ministre du commerce extérieur
Audition de Mme Anna Lipchitz conseillère technique chargée de la politique commerciale au cabinet de Mme Nicole Bricq ministre du commerce extérieur

Nous vous avons conviée pour mieux appréhender la place de la filière viande dans nos échanges extérieurs.

Pouvez-vous nous donner les chiffres clés sur les exportations et importations françaises en viande ainsi que votre analyse des forces et faiblesses de notre filière viande qui expliquent ces résultats ? Je m'interroge également sur les distorsions de concurrence avec nos voisins européens, notamment l'Allemagne qui rémunère ses salariés au salaire minimum de leur pays d'origine : comment réagissons-nous à cette forme de « dumping » ? Enfin, je souhaiterais connaître le volume global de notre commerce extérieur en viande casher et halal.
conseillère technique chargée de la politique commerciale au cabinet de Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. - Je rappellerai tout d'abord le contexte général. Le Gouvernement s'est fixé un objectif de rééquilibrage du solde de notre balance commerciale. La contribution du secteur agroalimentaire y est essentielle. En 2012, il conserve son rang de deuxième secteur en excédent commercial avec une balance commerciale positive de 11,5 milliards d'euros, malgré des importations en augmentation légèrement plus rapide que les exportations (+ 2,7 % et + 2,3 %). La France était en 2011, avec 5,6 % des parts de marché, le cinquième exportateur mondial pour tous les produits agroalimentaires après les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil. Ce secteur fait partie des quatre familles prioritaires à l'exportation que le Gouvernement a choisi de développer. On note cependant un essoufflement de cette performance globale. Ce sont principalement les vins et spiritueux ainsi que les produits laitiers qui génèrent des excédents commerciaux tandis que les exportations de viande connaissent un déclin relatif. La viande représente 8,4 % du total des exportations et 12 % des importations de produits alimentaires. Depuis 2005, le commerce de la viande est déficitaire pour la France. En 2012, le solde s'est à nouveau détérioré atteignant près de - 686 millions d'euros, contre - 323,3 millions d'euros en 2011, ce qui s'explique par la combinaison d'une stabilité des exportations, malgré une dégradation notable dans le secteur de la volaille, tandis que les importations progressent de 7,5 %.
Or la filière viande est très importante au regard de la question de l'emploi. La production de produits carnés en France concerne 40 000 éleveurs dans le secteur viande bovine, 20 000 dans le secteur porcin et 20 000 dans la filière volaille. Pour sa part, l'industrie de la transformation de la viande emploie près de 50 000 salariés. Par ailleurs, la production de viande revêt une dimension territoriale. Enfin, elle est au coeur de la problématique de la sécurité sanitaire.
Dans ce contexte, le rôle du ministère du commerce extérieur est d'appuyer l'internationalisation des entreprises du secteur et de souligner que la qualité de la viande française est un avantage comparatif important alors que la demande mondiale est en hausse, avec une croissance des besoins des pays émergents. Nous avons identifié des pays à cibler de façon prioritaires à la fois au sein de l'Union européenne et dans le reste du monde. Ces pays devraient représenter, en 2022, 53 % des exportations agroalimentaires, l'Asie occupant une place prépondérante au sein des pays tiers. C'est pourquoi un comité Asie a été mis en place conjointement avec le ministère en charge de l'agriculture pour réunir l'ensemble des acteurs afin de mieux les soutenir. Je souligne au passage l'importance de la composante génétique parmi les atouts de notre secteur de la viande.
La conduite des négociations commerciales constitue l'autre volet de notre action. L'Union européenne s'apprête à lancer des discussions de libre échange avec les États-Unis qui visent à une diminution des barrières tarifaires et non-tarifaires. Ces négociations sont particulièrement importantes dans le secteur de la viande, puisqu'après avoir conclu des accords plutôt bénéfiques avec la Corée, qui en importe beaucoup, l'Union européenne doit maintenant traiter avec des pays plus compétitifs que le nôtre dans le secteur de la viande, comme le Canada ou les États-Unis.
Par ailleurs, j'ajoute que 65 % de la valeur de nos exportations provient d'échanges d'animaux vivants qui incorporent bien entendu moins de création de valeur ajoutée que la vente de produits transformés. Ces exportations se heurtent à des barrières qui sont beaucoup plus fortes que dans les autres secteurs agroalimentaires. A l'inverse, les exportations de viande allemande sont très dynamiques - de l'ordre de + 10% par an environ - plus concentrées dans le hors sol - porc, volaille - et concernent des produits transformés.
Notre pays demeure le 7e exportateur de viande, derrière les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie et le Danemark. Notre position est stable, mais nous perdons cependant des parts de marché, qui selon les données provisoires pour 2012 diminueraient à 3,9 %.

On constate une chute brutale et rapide de nos exportations de volailles vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Avez-vous des explications à ce phénomène dont les facteurs semblent non seulement économiques mais aussi politiques.
Avant de répondre à votre question, très précise et très importante pour le secteur de la volaille, je rappelle au préalable que la viande s'échange globalement très peu puisque le commerce mondial porte sur seulement 6 % de la production de porcins, 11 % des bovins et 12 % des volailles. Les exportations mondiales de volailles augmentent fortement de + 18 %. Cette demande provient de pays comme le Japon, l'Arabie saoudite, Hong-Kong, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La viande blanche bénéficie d'une image positive du point de vue de la santé. Malheureusement, au même moment, notre appareil de production décline.
Les exportations mondiales de viande bovine augmentent de 16 %, avec des marchés très porteurs comme le Japon, les Pays-Bas et le Canada. La production de viande de porc, qui est la deuxième consommée au monde, est en grande partie absorbée par l'Asie, mais il faut s'attendre à une demande croissante en provenance d'Afrique.

J'observe que l'apparition d'un nouveau virus en Chine pourrait avoir un effet positif sur la demande de nos produits...
d'autant que les produits français bénéficient d'une réputation de sécurité sanitaire très forte.
Par ailleurs, s'agissant des explications de nos performances, on constate tout d'abord que notre tissu de production est composé d'entreprises de petite taille : on compte 68 % de très petites entreprises (TPE) dans l'agroalimentaire et 55 % dans la viande, ce qui a nécessairement des conséquences sur les capacités d'innovation et d'investissement du secteur. De plus notre appareil de transformation fonctionne en sous-capacité. En revanche, la petite taille des entreprises favorise la souplesse d'adaptation et le développement de produits de qualité.
En Allemagne, la pression des prix, poussés vers le bas par la grande distribution, a contraint les entreprises à industrialiser l'appareil de production et à innover. On constate aussi en France une tendance à la concentration mais qui est limitée par des préoccupations environnementales et en raison d'une transcription plus restrictive des normes européennes

Notre stratégie n'est-elle pas un peu contradictoire ? En effet, nos petites entreprises portent une image de terroir, mais pour exporter, les grandes entreprises sont mieux armées. En Allemagne, les producteurs se regroupent pour favoriser les exportations : n'y a-t-il pas là une piste que nous pourrions suivre ?
Nous nous posons souvent la question. Je fais cependant observer qu'une concentration excessive peut parfois nuire à la compétitivité. D'autres facteurs que le prix entrent en ligne de compte dans les stratégies à l'export. Je signale qu'une très intéressante étude de FranceAgriMer évoque les menaces structurelles sur l'agriculture allemande, avec un modèle qui risque d'atteindre ses limites. Ainsi, les ministres allemands verts dans les Länders - en Basse-Saxe depuis février 2013, en Bade-Wurttemberg et en Rhénanie-Westphalie - pourraient promouvoir une politique plus restrictive en matière de construction d'élevages et d'abattoirs, avec un relèvement des normes de protection des animaux. La coalition des verts avec le SPD souhaite également l'introduction d'un salaire minimum légal de 8,50 euros de l'heure dans les entreprises agroalimentaires. Les abattoirs et entreprises de découpe sont nommément visés. Ils pratiquent des salaires de 4 à 5 euros aujourd'hui. Des crises sanitaires plus fréquentes ces dernières années sont apparues outre-Rhin et les capacités de réaction de l'administration allemande face à ces crises sanitaires sont parfois ralenties par le fédéralisme. La méfiance de la population est de plus en plus marquée vis-à-vis de l'élevage. Bref, le modèle allemand est menacé d'essoufflement.
En France, le coût du travail salarié a augmenté de 7 % entre 2008 et 2010, contre 2 % en Allemagne, qui a par ailleurs bénéficié de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO). Mais je ne crois pas que la diminution du coût de la main-d'oeuvre soit la bonne solution pour notre pays, bien au contraire. La France a aussi pris une longueur d'avance en matière de protection de l'environnement, ce qui pourrait finalement nous être bénéfique puisque les autres pays devront sans doute se hisser au niveau que nous avons atteint en termes de normes sociales et environnementales.

Nous n'envisageons pas du tout de prôner une baisse de salaires ! Vous nous dites que la situation devrait s'améliorer. Pourquoi ne pourrions-nous pas également tirer la sonnette d'alarme à propos des bas salaires versés dans les abattoirs allemands : le Gouvernement envisage-t-il d'agir ?

On recense 7 000 méthaniseurs en Allemagne contre moins de 100 en France et il est difficile d'imaginer que les allemands pourraient remettent en cause le biogaz, or il assure une part importante du revenu des éleveurs.
Je suis convaincue que la France ne doit pas être complexée par rapport aux produits allemands. Nous pouvons nous appuyer sur d'autres facteurs que la compétitivité-prix et, comme vous le savez, la filière viande va elle aussi bénéficier du choc de simplification administrative que le Gouvernement met en place.
Nous disposons de vrais atouts. Notre potentiel d'exportation dans le domaine des semences et de la génétique animale est considérable. Il faut aussi développer de nouveaux segments de l'offre agroalimentaire. Par rapport à l'Italie, la France est peu présente sur les produits intermédiaires. Il nous faudrait combler ce retard en travaillant avec la grande distribution à l'étranger sur la distribution de tels produits.

Pourquoi ne pas créer un logo « made in France » représentant, par exemple, une Tour Eiffel ?

t. - Sur les produits canadiens, on peut lire : « Fait avec fierté au Canada ».
Nous avons effectivement besoin de réaffirmer la territorialisation de nos produits. On estime que les produits agricoles et alimentaires sous indication géographique (IG), qui répondent donc à un cahier des charges plus exigeant en termes de traçabilité, bénéficient d'une meilleure valorisation sur le marché européen, de l'ordre de 1,55 point. Les produits carnés sous IG sont encore mieux valorisés que la moyenne, avec un prix multiplié par 1,80, tandis que l'indication géographique est moins valorisante pour les viandes fraîches, avec seulement un facteur de 1,16.

Je partage votre point de vue sur l'orientation de nos produits vers le qualitatif. Je continue à penser que la France pâtit d'une certaine surenchère normative. Or pour exporter, il faut d'abord produire. Notre production décline, comme en témoigne les fermetures d'exploitations laitières. Il faut donc avant tout soutenir notre élevage. Je serai donc, dans l'ensemble, moins optimiste que vous. J'ajoute que la présence de prédateurs comme le loup décourage beaucoup d'exploitants. Enfin, je constate que les éleveurs allemands tirent quasiment la moitié de leurs revenus d'activités non directement liées à la vente de viande. L'agrandissement des exploitations est-il inéluctable ?
L'agrandissement des exploitations n'est pas une panacée. Il faut rechercher une taille optimale.

C'est aussi un problème d'organisation. Certains éleveurs de mon département se sont, par exemple, fédérés pour produire de l'énergie, mais ils n'ont pas été soutenus. Il y a là un potentiel de réussite qui n'implique pas nécessairement l'agrandissement des exploitations agricoles.
Il faut aussi introduire dans le raisonnement les soutiens de la PAC. On estime qu'un éleveur français percevrait 50 % d'aides en moins que par rapport à ses homologues allemands.

Pouvez-vous nous préciser la stratégie d'accompagnement de la filière à l'exportation ?
Je rappelle tout d'abord la mise en place d'un pilier export de la Banque Publique d'Investissement (BPI), qui vise à renforcer l'internationalisation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ainsi la BPI disposera-t-elle de bureaux régionaux composés d'une équipe de développeurs à l'international, qui auront vocation à détecter, accompagner et suivre dans la durée des entreprises disposant d'un potentiel à l'exportation. Sur le modèle de ses ingénieurs d'affaires, des agents d'Ubifrance prendront leur place aux côtés des collaborateurs de la BPI chargés des financements, des fonds propres, des prêts et de l'innovation, dans ce qui constituera la porte d'entrée unique pour l'international, simplifiant ainsi la démarche pour les entreprises.
Le pacte national pour la croissance, la compétitivité de l'emploi a fixé à 1 000 le nombre de PME et d'ETI de croissance devant faire l'objet d'un tel accompagnement personnalisé. L'identification des entreprises qui bénéficieront du soutien personnalisé en croisant plusieurs critères susceptibles de définir leur potentiel exportateur - taille, secteur d'activité, caractère innovant, localisation régionale, indépendance vis-à-vis d'un grand groupe... -, est actuellement en cours, en lien avec les Régions, Ubifrance, la Coface, Oséo et le Fonds stratégique d'investissement. Ces ETI et PME devront en principe évoluer dans l'une des quatre filières considérées comme prioritaire par la ministre du Commerce extérieur le 3 décembre 2012 - « Mieux vivre en ville », « Mieux se nourrir », « Mieux se soigner », « Mieux communiquer » -. Pour ces entreprises, Ubifrance mettra en place des prestations sur mesure, inscrites dans la durée et répondant à leur projet personnalisé de développement international.
L'accent sera mis sur une meilleure articulation de l'offre des dispositifs actuels de soutien financer à l'export (Oséo, Coface, Ubifrance) afin d'exploiter les synergies commerciales permises par la création des bureaux régionaux de la BPI. Dans le prolongement des recommandations du rapport de l'Inspection générale des finances dédié à ce sujet, nous devrions aboutir à une rationalisation de la distribution des instruments existants ainsi qu'à la mise en place de produits complémentaires destinés à couvrir des domaines dans lesquels l'action du secteur privé apparaît aujourd'hui défaillante comme l'amélioration de la trésorerie des PME et ETI exportatrices.
Nous réexaminerons également la logique des soutiens publics dans l'agroalimentaire. Le manque de cohérence du dispositif est budgétairement coûteux, économiquement peu efficace et porteur de risque au regard du droit communautaire. Une des pistes éventuelles de progrès serait de constituer une agence spécifique.
Par ailleurs, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) bénéficiera à hauteur de 700 millions d'euros aux industries agroalimentaires.
Enfin, la diminution des barrières non tarifaires est une de nos priorités : dans le secteur de la viande, 70 jours par an sont consacrés au traitement des divers documents requis pour exporter aux États-Unis suite à la maladie de la vache folle, des embargos ont été mis en place et n'ont pu être levés que très récemment.

Ne devrait-on pas, nous aussi, durcir les conditions d'accès à nos marchés intérieurs ?
Nous travaillons sur le thème de la réciprocité, notamment pour faire valoir nos préférences collectives d'alimentation non génétiquement modifiée.

Nous avons le plaisir de recevoir les représentants de l'OEuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir (OABA), association engagée dans la promotion du bien-être animal.

Votre association milite contre l'abattage rituel sans étourdissement. Appartient-elle à un mouvement d'écologie radicale ou à un courant d'extrême-droite ? Par cette question, j'espère couper court à toute polémique sur les raisons politiciennes qui, selon certains, animeraient ceux qui se préoccupent des conditions d'abattage des animaux. Pouvez-vous nous présenter les différentes techniques d'abattage des animaux destinés à la consommation ? Quels sont les changements pour lesquels votre association milite ?
Créée en 1961, l'OABA a été la première association à se préoccuper de la protection des animaux de ferme, de l'élevage à l'abattage. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1965. Nous considérons qu'il faut se préoccuper de l'animal vivant et sensible dont provient la viande.
Il s'agit d'une association complètement apolitique et non militante. Ce n'est pas l'abattage rituel qui nous préoccupe en lui-même, mais les conditions de réalisation de l'abattage, avec ou sans étourdissement des animaux. Les productions halal et casher ne requièrent pas nécessairement que les animaux soient abattus sans étourdissement. C'est la dérive que représente la généralisation de l'abattage sans étourdissement, qui conduit à ce que soient proposés des produits issus d'un tel abattage à des consommateurs qui ne souhaitent pas consommer des produits halal ou casher, que nous regrettons. Le 13 avril dernier a eu lieu une manifestation à Guéret contre un projet d'abattoir entièrement halal : nous n'avons pas souhaité nous y associer car nous savions que cet événement risquait d'être récupéré par certaines mouvances politiques.
Notre association a été créée dans le but de rendre les conditions d'abattage des animaux plus acceptables. Jusqu'en 1964, aucune réglementation n'existait sur l'étourdissement des animaux. Le décret du 15 avril 1964, obtenu à force de pressions et de persévérance, a prévu une obligation d'étourdissement des animaux de boucherie et de charcuterie avant abattage, avec une exception pour l'abattage rituel.
Notre association fonctionne avec un secrétariat réduit : elle compte quatre personnes chargées de l'administration, auxquelles s'ajoute un directeur. Son conseil d'administration est composé de douze membres, parmi lesquels cinq vétérinaires, dont deux issus de l'administration du ministère de l'agriculture, deux avocats et un magistrat. L'OABA revendique ainsi une compétence à la fois technique et juridique. Une équipe de six délégués, composée d'anciens vétérinaires ou de directeurs d'abattoir à la retraite, réalise des visites d'élevages et d'abattoirs dans le but de réaliser une forme d'audit et de faire de la prévention sur les éventuelles mauvaises méthodes utilisées.
Lorsque nous sommes informés, le plus souvent par les services vétérinaires, qu'un élevage se trouve en état d'abandon de soins ou fait l'objet de mauvais traitements, nous sommes en charge de recueillir les animaux. Il s'agit d'une activité très importante pour l'OABA. Les animaux ainsi recueillis, principalement des bovins, sont placés dans des fermes d'accueil auxquelles nous payons des frais d'hébergement et des frais vétérinaires. Le budget que nous consacrons au sauvetage d'animaux maltraités ou abandonnés s'élève à 250 000 euros. Nous assumons seuls cette charge, sans aucune aide de l'État, des collectivités ou des professionnels. Comme pour toute association reconnue d'utilité publique, notre financement provient de dons ou de legs.

Quelles sont les différences concrètes entre un abattage conventionnel et un abattage rituel ? Pourquoi la France n'impose-t-elle pas l'étourdissement préalable dans l'ensemble de ses abattoirs, alors même qu'il est autorisé par certains pays musulmans ?
L'abattage rituel est doublement dérogatoire au droit commun.
D'abord parce qu'il déroge à la règle selon laquelle les animaux doivent être étourdis avant leur abattage dans un souci de protection animale. Un avis de décembre 2012 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) préconise l'étourdissement avant l'incision des jugulaires comme le standard pour limiter la douleur au moment de l'abattage. Des études scientifiques démontrent que de l'abattage rituel pratiqué sans étourdissement résulte pour l'animal non seulement une douleur au moment où on lui tranche la gorge, mais également une agonie post-égorgement qui peut durer plusieurs minutes. Le rapport d'expertise sur les douleurs animales publié par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) en décembre 2009 précise que l'agonie peut durer jusqu'à 14 minutes chez les bovins. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l'agonie des gros bovins abattus dure en moyenne 126 secondes.
La deuxième dérogation est la suivante : l'abattage rituel consiste à trancher la gorge, la peau, les artères et surtout la trachée et l'oesophage des animaux. Il s'agit d'une exception aux principes généraux de l'hygiène alimentaire fixés par le règlement européen n° 853/2004 et applicables au sein des abattoirs européens. Ce règlement précise en effet que la trachée et l'oesophage doivent rester intacts lors de la saignée afin d'éviter la contamination des viandes, sauf dans le cas d'un abattage religieux. Des problèmes d'hygiène peuvent effectivement survenir dans la mesure où il est difficile de ligaturer l'oesophage lors de la saignée, ce qui peut en outre être fait avec retard ; il peut alors en résulter une souillure des viandes de tête et des viandes de gorge, qui sont utilisées dans les pot-au-feu ou pour fabriquer des steaks hachés. En 2008, le docteur Gilli-Dunoyer, chef du bureau des établissements d'abattage à la direction générale de l'alimentation (DGAL), mettait ainsi en exergue dans une communication publiée dans le bulletin de l'Académie vétérinaire française le risque de contamination de la viande par cette technique d'abattage.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, pays fortement exportateurs de viande halal vers le Moyen-Orient, les viandes produites proviennent d'animaux insensibilisés lors de la saignée. En France, seule une minorité de sacrificateurs accepte l'étourdissement avant abattage. On perçoit chez les sacrificateurs les plus modernes une conscience de la douleur occasionnée par cette technique d'abattage et une volonté d'amélioration du rite. Cette minorité concerne presque uniquement la filière halal, les sacrificateurs musulmans étant beaucoup plus ouverts que les rabbins sur cette question - bien que lors de la dernière convention du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) de janvier 2013, le rabbin Krygier ait déclaré qu'une réflexion sur l'évolution du rite d'abattage n'était pas exclue dans un souci de protection animale.

Les éleveurs peuvent-ils s'opposer à ce que leurs animaux soient abattus sans étourdissement ?
Certains éleveurs nous ont adressé des demandes sur ce point. Les éleveurs qui conduisent directement leurs bêtes à l'abattoir peuvent contrôler les conditions d'abattage de leurs animaux soit en assistant à l'abattage, soit en les dirigeants vers un établissement qui ne pratique pas l'abattage rituel. Nous avons dressé à partir des arrêtés préfectoraux une liste des abattoirs français qui pratiquent systématiquement l'étourdissement, à destination à la fois des consommateurs et des producteurs. En revanche, il est impossible pour les éleveurs qui passent par des négociants de contrôler le mode d'abattage de leurs animaux. En tout état de cause, même lorsque l'éleveur indique « abattage rituel exclu » sur le bordereau de l'animal, l'abattoir n'est pas obligé de suivre cette prescription. Il n'y a aucun moyen juridique permettant à l'éleveur de s'assurer que ses animaux ne sont pas abattus sans étourdissement, sauf à ce qu'une convention écrite soit passée entre l'abattoir et l'apporteur d'animaux.

Certains éleveurs particulièrement attachés à leurs animaux préfèrent les faire piquer que les voir abattus. Est-on certain qu'un animal que l'on pique ne souffre pas ?
Lorsque le T61 est correctement utilisé, l'animal meurt en trois secondes.
L'abattage rituel sans étourdissement soulève deux problèmes majeurs : la tromperie du producteur et du consommateur, et la souffrance de l'animal.
Sur le premier point, comme vient de l'exposer M. Freund, l'éleveur ne sait pas toujours quel sera le sort de ses animaux. Nous avons reçu des lettres particulièrement émouvantes de professionnels qui appliquent des normes européennes très strictes en matière d'élevage et de transport et qui ne comprennent pas que leurs animaux puissent être abattus selon une procédure qui ne correspond pas à la réglementation - d'autant plus lorsque la production est destinée à des consommateurs qui n'ont pas une exigence halal ou casher. Nous constatons aussi des réactions très fermes de la part de la confédération des boucheries artisanales et des charcutiers traiteurs, qui se voient obligés de mentir à leurs clients, ainsi qu'il l'ont exposé dans un récent communiqué de presse. Les professionnels comme les consommateurs réclament de la clarté.
C'est pourquoi la liste des abattoirs pratiquant l'étourdissement que nous avons éditée constitue une défense des professionnels de l'élevage. Notre association ne prône pas le végétarisme et son but n'est pas de nuire à l'élevage français. Nous souhaitons indiquer aux consommateurs qui le souhaitent qu'ils peuvent consommer de la viande produite en France et issue d'un animal abattu avec étourdissement dans un abattoir respectant la réglementation qui prévoit l'étourdissement des bêtes. Selon cette liste, 44 % des établissements d'abattage sont dans cette situation. Cette liste a été établie sans l'appui du ministère de l'agriculture, à partir d'une compilation des arrêtés préfectoraux qui sont nécessaires depuis le mois de mars 2012 pour qu'un abattoir puisse exercer son activité sans pratiquer systématiquement l'étourdissement. Particulièrement complète, elle est très précise sur les espèces animales concernées dans chaque abattoir.
Sur la question de la souffrance animale, il faut se représenter concrètement la scène d'abattage afin de bien saisir les enjeux. L'animal immobilisé soit debout, soit renversé, a la gorge tranchée par un opérateur plus ou moins habile, le plus souvent avec plusieurs coups de couteau. Il en résulte une plaie béante puisqu'on a coupé la peau, les muscles, les vaisseaux, la trachée, l'oesophage. L'animal est alors toujours vivant, et après une première chute, il retrouve ses esprits, se relève est commence une douloureuse agonie qui dure en moyenne de deux à cinq ou six minutes - quatorze minutes étant une durée extrême, qui concerne plutôt les vaches laitières qui se saignent plus lentement. La bête étant debout, elle plie le cou, ce qui a pour effet de ralentir la fuite sanguine et prolonge d'autant l'agonie. Lorsque des caillots se forment, il est parfois nécessaire de soulever à nouveau son cou pour trancher de nouveaux vaisseaux.
Je ne souhaite pas faire de sensiblerie, mais il faut avoir conscience que la souffrance animale existe bel et bien. Une souffrance même de quelques minutes est inacceptable dès lors que nous considérons dans un texte de loi que l'animal est un être vivant sensible.
Il existe aujourd'hui une vraie dérive de l'abattage sans étourdissement. De nombreuses querelles de chiffres ont eu lieu à ce sujet, notamment lors de la campagne présidentielle. Le chiffre de 14 % alors avancé par l'ancien ministre de l'agriculture Bruno Le Maire est faux. Il renvoyait au tonnage de viandes issues des animaux abattus sans étourdissement, et non au nombre de têtes d'animaux abattus - la distorsion est importante, puisque les ovins pèsent beaucoup moins lourd que les bovins. Or ce n'est pas la viande qui souffre, mais les animaux que l'on abat ! Nous avons pu établir des chiffres réels et actualisés en visitant 225 des 280 abattoirs français. Selon notre enquête, 60 % des ovins, 35 à 40 % des veaux et 20 à 25 % des gros bovins sont abattus sans étourdissement.

La DGAL nous a donné le chiffre de 14 % sur l'abattage rituel pour l'année 2010. Nous avons d'ailleurs eu beaucoup de mal à obtenir ce chiffre des différents interlocuteurs que nous avons auditionnés. Qu'en pensez-vous ?
La communication de Mme Gilli-Dunoyer publiée en 2008 dans le bulletin de l'Académie vétérinaire française, qui est une publication sérieuse, indiquait à partir de chiffres de 2007 que 49 % des ovins et caprins et 32 % des animaux toutes espèces confondues étaient abattus rituellement. Il serait plausible que le tonnage de viande correspondant à ce nombre de têtes d'animaux s'établisse à 14 %, puisque l'on exclut les os dans ce calcul. Le chiffre qui doit retenir notre attention est cependant bien celui du nombre d'animaux vivants abattus rituellement.
J'affirme que les chiffres donnés par cette enquête de la DGAL de 2010 sont faux et constituent un mensonge.
Dans une réponse du ministère de l'agriculture à une question posée par Mme Sylvie Goy-Chavent sur le bilan de la nouvelle réglementation applicable à l'abattage rituel des animaux de boucherie, publiée au JO du Sénat du 7 mars 2013, il est indiqué qu' « il est encore trop tôt pour savoir si ce dispositif a eu un effet sur le nombre d'animaux abattus sans étourdissement, dans la mesure où le système d'information de la direction générale de l'alimentation vient seulement de prendre en compte ce critère en vue de pouvoir effectuer une analyse sur un exercice civil ». Le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll indiquait ainsi clairement que ses services étaient incapables de fournir la moindre statistique sur ce point.
Il y a deux ans, lorsque la Commission européenne a interrogé l'ensemble des États membres de l'Union européenne sur la dérive de l'abattage sans étourdissement, un haut fonctionnaire de la DGAL m'a indiqué de manière officieuse qu'il avait été impossible aux services français de fournir des statistiques à la Commission, dans la mesure où ils ne disposaient pas alors d'une base réglementaire leur permettant de mener des enquêtes, et qu'ils s'étaient donc adressés aux professionnels, qui disposent eux de statistiques. Les chiffres communiqués à l'UE sur cette base n'étaient cependant que partiels dans la mesure où un grand groupe d'abattoirs avait refusé de fournir ses chiffres. Cela confirme bien que les services du ministère de l'agriculture ne disposaient d'aucune statistique fiable.
Le 19 août 2011, M. Daniel Causse, directeur de la société SODEM, indiquait dans La Nouvelle République que les trois quarts des moutons sont tués en France selon les principes de l'abattage halal. Il me semble difficile de mettre en doute la parole d'un professionnel, qui exerce de plus des responsabilités au sein du syndicat national des industries de la viande (SNIV).
Ces batailles de chiffres ne pourront donc être définitivement tranchées que lorsque les résultats de l'enquête de la DGAL, qui selon la réponse de M. Le Foll est actuellement en cours, auront été publiés.

A mon avis, les pratiques diffèrent beaucoup selon les abattoirs. Il me semble que l'abattage sans étourdissement est beaucoup moins pratiqué dans les établissements les plus récents et les plus modernes, dans la mesure où l'étourdissement permet de parvenir à de meilleures cadences et à de meilleures performances. Selon votre enquête, 56 % des abattoirs français pratiquent l'abattage sans étourdissement ; l'activité de ces établissements représente-t-elle un volume important de produits ?
Oui, puisque comme je vous l'indiquais, le nombre d'animaux abattus sans étourdissement varie selon les espèces. Le nombre d'ovins concernés est particulièrement important puisque les juifs et les musulmans consomment davantage de moutons que de bovins. Cependant, les chiffres que je vous ai communiqués sont très importants par rapport à la part de la population qui souhaite consommer des produits halal ou casher - exigence que nous comprenons et que nous respectons ; il existe une discordance entre le nombre de viandes halal et casher produites et la demande des consommateurs. Dans la mesure où les juifs ne consomment que les morceaux avant des animaux, la moitié des produits issus de l'abattage rituel se retrouve nécessairement dans le circuit de distribution classique.
C'est pourquoi nous demandons un étiquetage des produits issus de l'abattage rituel sans étourdissement, afin que le consommateur puisse bénéficier d'une réelle information. Il ne s'agirait pas d'insister sur le caractère rituel de la transformation, mais de faire porter une mention positive sur les produits indiquant que ceux-ci sont issus d'un animal abattu avec étourdissement. Nous ne souhaitons pas discriminer ni stigmatiser la partie de la population qui souhaite consommer des produits halal ou casher, mais insister sur le respect des principes fixés par la réglementation.

Après votre présentation, nous ne pouvons qu'estimer souhaitable de distinguer l'abattage rituel de l'abattage sans étourdissement, voire la généralisation de l'étourdissement.
Certaines images d'émissions télévisées consacrées à l'abattage rituel peuvent en outre être dévastatrice pour la filière viande. Il faut aussi avoir conscience que les petits outils d'abattage spécialisés dans les ovins sont en concurrence avec de grosses structures pratiquant l'abattage multi-espèces, qui peuvent équilibrer leur production sur plusieurs chaînes d'abattage, et qu'il est nécessaire de préserver nos abattoirs de proximité.
Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Il nous paraît nécessaire d'une part que les consommateurs soient informés des conditions de production de la viande qu'ils consomment, et d'autre part que les professionnels respectent les cadences. La perte de conscience est très rapide chez le mouton - environ 20 secondes - par rapport au bovin. Il faudrait normalement attendre, pour libérer l'animal du piège, que celui-ci ait perdu conscience. Or, pour respecter la cadence fixée (jusqu'à 60 bovins à l'heure !), certains professionnels ne respectent pas ce délai.

r. - Ce problème renvoie à la question des contrôles opérés sur les chaînes d'abattage. Il faut définir qui contrôle et qui sanctionne ces pratiques, sans risque de confusion des pouvoirs.
Si de nombreux contrôles sont effectués par des vétérinaires tout au long de la filière viande, aucun vétérinaire n'est présent sur les postes d'abattage, et très peu d'entre eux sont présents au moment du déchargement des animaux vivants.

Arrive-t-il fréquemment que des incidents se produisent au moment de l'abattage et de l'étourdissement des animaux ?
Selon un rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), on compte environ 4 % d'échecs à l'étourdissement avec le matador à tige perforante. Ces échecs sont essentiellement dus à des problèmes de matériel ou de formation des opérateurs. Il arrive notamment que les sacrificateurs n'aient pas une parfaite formation technique ; certains d'entre eux, qui bénéficient d'une expérience d'au moins trois ans, n'ont pas en effet à passer le certificat de capacité. Les problèmes de ce type sont en revanche extrêmement rares dès lors que l'on a recours à un personnel et à un matériel de qualité.

Est-il possible que certains animaux arrivent sur la chaîne de découpage alors qu'ils sont encore conscients ? Les chevaux de selle subissent-ils le même sort que les bovins lorsqu'ils sont abattus ?
Les opérateurs doivent normalement attendre la perte de conscience des animaux ; ils ne respectent cependant pas toujours cette obligation afin de respecter les cadences qui leur sont imposées. Il arrive ainsi qu'ils libèrent les animaux de la zone d'affalage avant leur perte de conscience. Des animaux qui souffrent et se débattent peuvent alors présenter un danger pour les personnels des abattoirs. Les animaux étant ensuite hissés, ils ne partent pas immédiatement sur la chaîne d'abattage : un temps d'égouttage de trois minutes, au cours duquel la fin de la saignée doit s'opérer, doit alors être respecté avant le passage à la découpe. On peut donc estimer que 95 % des animaux ont perdu conscience au moment où les membres commencent à être découpés. Il existe cependant un petit risque que la situation que vous décrivez se produise, ce qui n'est pas acceptable.
Le cheval est le seul animal qui peut être exclu de la chaîne d'abattage par son propriétaire. Une mention figurant sur la page 22 du livret signalétique peut en effet indiquer qu'en raison de l'administration passée ou à venir de certains traitements comme la phénylbutazone, l'animal est définitivement exclu de la chaîne alimentaire. Il arrive cependant que cette mention ne soit pas correctement apposée ou que le cheval entre dans un abattoir sans ces papiers - parfois suite à un vol - et que l'abattoir se montre peu regardant.
En principe, il n'est pas possible d'abattre un cheval sans étourdissement, dans la mesure où ce n'est pas prévu par les textes. Ce n'est cependant pas non plus interdit, ce qui crée une certaine ambiguïté. Des directeurs d'abattoir nous ont rapporté que des demandes visant à opérer un abattage rituel sur des équidés leur avaient été faites - demandes qu'ils ont refusés dans la mesure où les installations destinées aux bovins ne sont pas adaptées aux chevaux.

Quelle est la proportion de chevaux destinés à la consommation, en particulier parmi les chevaux de course et les chevaux de trait ?
En France, 17 000 chevaux sont abattus chaque année, et la production comme la consommation de viande de cheval sont en diminution. Les chevaux de trait sont fréquemment abattus.
J'aimerais enfin vous parler des suites que nous donnons aux manquements que nous constatons lors de nos enquêtes dans les abattoirs. Nous concevons notre rôle comme un rôle d'audit et de prévention. De ce fait, nous ne portons pas plainte lorsque nous recensons des manquements, mais nous essayons d'améliorer les procédures mises en oeuvre par le dialogue. Lorsque nous constatons des infractions importantes et répétées, nous les dénonçons aux services vétérinaires, et à la DGAL. Celle-ci n'est pas toujours réactive, et nous faisons parfois face à des pressions lorsque nous effectuons de tels signalements.
Outre ces pressions, les sanctions sont parfois rendues difficiles par le fait que la majorité des infractions commises dans ce secteur constituent des contraventions de quatrième classe, qui sont loin d'être prioritaires pour certains tribunaux très engorgés.

Notre mission commune d'information s'intéresse à tous les aspects de la filière viande - production, abattage, transformation et commercialisation des viandes -, et notamment à la question de la sécurité sanitaire, suite au récent scandale de la viande de cheval étiquetée boeuf. Dans cette chaîne de sécurité sanitaire, vous jouez un rôle important.

Les différents scandales survenus ces derniers mois pénalisent durement les professionnels de la filière viande et nuisent gravement à la confiance des consommateurs. Vous qui exercez au plus près du terrain, en tant que vétérinaires libéraux, auprès des animaux et des éleveurs, seriez-vous en mesure de nous expliquer votre rôle dans les processus de production et de nous dire ce que nous pourrions proposer pour améliorer la situation ? En ce qui concerne l'abattage, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de l'abattage sans étourdissement ? Il me semble avoir lu dans la presse que votre syndicat dénonce cette pratique. Pourriez-vous nous développer votre analyse sur ce point et revenir sur les propos de votre collègue vétérinaire M. Bruno Fiszon, conseiller en charge de l'abattage rituel auprès du consistoire central israélite de France, qui affirmait dans Casher magazine que non seulement l'abattage rituel n'entraîne pas de souffrance supplémentaire pour les animaux mais va au contraire dans le sens d'un plus grand respect ? D'un point de vue purement scientifique, pourriez-vous nous faire part de vos remarques sur ce point ? Nous aborderons enfin la question de la consommation d'antibiotiques par les animaux.
Le SNVEL est issu de la fusion, il y a vingt ans, de deux syndicats de vétérinaires, le syndicat des vétérinaires urbains et le syndicat des vétérinaires français. Il s'agit du seul syndicat national des vétérinaires libéraux. Il regroupe environ 2 500 adhérents et est représenté dans la moitié des cabinets français - il existe en France environ 10 500 vétérinaires libéraux et 4 500 salariés. Il appartient à la section de l'union européenne des praticiens et par là-même à la fédération européenne des vétérinaires. Son conseil d'administration est composé de praticiens en exercice, élus par leurs pairs : j'exerce moi-même à mi-temps.
Notre rôle principal est la défense des intérêts économiques des vétérinaires, profession dont les revenus proviennent exclusivement de ses relations commerciales avec ses clients et qui ne bénéficie d'aucun soutien étatique. Nous intervenons dans tous les domaines qui concernent l'économie de la profession vétérinaire, en tant que syndicat d'employeurs mais aussi auprès de l'État pour discuter des prérogatives associées à notre diplôme. C'est par exemple notre syndicat qui a été le promoteur du diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, une formation en alternance que nous gérons avec l'État dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique.
Un peu moins de la moitié des vétérinaires praticiens sont impliqués dans les circuits de production animale. Leur rôle premier est de prévenir et de traiter les maladies des animaux. Un certain nombre d'entre eux, de moins en moins nombreux, certes, interviennent en abattoir. Mais depuis une vingtaine d'année, les inspections sont avant tout réalisées par un corps spécialisé de fonctionnaires de l'État, les vétérinaires inspecteurs de santé publique.
Je ne reconnais aucune valeur scientifique aux propos de M. Fiszon que vous avez cités. Nous ne partageons pas son analyse et je n'ai jamais rien lu susceptible de venir corroborer ses dires. De telles déclarations relèvent davantage de la croyance que de l'expertise.
Sur la question de l'abattage rituel, notre position - que vous avez rappelée - est constante et a été affirmée par les délégués de notre mouvement : nous souhaitons que la pratique de l'étourdissement soit généralisée et que des limites claires soient fixées à l'abattage rituel, qui ne doit pas aller au-delà des stricts besoins cultuels, ainsi que le réclame l'Union européenne.

Pouvez-vous nous parler des situations que vous rencontrez, alors que les éleveurs français sont aujourd'hui en grande difficulté ? Quelle est l'impact des problèmes des éleveurs sur les vétérinaires ?
Les vétérinaires sont en prise directe avec les difficultés des éleveurs. Il n'existe ni tiers payant, ni assurance, ni mutualisation dans notre profession. Chaque éleveur assure directement le paiement des frais liées aux pathologies qui se produisent dans son exploitation et rendent nécessaire des services vétérinaires. Lui seul arbitre entre ces différents postes de charge que sont la prévention, les traitements. Il est susceptible de prendre la décision de ne pas procéder à des mesures de prévention si ses moyens ne le lui permettent pas cette année-là...

Une bonne partie des revenus des vétérinaires provient du fait qu'ils sont à la fois prescripteurs et vendeurs de médicaments. Comment se répartissent les revenus des vétérinaires entre les soins et la vente de médicaments ? Si les vétérinaires rencontraient davantage de difficultés pour gagner correctement leur vie, quel serait l'impact de ces difficultés sur le nombre de vétérinaires dans les campagnes ? Je suis préoccupée par le risque de voir apparaître des déserts vétérinaires, à l'instar des déserts médicaux.
Les vétérinaires sont très dépendants économiquement de la délivrance de médicaments, qui représentent 60 % de leurs revenus. Les actes de prescription ou de délivrance, qui sont des prestations intellectuelles, ne sont aujourd'hui quasiment plus rémunérés. Ils sont souvent seulement inclus dans la marge commerciale. Il s'agit là d'un paradoxe. La réalité économique est que ce couplage entre prestation intellectuelle et vente de médicaments ne permet d'assurer aux vétérinaires que des revenus modestes par rapport aux autres professionnels de santé - 55 000 euros annuels, soit 30 % de moins que la moyenne des médecins généralistes - alors qu'ils assurent un service de proximité, en soirée, de nuit, le dimanche, sans que l'État n'intervienne ni recevoir de compensations, contrairement aux pharmaciens et aux médecins. Malgré ces difficultés, le réseau des vétérinaires reste toujours bien réparti sur le territoire, y compris dans des régions qui comptent désormais des déserts médicaux. Nous ne recevons pas de courriers massifs de collectivités territoriales ou d'éleveurs qui ne parviendraient pas à trouver de vétérinaire. Les problèmes se posent davantage en périphérie urbaine. Ce modèle économique original s'est construit au fil des ans.
En ce qui concerne les antibiotiques, je voudrais rappeler qu'ils ne sont pas le poste dominant des médicaments utilisés, en particulier dans la filière bovine où ils ne représentent que 20 % des médicaments. Les choses sont un peu différentes dans les filières porc et volaille. Pour l'immense majorité de mes adhérents, la consommation d'antibiotiques est quelque chose d'accessoire, qui ne revêt pas de caractère collectif massif contrairement aux aliments médicamenteux dans les filières qui les utilisent. Les aliments médicamenteux représentent la moitié de la consommation de médicaments vétérinaires. Ils sont prescrits sur ordonnance de vétérinaires mais les vétérinaires ne sont pas intéressés financièrement à cette prescription et c'est dans ces aliments médicamenteux que se trouvent 50 à 60 % des antibiotiques délivrés en France.
Cette question fait l'objet de nombreux débats. Il existe en France un plan écoantibio 2017 qui fixe des objectifs de réduction et prévoit des mesures dont peu ont pour le moment un impact concret. L'une de ces mesures est incluse dans la visite sanitaire annuelle - le seul acte que l'État confie régulièrement aux vétérinaires qui ont en charge un élevage bovin. Depuis l'an dernier, est inclus dans cette visite un mémorandum sur l'antibiorésistance avec des questions à poser aux éleveurs : pourquoi utilisez-vous des antibiotiques ? dans quelles conditions ? que faites-vous des flacons ? Il s'agit d'expliquer aux éleveurs les enjeux de l'antibiorésistance.
L'évolution de l'antibiorésistance en médecine humaine comme en médecine animale sont encore en débat et se heurtent à des dogmes selon lesquels se poseraient de plus en plus des problèmes d'antibiorésistance parce que les vétérinaires utiliseraient beaucoup trop d'antibiotiques, ce qui aurait aussi des conséquences sur la santé humaine en renforçant l'antibiorésistance humaine. Scientifiquement, il y a très peu de preuves d'un passage de l'antibiorésistance animale à l'antibiorésistance humaine. Seuls sont concernés les quelques éleveurs de porcs qui portent des germes antibiorésistants.
Il existe aussi des informations complètement fausses selon lesquelles l'antibiorésistance serait acquise par la consommation de viande qui contiendrait des antibiotiques et des germes résistants. Il s'agit là d'assertions mensongères mais récurrentes qui reviennent sous la plume des journalistes.

Quel est l'impact de ces antibiotiques contenus dans l'alimentation sur l'environnement ?
Tout comme pour les humains, les antibiotiques pour animaux font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché après notamment une étude d'écotoxicité. Cet impact doit être évalué et il est jugé acceptable ou non en fonction du devenir technique de la molécule dans son cycle de vie. Certains posent les mêmes problèmes que les médicaments consommés par les humains et que l'on peut retrouver dans les eaux. Les antibiotiques sont relativement sensibles à la lumière et se dégradent rapidement. Ils n'ont pas d'effet à des doses infinitésimales contrairement à des pesticides.

Quel est l'impact du coût de tous les soins sur les coûts des élevages ?
Il y a peu d'études sur la question car, dans les comptes de gestion, le poste des frais vétérinaires est souvent un poste « fourre-tout », dans lequel se trouvent des produits qui ne sont pas facturés par les vétérinaires. Une étude assez précise, qui a été effectuée par l'école vétérinaire de Nantes, montre que ces frais atteignent au plus 4 % des charges totales d'un élevage moyen de vache laitière, qui requiert beaucoup d'interventions. Sur ces 4 %, 50 % sont consacrés au médicament. Entre 30 et 40 % des vaches sont victimes d'infections mammaires et ont besoin d'un traitement. Conserver une grande majorité d'élevages en plein air est une bonne chose mais pose le problème du parasitisme et nécessite d'avoir recours à des traitements antiparasitaires. Cela représente une charge de 85 € par vache et par an.

Il existe un débat sur la viande aux hormones. Je vais régulièrement aux États-Unis et j'en apprécie la viande, qui y est hormonée. Un ancien ministre de l'agriculture me disait que cette viande était tout à fait propre à la consommation et que ces hormones étaient naturelles. J'aimerais avoir votre avis sur cette question que se posent beaucoup de consommateurs.
Par ailleurs, je voudrais souligner que votre profession s'est organisée pour assurer un accès aux soins pour les animaux beaucoup plus performant que ce qui existe pour les personnes habitant les territoires ruraux. J'ai le sentiment que les vétérinaires ont une grande capacité à s'organiser collectivement.
La viande hormonée a disparu en France depuis 30 ans. Les États-Unis peuvent se poser cette question car chez eux la consommation de viande bovine est une consommation de masse qu'ils cherchent à promouvoir à tout prix. En France, l'avenir est plutôt à un marché de niche haut de gamme qui n'est pas compatible avec l'utilisation de ce types d'artifices. Cela dit, il ne semble pas que la santé des Américains soit pénalisée par cette viande hormonée. Je ne connais pas rapport le bénéfice-risque en matière de santé mais en matière d'image pour la filière, le recours aux hormones serait dévastateur. Ce débat, qui a eu lieu aussi pour le lait, est cependant derrière nous. De plus, pour valoriser notre production, il est important que nos méthodes de production soient différentes de celles des Brésiliens ou des Américains.
Le modèle économique des vétérinaires libéraux est lié à beaucoup d'éléments, à commencer par l'absence d'hôpital, ce qui fait que chaque vétérinaire est depuis toujours dans son territoire obligé de se consacrer à l'ensemble des activités de la médecine. C'est un peu moins le cas aujourd'hui avec les animaux de compagnie puisque le vétérinaire peut avoir recours à un référent ou faire venir un expert s'il est confronté à une difficulté. Pour les animaux de ferme, le contrat tacite qui lie l'éleveur au vétérinaire repose sur la disponibilité du vétérinaire. Avec ce couplage du service et de la fourniture de médicament, nous disposons d'un continuum complet dans la relation avec l'éleveur. Nous avons un débat économique avec l'éleveur pour ajuster au mieux ses coûts, pour privilégier la vaccination par exemple.
La contrainte de disponibilité devient acceptable quand les vétérinaires peuvent se relayer pour assurer des permanences grâce à leur regroupement dans un lieu unique.

Votre syndicat a-t-il des liens avec les autres syndicats vétérinaire d'Europe ? Pourriez-vous nous parler des exigences qui sont celles de nos voisins Européens ? Les Français sont-ils plus exigeants que les autres ? Existe-t-il des pays plus laxistes ?
La situation en Europe est très composite, avant tout parce que les cheptels ne sont pas composés de façon équivalente. Nous travaillons beaucoup avec les vétérinaires néerlandais et allemands et je n'ai pas le sentiment que les contraintes qui pèsent sur leurs éleveurs soient de nature très différente. Les contraintes sociétales sont les mêmes : ainsi au Pays-Bas, les éleveurs font actuellement face à des attaques sur l'élevage hors-sol et le bien-être animal. Je fais le même constat en Allemagne, avec toutes les problèmes liés aux exploitations de l'ex-Allemagne de l'Est. Dans ces pays existent la même pression sanitaire et les mêmes contrôles. En Europe du Sud et de l'Est, les exigences sont probablement moindres et la situation sanitaire moins maîtrisée.

Pourriez-vous nous parler des tests tuberculose, qui semblent varier suivant les départements ?
La réglementation européenne ne reconnaissait jusqu'ici que l'intradermo, c'est-à-dire l'injection dans le pli cutané d'une petite dose de tuberculine, qui est un allergène : on étudie la réaction allergique. Il s'agit d'une procédure très lourde et quasi incompatible avec les méthodes de contention des élevages allaitants. La fiabilité était très bonne tant que le taux de prévalence était très élevé - cet outil fonctionnait parfaitement dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe car les taux de prévalence sont très faibles et nos confrères sont soumis à des impasses car le système rend un diagnostic difficilement interprétable. D'où la recherche d'autre méthodes de dépistage comme les tests sanguins interféron, qui sont chers mais présentent des résultats bien meilleurs mais n'étaient pas reconnus jusque là par l'Union européenne, même si les choses évoluent actuellement.

Existe-t-il en France une recrudescence de la tuberculose dans certains troupeaux ?
Oui, notamment en Côte-d'Or, Dordogne et Camargue, pour des raisons qui sont propres à chacun de ces trois territoires. Il est incroyable de constater qu'une maladie que l'on pensait éradiquée il y a trente ans menace aujourd'hui de s'installer de façon définitive. Les Anglais sont eux aussi sont confrontés à ce problème mais ils ont baissé les bras et attendent désormais le vaccin. Pour les éleveurs, cette maladie a peu d'impact car les animaux sont très peu touchés. Le seul risque pour les éleveurs est une saisie de l'animal tuberculeux à l'abattoir. Par contre, imposer des tests sur les animaux représente un danger explosif. J'aimerais enfin souligner que le lien entre tuberculose humaine et animale apparaît aujourd'hui inexistant.

Pouvez-vous nous parler de la question de l'abattage et de ses risques sanitaires ?
Lorsque l'animal n'est pas étourdi et qu'il souffre, il existe un risque de purpura, c'est-à-dire de mini thromboses dans les capillaires des bovins au moment de la mort. Le stress, la durée de l'agonie sont des facteurs qui favorisent fortement ce type d'évènements et rendent la viande impropre à la consommation, car elle noircit durant son processus de maturation. Il s'agit avant tout d'un phénomène visuel : du sang coagulé se dissémine dans l'ensemble du muscle. Tous les facteurs qui majorent le stress favorisent ce genre de phénomène.
Je souhaiterais aborder avec vous le problème de l'abattage d'urgence, qui avait été interdit à l'époque de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mais est de nouveau pratiquée en France. Ce type d'abattage s'applique à des animaux blessés ou victimes d'accidents mais il pose des problèmes de transports car celui-ci dure trop longtemps. De plus, l'industrie de la viande ne veut pas de ces animaux qui ne correspondent pas à ses cahiers des charges. A mon sens, l'abattage d'urgence constitue une persistance d'une période de disette d'après-guerre qui n'a plus grand sens. Bien qu'elle ait été reprise dans la loi en 2004, cette pratique est aujourd'hui peu utilisée.

Concernant le transport des animaux, la directive européenne est très précise sur la façon dont les animaux doivent être chargés, déchargés, abreuvés... Cette directive est-elle applicable ? Je pense notamment aux éleveurs du plateau de Millevaches qui vont vendre leurs animaux dans la plaine du Pô, ce qui nécessite plus de huit heures de transport.
Sur un trajet de huit heures, le bénéfice-risque de décharger des animaux est difficile à identifier. Je crois qu'il y a là beaucoup d'anthropomorphisme. Des animaux transportés en groupe sont davantage perturbés par les évènements imprévus que par une heure ou deux de plus dans le camion. Les chargements-déchargements sont des facteurs de stress très importants, surtout pour des animaux qui viennent d'être allotés et ne se connaissent pas.