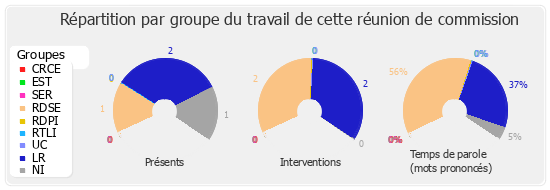Mission commune d'information Formation professionnelle
Réunion du 25 avril 2007 : 3ème réunion
Sommaire
- Audition de mm. claude cochonneau et christian decerle vice-présidents patrick ferrere directeur général et mme sylvie giraud chargée de mission de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea (voir le dossier)
- Audition de mme laurence paye-jeanneney administratrice générale et m. le recteur jérôme chapuisat directeur délégué du conservatoire national des arts et métiers cnam (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mm. Claude Cochonneau et christian decerle vice-présidents patrick ferrere directeur général et Mme Sylvie Giraud chargée de mission de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea
Audition de Mm. Claude Cochonneau et christian decerle vice-présidents patrick ferrere directeur général et Mme Sylvie Giraud chargée de mission de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea
Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle, président, puis de M. Jean-François Humbert, vice-président, la mission d'information a procédé à l'audition de MM. Claude Cochonneau et Christian Decerle, vice-présidents, Patrick Ferrere, directeur général, et Mme Sylvie Giraud, chargée de mission, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).
a tout d'abord fait observer que les problématiques de la formation professionnelle étaient distinctes pour les salariés et les exploitants agricoles. Il a indiqué que, d'ici à 2010, 30 % des actifs agricoles atteindront l'âge de la retraite ce qui constitue un défi majeur pour la formation.
Evoquant les particularités de l'emploi agricole, il a précisé qu'on dénombrait :
- 145 000 entreprises agricoles employant des salariés, seules 3 500 d'entre elles en ayant plus de dix ;
- et 1,2 million de salariés dans l'agriculture, correspondant à 300 000 « équivalents temps plein », et incluant 850 000 saisonniers qui ont vocation à devenir les « permanents de demain ».
Il a fait observer que la formation professionnelle agricole constituait un bon outil d'insertion des jeunes en les préparant à des métiers très variés, et utilisait les mécanismes du contrat de professionnalisation et du certificat de qualification professionnelle (CQP). Il a également souligné que la formation avait également pour but de fidéliser les travailleurs agricoles saisonniers.
Pour parvenir à ces objectifs, il a indiqué que la branche agricole avait notamment :
- assoupli le dispositif du congé individuel de formation ouvert aux salariés sous contrat à durée déterminée (CIF-CDD) ;
- mis en place un système de transférabilité et de majoration de la durée du droit individuel à la formation (DIF) ;
- et progressé dans le domaine de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
S'agissant de la mise en oeuvre de cette stratégie, il a évoqué l'efficacité du fonctionnement de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche que constitue le fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en précisant notamment qu'un mécanisme spécifique de mutualisation permettait de répondre aux besoins des très nombreuses petites entreprises agricoles. Il a également fait observer, en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux, que le FAFSEA ne rémunérait pas les représentants syndicaux qui participent à sa gestion et que la collecte des financements de la formation professionnelle était maîtrisée par le canal de la Mutualité sociale agricole (MSA).
a conclu son propos en indiquant que le besoin de main-d'oeuvre qualifiée pourrait constituer un des freins au développement de l'agriculture de demain, ce qui justifie un effort particulier pour améliorer l'attractivité des métiers agricoles.
a rappelé que le métier d'agriculteur était en pleine transformation, qu'il était, en particulier, tributaire de décisions nationales ou internationales complexes et que la formation professionnelle était, dans ces conditions, une nécessité.
Il a évoqué la fécondité de l'enseignement agricole, qui a prouvé son efficacité sur l'ensemble du territoire en s'efforçant de permettre à chaque exploitant de trouver dans son environnement géographique immédiat une formation adaptée. Il a signalé que se profilait, pour l'avenir, une tendance croissante des chefs d'exploitation à déléguer à des intervenants extérieurs des tâches de gestion et d'administration. Il a précisé que le niveau traditionnellement exigé pour l'installation comme exploitant était le niveau du baccalauréat mais que de plus en plus d'agriculteurs étaient titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un diplôme d'ingénieur. Il a enfin souligné la nécessité de rester très attentif au maintien d'une formation tout au long de la vie.
En réponse à une demande de précision de M. Jean-Claude Carle, président, M. Christian Decerle a indiqué qu'une des originalités du système de formation professionnelle agricole était le prélèvement de la cotisation de formation professionnelle par la Mutualité sociale agricole dans des conditions efficaces. Il a signalé qu'une difficulté était née du fait que les petits contributeurs n'avaient pas à acquitter la cotisation afférente au congé individuel de formation (CIF) mais que le législateur avait autorisé la mutualisation et la « fongibilité » des crédits consacrés aux diverses actions de formation, ce qui permet de continuer à financer ces stages de longue durée.
Il a ensuite évoqué les efforts de la branche agricole pour aider les multiples petites entreprises à prendre conscience de la nécessité de la formation, en prenant l'exemple de stages destinés à progresser dans l'accueil du public pour faciliter la vente directe des produits agricoles au consommateur.
Il s'est félicité de la croissance des actions bénéficiant de cofinancements régionaux et a rappelé le rôle pionnier de l'agriculture, qui a institué, dès 1982, la mutualisation des fonds consacrés au plan de formation.
Il a enfin signalé que la dissémination des partenaires de formation suscitait des difficultés notamment pour répondre aux besoins spécifiques, en zone de montagne, des bi-actifs - agriculteurs et moniteurs de sport, par exemple - qui relèvent d'organismes collecteurs ayant des logiques de fonctionnement mal articulées.

s'est interrogé sur les perspectives d'emploi dans l'agriculture et sur les mécanismes de reconversion.
a évoqué la raréfaction du vivier traditionnel de personnes susceptibles d'être employées dans l'agriculture, qui s'explique notamment par les besoins de main-d'oeuvre concurrents des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Il a observé que les difficultés de l'agriculture ne permettaient pas d'offrir des salaires aussi attractifs que dans ces secteurs. Puis en se fondant sur des exemples concrets, il a montré le caractère bénéfique des travaux agricoles saisonniers pour l'insertion de certains jeunes.
a précisé que 80 % des jeunes issus de l'enseignement professionnel agricole trouvaient, dans les quatre années suivant leur formation, un emploi stable dans le secteur agricole ou para-agricole.

a posé des questions sur les mesures de lutte contre l'illettrisme, sur la mutualisation des financements, sur la certification des formations et sur la régulation du nombre de diplômes de l'enseignement agricole.
a brossé un rapide tableau du processus d'adaptation des diplômes délivrés par l'enseignement agricole en lien avec le ministère de l'agriculture. Puis il a analysé les divers mécanismes permettant de personnaliser les parcours de formation et de les faire déboucher sur l'acquisition d'un diplôme, en particulier à l'aide de la validation des acquis professionnels.
a insisté sur la mise en place, par la branche agricole et la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), de modules de certifications professionnels à but essentiellement pratique, adaptés aux spécificités régionales, et qui se distinguent des diplômes d'Etat. Elle a en outre précisé que la validation des acquis professionnels bénéficiait de financements dédiés par le FAFSEA.
En réponse à des questions de M. Jean-Claude Carle, président, sur la frontière entre le secteur agroalimentaire et la branche agricole et sur la prise en compte des besoins des travailleurs saisonniers pluriactifs, M. Patrick Ferrere, après avoir rappelé la diminution générale depuis 1994 du nombre d'organismes collecteurs, a précisé que relevaient du FAFSEA : certaines entreprises de l'agroalimentaire comme les grandes maisons de vins et spiritueux, les entreprises forestières, l'Office national des forêts (ONF), l'ensemble du secteur du cheval, y compris les courses et les hippodromes, ainsi que certaines activités annexes à l'agriculture comme les parcs zoologiques ou les entreprises du paysage. Il a signalé que l'agroalimentaire se divisait en deux secteurs, coopératif et privé, qui relèvent d'organismes collecteurs distincts.
Il a observé que les entreprises de certains secteurs cotisaient à des organismes collecteurs interprofessionnels en dépit de la logique de branche qui avait inspiré la réforme de la collecte.
Puis il a signalé qu'à la différence des autres organismes collecteurs qui financent les organisations syndicales, le FAFSEA se limitait à rembourser les frais de déplacement des personnes participant au fonctionnement de l'organisme paritaire. Il s'est enfin félicité de la présence d'un contrôleur d'Etat et d'un commissaire du Gouvernement auprès du FAFSEA.

s'est interrogé sur la prise en charge des formations liées à la sophistication croissante des matériels agricoles, à la protection de l'environnement, et destinées à faciliter la reprise des exploitations agricoles. Il a demandé des précisions sur la procédure concrète d'information et d'accès à ces formations.
a précisé qu'en règle générale, ce n'est pas le fournisseur du matériel mais l'exploitant qui doit se charger de la formation à son utilisation et que les programmes de formation prenaient en compte cette nécessité, la décision de formation relevant du niveau régional. Il a ensuite évoqué les formations à l'environnement et à la santé, qui tiennent compte de l'évolution rapide de la réglementation dans ce domaine. Il a enfin mentionné les CIF, susceptibles de préparer des salariés à la reprise d'une entreprise agricole et à l'installation.
A ce sujet, M. Jean-François Humbert, président, a évoqué les programmes régionaux d'aide à l'installation agricole créés en Franche-Comté.
a apporté des précisions sur le caractère de plus en plus sophistiqué et performant des stages de formation aux nouveaux matériels, en signalant que certains agriculteurs acceptaient de jouer un rôle de formateur.

a signalé le cas d'agriculteurs bénéficiant de formations de reconversions de haut niveau.

s'est interrogée sur les formations s'adressant aux agriculteurs pour faire face à la complexité réglementaire.
a indiqué que les agriculteurs pouvaient bénéficier de financement pour faire face à de tels besoins.
a précisé qu'il convenait de distinguer la formation et ce qui relève du « développement », c'est-à-dire l'accompagnement à la gestion, la vulgarisation ou la recherche appliquée. Il a précisé qu'une contribution spécifique finançait ces dernières actions, en prenant l'exemple de l'assistance aux agriculteurs devant remplir une déclaration spécifique liée à la politique agricole commune.
En réponse à une interrogation de M. Yann Gaillard sur le rattachement de l'ONF au FAFSEA, M. Christian Decerle a indiqué que les 6 000 ouvriers salariés de droit privé de cet établissement public sont rattachés à la branche agricole à la différence des cadres qui relèvent, pour la plupart, d'un statut public.
Audition de Mme Laurence Paye-jeanneney administratrice générale et M. Le Recteur jérôme chapuisat directeur délégué du conservatoire national des arts et métiers cnam
Audition de Mme Laurence Paye-jeanneney administratrice générale et M. Le Recteur jérôme chapuisat directeur délégué du conservatoire national des arts et métiers cnam
La mission d'information a procédé, enfin, à l'audition de Mme Laurence Paye-Jeanneney, administratrice générale, et M. le recteur Jérôme Chapuisat, directeur délégué, du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
a rappelé que le CNAM, fondé par l'abbé Grégoire en 1794, est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Dédié à la formation professionnelle supérieure des adultes ayant au moins le niveau baccalauréat, le CNAM assure également une mission de recherche technologique et de diffusion de la culture scientifique et technique. L'établissement public, financé par l'Etat, fonctionne en réseau avec les vingt-huit centres régionaux répartis sur l'ensemble du territoire de métropole et d'outre-mer, organisés sous la forme d'associations. Cet établissement public, qui dispose d'un corps spécifique de professeurs titulaires de chaires, est chargé de la définition de l'offre de formation et du contrôle de la qualité des formations dispensées sur l'ensemble du territoire. Elle a précisé que les enseignants du CNAM sont tous affectés à l'établissement public et que les centres régionaux doivent faire appel à des personnels compétents en fonction de leurs besoins, ce qui leur assure une capacité d'adaptation plus forte.
a considéré que le CNAM, premier établissement de formation tout au long de la vie dans le domaine professionnel, était à la fois une université des métiers, un « Collège de France des techniques » et une université de la deuxième chance. Accueillant plus de 85 000 auditeurs, le CNAM peut délivrer les diplômes d'Etat licence-master-doctorat ainsi que des certifications professionnelles et des titres propres à l'établissement. Les formations dispensées, qui recouvrent l'ensemble des champs de métiers tertiaires et industriels, répondent à un souci permanent d'adaptation aux besoins et aux demandes locales émanant des 150 centres d'enseignement qui assurent un maillage du territoire. Les formations peuvent être assurées à distance, grâce aux technologies de l'information, mais tout en conservant un nécessaire accompagnement, dispensées en dehors du temps de travail et sous la forme de modules courts, selon un système d'unités de valeur.
a fait observer que ce modèle, encore trop peu connu car souffrant d'un manque de lisibilité, n'avait pas d'équivalent à l'étranger. Le CNAM a ouvert, toutefois, des centres à l'étranger, dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales et le milieu économique et social.
a ensuite insisté sur le concept de formation professionnelle supérieure, qui fait l'originalité du CNAM en dépassant la distinction entre formation initiale et continue et en se rapprochant de la notion de formation professionnelle tout au long de la vie. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un enseignement supérieur, mais non d'un enseignement supérieur professionnel ou de formation continue au sens strict, dans la mesure où l'établissement peut délivrer des diplômes.
Nombre des auditeurs, qui viennent sur leur initiative ou celle de leur employeur, s'engagent dans un parcours de formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, même si cela n'était pas leur première intention. En effet, le diplôme apporte une plus-value à la formation et constitue une condition de sa transférabilité.
a ajouté qu'une autre spécificité du CNAM tient aux méthodes employées, qui s'écartent des pratiques académiques et font intervenir en majorité des professionnels, puisque seuls 500 enseignants sur 5 500 sont des universitaires.

a demandé des précisions sur le profil des publics accueillis en formation, avant de s'enquérir des solutions permettant de réduire, à partir de l'expérience du CNAM, la césure entre formation initiale et continue. Relevant, de façon générale, une tendance à la prédominance de l'offre de formation sur la demande, il s'est interrogé sur les moyens d'inverser cette situation. En outre, il a demandé si le CNAM proposait des services d'anticipation des besoins en compétences et formation ainsi que de conseil et d'aide à l'orientation. Enfin, considérant le CNAM comme un établissement de référence dans le domaine de la formation, il s'est demandé s'il pourrait devenir un modèle de bonnes pratiques.

s'est interrogé sur les contacts que le CNAM entretient avec l'éducation nationale, avant de demander si les enseignants étaient des professionnels exerçant encore une activité. Il a souhaité connaître, en outre, le coût des formations délivrées pour les entreprises.

a voulu savoir si le CNAM avait des relations avec la Cité des sciences. Il s'est demandé, ensuite, où s'inscrivait le CNAM dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
En réponse à ces intervenants, Mme Laurence Paye-Jeanneney a apporté les éléments de précision suivants :
- le CNAM accueille des publics très divers, âgés de vingt à soixante-cinq ans environ, avec une moyenne d'âge de trente-trois ans ; ce sont en majorité des hommes, à 70 % ;
- la logique d'offre est un risque qu'il faut combattre en permanence ; la structure d'association des centres régionaux permet d'introduire davantage de souplesse ; par ailleurs, des assises régionales sont actuellement organisées en vue de mieux analyser les besoins, au contact direct du terrain ;
- le CNAM travaille avec des branches pour leur apporter une aide en matière d'ingénierie de formation, comme c'est le cas actuellement avec le secteur automobile par exemple, en vue d'adapter les compétences des garagistes ;
- le CNAM est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale ; il est en contact permanent avec les autres établissements relevant de ce ministère, dont sont issus ses enseignants ; toutefois, face aux difficultés rencontrées, il faudrait définir un accord-cadre afin de faciliter ces échanges ; la tutelle unique pose problème au CNAM dans la mesure où la formation professionnelle relève du ministère de l'emploi ; il serait donc utile d'envisager une double voire une triple tutelle ;
- les formations sont facturées aux entreprises à des tarifs en général plus élevés que ceux proposés aux personnes venant de leur propre initiative.
Complétant ces propos, M. Jérôme Chapuisat a apporté les éléments de réponse suivants :
- la notion de formation tout au long de la vie n'aura pas de réelle portée tant que l'on continuera de considérer la formation initiale comme un produit fini ; au contraire, le CNAM propose à chacun de s'engager dans une formation « continuée » ; ce « modèle CNAM » pourrait être amené à jouer un rôle-clé dans le cadre de la montée en puissance des compétences des régions en matière de formation professionnelle ;
- on déplore de façon générale un manque de relation entre l'éducation nationale et le monde de la formation professionnelle, duquel le CNAM se sent souvent mieux compris ; c'est pourquoi il serait plus adapté d'élargir sa tutelle aux ministères en charge de la formation professionnelle et de l'industrie.
S'interrogeant sur les éventuelles contraintes que susciterait une triple tutelle, M. Jean-Claude Carle, président, s'est demandé s'il ne serait pas préférable, au contraire, de renforcer l'autonomie du CNAM. Il a souhaité savoir, ensuite, si les personnes venaient au CNAM avec un projet, et si ces projets étaient mis en phase avec les débouchés.
a partagé le souhait que l'établissement bénéficie d'une plus grande autonomie, notamment dans le recrutement de ses enseignants. Elle a évoqué, ensuite, un projet en cours permettant à des étudiants des filières littéraires de s'engager dans un parcours de professionnalisation, en leur proposant une formation adaptée aux besoins des entreprises, dans des secteurs techniques. En outre, elle a souligné que le CNAM, parce qu'il apparaît plus accessible pour certains publics, accueillait près de 30 % d'auditeurs issus de l'immigration, contre 2 à 3 % seulement dans les universités. A cet égard, une réflexion est en cours sur un projet d'école de l'intégration. Enfin, si la plupart des auditeurs venant au CNAM ont un projet, l'établissement propose des services de conseil et d'accompagnement.