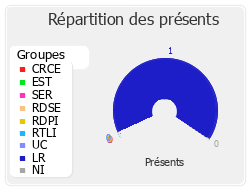Mission commune d'information sur le Mediator
Réunion du 14 avril 2011 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mme anne laude professeur de droit à l'université paris descartes codirecteur de l'institut droit et santé (voir le dossier)
- Audition de m. denys schutz directeur général de servier-biopharma (voir le dossier)
- Audition de m. bernard bégaud professeur de pharmacologie à l'université de bordeaux directeur de l'unité de recherche « pharmaco-épidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations » (voir le dossier)
La réunion

Vous êtes professeur de droit à l'université Paris Descartes et codirecteur de l'Institut Droit et Santé. Vous n'êtes donc pas concernée par la question sur les déclarations d'intérêts ; en revanche, je dois lui préciser que cette audition sera enregistrée en vue de sa diffusion sur le site Internet du Sénat et sur Public Sénat.
J'ai mené des recherches sur les responsabilités qui pourraient être engagées à la suite de prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (AMM). L'autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires comporte les indications de prescription, la posologie, etc. Une prescription hors de ces termes peut avoir un intérêt pour le patient. En effet, les essais cliniques sont difficiles à réaliser sur certaines catégories de personnes, par exemple les enfants ou les personnes âgées, et c'est alors empiriquement que l'on peut juger de certains effets dans des conditions qui n'ont pas été explorées.
Les prescriptions hors AMM peuvent cependant entraîner la mise en jeu de responsabilités. Celle des professionnels de santé, et tout d'abord : les médecins. Ceux-ci ont une liberté totale de prescription, sauf quand l'AMM limite l'usage d'un médicament au cadre hospitalier. Le législateur a posé une autre limite : les médecins sont tenus d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Leur responsabilité disciplinaire peut être mise en oeuvre en cas d'infraction aux obligations du code de déontologie. Leur responsabilité civile est engagée si le juge retient l'existence d'une faute. L'article L. 1110-5 du code de la santé publique précise que le médecin doit faire bénéficier son patient de thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui offrent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances scientifiques avérées. Dans le cas des prescriptions hors AMM, les connaissances peuvent être jugées insuffisantes et la sécurité sanitaire non assurée.
Le code de santé publique comporte, également depuis 2002, une obligation qui met en jeu la responsabilité civile du praticien : il s'agit de l'information du patient sur le traitement, l'utilité de celui-ci, ses conséquences, l'urgence éventuelle, les alternatives. Déjà particulièrement large, l'obligation d'information est renforcée dans le cas des prescriptions hors AMM, le médecin étant tenu de mentionner l'absence de validation par les autorités, justifier son choix et préciser les alternatives. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt récent.
Rappelons que, lorsque la responsabilité civile du médecin est engagée, il est a priori couvert par son assureur. Les professionnels de santé sont tenus de souscrire une assurance depuis 2002. Mais couvrirait-elle la responsabilité du professionnel de santé en raison d'une prescription hors AMM ? Sans validation scientifique, l'on peut se poser la question. Il faudrait interpréter au cas pas cas les polices d'assurance.
La responsabilité du médecin peut être également pénale, du fait d'obligations spéciales du code de la santé publique ou d'infractions plus générales, en cas d'homicide involontaire par exemple.
Enfin, le médecin qui prescrit hors AMM a l'obligation de mentionner sur l'ordonnance que la prescription ne sera pas remboursée. A défaut, sa responsabilité financière à l'égard de l'assurance maladie est engagée : il peut se voir infliger des pénalités financières tandis que son patient sera contraint de rembourser les sommes indûment perçues.
Le pharmacien a une obligation de conseil, de contrôle, de vérification des prescriptions. Il doit se montrer objectif. Aussi, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. La jurisprudence a retenu comme une faute le fait pour un pharmacien d'avoir délivré un médicament prescrit hors AMM après avoir préalablement appelé le médecin, dans la mesure où il avait accordé une trop grande confiance au prescripteur...
L'infirmière, qui délivre le médicament au domicile du patient ou qui injecte le produit, est éventuellement responsable, en ce qu'elle est tenue de respecter le mode d'emploi et les termes de l'AMM. Dans le doute, elle aussi doit en référer au prescripteur.
Et les laboratoires ? S'ils font de la publicité pour leurs produits, ils ont l'obligation de respecter les termes de l'AMM. Une publicité pour une indication hors AMM engagerait la responsabilité pénale du laboratoire. Il n'y a pas de jurisprudence en France dans ce domaine. Aux Etats-Unis, un juge a retenu la responsabilité d'un laboratoire qui avait lors d'un congrès laissé promouvoir un usage de son médicament qui ne figurait pas dans l'autorisation officielle. La publicité vise toutes les informations produites sur support papier ou audiovisuel mais aussi, dans l'interprétation française et européenne, celles transmises par les visiteurs médicaux.

La commission de la publicité de l'Afssaps peut relever le non-respect des règles et appliquer des sanctions. Elle a ainsi reproché aux laboratoires Servier des publicités mensongères.
La commission de la publicité contrôle a priori mais aussi a posteriori et, dans le second cas, elle peut demander au laboratoire de retirer les informations contraires aux termes de l'AMM. Elle peut aussi prononcer des sanctions. Le code de la santé publique prévoit également une sanction pénale lourde : deux années d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende.
Pas à ma connaissance.
On peut s'interroger aussi sur la responsabilité des organismes d'assurance-maladie. L'ordonnance en cas de prescription hors AMM doit porter la mention « NR », non remboursable. Si le praticien l'a portée, et que la prescription est tout de même remboursée par la caisse, la responsabilité de l'organisme peut être engagée. Par ailleurs, dans le cadre d'une affection de longue durée, le « parcours de soins » d'un patient doit être validé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Celui-ci, ainsi que le médecin prescripteur, pourrait voir leur responsabilité engagée en raison d'une prescription jugée non justifiée au regard de l'état de la science. Le juge, pour se prononcer sur une prescription hors AMM, se fonde en effet sur l'information donnée au patient et sur l'état des connaissances scientifiques.
L'Afssaps encourage dans le cadre de la pharmacovigilance la remontée de l'information sur les effets indésirables ; mais les médecins ne se précipitent pas, s'agissant de prescriptions hors AMM, car ils craignent l'engagement de leur responsabilité. La directive du 15 décembre 2010 relative à la pharmacovigilance - qui devra être transposée avant juillet 2012 - marque à cet égard une avancée : elle suggère aux Etats de déconnecter la remontée des informations sur les effets indésirables et la mise en jeu de la responsabilité des professionnels de santé, ce qui devrait les inciter à signaler les incidents.
Faut-il mieux encadrer les prescriptions hors AMM ? Aucun pays n'interdit plus de telles prescriptions - la Hongrie, qui était une exception, vient de modifier sa législation. Cela n'exclut toutefois pas de réfléchir à cette question.
Premier constat, les contrôles des organismes de sécurité sociale sont manifestement peu effectifs. Il faudrait pour les améliorer avoir des indications sur la pathologie traitée.

Eh oui ! La loi Teulade de 1993, le codage des pathologies ! Mais quand une loi votée dix-huit ans plus tôt n'est pas appliquée, peut-être faut-il se demander si elle est inapplicable.
Elle peut l'être par défaut de publication des décrets d'application.
Une autre piste de réflexion concerne le taux de remboursement. Celui-ci est fixé indication par indication pour un même produit, ce qui crée une grande complexité. Un seul taux par produit serait préférable. Et rien n'interdirait à un laboratoire de commercialiser deux gammes de produits, pour deux indications différentes, avec éventuellement deux taux de remboursement différents. Le médecin saurait tout de suite si l'indication est remboursable ou non.
J'ajoute que les modifications d'AMM sont mal diffusées auprès des professionnels. La communication gagnerait à être améliorée. De même, on devrait imposer aux laboratoires de notifier aux autorités compétentes toute utilisation de leurs produits dont ils ont connaissance et qui n'est pas conforme aux termes de l'AMM. Développons la culture du signalement, la directive européenne nous y encourage.

Quand un juge lui reproche son manque d'indépendance par rapport au praticien, cela signifie-t-il que le pharmacien ne doit pas respecter les instructions données au téléphone par ce dernier ?
Que la prescription soit conforme ou non à l'AMM, on peut reprocher au pharmacien d'avoir délivré des médicaments qui ne sont pas dans l'intérêt du patient ou qui ne sont pas confortés par l'état de la science.
Je l'ignore. Il ne parle même pas toujours au patient directement. Et il n'a pas à opérer un contrôle systématique de la pathologie et de la prescription.

Un seul taux de remboursement serait préférable. Il faut aussi distinguer première et deuxième intention. Certaines autorisations sont délivrées pour des médicaments de deuxième intention, puis les prescriptions se font en première intention. Il serait bon de simplifier tout cela afin d'éviter ces mésusages.
Les termes de l'AMM sont parfois difficiles à mettre en pratique.

N'est-il pas choquant que certains laboratoires limitent leurs études préalables pour réaliser des économies, quitte à restreindre les indications du produit soumises à l'AMM ? Les autres applications seront testées empiriquement, les effets pervers ne seront pas décelés, mais les laboratoires élargiront ensuite les indications soumises à autorisation, à leur plus grand profit.
Vous évoquez les essais effectués après le début de la commercialisation. La vraie vie du médicament va révéler de nouvelles indications. Si l'on généralise les essais post-commercialisation, à la charge de qui seront-ils, laboratoires, autorités de contrôle ? La directive de 2010 apporte un élément de solution. Au moment de l'AMM, les autorités pourraient imposer aux laboratoires de développer les essais après la mise sur le marché.

En effet, la législation européenne prévoit, dans certaines limites, la possibilité d'octroyer des AMM conditionnelles. Il y a là un risque, car si l'on restreint les contrôles préalables, si l'on raccourcit la durée des essais et diminue leur nombre, on mettra en danger la sécurité des patients. Je vois bien l'intérêt des firmes dans cette affaire, moins celui des malades.
Les essais post-AMM ne doivent bien sûr pas se substituer aux essais préalables, mais peut-être pourrait-on développer les essais post-AMM complémentaires, sans s'inscrire pour autant dans un cadre d'AMM conditionnelle.

Je suis très sceptique : aujourd'hui, les études post-AMM demandées sont rarement réalisées.
L'article 26 de la loi 4 mars 2002, relatif à la déclaration des liens d'intérêts, a fait l'objet d'un décret d'application en 2007. Or il n'est pas respecté. Quelles sont vos suggestions à ce sujet ?
Certains proposent de développer un système à l'américaine, inspiré du Sunshine Act.
L'obligation pèserait aussi sur l'autre partie : les laboratoires. Ils devraient déclarer ces liens d'intérêts comme ils le font pour les subventions qu'ils versent aux associations de patients.
Si, me semble-t-il, on peut le voir sur le site de la Haute Autorité de santé (HAS).

Trois seulement l'ont fait, indiquant qu'ils ne versaient pas de subventions aux associations.

Depuis juin 2010. Peu de laboratoires font des déclarations. Et ils ont raison : ils n'encourent aucune sanction ! Mais je remercie ceux qui s'acquittent de cette exigence morale. Il y aurait lieu de prévoir des sanctions. Soit dit en passant, l'obligation de déclarer les subventions aux associations ne figure pas dans le Sunshine Act.
La HAS a signalé que la loi actuelle lui paraissait bien floue. Il faudra y revenir car les aides à déclarer ne sont pas bien identifiées.
En effet, comme on l'a fait pour la loi anti-cadeaux. Les notions d'avantage, de bénéfice, mériteraient d'être mieux circonscrites.

Deux exceptions ont été introduites après 1993 : les avantages prévus par convention et les hospitalités. Ils doivent être portés à la connaissance de l'Ordre des médecins, qui procède aux contrôles en amont - c'est la direction générale de la concurrence qui contrôle en aval. Or l'un n'a pas les moyens de remplir cette mission, l'autre n'a que des moyens faibles. Une autre instance pourrait-elle en être chargée ? Les congrès sous les cocotiers restent trop fréquents... Il faut changer la loi ou l'instance de contrôle.
L'Afssaps étant chargée de la police des médicaments et non de celle des professionnels, à quelle autorité de contrôle confier cette tâche : direction générale de la santé, HAS ? Celle-ci contrôle déjà les relations des laboratoires avec les associations de patients, il y a une logique à lui confier les relations entre les laboratoires et les professionnels, mais cela rentre-t-il dans le champ de l'évaluation ?

Et les hospitalités sont toujours offertes dans le cadre de la formation continue, qui relève de la HAS.
Le « développement professionnel continu » est effectivement placé sous son contrôle. Cependant, j'entends dire ici et là que la formation continue devrait être indépendante, qu'elle pourrait être confiée aux universités. Attribuer ce contrôle à la HAS ne consacrerait-il pas le rôle des laboratoires dans la formation continue ?

Il y aura forcément une période transitoire, interdire du jour au lendemain les financements par les laboratoires équivaudrait à un tremblement de terre. Les sociétés savantes et les associations seraient prises au dépourvu ! Du reste, je me demande comment on fait dans les autres disciplines : qui paye les formations et les congrès en droit de la santé ?
Les professionnels, en l'occurrence avocats, paient leur inscription !

Dans le monde de la santé, les mauvaises habitudes sont ancrées depuis longtemps.
Vous l'avez signalé dans plusieurs de vos nombreux articles, il n'y a pas de définition du patient dans notre droit. La loi de 2002 mentionne la « personne malade », vous utilisez les termes de patient, usager, malade, citoyen. Ne serait-il pas utile de préciser ces termes dans la loi ?
Vous avez raison. L'usager du système de santé désigne la personne prise en charge par le système hospitalier : il n'y a pas de contrat comme en matière libérale. Malade, patient, sont des termes qui ne clarifient pas les concepts, mais la directive du 9 mars 2011 sur les soins de santé transfrontaliers donne une définition assez large du patient. Nous serons de toute façon obligés de nous en inspirer en transposant !

L'avis défavorable rendu sur le Mediator par la commission de transparence en 1999 n'a pas été suivi d'effets. Le ministre n'a pas pris de décision, pour des raisons politiques. Ne devrait-on pas faire en sorte que cette commission prenne des décisions plutôt qu'elle ne rende des avis ? Lorsqu'elle estime insuffisant le service médical rendu (SMR) par un médicament, ce dernier ne serait pas inscrit sur la liste des produits remboursés et le ministre n'aurait plus à intervenir. Les ministres que nous avons interrogés ne se souviennent même pas s'ils sont ou non intervenus après de tels avis. Ils n'exercent pas réellement cette compétence !
Votre question en soulève plusieurs autres. Sur l'avis de 1999, il faudrait examiner les textes d'application ; la politique de déremboursement s'est effectuée en trois temps. En 2006...

Je n'ai pas évoqué 2006, parce que la commission n'a alors statué que sur l'une des deux indications du Mediator. C'est d'autant plus absurde que cette indication a ensuite été retirée...
On retrouve ici le problème de la différence des taux de remboursement en fonction de l'indication thérapeutique. Mais surtout, selon moi, on assimile trop facilement l'insuffisance du SMR à une inefficacité du produit. Appréciant l'efficacité d'un médicament en comparaison de ses concurrents, la commission de la transparence ne se prononce pas d'après les mêmes critères que la commission d'AMM, d'où un risque de confusion : un médicament peut présenter un SMR insuffisant sans que sa balance bénéfice-risque soit négative.
Quid du pouvoir de décision de la commission de la transparence ? Il est vrai qu'en l'espèce, l'Afssaps dispose vis-à-vis du ministre de plus d'autonomie que la Haute Autorité de santé.

Beaucoup d'associations sont subventionnées par les laboratoires. Cela porte-t-il atteinte à leur indépendance ? Des représentants des associations siègent à la commission nationale de pharmacovigilance, et peut-être demain à la commission de l'AMM.
Oui, le financement par les laboratoires peut mettre en cause l'indépendance des associations, mais la même remarque vaut pour les experts et les autres professionnels. La transparence est de rigueur, puisque les versements effectués par les laboratoires doivent être déclarés, ce qui permet d'apprécier les conflits d'intérêts et de demander, le cas échéant, aux personnes concernées d'en tirer les conséquences.

Mais si l'on considère demain que la transparence ne suffit plus, et que l'on exige de la part des experts l'absence de tout lien d'intérêts avec les laboratoires, la même règle ne devrait-elle pas s'imposer aux associations ?
Sans doute, au nom du parallélisme des formes. Mais serait-ce réaliste ?

Cette audition se déroulera à huis clos, comme vous l'avez souhaité. Ceux qui vous accompagnent peuvent-ils se présenter ?
Je suis responsable de la gestion des risques et des assurances chez Servier.
Je suis directrice en charge des relations avec le Parlement.
Je vous remercie d'avoir accepté de reporter cette audition, suite à l'accident de santé que j'ai subi. C'est avec une profonde tristesse que je me présente devant vous : en fin de carrière, l'idée qu'un médicament qui devait améliorer le pronostic des patients ait fait des victimes est tout à fait contraire aux motifs qui m'ont fait entrer chez Servier. Nos collaborateurs sont dans le désarroi : une de nos secrétaires a été traitée de « tueuse » par un commerçant, qui a refusé de la servir...

C'est la troisième fois que nous auditionnons des représentants des laboratoires Servier, dans le cadre de notre mission de contrôle. Des procédures judiciaires sont en cours, et vous n'êtes pas ici devant un tribunal : ce que nous voulons, c'est comprendre les dysfonctionnements dans l'évaluation et le contrôle des médicaments dont l'affaire du Mediator est l'indice.
Le débat scientifique sur la composition physico-chimique du Mediator se poursuit. Vous avez écrit en 2010 que « les principes actifs de Mediator et d'Isoméride sont différents, tant en termes de structures chimiques que d'effets biologiques (...) ou en termes de métabolisme ». Maintenez-vous cette affirmation contestée par l'Igas dans son rapport de janvier ?
Comment expliquez-vous la part des prescriptions hors AMM du Mediator ? Quelles étaient les méthodes des laboratoires Servier pour informer les médecins à son sujet ?
Je ne suis pas pharmacologue. Ma tâche, à la tête de Biopharma, société d'information du groupe Servier que je dirige depuis 1997, est de diffuser une information médicale, certes promotionnelle, mais conforme aux AMM, aux avis de la Commission de la transparence et aux diverses recommandations, afin de favoriser le bon usage des médicaments.

Si vous n'êtes pas pharmacologue, pourquoi avez-vous adressé aux médecins, le 3 décembre 2010, une lettre où vous indiquiez que le Mediator est un antidiabétique oral ? C'est tout simplement faux. Même l'indication comme adjuvant au régime antidiabétique a été refusée en 1987. Tous les pharmacologues - le dernier en date est le professeur Philippe Lechat, directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques de l'Afssaps - admettent désormais que le benfluorex est un anorexigène. Des publications le prouvaient dès 1974. Un tel déni de réalité de votre part m'inquiète ! Reconnaissez-vous que la concentration plasmatique de norfenfluramine après l'ingestion de 60 mg d'Isoméride ou de 450 mg de Mediator est la même, comme le prétend le docteur Frachon ?
La lettre à laquelle vous faites référence a été écrite en faisant appel à toutes les compétences de la maison Servier, et en conformité avec l'AMM. Tous les médecins qui prescrivaient du Mediator et que nos visiteurs ont rencontrés affirmaient que les patients n'éprouvaient pas les sensations subjectives habituelles avec les coupe-faim. Des études cliniques ont montré que l'effet du Mediator sur le poids était minime, comparable à celui des médicaments contre l'insulinorésistance : les patients perdent entre 500 g et 1,5 kg. Depuis le début des années 1990, nous utilisons la technique du clamp hyperinsulinique qui permet de déceler les effets des produits sur la sensibilité à l'insuline. Les effets du Mediator sur l'hémoglobine glyquée - entre 0,9 et 1 point - le situent à mi-chemin entre deux antidiabétiques : l'acarbose, commercialisé sous le nom de Glucor...

Je vous arrête : selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP), le Mediator n'a jamais été un antidiabétique, mais tout juste un adjuvant du régime du diabète. Vous qui vous retranchez souvent derrière les décisions des autorités sanitaires, reconnaissez que votre présentation de décembre dernier était mensongère ! Les laboratoires Servier ont d'ailleurs déjà été condamnés pour publicité mensongère.
Il y a eu deux interdictions de publicité, mais pas de condamnation pour publicité mensongère.

La commission de la publicité de l'Afssaps a émis des observations à trois reprises, en 1998, 2002 et 2004, et je reviendrai tout à l'heure sur le contentieux qui vous a opposé au professeur Roujansky dans les années soixante-dix. En 2004, l'Afssaps a interdit des publicités vantant l'efficacité et le caractère bien toléré du Mediator chez les patients diabétiques, et comprenant des recommandations erronées pour le traitement des hypertriglycéridémies. Si ce n'était pas mensonger, c'était au moins erroné !
Les antidiabétiques reçoivent eux aussi l'indication d'adjuvant au régime, ce qui signifie avant tout qu'aucun médicament ne peut se substituer à un régime adapté. Encore une fois, il est de ma responsabilité de diffuser des informations conformes aux recommandations des autorités sanitaires, et dans la classification des RCP, le Mediator a été d'abord classé parmi les antilipémiants, puis parmi les « antidiabétiques ou autres, non insuliniques ».

Je répète que les autorités de contrôle n'ont jamais reconnu le Mediator comme un antidiabétique, mais comme un anorexigène.
Sa structure chimique commande-t-elle les propriétés d'un produit ? Celle du Mediator - la phényléthylamine - se retrouve dans beaucoup de neuromédiateurs et d'autres produits. De la même façon, le graphite et le diamant ne diffèrent que par la structure cristalline ! L'amidon, comme la cellulose, est un polymère de glucose. L'aniline servit à développer toute une famille de colorants chez IG Farben, mais aussi à mettre au point le premier sulfamide antibactérien dans les années trente, et à soigner la typhoïde à Montpellier en 1942, grâce aux efforts de Marcel Janbon...
Un mot encore : si ce traitement a permis d'éradiquer la salmonellose, il a aussi produit des hypoglycémies et des comas. Tout cela pour dire que deux produits dotés d'une même structure chimique peuvent avoir des profils d'activité tout à fait différents. Les patients sous Mediator n'éprouvaient pas les sensations caractéristiques des coupe-faim - diminution de l'appétit, stimulation de la vigilance, tachycardie - et ne perdaient pas autant de poids qu'avec un amaigrissant. Les effets du produit s'apparentaient plutôt à ceux des antidiabétiques diminuant l'insulinorésistance musculaire ou hépatique : des travaux l'ont confirmé dans les années 1990.

Vous ne m'avez pas répondu : la concentration plasmatique de norfenfluramine après l'ingestion de 60 mg d'Isoméride ou de 450 mg de Mediator est-elle équivalente ?
Oui, mais la norfenfluramine n'est pas le support d'activité.

Vous reconnaissez cependant que le Mediator est une pré-drogue, dont on retrouve les traces dans le sang. C'est bien un anorexigène.
Pas du tout. Nos travaux ont montré que les métabolites supports de l'activité du Mediator étaient le S 422 et le S 1475, pas la norfenfluramine.

Ces dérivés ont une durée de vie très courte et laissent rapidement place à la norfenfluramine, vous le savez très bien. Mais avançons.
Pour répondre à la deuxième question de Mme le rapporteur, nous sommes très directifs à l'égard de nos visiteurs médicaux, qui ne doivent pas conseiller la prescription d'un produit hors AMM, et s'ils constatent de telles pratiques, un courrier est envoyé aux médecins concernés. Il existe en outre des mesures de surveillance. Le cabinet Antoine Minkowski (CAM) recueille anonymement auprès de panels de médecins le contenu des visites médicales pour tous les produits.

Le contenu ? Voulez-vous dire les propos échangés ? Y a-t-il donc des caméras ?
Les médecins doivent remplir un formulaire. Tous les laboratoires utilisent ces données, afin de vérifier que les conseils des visiteurs médicaux correspondent aux instructions, et pour savoir si les médecins considèrent que les visites leur apportent quelque chose. Or nous n'avons jamais constaté de dérives au sujet du Mediator.
Nous nous servons aussi de panels pour analyser les prescriptions : à qui est prescrit tel ou tel produit ? Selon quelles indications ? Pour quels effets attendus ? Avec quelles coprescriptions ? Il y a toujours des prescriptions hors AMM, et pour le Mediator, elles représentaient environ 10 % du total - il était alors prescrit en tant qu'amaigrissant.

Le Mediator a été commercialisé dans plusieurs pays, en Asie sous le nom de Mediaxal. Dans combien de pays exactement ? Avez-vous retiré le produit du marché partout en même temps ? Quels étaient les chiffres de vos ventes dans ces différents pays ?
Quelle est la part des dépenses consacrées respectivement à la recherche et au marketing chez Servier et dans l'industrie pharmaceutique en général ?
Je ne saurais dire dans combien de pays le Mediator a été commercialisé. Je rappelle d'ailleurs qu'il ne représentait que 0,7 % de notre chiffre d'affaires. Il a naturellement été retiré du marché partout en même temps. Contrairement à ce qu'on lit dans la presse, il n'a pas continué à être commercialisé en Chine : il ne l'a même jamais été ! C'est une copie qui a été mise sur le marché.

Le Sénat s'est saisi récemment du problème du trafic de faux médicaments.
Je ne sais pas non plus quelle est la part des dépenses de recherche et de marketing dans nos dépenses consolidées.

Il serait intéressant que vous nous communiquiez ces chiffres. Nous aimerions aussi savoir combien vous dépensez pour informer sur les effets secondaires des médicaments et lutter contre les accidents iatrogéniques.

Vous avez évoqué des fiches de suivi des visites médicales. Sont-elles archivées, et pour combien de temps ? Qui y a accès ? Comment utilisez-vous ces données, en général et pour le Mediator en particulier ? Le cadre a dû changer depuis l'origine. Il serait précieux pour nous de disposer des fiches vierges, pour constater l'évolution des questions, et des fiches remplies si elles existent encore.
N'importe qui a accès aux messages Hermès du CAM. Quant à nos données internes, elles sont informatisées depuis longtemps, sous la forme d'un fichier de médecins bien évidemment déclaré à la Cnil. Le Mediator n'occupait qu'une place secondaire dans les comptes rendus de visites ; il était d'ailleurs bien connu des médecins.
Lorsqu'un médecin demande un supplément d'information, le visiteur médical transmet sa demande à notre département d'information scientifique. Lorsqu'est signalé un effet indésirable, le message est transmis à notre service de pharmacovigilance, même si le médecin ne le demande pas ; cette procédure est parfaitement contrôlée. Les visites médicales sont d'ailleurs soumises à un système de certification, et des audits sont menés à échéance régulière sur leur organisation et leur fonctionnement.

Pourriez-vous nous transmettre le cahier des charges de cette certification ?
Bien sûr. Une nouvelle vague d'audits vient d'avoir lieu, et l'auditrice a donné un avis favorable à la reconduction de la certification des visites médicales de Servier pour la France.

En 1977, le professeur Roujansky vous a accusé d'avoir donné du Pondéral une présentation non conforme à la réalité pharmacothérapeutique. Il a saisi le Conseil de l'ordre et, je crois, écrit au procureur de la République. Que dites-vous de cette affaire ?
C'était au début de ma carrière, et les procédures devant le Conseil de l'ordre comme devant la justice ont abouti à un non-lieu.
Audition de M. Bernard Bégaud professeur de pharmacologie à l'université de bordeaux directeur de l'unité de recherche « pharmaco-épidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations »
Audition de M. Bernard Bégaud professeur de pharmacologie à l'université de bordeaux directeur de l'unité de recherche « pharmaco-épidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations »

L'audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur le site internet du Sénat et sur Public Sénat. Il me revient en application de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, de vous demander si vous avez des liens avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.
Je n'ai pas de liens avec de tels organismes ou entreprises, je préside seulement les conseils scientifiques de deux études menées par Lucien Abenhaïm, l'une sur l'homéopathie, l'autre sur le traitement de l'arthrose. Mais, à ce titre, je ne reçois pas d'honoraires des laboratoires et n'ai aucun lien ni conflit d'intérêts avec aucune firme.

Pouvez-vous nous donner des informations sur l'Association pour la recherche méthodologique en pharmacovigilance (ARME) ?
Sur le sujet, je ne fais aucun lien avec votre question précédente. Cette association a été créée en 1989 pour rechercher des méthodes plus efficaces en pharmacovigilance et nous tentons de les diffuser pour améliorer les connaissances et les pratiques. Pour ce faire, nous organisons des réunions de travail et publions des ouvrages, parfois à compte d'auteur. Cette association s'est bâtie, en opposition aux conflits d'intérêts, comme un modèle de collaboration entre l'industrie privée et le public, modèle qui pourrait être applicable en d'autres domaines. J'ai été président d'université et, à ce titre, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche m'a souvent poussé à nouer des partenariats avec le privé. Or, une affaire comme celle du Mediator fait que, lorsqu'un acteur du secteur public noue des liens avec le privé, il a quasiment l'impression de vendre son âme au diable. Personnellement, j'ai toujours pensé que - comme la coexistence de l'URSS et des Etats-Unis assurait l'équilibre pendant la guerre froide - il était important qu'en matière de pharmacovigilance deux pouvoirs, le public et le privé, assurent la paix sanitaire. S'il est normal que les industriels assurent leur propre pharmacovigilance, on ne peut leur abandonner la sécurité sanitaire, il leur faut le contrepoids d'une pharmacovigilance publique. J'ai donc toujours milité pour un travail commun entre les deux secteurs ; l'ARME a été créée dans ce but et sa composition est paritaire entre industriels et public. L'ARME - mauvais jeu de mots - a aussi été créée en réponse à un autre groupe, RADAR, fondé avec un pilotage uniquement industriel vers 1985 et dont l'objectif est de vendre l'idée que les risques des médicaments sont acceptables.

Vous dites n'avoir aucun lien d'intérêts mais vous présidez une association dont font partie, entre autres, AstraZeneca, GSK, Servier, Pierre Fabre, Roche, Sanofi Aventis, Lundbeck etc. De la part d'un pharmacologue dont on a dit qu'il est « l'un des plus indépendants », c'est surprenant. En outre, Lucien Abenhaïm en est membre d'honneur ainsi que Carmen Kreft-Jais, chef du département de pharmacovigilance de l'Afssaps, Patrick Le Courtois de l'Agence européenne du médicament, Marc Pierredon délégué pour la France d'une association mondiale financée par GSK, et, cerise sur le gâteau, le professeur Roger Salamon, président du Haut Conseil pour la santé publique. Tous ces gens sont certainement là dans l'intérêt général mais encore faut-il le démontrer. Et d'abord, les laboratoires paient-ils une cotisation ? La même pour tout le monde ?
Oui et, justement, une cotisation d'un montant fixe est toute différente du sponsoring d'un laboratoire qui donnerait ce qu'il veut. Personne ne tire avantage de sa participation à cette association et j'en suis le président à titre bénévole.
Elle est faite pour ça ! Voyez la liste des travaux que nous avons menés : il s'agit de pure méthodologie et je ne vois pas là le moindre conflit d'intérêtS, au contraire. D'autant plus que la FDA cite en premier ouvrage de référence le dictionnaire de pharmaco6épidémiologie que j'ai écrit pour ARME.
Il est extrêmement difficile d'arriver à ce que vous appelez l'indépendance. Dès lors que vous ne tirez pas d'avantages du privé et ne recevez pas de subsides du public, il est difficile de faire des recherches dans ce pays. Un exemple : alors que je suis co-fondateur d'une société internationale de pharmacologie, aujourd'hui, je ne peux plus me rendre à ses réunions qui me coûteraient dans les 2 000 euros lorsqu'elles ont lieu aux Etats-Unis. Dépenser pour cela les subsides qui me viennent de l'Inserm ou de l'université empêcherait de recruter un stagiaire de master 2. Je ne vais donc plus à ces réunions depuis plusieurs années. Et je n'ai jamais utilisé ARME pour y aller. Il faut y réfléchir lorsqu'on nous dit de ne pas travailler avec le privé.

Le problème n'est pas là. Il faut au contraire encourager les médecins à travailler avec l'industrie pharmaceutique. Mais le problème vient de ce que les mêmes médecins travaillent avec cette industrie et, en même temps, délivrent leurs avis aux autorités sanitaires.
Autre exemple : nous avons un dossier très sensible cherchant à déterminer si la prise, sur longue période, de benzodiazépines par des sujets âgés serait un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Il est impossible de lui trouver un financement ! Alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique majeur car, si le risque est avéré, ce sont plusieurs dizaines de milliers de cas d'Alzheimer qui pourraient être évités chaque année en France ! Eh bien, nous en avons été de notre poche... ARME est donc tout, sauf un conflit d'intérêts. Je suis fier qu'elle existe et, si c'était à refaire, je la referais à l'identique.

Donc, j'ai bien fait de vous amener à en parler. Dommage que vous ne l'ayez pas fait spontanément...
Je n'en ai pas parlé car ce n'est pas un conflit d'intérêts. J'ai cité la présidence des conseils scientifiques de deux études menées par Lucien Abenhaïm qui pourront donner lieu à compensation pour mon université ; cela rentre dans une définition du conflit d'intérêts qui est très large! Ce n'est pas du tout le cas de l'ARME. Que ce soit clair !

Avant le Mediator, il y avait eu l'Isoméride et le Pondéral. Avec Lucien Abenhaïm, vous aviez fait l'étude IPPHS, étude qui a marqué et à la suite de laquelle la prescription de fenfluramine a été restreinte, mais non supprimée, dans notre pays. Paradoxalement le médicament a alors été mis sur le marché aux Etats-Unis ! A cette étude s'est ajoutée celle du centre régional de pharmacovigilance de Besançon. Pensez-vous qu'il soit compatible d'être membre ou vice-président de la commission de la transparence et, en même temps, responsable d'une étude sur l'Isoméride ? Lorsque vous présentiez les résultats de l'IPPHS à la commission nationale de pharmacovigilance, quelle casquette portiez-vous ?
J'avoue qu'à l'époque, je ne me suis pas posé la question. Il était naturel que je sois membre du conseil scientifique de l'étude IPPHS parce que, à cette époque, j'étais assez connu internationalement dans le monde de la pharmacovigilance et, surtout, de la pharmaco-épidémiologie. En outre, je connaissais Lucien Abenhaïm depuis la fin des années quatre-vingt. Je n'étais pas, à l'époque, vice-président de la commission de pharmacovigilance. Avec le recul, je pense que ce n'était pas bon d'y rester aussi longtemps et c'est pourquoi j'en ai démissionné en 2000, après y être resté pendant dix-huit ans. En plus, je présidais le GEC (Groupe d'essais cliniques) et j'étais un expert sollicité par l'AMM ou la commission de transparence pour certains dossiers. Si j'avais été malhonnête, je tenais les laboratoires par tous les bouts... Mais ce n'est pas sain et, si c'était à refaire je ne cumulerais pas x mandats. J'ai été nommé vice-président de la commission nationale en tant que pharmaco-épidémiologiste, pour faire un duo avec le professeur Claude Labrousse qui, lui, était plutôt spécialiste de pharmacovigilance. Pour moi il n'y avait pas conflit d'intérêts parce que d'emblée, il avait été négocié qu'il y aurait un lien entre l'étude IPPHS et l'enquête officielle et on avait souhaité que je sois le lien entre les deux. Lucien Abenhaïm donnait tous ses cas à l'enquête Bechtel et l'en informait régulièrement. C'est lui qui a présenté l'étude IPPHS. Je n'étais pas là en 1994 pour présenter l'étude intermédiaire.

Le 10 mai 1994, vous participez à la réunion de la commission nationale de pharmacovigilance où le professeur Bechtel a présenté les premiers résultats de son enquête et vous avez eu tout loisir de consulter les cas, notamment les quatre cas où le Mediator avait été pris en même temps que de la fenfluramine. Cela ne vous a pas mis la puce à l'oreille ? .
Je ne me souviens pas très bien. A vrai dire je n'ai découvert que récemment - en écoutant votre audition du professeur Abenhaim - le rapport qui mentionne le Mediator. J'ai alors appelé la secrétaire de la commission de pharmacovigilance de Bordeaux pour vérifier. Effectivement, on y constate quatre observations, d'ailleurs manuscrites, où le Mediator est mentionné. En 1995, ces quatre observations apparaissent encore, mais la mention du Mediator n'apparaît plus que dans un cas, non pas dans ceux d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) mais dans la liste des décès. Je ne m'explique pas pourquoi, d'une année sur l'autre, le Mediator apparaît ou disparaît.
Pierre Bechtel a dû présenter des résultats globaux. Les laboratoires commercialisant les anorexigènes étaient invités, il a fallu les auditionner tous les treize. Le temps a sans doute manqué ensuite. Honnêtement, je n'ai donc découvert le Mediator qu'en 1995 lorsque, à la réunion du 18 mai de la Commission technique, il apparaissait au point 12 de l'ordre du jour. Nous demandons alors la mise en enquête du produit, non à cause d'un danger avéré, mais en vertu du principe de précaution, pour voir s'il était apparenté aux anorexigènes ou aux fenfluramines.
M. Bernard Bégaud. - Pas clairement.

Vous aviez enquêté sur l'Isoméride et le Pondéral qui sortaient du même laboratoire : vous n'aviez pas à chercher bien loin et pouviez voir que le Mediator n'est qu'un dérivé de la fenfluramine !
En 2011, cela peut en effet surprendre mais, à l'époque, le Mediator n'était pas connu des pharmacologues. Sans doute pour des raisons de stratégie marketing et pour ne pas concurrencer le Pondéral, le Mediator a été positionné dans deux classes où il n'aurait pas dû l'être - contre les dyslipidémies et le diabète - et non classé parmi les anorexigènes. C'était un produit prescrit par les généralistes libéraux - il ne l'a jamais été dans mon hôpital - et il était commercialisé surtout en France, alors que - on peut le regretter - nous travaillions surtout sur des ouvrages anglo-américains où il n'apparaissait pas dans les listings d'anorexigènes.

Pourtant, l'OMS le classe parmi les anorexigènes ! Tous les Orex sont des anorexigènes.
Je ne sais pas si le Mediator est un anorexigène, je le suppute, je n'ai pas travaillé dessus. En tout cas, en 1995, ce n'était pas évident.

Mais il n'est pas indispensable que vous ayez personnellement travaillé sur tous les produits ! On est bien obligé de se référer à des études ! Le fait est qu'il y en a eu - dont une dès 1974 - qui montraient que le benfluorex était un puissant anorexigène. En 1974 sont parus les résultats d'une étude sur le benfluorex - financée par Servier ! - dans Psychopharmacologia et ses conclusions sont très claires. Moi, lorsque j'exerçais, je me fiais aux études plutôt qu'aux visiteurs médicaux - même si cela a dû malheureusement m'arriver.
Je n'avais aucune raison personnelle de lire une étude Servier dans une revue que je ne connais pas et dans une discipline qui n'est pas la mienne. Les membres de la commission - dont le Mediator n'était pas l'unique préoccupation - se fiaient à ce qu'on leur disait. Lors du comité technique du 10 septembre 1998 - donc bien après cette étude - en point 4 de l'ordre du jour, on leur fait un exposé où il est dit « Les enquêtes pharmacodynamiques n'ont jamais montré un effet anorexigène du benfluorex ». L'OMS a fait classer ce médicament dans les Orex, mais pour les dyslipidémies et les diabètes.

Les membres de la commission technique de pharmacovigilance n'ont pas reconnu ce classement de l'OMS ?
On m'aurait dit en 1994 qu'il y avait un médicament orex, le benfluorex, qui est hypolipidémiant, j'aurais regardé plus avant. Mais on ne me l'a pas dit ! Avant cette fameuse réunion du 18 mai 1995, je n'avais jamais rencontré le Mediator ! A cette réunion, nous avons été très proréactifs puisque nous avons lancé l'enquête. D'une façon générale, on ne m'a jamais sollicité sur ce dossier et à aucun moment on ne m'a demandé mon avis sur ce produit ! Je n'ai donc pas de problème de conscience.

Mais aujourd'hui, doutez-vous encore de la nature anorexigène du Mediator ? Rassurez-vous, le professeur Alexandre est encore plus net : pour lui, le Mediator n'est pas un anorexigène, c'est un antidiabétique mal étudié...
Il faut dire que cette histoire de métabolite a été confuse. Il y a eu cette surprenante règle de trois : le Mediator, disait-on, c'est seulement 4 % de norfenfluramine, contre 33 % dans l'Isoméride ; donc c'est négligeable. C'était oublier que le Mediator, c'était 150 mg et l'Isoméride seulement 15. Donc, au total, la quantité de métabolite était exactement la même. Si c'est vrai que c'est le métabolite qui est actif...
Tout cela est encore bien polémique. Ma conclusion est que la pharmacologie de ce produit, pour ses propriétés et sa toxicité, ne doit pas être éloignée de celle de l'Isoméride et du Pondéral.

J'en reviens au télescopage entre l'étude IPPH et le rapport Bechtel. Ce dernier, dites-vous, vous a été remis le 10 mai 1994. Vous l'avez parcouru mais vous ne vous souvenez plus avoir noté que, parmi les HTAP imputables à la fenfluramine, il y avait quatre cas comportant aussi du Mediator. Cela vous a échappé ?
ette même commission recevait en même temps les résultats de l'étude intermédiaire IPPHS de Lucien Abenhaïm, laquelle concluait déjà à l'association entre la prise d'anorexigène ou de fenfluramine et la venue d'HTAP primitive. Or, lorsque vous avez, d'une part, une étude et, d'autre part, des notifications spontanées, vous regardez plutôt l'étude parce qu'elle permet une conclusion de causalité. J'étais davantage préoccupé par l'étude Abenhaïm qui provoquait des tensions avec le laboratoire. Et, comme quatre-vingt-quinze cas d'HTAP de l'étude Bechtel étaient dans l'étude Abenhaïm, il n'y avait aucun besoin de fouiller dans les notifications de cas, qui étaient moins précises que l'étude IPPHS. Ensuite, il n'était pas surprenant de voir mentionné quatre fois le Mediator, car un sur six des sujets traités à l'Isoméride ou au Pondéral avait soit un diabète, soit une hyperlipidémie. Cela ne faisait que quatre sur une centaine de cas.
Je ne sais pas. En gros 80 % des cas Bechtel se sont retrouvés dans l'IPPHS. Il faut aussi considérer « l'effet laboratoire » : quand vous prescrivez un produit Servier pour maigrir, vous avez aussi tendance à prescrire un produit Servier pour l'hyperlipidémie ou pour le diabète.

Alors que vous, quand vous étudiez les fenfluramines, vous n'en profitez pas pour étudier le Mediator ; pourtant, c'est aussi Servier !
Je plaide coupable. Si une personne devait le faire, c'est moi. Le professeur Abenhaïm n'est pas pharmacologue et il vivait au Canada où le Mediator n'était pas commercialisé. Et dans l'étude, on interrogeait les sujets principalement sur les anorexigènes ; lorsque j'ai demandé à la direction de la pharmacie et du médicament (DPHM) la liste des anorexigènes commercialisés en France, le Mediator n'y était pas ! Nous nous en sommes tenus à ce qui était officiellement cadré.

Vous n'avez pas été proactif vis-à-vis des fenfluramines et de leurs dérivés que produisait Servier. Le fait de trouver la présence du Mediator à côté de fenfluramines aurait pu vous intriguer et vous auriez pu vous interroger sur ce qu'était ce Mediator. Tout cela avait été bien mis en lumière dans le rapport de 1994 où c'était le seul médicament mentionné de façon manuscrite.
Cela n'aurait pas changé grand-chose. Dans l'IPPHS on interrogeait sur les anorexigènes mais aussi sur une centaine de médicaments qui étaient les cinq leaders de leur classe pharmaco-thérapeutique. Il est donc probable que les témoins ont été interrogés sur le Mediator et, si rien n'en est sorti, c'est qu'il n'y avait rien.

Dans le deuxième rapport de l'enquête sur les anorexigènes, du 28 avril 1995, la mention du Mediator avait disparu ! Vous l'aviez constaté ?
Je l'ai constaté après avoir entendu vos auditions. Je suis allé vérifier dans le rapport de 1995 : j'ai vu une mention du Mediator dans la liste des décès mais trois mentions du rapport de 1994 n'étaient pas reprises.

Plus troublant encore : dans l'annexe du rapport de l'Igas qui reprend le rapport de 1995, les pages où devraient se retrouver les cas qui ont pris de la fenfluramine et aussi du Mediator ont disparu ! Les rapporteurs de l'Igas ont donc eu en main un rapport incomplet sur la commission du 28 avril 1995...
Cette affaire de Mediator m'a atteint et je m'interroge : en 1995 y avait-il quelque chose à voir que je n'ai pas vu ? Je n'en suis pas sûr. Et je suis d'accord avec le professeur Jean-Pierre Bader : le drame du Mediator est avant tout une affaire d'AMM et de pharmacopée. Chronologiquement, c'est d'abord une affaire d'AMM. Le problème de pharmacovigilance est apparu plus tardivement. De toute façon on a été trop longs : dès 1999, l'affaire était jouée et on n'a retiré ce produit du marché que dix ans plus tard !
Oui et non. Je figure parmi les présents de la réunion mais je suis parti avant la fin. Le Mediator, qui n'est toujours pas une priorité, figure au point 8 de l'ordre du jour : c'est là qu'est rapporté le premier cas de HTAP dû au Mediator seul. En tout cas, 1999 est l'année charnière car s'ajoute alors le premier cas de valvulopathie, ce qui accrédite doublement la parenté pharmaco-toxicologique du Mediator avec les fenfluramines. A la réunion du 7 juillet 1999, je suis parti avant la fin et j'assume....

Si vous aviez été là, vous auriez pu mettre en application l'article sur la pharmacovigilance que vous avez rédigé pour le traité de pharmacologie du professeur Giroux, et où vous écriviez : « En pharmacovigilance, un seul cas peut, à la limite, suffire à démontrer la capacité que possède un médicament de produire un effet donné ». Si vous aviez été là, vous auriez pu arguer de cette publication pour faire suspendre le Mediator. Dommage que vous soyez parti trop tôt...
Le compte rendu de la réunion atteste de la présence de certains experts qu'on ne peut accuser de laxisme. A moins qu'ils ne soient eux aussi déjà partis à ce stade de la réunion. Le problème de ces réunions, c'est qu'on ne sait jamais à quelle heure a été débattue telle ou telle question ni combien de personnes étaient encore présentes. Il faudrait imposer que ces réunions soient...
Il faudrait qu'on sache qui était présent et qu'on exige un quorum pour chaque vote. Parce que, à partir de 17 heures, c'est la valse des adieux. Mais si les experts auxquels je pense étaient présents, très rigoureux, ils n'ont pu laisser passer la chose. Et, à la lecture du compte rendu, on se rend compte qu'on les a rassurés en leur annonçant, d'une part, que le dossier allait être confié au centre de spécialités pharmaceutiques (CSP), la pharmacovigilance européenne, où on peut compter sur la sévérité des Anglais et, d'autre part, que l'hôpital Antoine Béclère reprendrait tous les cas de HTAP pour les interroger sur leur prise éventuelle de Mediator. Dans ces conditions, je comprends que les membres de la commission ne se soient pas émus. Alors que cela aurait dû être le début de la phase critique pour ce produit, cela a été au contraire le début du grand sommeil.
J'étais surchargé. En 1995 je suis devenu chef du service de pharmacologie clinique à Bordeaux. J'étais vice-président de la commission. En 1997, j'ai été élu doyen de ma faculté de médecine. Les réunions de la conférence des doyens avaient lieu le jeudi, comme celles de la commission. J'en étais donc souvent absent et c'est pourquoi j'en ai démissionné en 2000. En pharmacovigilance proprement dite, j'étais accaparé par des dossiers qui ont été des combats, auxquels j'ai consacré beaucoup d'énergie, et le Mediator n'était pas parmi mes priorités. Je rappelle mon combat sur le vaccin contre l'hépatite B, étendu aux adultes alors qu'il ne devait viser que les enfants; j'ai tiré la sonnette d'alarme dès 1996 à propos des risques de sclérose en plaque. En 1997, on était en pleine polémique à ce sujet, en 1998, j'ai mené des études épidémiologiques et un bras de fer avec Bernard Kouchner et les médias. Puis j'ai fait face à d'autres grosses affaires, dont celle du Vioxx...
A l'époque, nous étions peu nombreux à dire que ces produits n'étaient pas la révolution qu'on prétendait. Les membres de la commission ont été rassurés par le fait que le Mediator n'était traité qu'au chapitre des questions diverses et que son dossier était transmis à l'Europe.

Maintenez-vous ce que vous préconisiez dans le traité de pharmacovigilance du professeur Giroud, à savoir qu'un seul cas suffit pour suspendre un produit ?
Quand il s'agit d'une maladie grave, d'un produit sans intérêt majeur et en présence d'éléments de plausibilité - par exemple le rapport entre fenfluramine et HTAP ou valvulopathie - un seul cas suffit en effet. Inutile d'attendre d'en avoir cinquante.

Et ne trouvez-vous pas étonnant la différence de traitement entre le rapport bénéfice-risque, pour lequel on émet toujours un avis qui présume de la positivité de ce rapport, et le retrait d'un médicament pour lequel on ne se contente pas d'une présomption mais exige que le risque soit avéré ? Ce déséquilibre est-il indépassable ?
Je suis d'accord avec vous. Une des raisons de la crise du Mediator réside dans les anomalies de fonctionnement de la commission de pharmacovigilance.qui a été affaiblie ; on lui a retiré beaucoup de ses prérogatives et elle ne délivre plus que des avis. On ne lui a confié que le risque et elle n'a pas le droit de statuer sur le rapport bénéfice-risque qui reste du ressort de la commission de l'AMM. Lorsque la commission de pharmacovigilance a fini d'instruire un dossier, elle le transmet à la commission de l'AMM, pour lui demander de bien vouloir juger du rapport bénéfice-risque. Cela s'appelle aller à Canossa, c'est très humiliant et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné.
Le rapport bénéfice-risque doit être évalué comme un tout, sinon l'exercice n'a aucun sens. Autre point choquant, on demande des preuves, toujours plus de preuves de la toxicité, toujours plus de cas, et l'on accumule le retard. Côté bénéfice, la démonstration est généralement claire - sauf ici, car seule était mentionnée une étude chez le rat pour le diabète et le Vidal, jusqu'en 2009, ne disait rien de la toxicité cardio-pulmonaire, rien de l'effet central...
On n'exige aucune vérification sur le terrain de l'efficacité du médicament. Elle est considérée comme acquise, tandis que la toxicité doit être démontrée. Lorsque M. Lucien Abenhaïm était directeur général de la santé, il m'a confié des missions ponctuelles, notamment la documentation sur l'intérêt en santé publique des médicaments. Il s'agissait de savoir si l'efficacité démontrée lors des essais cliniques se confirme dans les prescriptions réelles. Ce fut une volée de bois vert ! « C'est un scandale ! Qu'allez-vous chercher, l'efficacité a déjà été démontrée ! »
Un équilibre a été rompu. Il faut le retrouver.

Vous souhaitez donc que la commission de pharmacovigilance soit plus indépendante ? Que ses avis soient directement transmis au directeur général de l'Afssaps ?
Oui, quitte à ce que l'évaluateur de la commission de l'AMM soit présent pendant les réunions. Il est un médicament que je déteste, l'Equanil, un Mediator bis qui a tué autant et qui ne sert à rien puisque nous avons la benzodiazépine. Mais certains psychiatres expliqueront qu'il est utile pour quelques indications concernant les sujets âgés et la conclusion pourra alors être modulée. La commission n'est pas suffisamment instruite de ce qui se passe au plan européen. Son président ne va pas dans les instances européennes, ce sont les directeurs de l'évaluation qui s'y rendent. La commission a des prérogatives trop faibles.

Il faut renforcer le poids de la commission de pharmacovigilance. En cas de conflit entre les deux commissions, comme en 1997 sur le Mediator, on pourrait, cette suggestion a été formulée par l'un de ceux que nous avons auditionnés, réunir une commission mixte paritaire qui statuerait.
Cela s'est fait je crois une ou deux fois. C'est une bonne idée. Les commissions sont trop nombreuses, trop séparées, trop étanches. Il est curieux que le Mediator ait pu être interdit dans les préparations en 1995 mais non dans les préparations médicamenteuses, mais je ne suis même pas certain que les membres de la commission de pharmacovigilance en aient été informés !

Ils ne l'ont pas été car à l'époque la compétence appartenait à la direction générale de la santé.
Certaines décisions sont prises d'un côté, ignorées de l'autre. Il serait bon de corriger cela.

Vous avez réalisé de nombreuses études sur les psychotropes, notamment dans le cadre du rapport de la députée Maryvonne Briot. Ces propositions fort intéressantes sont presque toutes demeurées lettre morte.
Il en a été de même en 2006 pour le rapport que Mme Costagliola et moi-même avons rédigé sur l'état de la pharmacovigilance et de la pharmaco-épidémiologie, établi à la demande de la direction générale de la santé. Nous y décrivions une situation qui ressemble fort au cas du Mediator et nous estimions que si rien ne changeait, des affaires se produiraient.

Sur les psychotropes, mais aussi sur l'iatrogénie médicamenteuse, que vous avez beaucoup étudiée, quels messages avez-vous à nous communiquer ?
En 1998, nous avons réalisé une enquête nationale sur les effets indésirables des médicaments, responsables d'environ 18 000 décès par an. Il y a les médicaments qui tuent mais qui soignent et qui sauvent des vies, anti-cancéreux, anti-coagulants. Mais il y a aussi les erreurs de prescription et les médicaments qui n'ont pas d'efficacité thérapeutique majeure mais présentent un risque élevé. Je m'étonne du reste - je fus doyen de faculté de médecine, je dois me flageller aussi - que les étudiants en médecine en France soient si peu formés à la prescription médicamenteuse : leurs condisciples européens suivent dix fois plus d'heures d'enseignement en cette matière. Tout le monde est d'accord pour le déplorer mais aucune réforme de l'enseignement n'y a remédié, au contraire, on ne cesse de réduire le nombre d'heures !
Nous sommes les champions du monde des psychotropes, notamment la benzodiazépine : plus de 30 % des sujets âgés en prennent au long cours, alors que les médicaments en question sont recommandés en traitement de quelques semaines. Chutes, troubles du comportement, peut-être démence, l'impact est énorme. Mais il n'y a pas de pharmacovigilance proactive, on constate a posteriori les effets mais pourquoi ne s'interroge-t-on jamais sur la façon dont nous pourrions réduire la consommation de psychotropes en France ? Je ne sais ce qui ressortira des assises, des recommandations ; mais il y a un gros danger que l'on tue la pharmacovigilance actuelle pour le compte de quelqu'un. L'industrie pharmaceutique est très désireuse de reprendre du terrain mais je le répète, il faut préserver un équilibre entre la pharmacovigilance publique et celle assumée par les industriels.

Le rapport Even-Debré donne des chiffres impressionnants : 4 000 médicaments environ, mais seulement 1 120 molécules originales, dont 560 sans intérêt.
Comment se fait-il que les pharmacologues n'aient pas mieux connu le Mediator ? Sur 4 500 médicaments, un médecin en maîtrise 500, un bon pharmacologue 1 000 à 1 500. Parmi les médicaments que l'on ne connaît guère, il y a du ménage à faire...

Hélas, on n'y parvient jamais. Cela a pris dix ans de réduire le taux de remboursement de 835 produits de la liste des médicaments remboursables.
L'Euphytose a été déremboursée, ce qui se justifiait puisque ce somnifère doux n'avait pas fait l'objet d'études, mais cette suppression a entraîné des reports vers la benzodiazépine. Il ne faut donc pas procéder à la hache mais rester prudent. Le rapport Debré-Even ne fait pas dans la nuance...
J'ai parfois montré de la passion ; sur l'ARME, je persiste !