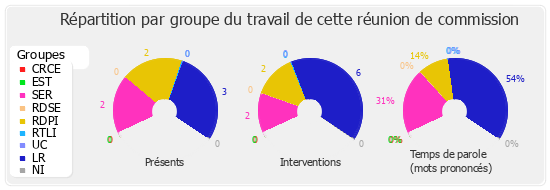Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 18 février 2016 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, après une audition généraliste sur la thématique des normes dans les outre-mer, le 28 janvier 2016, au cours de laquelle nous avons entendu les représentants de la Direction générale des outre-mer, nous abordons aujourd'hui le cycle d'auditions qui permettra d'instruire le volet de l'étude relatif aux normes sanitaires et phytosanitaires dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture. Le poids de ces secteurs est tout à fait majeur pour nos outre-mer en termes d'emploi et, au-delà des grandes cultures telles que la canne et la banane qui comptent parmi les rares productions à l'export, l'enjeu normatif est également tout à fait considérable pour les productions vivrières locales de plus en plus concurrencées par les importations de produits équivalents des territoires voisins sous l'appellation trompeuse de « produits locaux ».
La question des normes en matière agricole est une question complexe, et encore davantage s'agissant des agricultures ultramarines : il faut l'envisager du point de vue des producteurs et du point de vue du consommateur ; il faut aussi mesurer les enjeux pour le développement des économies locales et leur insertion dans leur environnement régional. À cette fin, il nous faudra nous intéresser aux processus de formation des normes sanitaires et phytosanitaires mais aussi vérifier si l'exigence normative pour les producteurs sur le territoire de l'Union européenne est de même intensité que celle qui s'impose aux produits extérieurs mis sur le marché communautaire. Il faudra enfin examiner la pertinence des outils censés assurer le respect des normes.
Pour instruire tous ces aspects, nos rapporteurs, Éric Doligé, Jacques Gillot et Catherine Procaccia, nous proposeront de nombreuses auditions et plusieurs visioconférences au cours des prochains mois. Je peux d'ores et déjà vous indiquer que les deux prochaines matinées d'audition se tiendront les jeudis 17 et 24 mars.
Madame, messieurs les rapporteurs, l'un d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole ?

Monsieur le délégué ministériel aux outre-mer, mesdames et messieurs, vous êtes les premiers à être auditionnés dans le cadre de ce nouveau cycle d'auditions. Nous vous écouterons avec intérêt avant de vous poser les questions que ne manqueront pas de susciter vos propos. Si le délai imparti pour cette audition ne nous permet pas de vous les poser toutes, nous vous les adresserons ultérieurement par écrit.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous indique dès maintenant que vous recevrez par écrit les réponses détaillées au questionnaire qui nous a été adressé.
S'agissant des grandes caractéristiques des économies agricoles des outre-mer, je peux vous apporter les éléments suivants.
En 2010, les 43 000 exploitations recensées des cinq départements d'outre-mer occupaient 131 600 ha, soit une superficie moyenne de 3,3 ha par exploitation. Ce résultat cache de grandes disparités entre les grandes plantations de canne à sucre à La Réunion et de banane aux Antilles et les petites exploitations de quelques ares à vocation vivrière que l'on trouve fréquemment à Mayotte et en Guyane.
Une partie seulement des agriculteurs exerce son activité à titre professionnel principal et bénéficie des aides publiques. Depuis 1988, nos analyses révèlent une réduction de 53 % du nombre des exploitations et une surface agricole utile (SAU) en diminution de 20 %, ce qui traduit une concentration des exploitations. Il nous faut mettre en évidence le cas particulier de la Guyane où l'agriculture est en développement avec une augmentation de 23 % de la SAU et de 33 % du nombre des exploitations, ce qui reste cependant modeste au vu des potentialités et de la croissance démographique du territoire, la première de France.
En 2010, pour les cinq départements d'outre-mer, l'emploi agricole représente 47 000 emplois annuels à plein temps dont 32 000 actifs familiaux et 8 000 salariés permanents. La tendance est à la baisse, sauf en Guyane où l'emploi agricole gagne 44 % depuis 1988.
En 2010, l'agriculture représentait 1,7 % du produit intérieur brut des cinq départements d'outre-mer (DOM) pour une valeur ajoutée évaluée à 735 millions d'euros. Si les grandes productions d'exportation, la banane, le sucre et le rhum, tirent toujours vers le haut les économies agricoles ultramarines, les productions végétales se diversifient et l'élevage se développe. On note un accroissement significatif du taux de couverture des productions de diversification végétale (cultures vivrières, fruits et légumes) et animales destinées au marché local. La croissance continue et forte de la population des DOM doit cependant être considérée comme un facteur atténuateur des effets mesurés. Les filières se structurent, particulièrement dans le domaine des productions animales à La Réunion et en Guadeloupe, où les interprofessions sont devenues des acteurs incontournables au bénéfice du consommateur local.
Vous trouverez dans les documents que nous vous ferons parvenir un certain nombre de chiffres révélant les tendances.
Vous avez souhaité connaître les ambitions pour l'outre-mer de notre ministère.
Le cadre politique que se fixe le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au regard des dynamiques en cours dans les secteurs agricole, agro-alimentaire, forestier et de la bio-économie se traduit par cinq ambitions pour les outre-mer :
- une production agricole, agroalimentaire, forestière et une bio-économie qui contribuent à la croissance économique des outre-mer ;
- une agriculture d'outre-mer qui rayonne et crée de la valeur par ses produits et ses services ;
- un secteur attractif avec des actifs qui bénéficient d'un revenu équitable ;
- une agriculture d'outre-mer résiliente et robuste ;
- une croissance économique qui pérennise les ressources naturelles des outre-mer.
Les soutiens du ministère ciblent ces objectifs pour appuyer les stratégies de filières qui ont été adoptées l'année dernière en conseil d'administration de l'ODEADOM et les plans régionaux d'agriculture durable adoptés localement.
Des indicateurs ont été définis qui permettront d'apprécier la réalisation de ces ambitions. Ils portent sur :
- la croissance annuelle du produit intérieur brut cumulé des secteurs agricole, forestier, agroalimentaire et de la bio-économie ;
- la croissance en valeur de la commercialisation des produits agricoles, forestiers et agroalimentaires bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) sur les marchés locaux et internationaux ;
- le revenu agricole moyen par actif par rapport à celui des autres secteurs économiques ;
- le nombre d'emplois directs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt et de la bio-économie ;
- le nombre d'exploitations et d'entreprises qui cessent leurs activités en raison de crises d'ordre sanitaire, climatique, environnemental ou économique.
Les cibles qui seront adossées à chacun de ces indicateurs sont en cours de définition.
En matière de différentiel de compétitivité des productions ultramarines, vous trouverez dans le document que nous vous ferons parvenir un certain nombre de chiffres sur les grandes cultures exportatrices. Nous avons réalisé une analyse de compétitivité, calculée au niveau de l'amont des filières banane et canne-sucre-rhum.
Pour cela, nous disposons des données comptables des exploitations, collectées via le Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA). À partir de ces outils, nous mesurons le revenu moyen des exploitations de canne et de banane des départements d'outre-mer.
Nous disposons également des données techniques via les enquêtes pluriannuelles « pratiques culturales » et « phytosanitaires ». Ces enquêtes sont réalisées auprès des producteurs par les services statistiques départementaux. Cet outil permet de disposer d'une connaissance actualisée des itinéraires techniques et de l'usage des produits phytopharmaceutiques, et ainsi de reconstituer les coûts de production.
D'autres sources de données existent au sein des filières et du CIRAD, qui communiquent régulièrement sur les différentiels de coûts de production, mais ces données ne sont pas toujours accessibles.
En ce qui concerne la compétitivité de la filière banane, les données du réseau RICA permettent d'estimer les principaux coûts de production des bananeraies en France. La main d'oeuvre représente environ 27 % des coûts de production, contre 17 % pour le transport et 8 % pour les emballages. À titre de comparaison, le salaire d'un employé de bananeraie est 15 fois moins élevé en Afrique et en Amérique centrale qu'en France. De plus, les normes nationales engendrent des surcoûts non compensés par les prix, compte tenu de la libéralisation des normes économiques européennes.
Pour la filière canne à sucre, l'analyse comparée de la compétitivité des exploitations de canne ultramarines avec les exploitations spécialisées de grandes cultures en métropole s'avère inopérante compte tenu de la différence de taille. Les exploitations betteravières en métropole représentent 20 à 30 fois la taille moyenne d'une exploitation cannière des DOM et des différences importantes existent dans les systèmes de production et la conduite des exploitations. Toutefois, nous essayons d'objectiver au maximum les données dont nous disposons.
Nous analysons également la compétitivité au niveau de l'aval de la filière canne-sucre.
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dispose des données relatives aux coûts de production de l'industrie ultramarine et de la valorisation économique des sucres (prix de vente, coûts de transformation, d'achat, de transport, montant d'aide reçu...) qui permettent d'estimer les marges opérationnelles des entreprises sucrières.
Des comparaisons sont également possibles pour des débouchés équivalents (sucre blanc) avec la filière betterave-sucre qui fait l'objet d'un suivi approfondi, notamment dans la perspective de la fin des quotas sucriers en 2017.
L'analyse comparée des coûts de production avec des pays tiers (Brésil, PMA) qui sont en concurrence directe avec les DOM sur leurs débouchés (sucres destinés au raffinage, sucres roux) est compliquée, les données des pays tiers étant plus difficilement accessibles, à l'exception de celles du Brésil. Avec les données dont dispose la filière betteravière sur les coûts au Brésil, on peut estimer que les coûts de production (achat de matière première et coûts de transformation, hors coûts de transport et de raffinage) sont trois fois plus élevés dans les départements d'outre-mer qu'au Brésil.
Les estimations d'écarts de compétitivité conduisent le ministère à porter une demande d'exclusion des sucres spéciaux à chaque début de mandat de négociation. On notera toutefois que les sucres spéciaux, comme la banane et le rhum, peuvent se trouver moins prioritaires que d'autres productions agricoles hexagonales qui ont aussi des intérêts défensifs à faire valoir.
S'agissant des accords avec le Vietnam, par courrier en date du 10 février 2016, la Commission européenne a informé la France de l'exclusion de la ligne tarifaire 1701 1490 du contingent tarifaire de 20 000 tonnes agréé par le Vietnam et de l'ouverture d'un contingent tarifaire séparé de 400 tonnes sur la même ligne tarifaire.
Nous serons vigilants pour les négociations à venir avec le Mexique.

Pourriez-vous nous apporter des informations complémentaires sur l'accord avec le Vietnam ?
C'est à la suite d'une intervention politique que nous avons obtenu l'exclusion de la ligne tarifaire 1701 1490 et l'ouverture d'un contingent tarifaire séparé de 400 tonnes.
Vous nous avez demandé des exemples concrets de normes ou de procédures qui pénalisent les producteurs ultramarins.
En matière de productions végétales, plusieurs filières agricoles sont caractérisées par un faible choix ou par l'absence de produits phytopharmaceutiques homologués et adaptés aux contextes des outre-mer. Seuls 29 % des usages phytosanitaires sur cultures tropicales étaient couverts en 2013, ce qui reste très insuffisant pour garantir la sécurité des récoltes des producteurs et relancer certaines filières.
Les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés sont généralement adaptées à un usage en climat tempéré. Ainsi, le nombre maximal d'applications est-il défini sur une période végétative plus courte que celle qui est propre au climat tropical. Une réduction des doses, couplée avec une augmentation de la fréquence de traitement, permettrait d'adapter les conditions d'utilisation à des périodes végétatives plus longues.
L'importance des usages non couverts dans les DOM participe à générer des distorsions de concurrence avec les producteurs de cultures tropicales des pays tiers qui peuvent avoir accès à des itinéraires techniques recourant à des traitements chimiques non disponibles pour les agriculteurs ultramarins.
La problématique des usages mineurs est traitée dans les Réseaux d'innovation et de transfert agricole (RITA) et du plan ECOPHYTO. Ainsi, les informations indispensables aux extensions d'usages sont recueillies en lien avec la profession agricole et les instituts techniques. Un réseau dédié aux cultures tropicales a été mis en place dans les DOM. Il est constitué des Centres Techniques de la Canne et du Sucre (CTCS) de Martinique et de Guadeloupe, de l'ARMELFHOR et, depuis le début 2014, de ERCANE à La Réunion.
Le lien établi avec les sociétés phytosanitaires détentrices des produits testés permet de préciser avec elles les modalités de demande d'extension d'usages sur les cultures tropicales. Chaque année, des programmes d'expérimentation sont menés pour permettre de proposer de nouvelles extensions. L'objectif est d'atteindre un taux de couverture de 49 % fin 2016.
Vous trouverez dans les documents que nous vous ferons parvenir des chiffres sur la canne, la banane et les cultures de diversification.
L'étroitesse des marchés correspondants n'incite pas les opérateurs à engager les démarches nécessaires à l'homologation de produits au niveau national ou de substances actives au niveau européen. Cependant, l'article 51 du règlement (CE) 1107/2009 prévoit des dispositions applicables aux extensions d'autorisations pour des utilisations mineures.
Dans le cas de situations d'urgence phytosanitaire, l'article 53 du même règlement permet des autorisations de mise sur le marché d'une durée maximale de 120 jours qui restent délivrées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles concernent les cultures à impact économique majeur dans les DOM.
Des solutions innovantes sont à développer avec la recherche et dans le cadre des actions Ecophyto, afin de proposer des itinéraires techniques efficaces et économes en produits phytopharmaceutiques de synthèse.
Le ministère travaille au développement du bio-contrôle en relations étroites avec les interprofessions.
En matière de productions animales, les normes sanitaires européennes en élevage (porcins notamment) ou à l'abattage, sont plus exigeantes que dans les pays tiers. Des contraintes d'investissements supplémentaires et des frais de gestion administrative s'ajoutent aux mesures anticycloniques.
Les exigences sanitaires d'essence européenne peuvent avoir un effet négatif sur les productions animales locales.
Je m'attarderai un instant sur la filière banane biologique.
Trois spécialités commerciales sont autorisées en France pour le traitement des cultures de bananes biologiques. De la banane biologique en provenance des Antilles, et de la Martinique en particulier, est commercialisée depuis octobre 2015.
À titre de comparaison, la République dominicaine autorise dans le cas de la culture de banane biologique vingt-cinq spécialités commerciales en pré-récolte et huit en traitement post-récolte. De plus, quatorze spécialités commerciales autorisées en République dominicaine ne correspondent à aucune catégorie européenne.
Par ailleurs, les normes françaises et européennes, notamment environnementales et sociales, sont bien supérieures aux normes des pays africains et latino-américains qui sont les principaux concurrents des producteurs ultramarins.
Vous nous avez demandé des précisions sur les modalités de la participation du ministère de l'agriculture à l'élaboration des normes sur les productions agricoles et l'alimentation.
Au niveau international, dans le cadre des négociations d'accords commerciaux, la conduite des négociations est une prérogative exclusive de la Commission européenne. Les autorités françaises soutiennent la Commission dans la réalisation de ces négociations.
Ainsi, nous participons aux négociations multilatérales et suivons les travaux des instances normatives, au niveau de la convention internationale sur la protection des végétaux, du Codex alimentarius et de l'Organisation mondiale de la santé animale.
Au niveau européen, le ministère participe à l'élaboration de la législation et de la réglementation européenne. Sur les questions sanitaires et phytosanitaires, la plupart des règles sont harmonisées. Les questions laissées à la subsidiarité des États-membres sont peu nombreuses.
Le ministère est également chargé de transposer en droit national les directives de l'Union européenne. Cette transposition doit se faire dans des délais souvent contraints, sous peine de se voir infliger des astreintes qui peuvent être très pénalisantes. Les États-membres jouissent d'une certaine latitude dans ce processus de transposition. Ils peuvent ainsi tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques nationales, ce que nous faisons pour les outre-mer.
Toutefois, le nombre d'adoption de directives dans les domaines sanitaires et phytosanitaires étant de moins en moins important, la prise en compte des particularités des RUP doit être envisagée dès l'élaboration du droit au niveau européen.
En matière d'environnement normatif phytosanitaire, dans l'exercice de construction des normes au niveau européen, l'impossibilité d'adopter pour les outre-mer un modèle de fonctionnement fondé sur une libre circulation des végétaux sous « passeport phytosanitaire européen » a été démontrée à la Commission. Cela a entraîné un retrait total de la réglementation des départements d'outre-mer du règlement européen dédié à la santé des végétaux. Le cadre réglementaire national de 1990-1991 adapté aux contraintes locales a été maintenu. Cela permet une meilleure protection des conditions de production agricole dans les outre-mer.
Un arrêté est prévu par le ministère chargé de l'agriculture afin de catégoriser les parasites dans les départements d'outre-mer. Cela nous facilitera la définition des priorités pour les programmes de lutte.
Le cadre juridique des contrôles à l'importation dans les outre-mer, tant pour les produits originaires de l'UE métropolitaine que des pays tiers, est constitué par un arrêté ministériel de 1991.
À cet arrêté s'ajoute, pour les seules importations provenant des pays tiers, les dispositions de la directive 2000/29/CE, transcrites dans le droit français par un arrêté datant de 2006, qui ont été rédigées en fonction des seules conditions environnementales et agricoles du continent européen.
Un nouveau règlement sur la santé des plantes est en cours d'élaboration par les instances de L'UE. Il devrait être adopté dans le courant de 2016.
Profitant de cette refonte, le ministère chargé de l'agriculture a décidé de libérer les outre-mer des contraintes de la législation européenne qui sont inadaptées à leur situation.
Afin de faire profiter les outre-mer de la même stratégie préventive qui sous-tend le système des contrôles à l'importation mis en place par le prochain règlement de l'UE, un arrêté ministériel spécial aux outre-mer est prévu. Il prendra en compte l'évolution de la situation des outre-mer depuis 1991 ainsi que le territoire de Mayotte, désormais département d'outre-mer.
En matière d'environnement normatif de l'alimentation, je rappelle que le droit européen en matière sanitaire et phytosanitaire est applicable à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, hors dispositions particulières définies dans le code rural.
Des évolutions du cadre juridique national sont en cours :
- en matière d'équarrissage, les outre-mer bénéficient de certains aménagements qui figurent dans une ordonnance en attente d'examen par le Conseil d'État ;
- la catégorisation des dangers sanitaires animaux dans les départements d'outre-mer, prévue par l'ANSES pour la fin 2016, permettra de déployer dans les DOM des gestions plus proportionnées à leurs particularismes.
Par ailleurs, les mises aux normes européennes en matière de bien-être animal n'ont pas posé de difficultés majeures. Seule Mayotte a bénéficié d'une dérogation officielle pour la mise aux normes afférentes aux poules pondeuses.
La sécurité sanitaire des aliments n'est pas négociable puisqu'elle est fondée sur une analyse des risques et il ne peut y avoir de niveau d'exigence différent de santé publique en fonction du territoire.
En revanche, le paquet réglementaire européen (« paquet hygiène ») prévoit une flexibilité des exigences pour les petites structures, les petites quantités et les courtes distances, qui s'applique de fait aussi bien en outre-mer qu'en métropole.
Les principaux problèmes d'application rencontrés dans les départements d'outre-mer par les inspecteurs de la direction générale de l'alimentation (DGAL) portent sur l'abattage clandestin, qui peut mettre en danger la santé du consommateur par défaut d'inspection sanitaire.
Mayotte a bénéficié d'un délai pour l'équarrissage, le temps de construire les outils d'élimination des sous-produits animaux et d'un délai pour la mise aux normes de l'abattoir. Un abattoir pour les bovins devrait être réalisé dans un délai maximum de deux ans.
En ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires par rapport aux pays tiers, la DGCCRF précise qu'il y a trois niveaux de réglementation selon que la denrée est produite en France, dans l'Union européenne ou dans un pays tiers :
- pour les denrées en provenance de pays tiers, seules les limites maximales résiduelles (LMR) sont opposables. Une LMR « par défaut » est fixée (à un niveau très bas) et opposée aux produits importés pour toute substance active non approuvée au niveau de l'UE ou non autorisée en France ;
- les denrées en provenance de pays de l'Union européenne doivent respecter les LMR et ne pas contenir de résidus de substances actives non autorisées ;
- les denrées d'origine française doivent respecter les conditions précédentes et ne pas avoir été traitées avec un produit phytopharmaceutique (PPP) n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l'usage considéré. En effet, les délivrances d'AMM prennent en compte d'autres critères que la santé du consommateur (effets sur la pollution des sols par exemple) difficilement opposables à des pays tiers. Les AMM doivent de plus avoir fait l'objet d'une demande de la part des fabricants de PPP.
L'analyse des taux de non-conformité observés dans les plans de surveillance « fruits et légumes » fait apparaître, sur les trois dernières années, des taux systématiquement supérieurs pour les produits en provenance des pays tiers. Par exemple, le taux de non-conformité des légumes contrôlés dans le cadre du plan de surveillance s'élevait à 3,3 % en 2014 (contre 1,6 % en moyenne).
L'Union européenne a mis en place des contrôles renforcés à l'importation qui ciblent certaines denrées en fonction de leur pays d'origine. Dans ce cadre, 789 prélèvements ont été effectués en 2014 pour un taux de non-conformité de 6,5 %.
En matière de réciprocité et d'équivalence des normes agricoles de protection entre l'Union européenne (UE) et les pays tiers, le cadre juridique défini est le suivant :
- les producteurs ultramarins doivent respecter les normes de production de l'UE. En ce qui concerne les importations, le principe est d'exiger les mêmes garanties sanitaires et phytosanitaires que celles exigées au sein de l'UE. De plus, les contrôles à l'importation visent à empêcher toute introduction de parasites nouveaux qui obligeraient les agriculteurs à prendre des mesures d'éradication très coûteuses ;
- en vertu des accords Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) signés sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, les pays tiers s'engagent à respecter les normes sanitaires et phytosanitaires de l'UE pour les produits qu'ils exportent vers elle. Dans le cadre de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), les pays membres de l'OMC sont aussi tenus de notifier l'adoption de normes agricoles. La France est donc informée des mesures mises en place par les pays tiers ;
- en ce qui concerne les animaux et les produits animaux, chaque pays tiers doit être autorisé par l'UE pour chaque filière d'exportation. Pour cela, il doit s'engager, entre autre, à mettre en place des plans de surveillance sanitaire en conformité avec les dispositions de l'UE. De plus, pour les produits animaux, chaque établissement doit être également autorisé par l'UE. L'émission d'un certificat sanitaire par le pays tiers garantit le respect de ces conditions pour chaque lot exporté ;
- en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux, le respect des normes portant sur la santé humaine est fondé sur un plan de surveillance à l'importation mis en place par l'UE, qui implique des prélèvements pour analyse en laboratoire par sondage selon des analyses de risques par filière d'importation. Pour un certain nombre de végétaux, un certificat phytosanitaire émis par le pays tiers garantit qu'une inspection a été conduite en vue de vérifier la conformité aux normes européennes du lot exporté.
Au niveau européen, la Commission européenne organise des audits réguliers tant au sein des États-membres de l'UE que des pays tiers, en vue de vérifier leur respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l'UE.
En 2015, 221 audits ont été organisés. Cependant, seuls 60 (un quart environ) se sont déroulés dans les pays tiers, les 161 restant visant les États-membres (8 pour la France). À plusieurs occasions, la France, comme certains autres États-membres, a demandé à la Commission que le nombre d'audits dans les pays tiers soit significativement augmenté.
Au niveau national, la vérification du respect des exigences de l'UE par les pays tiers se fait à deux niveaux. Les lots importés sont soumis à un contrôle avant leur introduction dans le territoire de l'UE, principalement les ports et aéroports. Ce contrôle s'effectue dans :
- des postes d'inspection frontaliers (PIF) pour les animaux et produits d'origine animale ;
- des points d'entrée désignés (PED) pour les végétaux, produits végétaux et certains autres produits, comme les vitamines, lorsqu'il s'agit de veiller à la santé humaine et animale ;
- des points d'entrée communautaires (PEC) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, dès qu'il s'agit de veiller à la santé des végétaux.
Les contrôles dans les PIF, les PED en ce qui concerne la santé animale et les PEC sont effectués par des agents relevant du ministère chargé de l'agriculture (DGAL/SDASEI/Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire - SIVEP).
Les contrôles dans les PED concernant la santé humaine sont effectués par des agents relevant du ministère chargé de l'économie (DGCCRF).
Pour le contrôle des végétaux à l'importation, la publication d'un arrêté spécifique aux départements d'outre-mer, indépendamment de la législation de l'Union européenne, permettra d'appliquer le principe de réciprocité avec les pays tiers en ce qui concerne les échanges propres aux DOM.
Le Marché unique a déplacé le contrôle sanitaire et phytosanitaire des importations agricoles et animales aux limites de l'Union européenne et instauré des points de contrôle obligatoires à l'entrée du territoire européen. Les importations d'animaux, de végétaux et de leurs produits en provenance de pays tiers à l'Union européenne doivent être présentées dans des postes frontaliers disposant des installations nécessaires à l'inspection et des personnels compétents.
Par principe, les conditions sanitaires et phytosanitaires applicables aux marchandises importées en provenance des pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché de l'Union européenne. Les critères sont définis par des textes européens ou, à défaut, par des textes nationaux. C'est quasiment l'ensemble des conditions d'importation qui sont harmonisées au niveau européen.
Une fois accepté aux postes frontaliers français, un lot peut circuler dans l'intégralité du territoire de l'Union européenne, en vertu du principe de libre circulation des biens.
Par arrêté du 28 décembre 2009, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a créé le SIVEP, service à compétence nationale chargé de l'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières.
Afin de tenir compte des contraintes naturelles des départements d'outre-mer et de leur éloignement géographique, la réglementation vétérinaire de l'Union européenne laisse le choix aux départements d'outre-mer d'appliquer les mêmes règles que la métropole ou de bénéficier d'un régime dérogatoire (dit « Régime des RUP »).
Le régime dérogatoire interdit toute possibilité de réexpédier les produits importés ou leurs dérivés vers le reste de l'UE. Depuis 2011, la situation des départements d'outre-mer est la suivante : La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte ont choisi l'option RUP et La Réunion a un agrément de l'Union européenne pour 2 PIF.
Le caractère dérogatoire du dispositif ne concerne que la conformité des installations de contrôle du poste d'inspection frontalier (PIF). Ainsi, les collectivités locales, les professionnels ou les autorités portuaires et aéroportuaires souhaitent aujourd'hui pouvoir se dégager des contraintes inhérentes au plan RUP.
Vous avez souhaité que nous vous précisions les modalités pratiques de contrôle.
Les contrôles vétérinaires des animaux et produits d'origine animale visent un double objectif : protéger la santé humaine contre des infections, maladies zoonoses ou contaminations chimiques, d'une part, préserver la santé animale, d'autre part.
Ces types de contrôle sont assurés exclusivement par la DGAL.
Les contrôles phytosanitaires visent pour leur part à :
- préserver la santé humaine contre les infections ou les contaminations chimiques. Ce type de contrôle est assuré par la DGCCRF ;
- s'assurer de la santé des végétaux en vue de protéger l'environnement et l'agriculture. Ce type de contrôle est assuré par la DGAL.
Les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour l'importation des animaux vivants et des produits d'origine animale en provenance des pays tiers sont définis par les directives 91/496/CEE du 15 juillet 1991 et 97/78/CE du 18 décembre 1997. En droit français, ces directives ont été transposées par les arrêtés du 5 mai 2000 et du 19 juillet 2002, textes eux-mêmes fondés sur les articles L. 236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Les contrôles aux frontières s'appliquent de manière systématique à l'ensemble des animaux vivants et des produits d'origine animale, qui doivent provenir de pays et d'établissements préalablement autorisés à exporter vers l'Union européenne et être accompagnés d'un certificat sanitaire correspondant à un modèle préétabli au niveau européen et validé par l'autorité compétente du pays d'origine.
Ils sont réalisés dans les postes d'inspection frontaliers agréés par la Commission européenne, dont sept dans les DOM.
S'agissant des contrôles phytosanitaires des végétaux et des produits végétaux, les États-membres, en application de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000, ont l'obligation d'effectuer le contrôle de certains végétaux et produits végétaux présentant un risque phytosanitaire. Cette directive a été transposée par les articles L. 251-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du 24 mai 2006.
Les contrôles aux frontières s'appliquent à certains végétaux ou produits végétaux présentant le plus de risques. Pour être admis sur le territoire, ces végétaux et produits végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire défini selon l'espèce végétale, son traitement et son pays d'origine.
Le contrôle documentaire systématique est accompagné d'un contrôle d'identité également systématique et d'un contrôle physique dont la fréquence est déterminée par le niveau de risque phytosanitaire.
Concernant les denrées végétales, il n'existe pas de listes de pays ou d'établissements autorisés ; en revanche, des interdictions touchent certains pays qui ne peuvent pas exporter certains de leurs produits.
Les marchandises sont contrôlées dans les 33 points d'entrée communautaires (PEC) installés en France, dont 11 dans les DOM.
Les contrôles des aliments pour animaux d'origine non animale sont définis par les règlements (CE) n° 882/2004 et n° 669/2009. Ils fixent les modalités de contrôle d'importation des produits d'origine non animale, dont ceux destinés à l'alimentation des animaux. L'inspection comporte un contrôle documentaire systématique et un contrôle physique dont la fréquence est déterminée par le niveau de risque du produit et son origine.
Les lots sont contrôlés dans des points d'entrée désignés (PED), au nombre de 19 sur le territoire français, dont 4 dans les départements d'outre-mer.
À l'issue du contrôle à l'importation, en cas de conformité du produit, l'inspecteur en poste frontalier délivre une attestation de contrôle dite document commun d'entrée attestant de la conformité des marchandises. Ce document permet le dédouanement des produits et leur mise en libre pratique.
En matière de respect des contingents et des quotas fixés pour les pays tiers, la direction des douanes précise que les importations de produits agricoles (en provenance de pays tiers ou de métropole ou d'un autre DOM) sont soumises à la présentation d'une déclaration en douane (DAU).
Un certificat d'importation est exigé à l'appui de la DAU lors de l'importation des produits agricoles repris à l'annexe II - partie I du règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008.
Les certificats d'importation sont délivrés par FranceAgriMer.
Les importations de produits agricoles soumis à certificat font l'objet d'une surveillance particulière de l'administration des douanes, compte tenu des risques de fraude identifiés à la fois par la Commission européenne et par les services douaniers.
Le contrôle effectué vise à vérifier que l'importation de ces produits, considérés comme sensibles, est autorisée et, le cas échéant, si l'importation peut être réalisée sous couvert d'un régime préférentiel. Certains produits agricoles bénéficient en effet de mesures tarifaires préférentielles d'importation du fait d'accords conclus entre l'Union européenne et des pays ou groupes de pays ou de mesures qui sont accordées unilatéralement par l'Union européenne en faveur d'autres pays.
Certains produits agricoles peuvent également être importés dans le cadre de contingents tarifaires.
Dans la cadre du POSEI, les opérateurs qui souhaitent réaliser ces opérations dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement doivent être enregistrés dans la base de données CALAO gérée par l'ODEADOM. Chaque importation est réalisée sous couvert d'un certificat d'importation, d'exonération ou d'aide délivré par l'ODEADOM et présenté aux autorités douanières.
Il y a, dans ce cas-là, un contrôle des contingents tarifaires fixés au niveau européen. Dans le cas des contingents, il y a aussi des contrôles automatisés.

Merci Monsieur le délégué, pour cet exposé très complet que nous lirons dans son intégralité avec grand intérêt. Permettez-moi cependant de vous interrompre afin que les rapporteurs et mes collègues aient le temps de vous poser quelques questions.
Si vous nous résumiez le tout, diriez-vous que tout va bien, que tout va mieux, que tout va s'améliorer ou qu'il n'y a pas de problèmes ?

Vous nous avez apporté tellement d'informations qu'il nous est difficile d'avoir immédiatement une vision synthétique des enjeux.
J'ai l'impression d'avoir compris qu'il y avait une progression dans la mesure où les particularités des outre-mer commencent à être prises en compte dans la réglementation européenne et le seront davantage encore en 2016. Est-ce exact ?
Avez-vous une évaluation du surcoût des normes sur la banane, la canne à sucre, l'agriculture en général ?
La banane bio et la banane durable procèdent-elles de la même filière ? Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous nous donner la part des filières bio et durable par rapport à la banane totale aux Antilles ?

Je partage l'analyse de ma collègue.
Auriez-vous des exemples concrets de normes ou de procédures qui pénalisent les producteurs ultramarins par rapport à leur environnement régional ?
De quels moyens le ministère dispose-t-il pour s'assurer que les contrôles sont efficients ? À mon avis, ils ne sont pas totalement adéquats.
Nous allons nous répartir les réponses en fonction de nos compétences techniques.
Comme vous le disait M. Joly, lorsqu'il s'agit de transposer une directive, nous nous soucions de l'adapter - si nécessaire - pour l'outre-mer. Mais de plus en plus, nous sommes face à des règlements, d'application immédiate, avec une marge de négociation a posteriori moins importante. Il nous faut donc anticiper et insister sur la prise en compte des spécificités de l'outre-mer avant le vote des règlements.
Il y a deux discussions. Sur la question de la santé publique, de la sécurité de l'alimentation et de la protection animale, la France a fait le choix qui me semble légitime de considérer que les normes devaient être les mêmes quel que soit le territoire concerné. Au-delà de ce postulat de base, il est entendu que, sans qu'il y ait de dispositifs réglementaires spécifiques ou de dérogations, nous pouvons être amenés à aménager les délais ou à donner des flexibilités dans le temps ou pour l'aménagement des infrastructures afin d'arriver au même résultat. Je pense, en matière de bien-être animal, aux poules pondeuses ou aux abattoirs.
M. Denis Allex va compléter mon propos pour les aspects phytosanitaires.
Par aspect phytosanitaire, j'entends la santé des plantes. La situation est un peu différente. L'objectif est de maintenir le même niveau d'exigence mais avec des objectifs qui sont adaptés à la situation des départements d'outre-mer. À l'heure actuelle, le contrôle des végétaux à l'importation est défini par une directive dont la rédaction initiale date de 1977 et un arrêté d'adaptation aux départements d'outre-mer de 1991 qui souffre d'être ancien. Le défaut de ce référentiel est de ne pas permettre d'anticiper. On attend que des problèmes arrivent pour ensuite légiférer. L'exemple sans doute le plus flagrant est celui de la bactérie Xylella Fastidiosa qui pose d'énormes problèmes dans le sud de l'Italie et en France. On savait que le Costa Rica, qui exporte beaucoup de plantes, était touché par cette maladie. Sans que l'on puisse en apporter la preuve, il nous l'a probablement envoyée. On a alors interdit les exportations du Costa Rica. Ce principe n'est pas efficient pour l'Europe et les départements d'outre-mer.
Face à cette situation, on se retrouve devant l'échéance de 2016 pour le règlement sur la santé des végétaux. Par le passé, la France a tenté sans succès de faire remonter les problématiques des départements d'outre-mer au niveau de l'Union européenne. En conséquence, elle a demandé leur exclusion du champ de ce règlement et de pouvoir légiférer de manière indépendante.
Pour l'instant, personne n'a contesté ce point.
Un deuxième point pourrait intéresser les départements d'outre-mer. Il s'agit de la stratégie préventive. Elle consiste à réévaluer les filières d'importation avant de les autoriser. Ce principe sera appliqué au futur règlement. Le choix des institutions françaises a été de dire qu'un arrêté spécial serait rédigé pour les départements d'outre-mer. Nous sommes en train de travailler sur cet arrêté et je ne crois pas trop m'avancer en prévoyant une parution pour 2017. Bien évidemment, il respectera les principes de démarche préventive de la loi de santé végétale européenne.
Je reviens sur la question des normes qui pénalisent les producteurs ultramarins, au coeur de vos préoccupations.
Depuis trois ans, je travaille à la direction générale de l'alimentation. Comme dans toutes les directions, chaque année, il y a des dialogues de gestion. Chaque directeur régional de l'agriculture est amené à venir et à exposer pendant une à deux heures les problématiques dans le champ global de la direction. Il en suit des discussions et des négociations. J'ai relu les comptes rendus avant de venir aujourd'hui. À part la problématique de l'adaptation des traitements phytosanitaires aux départements d'outre-mer, je n'ai pas identifié d'inquiétudes des directeurs régionaux de l'agriculture. La problématique de la leucose bovine à La Réunion, qui n'était pas correctement catégorisée pour déclencher les aides adéquates, a été soulevée mais elle a été résolue à la suite de la saisie de Comité national de santé animale. Le dernier exemple concerne Mayotte qui nous avait alertés sur les poules pondeuses, son abattoir et l'équarrissage. Les dispositions ont été adaptées. Je n'ai pas d'autres problématiques à vous soumettre aujourd'hui.
Ils peuvent nous saisir directement sur une question particulière quand ils ont un motif d'inquiétude. Nous sommes également saisis par des sénateurs. Il y a des discussions régulières entre la direction générale à l'alimentation et les syndicats professionnels représentatifs. Historiquement, le ministère de l'agriculture a toujours été proche de ces filières professionnelles. Un dialogue en amont de l'élaboration des textes est souvent noué.
Vous nous avez interrogés sur les effectifs. Je vais vous répondre sur le volet qui correspond au domaine de compétence de mon service de contrôle des importations. À la fois pour l'outre-mer et pour les postes frontaliers dans les DOM, l'effectif des inspecteurs qui réalisent des contrôles à l'importation vétérinaires et phytosanitaires est stable et a même été renforcé. Une révision annuelle en fonction des flux est réalisée. Le directeur général de l'alimentation est très attentif à cet effectif, dernier rempart avant l'entrée dans l'Union européenne.
Vous vouliez savoir si toute la production de banane est durable. En 2012, 80 % de la banane était produite dans le cadre du plan banane durable. Des démarches globales sont effectives : la démarche Global GAP ; depuis 2015, la banane française vendue avec un ruban bleu-blanc-rouge et un code barre ; une démarche de certification IGP devrait aboutir d'ici trois ans.
Actuellement, il y a un producteur bio en Martinique, adhérant de l'UGPBAN. Il possède 16 hectares de plantation de banane et envoie un conteneur par semaine. L'objectif est d'atteindre prochainement 8 à 10 % de la production.

Dans la mesure où nous ne souhaitons pas aligner nos conditions économiques sur celles du Brésil ou de certains pays africains, il nous faut trouver une autre solution, et notamment jouer sur la qualité de nos produits qui est très bien perçue par nos concitoyens consommateurs et nous-mêmes.
Est-ce qu'il y a des normes imposées par la France qui vont au-delà de ce que décide l'Union européenne pour les produits et les productions agricoles, et notamment des DOM ? On a l'impression que la France aime mettre des normes supplémentaires, avec les coûts qu'elles induisent, multiplier les tracasseries administratives et techniques.
Vous avez évoqué l'entrée de la banane et de la canne sur le marché de l'Union européenne. L'Union est constituée de pays qui ont eu des histoires coloniales diverses (la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas). La banane qui provient de certaines anciennes colonies de ces pays arrive sur le marché de l'Union européenne sans être différenciée de celle qui est produite, au sein de l'Union, par la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion. Comment faire pour que l'identification de ces produits soit d'abord une identification européenne, peut-être même plus que française en tant que telle ?
Je vous répondrai à partir du support qui nous a été fourni par la DGCCRF. Mon service réalise des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Un contrôle phytosanitaire consiste à vérifier l'absence de bactéries ou de parasites qui peuvent avoir un impact sur la production agricole.
Je peux vous indiquer la différence des contrôles à l'importation qu'applique la DGCCRF entre la banane des pays tiers et la banane européenne. Les contrôles à l'importation des bananes en pays tiers portent sur le taux de résidus en traitement phytosanitaire qui doit être bien inférieur à une Limite Maximale Résiduelle (LMR). C'est une problématique de santé publique. À la LMR s'ajoute, pour les producteurs ultramarins et les producteurs européens pour d'autres filières, une autorisation de mise sur le marché des traitements phytosanitaires utilisés. C'est une démarche longue et très coûteuse. Nous serions bien en peine d'imposer aux pays tiers cette préoccupation de l'impact sur la pollution des sols. On en revient à la difficulté qu'a soulevée la Martinique sur les usages orphelins avec seulement huit traitements autorisés en Europe et en outre-mer et la République Dominicaine qui dispose de vingt-cinq produits différents.

Vous mettez le doigt sur le problème. La banane est un produit fragile qui se développe dans un milieu riche en parasites et en champignons qui mutent d'une année à l'autre. Nos agriculteurs disent que les agriculteurs des pays voisins utilisent des produits phytosanitaires dont ils ne disposent pas eux-mêmes et qu'ils n'ont pas trouvé de laboratoire disposé à faire des recherches pour un marché aussi restreint que le leur. Ils sont démunis alors qu'ils interviennent sur un marché concurrentiel.
À cela s'ajoute ce que j'ai entendu en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. En Guyane, un jeune de la métropole qui souhaitait s'installer pour planter de l'herbe - qui ne coûte presque rien au Brésil - devait s'adresser à Marseille pour obtenir des semis pour un coût quinze fois supérieur. Le déficit de compétitivité s'explique aussi par le coût du travail.
Nous ne nous battons pas à armes égales alors que nous sommes en compétition sur le marché européen.
Vous soulevez deux problèmes que nous rapporterons à nos autorités, à savoir les semences autorisées et les usages orphelins de produits phytosanitaires.
Pour les semences, je n'ai pas de réponse immédiate à vous apporter.
En ce qui les usages orphelins des traitements phytosanitaires, la possibilité d'activer des aides de type FEDER ou FEADER pour pouvoir travailler sur ces autorisations de mise sur le marché dans un secteur confidentiel a-t-elle été explorée ?

C'est d'abord une question de production. L'agriculteur dont le champ est malade ne produit plus rien. Ce que veulent les agriculteurs, ce ne sont pas des compensations, c'est produire. Ils voient qu'au Nicaragua, en Colombie ou en République dominicaine les agriculteurs traitent largement leurs bananeraies tandis qu'ils sont obligés de laisser leur production s'abîmer. Ils ne disposent pas des produits adaptés pour lutter contre les maladies et quand ils s'adressent aux scientifiques européens, ils n'ont pas de réponse ou on leur dit qu'il n'y a pas de produit pour un aussi petit marché en zone tropicale. Un produit peut être utile pendant deux années et devenir inefficace la troisième car un autre champignon, un autre parasite est apparu. Les pays voisins sont réactifs et disposent de centres de recherche, sur le terrain, qui proposent des solutions concrètes.
Nos agriculteurs souhaitent plus de souplesse, plus de solidarité. Pourquoi ne pourraient-ils pas utiliser ces produits dès lors qu'ils présentent des garanties sanitaires suffisantes ?
Les usages mineurs ont été bien identifiés. Des pistes précises comme le groupe technique filières tropicales sont étudiées pour augmenter la disponibilité des produits.
Nous ne surpassons pas les normes européennes mais nous sommes obligés de passer par l'inscription sur une liste européenne des substances actives. Là, il faut un porteur de projet, que quelqu'un du secteur privé ou un secteur interprofessionnel manifeste son intérêt pour ce marché l'intéresse et effectue les démarches nécessaires.

Monsieur le délégué ministériel, madame, messieurs, nous vous remercions pour la qualité de vos réponses.
Je rappellerai que les départements d'outre-mer sont des régions ultrapériphériques (RUP). Les directives transposées en droit national s'appliquent systématiquement aux RUP. Je regrette qu'il n'y ait pas assez d'adaptations.
Vous dites qu'il y a un suivi des travaux de production normative. Nous pourrions avoir la tentation de vous demander dans quelle mesure vous avez une influence sur leur rédaction. Les normes telles qu'elles sont conçues pour l'Europe sont pour nous, dans certains domaines, bien inadaptées aux réalités de notre environnement ultramarin, réalités d'ailleurs parfois différentes d'un territoire à l'autre.
Vous avez évoqué l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application des normes phytosanitaires, d'une stratégie préventive qui me semble intéressante, d'un régime spécifique. Comment peut-on intervenir pour faire aboutir ce type de propositions ?
Nous voyons les accords internationaux quand ils sont signés. La France donne souvent un mandat en début de rédaction et à la fin demande des ajustements. On peut parfois penser que c'est trop tard.
Vous n'avez pas évoqué la partie du commerce à l'échelon régional. Les produits des départements d'outre-mer font l'objet d'une compensation de leurs surcoûts mais la réalité c'est que ces surcoûts ne permettent pas de vendre aux territoires voisins.

Mes chers collègues, nous accueillons maintenant Monsieur Hervé Deperrois, directeur de l'Office de développement de l'économie agricole des DOM (ODEADOM), accompagné de Mesdames Valérie Gourvennec, chef du service Productions de diversification, Laure Lacour, adjointe au chef de service, et de Monsieur Jérôme Mater, chef du service Grandes cultures.
Monsieur Éric Doligé est le rapporteur coordonnateur de l'ensemble de nos travaux sur les normes, Monsieur Jacques Gillot et Madame Catherine Procaccia sont les rapporteurs du volet spécifique consacré aux aspects sanitaires et phytosanitaires.
Monsieur le Directeur, nous vous avons transmis une trame pour vous permettre de préparer cette audition. Je vous demanderai d'être synthétique afin de permettre à nos collègues de vous poser quelques questions complémentaires.
L'ODEADOM est à la fois un organisme de développement de l'agriculture à l'outre-mer et un organisme payeur des aides communautaires du POSEI et des aides nationales complémentaires. Nous disposons d'un budget d'environ 320 millions d'euros par an en faveur des filières agricoles d'outre-mer et principalement consacrés aux cinq départements d'outre-mer (DOM).
Cet organisme existe depuis de nombreuses années. Il a trois principaux objets :
- une fonction d'aide aux filières et de structuration de ces filières à travers le POSEI. L'ODEADOM intervient en complément des financements FEADER du deuxième pilier pour tout ce qui concerne les aides à l'investissement qui sont gérées au niveau des collectivités territoriales et en liaison avec les directions des affaires foncières et les préfectures ;
- notre deuxième fonction est une fonction d'observatoire économique qui ne fait que débuter, de collecte de toutes les données économiques sur l'agriculture à l'outre-mer ;
- une troisième fonction de concertation avec les professionnels des filières puisque sont rattachés à l'ODEADOM quatre comités sectoriels, deux sur les grandes cultures (un sur la canne à sucre et le rhum, l'autre sur la banane), et deux sur les filières de diversification (l'un sur la diversification animale, l'autre sur diversification végétale).
Je suis venu avec mes chefs de service responsables de ces secteurs. Ils pourront détailler les réponses.
La préoccupation sanitaire n'est pas au coeur de nos préoccupations. Nous ne pourrons pas entrer autant dans les détails que vos précédents interlocuteurs du ministère de l'agriculture. En revanche, nous sommes au courant des contraintes qui pèsent sur les filières agricoles. À partir des quatre comités sectoriels cités précédemment, nous avons bâti des stratégies de filière. Dans les comités sectoriels il y a deux représentants professionnels par DOM qui représentent la production agricole mais aussi la transformation agricole. Cela nous fait dix membres professionnels. S'ajoute le ministère de l'agriculture au niveau de son administration centrale et au niveau territorial.
Nous sommes aussi en cours d'évolution d'organisation pour nous appuyer de plus en plus sur l'échelon déconcentré, au niveau des préfets qui seront, nous l'espérons, nos futurs délégués territoriaux. Ce chantier a été lancé par le ministre de l'agriculture pour montrer la cohérence de l'État sur le terrain vis-à-vis des professionnels et des autorités des collectivités territoriales.
Nous venons de valider les stratégies de filières en conseil d'administration le 17 novembre dernier. Nous sommes maintenant dans une phase de déclinaison de plans d'action locaux qui vont étayer ces différentes stratégies sur le modèle de ce que FranceAgriMer a fait en métropole depuis plusieurs années. L'ODEADOM est un peu l'organisme frère, pour les territoires d'outre-mer, de FranceAgriMer en métropole. Nous essayons d'adopter des méthodes de travail déjà éprouvées et comparables.
Les plans d'action seront déclinés avec les professionnels dans le cadre de comités qui viennent d'être créés dans chaque DOM, les comités d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) qui mettent en commun les compétences des professionnels, des autorités des collectivités territoriales et des services de l'État.
Sur le contenu plus précis de ces stratégies, il y a des enjeux économiques, il y a aussi des enjeux de qualité des produits et des enjeux de développement durable. Ce ne sont pas les mêmes d'une filière à l'autre même si on retrouve une trame commune.
Pour entrer un peu plus dans le détail, je vous propose d'entendre Monsieur Jérôme Mater sur les enjeux que représentant les grandes cultures, puis Mesdames Gourvennec et Lacour, sur les productions de diversification.
La stratégie de la filière banane vise à renforcer la durabilité économique, environnementale et sociale, tout en s'inscrivant dans une démarche de production de banane durable et dans la politique développée par le ministère de l'agriculture en termes de démarche d'agro-écologie. Pour cela les professionnels ont retenu six enjeux principaux :
- renforcer la performance économique de la filière ;
- assurer une maîtrise durable des bio-agresseurs ;
- maîtriser durablement les impacts sur l'environnement ;
- améliorer les performances sociales et sociétales ;
- mieux valoriser la banane de la Martinique et de la Guadeloupe sur les marchés ;
- acquérir, partager et transférer l'innovation et les connaissances en termes de production, de technique culturale, etc.
Ces enjeux ont été déclinés au travers de 28 axes d'intervention qui se traduisent par plus de 70 actions de terrain.
Nous vous transmettrons un document qui vous donnera davantage de précisions.
Dans la stratégie banane, nous sommes un peu en avance par rapport aux plans départementaux car la filière banane est très organisée. Il y a une coopérative qui regroupe tous les producteurs dans chaque département des Antilles. Ces coopératives sont regroupées au sein d'une union générale des producteurs de banane basée à Rungis. Ils avaient déjà développé dans le passé ce qu'on a appelé le plan banane durable 1 pour améliorer la production sur tous les aspects économique, social et environnemental. Ils ont décliné à partir de 2015 un nouveau plan banane durable 2. Il y a une très grande cohésion entre la stratégie et ce plan banane durable 2 qui est validé par l'ensemble des producteurs et qui constitue une base de plan d'action. C'est dans ce plan que l'on retrouve les 70 actions de terrain.
98 % de la banane des Antilles est écoulée en Europe, marché très concurrentiel avec les productions ACP. Les actions plus spécifiques en termes de compétitivité, reprises dans les axes d'intervention, visent à améliorer l'attractivité de ce produit, à encourager la segmentation de l'offre sur les divers marchés, développer les démarches de certification de toute nature et, éventuellement, accroître la valeur ajoutée par la transformation. Mais les possibilités de transformation de la banane restent assez limitées.
Pour la filière canne/sucre, l'orientation stratégique fondamentale est de préserver les débouchés des productions sucre et rhum de la filière canne au travers de quatre enjeux principaux :
- sécuriser les débouchés après la suppression des quotas sucriers en 2017 et protéger les sucres des DOM dans les accords commerciaux de libre-échange signés par l'Union européenne et, en particulier, pour les sucres spéciaux ;
- défendre et renforcer les débouchés du rhum. On a une stratégie de préservation de nos débouchés actuels ;
- consolider la production et l'emploi en maintenant le modèle des exploitations domiennes et en garantissant un revenu aux producteurs tout en poursuivant parallèlement l'innovation des outils industriels et en maintenant ces filières porteuses d'emploi ;
- conserver la structuration du monde agricole et de l'aménagement du territoire. Il y a environ 10 000 planteurs de canne.
Ces enjeux s'inscrivent dans la volonté d'une double performance économique et environnementale de l'agro-environnement.
La filière canne a souhaité développer cette stratégie avec treize objectifs très opérationnels, dont trois spécifiques à l'industrie sucrière et trois spécifiques à la distillation du rhum, les autres étant davantage axés sur la production. Pour les industriels, les points-clé sont l'innovation, la démarche qualité et la valorisation des co-produits de la canne (la bagasse, les mélasses, etc.) pour dégager des marges accrues de valorisation de ce produit.
Pour la banane, pour la première fois à partir de 2016, il y aura un lien entre le plan banane durable 2 et le POSEI. Un compte rendu annuel sera fait auprès de la Commission européenne sur l'évolution et les engagements pris au niveau du développement durable pour montrer la progression de la démarche et l'engagement de la filière. Notre souhait est que ce modèle et nos stratégies qui comprennent ces engagements de développement durable soient progressivement liés au POSEI. Cela donne du sens, du contenu, aux aides à la production économique.
S'agissant des productions de diversification, l'exercice a été un petit peu plus compliqué. Nous sommes sur des filières qui sont, pour le végétal, peu organisées. Elles le sont un peu plus pour l'élevage, du fait du goulot d'étranglement que constituent les abattoirs. La deuxième complexité tient aux territoires très différents d'un DOM à l'autre en termes de développement économique.
Nous avons développé une stratégie de filières pour les filières animales, une autre pour les filières végétales. Un certain nombre d'axes ont été développés, de l'amont jusqu'à la valorisation, même si celle-ci n'est pas encore bien intégrée dans ces stratégies.
Les principaux enjeux sont de développer et de sécuriser les productions en quantité et en qualité pour nourrir la population locale, de renforcer la structuration des organisations de producteurs tout en leur assurant un revenu correct, de renforcer la valeur ajoutée des produits pour favoriser le positionnement sur le marché local. Il s'agit avant tout, pour ces territoires, de dépendre moins des intrants et des semences, de ne plus servir de marché de dégagement pour certains produits et de favoriser l'activité et l'emploi ultramarin.
On a lancé le travail de développement des plans d'action qui seront très différents d'un DOM à l'autre compte tenu du niveau de l'organisation économique de chacun d'entre eux, en sachant que La Réunion a des structures plus fortes et mieux organisées tandis que Mayotte émarge nouvellement au dispositif communautaire du POSEI.
Les objectifs stratégiques sont un peu différents par territoire. Ils seront développés dans un deuxième temps.
Pour l'animal, ce sont toutes les filières métropolitaines des bovins, des caprins, du porcin, de la volaille et la filière avicole.
Pour le végétal, ce sont les fruits et légumes, l'horticulture, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, hors la banane bien évidemment.
Il y a eu un second souffle après les manifestations intervenues en faveur de la production locale dans les DOM en 2009. Cela couvre notamment les besoins en produits frais. Ces stratégies, qui ont été accompagnées par un budget sur le CIOM d'environ 35 millions d'euros par an, portent leurs fruits. Les consommateurs locaux sont très demandeurs de produits identifiés comme produits localement, les produits PEI. Sur le terrain, les producteurs les mettent bien en valeur. Il y a une vraie différenciation, plus forte que celle que nous pouvons voir en métropole. La production est vraiment incitée à répondre à la demande de ce marché. Cela marche très bien à La Réunion où on atteint des taux proches de 100 %. Cela se développe bien aux Antilles et en Guyane et commence à Mayotte. Une capacité d'offre se met progressivement en place. Les cours des marchés locaux se tiennent plutôt mieux dans les DOM qu'en métropole. Le contexte économique que nous connaissons en métropole n'existe pas dans les DOM car les marchés ne sont pas saturés. La demande est forte et les aides du POSEI et du CIOM servent de complément.

Vous avez dit que vous étiez là pour accompagner la production et donc pour l'améliorer. Or, nous savons que les normes pénalisent ce secteur agricole et ne permettent pas d'augmenter la production. Même si ce n'est pas votre spécialité, dans quelle mesure pouvez-vous intervenir sur ces normes ?

J'ai une question de consommatrice davantage que d'élue. Il y a une grande variété dans la production des bananes : production PEI, bio, durable, etc. Je constate qu'en métropole, et particulièrement en province, nous n'avons pas ce choix dans les magasins. On voit des bananes d'Afrique, d'Amérique centrale. Je n'achète que de la banane des Antilles et j'ai toujours beaucoup de mal à en trouver. Il y a un vrai manque de valorisation de la filière dans les grandes surfaces alors que depuis quelques années, on trouve très facilement l'ensemble de la production du rhum.
La diversification est vraiment faite pour le marché local. À quelques exceptions près, on ne peut pas vraiment envisager que ce qui ne sature même pas le marché local puisse sortir du DOM pour être sur le marché métropolitain. Il s'agit plutôt d'éviter des importations dans les DOM.
Pour la banane, c'est très différent. Depuis le début, il y a une culture d'exploitation. Il y a toutefois des problèmes de conservation des bananes. Vous dites qu'il y a une grande variété mais la seule au monde qui se conserve aujourd'hui, c'est la Cavendish. Les petites bananes ne se conservent pas et franchissent très difficilement les milliers de kilomètres. Vous avez raison, l'origine du produit est sans doute à valoriser au niveau commercial. Les professionnels en prennent bien conscience. Valoriser l'origine française et domienne est un plus. Il y a une stratégie d'accompagnement du message qui a été déjà lancée sur la banane française des Antilles par les professionnels, avec un contenu qualitatif.
La problématique se posera sur le sucre l'an prochain avec la fin des quotas. Il y a une dizaine de jours, nous avons organisé un groupe de travail avec les professionnels pour mieux segmenter ce marché et mieux nous défendre par rapport au sucre d'importations étrangères. La valorisation des origines est un plus indéniable qu'il faudra développer, tout comme l'aspect qualitatif. Sur ce dernier point, les professionnels sont réticents car ils trouvent que c'est compliqué. Tout ce qui est bio est compliqué. Nous occupons déjà 60 % du marché avec les sucres spéciaux consommables en bouche mais tout ce qui est destiné à la transformation agro-alimentaire est plus compliqué à valoriser. Même les professionnels acheteurs ne tiennent pas trop à connaître l'origine.
Je voudrais juste apporter un complément sur la banane. Dans les rayons français, la banane dans le rayon fruits de tous les supermarchés est un produit d'entrée de gamme. Le prix de la banane sur l'année varie de 90 centimes à 1,05 euro au kilo. Quelle que soit l'origine de la banane, française des Antilles, venant d'Afrique ou des Caraïbes, elle est vendue pour tout le monde au même prix. Le consommateur français achète une banane à un euro. Les promotions entretiennent cette idée du produit pas cher, destiné à tous les consommateurs. Comme vous le dites très justement, on a du mal à différencier les origines. Depuis 2007, les Antilles ont tenté de le faire en utilisant un programme européen qui est la valorisation, la promotion du logo RUP, en ajoutant parfois Guadeloupe ou Martinique. Cela n'a pas eu d'effet sur la consommation. Malgré le soutien de l'Europe, on n'a pas réussi à inverser cette tendance. L'UGPBan cherche à valoriser davantage son produit. Ils ont lancé en 2015 la banane française. Ils cherchent à différencier ce produit en ne le vendant plus au kilo mais sous forme de produit emballé de 1 à 5 bananes, vendu au packaging. Cela montre qu'une bonne stratégie de communication, avec un drapeau tricolore, permet de vendre un produit avec 25 centimes de plus pour le producteur. Les cinq grandes enseignes nationales sont intéressées par ce produit. C'est une nouvelle démarche qui vise à préserver les parts françaises du marché. Nous avons du mal car la banane française dans le marché européen, dans tout l'export, ne représente que 5 % compte tenu de nos capacités de production. Même si nous faisions localement quelques efforts de productivité, il serait difficile d'excéder 6 à 7 %. L'idée est de parvenir à créer un marché de niche pour la banane française.
Avec les AOC en Martinique qui représentent un aboutissement, les stratégies de signes de qualité entreprises depuis de longues années portent leurs fruits. Les appellations d'origine incarnent un capital patrimonial qui est un argument de vente efficace. Cela permet une mise en perspective pour les autres DOM qui ne sont pas encore aussi avancés en termes de signes de qualité. La Martinique, de ce point de vue, est un modèle, y compris pour le développement de la canne. La stratégie d'appellation d'origine avec un contenu qualitatif fort et un accompagnement de la culture de consommation de ces produits est incontestablement un plus pour l'avenir. Nous souhaiterions développer ce type de démarche avec l'aide de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et de l'Agence bio dans le domaine bio.

Le plan chlordécone a incité les consommateurs dont les jardins familiaux étaient pollués à ne pas manger tous les jours des légumes racines et d'aller vers d'autres produits. La filière diversification a-t-elle bénéficié de cette incitation ?
Il est difficile de répondre pour la production inorganisée. Dans le plan banane durable 1, des informations ont été délivrées en ce qui concerne les sols impropres à la production de type tubercules comme les ignames. Les producteurs organisés, dans le cadre des organisations de producteurs reconnues en Martinique et en Guadeloupe, respectent un zonage des productions.
Dans les filières de fruits et légumes d'outre-mer, 80 % en moyenne des productions sont écoulées de manière inorganisée. C'est une vraie difficulté. Le POSEI tel qu'il est conçu avait pour objet d'augmenter la structuration pour avoir une meilleure maîtrise sanitaire de la production. Il y a des progrès. Des organisations de producteurs se sont créées. Les interprofessions des filières végétales sont encore émergentes mais l'objectif est bien de renforcer l'organisation économique pour avoir une meilleure maîtrise de la production, de l'origine, du suivi et de la traçabilité du produit.

Vous nous avez dit que 98 % de la production de la banane des Antilles était vendue en Europe et ne pesait que 5 % du marché. A priori, il n'y a pas de problème de débouché puisque tout est absorbé au niveau européen. Nous avons vu précédemment que les pays concurrents d'Amérique du sud ou d'Afrique avaient des salaires environ 15 fois inférieurs à ceux de nos producteurs. Y a-t-il un problème de prix, de rentabilité, de marge ? Puisqu'il y a un prix unique qui tourne autour d'un euro, a-t-on une capacité de développer des marges sur ces produits ? Est-ce un produit qui a un avenir ?
La banane est un produit social à la fois sur le marché du consommateur en Europe et aussi localement puisque cette production représente 10 000 emplois.
Effectivement, on a la capacité de production mais elle n'est pas extensible. La Guadeloupe est plutôt sur une marge de progression. Elle produit 70 000 tonnes de banane et vise un objectif de 100 000 tonnes. La Martinique est plutôt sur un objectif de maintien. On ne va pas accroître fortement nos volumes de production.
Compte tenu du fait que nos principaux concurrents sont des pays africains, des Caraïbes ou d'Amérique du sud, on a effectivement un problème de coût de main d'oeuvre. La valorisation est l'un des seuls moyens d'action pour se démarquer. Elle permettra de créer un marché de niche, de rentabiliser ce produit et de le développer.
Par ailleurs, il faut aussi voir qu'en sept ans on a fait beaucoup d'efforts pour réduire de 50 % les traitements phytosanitaires. Depuis le décret de 2014, le traitement aérien est complétement interdit dans les Antilles. Nous sommes le seul État au monde à ne plus avoir de traitement aérien de la banane. Cette réduction de 50 % signifie que nous avons recours à d'autres méthodes de lutte. Nos méthodes de lutte contre la cercosporiose noire reposent sur l'effeuillage des arbres, ce qui ajoute des coûts de main d'oeuvre. Comparativement, dans les pays tiers de nombreux produits phytosanitaires sont encore autorisés et les traitements sont massifs.
Pour la banane bio, en République dominicaine, il y a encore 25 produits de traitement autorisés. Il n'y en a plus que 3 en France. Bien que le marché soit mondial, nous ne jouons pas dans la même cour !

Un produit est social quand il est bon marché pour le consommateur mais aussi quand il fait vivre les producteurs et soutient l'emploi local.

L'Europe a fait le choix de soutenir l'agriculture des RUP à travers les politiques d'aides européennes et du PPOSEI. Sans ces aides, l'agriculture n'existerait plus.
On peut comprendre que le sucre roux ou le rhum soient des produits d'avenir. On peut en faire des produits haut de gamme et la quantité deviendra secondaire par rapport à la qualité. Le revenu pour l'agriculteur sera globalement plus intéressant. La situation est différente pour la banane, produite par de nombreux pays.
Vous disiez qu'il y a de la banane qui vient des ACP. Mais l'Europe aide considérablement les ACP qui produisent déjà dans des conditions que nous ne pouvons pas reproduire. Dans votre programme de travail, y-a-t-il une évaluation du surcoût normatif et une réflexion sur l'adaptation des normes applicables outre-mer ?
Vous l'avez bien dit. L'influence du POSEI est capitale. Il y a environ 125 millions d'euros annuels pour 250 000 tonnes. Cela fait environ 50 centimes d'euro par kilogramme d'aide pour un produit qui se vend au consommateur environ 1 euro le kilogramme. C'est le soutien économique européen qui permet à cette filière d'être rentable malgré les coûts de main d'oeuvre plus élevés et des normes de traitement plus contraignantes. Tant que cet équilibre sera maintenu, on arrivera à maintenir la production.

Votre raisonnement tient dans le cas où l'outre-mer vend à l'Europe. Cela ne va plus dans le contexte régional alors que l'outre-mer souhaiterait également commercer avec celui-ci.
On peut valoriser assez bien l'origine française en métropole. On aura plus de mal à le faire dans les autres pays.
La segmentation se fait davantage sur la qualité. Le consommateur demande à avoir des garanties. Depuis la chlordécone, les producteurs de banane l'ont bien compris et commencent à communiquer sur les conditions de traitement. Il faut transformer cette contrainte en atout. Cela a été le point déterminant du plan banane durable 1 puis du plan banane durable 2. Il faut se différencier par la qualité comme l'ont déjà fait d'autres filières plus avancées comme le rhum AOC.

En tant qu'observateur privilégié de la vie de la banane, quel est votre avis sincère sur l'avenir de ce produit français ultramarin ? Compte tenu du nombre de contraintes, on a le sentiment que c'est plus qu'un produit social. C'est un produit sous perfusion.
La banane, c'est les Antilles. Il faut relier cette culture à ces territoires insulaires dont le foncier est extrêmement sollicité à la fois par l'urbanisation mais aussi par le développement d'autres filières de diversification. Il y a une forte concurrence sur le foncier. Si les filières de diversification se développent, ce sera forcément un peu en concurrence avec le foncier utilisé par la banane. J'ai observé sur le terrain en Martinique il y a trois semaines que les filières de diversification végétale se localisent souvent dans de petits espaces laissés par la bananeraie.
Tant qu'il y aura le POSEI, conforté par une démarche aussi dynamique que celle que nous avons avec les professionnels, la banane a un bel avenir devant elle. Il faut que le consommateur puisse repérer assez vite que la banane française antillaise est différente de celle qui est importée des autres pays où il n'y a pas cette segmentation qualitative. Il faut des années pour que le consommateur identifie les appellations d'origine, les certifications géographiques.

Comment les pays européens non producteurs de banane réagissent-ils face à cette problématique ?
C'est le même problème pour le sucre de canne. La Réunion représente 80 % de la production européenne de sucre de canne. La France est dans une situation très spécifique. Nous avons du mal à sauvegarder nos positions au niveau européen. Lorsqu'il y a des négociations commerciales, on l'a vu avec le Vietnam, la France doit se battre pour faire partager ses points de vue. On y arrive encore, mais la notion de contingent est de plus en plus difficile à faire accepter, surtout quand on essaie de s'ouvrir à ces pays comme le Vietnam qui produisent aussi du sucre. Nous sommes assez isolés au niveau européen.
Je vous ai dit que la banane représentait 5 % de l'approvisionnement brut de l'Union européenne. Elle est essentiellement consommée en France. L'influence des autres pays par rapport à ce produit est relativement négligeable. Toutefois, la consommation de banane augmente en Europe. Elle a gagné 2 kilogrammes depuis l'entrée des anciens pays de l'Europe de l'Est et même dans des pays adhérents depuis longtemps comme la Suède ou la Grande-Bretagne, la consommation augmente. Dans un marché en progression, il y a un avenir pour la banane de qualité telle que nous envisageons de la produire. Il n'y a même plus 600 producteurs de banane. On en est à 400 en Martinique et un petit 200 en Guadeloupe, organisés en une seule coopérative, fédérés au sein d'une union de coopérative au niveau national qui dispose de son propre réseau de murisserie. La filière de production de bananes a tous les outils à sa disposition. Avec une politique volontariste basée sur la diminution des produits phytosanitaires, sur une démarche commerciale comme celle de la banane française, je pense que cette filière peut conserver ses parts de marché.
Il est vrai que les coûts de main d'oeuvre, de production sont plus élevés. L'aide du POSEI a aussi la vertu de permettre à la filière banane de rester compétitive. Dans ces conditions, il y a encore un avenir pour la banane française, d'autant que dans les deux départements cette filière est le premier employeur.
Je voudrais compléter en vous donnant une illustration relative aux filières de diversification. J'ai observé dans une grande surface de La Réunion que la qualité des produits locaux n'avait rien à voir avec les produits importés. Il faut avoir confiance en nous. Les oignons qui viennent de l'Inde sont plein de moucherons. Ces produits voyagent très mal. Les produits locaux ont une toute autre allure et ont un profil qualitatif très fort. Les consommateurs voient bien la différence. La proximité est un atout. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Le frais est en soi un atout, en plus du contenu qualitatif. Le marché existe, il y a une vraie demande et les distributeurs sont prêts. On le voit à La Réunion mais également ailleurs.
L'avenir, c'est le circuit court, la valorisation du frais et la qualité, avec des signes qui l'attestent auprès du consommateur.

Notre collègue a indiqué que la banane était une production sous perfusion. Mais toute l'économie agricole européenne est subventionnée. L'Europe gagne davantage à subventionner la banane qu'à exclure des pays dans le cadre des accords commerciaux internationaux. C'est le grand débat sur les clauses d'exclusion dont l'Europe ne veut plus entendre parler en privilégiant les contingentements.
Comme mes collègues, j'apprécie beaucoup votre optimisme sur l'avenir de ces filières.