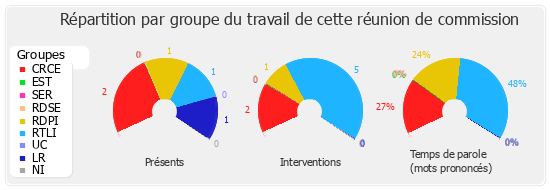Mission d'information situation psychiatrie mineurs en France
Réunion du 21 février 2017 à 14h35
Sommaire
- Audition conjointe sur les « dys- » : pr paul vert professeur émérite de pédiatrie membre de l'académie nationale de médecine pr mario speranza chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de versailles pr franck ramus directeur de recherches au cnrs et professeur attaché à l'ecole normale supérieure dr michel habib président de résodys (voir le dossier)
- Audition conjointe de mme béatrice borrel présidente de l'union nationale de familles et amis de personnes malades et-ou handicapées psychiques unafam et mme claude finkelstein présidente de la fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie fnapsy (voir le dossier)
La réunion
Audition conjointe sur les « dys- » : pr paul vert professeur émérite de pédiatrie membre de l'académie nationale de médecine pr mario speranza chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de versailles pr franck ramus directeur de recherches au cnrs et professeur attaché à l'ecole normale supérieure dr michel habib président de résodys
Audition conjointe sur les « dys- » : pr paul vert professeur émérite de pédiatrie membre de l'académie nationale de médecine pr mario speranza chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de versailles pr franck ramus directeur de recherches au cnrs et professeur attaché à l'ecole normale supérieure dr michel habib président de résodys

Nous allons clore cette semaine nos auditions au Sénat. Deux déplacements seront organisés, l'un dans les Bouches-du-Rhône la semaine prochaine et l'autre dans le Nord la semaine suivante.
Nous avons décidé en bureau de concentrer nos auditions sur les associations de spécialistes de la prise en charge psychiatrique des mineurs. Plusieurs associations de psychiatres nous ont contactés pour nous demander de prendre en compte leurs points de vue. De même, plusieurs praticiens nous ont été signalés comme susceptibles de présenter un point de vue intéressant pour nos travaux. Ils nous feront parvenir une contribution écrite qui pourra être prise en compte dans le rapport.
Puisque notre rapport doit paraître la première semaine d'avril, pour respecter les délais imposés, il ne nous paraît pas raisonnable, au rapporteur et à moi-même, de prolonger nos auditions.
Je remercie M. le Pr Paul Vert, professeur émérite de pédiatrie, membre de l'Académie nationale de médecine, M. le Pr Mario Speranza, chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier de Versailles, M. le Pr Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS et professeur attaché à l'École normale supérieure et M. le Dr Michel Habib, président de Résodys, d'avoir accepté notre invitation.
Je ne suis pas psychiatre mais neurologue. La dénomination Dys- est très française, nous sommes les seuls à y recourir, y compris dans le monde francophone. Le terme consacré est plutôt celui de « troubles spécifiques de l'apprentissage ». Historiquement, ce sujet est d'ordre psychopédagogique dans ses mécanismes présumés. Il est devenu neuroscientifique - M. Ramus en est le spécialiste français - et davantage neurologique que psychologique. Il reste néanmoins psychologique à un certain degré, d'où la présence de M. Speranza, pédopsychiatre. Nous sommes trois représentants spécialisés dans cette discipline.
Près de 10 % des enfants en âge d'être scolarisés ont des troubles de l'apprentissage, avec deux caractéristiques : ces difficultés entravent leur scolarité et ils ont une intelligence normale. Autrement dit, ils n'arrivent pas à apprendre malgré un quotient intellectuel normal. Ces vingt dernières années, les travaux scientifiques nous ont aidés à comprendre les dysfonctionnements du cerveau à l'origine d'un certain nombre de problèmes, dont certains sont psychopathologiques ou psychoaffectifs. C'est tout le problème de la poule et de l'oeuf. Certains enfants ayant des difficultés à apprendre sont, par voie de conséquence, en souffrance psychologique mais des facteurs psychopathologiques peuvent aussi être à l'origine de difficultés d'apprentissage.
Je suis pédopsychiatre et neuropédiatre car j'ai été formé en Italie, où l'on est passé d'un modèle psychopédagogique-psychologique à un modèle neurologique, en lien avec les formations des professionnels, au-delà des connaissances scientifiques qui ont aussi fait évoluer les pratiques.
Je partage le point de vue de M. Habib sur les spécificités cognitives empêchant l'enfant d'utiliser l'expérience éducative classique proposée dans sa famille ou à l'école.
Les troubles spécifiques de l'apprentissage font référence à des enfants présentant des spécificités cognitives dans le traitement de l'information, à la différence d'enfants souffrant de difficultés d'apprentissage pour des raisons multiples. Si conceptuellement, la spécificité est due à ces problèmes de fonctionnement cognitif, départager, dans tel cas individuel, ce qui est spécifiquement cognitif de ce qui est lié à des troubles psychopathologiques reste difficile. Chez certains enfants, c'est même très imbriqué. La théorie est complexe à mettre en pratique, or plus la situation est complexe, plus les facteurs sont multiples. Mais la trajectoire est parfois plus claire, avec des mécanismes plus simples.
Je ne suis ni psychiatre, ni neurologue, mais juste un chercheur sur la dyslexie, au contact des patients mais sans intervention médicale. Les familles et leurs associations sont ma source principale d'information. Les recherches sur les causes des troubles Dys- sont menées par une communauté internationale qui travaille avec toutes les hypothèses et les méthodes possibles à différents niveaux d'investigation - psychologique, cognitif, cérébral, génétique - et sur l'environnement, qui peut moduler tous ces facteurs. On commence à comprendre la causalité des troubles Dys-, et notamment de la dyslexie, le plus connu et le plus étudié : les facteurs génétiques prédisposent à hauteur de 50 % à 60 % de la causalité mais il s'y ajoute des facteurs environnementaux... L'ensemble de ces facteurs engage le cerveau de l'enfant sur une trajectoire légèrement déviante qui implique des particularités cognitives entravant certains apprentissages scolaires ou non scolaires. De nombreuses études ont été publiées sur ce sujet.
Une séance de l'Académie nationale de médecine organisée par la commission handicap que je préside a étudié le thème qui nous réunit aujourd'hui. Je suis pédiatre néonatologiste avec également une fibre pharmacologique périnatale - je suis expert externe pour l'Agence nationale de sécurité du médicament.
À la fin de ma carrière de chef de service en néonatologie, j'ai travaillé durant douze ans dans certains centres d'action médicosociale précoce, où le dépistage des Dys- était réalisé avec des spécialistes de la famille et de la santé, au premier rang desquels les enseignants d'école maternelle, les meilleurs physiologistes du développement que nous ayons : un mois après la rentrée, ils savent détecter les enfants qui ne sauront pas tenir leur crayon...
Ce sujet nous tient à coeur car, statistiquement, c'est un problème majeur : 8 % des enfants sont concernés, tandis que l'on constate 20 % d'illettrisme chez les enfants entrant en sixième - dont de nombreux enfants dyslexiques, dyspraxiques et autres. Cette pathologie est en partie curable car ces enfants sont normalement intelligents. Un diagnostic précoce et un accompagnement convenable, par les professionnels et les parents, doit éviter de décourager l'enfant. Il est capable, le tout est de trouver de quoi et de l'aider dans cette démarche. Je rejoins M. Ramus sur l'étiologie et la diversité des causes, ce qui pose aussi la question de l'exposition intra-utérine à des médicaments.
Comment repérer ces enfants sans stigmatiser ni eux ni leurs familles ? Il y a quelque chose à inventer. L'éducation nationale joue un rôle fondamental. L'Académie de médecine avait auditionné M. Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche, président du comité scientifique de la Fédération nationale des Dys-. Un transfert de responsabilité s'est opéré du monde de la santé au monde de l'éducation, depuis la loi du 11 février 2005 qui impose l'intégration de l'enfant atteint de tels troubles dans les écoles et les collèges proches de son domicile, au même titre que les autres enfants. On a demandé aux enseignants de s'adapter. Ce n'est pas faisable d'emblée : des dispositions ont été prises dont l'inventaire serait utile pour savoir où l'on en est. Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) jouent un rôle capital, même s'ils ont été recrutés selon des critères flous et différents selon les départements, et avec des compétences variables. Après quelques années d'accompagnement, de nombreux enfants récupèrent leurs capacités d'apprendre dans des limites acceptables.

Je vous remercie de vos réponses. Ce sujet des Dys- a-t-il sa place dans notre mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France ?
Monsieur le professeur Vert, vous avez évoqué la loi de février 2005 sur le handicap qui a présidé à la création des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Ces établissements sont encombrés par un grand nombre de dossiers. Comment distinguer le retard lié à des troubles de l'apprentissage et celui lié aux troubles spécifiques Dys- ? Maire d'une ville qui compte 2 000 enfants, je m'interroge sur la formation des AVS. Faut-il en faire un véritable métier, voire un diplôme, au même titre que les assistants familiaux ? Qu'en est-il du repérage précoce, garantie d'une meilleure prise en charge voire d'une probable guérison ?
M. Speranza, pédopsychiatre, vous répondra mieux que moi sur l'évolution - ou plutôt la révolution - dans la conception de ces troubles.
Une première réponse se trouve dans la classification internationale des maladies (CIM-10) et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) utilisés dans la recherche et la clinique internationale. Les troubles spécifiques de l'apprentissage font partie des troubles mentaux, dans une définition qui diffère un peu de celle de la psychiatrie. Les connaissances scientifiques permettent de classer ces troubles parmi les troubles neuro-développementaux, qui appartiennent aux troubles recensés dans les DSM. Dans un à deux ans, la CIM-11 réalisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ira probablement dans le même sens.
La plupart des enfants ayant des troubles spécifiques connaissent des difficultés d'adaptation avec parfois de véritables troubles psychopathologiques associés justifiant une identification et un accompagnement spécifique. Si certaines situations peuvent se passer de consultations psychiatriques, d'autres non.
Un trouble spécifique est défini par l'absence d'un trouble psychiatrique avéré, mais jusqu'à quel point peut-on mettre en évidence cette spécificité ? On a beaucoup progressé sur les méthodes d'évaluation mais la présence de troubles psychiatriques associés n'est pas exceptionnelle et peut souvent intervenir par la suite, même si ce n'est pas systématique. Parfois, certains enfants sont dyslexiques sur une base anxieuse mais des mécanismes psychopathologiques peuvent aussi susciter des problèmes d'apprentissage. Il est donc nécessaire que le psychiatre soit formé et qu'il appartienne à des équipes pluridisciplinaires s'occupant des enfants. Le problème réside plus dans la formation que dans les positions idéologiques - qui commencent à s'estomper.
J'ose prononcer le terme de sur-handicap. Souvent, des troubles psychologiques s'ajoutent au déficit qui est la traduction d'un problème organique. Les modifications de la neurobiologie actuelle ont été énormes. Jusque dans les années 1970, on pensait que l'enfant naissait avec un stock de neurones, dont il perdait la moitié à l'âge de cinq ans, que le cerveau s'agrandissait grâce aux connexions, aux synapses, puis que la neurogenèse était finie pour toujours. On sait désormais qu'il n'en est rien. On a observé une neurogenèse saisonnière pour la nidation chez les oiseaux et l'être humain est capable, plus ou moins, d'avoir une neurogenèse durant toute sa vie. Désormais, nous avons une vision dynamique des connexions avec une dynamique instantanée de la synapsogenèse. Ce sont des milliards de synapses qui changent. J'ai dirigé une unité de recherche de l'Inserm sur la neurologie et la pharmacologie. On retrouve une évolutivité énorme chez l'animal. Ainsi, des foetus ou des nouveau-nés de souris dont la mère est soumise à un fort stress durant la gestation connaissent un développement synaptique atypique. Cela donne le vertige et justifie que l'on accorde toute notre attention à cette notion de sur-handicap et à la détresse des enfants qui, ne réussissant pas, sont en retrait par rapport à la famille et aux enseignants.
Le Pr Vert a fait allusion à des données neurologiques sur la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie... Si l'enfant peut dépasser ces difficultés à parler, compter et autres, il pourra suivre une scolarité normale. L'imagerie cérébrale, qui détecte quelles parties du cerveau dysfonctionnent, a permis de conduire de nombreux travaux. Mais les dysfonctionnements observés sont-ils la cause ou la conséquence des difficultés d'apprentissage ? Selon les dernières études et grâce à l'imagerie de diffusion, nouvelle technologie qui fait apparaître les « câbles » et les connexions, ce serait plutôt la cause. Dans chacune de ces affections, la principale particularité du cerveau est de ne pas avoir de connectivité normale. Ainsi, les difficultés de dyslexie préexistent aux problèmes de lecture. En revanche, cette anomalie est aussi présente dans les cas d'illettrisme - qui est également massivement lié à des causes environnementales. L'anomalie est donc génétique mais peut être aussi modifiée par l'environnement.
La majorité des professionnels s'occupant de ces enfants sont des orthophonistes - une profession difficile, qui nécessite de connaître les pathologies de la voix, le cancer du larynx, en passant par l'anatomie du cerveau... Il est difficile d'appréhender la manière dont ils y font face. Cette pathologie est complexe, due à des causes génétiques, environnementales, psychopathologiques, comme cela a été rappelé. Intéressons-nous à un aspect plus structurel, selon la sévérité du trouble. Si une majorité des enfants - 65 % à 70 % d'entre eux - peuvent être traités de façon ordinaire par orthophonie et un système scolaire volontaire, tout se passe bien. Mais pour les 30 % restants, il faudrait des équipes pluridisciplinaires, qui font défaut. En 2002, 25 centres hospitaliers universitaires ont créé des centres de référence pour les troubles de l'apprentissage mais qui ne peuvent recevoir qu'une infime partie des enfants. Cela ne suffit pas. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire complexe avec des équipes réunissant des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes et des enseignants. Ne faisons pas l'économie d'une bonne structuration et d'un travail d'équipe.
On en voit toute l'utilité : parfois ils sont même surutilisés. Il est difficile de définir des critères absolus. Les MDPH ont des quantités de dossiers à traiter mais se heurtent aussi à un problème de qualité. Un médecin de MDPH ne peut être spécialisé dans tous les handicaps et doit recourir à des experts, qui souvent manquent, afin de trouver les bonnes mesures de compensation.
Ce n'est pas à nous de définir les troubles Dys- par rapport à la psychiatrie. Restons-en aux classifications internationales de l'OMS et de l'Association américaine de psychiatrie. Le pire serait de réinventer la roue. C'est dans cet ensemble que forment les troubles neuro-développementaux que se trouve la catégorie des troubles de l'apprentissage ou du développement moteur. Certains sont plus ou moins dépendants de la psychiatrie, mais cela dépend plutôt de la répartition des pathologies entre les neurologues et les psychiatres.
Comment distinguer les vrais troubles Dys- des difficultés scolaires habituelles ? La dyslexie touche 5 % des enfants en âge scolaire, tandis que les difficultés d'apprentissage de la lecture en touchent 15 %. La dyslexie n'explique qu'une partie des difficultés d'apprentissage de la lecture.
Dans d'autres pays, notamment les États-Unis, a été adoptée une approche « réponse à l'intervention » extrêmement pragmatique et centrée sur les difficultés de l'enfant. Dans une première étape, on enseigne la lecture et le calcul sur la base des meilleurs standards éducatifs, avec des enseignants formés. Au cours du CP, on détecte les quelques enfants qui n'entrent pas dans ces enseignements, sans poser de diagnostic de dyslexie - celui-ci n'est possible que deux ans après le CP. Mais on n'attend pas ce diagnostic pour agir. La démarche est fondée sur les preuves, et notamment sur ce qui a bien marché, par exemple la lecture en petits groupes, grâce à des enseignants bien formés - ce serait le rôle de tous les enseignants de primaire. On donne alors un nouvel enseignement de la lecture par des méthodes plus intrusives, systématiques, fonctionnant mieux que devant une classe entière. Grâce à ces innovations pédagogiques, des enfants en légère difficulté peuvent se maintenir dans leur classe. À défaut, il faut réaliser un bilan cognitif et identifier plus précisément la difficulté. Au bout d'un certain temps et à la fin d'un cheminement pédagogique, on peut poser un diagnostic. On ne devrait poser de diagnostic que sur le fondement d'une résistance à l'intervention pédagogique de première intention.
Cette approche « réponse à l'intervention » sur trois stades, théorisée aux États-Unis, a été mise en place dans plusieurs centaines d'écoles, pragmatiquement, à faible coût, et avec une efficacité certaine. Certes, il est des enfants qui résistent à ce dispositif. Il faut alors réaliser un bilan cognitif complet, un diagnostic, afin de les orienter vers les professionnels de santé.

A-t-on une approche épidémiologique dans l'espace et dans le temps ? Les Français ne sont pas les meilleurs en la matière...
Tout à fait, aucune étude épidémiologique sur les troubles de l'apprentissage n'a été réalisée en France. Il en existe quelques-unes dans d'autres pays. Une prévalence est difficile à estimer. Elle est un nombre, arbitraire, qui dépend de critères de diagnostic et d'un certain seuil de sévérité préalablement établis. La prévalence dépend de ces définitions mais on peut définir des niveaux absolus comme le niveau en lecture à la fin de l'école primaire. Selon les études épidémiologiques internationales, la prévalence de la dyslexie est de 3 % à 7 % selon les caractéristiques de la langue : 3 % en Italie, 7 % aux États-Unis et entre les deux pour la France. Si l'on y ajoute d'autres troubles de l'apprentissage comme la dyscalculie, on atteint 5 % à 10 % des enfants. Certaines études évoquent le chiffre de 20 %, qui est me semble-t-il exagéré et concerne l'ensemble des difficultés scolaires plutôt que les seuls troubles spécifiques. Si les études épidémiologiques sont approximatives, il n'en reste pas moins que le problème est massif.
Nous n'avons aucune raison de le penser, de même pour l'autisme : je ne suis pas sûr qu'il y ait une véritable augmentation de la prévalence. Par contre, il y a un meilleur dépistage.
Les instituteurs d'école maternelle sont les meilleurs physiologistes du développement grâce à leur expérience, et non grâce à leur formation. Cette formation a profondément évolué ; elle a été rendue plus universitaire. Comment enseigner cela devant un amphithéâtre de 300 personnes ? Les candidats ont été mis en situation à mi-temps, ce qui leur permet d'enseigner à partir de ce qui ne va pas. Mais on ne doit pas seulement se fonder sur l'expérience. Il faut une formation scientifique et pratique pour gérer des enfants en difficulté.
Faisons attention aux normes. Vous avez prononcé le mot « retard », extrêmement dangereux sur le plan pratique. Un retard se compense mais certaines situations ne se rattrapent jamais. À quelle norme se réfère-t-on lorsqu'on évoque un retard ? Les apprentissages sont soumis à une distribution gaussienne par rapport au temps : certains apprentissages sont rapides, d'autres lents - comme pour l'assimilation de médicaments. À quel moment intervient-on ? Certains enfants marchent à vingt mois, d'autres à onze ; ils sont aux extrémités d'une courbe de Gauss. C'est aux professionnels de se réunir pour savoir quand intervenir, en collaboration avec les enseignants qui leur apportent leur expérience.

Merci pour vos interventions très instructives. Nous sommes très attachés à l'éducation et aux classes maternelles. Vous avez souligné le rôle de ces enseignants, les premiers à signaler les difficultés. On leur demande beaucoup et ils sont capables de beaucoup. Ils envoient des signaux, mais comment la prise en charge se fait-elle ? Auparavant, il y avait des maîtres des réseaux d'aide aux élèves en difficulté (Rased) qui les aidaient à intervenir auprès des enfants, ce qui permettait une réponse pédagogique. Ils n'existent plus.
Le monde de la santé scolaire est en grande difficulté, même si un statut de psychologue a été défini, dont les modalités de concours vont s'ouvrir. Au Canada comme dans d'autres pays, des pédo-psychologues interviennent dans les écoles. C'est une des premières réponses. Nous manquons de professionnels capables d'apporter ces réponses. Une équipe pluridisciplinaire serait une solution idéale mais nous butons sur les réalités.
La commission de la MDPH doit bénéficier de l'avis des médecins scolaires, qui sont peu nombreux et qui passent le tiers de leur temps à établir des projets d'accueil individualisé (PAI) - encore faut-il les mettre en application. On se heurte à d'importantes difficultés.

Professeur Vert, vous défendez avec ardeur la formation des enseignants mais aussi des AVS : avoir un master ne suffit pas pour traiter de manière appropriée l'enfant ou l'adolescent. Pour autant, vous affirmez que tout ne réside pas dans la formation. Comment s'articulent ces deux arguments ? Au-delà de la transmission de savoir par le sachant, faut-il envisager une formation au dépistage, qui impliquerait un transfert de compétences médicales vers l'éducation ?
Sachant qu'il existe, comme l'un d'entre vous l'a dit, des apprenants rapides et d'autres plus lents, notre système scolaire, qui fixe un nombre d'années pour l'apprentissage, n'est-il pas trop normé ? Ne faut-il pas laisser du temps à ceux qui en ont le plus besoin, pour anticiper certaines pathologies ?
En matière de santé comme d'enseignement, enseignement théorique et expérience pratique sont complémentaires. Les professeurs des écoles étudient à l'université, puis sont placés en situation et reviennent du terrain avec leurs questionnements. Le tout est d'évaluer ce système ; or les gouvernements successifs - et j'en ai vu passer beaucoup - ont tendance à proposer des réformes sans évaluer les précédentes. Lorsque je me suis intéressé à la formation des maîtres, j'ai pu constater que la formation des instituteurs dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) n'abordait pas le handicap. Or j'ai également donné des cours en école d'instituteurs et constaté que leurs étudiants sont intéressés par la question du développement cognitif des enfants. Il est indispensable d'évaluer ce qui se fait sur le terrain.
Est-on trop normatif ? Éternel problème, les instituteurs sont chargés d'amener des enfants à la lecture dans un temps donné, sans toujours avoir le temps de s'occuper de ceux qui sont à la traîne. J'ai connu la guerre où, beaucoup de maîtres étant prisonniers en Allemagne, il y avait des classes de 60 élèves. La meilleure pédagogie est celle des petites classes. Revenons à l'Émile de Jean-Jacques Rousseau et demandons-nous comment on forme un enfant...

Tous les enfants ont-ils besoin du même laps de temps pour apprendre à lire ? Un enfant plus lent est-il nécessairement un Dys- ?
La réponse est suggérée dans votre question... Le tout est de ne pas stigmatiser - il fut un temps où l'on rangeait les enfants en classe en fonction de leurs notes, en plaçant les meilleurs devant, moyennant quoi les enfants en difficulté parce qu'ils avaient des problèmes d'audition entendaient encore moins bien. Mais en pratique, beaucoup d'enseignants prennent en charge les enfants en difficulté. J'ai un exemple en tête, celui d'une institutrice confiant sa classe pendant une heure à une AVS, dont le niveau de compétence le permet, pour s'occuper d'un enfant en particulier.
Certains enfants ont besoin de six mois, d'autres de deux ans pour apprendre à lire. Il appartient au monde de l'éducation, et non aux médecins, de résoudre ces disparités grâce à des classes adaptées. Dans les villages où les effectifs scolaires étaient réduits, il y avait des classes à deux niveaux ; ainsi, les enfants les moins avancés qui passaient au niveau supérieur continuaient à tirer parti de ce qui était expliqué aux plus jeunes.

Merci, professeur Vert, de votre regard positif sur l'école maternelle où j'ai moi-même enseigné vingt ans dans une ZEP. L'école est soumise à l'exigence de la performance à tout prix et du classement. L'enfant doit savoir lire à la fin du CP mais c'est encore mieux s'il sait lire à Noël... Laissons du temps au temps - c'est la raison d'être des cycles : si l'enfant ne maîtrise pas la lecture à la fin du CP, il reste le CE1 pour que le déclic se produise. Vous l'avez dit, on ne met pas les enfants debout à un certain âge pour leur apprendre à marcher ! Pourtant l'école subit la pression de la société, des parents qui s'inquiètent au moindre ralentissement et angoissent l'enfant inutilement.
On nous dit que 20 % des enfants entrant en sixième ne savent pas lire et que 8 % présenteraient des signes de Dys-. Avez-vous des éléments sur ce sujet ?
Certaines anomalies préexistantes n'apparaissent qu'au moment de l'apprentissage de la lecture, avez-vous dit. Y a-t-il néanmoins des signaux repérables, notamment dans le comportement, dès l'école maternelle ?
Il existe parfois des écarts incompréhensibles entre le nombre d'heures réservées par les MDPH à l'accompagnement d'un enfant et le fractionnement de cet accompagnement. Comment s'effectue la prescription ?
Ne faisons pas dire aux chiffres plus qu'ils ne peuvent dire : les normes sur l'apprentissage de la lecture varient en fonction des pays et des langues. La proportion de 8 % d'enfants Dys- est néanmoins communément admise. La grande majorité d'entre eux sont dyslexiques, notamment parce que la dyslexie est plus souvent diagnostiquée.
Les 8 % d'enfants Dys- n'ont pas les mêmes besoins en matière de rééducation et tous ne nécessitent pas un parcours pédagogique aménagé. Or aucun critère n'est défini au niveau national pour l'attribution d'un ordinateur, d'une AVS ou d'un contingent d'heures : tout est décidé au niveau départemental. Mieux vaudrait que les professionnels définissent, en lien avec les MDPH, des critères de sévérité justifiant un accompagnement.
Le système des MDPH se caractérise par l'hétérogénéité de la prise en charge en fonction des départements, dont les critères varient, ce qui a des conséquences sur le travail demandé. Il conviendrait que les MDPH s'appuient sur des équipes d'experts mais elles s'y refusent parfois car ces derniers sont ceux qui leur adressent les patients. Dans les pays où la loi n'est pas allée aussi loin dans la prise en charge des handicaps d'apprentissage, on observe paradoxalement plus de souplesse. Au nom de l'équité, nous avons aggravé les inégalités.
Quelle est la proportion d'enfants chez qui au trouble initial s'ajoute le sur-handicap du découragement et du rejet, qui finissent par entraîner des troubles cognitifs ?
L'un des principaux paramètres qui influencent la trajectoire psychopathologique des dyslexiques est la précocité du diagnostic. Plus elle est grande, mieux l'enfant s'adapte, à travers un parcours pédagogique spécifique si nécessaire. Un tiers des enfants dyslexiques présentent une comorbidité, souvent sous les espèces d'une dépression.
Le docteur Habib a montré dans l'un de ses ouvrages que les enfants qui présentent un trouble en ont souvent d'autres, exprimés de façon plus discrète : dyspraxie chez un enfant dyslexique, ou l'inverse.
Nous l'avons tous observé : on rencontre plus souvent plusieurs problèmes Dys- qu'un seul chez un même enfant. Cela mobilise rapidement plusieurs spécialités. D'abord l'orthophoniste intervient mais bientôt il faut faire appel à un psychomotricien, puis à un ergothérapeute pour compenser, avec l'aide de l'ordinateur, les problèmes de graphisme développés par l'enfant. Le neuropsychologue peut lui aussi être sollicité pour les troubles de l'attention, aujourd'hui très sous-estimés ; or il a été démontré que le cerveau possède un organe de l'attention, souvent touché en même temps que la zone spécialisée dans la lecture ou le calcul. Pour y remédier, des méthodes de rééducation spécifique de l'attention ont été mises en place, dont l'efficacité est prouvée.
Le seuil de sévérité à partir duquel il faut faire appel à plusieurs professionnels est rapidement atteint.
Ce développement fait ressortir un point d'achoppement du système : seule l'intervention de l'orthophoniste est remboursée. De ce fait, il a même été envisagé de confier à ces derniers des tâches qui ne relèvent pas entièrement de leur périmètre, notamment dans le domaine neuro-visuel.
Pour tenir compte des chronologies différentes de développement chez les enfants, il faudrait que l'enseignement soit plus modulaire : ainsi un élève pourrait suivre le cours de lecture de deuxième année et le cours de mathématiques de troisième année. C'est difficile à mettre en oeuvre.
Des cohortes longitudinales montrent que les enfants qui ne lisent pas à la fin du CP accumulent du retard dans les années suivantes. De même, le pronostic pour les enfants qui ont des difficultés dans le langage oral à la maternelle n'est pas très favorable pour l'apprentissage de l'écrit en CP. En France, nous avons eu tendance à laisser les troubles se développer sans intervenir : on disait souvent que si un enfant ne parlait pas à trois ans, c'est qu'il n'en avait pas envie... Voici le délicat compromis à trouver : fixer des seuils normatifs au-delà desquels on décide d'intervenir, sans stigmatiser, mais en renforçant les capacités et en préservant une flexibilité pour s'adapter aux enfants.

Merci pour ces interventions extrêmement intéressantes et pédagogiques.
Mon groupe politique est favorable à l'entrée des enfants en maternelle dès deux ans et demi. En Bretagne, ils peuvent y entrer dès qu'ils sont propres. Cela faciliterait l'accompagnement des enseignants dans les diagnostics précoces. Quel est votre avis sur les équipes de Rased, en forte diminution ? En faudrait-il davantage ? Quid des classes moins nombreuses ? Ce sont à nos yeux des solutions d'amélioration de l'accompagnement des enfants présentant des troubles de l'apprentissage.
Il faudrait davantage d'enseignants spécialisés, mais à la condition qu'ils soient bien formés ; or par le passé, ils ne l'étaient pas sur les troubles de l'apprentissage. La formation est le maître mot pour les enseignants, qu'ils soient ou non spécialisés et tous les autres professionnels, y compris les médecins. Une formation appuyée sur les données scientifiques les plus récentes délivrée à tous les intervenants de la prise en charge aurait un effet infiniment plus positif que toutes les grandes réformes structurelles.
Les familles qui viennent me voir me demandent souvent sur quel critère doit être évalué le besoin d'un accompagnement spécifique. J'insiste auprès d'elles sur l'écart entre l'intelligence apparente de l'enfant et son intelligence réelle, souvent normale voire au-dessus de la moyenne. Les enfants à haut potentiel sont souvent Dys- et souffrent de n'être reconnus ni pour leur intelligence, ni pour leurs difficultés.
C'est cet écart entre l'intelligence - normale ou supra-normale - de l'enfant et ce que laisse apparaître l'apprentissage qui doit mettre la puce à l'oreille de l'enseignant. Malheureusement, ce dernier ne se pose pas la question dans ces termes.
En cas de difficultés d'apprentissage, il faut également s'assurer que l'enfant ne souffre pas de troubles sensoriels.
Audition conjointe de Mme Béatrice Borrel présidente de l'union nationale de familles et amis de personnes malades et-ou handicapées psychiques unafam et Mme Claude Finkelstein présidente de la fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie fnapsy
Audition conjointe de Mme Béatrice Borrel présidente de l'union nationale de familles et amis de personnes malades et-ou handicapées psychiques unafam et Mme Claude Finkelstein présidente de la fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie fnapsy

On ne peut parler de psychiatrie, et surtout de pédopsychiatrie ou de psychiatrie des mineurs, sans entendre les malades et les familles : en première ligne face aux troubles, celles-ci sont confrontées aux difficultés d'organisation de la prise en charge au fil des années et font elles-mêmes partie du soin.
C'est pourquoi nous recevons Mmes Béatrice Borrel et Claude Finkelstein, respectivement présidentes de l'Union nationale de familles et amis des personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) et de la Fédération nationale des associations d'usagers de la psychiatrie (Fnapsy).
Ouverte au public et à la presse, cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise sur le site du Sénat.
Les troubles psychiatriques des mineurs sont un sujet certes en amont de notre action mais très important. En effet, l'association que je préside représente des personnes qui se reconnaissent comme porteuses d'une maladie psychiatrique et nous sollicitent généralement à l'âge de 35 ou 40 ans ; mais cela ne nous empêche pas de porter un regard rétrospectif sur notre propre histoire, sans compter que certaines maladies mentales étant transmissibles, nous nous préoccupons également de nos enfants et de nos petits-enfants. Le dépistage leur éviterait ce qui a eu un impact fort sur notre vie.
Ce n'est pas un scoop : la psychiatrie des mineurs en France est déplorable. Les familles ne savent pas à qui s'adresser. Les délais de réponse des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont en moyenne de quatre à six mois, ce qui est considérable dans la vie d'un enfant. Il est pourtant crucial de déterminer au plus tôt si les troubles sont dus à son environnement et appellent une réponse sociale, ou relèvent d'une maladie psychiatrique.
Au-delà de la prévention et du dépistage, il faudrait une réponse réelle au niveau psychiatrique. Or il n'y a pas de lits en psychiatrie pour les personnes souffrant de troubles autistiques. La pédopsychiatrie ne répond aux attentes que dans quelques endroits offrant une hospitalisation de jour ou de semaine. Une personne souffrant de schizophrénie, qui fait une décompensation à 17 ou 18 ans mais n'est diagnostiquée qu'à trente ans et se présente à nous à 40 ou 45 ans, a perdu toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte. C'est dramatique.
Nous avons soumis une proposition voici deux ou trois ans à Mme la ministre qui, malgré l'intérêt qu'elle a manifesté, n'a pas été suivie d'effet : construire, aux abords des hôpitaux psychiatriques - construits au XIXe siècle dans des banlieues qui sont aujourd'hui des déserts médicaux - des maisons médicales. À Nice, où je réside, l'hôpital psychiatrique se trouve à proximité d'une barre HLM très difficile. Je vois des femmes courir aux urgences pour faire soigner une bronchiolite de leur enfant. S'il y avait une maison médicale, elles s'y rendraient ; puis, à force de se familiariser avec les lieux, elles seraient plus enclines à emmener leur fils à l'hôpital si des troubles apparaissaient à 15 ou 16 ans. La maison médicale assurerait aussi une prise en charge somatique des personnes en soins psychiatriques. On déstigmatiserait ainsi la psychiatrie. Malheureusement, cette solution intéressante, à moindre coût, n'excite pas nos élus...
Nous fondons un grand espoir dans la capacité du nouveau Comité de pilotage de la psychiatrie à se saisir de la question de la pédopsychiatrie et nous attendons ses propositions avec intérêt. Nous avons également de grandes attentes vis-à-vis de votre mission d'information, en particulier au vu de l'action de M. Milon dans ce domaine.
Notre action est historiquement centrée sur l'entrée dans la maladie, entre 18 et 20 ans ; nous accompagnons aussi les familles de patients âgés. Mais nos délégations, réparties sur l'ensemble du territoire, reçoivent de plus en plus de familles accompagnées de jeunes enfants. Des assistantes sociales nous adressent également des demandes. C'est pourquoi nous mettons en place des structures pour mieux recevoir et assister ces familles.
L'entrée de l'adulte dans la maladie suscite bien entendu des inquiétudes ; mais les familles, alertées par les troubles du sommeil ou la phobie scolaire de leur enfant, faute de lieu où s'informer, commencent un véritable parcours du combattant. Leur réaction est soit le déni, soit la culpabilité. Elles ont besoin d'explications sur le diagnostic qui leur est délivré et s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant, dont la maladie débouche souvent sur une déscolarisation et un retour à la maison, sans solution. À cela s'ajoute la difficulté d'obtenir un rendez-vous en pédopsychiatrie. À Marseille, d'où je viens, l'attente est très longue.
Les familles se tournent quelquefois vers des psychologues mais ces consultations ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ce qui pose question. De plus, certains de ces psychologues travaillent seuls ; par conséquent, si l'enfant est atteint d'une maladie psychiatrique, il ne pourra bénéficier immédiatement d'un réseau.
Les familles éprouvent aussi des besoins en matière d'aide à domicile. Elles s'interrogent sur les compensations possibles, sur le conseil parent-aidant et sur les procédures de placement. C'est pour répondre à ces questions que l'Unafam s'est penchée sur le sujet.
Tout comme Claude Finkelstein, nous avons noté que le manque de repérage précoce est un facteur crucial. De ce fait, des troubles qui auraient pu être résolus plus tôt s'installent. En outre, la présence d'une personne malade dans une famille peut déclencher des troubles chez d'autres membres de la famille, en particulier les enfants. Ces troubles sont souvent réversibles si l'on s'y prend à temps mais ils s'aggravent si rien n'est fait, ce qui est dommageable pour la famille, mais aussi pour la société. Quand un enfant a des problèmes, cela a un impact sur toute la famille ; ce n'est pas spécifique à la psychiatrie.
Le repérage précoce devrait être développé. Il faut pour cela former les acteurs de première ligne. Les médecins scolaires, les généralistes et même les pédiatres ne connaissent pas grand-chose à la psychiatrie. La protection maternelle et infantile (PMI) doit jouer son rôle, tout comme les crèches. Il faut surtout intégrer à cette démarche les écoles, qui sont le bon endroit pour effectuer ce repérage. C'est un problème de formation et d'information des acteurs de première ligne.
Le retard au diagnostic est aussi dû à la stigmatisation de la maladie. On n'est pas fier d'avoir un enfant schizophrène. Dire à un adolescent qu'il doit aller en hôpital psychiatrique, cela le stigmatise. Il faut donc des lieux banalisés pour l'accueil des adolescents. Il faut également mener des campagnes de sensibilisation sur ce qu'est la maladie mentale.

Vos propos, mesdames, rejoignent largement ceux des professionnels que nous avons auditionnés avant vous. Cela est rassurant quant au diagnostic que nous devons poser, mais aussi inquiétant quant au traitement qu'il nous faut préconiser. En effet, force est d'admettre que nous manquons aujourd'hui de pédopsychiatres, du fait d'un manque de formateurs dans cette discipline au sein des universités.
Vous avez évoqué la formation des personnels et l'information du public, nécessaires selon vous au développement d'une politique de prévention à même de permettre le repérage précoce de ces pathologies. Si vous aviez à émettre trois préconisations, clairement énoncées et aussi réalistes que possible, quelles seraient-elles ?
Il faut que, par notre rapport, nous puissions interpeller de manière percutante les candidats à l'élection présidentielle. C'est pourquoi de telles préconisations sont importantes.
Vous avez également évoqué la notion de « répit » pour les familles, qui parfois n'en peuvent plus. Ce problème m'est familier.
Il faut des lieux d'information. Une famille constate des troubles chez un enfant ; ce n'est peut-être pas grave mais il faut pouvoir se renseigner facilement, et cela doit pouvoir déboucher rapidement sur un rendez-vous chez un pédopsychiatre pour obtenir un diagnostic.

Il existe aujourd'hui deux sortes de lieux d'information : les maisons des adolescents, qui ne maillent malheureusement pas tout le territoire, et les espaces santé jeunes. Quelle expérience avez-vous de ces lieux ?
Je connais bien une maison des adolescents, dans l'Isère, qui est va vers les adolescents et les professionnels autour d'eux. Il arrive qu'ils parlent, à travers la porte, à des adolescents qui ne veulent pas sortir de leur chambre. Ils offrent aussi des lieux de court séjour. Cela est important car mettre un enfant dans un service de psychiatrie adulte pose des risques et renvoie à cet enfant une image insupportable, ce qui peut conduire à un refus de soins. Cette maison soutient aussi les professionnels qui travaillent avec des jeunes en difficulté. Malheureusement, de telles maisons n'existent pas partout, loin de là.
Les espaces santé jeunes s'adressent aux seuls adolescents. Il faudrait pouvoir s'intéresser aussi aux enfants plus jeunes. On ne prête pas assez attention aux moments de transition, de la maternelle au primaire par exemple. Ces périodes sont difficiles pour les enfants les plus fragiles.
En somme, il faut de l'information, du repérage précoce et de la coordination entre les acteurs. Il faut également faire en sorte que les enfants restent le plus possible dans l'école de leur quartier, pour l'inclusion.
Je rejoins les propos de Béatrice Borrel. Nous travaillons avec plusieurs établissements scolaires qui offrent, notamment à des personnes anorexiques, des programmes « études-soins ». Cela fonctionne car les enfants ne sont pas déscolarisés. Il existe bien des programmes « sport-études », « musique-études », alors pourquoi ne pas développer ces programmes « soins-études » ?

C'est le modèle de la fondation Pierre Deniker, dont nous avons auditionné la directrice générale.
Oui et ils ne sont pas les seuls à le faire. Le problème est que ces structures sont souvent issues de l'initiative d'une seule personne ; elles périclitent souvent quand cette personne disparaît. Il faut que ces structures puissent être dupliquées et qu'il y en ait au moins une par région.
La psychiatrie dispose de réels moyens. Je milite dans ce milieu depuis vingt-cinq ans ; j'ai moi-même subi la maladie mentale et j'ai été élevée par une tante qui souffrait de schizophrénie et est morte à l'hôpital psychiatrique. Ce lourd passé me donne une vue bien complète de la psychiatrie en France.
Des lieux d'information sont nécessaires, c'est indéniable, ainsi que des formations où les patients et leurs familles soient inclus. L'impact de telles formations sur les professionnels est majeur. Le développement d'un réseau est également indispensable.
Il faut surtout prendre en compte le dépistage ; malheureusement, il n'y a pas de réelle politique de prévention en France aujourd'hui, à la différence de certains pays du nord de l'Europe.

Vous soulignez des éléments très importants. Je suis attentive, en particulier, à plusieurs points sur lesquels votre témoignage corrobore nos précédentes auditions.
Vous avez mentionné l'importance du dépistage précoce. Cela dit, pour qu'il soit bénéfique, il faut que des soins soient mis en place immédiatement après. C'est cette étape qui, souvent, fait défaut. En effet, comme vous l'avez souligné, le temps d'attente entre la première suspicion de difficultés psychiatriques et la prise en charge est souvent trop long. Cela mérite qu'on y travaille.
Nous pourrions par ailleurs nous pencher davantage sur la notion de réseau. Tout le monde en parle et le secteur psychiatrique actuel s'est mis en place autour de ce concept, mais les choses changent. Parfois, en voulant bien faire, en voulant plus de proximité, on détruit des choses utiles. Quelle conception, quelle expérience avez-vous de cette mise en réseau ?
Le réseau se construit sur le terrain, par exemple par des journées communes entre différentes structures. Il existe ainsi, depuis plus de dix ans, les groupes d'entraide mutuelle, qui ont constitué un réseau informel par leurs journées portes ouvertes, où ils invitent des représentants de la mairie et des institutions voisines. Les gens qui y vont se rendent compte que la maladie mentale n'est pas ce qu'ils s'en représentent ; cette déstigmatisation est très importante.
Je suis présidente d'un groupe d'entraide mutuelle, à Paris. Quand nous l'avons ouvert, voici quinze ans - il s'agissait alors d'une association d'usagers -, le propriétaire des murs de la boutique que nous avions louée a reçu une pétition signée de tous les propriétaires de l'immeuble, qui disait : « On ne veut pas de fous chez nous ! » Aujourd'hui, les voisins passent prendre un café, mais c'est le résultat de quinze ans de travail !
Sur la notion de « répit », je rejoins vos propos, monsieur le rapporteur. Je me suis occupée de ma tante, qui souffrait de schizophrénie, jusqu'à sa mort. Une fois par an, je l'emmenais à Monéteau, dans un centre de vacances, où elle restait un mois. J'étais contente de la retrouver à la fin du mois, mais quand je la déposais, c'était un vrai soulagement car j'allais pouvoir avoir un mois tranquille, sans la peur qui n'abandonne jamais quelqu'un qui prend soin d'un parent atteint de maladie mentale.
J'en reviens aux réseaux. Ils se créent aussi par l'organisation de formations croisées, in situ. Il n'y a rien de pire que les formations déconnectées du terrain. Quand la formation est organisée sur place, tout le monde peut en tirer des fruits.
Les personnels de l'Éducation nationale et les soignants se connaissent mal. Dispenser une formation aux enseignants peut les aider à mieux connaître les pratiques des soignants. Cependant, j'ai découvert que l'école que je connaissais du temps où mes enfants la fréquentaient avait beaucoup évolué sur ces questions ; les médecins n'en sont pas toujours conscients. Si l'on organise des moments d'échange entre enseignants et médecins, les deux professions pourront apprendre à travailler ensemble. Le médecin peut penser, à tort, que l'enfant ne peut être scolarisé que de manière très partielle, alors que l'enseignant aura une meilleure connaissance des possibilités offertes. Les formations croisées, mais aussi de simples réunions d'information, peuvent y jouer un rôle.
La coordination demande du temps et des moyens. Il n'en reste pas moins que le travail en commun n'est pas une pratique très répandue en psychiatrie. Grâce au plan cancer, on est parvenu à un meilleur partage des diagnostics et des protocoles de soin en cancérologie. Il faudrait une évolution similaire en psychiatrie. Les pédopsychiatres se sont sans doute davantage avancés dans cette voie que les autres psychiatres : une coopération existe déjà avec les psychomotriciens ou encore les orthophonistes.

Vous avez parlé de stigmatisation. Selon vous, faire de la psychiatrie une grande cause nationale permettrait-il d'améliorer la situation ou bien cela aggraverait-il encore la stigmatisation ?
Il faut en parler tout simplement. Deux millions d'adultes sont affectés par une maladie mentale : c'est beaucoup ! D'après mon expérience personnelle, tout le monde est touché, dans sa famille ou ses amis. Il faut en parler comme d'une autre maladie. Le cancer aussi était jadis stigmatisé, sans parler du Sida ! Ce n'est pas en se cachant qu'on sortira de la stigmatisation.
Mes petits-enfants savent ce que je fais et ils essaient de comprendre. Le handicap est accepté à l'école maintenant. Mais les « gogols », comme ils disent, ce n'est pas la même chose : ces personnes restent très stigmatisées !
La manière dont la presse et la télévision en parlent est également problématique. De ce point de vue, les émissions télévisées françaises sont pires que les américaines.
Je voudrais insister sur la nécessité d'associer étroitement les familles aux soins. Souvent encore, les familles sont culpabilisées. Il faut que tous les intervenants leur portent une attention bienveillante. Vous avez parlé de répit : les familles ont un vrai besoin de soutien, d'explications et d'information.
J'espère que la conférence nationale sur la santé mentale et le comité national de pilotage sur la psychiatrie pourront nous aider. Ce sont des lieux d'échange et de réflexion communs avec les médecins.

Nous sommes tous convaincus de l'utilité de la formation, de la prévention et de la mise en place d'un réseau de soins auquel participent les familles. Malheureusement, beaucoup de travail reste à faire. Le dépistage par les professionnels de santé - médecins généralistes, médecins scolaires, médecins de PMI, psychiatres - mais aussi par les enseignants, dès l'école maternelle, est important. Il faut des formations spécifiques sur ce sujet extrêmement important, qui coûte plusieurs milliards d'euros par an. Merci à vous.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 16 heures 40.