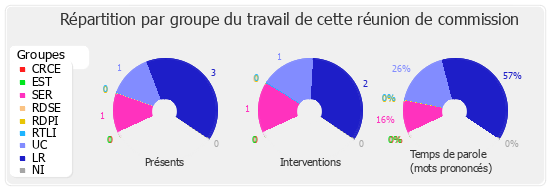Mission commune d'information Répression infractions sexuelles sur mineurs
Réunion du 4 décembre 2018 à 15h00
Sommaire
La réunion
Audition du dr georges picherot pédiatre ancien chef de service de pédiatrie au chu de nantes membre du conseil national de la protection de l'enfance cnpe et du comité d'experts du jeune public au conseil supérieur de l'audiovisuel csa
Audition du dr georges picherot pédiatre ancien chef de service de pédiatrie au chu de nantes membre du conseil national de la protection de l'enfance cnpe et du comité d'experts du jeune public au conseil supérieur de l'audiovisuel csa

Nous sommes heureux de vous accueillir, monsieur Picherot ; vous êtes pédiatre, ancien chef du service de pédiatrie du CHU de Nantes, et membre du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) ainsi que du comité d'experts du jeune public au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Vous connaissez le périmètre de notre mission commune d'information : il s'agit des violences sexuelles sur les mineurs commises par des adultes ayant une forme d'autorité sur l'enfant en raison de leurs fonctions ; nous excluons donc les violences sexuelles commises dans le cadre familial ou commises par des mineurs. Notre mission cible les infractions commises dans la sphère publique - par exemple l'éducation nationale - ou au sein d'organisations privées - Église, clubs de sport, ou autres.
Nous souhaitons mieux comprendre comment détecter si un enfant est victime de violences sexuelles et déterminer les modalités de prise en charge les plus adaptées pour surmonter le traumatisme vécu par l'enfant.
Les trois rapporteurs de cette mission sont Michelle Meunier, membre de la commission des affaires sociales, Marie Mercier, membre de la commission des lois, et Dominique Vérien, membre de la commission de la culture et de l'éducation.
Je propose que vous commenciez votre intervention par un propos liminaire, puis les rapporteurs et les membres de la mission vous poseront des questions.
Je vous remercie de votre invitation. Ce sujet regroupe plusieurs situations de maltraitance, qui peuvent avoir lieu dans différents milieux ou dans différentes situations, mais qui présentent des points communs.
Pour structurer mon propos liminaire, je partirai des questions que vous m'avez transmises.
Votre première question porte sur ma carrière, qui a été longue et qui est derrière moi. Cette question me conduit à distinguer deux périodes. Avant 1990, le thème des violences sexuelles sur mineurs était peu abordé dans le milieu médical. Le milieu pédiatrique avait une grande expérience de la maltraitance physique, psychologique et de la maltraitance institutionnelle secondaire à des soins - on a ainsi révélé au cours des années 1980 le problème posé par la douleur -, mais on abordait peu les violences sexuelles.
Deux voix ont fait évoluer la communauté médicale à ce sujet. Il y a d'abord eu une voix internationale, portée par les équipes canadiennes, qui avaient plus d'expérience en matière d'accueil des enfants victimes de violences sexuelles et avec lesquelles nous sommes d'ailleurs restés en contact. Il y a ensuite eu une voix ministérielle, le ministère de la santé ayant organisé un grand colloque sur les violences sexuelles, qui a beaucoup troublé la communauté médicale, peu habituée à entendre parler de ce sujet - je parle ici surtout de la médecine somatique, que je représente, la médecine psychiatrique étant probablement mieux informée, même si elle n'avait pas vraiment organisé ses soins en conséquence.
À partir des années 1990, j'ai travaillé essentiellement sur la coordination de l'action de la justice, de la santé - psychologique et somatique - et du travail social. Mes plus belles rencontres dans l'organisation des soins ont été celles que j'ai faites avec deux procureurs chargés des mineurs, qui ont fait preuve d'une ouverture extraordinaire sur ces sujets complexes. À la suite de l'émergence de cette question, j'ai organisé deux unités médico-judiciaires pédiatriques, à Saint-Nazaire et à Nantes.
A la fin des années 1980, la plupart des prises en charge d'enfants se faisaient encore dans des services médicaux non adaptés - principalement les urgences -, où ils étaient suivis par des médecins non spécifiquement formés. Cela a pu être très traumatisant. Il a fallu attendre la fin des années 1990 pour que soient mises en place des unités plus spécialisées, répondant aux besoins médicaux des enfants.
Votre deuxième question porte sur la formation des médecins en matière de violences sexuelles et sur la détection. La formation des médecins aux violences subies par les enfants n'a pas cessé d'augmenter, mais elle demeure notoirement insuffisante. Le risque pour un médecin de rencontrer un cas d'enfant victime de maltraitance n'est pas du tout proportionnel au nombre d'heures de formation.
Si l'on compare cela à la formation en matière de détection de la méningite bactérienne de l'enfant, c'est troublant. Que l'on me comprenne bien, il est très important que le médecin sache repérer une méningite bactérienne, mais le risque pour lui d'en rencontrer une est très faible. Il y a 400 cas par an en France ; cela est donc très inférieur au risque de rencontrer une situation de maltraitance, sexuelle ou autre, qui équivaut au risque de rencontrer une crise d'asthme dans sa patientèle. Le nombre d'heures de formation reste donc trop limité ; même dans les CHU sensibilisés, comme celui de Nantes, cela représente moins de dix heures dans tout le cursus médical, même dans un cursus spécialisé comme la pédiatrie.
La question est la suivante : à quoi doit-on former les médecins ? Il ne s'agit pas de les former à l'examen gynécologique de la petite fille, afin d'en faire des experts ; c'est illusoire. Il faut former les médecins à deux choses : à la reconnaissance des signes de violences sexuelles subies et aux conséquences des violences sexuelles, quel que soit le contexte - intra ou extrafamilial. Ce deuxième aspect, qui me tient particulièrement à coeur, devrait donner lieu à un important effort de formation, car il concerne des médecins de nombreux exercices.
Des travaux sur les conséquences à long terme de ces maltraitances ont été publiés, et leurs conclusions sont révolutionnaires : le fait d'avoir subi ces maltraitances entraîne une vulnérabilité chronique, qui se rapproche de celle des erreurs diététiques, et constitue un déterminant de pathologies cardiovasculaires, de troubles du comportement alimentaire et, évidemment, de troubles psychiatriques ou psychologiques.
Une telle formation doit s'adresser aux médecins généralistes et aux pédiatres de première ligne, mais également aux spécialistes qui disent passer régulièrement à côté de problèmes de violences sexuelles ; je pense en particulier aux gynécologues obstétriciens, aux neurologues et aux algologues.
Cela dit, on ne peut envisager de formation sans clarifier au préalable ce qu'il convient de faire lorsque l'on repère un cas de violence, sans quoi on envoie médecins et éducateurs à l'échec. Pour nous, c'est très important, et c'est là que l'on voit à quel point toutes vos questions sont liées entre elles - la formation dépend de l'existence de structures d'accueil adaptées. Ces formations ne peuvent être organisées que par des acteurs travaillant en lien les uns avec les autres. Les acteurs de la justice doivent expliquer ce qu'ils attendent des soignants. Il faut améliorer les formations à double ou à triple entrée, dans un processus qui doit être global et continu.
J'en viens au repérage, aux signes, puisque les enfants ne parlent pas spontanément, la plupart du temps, de ce qu'ils ont vécu, soit parce qu'ils n'ont pas accès au langage, soit parce qu'il est difficile de parler de la famille ou des institutions - d'autant que les violences sexuelles institutionnelles arrivent souvent à des enfants ayant déjà subi des violences en famille.
Si la détection est importante, on a longtemps fait une erreur à ce sujet : on pensait trouver des signes physiques qui induiraient ou, au moins, renforceraient un soupçon. En réalité, chez l'enfant, on ne trouve de signes physiques qui confirment ces violences sexuelles que dans 10 % des cas. Dans 90 % des cas, l'examen gynécologique expertal n'apporte pas de signe direct. Les repères relèvent donc non pas de l'examen clinique, mais de l'étude du comportement de l'enfant, de ses propos et de ses signes indirects. Je ne les listerai pas tous, mais il faut les connaître.
Le premier signe indirect est le suicide ou la tentative de suicide ; cela doit majoritairement faire penser à la possibilité d'une agression sexuelle. Autre signe : la grossesse chez l'adolescente ; c'est un signe indirect fondamental, qui ne donne pourtant pas toujours lieu à une enquête. Ensuite, il y a toutes les pathologies de régression, notamment autour de la sphère génitale - perte de propreté, par exemple - ou encore les refus d'examen physique. Ces signes indirects sont nombreux et très bien décrits dans de nombreuses publications de médecine.
Il faut une formation pour détecter ces signes et pour procéder à la démarche associative qui conduira à ce diagnostic. Une telle formation entraînera, si j'ose dire, la banalisation de ce diagnostic, qui sera envisagé comme tout autre diagnostic.
Enfin, pour terminer sur ce volet, je tiens à souligner qu'il ne peut y avoir de formation au repérage sans protection des auteurs de signalements, de ceux qui donnent une information préoccupante. Cela ne signifie pas qu'il faut les protéger lorsqu'ils disent n'importe quelle bêtise, mais leur protection doit être importante.
Il faut notamment rappeler aux instances médicales que cette protection est inscrite dans la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé, car on m'a rapporté des faits graves. En effet, si le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des documents intéressants sur le signalement, certains conseils locaux de l'ordre des médecins ont oublié cette loi. Ainsi, lors d'un signalement récent, l'ordre local a proposé une confrontation entre le signalant médical et la personne mise en cause. C'est très grave pour moi ; un médecin ou un travailleur social confronté à ce genre de situation ne le refera pas de sitôt...
J'en arrive aux dispositifs de prise en charge et aux unités d'accueil pédiatrique d'enfants en danger. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet ; de telles unités doivent absolument réunir trois éléments : le soin, la protection et l'expertise. Le meilleur exemple réside dans les unités médico-judiciaires pédiatriques, inspirées des child advocacy centers aux États-Unis. On ne peut pas dissocier une expertise de haut niveau d'un soin immédiat : si on laisse un enfant sans soins après l'expertise, il subira un traumatisme. C'est très différent de ce que l'on pense habituellement en matière de médecine légale - on fait un examen de haute qualité, puis le juge décidera du soin. Le temps passe vite pour un enfant, et le temps de la justice est long. Si un enfant subit une expertise pour une violence sexuelle en institution et que le procès a lieu deux ou trois ans après, quel soin lui sera donné dans ce laps de temps ? Il sera passé de sept à dix ans, de dix à treize ans ou de treize à seize ans... La différence est considérable pour lui, l'évolution est majeure. Durant cette période de grande vulnérabilité, son développement se fera sans prévention des séquelles. C'est là que réside l'intérêt de ces structures qui abordent les trois aspects en même temps.
Il est éthiquement impossible pour moi de faire une expertise sur un enfant sans savoir ce qu'il adviendra de lui immédiatement après. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue, mais c'est ce qui se pratique largement en France. La Société française de pédiatrie médico-légale est aussi sur cette ligne.
Je serai plus rapide sur les autres questions. Les relations entre justice et éducation nationale sont essentielles ; cette relation doit être un axe important du travail du CNPE. Il est possible pour un médecin d'avoir des relations avec la justice, tout en respectant son code de déontologie. Il faut simplement que les choses soient clairement établies. Le médecin n'est pas là pour juger ; le juge n'est pas là pour faire de la médecine ; mais ils doivent pratiquer ensemble la pluridisciplinarité, en toute transparence. Les unités que j'évoquais sont en lien, quand elles fonctionnement bien, avec la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), les structures juridiques de signalement, les brigades de police et de gendarmerie ; on réunit le plus possible les acteurs. Ce dispositif interprofessionnel doit être soutenu lorsqu'il fonctionne.
Il faut distinguer les violences institutionnelles et les violences en institution, car l'institution peut être maltraitante dans les soins ou lors de phénomènes de harcèlement par exemple. Le déni de ces violences est encore plus important que celui des violences intrafamiliales, sans doute à cause de modes de fonctionnement qui restent opaques. La culpabilité qui pèse sur celui qui serait tenté de faire des révélations est aussi prégnante. Les signes indirects, comme la régression scolaire, peuvent être des indicateurs. Il est évident qu'il faut mettre en place une prévention, notamment vis-à-vis des institutions qui ne respectent pas l'égalité des sexes, qui ne sont pas ouvertes sur l'extérieur, car ce sont des lieux à haut risque. Des violences sexuelles institutionnelles continuent de s'exercer alors que l'on pensait que le problème était réglé.
On gagnerait à travailler avec des institutions comme l'Union nationale des associations familiales (Unaf) pour informer les parents et éviter qu'ils ne placent leurs enfants dans des structures parasectaires. Le dialogue avec les familles n'est pas forcément facile, car mon expérience m'a montré que les enfants ayant subi des violences sexuelles dans les institutions ont souvent commencé par en subir dans leur famille, ou dans une famille d'accueil.
Je participe au comité d'experts du CSA, qui travaille essentiellement sur les contenus de diffusion inopportuns. Le CSA couvre un champ plus large que celui des structures télévisuelles ou radiophoniques, puisqu'il s'intéresse aussi aux contenus diffusés sur les réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Le travail interdisciplinaire que nous menons avec les producteurs porte ses fruits. Même si le CSA reste une structure lourde, il permet le dialogue.
La prise en charge totale par l'assurance maladie des enfants victimes de violences sexuelles avec un panier de soins est une autre piste à creuser. La prise en charge à 100 % ne suffit pas car il faudrait y ajouter la prise en charge psychologique et celle des soins de psychomotricité, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Enfin je suis également membre du CNPE qui s'intéresse naturellement beaucoup à la question des violences sexuelles sur mineurs et qui réfléchit notamment aux notions de discernement et de majorité sexuelle.

Combien y a-t-il d'unités médico-judiciaires pédiatriques dans la région Pays de la Loire ?
Il y en a trois, à Angers, Saint-Nazaire et Nantes. Elles traitent environ 1 200 cas par an, dont 400 à Saint-Nazaire et autant à Angers.

Vous avez parlé du déni. Il a été manifeste que, sur ce sujet, personne ne voulait voir ni savoir. On donne libre cours au silence et à l'omerta dans les institutions religieuses, l'éducation nationale, le milieu du sport et les centres de loisirs. Avec quarante ans de recul, considérez-vous que la situation a évolué ?

Nous souhaitons travailler sur le volet prévention. En tant qu'expert auprès du CSA, quel impact l'exposition précoce aux films pornographiques ou aux réseaux sociaux peut-elle, à votre avis, avoir sur un jeune cerveau ? Avez-vous des suggestions sur la prévention à mettre en place pour contrôler l'accès à de telles images ?

On a beaucoup débattu de l'obligation de signalement pendant l'examen du projet de loi sur les violences sexuelles. Est-il, selon vous, important de l'instituer pour les médecins, voire pour l'ensemble des professionnels ?
L'institution prend souvent en charge des enfants qui ont été retirés de leur famille. Ne les remet-on pas en danger en les plaçant ainsi avec d'autres enfants ? Dans quelles structures les place-t-on ?
Enfin, en quoi les médias peuvent-ils modifier le comportement des enfants en matière d'approche de la sexualité ?
Le déni est très lourd sur tout ce qui concerne la maltraitance. Chacun préfère croire que le monde est merveilleux et que tout y est fait pour protéger les enfants. Découvrir qu'il en va autrement ne peut être que douloureux. Le déni simplifie les choses. Pour lutter contre, il faudrait clarifier le circuit, de sorte que chacun soit en mesure de trouver une structure où il sera rapidement entendu. Le déni se construit sur l'illusion que l'on pourra régler la situation tout seul. L'une de ses manifestations dans les institutions consiste à optimiser sans cesse les relations humaines. Le déni est constant et touche toute la chaîne.
L'organisation hospitalière est dans le repérage et l'accompagnement immédiat. Elle est relayée par le système de soins. Pour éviter le déni, il faut que les deux actions s'articulent le mieux possible. Dans le département du Maine-et-Loire, une gynécologue vient de publier une thèse où elle montre que, sur les 100 cas de symptômes non expliqués qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière, 90 concernaient des femmes ayant été abusées dans leur enfance. Une autre manière de combattre le déni consiste à ne pas laisser le soignant seul face à la situation.
Je reste ébahi par le nombre de collégiens ayant eu accès à des films pornographiques. C'est terrible. Les conséquences sont connues et le CSA les met en avant dans sa campagne d'information. Bien sûr, rien n'empêche d'aller voir l'Origine du monde de Courbet avec ses enfants, mais ce n'est pas la même chose que de les laisser seuls face à un écran devant des images terrifiantes ? Le rôle des parents est de les accompagner. Les enfants les moins vulnérables s'en sortiront. La rupture tient aux modes de vie. Dans les milieux vulnérables, où les enfants ont subi des maltraitances, le phénomène est déstabilisant. Le CSA s'y intéresse beaucoup, tout en reconnaissant que l'exercice d'un contrôle reste très difficile.
Pour les médecins, ce que prévoit la loi en matière de signalement est à mon avis suffisant. Introduire une obligation pourrait se heurter à certaines règles de déontologie. Mieux vaut inciter les médecins à adhérer au parcours de soins proposé.
Les médias pourraient constituer un moyen d'information intéressant en matière d'apprentissage de la sexualité, dès lors qu'ils développeraient un contenu positif et adapté. La diffusion de contenus non contrôlés et inadaptés aux enfants est la source des difficultés.
Le placement en institution n'est pas la seule solution pour prendre en charge les enfants victimes de violences, mais c'est une possibilité. Les institutions ont encore beaucoup de progrès à faire. La vulnérabilité des enfants qu'on y place est chronique. Il faut développer l'accueil des enfants en leur prodiguant des soins. Une réflexion est en cours à ce sujet, au niveau européen. Les enfants ne pourront se sentir bien dans les institutions que si on en adapte les structures. Des efforts restent à faire, par exemple, sur la stricte surveillance somatique. Pour autant, beaucoup d'institutions fonctionnent bien.

Je suis pédiatre de profession et j'ai exercé en région bordelaise. Mon activité a été transformée par l'ouverture de la cellule d'accueil d'urgences des victimes d'agressions (Cauva). Auparavant, les gendarmes m'amenaient des enfants pour que je rende mon diagnostic - viol, pas viol ? - dans des délais très courts. J'ai sans doute fait plus de signalements que je n'aurais dû, mais sur ces sujets, mieux vaut être excessif que timide. La prise en charge par la Cauva a vraiment amélioré la situation.
Dans les institutions, trop d'éducateurs sont livrés à eux-mêmes et pas assez formés. Le médecin qui reçoit les enfants aura du mal à détecter le problème. On a de moins en moins de pédopsychiatres. Qui mettra donc en oeuvre le panier de soins que vous proposez ?
C'est une question importante. Le manque de pédopsychiatres pourrait conduire à faire intervenir des psychologues, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. Il conviendrait aussi de sensibiliser les pédopsychiatres à l'intérêt du travail social.
Je vous transmettrai le dossier du Concours médical auquel nous avons participé, ainsi qu'une étude que nous avons menée sur les unités d'accueil.
La réunion est close à 16 h 10.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.