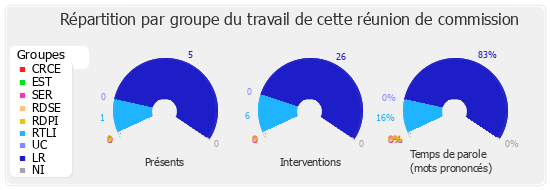Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du 21 mars 2019 à 9h30
Sommaire
La réunion

Je vous prie d'excuser l'absence de M. Longuet, retenu dans une autre réunion, et de M. Villani, qui va nous rejoindre. Une audition publique s'est tenue, le 7 février dernier, pour tirer le bilan, dix ans après, des recommandations d'un rapport présenté au nom de l'Office en 2007 par M. Roland Courteau sur la prévention et l'alerte du risque de tsunami sur les côtes françaises. Notre collègue nous a suggéré une audition de suivi de ces mesures. Je rappelle que lorsqu'il a été produit, ce rapport avait un caractère novateur, car on doutait à l'époque de ce que les côtes françaises, hormis aux Antilles, puissent être menacées par des phénomènes tels que ceux qui sévissaient en Asie. Monsieur le rapporteur, vous pourrez nous faire part des progrès accomplis sur le sujet depuis 2007 et des difficultés qui persistent ?

L'Office a organisé une audition publique le 7 février 2019 pour dresser le bilan des recommandations des deux rapports que j'ai présentés en 2007 et en 2009 au nom de l'OPECST. En 2006, au lendemain du tsunami de Sumatra, qui avait causé plus de 250 000 morts, l'OPECST m'avait posé la question de savoir si la France, qui compte des millions de kilomètres carrés d'espace maritime, était à l'abri d'une catastrophe. Nous nous sommes employés à examiner la question partout dans le monde et à étudier les risques de tsunami en Méditerranée, dans l'Atlantique Nord-Est, mais aussi aux Antilles et dans l'Océan indien. L'une de nos recommandations essentielles a porté sur la mise en place d'un centre d'alerte au tsunami, pour la Méditerranée occidentale et l'Atlantique Nord-Est, recommandation suivie d'effet.
Le tsunami a toujours une origine géologique, qu'il s'agisse d'un séisme, d'un glissement de terrain sous-marin, ou de l'effondrement d'un volcan. Il peut aussi provenir d'une météorite qui tombe en mer. Il prend la forme d'une colonne d'eau qui part de la mer, éventuellement haute de plusieurs dizaines de mètres, et allant à la vitesse d'un avion. Si un tsunami se déclenchait au nord de l'Algérie, il ne mettrait qu'une heure pour atteindre les côtes françaises, comme cela s'est produit en 2004.
Les récents tsunamis qui ont touché la Grèce et la Turquie en 2017 étaient de faible ampleur. En 1908, à la suite d'un séisme à Messine, un tsunami a fait 10 000 morts. En 1887, la Côte d'Azur a été touchée, avec une centaine de morts ; nous en aurions des milliers si la catastrophe survenait aujourd'hui. En 1755, un tsunami parti de Lisbonne a traversé l'Atlantique et fait des ravages aux Antilles. Rien n'empêche que le phénomène se produise en sens inverse. En Indonésie, on sait que le volcan Krakatau, en éruption, peut générer un tsunami à tout moment. Or, en Méditerranée, le volcan Stromboli est entré en éruption depuis les années 2000.
L'OPECST a obtenu la mise en place d'un centre d'alerte au tsunami qui couvre la Méditerranée occidentale et l'Atlantique Nord-Est, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec six ou sept ingénieurs qui se relaient nuit et jour. Les stations sismiques sont réparties entre les Açores et la Sicile. Des marégraphes fonctionnent en temps réel. Le Centre national d'alerte aux tsunamis (Cenalt), basé à Bruyères-le-Châtel, couvre particulièrement bien l'alerte montante. Il suffit de 8 à 15 minutes après le déclenchement d'un tsunami pour que l'alerte soit donnée au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic), à l'articulation de l'alerte montante et de l'alerte descendante.
Cependant, des faiblesses subsistent tant dans le fonctionnement du Cogic que dans le manque de sensibilisation des populations exposées au risque de tsunami. Lors du dernier tsunami au Japon, 150 000 personnes ont été exposées en front de mer. On a déploré 30 000 morts, ce qui signifie que 120 000 personnes ont réussi à sauver leur vie parce qu'elles savaient ce qu'il fallait faire.
Si un tsunami se déclenchait au nord de l'Algérie, à la suite d'un séisme, il serait sur nos côtes, 60 à 70 minutes plus tard, ce qui nous laisse le temps de réagir. Le centre d'alerte pourra fonctionner de manière efficace. En revanche, si un tsunami se déclenchait à la suite d'un glissement de terrain en mer Ligure, il serait sur nos côtes 10 minutes plus tard, de sorte qu'il serait difficile de réagir. D'où l'importance de sensibiliser les populations. Hormis dans la ville de Cannes et dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'impréparation qui prévaut.
Autre problème, nous devons pouvoir avertir la population au plus vite. Le représentant du ministère de l'Intérieur m'a assuré que 5 000 sirènes pourraient être déployées en deux vagues, s'il n'y avait pas des problèmes budgétaires. Les sommes ne sont pourtant pas exorbitantes.
Les Antilles, Mayotte et la Réunion ne disposent d'aucune couverture, ni d'aucun dispositif d'alerte. Je tremble à l'idée qu'un tsunami s'y déclenche, un jour, car ce serait un carnage. La Polynésie française est le seul territoire à disposer d'un véritable centre d'alerte, depuis une vingtaine d'années.
Le risque zéro n'existe pas. L'implantation de sirènes, la sensibilisation de la population et la mise en oeuvre d'exercices d'évacuation pourraient réduire le nombre des victimes. À Cannes, lors d'un récent exercice, il a fallu 55 minutes pour transmettre l'alerte et lancer le dispositif d'évacuation. C'est trop long. Il faut absolument améliorer l'articulation entre alerte montante et alerte descendante. Le Cogic manque d'effectifs.
L'État peut disposer de 5 000 sirènes pour couvrir les plages du Languedoc-Roussillon et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'attend-on pour les rendre opérationnelles ? Le Cenalt n'a besoin que de quelques milliers d'euros pour couvrir la zone des Antilles, de Mayotte et de la Réunion. Je suis prêt à suivre ce dossier avec votre accord et à saisir le ministère de l'Intérieur pour améliorer les systèmes d'alerte à la population et la couverture de ces zones.
Le tsunami est un phénomène rare, de sorte que le Gouvernement peut parier sur cette rareté. Cependant, il y en a eu 91 en Méditerranée, au cours du XXe siècle. Là où un tsunami s'est déclaré dans le passé, il y a un risque pour l'avenir.
J'ai présenté un premier rapport au ministère de l'Intérieur où l'on m'a répondu que la mise en place d'un centre d'alerte coûtait cher. Dans cette logique, à combien évalue-t-on une vie humaine ?

Je vous remercie. Ne pourrait-on pas inscrire ce point dans le cadre de notre mission de contrôle du Gouvernement ? Des plans de prévention existent. Ce problème d'alerte devrait être pris en compte dans les communes. Quant aux sirènes, il faudrait aller plus loin. Les 2 000 sirènes qui sont opérationnelles étaient, il me semble, sous la responsabilité de l'armée de l'air. Historiquement, elles fonctionnaient pour les alertes aériennes pendant la seconde guerre mondiale. Elles sonnent à 11h30 dans le nord de la France et à 12h15 dans le sud de la France.

Le représentant du ministère de l'intérieur nous a dit que les sirènes déployées dans les zones côtières sont dédiées à l'alerte tsunami.

La ville de Cannes a fait un travail remarquable - et, à ma connaissance, unique sur notre littoral méditerranéen - en installant des panneaux lumineux et des hauts parleurs et en tenant des réunions de sensibilisation. Il est vrai qu'ils ont du monde sur les plages, été comme hiver.

Je trouve rassurant qu'un parlementaire suive ces questions sur le long terme - ce qui illustre l'intérêt du cumul des mandats ! Le phénomène des tsunamis ne va pas s'arrêter, et les facteurs de risque s'accroissent, notamment avec la montée des eaux et l'héliotropisme. Des tsunamis vont survenir de nouveau, et nous avons le devoir de nous y préparer.
À cet égard, je m'étonne qu'avec les progrès technologiques que nous connaissons, qui accélèrent toujours davantage la circulation de l'information, il y ait toujours deux systèmes, l'un pour l'alerte montante, l'autre pour l'alerte descendante. Pourquoi ne pas les coordonner automatiquement ? Pourquoi conserver deux centres distincts ? Cela rend le système faillible, et occasionne des pertes de temps. Ne pourrait-on l'automatiser entièrement ?
Les risques de montée des eaux donnent lieu à des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur nos zones littorales. Pourquoi ne pas y intégrer la menace tsunami ? Le Sud de la Bretagne, par exemple, peut être menacé par un tsunami qui viendrait des Antilles ; le Nord est relativement à l'abri - sauf à assimiler le Brexit à un séisme !

Il est avéré que, pour le site de Fukushima, les anciens avaient borné le terrain - et l'autorité de sûreté nucléaire japonaise avait demandé l'édification d'un mur de quatorze mètres de hauteur. Une autre centrale, construite à une centaine de kilomètres, a édifié un tel mur, et il ne lui est rien arrivé. À Fukushima, on s'est contenté d'un mur de six ou sept mètres. Conclusion : on aura beau faire tous les PPRI du monde, si les hommes ne sont pas raisonnables, il y aura toujours des drames.

Un tsunami se diffuse-t-il de manière concentrique ? Est-ce lié aux marées ?

Non, aucun rapport, ni avec la météorologie d'ailleurs. Les tsunamis ont des causes géologiques - séisme, glissement de terrain sous-marin, effondrement d'un volcan - ou sont consécutifs à la chute d'une météorite.

Ce qui n'est pas si exceptionnel : un météore est tombé sur la Russie il y a quelques années, et j'ai entendu à la radio qu'un astéroïde devait tomber prochainement quelque part en mer. Si c'est au coeur du Pacifique, cela peut sembler moins risqué - encore que les îles que je connais bien par le groupe d'amitié que je préside ont parfois leur sol à quelques dizaines de centimètres seulement au-dessus du niveau de la mer...

Le tsunami de Sumatra s'est diffusé en cercles concentriques. Après quatre ou cinq heures, il a touché l'Inde, puis la Réunion. Dans ce type de cas, on a le temps de s'organiser. De même, le tsunami qui a détruit Lisbonne en 1755 a touché les Antilles et l'Irlande.
M. Sido a raison : les hommes doivent se montrer raisonnables, et responsables. Même sur notre littoral méditerranéen, certaines maisons sont construites les pieds dans l'eau : en cas de coup de mer, ou de tsunami, il y aura des problèmes. Et une vague de tsunami véhicule beaucoup plus d'énergie qu'une vague de tempête. Au large, elle ne fait que quelques dizaines de centimètres, et un bateau la sent à peine passer, d'autant qu'elle voyage à 800 kilomètres par heure. Mais la pente de la côte la freine, et son énergie cinétique se convertit en énergie potentielle, ce qui peut aboutir à une vague haute de 80 mètres - comme celle qui a détruit la civilisation minoenne à la suite de l'effondrement de Santorin.

Le changement climatique n'est-il pas de nature à multiplier les glissements de terrain, que vous avez cités parmi les causes des tsunamis ? Existe-t-il une carte mondiale des niveaux de risque ?

Lors du premier déplacement du groupe d'amitié France-Vanuatu-Îles du Pacifique, nous avions rencontré des vulcanologues et des sismologues. On nous avait interdit de nous rendre dans une région dont on sait qu'elle va complètement s'effondrer, dans six mois, six ans, ou peut-être mille ans... Les autorités ont posé des balises, mais celles-ci sont régulièrement volées. Et la population reconstruit des maisons là même où elles ont été détruites par le précédent tsunami... Du côté californien, on sait aussi qu'une catastrophe va se produire. On ne sait simplement pas dire quand.

M. Bignon souhaite une automatisation des alertes montantes et descendantes. Le problème relève moins de la technologie que de l'humain - et des effectifs. En tous cas, les responsables réfléchissent aux pistes d'amélioration. Il demande aussi l'intégration du risque tsunami aux PPRI. Dans les communes déjà sensibilisées, comme Cannes, c'est déjà fait. Ailleurs, cela n'aurait guère d'intérêt.
Les glissements de terrain dont j'ai parlé n'ont rien à voir avec le changement climatique, puisqu'ils sont sous-marins. À Nice, en 1979, ce sont les travaux sur le site de l'aéroport qui ont déclenché un premier glissement de terrain, qui en a provoqué un second, lequel a généré un tsunami qui a fait onze morts. Heureusement que cela s'est produit en octobre, et non en juillet ou en août...
Les États-Unis sont très en avance dans ce domaine, et leur centre d'Hawaï couvre une grande partie du Pacifique - y compris, désormais, l'Indonésie. Lors du premier séisme, ils ne la couvraient pas, mais ils ont alerté les autorités pour le second ; malheureusement celles-ci n'ont pas été capables de prévenir leur population, et on a déploré 500 morts.
Faut-il une carte mondiale des risques ? Pour moi, partout où il y a un peu d'eau, il y a un risque... C'est l'Unesco qui a ordonné que les mers et les océans qui n'étaient pas couverts le soient avant 2010. Nous nous sommes mis aux normes en 2012.
L'Office autorise la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu de l'audition publique sur la prévention et l'alerte du risque de tsunami sur les côtes françaises.

L'audition publique sur l'expérimentation animale a eu lieu le 17 janvier dernier. Elle avait pour objet de faire un état des lieux de l'utilisation des animaux en recherche et de faire un point sur les alternatives à l'expérimentation animale. Notre premier vice-président, Cédric Villani, présidait la première table ronde, et Florence Lassarade présidait la seconde. Cette audition s'inscrivait dans la continuité de travaux antérieurs de l'Office, puisqu'en 2009, un rapport de deux anciens collègues députés faisait un point sur l'expérimentation animale en Europe. Le sujet de la condition animale devient en effet cher - peut-être trop... - à beaucoup de nos concitoyens. Il était donc important de rencontrer les différentes parties prenantes à l'utilisation d'animaux de laboratoire pour évaluer la situation actuelle et dresser les perspectives. C'est bien aussi le rôle de l'Office d'examiner les incidences sur la recherche scientifique d'une modification éventuelle des règles en la matière.

En 2009, les députés Michel Lejeune et Jean-Louis Touraine se sont penchés sur la question. Quelles alternatives ? Quelle éthique ? Quelle gouvernance ? Pour faire le point sur ce sujet passionné, qui touche à notre sensibilité envers les animaux, le débat doit être éclairé par des faits. Qu'apportent les animaux à la recherche ? Jusqu'où les modèles actuels de substitution nous permettent-ils d'aller ? Dans quelles conditions utilise-t-on les animaux en France, par rapport à nos voisins européens et d'autres pays dans le monde ? Quelles sont les évolutions depuis la révision de la directive européenne en 2010 ?
La première table ronde réunissait des scientifiques du milieu académique, du milieu industriel et un spécialiste de l'étude du comportement animal ; des représentants des instances qui communiquent, définissent et contrôlent les conditions dans lesquelles les animaux sont utilisés ; et deux représentants d'associations de défense de la cause animale. La deuxième table ronde réunissait des spécialistes des méthodes alternatives, le représentant d'un industriel et le représentant d'une association qui finance la recherche sur méthodes substitutives.
Les sensibilités des uns et des autres ont évolué, si bien qu'on nous a assurés que les bonnes pratiques enseignées dans les formations à l'expérimentation animale allaient au-delà des normes fixées par l'Union européenne. L'Europe est plutôt en avance sur l'Asie et l'Amérique du Nord dans la prise en compte du bien-être animal - ce qui n'est pas sans conséquences sur la recherche.
Mais la France pourrait faire mieux, à l'image de certains de ses voisins -l'Allemagne et le Royaume-Uni -, en ce qui concerne les animaux utilisés dans les parcours éducatifs, dans l'enseignement secondaire et supérieur, en limitant l'accès aux animaux aux étudiants déjà bien avancés dans leur parcours, et en accompagnant l'utilisation d'animaux par une formation à l'éthique et à la bientraitance.
La question de l'efficacité des modèles - animaux ou non - a été soulevée. Les scientifiques se sont accordés sur le fait qu'aucun modèle n'est parfait, et que les différentes méthodes - in vivo, in vitro et in silico - ne doivent pas être opposées mais utilisées de façon complémentaire, car elles ne permettent pas de répondre aux mêmes questions. Les données de bio-surveillance mériteraient pour leur part d'être davantage exploitées puisqu'elles reflètent directement la physiologie humaine. Nous proposons donc d'encourager le développement d'études épidémiologiques de grande ampleur, telles qu'elles se font au niveau européen, par exemple dans le cadre du projet HEALS (Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys). Le dossier médical partagé pourrait constituer une autre piste, à condition que l'accord de ses propriétaires soit requis, que les données soient gérées de façon irréprochable, et que leur sécurité soit garantie.
Le partage des résultats non destinés à être publiés, dits résultats négatifs, devrait être encouragé, comme le proposait déjà l'OPECST en 2009. Nous continuons à soutenir cette initiative, qui pourrait bénéficier de l'expérience de bases de données telles qu'ar÷iv.
La recherche publique et la recherche privée ont insisté sur la complexité du vivant, loin d'être élucidée dans sa totalité. Ce fait rend l'expérimentation animale nécessaire, car le modèle animal est le seul à prendre en compte tous les paramètres physiologiques nécessaires à l'étude de l'effet d'un médicament, par exemple. Cependant, de nouvelles technologies prometteuses sont en développement : ainsi, la modélisation par des algorithmes peut s'avérer meilleure que des modèles animaux dans certains cas, et notamment pour les accidents vasculaires cérébraux. Nous encourageons les agences de santé françaises à accueillir favorablement les preuves de concept effectuées in silico, comme l'a fait la Food and Drug Administration aux États-Unis.
En somme, le monde scientifique ne doit pas s'isoler des revendications des citoyens. Il convient à cet égard d'insister auprès des ministres compétents pour que le décret - annoncé en 2016 - qui doit faire passer le nombre de représentants d'associations de défense des animaux au sein de la Commission Nationale de l'Expérimentation Animale (CNEA) de trois, soit un cinquième des membres, à six, soit un tiers, soit signé. Je proposerai que Gérard Longuet, Cédric Villani et moi-même écrivions aux ministres compétents en ce sens.

Non, mais elle fut très détaillée. Il y a eu peu de provocations. Chacun a pu s'exprimer. Dans le contexte actuel, il était nécessaire d'associer des représentants d'associations comme Pro Anima. Le vétérinaire qui les représentait a par exemple commencé par donner l'exemple de recherches sur le Botox, effectuées sur des chimpanzés par le passé, et qui avaient été suspendues suite à l'action d'associations de citoyens, pour lesquels il n'apparaissait pas légitime que des produits de chirurgie esthétique soient testés sur des animaux. J'ai rappelé que les expériences sur le Botox avaient, en premier lieu, servi à étudier les paralysies consécutives à la grande prématurité.
Georges Chapouthier a parlé des trois « R » : replace, refine and reduce. Pour accroître l'acceptabilité, il faut bien sûr toujours plus de transparence - mais pour autant nous sommes loin des monstruosités des années 1950. Des responsables de l'industrie pharmaceutique nous ont ainsi expliqué que les expériences se faisaient sous la surveillance de vétérinaires, au moins pour les mammifères.
J'ajouterais que cette audition était ouverte aux internautes, qui ont pu poser des questions.

Avez-vous pu discuter avec le ministre de l'utilisation d'animaux dans le secondaire ou l'enseignement supérieur ?

Les animaux vivants ne sont plus utilisés dans l'enseignement secondaire. Il n'y a que dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les écoles vétérinaires, que des animaux sont manipulés vivants. Les animaux sont aussi très utiles pour les neurosciences - où ils peuvent être bien traités. Le problème est que ces préoccupations, qu'ont les chercheurs en Europe, sont peu partagées en Asie, ce qui rend la recherche plus facile là-bas. Résultat : nos laboratoires sont défavorisés.
L'audition a été l'occasion pour certains scientifiques de préciser que l'expérimentation animale n'est pas toujours pertinente pour les humains, pour preuve, seuls 10 % des médicaments développés chez l'animal sont finalement commercialisés pour l'homme. Il y a donc eu beaucoup d'animaux sacrifiés en vain. Le terme de « reduce » a tout son sens : comme il a été dit, l'homme n'est pas un rat de 70 kg ! Ce constat appelle à envisager des modèles qui peuvent être plus performants, comme le sont parfois les techniques in silico.

Dans l'industrie pharmaceutique, ce sont des rats et souris de laboratoire qui sont utilisés, je suppose.

Oui, ils sont élevés spécialement à cet effet, par des personnels sensibilisés à leur bien-être. Pour les mammifères, se pose aussi le problème de leur « retraite ». Il existe des établissements pour héberger les singes réformés.

Cela signifie qu'ils ne périssent pas ! Mais j'imagine que cela ne concerne pas les escargots ou les poissons... ?

Les escargots pas encore, les poissons si : la règlementation concerne les vertébrés et les céphalopodes - les calmars par exemple -, mais pas les invertébrés (dont les escargots, les insectes, les vers, etc.).

Cette question est intéressante car elle traverse la société. Elle ne concerne pas que les animaux de laboratoire, mais également les gibiers. Certaines ONG ne sont pas contre la chasse elle-même mais contre le fait de tuer des animaux. Animant des tables rondes après le Grenelle de l'environnement, j'avais fait venir un sociologue qui expliquait de manière éclairante leur point de vue, assis sur l'idée que l'animal ne présentait qu'une différence de degré avec l'homme. Nous avons évolué depuis l'époque où l'on estimait pouvoir faire n'importe quoi avec les animaux de laboratoire au motif qu'ils n'étaient que des animaux... Une autre table ronde concernait alors, à l'initiative du ministre de l'agriculture Michel Barnier, l'abattage, le transport et les conditions d'élevage des animaux, tous sujets qui agitent également encore notre société. Ce qui choque dans les fermes des mille vaches n'est pas le nombre mais le traitement qu'elles subissent. Mieux vaut mille vaches bien traitées dans un grand établissement avec des vétérinaires que dix vaches dans une ferme misérable. Bref, ces problèmes dépassent la question des animaux de laboratoire. Des propositions de loi circulent sur ces questions, et nous n'avons encore rien réglé.

C'est un fait de société en effet. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur la question de la souffrance et de la douleur animale. Dans les années 1980, d'aucuns soutenaient que l'on pouvait effectuer des actes sans anesthésie sur les bébés prématurés, pour la raison qu'ils n'avaient pas encore de sensibilité à la douleur, ce que je ne pouvais pas croire ! Depuis, les progrès ont été considérables. Bref, soyons modestes dans notre approche des affaires animales, et sachons reconnaître nos erreurs, pour éviter de les commettre à nouveau.

Je suggère que le compte rendu fasse apparaître plus clairement que nous ne parlons que des mammifères. Cela pourrait par exemple figurer dans l'introduction.

Sont en réalité concernés tous les vertébrés, car les poissons aussi font l'objet d'expérimentations. Les vertébrés incluent aussi les oiseaux et les reptiles. Sont en revanche exclus de cette catégorie les insectes, les mollusques, et bien d'autres encore.

De nombreuses expérimentations sont conduites en effet sur les poissons des glaces par exemple, qui ont des sangs très particuliers.

Soit. Autorisez-vous la publication de ces conclusions et du compte rendu de l'audition ?
L'Office autorise la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu des auditions publiques sur l'expérimentation animale.

Les auditions sur l'intelligence artificielle et les données de santé ont eu lieu le 21 février dernier. Elles avaient pour objet, d'une part, de faire un point sur la question de la collecte des données de santé, d'autre part, de prendre la mesure des améliorations diagnostiques et thérapeutiques qu'une bonne utilisation de ces données rend possible. Deux tables rondes étaient organisées : l'une présidée par M. Cédric Villani, l'autre par M. Gérard Longuet. Elles ont permis des discussions approfondies et précises, notamment sur la question de la création du Health data hub par le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Les travaux de l'Office s'insèrent donc pleinement dans l'activité législative du moment.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Cette audition publique s'insère en effet parfaitement dans l'actualité parlementaire puisque le projet de loi santé est en train d'être défendu à l'Assemblée nationale par la ministre, Mme Agnès Buzyn. Les débats sont d'ailleurs intenses, puisqu'ils viennent juste de dépasser l'article 5...
La mise en oeuvre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé passe par la collecte des données, leur organisation et la régulation de leurs modalités d'accès et d'utilisation - la question de leur transformation en nouvel algorithme, en systèmes diagnostics ou en nouvelles thérapies, ne se posant qu'ensuite. Tous ces aspects, sur notre continent, relèvent de la puissance publique. Ils font l'objet d'un titre entier au sein du projet de loi sur la transformation de notre système de santé.
L'article 11, en particulier, prévoit la création d'une plateforme des données de santé (PDS), succédant à l'actuel Institut national des données de santé (INDS), et l'article 12 celle d'un espace numérique de santé, succédant au dossier médical personnalisé (DMP). La plateforme aura pour but de collecter des informations en provenance de divers acteurs - bases de données administratives, cliniques, etc. ; l'espace numérique de santé servira, lui, à accompagner les consultations et à suivre les diagnostics. Production, partage et protection des données comptent parmi les enjeux essentiels de la bonne utilisation de ces données à des fins diagnostiques et thérapeutiques, dans une relation de confiance avec les individus, sans laquelle rien n'est possible.
Deux tables rondes ont été organisées, représentant l'essentiel des parties prenantes et des enjeux, pour des auditions qui ont duré de quatre à cinq heures.
En l'état actuel de la législation et du cadre de contrôle par la CNIL, le risque majeur serait de ne pas s'ouvrir suffisamment à l'intelligence artificielle, au numérique et au pilotage des données. Le représentant de l'initiative Ethik IA nous a bien dit, comme le représentant des associations de patients, que la collecte et l'utilisation des données de santé seront essentielles à l'évolution de notre système de santé ; en cas d'excès de protection, rien ne se fera et nous irons à l'encontre de l'intérêt du patient.
De multiples illustrations médicales nous ont été données, soit diagnostiques soit thérapeutiques, en cancérologie et analyse des tumeurs, anatomopathologie, dermatologie, chirurgie, ophtalmologie, radiologie et imagerie médicale, etc. Dans certains domaines, comme le diagnostic du cancer du sein, les logiciels d'apprentissage peuvent se comparer aux meilleurs spécialistes, et la combinaison logiciel-humain fait mieux que les meilleurs spécialistes. L'intelligence artificielle permettra également d'accompagner le développement de la télémédecine et du télédiagnostic, sous réserve qu'elle ne soit qu'une aide pour le médecin - c'est souhaitable pour des questions d'efficacité et important pour la confiance et l'organisation de notre société.
Avec l'analyse de données massives de santé et le développement de la notion de patient numérique, on peut intégrer les images anatomiques et fonctionnelles, mais aussi les données biologiques - génétiques, métabolomiques, etc. - et les données comportementales ou environnementales, qui permettent d'affiner les diagnostics. Nous discutions récemment, ici même, à propos de l'évolution des lois bioéthiques, des questions relatives à la communication des risques aux patients : ces enjeux d'information des patients sont majeurs.
Second risque : si nous ne développons pas suffisamment ces algorithmes, ils seront, dans un marché mondialisé, développés à l'étranger. Mieux vaudrait utiliser des algorithmes correspondant à nos règles et à nos habitudes, plutôt que ceux conçus aux États-Unis ou en Chine - pour ne citer que les acteurs les mieux identifiés dans ce domaine.
La future plateforme des données de santé et l'espace numérique de santé seront tous deux des outils très importants pour compléter les données, les rassembler et permettre de développer de nouvelles solutions. Il faudra de bonnes capacités de collecte et la confiance des individus dans le système. En règle générale, lorsqu'on leur pose la question dans les formes, les gens sont massivement d'accord pour que leurs données soient collectées. L'enjeu est davantage de systématiser la demande que d'ajouter des protections, même s'il faudra naturellement des garanties de protection, préserver le rôle de la CNIL et mieux informer les personnes.
Pour relever ce défi, nos tables rondes ont d'abord identifié un enjeu technique à relever : l'organisation informatique n'est pas encore au niveau. La plus célèbre de nos bases de données en la matière, le Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (Sniiram) est vieillissante. De même, l'interopérabilité des systèmes d'informations est un axe essentiel, ainsi que la capacité à disposer des bons formats et de bons matériels. L'utilisation maintenant permise, sinon obligatoire, du numéro de sécurité sociale, l'INS, est un élément majeur dans cette perspective. L'impossibilité, naguère, de l'utiliser comme identifiant universel a été un frein puissant au développement des systèmes d'information.
L'enjeu est également financier. Le coût du système national des données de santé a été chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros, en raison du sous-investissement historique de notre pays ; il faudra s'assurer de ce financement. Plus globalement, nous aurons besoin de ressources humaines, sachant que ces ressources sont très convoitées : il faudra une grande force de persuasion pour convaincre les ingénieurs de travailler dans ces institutions plutôt que dans le secteur privé, où les salaires peuvent être quatre ou cinq fois plus élevés. Il leur faudra en particulier la garantie que leur action aura de l'impact, c'est-à-dire qu'ils ne s'acharnent pas à développer un projet mort-né.
Plusieurs intervenants se sont interrogés sur le choix du statut juridique de cet outil. Le ministère a choisi le statut de groupement d'intérêt public (GIP) pour ce Health data hub. Le représentant de la ministre a indiqué que celle-ci avait privilégié cette formule pour garantir à nos concitoyens que le statut public resterait majoritaire dans cette structure et que l'État serait bien garant de la protection et du traitement des données de santé. Le GIP-INDS est actuellement constitué entre l'État et des organismes représentant des patients et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé - y compris des organismes de recherche en santé.
Jeanne Bossi-Malafosse, faisant référence aux GIP existants, tels le GIP-CPS, le GIP-DMP ou encore le GIP Asip-Santé - à la création duquel elle a participé -, a souligné que la création d'un GIP a été chaque fois choisie pour gérer des sujets particuliers, mais que cette forme de gouvernance était source de complexité et allongeait les délais de mise en oeuvre. En clair, un GIP est lourd et lent : chaque modification requiert un certain nombre d'accords ; la seule mise en place du GIP-INDS a nécessité dix-huit mois... Dans le climat d'urgence actuel, nous ne voulons surtout pas attendre autant !
Un consensus s'est clairement dégagé parmi les intervenants - chercheurs, juristes ou représentants de l'administration -, pour souligner l'importance d'une structure agile pour assurer le succès de la plateforme des données de santé. Il est certain que le nombre important d'acteurs représentés dans la gouvernance des GIP, chaque membre étant représenté et pouvant s'opposer à des élargissements, constitue une source de blocages récurrents qu'il faut éviter de transmettre à la future plateforme des données de santé.
La comparaison des avantages et inconvénients des différentes formules a conduit à préconiser que la plateforme des données de santé prenne plutôt la forme d'une société par actions simplifiée (SAS), plutôt que celle d'un GIP comme le prévoit le projet de loi, à la condition que la loi impose que cette SAS demeure majoritairement détenue par l'État ou par ses établissements publics. Les avantages de cette formule sont multiples. D'abord, la gouvernance d'une SAS est beaucoup plus flexible que celle d'un GIP et pourra évoluer de manière souple au regard des enjeux. Ensuite, l'adaptation à des projets développant une activité commerciale et visant à attirer des compétences plus généralement trouvées dans le secteur privé - ingénieurs, développeurs, data scientists... - sera facilitée. La forme SAS facilitera d'éventuels partenariats avec l'écosystème privé, tout en assurant la poursuite d'une mission d'intérêt général - nous en débattions déjà lors de l'examen de la loi sur la protection des données personnelles. Le conseil d'administration et le capital devraient en tout état de cause demeurer majoritairement publics. Sur le plan stratégique, une forme souple, réactive, serait un signal fort de modernité et d'attractivité à l'international, mais aussi pour nos entrepreneurs, qui ont pour l'heure le sentiment d'être plus souvent présentés comme des assoiffés de bénéfice plutôt que comme des preneurs de risques pour la médecine du futur.
J'en viens aux recommandations de l'Office. Dans un contexte dans lequel tant la position des patients que les réflexions sur l'éthique mettent l'accent sur le fait que le risque principal serait de ne pas s'ouvrir à l'intelligence artificielle, il faudrait d'abord élaborer une doctrine pour la future plateforme des données de santé qui s'inscrive pleinement dans la concurrence et l'exigence d'attractivité internationales.
Nous proposons également de réguler l'utilisation des données de santé pour des algorithmes et des applications d'intelligence artificielle en s'appuyant sur deux dispositifs : d'une part, sur la CNIL, d'autre part, sur un comité consultatif national d'éthique pour les technologies numériques et l'intelligence artificielle, que le professeur Delfraissy est en train de mettre sur pied, sur le modèle de l'actuel Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Nous recommandons en outre de garantir dans la loi le contrôle de la future plateforme de données de santé par l'État et plus généralement les organismes publics, et de retenir une formule de gouvernance aussi souple que possible, la formule la plus adaptée étant celle du statut de SAS.
Concernant plus spécifiquement les projets de recherche sur les personnes, nous préconisons, à la suite des observations de Jeanne Bossi-Malafosse, de réexaminer l'ordonnance du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine, pour supprimer ou limiter les difficultés juridiques résultant de la définition des recherches non interventionnelles dans la loi Jardé de 2012 et de leur modification par l'ordonnance précitée. Mme Procaccia nous dira peut-être où en sont les travaux de la commission des affaires sociales du Sénat sur ce point.
J'ai déposé un amendement en commission des affaires sociales pour transformer le GIP envisagé par le Gouvernement en SAS ; il a été battu d'une courte majorité, la plupart des collègues préférant s'abstenir... Nous sommes convenus avec le cabinet de la ministre que les débats se poursuivraient ; ils n'ont pas encore abouti. Un malentendu subsiste sur la rédaction de l'amendement, la ministre n'étant pas persuadée que la SAS que nous proposons resterait éternellement sous capital et gouvernance majoritairement publics ; nous nous employons à la rassurer sur ce point.
Souplesse, travail avec tout le monde, urgence à mettre les choses en place : voilà en tout cas les mots d'ordre issus des deux tables rondes.

La commission des affaires sociales a en effet travaillé sur la loi Jardé, qui a soumis tous types de recherches impliquant la personne humaine, interventionnelles ou non interventionnelles - c'est-à-dire les simples observations - à l'avis des comités de protection des personnes. Mais comme je ne suis plus membre de la commission des affaires sociales, j'ai soumis les conclusions du rapport de l'Office relatives aux recherches non interventionnelles à son président Alain Milon, qui m'a dit son accord avec elles.

Nous n'en avons pas encore débattu au sein de la commission des affaires sociales. Ce qui m'inquiète est moins l'utilisation des données que leur recueil. Le dossier médical partagé marche très mal. Nous, pédiatres, faisons habituellement le compte rendu de nos consultations sur le carnet de santé de l'enfant, qui est très détaillé. Cela ne me dérangerait nullement de faire la même chose sur un dossier médical partagé, mais mes confrères généralistes y voient une tâche administrative supplémentaire source de perte de temps...
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Le problème est en effet moins celui du patient, sur lequel on s'est beaucoup focalisé alors qu'il est la plupart du temps d'accord pour confier ses données, que du médecin, qui n'est pas forcément à l'aise avec le numérique, ou n'a pas l'envie ou le temps de s'y consacrer ! Nos collègues israéliens nous ont dit de manière un peu crue que leurs médecins avaient râlé mais qu'ils n'avaient pas eu le choix, étant employés par les caisses d'assurance !

Lorsqu'Alain Juppé, en 1996, a impulsé l'informatisation des cabinets, il s'est heurté à une forte réticence, et ce n'est qu'en dégageant des incitations financières qu'il a pu faire avancer les choses. Il faudra en passer par là pour faire participer le médecin - à moins que l'on recoure au fameux assistant médical, dont nous ne savons pas encore grand-chose.
D'autres systèmes marchent bien, tel le PAACO/Globule dans les Landes, qui consiste à partager les données entre tous les intervenants - aides-soignants, infirmières, médecins, etc. La collecte des données n'est-elle pas plutôt un travail d'équipe ? Les jeunes internes que nous avons reçus récemment à la commission des affaires sociales veulent consacrer le plus de temps possible aux actes cliniques, et le moins possibles aux tâches administratives.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Nous mesurons bien cette tension.

Tout cela est très intéressant, mais il va falloir articuler le dossier médical partagé avec les plateformes de télémédecine. Cela va vous étonner, mais l'Essonne, aux portes de Paris, est un désert médical à 70 %, et c'est le cas d'autres départements pourtant proches de métropoles. En conséquence de quoi les plateformes fleurissent partout - début avril, nous en inaugurons encore une dans le sud de mon département. Or cela ne va pas sans contradictions. D'après Agnès Buzyn, de nombreux actes de soin ou examens doivent encore être autorisés par le médecin traitant ; absurde, répondent les médecins travaillant pour les plateformes, puisque celles-ci ont vocation à pallier l'absence de médecins sur le terrain !
Tout cela posera des questions éthiques complexes. Des pharmaciens essaient même d'ouvrir leurs propres plateformes : qui assumera alors la responsabilité d'un mauvais diagnostic ou d'un mauvais examen ? J'ignore dans quelle mesure la e-santé remplacera les humains, mais elle posera d'énormes problèmes. Sur tous ces aspects, il va falloir faire très attention.

Vous proposez que l'Office recommande de « garantir dans la loi le contrôle de la future plateforme de données de santé par l'État ». Nous allons indiscutablement vers la numérisation des données de santé, et même de toutes les données de notre vie, d'ailleurs, et nous savons qu'aucun système n'est infaillible. Le créateur d'Internet disait récemment qu'il incombait à chacun de se constituer un coffre-fort de données sensibles, au moyen de la blockchain par exemple, car les données sont attaquées en permanence. Les actes malveillants sur nos données de santé pourraient avoir un impact sur nos contrats d'assurance et de mutuelle. C'est une forme de saut dans l'inconnu que nous faisons ; comment nous prémunir de ces risques ? Légiférer ainsi, c'est bien, mais comment garantir que le système de sécurisation de nos données sera assez performant ?

Je suis sensible au fait que l'État trouve un moyen de rester propriétaire, sans en rabattre sur la souplesse et l'agilité. La SAS semble un bon moyen d'y parvenir. Le mécanisme des golden shares permettrait sans doute cet équilibre ; il faudrait voir si c'est compatible, dans ce domaine, compte tenu des missions confiées à la structure envisagée, avec le droit européen, qui l'a remis en cause en matière commerciale. Distinguons en outre l'enjeu de la propriété de la plateforme de celle de la protection contre le piratage. Ma question porte plutôt sur le premier aspect : comment empêcher l'aliénabilité de la plateforme ? La solution trouvée avec le Conservatoire du littoral est intéressante, qui rend inaliénables les terrains qu'il achète. Aux juristes de trouver des solutions analogues.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Les habitants de l'Essonne, qui ne passe pourtant pas pour un département défavorisé, manquent en effet de tout, notamment de médecins.
Pour rendre justice aux échanges de nos tables rondes, précisons que les plateformes n'ont jamais été envisagées comme des solutions aux déserts médicaux. Nous cherchons des médecins augmentés, plutôt que des algorithmes médecins. Cela passe par conséquent davantage par la formation des médecins, la manière de les acculturer, la transformation des programmes universitaires, etc. L'évolution est en cours, quoique variable d'une spécialité à une autre.
C'est un sujet que l'hôpital devra également s'approprier. L'hôpital de Paris-Saclay, je l'ai dit à son comité de surveillance, devra avoir le bon niveau de coopération avec les universités pour développer les bonnes procédures. Certains acteurs privés de l'intelligence artificielle vont d'ailleurs démarcher les hôpitaux pour leur proposer non pas des diagnostics améliorés, mais une organisation améliorée.
On ne peut certes pas, monsieur Piednoir, garantir par la loi l'absence de piratage - nous aurions l'air malin à l'interdire... Pour sécuriser les données, il faut du bon matériel et des personnes de qualité. En matière de cybersécurité, nous sommes, en France, particulièrement sous-dotés au regard des besoins, de même qu'en matière d'analyse de données pour l'intelligence artificielle.
Compte tenu de la rareté et de l'importance stratégique de ces ressources humaines, elles sont très convoitées. Même avec la solution GIP, il sera important de leur faire des contrats de travail compétitifs. En clair, avec les grilles classiques de fonctionnaires, il n'y a aucune chance d'attirer les meilleurs à l'échelle internationale.
C'est une position pragmatique au regard de la qualité de service que l'intérêt général réclamerait. De tels recrutements sont plus faciles dans le cadre d'une SAS que d'un GIP, où ils nécessiteraient un statut dérogatoire, et le visa d'autres administrations.
Outre les questions techniques, matérielles et technologiques, il faut prendre en compte la discipline des utilisateurs - bonne information, gestion et archivage des fichiers, prise en charge des mots de passe, par exemple. La discipline est aux politiques de confidentialité ce que l'hygiène est aux politiques de santé. Enfin, la chaîne de commandement, l'organisation humaine devront être conçues de manière à limiter autant que possible les risques de piratage.
Dernier point, les golden shares. M. Bignon, pouvez-vous développer ce point ?

C'est un type d'actions inaliénables, que l'État pourrait détenir au sein de la SAS, avec des droits spécifiques attachés.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Cela répondrait peut-être à notre objectif consistant à garantir que l'État reste actionnaire dans une proportion d'au moins deux tiers. Nous proposons d'écrire dans la loi que toute décision contraire du conseil d'administration serait nulle et de nul effet.

Cette construction me semble viable. Si l'objet de la société est commercial, une participation majoritaire de l'État pose problème au regard du droit de la concurrence et la Commission européenne est fondée à intervenir, mais pas si l'objet est stratégique et d'utilité publique.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Le ministère craint avant tout le pouvoir des mots : la discussion porte moins sur les aspects techniques que sur leur perception par les médias. Pour contrer ces peurs, il convient de mettre en place un contre-narratif clair et précis : par exemple, l'inscription dans la loi d'une règle garantissant que l'État restera toujours propriétaire de la société. Il faudra faire preuve de vigilance, sachant qu'il reste mille amendements à examiner dans le projet de loi santé, mais la navette parlementaire peut justement contribuer à faire avancer ce sujet.

Je vous propose d'autoriser la publication de ces conclusions. Cette réunion permettra au Sénat de mûrir sa réflexion d'ici à l'examen du texte santé, en principe au mois de juin.
L'Office autorise la publication du rapport d'information présentant les conclusions et le compte rendu de l'audition publique sur l'intelligence artificielle et les données de santé.

Ces auditions, qui ont eu lieu le 24 janvier dernier, avaient pour l'objet de faire un point sur les menaces de captation de savoirs et technologies sensibles et de faire le bilan des procédures relatives aux zones de recherche à régime restrictif, dites ZRR.
La première audition sous forme de table ronde, présidée par Gérard Longuet, s'est déroulée à huis clos, en raison du caractère sensible de certaines informations qui ont été évoquées à cette occasion. La seconde, présidée par Cédric Villani était ouverte à la presse. Je cède la parole à ce dernier pour la présentation des conclusions de cette audition.
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - C'est un sujet dont j'ai eu à connaître en tant que directeur de laboratoire. Il se traitait de façon fermée et quelque peu traumatisant pour la communauté scientifique, en raison d'une divergence entre la volonté des autorités chargées de la sécurité nationale d'éviter tout risque d'espionnage et la volonté des scientifiques de travailler dans un contexte ouvert, accueillant et international. Les représentants de la sécurité nationale estimaient qu'il leur appartenait de décider de ce qui était bon pour les scientifiques, tandis que ces derniers revendiquaient leur liberté d'organisation.
La première table ronde sur les menaces et les risques, confidentielle, a réuni les principaux responsables de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST) de la nation ; secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) du ministère de l'intérieur et Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
Les intervenants ont exposé les menaces et risques de captation de savoirs, savoir-faire et technologies - thésards espions, récupération de documents par exemple. Le dispositif des ZRR, au coeur de la PPST de la France, a été rappelé : accès physiques sécurisés, autorisation des personnels travaillant dans la zone après enquête, protection informatique, procédures de concertation entre les directeurs d'unité et les services chargés de la sécurité avec un collège d'experts et des sous-commissions thématiques. C'est un régime très restrictif, alors que les laboratoires scientifiques préfèreraient disposer d'outils de réponse à la menace.
La deuxième table ronde, ouverte à la presse, a réuni le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) adjoint des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) et de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ), et des chercheurs de plusieurs disciplines. Les responsables de laboratoires en sciences de la vie, agronomie et sciences de l'environnement et sciences pour l'ingénieur (mécanique), ont montré qu'ils avaient bien intégré le dispositif des ZRR. En revanche, leurs homologues des laboratoires de mathématiques, d'informatique et de physique ont exprimé de vives critiques à son encontre : délais d'autorisation des candidats, frais de protection physique et logicielle, surcoût administratif de gestion, insuffisance du dialogue avec les services chargés de la sécurité, incompréhension des décisions prises. Pour les seuls candidats étrangers, le délai moyen d'autorisation d'accès est de 34 jours et le taux de refus est de 3,8 %, contre respectivement 16 jours et 1 %o1(*) pour les français. En aparté, on nous a indiqué que certains pays, l'un d'entre eux en particulier, posaient de vrais problèmes.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HDFS) adjoint qui participait à la table ronde a formulé trois propositions. : un « contrat PPST » avec les directeurs d'unité (DU) et les établissements, comportant des garanties en matière de concertation et d'échanges ; l'expérimentation d'une procédure simplifiée pour les avis sur demande d'accès, qui réduirait les délais de moitié ; un travail d'aménagement du dispositif réglementaire, par discipline.
C'est en mathématiques que la contestation des ZRR a été la plus violente, à tel point que les directeurs de laboratoire dans cette discipline ont envisagé une démission collective. L'un des objectifs de la table ronde était de mettre les parties en présence et de confronter leurs positions, pour parvenir ensuite à un éventuel accord.
En conséquence, je propose de conclure dans les termes qui suivent.
L'Office rappelle d'abord que, si les activités de recherche sensibles nécessitent une protection, la liberté académique et l'ouverture internationale des scientifiques, principes fondamentaux du développement des connaissances, doivent être préservées. Le maintien de l'excellence de la recherche française nécessite l'échange des idées et l'attraction des meilleurs chercheurs et étudiants dans ses laboratoires. Le souci de l'efficacité de la recherche est essentiel pour garder les laboratoires français au meilleur niveau international. Nous retrouvons ici la même tension entre sécurité et efficacité que dans le précédent sujet.
L'Office estime également que, depuis 2012, le dispositif des ZRR a été mis en place de façon trop rigide et contraignante, avec une concertation insuffisante. D'où une gêne considérable pour les laboratoires, qui a été plus ressentie dans certaines disciplines scientifiques comme les mathématiques, l'informatique ou la physique que dans les sciences de la vie, déjà soumises à des contraintes et procédures très importantes qui leur rendent plus acceptable ce type de restrictions.
L'Office regrette que la PPST repose sur une logique binaire : soit un classement en ZRR entraînant une application uniforme de toutes les contraintes sans tenir compte de la particularité des disciplines et des laboratoires, soit une absence de classement exonérant le laboratoire de toute discipline. Or un algorithme ne réclame pas nécessairement le même type de protection qu'un virus...
À cet égard, l'Office prend acte des déclarations du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HDFS) adjoint : selon ce dernier, les enquêtes précédant une demande d'accès à une ZRR ne se limitent pas à l'utilisation de mots clés ou à la nationalité du candidat, comme avancé par certains scientifiques lors de l'audition, mais reposent sur une étude approfondie au cas par cas ; les publications des chercheurs des ZRR ne sont pas obligatoirement soumises à un régime d'autorisation préalable, tout dépend de ce qui est prévu dans le règlement intérieur de la ZRR.
L'Office souhaite rester en contact avec la communauté scientifique en organisant une nouvelle table ronde, dans un délai à déterminer en fonction des avancées constatées, mais en tout cas dans une limite de deux ans.
L'Office recommande la mise en place d'une procédure de recours interne des décisions prises dans le cadre de la création et de la gestion des ZRR. Cette procédure serait confiée à trois personnes : l'une représentant les sciences et devant être une personne à la légitimité incontestable et reconnue, habilitée confidentiel défense ; la deuxième représentant les services de l'État en charge de la sécurité ; et la troisième avec un profil plus juridique et dont l'indépendante serait assurée.
L'Office estime, au vu de tous ces éléments, que les problèmes rencontrés par les laboratoires de recherche français ne relèvent pas des seules modalités d'applications du dispositif des ZRR et recommande, en conséquence, un véritable changement de doctrine et d'état d'esprit dans la mise en oeuvre de la PPST.
L'Office souhaite que l'on s'inspire des pratiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ne sont pas réputés naïfs en matière de sécurité, pour : adapter le dispositif des ZRR aux spécificités des différentes disciplines scientifiques ; protéger des projets sensibles au cas par cas, plutôt que des secteurs ; s'appuyer sur une plus grande responsabilisation des chercheurs, avec des actions de formation et d'information, plutôt que sur des mesures contraignantes ; et développer une culture de sécurité de tous les acteurs pour permettre, au-delà des seuls laboratoires sensibles, une prise de conscience des enjeux de la recherche en termes de compétition internationale, de propriété intellectuelle, de valorisation de l'innovation et de défense nationale.
Enfin, l'Office recommande un effort en matière d'éducation sur la sécurité informatique, qui doit être réalisé dès le collège, pour la diffusion d'une meilleure « hygiène informatique ».
Avec le rapport que nous avons présenté la semaine passée, nous avons eu peu de temps pour regarder ce sujet mais ces conclusions nous paraissent tout à fait satisfaisantes en l'état.

Les scientifiques devaient être satisfaits que l'Office s'intéresse à la question des ZRR ?
député, premier vice-président de l'Office, rapporteur. - Ils étaient heureux que le Parlement s'en empare. Pour les scientifiques, le face-à-face avec les représentants des ministères chargés de la sécurité, souvent convaincus de leur naïveté, peut être délicat.

Je propose que nous autorisions la publication de ces conclusions.
L'Office autorise la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu des deux auditions, sous forme de tables rondes, sur les zones à régime restrictif (ZRR) dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation.
La réunion est close à 11 h 45.
* 1 Un pour mille.