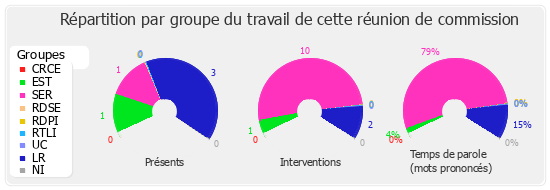Mission d'information sur la gestion des risques climatiques
Réunion du 4 avril 2019 à 16h10
Sommaire
- Audition de mm. stéphane roy directeur des actions territoriales et pierre pannet directeur régional hauts-de-france du bureau de recherches géologiques et minières brgm (voir le dossier)
- Audition de mm. valéry laurent chef du service « normalisation » et didier valem chef du service « qualité-construction » et de mmes marina grosjean chargée d'études au service « assurance » et annabelle lavergne membre de la direction des relations institutionnelles de la fédération française du bâtiment ffb (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mm. Stéphane Roy directeur des actions territoriales et pierre pannet directeur régional hauts-de-france du bureau de recherches géologiques et minières brgm
Audition de Mm. Stéphane Roy directeur des actions territoriales et pierre pannet directeur régional hauts-de-france du bureau de recherches géologiques et minières brgm

Nous reprenons les auditions de notre mission d'information consacrée aux risques climatiques.
Nous recevons tout d'abord M. Stéphane Roy, directeur des actions territoriales, et M. Pierre Pannet, directeur régional Hauts-de-France, du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Je rappelle que le BRGM est un établissement public d'État, qui constitue le service géologique national. À ce titre, il assure des missions de recherche scientifique en matière de sols, mais également d'appui aux politiques publiques.
Nous avons souhaité vous entendre compte tenu du lien étroit qui existe entre les questions géologiques et les phénomènes climatiques, en particulier en matière de sécheresse et de retrait-gonflement des argiles. Le BRGM mène également des travaux sur les risques côtiers, qui intéressent notre mission d'information en raison des effets du changement climatique - en particulier l'élévation du niveau des océans - sur ces phénomènes.
Merci de votre accueil, nous sommes très honorés d'être invités à participer aujourd'hui à cet échange. Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial sous triple tutelle - du ministère de la recherche, du ministère de l'environnement et du ministère de l'économie - dont la vocation scientifique est de comprendre les mécanismes géologiques. La géologie ne recouvre toutefois qu'une partie de nos activités. Avec environ mille collaborateurs, le bureau compte en son sein des mathématiciens, des géographes, des géologues, des chimistes, des physiciens entre autres, et il est présent dans tous les territoires, en métropole et outre-mer, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, avec au total vingt-cinq antennes. Nous avons donc une approche concrète des sujets et de la situation des territoires.
La connaissance du sous-sol fait bien sûr partie de nos compétences intrinsèques, avec la mise à disposition de données, la gestion intégrée et durable des sols ainsi que des ressources en eau. Nous traitons également de la question des risques, du recyclage et de l'économie circulaire, ainsi que de la transition énergétique, avec, notamment, la géothermie, une source d'énergie renouvelable qui représente un potentiel important, notamment en métropole. La question des risques représente à peu près 20 % de l'activité de l'établissement, soit une part très significative.
Quels sont les risques géologiques et côtiers ? Il s'agit principalement des inondations, avec les débordements de cours d'eau, le ruissellement, les coulées de boue, qui sont en lien avec le contexte géologique particulier, et la remontée de nappe, mais aussi du retrait-gonflement des argiles lié à la sécheresse - la France étant peu confrontée au gonflement -, du recul du trait de côte, une question prégnante, notamment dans le contexte du changement climatique et de montée du niveau marin, de l'affaissement ou de l'effondrement lié à la présence de cavités souterraines, et enfin des mouvements gravitaires - glissements de terrain ou de blocs -, des mouvements certes ponctuels, mais qui peuvent être très violents. Ces risques ont, de près ou de loin, un lien avec le climat, et donc avec le changement climatique. Le dernier risque géologique, le risque sismique, est, quant à lui, inhérent aux forces internes de la planète.
Les inondations et le retrait-gonflement des argiles lié à la sécheresse constituent pour moitié les phénomènes causant des dommages, l'autre moitié étant due aux tempêtes, à la grêle et à la neige. Le phénomène du retrait-gonflement des argiles est évidemment ponctuel : depuis la fin des années 1980, les dommages liés à ce phénomène se chiffrent à 11 milliards d'euros, avec un pic à 1,6 milliard en 2003.
Nous ne disposons pas encore des chiffres pour l'année 2018, mais les coûts devraient avoisiner ceux de 2003. Nous travaillons en lien avec les caisses d'assurance, et ces chiffres nous sont d'ailleurs fournis par l'Association française de l'assurance. À l'horizon de 2050, le coût des dommages pourrait augmenter de 50 %.
Pour ce qui concerne la prévention des risques, le BRGM a trois missions. Premièrement, la connaissance, la recherche et développement (R&D), avec l'analyse et la description des processus de mise en place des phénomènes de risques naturels, le développement de méthodes et d'outils d'acquisition de données et d'analyses, les modélisations et la mise au point de méthodologies permettant la prévention la plus précise possible en fonction de l'avancement des technologies. Le rapport coût-bénéfice de la prévention est nettement positif sur le long terme. Deuxièmement, l'appui aux politiques publiques, en matière de gestion des catastrophes naturelles et de prévention, avec un développement méthodologique pour les services de l'État, dans le cadre de l'établissement de plans de prévention des risques (PPR). Troisièmement, enfin, l'information à destination du grand public ou des élus, via deux sites en particulier : www.infoterre.brgm.fr et www.georisque.gouv.fr.
La connaissance est fondamentale dans la prévention des risques. À cet égard, je prendrai l'exemple de la gestion du risque lié aux cavités souterraines en milieu urbain. Jusqu'à présent, les inventaires nous permettaient d'avoir des informations partielles pour cibler les zones les plus à risques. Le milieu urbain étant très complexe - de nombreux bâtiments, de nombreux réseaux, une impossibilité de condamner une rue ou un quartier -, nous n'étions pas capables d'entrer dans le détail. Aussi, il nous a paru nécessaire de développer des méthodes adaptées qui soient non destructives, non sensibles à la présence de réseaux, non impactées par la présence de bâtiments et spatialement « intéressantes », c'est-à-dire capables de traiter des quartiers entiers en un temps assez court.
Dans la ville de Reims, le BRGM a pu faire une échographie du sous-sol pour imager les anomalies. Le développement de modèles de correction a permis de modéliser le milieu urbain, la masse ou le déficit de masse, donc les cavités. Nous avons donc une image du sous-sol sans l'impact des bâtiments. Dans le même temps, grâce à l'acquisition de la 3D de haute précision, des diagnostics de stabilité très précis ont été réalisés ; on voit ainsi les vides souterrains sur le graphique qui vous est présenté.
Il peut y avoir des souterrains naturels dans les villes, mais la plupart d'entre eux ont été creusés par l'homme à un moment ou à un autre.
Nous n'avions alors qu'une connaissance des vides existants selon les endroits de l'ordre de 20 à 50 %. Avec cette nouvelle méthode, nous pouvons retrouver les zones de vide, les quantifier en trois dimensions - 400 crayères sont utilisées par les maisons de champagne, alors qu'on en a recensé 2 000 - et nous avons développé des modèles de correction pour calculer l'effet théorique de ces vides. Nous pouvons donc traiter de manière exhaustive le risque lié à la présence de cavités souterraines en milieu urbain.
Notre mission est de faire de la recherche pour être le plus précis possible dans la prévention des risques. Auparavant, en cas de suspicion de cavités, soit on ne faisait rien, et on faisait prendre des risques à la population, soit on condamnait des quartiers complets, ce qui faisait perdre de la surface et diminuait la valeur des biens immobiliers. Aujourd'hui, à l'intérieur d'une même parcelle, on sait définir les différents aléas. C'est une grande avancée dans la prévention.
La problématique est la même pour ce qui concerne le littoral. L'éboulement majeur qui s'est produit récemment à Dieppe a détruit une habitation. On a alors découvert un contexte géologique peu connu, mais particulièrement impactant, qui pourrait se reproduire dans les zones fortement urbanisées. Grâce à la R&D, les méthodologies ont été adaptées pour mesurer le risque avec précision à différents termes - dix, trente et cent ans -, lequel est aujourd'hui inclus dans la carte réglementaire.
Cette évaluation des risques est extrêmement éclairante en termes d'aménagement du territoire.
Nous l'avons fait pour quelques communes, notamment celles qui rencontrent des problèmes.
La prévention est un investissement en soi. Cette étude a coûté entre 300 et 400 000 euros à la ville de Dieppe. Toutefois, cela correspond à peu près au prix de la maison qui s'est effondrée. Sur le long terme, cet investissement est donc positif.
C'était une demande de la direction départementale des territoires (DDT).

Vous pourriez donc analyser toutes les côtes pour évaluer les risques à plus ou moins long terme ?
Tout à fait. Techniquement, nous sommes capables de le faire sur les côtes rocheuses et les côtes sableuses pour l'ensemble de la France.
Nous avons analysé une bonne partie de la côte aquitaine, quelques communes de la Méditerranée, ainsi que d'autres territoires, comme la commune d'Ault dans la Somme, par exemple.
Je pense que oui.
Le PPR fixe une prévision à cent ans ; mais nous sommes capables de prévoir le risque à différents termes : dans un terme imminent, à dix ans, cinquante ans, cent ans. Plus on s'éloigne dans le temps et plus les projections sont évidemment soumises à des variables climatiques.

J'ai cru comprendre que le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) réalisait le même type d'études, à la demande du Gouvernement.
Le Cerema peut réaliser ce type d'études dans certains cas. Ce que le Gouvernement lui a demandé est un état des lieux entre 1950 et aujourd'hui, en vue de définir les zones dans lesquelles on voit poindre des risques supérieurs à d'autres.

Pour compléter les propos de Didier Mandelli, il nous semble que le Cerema a été chargé de faire davantage qu'un simple état des lieux. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?
Avec le Cerema, nous travaillons plutôt dans un continuum. Les méthodologies que nous vous présentons sont en cours d'élaboration, et nous les testons sur le terrain. Le Cerema, qui est un établissement public administratif, oeuvre en aval, en appui aux collectivités. L'approche entre les deux organismes est commune ; nous sommes très rarement en concurrence.

Je vous remercie pour cet exposé. Je me réjouis que le BRGM soit présent dans tous les territoires. Compte tenu de votre méthodologie et de vos implantations locales, pourquoi ne contribuez-vous pas aux études lors de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ? Je suis élue de Charente, territoire victime de la sécheresse depuis plusieurs années. Les sinistrés ne comprennent pas que telle commune ne soit pas reconnue en état de catastrophe naturelle, alors que telle autre l'est. La commission interministérielle s'appuie, pour rendre son avis, sur l'outil SIM, une méthode de modélisation utilisée par Météo France que je ne conteste pas, mais qui est très peu intelligible. D'autant plus que le Cerema nous a indiqué qu'il n'y avait pas de dossier technique produit pour la reconnaissance des sécheresses. Pourquoi le BRGM n'est-il pas plus impliqué ?
Dans les années 2000, l'État nous a demandé de réaliser la carte nationale des aléas à l'échelle 1/50 000e. On connaît donc les zones à risques. Pour qu'un territoire soit reconnu en état de catastrophe naturelle, l'État prend en compte, à juste titre ou non - il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce point - les critères météo au travers de l'outil SIM. La France est découpée en mailles de huit kilomètres de côté, avec quatre différenciations possibles d'un point de vue météo, le couperet étant la récurrence de vingt-cinq ans, ce qui est énorme, surtout dans le contexte actuel de changement climatique.
Il devient de plus en plus contraignant.

Les sinistrés ne comprennent pas. La sécheresse de 2016 a été plus forte que les précédentes, mais elle n'a pas été reconnue.
Si la sécheresse de 2003 se produisait aujourd'hui, moins de communes seraient reconnues en état de catastrophe naturelle du fait des statistiques. Précisons qu'en 2050 une telle sécheresse serait récurrente une fois tous les trois à cinq ans, ce qui est considérable.
La carte de la France disponible sur le site www.georisques.gouv.fr présente à l'échelle 1/50 000e les aléas liés au retrait-gonflement des argiles. Dans la Charente, par exemple, les aléas sont moyens et forts.

Cet outil ne pourrait-il pas être mieux utilisé dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ?
On peut affiner cette étude, mais, pour être clair, il s'agit davantage d'une question politique que scientifique. Aujourd'hui, la majorité des sinistres ne sont pas reconnus en état de catastrophe naturelle. Pourtant, même sans récurrence de vingt-cinq ans de sécheresse, les dégâts peuvent être considérables. C'est tout ce que je peux dire d'un point de vue scientifique.
Ce sont les critères qui sont appliqués pour classer un territoire en état de catastrophe naturelle. Vu l'évolution du changement climatique, il conviendrait peut-être de les modifier.
Les simulations montrent que, à l'horizon de 2050, les coûts liés à la sécheresse seront supérieurs de deux fois ou deux fois et demie à ce qu'ils sont aujourd'hui.
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), modifie les modalités de prévention de ce risque, en fixant des prescriptions en matière de construction. Cette mesure va dans le bon sens pour la prévention des risques.

Intervenez-vous dans les secteurs de montagne ? Les évolutions que connaissent les glaciers ont des conséquences en chaîne. Quels liens avez-vous avec les services de restauration des terrains de montagne (RTM) ?
À ma connaissance, nous intervenons assez peu en montagne, pour ne pas être en concurrence avec les services de RTM. Dans ces zones, nous travaillons principalement sur les problématiques de chutes de blocs ou de coulées de boues.
Nous menons des travaux en commun, mais nous évitons de travailler sur les mêmes sujets. Nous apportons des compétences complémentaires en cas de besoin.

Je ne reviendrai pas sur l'exemple de Dieppe, mais la Normandie compte de nombreuses marnières. J'ai interrogé le ministre à cet égard. Ces données sont prises en compte dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Un constat : la situation est difficile à gérer pour les élus. Certains d'entre eux veulent revitaliser leur territoire, mais ne peuvent pas construire.
Vous avez pris le cas de Reims. Quand vous découvrez des cavités vides, comment cela se passe-t-il avec les élus locaux, qui doivent - une nécessité raisonnable -reconstruire la ville sur la ville ? Intervenez-vous pour leur interdire de reconstruire ?
Je connais bien le phénomène des marnières pour avoir été ingénieur risques en Normandie, spécialiste des marnières. Ces cavités sont le cas le plus compliqué. Un projet méthodologique a été tout récemment validé par la DDT de Seine-Maritime, en collaboration avec la chambre d'agriculture et quelques services urbains, pour définir des méthodes d'échographie du sous-sol, en vue de détecter la localisation précise des marnières. Cela constituerait une énorme avancée, car ce sont des parcelles entières qui sont aujourd'hui condamnées au regard de la prévention des risques. La solution passe par la R&D. La Seine-Maritime et l'Eure comptent 150 000 marnières, soit 15 marnières au kilomètre carré.
Le cas de Reims est très intéressant parce que l'on est hors du cadre réglementaire. Parfois, les collectivités ne souhaitent pas mettre en place des actions de prévention, pour éviter de faire peur à la population ou d'entraîner une dévaluation importante des biens. L'effondrement qu'a connu Reims en 2016 a été très marquant pour la population. Dans le cadre des travaux de réaménagement urbain, cette ville a engagé des actions de prévention. Le coût de la prévention est certes élevé, mais il correspond au coût induit par un seul accident matériel. Le rapport coût-bénéfice est donc, je le répète, nettement positif. La cavité n'interdit pas de construire : il convient de bien pieuter la maison, de construire sur radier ou, si nécessaire, de combler le vide. De plus, dans le contexte du changement climatique et de transition énergétique, la recherche montre que les tampons thermiques permettent d'améliorer le bilan thermique des maisons construites au-dessus de ces cavités.
Le fait de connaître le risque conduit à prévoir des solutions de réaménagement, pour ne pas prendre de risques sur le long terme, car une cavité finira toujours par s'effondrer.
Dès lors que l'on connaît le terrain, on peut l'aménager en conséquence. Certes, cela aura un coût, mais c'est indispensable pour éviter la catastrophe.
Ils le sont partiellement selon les cas. Pour l'heure, les données scientifiques en matière de risques ne sont pas exhaustives.
La méthode que je vous ai présentée précédemment date de moins d'un an. Nous recommandons aujourd'hui faire des efforts sur la prévention.
La culture du risque est très différente en outre-mer parce que les habitants ont malheureusement l'habitude de subir des phénomènes climatiques beaucoup plus forts. Nous avons beaucoup à apprendre dans ces territoires. Par exemple, des exercices d'évacuation sont prévus annuellement dès l'entrée en crèche et tout au long de la scolarité. L'éducation à l'appréhension du risque et à la réactivité est une piste sur laquelle il convient de réfléchir.
En France, le suraccident lié à la méconnaissance et au mauvais comportement en cas de catastrophe est à l'origine d'un grand nombre de victimes supplémentaires. Au Japon, un enfant de quatre ans sait exactement comment réagir en cas de séisme. Alors que la force des séismes possibles dans la région de Nice, par exemple, sera cent fois inférieure à celle des séismes au Japon, ceux-ci feront des victimes à cause de l'habitat et de l'absence totale de culture du risque parmi les élus, les enseignants, la population.
L'éducation et la prévention sont donc deux sujets majeurs. Si des efforts sont réalisés en la matière, la France sera beaucoup mieux armée dans une dizaine d'années.
Et la population ne doit pas être surprise de l'occurrence de ces phénomènes. Chaque Français doit être conscient qu'il peut être soumis à tel ou tel risque dans la région dans laquelle il habite. Alors qu'il n'y a eu aucun dégât, le séisme qui a eu lieu dans la région de Bordeaux la semaine dernière a créé un grand émoi au sein de la population.

La catastrophe de l'Aude a eu lieu en pleine nuit. Comment informer la population ? L'élu doit réfléchir à la manière d'informer en urgence selon le phénomène.
Je suis arrivée au moment où vous parliez de la loi Elan et des dispositions visant les constructions neuves. J'aimerais revenir sur les critères très techniques retenus pour évaluer l'état de catastrophe naturelle. J'ai du mal à comprendre pour quelles raisons des collectivités très proches les unes des autres ont été pour certaines déclarées en état de catastrophe naturelle et d'autres non, même si les poches argileuses sont parfois de petite taille.
Ce sujet a été évoqué précédemment. Vous abordez la question des petites poches argileuses. Le BRGM a réalisé la carte d'aléas à l'échelle nationale, département par département. Dans certains cas, vu l'échelle de la carte, on est peut-être passé à côté de certaines poches. Ce problème pourrait être réglé par les collectivités. Quant au problème des critères météo, ils sont effectivement très restrictifs.
C'est un verrou.
Vous l'avez dit, la loi Elan comporte de bonnes mesures pour l'avenir ; la situation est plus problématique pour l'habitat ancien. À cet égard, je mentionnerai les modulations de franchises. Sans PPR, comme le prévoit la loi Elan, chaque fois qu'une commune subira une catastrophe naturelle, la franchise augmentera. Elle augmentera tous les ans et pourra atteindre cinq fois le montant de la franchise initiale, ce qui correspond grosso modo au coût moyen du dégât.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) nous a indiqué travailler sur de nouveaux critères pour ce qui concerne la sécheresse, en prenant en compte les niveaux de pluviométrie, la température globale, le niveau des nappes phréatiques, le niveau de rivière, l'évaporation des végétaux. Êtes-vous associés à ce travail ?
L'un de nos spécialistes est consulté dans le cadre de la réflexion en cours sur ce sujet. Dans l'idéal, il faudrait tenir compte du type d'argile et, surtout, de l'environnement. Si l'ensemble de l'argile se rétracte de manière uniforme, la maison ne bougera pas ou presque ; il en va autrement pour les maisons construites à moitié sur des argiles et des sables. De plus, s'il y a des arbres près de la maison, ils vont assécher les argiles et, donc, un seul côté de la maison. Il faut donc prendre en compte un grand nombre de critères.
Non. En fait, les critères d'aménagement du territoire sont presque aussi importants que les critères météorologiques pour l'ensemble des risques que nous avons évoqués. Sur le littoral, par exemple, on constate que l'accélération des phénomènes d'érosion tient plus aux aménagements qu'aux phénomènes de changement climatique.

Ne pourrait-on pas dès lors prévoir des critères nationaux mais aussi territoriaux ?
Ce serait plus juste, mais cela a un coût et, il faut en avoir conscience, le coût des assurances dommages risque d'exploser.

Nous sommes là pour répondre au mieux et au plus juste en cas de dommages.
Les effets de mouvements se situent entre 5 et 10 millimètres, et ils suffisent pour casser une maison en deux.

Un chercheur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) nous a indiqué que nous connaîtrions dans un avenir proche une sécheresse tous les deux ans.
Les simulations montrent que nous allons connaître une sécheresse telle que celle de l'année 2003 tous les trois ans à l'horizon de 2030-2050.

Le Gouvernement fait une différence entre les catastrophes naturelles, imprévisibles, telles que les inondations, la sécheresse, la submersion marine, et les phénomènes dits prévisibles comme le recul du trait de côte. Dans le cadre de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique défendue par la députée Pascale Got, que j'avais souhaité reprendre dans la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, nous avions suggéré des évolutions à ce sujet. A titre personnel, j'estime qu'il y a un lien direct avec la montée des eaux et les phénomènes climatiques violents, qui vont nécessairement amplifier le recul du trait de côte. Comment distinguer clairement les phénomènes imprévisibles de ceux qui sont prévisibles ? Nous avons le sentiment que le Gouvernement veut se retourner vers les collectivités territoriales au motif que l'aménagement du territoire fait partie de leurs responsabilités. Estimez-vous ces distinctions pertinentes ?
Nous avons travaillé sur ce sujet pour le compte de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), et le rapport n'apporte pas de conclusion tranchée sur cette question.
Le recul du trait de côte est prévisible, tout comme le sont les mouvements de terrain en milieu continental. Cet argument vaut pour toutes les catastrophes naturelles en France.
Je vous l'accorde ; je parlais des phénomènes d'érosion.
Que ce soit sur les côtes sableuses ou rocheuses ou à l'intérieur des terres, les aléas naturels sont liés, d'une part, au climat pour l'élément déclencheur et, d'autre part, au contexte géologique. À nos yeux, le recul du trait de côte est un risque naturel. La seule différence, c'est que le phénomène peut être réversible pour les côtes sableuses, selon les conditions de la mer, de la houle.
La succession de tempêtes en 2004 a créé des reculs de trait de côte de vingt mètres sur les communes touchées comme Lacanau ou Biscarosse. Mais les reculs majeurs n'excèdent pas vingt mètres, à l'exception de Dieppe avec quarante mètres. Les événements de référence font apparaître des reculs similaires, avec une soudaineté similaire. En termes de sinistralité, on ne peut donc pas établir de différenciation.
Notre conclusion : cette question est plus politique que scientifique.
Les effectifs sont constants, mais avec des compétences et des tâches élargies.

Avez-vous aujourd'hui les moyens de mettre en place une prévention sur l'ensemble du territoire pour permettre à tous les élus locaux de s'emparer pleinement de ces sujets ?
Je suis moi-même élu local dans une petite commune. Même si le BRGM n'a pas cette capacité ni en termes de temps ni en termes budgétaires, l'action doit être transversale. Pour mailler le territoire, plusieurs organismes doivent porter le message pour qu'il soit plus impactant. Il faut montrer aux élus locaux des cas concrets sur le terrain.
Nous pouvons coordonner ces actions, mais nous ne pouvons agir seuls.
Je le redis, c'est certes un investissement, mais c'est un investissement pour l'avenir. Pour ce qui concerne les coulées de boues, à l'échelle de cinquante communes, le coût de toute la procédure s'élève à 150 000 euros, soit 3 000 euros par commune. Mais une coulée de boue sur l'une de ces communes représente des dégâts de l'ordre de 150 000 euros a minima. Actuellement, il y a une coulée de boue tous les dix à vingt ans dans le nord de la France ; à l'horizon de 2030-2050, trois coulées de boue auront lieu tous les dix ans. À court terme, le bénéfice net est de plusieurs centaines de milliers d'euros.
En effet. Ni de l'impact environnemental sur les rivières, par exemple. Il faut communiquer auprès des élus locaux pour que ceux-ci investissent dans la prévention.
Nous sommes en relation avec un certain nombre d'associations, notamment Régions de France. Mais si l'on veut être efficace, il faut aller sur le terrain.

Merci beaucoup de votre participation à cette audition.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Audition de Mm. Valéry Laurent chef du service « normalisation » et didier valem chef du service « qualité-construction » et de mmes marina grosjean chargée d'études au service « assurance » et annabelle lavergne membre de la direction des relations institutionnelles de la fédération française du bâtiment ffb
Audition de Mm. Valéry Laurent chef du service « normalisation » et didier valem chef du service « qualité-construction » et de mmes marina grosjean chargée d'études au service « assurance » et annabelle lavergne membre de la direction des relations institutionnelles de la fédération française du bâtiment ffb

Nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs représentants de la Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Valéry Laurent, chef du service « normalisation », M. Didier Valem, chef du service « qualité-construction », Mme Marina Grosjean, chargée d'études au service « assurance », et Mme Annabelle Lavergne, membre de la direction des relations institutionnelles. Je vous propose de commencer par une présentation liminaire avant de passer aux questions des membres de la mission d'informations.
La FFB, fédération professionnelle, représente 60 000 entreprises, surtout des TPE et des PME, et 35 000 artisans, sur tout le territoire français. Elle est structurée en fédérations régionales et départementales, et rassemble 32 unions et syndicats de métiers.
Chef du service « normalisation », je coordonne la veille sur la normalisation volontaire - au sens de l'Association française de normalisation (Afnor) - et les réglementations techniques européennes. La FFB est vigilante à ce que les réglementations techniques de l'État soient lisibles, claires, applicables et contrôlables, pour éviter toute déviance, et pour s'assurer que les entreprises puissent agir de façon loyale selon une libre concurrence. Le cadre réglementaire sur les catastrophes naturelles est dense, et s'appuie essentiellement sur le code de la construction et le code de l'environnement. Nous avons beaucoup travaillé sur la réglementation parasismique, et localement sur les plans de prévention des risques établis par arrêté préfectoral, en relation avec les collectivités territoriales.
Les normes volontaires applicables, au sens de l'Afnor, sont d'origine soit nationale, soit européenne et c'est le plus souvent le cas. Transposées à l'identique, les normes européennes remplacent alors les normes nationales préexistantes. La prise en compte des catastrophes naturelles est traitée indirectement, sans norme spécifique. Il existe des normes internationales sur les secours. Les normes européennes sur la construction concernent l'ingénierie et la conception des ouvrages d'art ; 59 normes appelées « Eurocodes » couvrent tous les aspects de la conception des bâtiments, dont le parasismique et la sécurité incendie.
Non car ces normes sont communautaires. Mais il existe des annexes nationales sur les zones de vent ou sur l'argile.

Ces normes européennes, complétées par des mesures françaises, prennent-elles en compte les spécificités de chaque territoire en termes de risques ?
Elles ne prennent pas en compte tous les risques. Il existe des cartographies spécifiques, notamment sur le vent ou la neige.
Ces cartographies définissent l'effet des phénomènes climatiques comme le vent, la neige, les températures...
Non, car les inondations sont liées à un niveau d'eau. Ces normes ne traitent pas de l'inondation en tant que telle, mais des moyens de calibrer les ouvrages par rapport au niveau de la nappe phréatique ou au niveau des plus hautes eaux exceptionnelles. Ces référentiels de calcul permettent de dimensionner les ouvrages d'une manière partagée entre tous les acteurs. Ainsi, une soupape pourra être prévue dans un sous-sol pour préserver la structure d'un parking, quitte à sacrifier quelques voitures en cas d'inondation. Plutôt que de résister, on cède. Ce sont des normes de conception.
Les normes européennes et françaises sont réexaminées tous les cinq ans - ce qui n'empêche pas des modifications intermédiaires si besoin.
Les normes d'ingénierie géotechnique s'appliquent aux sols. La majorité des normes européennes et nationales concernent les produits de construction, qui font l'objet d'un règlement européen sur le marquage CE. Aucune de ces normes ne porte directement sur des aspects touchant à des catastrophes naturelles, hormis une norme internationale sur les vitrages de protection résistant aux tempêtes destructrices, une norme française sur les barrières à neige protégeant des avalanches et une norme européenne sur les ascenseurs soumis à des conditions sismiques.
D'autres normes reflètent les techniques de construction mise en oeuvre, à savoir les documents techniques unifiés (DTU) inventées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), missionné par le ministère de la construction dans les années 1960 à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement avec mort d'hommes. Le CSTB a recensé les meilleurs cahiers des charges des maîtres d'ouvrage pour en faire des documents techniques, devenus depuis les années 1990 des normes Afnor, qui passent par une enquête publique. Ces DTU reflètent les techniques de construction pour lesquelles les différents corps d'état ont un retour d'expérience avéré et réussi, avec des produits courants. Ces normes servent aussi dans les marchés de travaux en bâtiment et leur conception. Elles ne s'appliquent que si le maître d'ouvrage et le concepteur - architecte ou bureau d'études - a donné des éléments aidant les entreprises de travaux.
Dans les Eurocodes, des cartes de neige ou de vent et des méthodes de calcul sont données à l'entreprise pour qu'elle construise selon des techniques fiables. Sans ces éléments donnés en amont, l'entreprise aura du mal à anticiper les catastrophes naturelles. Ce n'est pas au niveau de l'entrepreneur qu'il faut définir ces critères - ce serait trop tard.
Trois révisions de DTU sont en cours pour le cas des retraits-gonflements d'argile pour les fondations profondes, les fondations superficielles et les dallages, qui prennent en compte les avancées récentes de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), qui a créé l'article L. 112-20 du code de la construction et de l'habitation, exigeant la fourniture d'une étude de sols.
Non, il s'agit de révisions de normes de construction préexistantes, intégrant les évolutions juridiques récentes. Le maître d'ouvrage devra donner à l'entreprise les informations relevant des études de sol.
Oui, mais elles ne les obtenaient pas systématiquement. La FFB a beaucoup insisté pour que ces informations soient obligatoirement données.

Quel était l'intérêt pour ces entreprises de les demander ? Des sinistrés, par exemple à cause de la sécheresse, se retournaient-ils parfois contre les constructeurs ?
Les deux principales causes de sinistres en France sont l'inondation et le retrait-gonflement d'argile, cette dernière cause étant surtout apparue depuis 1992 et a connu un pic avec la canicule de 2003. Il fallait mener des actions, mais encore fallait-il avoir les informations nécessaires. Le BRGM a établi une cartographie des zones argileuses. Désormais, la loi oblige à fournir des éléments à la vente du terrain, pour qualifier sa constructibilité. Pour une maison individuelle, dont l'ingénierie est moins importante et les coûts assez tendus, un sondage de sol peut représenter 10 % du coût. Certains prenaient alors des risques inconsidérés... Le parc construit sur argile est important, et seulement 1% du parc immobilier est renouvelé chaque année. Ces améliorations seront donc longues à mettre en place.
Lorsque le sinistre a lieu dans les dix ans, la garantie décennale prend le relai. Au-delà, il est difficile de faire face aux coûts générés - diagnostic, sondage de sol, travaux - hormis en cas de reconnaissance de catastrophe naturelle. Sur les constructions neuves, l'entrepreneur connaît son département, mais le maître d'ouvrage peut choisir une entreprise prenant davantage de risques. La cartographie de l'argile, l'obligation d'étude de sol et les évolutions de normes fiabilisent les constructions. Le maître d'ouvrage devra fournir une étude de sol adaptée à son projet. Tous ces progrès ont été faits en dix ans.
Le dispositif Géorisques, national et public, de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) fournit des informations sur les différents types de risques sur une parcelle.
À la suite d'incidents liés aux travaux ayant percé des canalisations de gaz ou d'électricité, désormais, le maître d'ouvrage doit déposer une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) sur internet. Les gestionnaires des réseaux donnent alors toutes les informations, que le maître d'ouvrage transmet ensuite à l'architecte.

Les artisans du bâtiment sont-ils suffisamment formés, et par qui ? Ont-ils une bonne connaissance des risques ?
Chaque professionnel maîtrise les techniques spécifiques à son corps de métier. Il est difficile de lui demander d'assimiler tous les impacts climatiques globaux sur son territoire. L'implantation d'un ouvrage dans son environnement revient au maître d'ouvrage, qui s'appuie sur les normes de conception. Lorsqu'un facteur de risque est identifié, la conception du bâtiment peut le prendre en compte notamment pour le gros oeuvre ou la charpente, si le maître d'ouvrage consulte les entreprises. C'est plus difficile pour les entreprises effectuant les finitions. Les normes sur les produits gèrent l'étanchéité du bâtiment mais ne sont pas prévues pour intégrer les accidents climatiques.

Si un particulier fait construire une maison, son entrepreneur sait-il apprécier la nature du sol pour conseiller un type de maison ?
Le maçon se conforme aux plans établis par un bureau d'études. Il suit ce qui a été fixé en amont lors de la conception et dans le permis de construire. En zone sismique par exemple, les fondations sont calculées pour résister aux sollicitations sismiques. Celui qui construirait sans étude ne pourrait se dire professionnel du gros oeuvre !

Vous avez mentionné une réflexion actuelle pour intégrer des dispositifs particuliers - dans le cadre du DTU, je suppose - pour les parcelles reconnues comme argileuses. C'est donc le DTU qui déterminera les types de fondations à réaliser ? Si l'on continuait à construire les pavillons à la manière d'aujourd'hui, le législateur n'aurait pas fait oeuvre utile avec la loi Elan, ni le BRGM avec sa cartographie. Il faut que changent les habitudes des maîtres d'oeuvre, pour les maisons neuves.
Le DTU est un guide des bonnes pratiques pour la réalisation d'ouvrages conçus sur la base d'une étude géotechnique et de référentiels de calcul des données techniques. Le DTU précise comment faire un chaînage, comment bien réaliser les fouilles. Dans sa nouvelle version, qui est à l'enquête, il renverra explicitement à l'étude de sol règlementaire, laquelle prend en compte la cartographie des zones argileuses. Les sollicitations climatiques, dont la localisation et l'intensité sont identifiées par les cartes du BRGM, conduisent à exiger dans les zones sensibles des sondages de sol, des éléments de sécurisation ou des dispositions forfaitaires - définies règlementairement. Le DTU sert à accompagner la réalisation dans les règles de l'art.
Les DTU ne définissent pas de règlementation et ne reprennent pas la règlementation : ils concernent les gestes techniques, et mentionnent des points singuliers, qui sont fonction des données établies dans la phase de conception.
Pour les collectivités territoriales, l'État fait la promotion des normes ISO relatives au développement durable. Il s'agit de mettre en place des systèmes de management pour le développement durable, intégrant par exemple la notion de résilience : lorsqu'un événement s'est produit, l'objectif est d'identifier quelles méthodes adopter, comment gérer les risques, quels intervenants associer, etc. C'est du management de projet et de la gestion des risques.

Cela concerne les constructions neuves. Mais il y a aussi le stock : existe-t-il des possibilités pour renforcer les constructions existantes par des travaux qui ne coûtent pas aussi cher que la maison elle-même ? Avec la poursuite du changement climatique, il sera difficile de tout indemniser. On peut songer, pour aider les particuliers à financer certains travaux, à des subventions par les collectivités territoriales ou par l'État, à un fonds de péréquation, à des crédits d'impôt... Avez-vous des idées à proposer sur ce point ?

La sécheresse a provoqué dans mon département des fissures profondes, et le coût des travaux peut atteindre 100 000 euros, soit le prix de la maison... Je connais des ménages qui se sont endettés à trente ans. Ils ne bénéficient pas d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Les conséquences humaines sont épouvantables. Nous tentons de proposer des solutions en termes de reconnaissance, de prévention, de réparation. La loi Elan comporte de nouvelles dispositions applicables aux constructions à venir, et c'est tant mieux, mais pour l'existant ?
Les entreprises de construction n'ont pas de baguette magique. Les épisodes alternés de sécheresse et de forte hydratation provoquent une fatigue des ossatures. Malheureusement des reprises en sous-oeuvre à bon marché ne sont pas possibles. Certaines études, notamment menées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) recommandent plutôt de réhydrater les sols, mais on en est encore au stade de l'expérimentation. D'autres méthodes sont possibles, par injection - le coût est un peu moindre mais lorsque la maison est déjà endommagée, la réparation est beaucoup plus onéreuse.

Au-delà des maisons déjà endommagées, la prévention est intéressante, également, dans les zones les plus à risque. Il serait utile de pouvoir faire des propositions techniques aux ménages dont les propriétés présentent des risques de désordre, et ce, afin de prévenir des drames humains et un coût très élevé pour tout le monde, y compris pour les assurances. S'il existe des techniques fiables, il serait important de pouvoir les proposer, et peut-être d'imaginer des aides pour les financer. Réfléchissez-vous à des solutions techniques ?
Les plans de prévention des risques comprennent souvent des prescriptions pour les constructions neuves, mais également des mesures, à horizon de quelques années, pour maîtriser l'humidité autour de la maison, prévoir l'évacuation des eaux de pluies, gérer les trottoirs périphériques, éloigner les arbres à tiges et les arbustes qui aspirent l'eau...
C'est la conclusion que nous voulions formuler, car nous parlons ici du retrait-gonflement des argiles mais il y a aussi le trait de côte, la montée des eaux, les inondations... Dans tous les cas, la première prévention, c'est une information lisible et compréhensible ! Les entrepreneurs nous appellent souvent car ils doivent tenir compte de PPR qu'ils ne parviennent pas à consulter... Les documents ne sont pas mis en ligne sur les sites de la préfecture ou de la commune. Le portail de la DGPR « Ma commune face aux risques » comprend néanmoins des éléments d'information intéressants. Et il faut consulter l'historique des catastrophes naturelles lorsque l'on envisage l'achat d'un terrain, afin d'évaluer son environnement et les risques. Il serait bon de faciliter l'accès direct au contenu des PPR.
Mais dans les faits, l'information n'est pas toujours facile à trouver.
Quelques remarques sur la gestion de l'après-catastrophe : après des tempêtes de vent comme celle de 1999 ou comme Xynthia, les entreprises de réparation ont déploré la difficulté d'approvisionnement en matériaux. Celle-ci a freiné les réparations.
Oui, mais c'est un facteur à prendre en compte. Il y a peut-être des dispositifs à imaginer concernant la chaîne des fournisseurs.
En 2015, un protocole relatif à la gestion des situations de crise a été signé entre l'État, la FFB, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et la Fédération des sociétés coopératives du bâtiment et des travaux publics, afin d'optimiser la mobilisation des moyens et de faciliter les interventions. Il prévoyait des marchés publics sous le régime de l'urgence impérieuse, sans publicité préalable ni mise en concurrence ; il visait également les modalités de réquisition des entreprises ou encore la préparation à la gestion des crises. Le document a été largement diffusé par la FFB mais il est encore peu connu par les collectivités territoriales, nous l'avons encore constaté lors des inondations dans l'Aude en 2018. Il serait utile de mieux faire connaître ce protocole.
La connaissance des entreprises de travaux est inégale selon les administrations. Pour l'élaboration de certaines règlementations, visant notamment le changement climatique ou la prise en compte de tel ou tel type de risques, il serait bon d'associer les représentants de nos professions plus en amont. Nous sommes souvent consultés tardivement dans les discussions touchant des textes qui ont un impact sur les entreprises de travaux. Il y a des progrès à faire dans l'élaboration.

Parlons du désamiantage. L'orage de grêle du 4 juillet 2018, en Charente, a rayé de la carte une dizaine de communes. Tout le monde s'est mobilisé, mais il fallait désamianter les bâtiments détruits ou endommagés avant de les reconstruire. Or peu d'entreprises savent le faire. Elles ne sont pas encore passées partout ! La FFB m'avait alertée dans le cadre de la cellule de crise ; il serait bon effectivement de desserrer le marché, car la situation actuelle incite des non professionnels à se charger de cette tâche, dans des conditions dangereuses. Avez-vous des propositions à formuler ?
C'est un matériau délicat, et les entreprises qui le manipulent doivent respecter un cadre réglementaire strict, elles sont soumises à certification... et elles sont effectivement peu nombreuses. Il y a un problème sanitaire.
Oui, y compris hors situation de catastrophe naturelle ! Cela pose le problème des interventions après sinistre. Mais là non plus, nous n'avons pas de baguette magique. Il est difficile d'imaginer des dérogations, car les mesures de protection ou les règles de gestion des déchets sont exigeantes.
Dans les interventions en urgence, on manque de temps pour faire les mesures et les prélèvements nécessaires pour évaluer la présence d'amiante. On peut décider de procéder comme si celle-ci était confirmée, mais cela a un coût - comme de travailler à l'humide, car il faut alors gérer le problème des déchets. Du reste, si un bâtiment a été inondé jusqu'au plafond ou presque, les murs sont imbibés d'eau, et il est impératif d'attendre le séchage et le retour à la normale avant toute reconfiguration du bâtiment.
Permettez-moi d'évoquer en complément la question de l'accompagnement des maîtres d'ouvrage qui découvrent après publication d'un PPRN qu'ils vivent en zone inondable. Un document a été établi en 2012, le référentiel de travaux de prévention de l'inondation dans l'habitat, par le ministère de l'égalité des territoires, la DGPR et la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) après la tempête Xynthia, pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans la réparation et les actions préventives.
La FFB conduit une action importante avec les outre-mer, pour adapter les DTU à ces régions et appendre quelles sont les techniques de construction adaptées aux écosystèmes climatiques locaux. Ce travail est conduit en relation avec votre délégation aux outre-mer.

Pour revenir sur l'amiante, il s'agit d'un débat très sensible. Dans les régions agricoles, beaucoup de bâtiments sont construits en amiante ciment, avec à la fois de la plaque ondulée sur le toit et de la plaque plane sur les murs. Les agriculteurs n'auront pas les moyens de faire appel à des professionnels spécialisés pour le démontage et les bâtiments vont pourrir sur place. En Bretagne par exemple, ce sera un lourd sujet. Pourtant, et je le sais pour avoir travaillé pendant plusieurs années à Eternit Industries, les risques sont faibles hors tronçonnage des plaques. On traite pareillement toutes les opérations de désamiantage, ce n'est pas légitime.
Nous vous remercions pour vos éclairages et vous solliciterons si nous avons besoin d'informations complémentaires.
La réunion est close à 18 h 5.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.