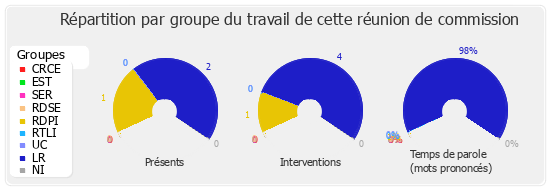Commission des affaires européennes
Réunion du 16 juillet 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Nous avons tout d'abord à procéder à plusieurs nominations de rapporteurs.
À la demande du groupe socialiste, le texte concernant la taxation de l'énergie a été retiré de la procédure écrite. Comme c'est de règle, il devra être examiné en réunion. J'ai reçu la candidature de Bernadette Bourzai.
Nous sommes saisis d'un texte concernant la sécurité nucléaire. Jean Bizet qui connaît bien le sujet pourrait être rapporteur.
Un texte important concernant la fraude fiscale nous a été transmis. Le rapporteur pourrait être Richard Yung.
Enfin, André Gattolin souhaiterait être rapporteur au sujet de la stratégie européenne pour l'Arctique.
Les désignations proposées sont approuvées.

Jean Bizet poursuit son travail sur la politique agricole et le droit européen de la concurrence. Après avoir abordé le problème des organisations de producteurs, il s'intéresse aujourd'hui au rôle des autorités de contrôle de la concurrence. Je lui donne la parole.

L'actualité agricole est celle de la réforme de la PAC et des problèmes de certaines filières, qui sont deux sujets suivis essentiellement par notre collègue Mme Bernadette Bourzai, mais il y a aussi des questions lancinantes qui méritent notre attention. Le fait que notre pays ait perdu sa place de premier exportateur européen au profit de l'Allemagne et des Pays-Bas ne peut manquer de nous interpeller. Le cadre juridique concurrentiel est commun mais l'application semble différente.
L'année dernière, à la même époque, j'avais présenté à notre commission un premier rapport sur ce thème qui concernait les organisations de producteurs - les OP, dans le jargon professionnel. À l'initiative de la France, en particulier de notre ancien ministre de l'agriculture M. Bruno Le Maire, le législateur européen a adopté un règlement - connu sous le nom de « paquet lait » - qui a permis la reconnaissance d'OP dans le secteur laitier et leur a confié une compétence dans la négociation contractuelle des prix et des volumes avec les industriels. Il s'agit incontestablement d'une singularité de la PAC. Une singularité jugée même extravagante par la DG Concurrence que j'ai rencontrée et qui reste très hostile à cette disposition. C'est pourtant une formidable mutation, sans doute à parfaire, dont le monde agricole doit apprendre à tirer profit pour rééquilibrer ses rapports avec les industriels et les distributeurs. J'y reviendrai.
La présente communication est en quelque sorte le deuxième volet de mon travail sur l'application du droit de la concurrence dans le domaine agricole.
Pourquoi m'intéresser à nouveau à ce sujet ?
En 2011, une coopérative agricole de mon département, Agrial, engage une opération d'acquisition d'Elle et Vire. Agrial récupère à cette occasion une activité cidricole. L'Autorité de la concurrence autorise la concentration mais, au vu de sa nouvelle position sur ce marché cidricole, oblige la société à céder cette entreprise - une activité tout à fait secondaire que la coopérative a été obligée de revendre à perte -, et met des conditions supplémentaires en modifiant les conditions d'approvisionnement des éleveurs auprès de la coopérative.
Quelques mois plus tard, la même Autorité de la concurrence intervient dans une affaire connue sous le nom du « cartel des endiviers ». Elle sanctionne les producteurs d'endives pour avoir conclu une entente sur les prix et les productions qui leur permettait d'affronter la grande distribution de façon solidaire. L'Autorité de la concurrence impose une amende de 3,6 millions d'euros aux producteurs. Je les avais rencontrés à cette occasion. L'affaire est en appel.
Ainsi, coup sur coup, l'Autorité sanctionne Agrial pour concentration excessive et les endiviers pour leur entente illicite. Ces deux décisions m'ont laissé penser que l'Autorité de la concurrence était peut-être excessivement rigoureuse dans l'application du droit de la concurrence et qu'elle pouvait même freiner la constitution de « champions nationaux » particulièrement utiles dans la compétition internationale.
Telle est l'idée que j'ai voulu vérifier en tentant une comparaison avec les pratiques de nos partenaires européens. Ce travail est en cours. La semaine passée, je me suis rendu à Bruxelles, à la Direction générale de la Concurrence, et à La Haye. D'autres auditions sont prévues afin de publier un rapport à l'automne prochain. Il s'agit donc aujourd'hui d'un point d'étape.
Quel est le contexte ?
Au départ, il faut rappeler le droit commun. Depuis le traité de Rome, le droit de la concurrence et la PAC sont dans une complémentarité difficile. Selon l'article 42 du TFUE, les dispositions du droit de la concurrence ne s'appliquent que dans la mesure déterminée par le législateur européen compte tenu des objectifs de la PAC. Ces objectifs, fixés à l'article 39, sont eux-mêmes contradictoires sur ce sujet. Les règlements organisant les marchés, fondus dans l'OCM unique, ont apporté leur lot d'exceptions et le « paquet lait » est le dernier exemple des dérogations explicites au droit de la concurrence.
Pourtant, malgré ces dispositions réglementaires, il apparaît clairement que, avec le temps, la balance a penché du côté de la concurrence.
Les articles de base sont les articles 101 et 102 du TFUE relatifs aux ententes et aux abus de position dominante. La montée en puissance du droit de la concurrence s'est produite à la fin des années 90, dans deux directions. La première a été la grande révolution de la réforme de la PAC de 1992, poursuivie en 2003. En dix ans, l'Union européenne est passée d'une PAC quasi-administrée, à une libéralisation quasi-totale des marchés sous réserve du maintien d'aides directes au revenu. Le mot de « révolution culturelle » n'est pas trop fort et beaucoup de nos agriculteurs raisonnent comme si l'on était encore dans l'ancienne PAC en rêvant au retour à des prix garantis. De manière significative, la France renâcle encore souvent à appliquer les dispositions les plus novatrices. Cette réforme de la PAC s'est accompagnée d'un désengagement de l'État, illustrée par la baisse des aides nationales à l'agriculture.
La deuxième direction a été l'affirmation claire du primat du droit de la concurrence. Je rappelle qu'il s'agit d'une compétence exclusive de l'Union. Le traité a été complété par un droit dérivé très complet tel que le règlement de 2004 sur les concentrations. La Commission a elle-même développé une activité quasi normative sous forme de guides et de communications qui finissent par former une « soft law » qui détermine la méthode que suit la Commission pour appliquer le droit de la concurrence. Je peux citer, par exemple, les orientations en matière de concentration ou les lignes directrices sur le calcul des amendes.
La Commission européenne et la Cour de justice ont été de plus en plus rigoureuses. Les conditions pour bénéficier de dérogations à la concurrence ont été de plus en plus sévères. Une dérogation n'est possible que si la disposition concourt à tous les objectifs de la PAC - et non à certains d'entre eux. Comme ces objectifs sont contradictoires, les dérogations ne sont, par conséquent, presque jamais admises. Dès qu'un principe fondateur est mis en cause - y compris par des particuliers -, l'État est condamné comme ce fut le cas, s'agissant du marché intérieur, lors de l'affaire dite des « fraises espagnoles ». Alors que des barrages routiers empêchaient la circulation de camions de fraises espagnoles, la Cour a condamné l'État français - pas les transporteurs, mais l'État -, pour manquement à ses obligations. Même l'évocation de risques sanitaires ne suffit pas à justifier des mesures de sauvegarde. Dans une décision de 2003 dite « viande bovine française », la Commission a interdit les mesures de sauvegarde qui avaient pour résultat d'établir une grille de prix minimum pour les clients des éleveurs.
En France, la même évolution peut être constatée. En 2008, le ministère de l'économie et des finances a mis fin à la négociation interprofessionnelle du prix du lait à partir d'indicateurs de prix fixés par le Centre national d'information de l'économie laitière (CNIEL). Beaucoup d'observateurs appréhendaient les conséquences de cette décision. La même année, le transfert du contrôle des concentrations à la nouvelle Autorité de la concurrence a été un pas supplémentaire dans cette affirmation du droit de la concurrence. Le contrôle des concentrations qui relevait jusqu'alors de la DGCCRF a été transféré à la nouvelle Autorité de la concurrence, une autorité administrative indépendante. Les professionnels considèrent parfois que les rapports avec cette dernière ne sont pas aussi faciles qu'avec l'administration sous l'autorité d'un ministre qui pouvait être plus sensible aux circonstances locales d'une affaire.
Ainsi, si l'on exclut quelques exceptions, il semble que tout a été fait pour donner la priorité absolue aux règles de concurrence, idéal européen censé « améliorer le bien-être du consommateur » comme le répète à l'envi la Commission européenne.
Même si les règles sont communes, n'y a-t-il pas des différences dans l'application des règles ? Quelles sont les leçons de mes entretiens en France et à l'étranger ?
Le premier constat est qu'il faut clairement distinguer le contrôle des ententes sur les prix et celui des concentrations. Partout en Europe, une entente sur les prix est le chiffon rouge absolu, l'abomination de l'abomination ! Il faut savoir que, dans ce genre d'affaires, les ententes sont souvent dénoncées de l'intérieur, soit par des opérateurs évincés, soit, simplement, par des appels anonymes. Les rachats d'entreprises sont des moments de risque et de vérité. Une entente illicite peut perdurer jusqu'à ce qu'une entreprise soit rachetée par une autre, française ou étrangère. La nouvelle entreprise préfère alors dénoncer l'entente afin de bénéficier de la clémence des juges.
Les Autorités de la concurrence nationales ainsi que la Commission contrôlent les accords collusoires, en particulier les ententes sur les prix. Les sanctions sont alors toujours sévères. L'entente sur la viande bovine a été sanctionnée par la Commission à hauteur de 12 millions d'euros.
Le deuxième constat est que notre Autorité de la concurrence ne paraît pas, malgré tout, être parmi les plus sévères des autorités nationales. Dans le cas du cartel des endives, l'amende prononcée a été de 3,6 millions d'euros. Une somme qui peut paraître importante pour les producteurs considérés mais qui sanctionnait une pratique vieille de douze ans. Les producteurs d'endives donnaient clairement des indications sur les prix et les volumes. Le ministère avait lui-même mis en garde à plusieurs reprises les producteurs de l'illégalité de leur pratique, même si je dois avouer qu'à l'époque, cette coopération entre producteurs me paraissait être une façon de rééquilibrer les rapports avec la grande distribution. L'affaire est en appel et l'amende n'est toujours pas payée.
3,6 millions peut sembler une somme importante au regard de la situation des producteurs d'endives mais l'Autorité de la concurrence estime qu'elle a fait preuve de mesure, prenant en compte le déséquilibre commercial avec les acheteurs et, au bout du compte, le faible impact de l'entente sur la rémunération finale des producteurs.
Par ailleurs, ce n'est qu'une somme relativement réduite par rapport aux sanctions imposées dans d'autres pays. Ma visite à l'Autorité de la concurrence néerlandaise a été assez éclairante sur ce point. Je pense, par exemple, aux 14 millions imposés aux producteurs de poivrons qui s'étaient simplement entendus pendant trois ans sur les surfaces à planter, ou aux 9 millions imposés aux producteurs d'oignons blancs qui s'étaient entendus sur les volumes échangés. Une dernière affaire concerne les plants d'oignons. Dans ce dernier cas, l'entente n'a duré qu'une seule année et ne portait que sur les surfaces ensemencées. La sanction prononcée a été pourtant de 4 millions d'euros. Dans ces différents cas, l'effet sur les prix n'était qu'indirect, mais la sanction a été très lourde.
La Direction générale de la concurrence à Bruxelles nous a indiqué qu'il existait des autorités encore plus sévères. Ce serait le cas en Allemagne et en Espagne. L'Autorité de la concurrence espagnole serait même « haïe par tout le monde », selon l'expression du directeur.
J'évoque là le montant des amendes prononcées par les Autorités de la concurrence. Dans la plupart des cas, les affaires sont en appel et les amendes n'ont donc pas encore été appelées. Je précise qu'en droit français, la décision permet l'exécution immédiate des sanctions pécuniaires. Ce n'est que dans le cadre d'un recours en demande suspension que l'amende est suspendue. Ce qui est le cas dans l'affaire des endiviers. Mais force est de constater qu'il ne semble pas qu'il y ait, en France, de plus grande sévérité qu'ailleurs même si le contrôle des ententes n'est pas rare. Une étude internationale aurait noté l'Autorité française d'un cinq étoiles signifiant une sorte d'exemplarité, un peu à double tranchant...
Troisième constat : l'appréciation du contrôle des concentrations est un tout autre sujet, beaucoup plus difficile.
Les concentrations d'entreprises sont notifiées par les entreprises et autorisées, en fonction des seuils de chiffre d'affaires, par les Autorités de la concurrence nationales ou la Commission européenne. L'opération de concentration peut être autorisée sans ou sous conditions appelées « engagements ». L'entreprise doit les respecter sous peine d'être sanctionnée.
Globalement, dans le domaine agricole, les concentrations sont toutes autorisées. Les opérations de concentration verticale et horizontale sont courantes, dans le secteur laitier par exemple, notamment en Europe du nord. La plus grande fusion a été annoncée en 2004 entre deux entreprises suédoise et danoise, Arla et Campina, en vue de créer la plus grande entreprise laitière au monde. Si l'opération n'a finalement pas eu lieu, ce n'est pas pour des raisons juridiques mais pour des difficultés financières de dernière minute. Campina a poursuivi avec d'autres partenaires notamment en 2008 avec le hollandais Friesland, donnant naissance à la méga-coopérative Friesland-Campina. De son côté, Arla foods a poursuivi ses acquisitions en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne.
Toutes ces opérations entre très grandes entreprises ont été autorisées par la Commission européenne. Dans quelques rares cas, la Commission a posé des conditions que l'on peut considérer comme assez mineures. Dans le cas Friesland-Campina, elle a autorisé la fusion conduisant à un quasi-monopole de l'approvisionnement laitier aux Pays-Bas sous réserve d'engagements tendant à éviter tout risque de forclusion, c'est-à-dire d'exclusion d'un concurrent au stade de la distribution.
Ces opérations qui portent sur des milliards d'euros donnent un peu le tournis et suscitent l'étonnement puisque en France, l'Autorité de la concurrence a obligé une entreprise - certes de belle taille mais sans comparaison avec les géants laitiers d'Europe du nord - à céder une unité de fabrication de cidre dont personne ne savait trop quoi faire. L'autorité française serait-elle particulièrement exigeante, voire tatillonne, par rapport aux autres ? Pour le dire autrement, y aurait-il deux poids deux mesures ?
L'Autorité nationale de la concurrence se défend de freiner « l'émergence de champions » selon ma formule du départ, en rappelant que sur les quelques 30 ou 40 concentrations qu'elle a eu à contrôler, toutes ont été autorisées et qu'elle n'a posé des conditions que dans 3 ou 4 cas. Dans le cas d'Agrial, ces conditions portaient sur le périmètre de l'entreprise mais aussi sur les obligations d'approvisionnement posées à ses adhérents. L'Autorité de la concurrence estime que dans cette affaire, loin de pénaliser les producteurs, elle les a, au contraire, protégés contre des clauses abusives. Elle indique même qu'elle a décidé en ce sens après avoir été alertée par les producteurs eux-mêmes.
Mais le point crucial est l'appréciation du pouvoir de marché de la future entité. Les concentrations s'apprécient par rapport au concept de « marché pertinent » qui, lui, est examiné au cas par cas. Il se pourrait qu'il y ait des différences entre les appréciations nationales de cette notion cruciale. Même si le droit est européen, le contexte économique et historique est national.
Y aurait-il deux poids, deux mesures ? Il s'agit plutôt de deux histoires différentes. Le marché français est un grand marché. C'est sa force, mais aussi sa faiblesse car pour l'Autorité de la concurrence française, le « marché pertinent » est, naturellement, le marché national. Le marché hollandais est un petit marché. C'est sa faiblesse, mais c'est aussi sa force car le « marché pertinent » est, forcément, le marché européen.
Ainsi, une concentration pourrait être jugée excessive en France, alors qu'elle ne le serait pas aux Pays-Bas. C'est tout aussi vrai en Allemagne où toutes les forces économiques sont tournées vers l'exportation. Il y a des pays dans lesquels le « marché pertinent » est, naturellement, le marché européen, et des pays où le « marché pertinent » est avant tout national. Doit-on se poser la question de faire évoluer la définition du marché pertinent - que ce soit dans les esprits ou juridiquement parlant - pour une France qui ne regarderait pas assez loin, ce qui expliquerait, entre autres, notre déficit commercial chronique ? Pour ma part, la réponse est oui. À mon avis, nous ne pouvons en rester à une vue nationale. La recherche de « productivité » ne doit pas être bannie car elle détermine l'avenir de notre agriculture, qui peut parfaitement reposer sur des modèles différents selon les situations locales. Notre commission serait aussi dans son rôle si elle parvenait à faire accepter par le juge que l'appréciation du « marché pertinent » doit privilégier la dimension européenne.
Ainsi, on ne peut parler d'attitude négative de l'Autorité de la concurrence vis-à-vis du monde de l'entreprise, mais plutôt de réactions en fonction de chaque situation. Une communication appropriée destinée au monde agricole permettrait de lever les doutes.
Cette analyse rapide du droit de la concurrence appliqué au secteur agricole m'a permis néanmoins de tirer quelques leçons générales.
Ce qui fait la force des entreprises du secteur de l'agroalimentaire chez nos partenaires réside moins dans une application tempérée du droit de la concurrence que dans l'innovation, la logistique, et, d'une façon générale, un environnement d'appui aux entreprises. Tout l'appareil d'État - qu'il s'agisse des ministères, des autorités indépendantes, voire des autorités judiciaires - semble favorable au libéralisme entrepreneurial. Aux Pays-Bas comme en Allemagne, l'entreprise est au coeur de la société et du lien social. Elle est la source de richesses. Les ministres allemands l'évoquent dans tous leurs discours. Les relations sociales ne contestent pas ce primat absolu. Le ministère de l'économie hollandais m'a indiqué, que, au moment des fusions, les grandes entreprises du secteur agroalimentaire négocient leurs impôts avec le fisc. L'agriculture et le secteur agroalimentaire sont l'une des neuf priorités nationales et tout l'appareil d'État est orienté vers le soutien aux entreprises. Nous sommes loin de cet état d'esprit et ce depuis des décennies.
Enfin, je voudrais profiter de cet examen pour dresser un premier bilan de la mise en place des organisations de producteurs.
Si l'on s'inspire du droit de la concurrence, la solution au renforcement des producteurs serait soit dans la formation de coopératives, soit dans l'intégration verticale de type « marque de distributeurs ». Deux formes de regroupements dont les agriculteurs ne veulent pas. La solution qui figure dans le « paquet lait » est l'appui aux OP qui permettent des regroupements sans transfert de propriété. La structure est mandatée pour négocier les contrats de vente des productions. La négociation porte sur les volumes et éventuellement sur les prix. Cette forme d'organisation est très sévèrement critiquée par la DG Concurrence. Elle y voit « une erreur grave ». Lors de notre rencontre à Bruxelles, j'ai senti que le Directeur général était satisfait de recevoir un Français et qu'il avait un message à délivrer, considérant que la France lors de cette réforme du « paquet lait » lui avait un peu « tordu le bras ». L'OP serait un cartel légal, en opposition frontale aux principes de base du droit de la concurrence. La DG dénonce le verrouillage des prix et les effets pervers de la réforme, l'accusant même d'avoir été à l'origine de la hausse des importations laitières en France. Certains fabricants auraient menacé de s'approvisionner dans d'autres pays de l'Union si les OP discutaient les prix. Il se pourrait que certains grands fabricants l'aient fait en achetant du lait en Allemagne et en Irlande. Pour la DG Concurrence, cette disposition les éloigne de l'efficacité à long terme.
S'il faut admettre que les OP sont des formes de cartels, par ailleurs totalement bannis par le droit de la concurrence, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. La réforme des OP et la contractualisation qui lui est associée étaient destinées à donner une perspective aux éleveurs, inquiets de la fin des quotas laitiers. C'est le moyen que la France et l'Europe avaient trouvé pour rééquilibrer les relations contractuelles entre producteurs et fabricants.
Est-ce que cela marche ? Lors de notre rapport de juillet 2012, nous avions identifié les obstacles qui s'opposaient à la constitution des OP. Un an après, nous pouvons avoir une appréciation nuancée. D'un côté, les OP se mettent en place. On en compte une petite quarantaine aujourd'hui, ce qui est un succès. Après une phase d'inquiétude, les OP contribuent à améliorer le climat des négociations contractuelles. De l'autre côté, il faut reconnaître que beaucoup d'entre elles sont des « OP maison » constituées autour des fabricants, voire par les fabricants eux-mêmes, avec leurs anciens fournisseurs.
De plus, et contrairement aux affirmations de la DG Concurrence, les observateurs relèvent que l'impact sur les prix est très faible. J'aurais tendance à dire, hélas. Les OP négocient assez bien les livraisons, mais négocient beaucoup plus difficilement les prix. Des associations d'OP pourraient sans doute avoir une taille critique qui leur permettrait d'avoir plus de poids dans les négociations, mais il faudra sans doute attendre un peu avant qu'elles ne se mettent en place.
Il faut considérer ces OP comme des OP de la première génération. Avec la réforme du règlement OCM unique dans le cadre de la réforme de la PAC, une autre génération d'OP doit suivre, étendues aux secteurs de la viande bovine, de l'huile d'olive et des céréales, moins concentrées sur les relations contractuelles avec les fabricants et plus orientées sur l'aide à leurs adhérents, qu'ils s'agisse d'innovation, de recherche de valeur ajoutée ou d'économies d'échelle.
Je ferai le point à l'automne.

Je vous remercie de ce rapport d'étape. Nous avons tous eu plaisir à vous écouter. Nous attendons, à votre choix, une PPRE ou un avis politique avant la fin de l'année.

Ce que le rapporteur dit n'est pas de nature à favoriser la participation aux élections européennes. Le rôle de la DG Concurrence est excessif. La sanction faite par l'Autorité de la concurrence française dans l'affaire Agrial paraît paradoxale. Lorsque les entreprises s'efforcent de se regrouper, elles sont condamnées. L'objet de la loi de modernisation de l'économie (LME) était de développer l'économie contractuelle, ce qui, pour tout le monde, est du bon sens. Mais cette évolution a été critiquée par la DG Concurrence, qui a rappelé son hostilité à la compétence des OP dans le secteur laitier. L'agriculture n'est pas un produit ordinaire, elle a des contraintes de temps de production et de prix de revient et les rapports avec l'industriel et la grande distribution sont totalement déséquilibrés. L'évolution vers la contractualisation est une bonne chose.

Je remercie le rapporteur d'avoir traité ce sujet très rarement abordé. J'y ai appris beaucoup de choses. Oui, l'agriculture n'est pas un secteur de production ordinaire. Outre son impact sur l'aménagement du territoire, le cycle de production agricole est long alors que le cycle de commercialisation est court. Considérez-vous vraiment que le droit européen est un élément « mineur » de la concurrence ? La notion de « marché pertinent », cruciale dans le droit de la concurrence, doit être creusée. Il est étonnant qu'il y ait encore des gens capables de penser que le « marché pertinent » est le marché français alors que de toute évidence, c'est le marché européen. La France a régressé dans le commerce agroalimentaire et, si on excluait les exportations de vin, elle serait encore plus mal placée. Comme je l'ai constaté à l'occasion de l'élaboration toute récente d'un rapport d'information de la commission des finances consacré au soutien aux exportations agroalimentaires, le pragmatisme hollandais peut nous servir de leçon. Ils ont opéré la fusion du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et ont institué une Agence gouvernementale chargée de coordonner toutes les opérations afin de favoriser les exportations agro-alimentaires. Les structures françaises restent éclatées. Concernant les organisations de producteurs, je n'arrive pas à entrer dans la logique de la DG Concurrence ; cela me choque de voir que la grande distribution est ultra-concentrée alors que les OP sont critiquées. Lors de la loi de modernisation de l'agriculture, le ministre avait indiqué que les agriculteurs devaient se regrouper. Il était bien conscient des difficultés et avait évoqué alors la notion de bassin laitier comme un espace pertinent pour les regroupements. On constate, en pratique, que beaucoup d'OP ont été constituées autour des fabricants. L'influence de ces « OP maison » peut être débattue. « OP maison - OP bidon » ? En tout cas, je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse institutionnaliser cette différence de traitement entre producteurs et distributeurs.

Je suis interpellé par cette notion de marché pertinent. Comment est-il appréhendé ? Existe-t-il des découpages, moitié nord, moitié sud, par exemple ? Existe-t-il des groupes de pays ? Les concentrations opérées dans tous les secteurs sont-elles évaluées à l'aune de ce critère ?

Le positionnement français dans la compétition internationale remonte à Méline. Contrairement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni tournés vers le commerce international, j'ai le sentiment que nous restreignons notre zone d'influence. La tradition commerciale allemande a des racines historiques profondes autour de la Hanse. Les Pays-Bas sont le symbole de l'ouverture de l'Europe avec Rotterdam. Il est plutôt paradoxal que l'un des plus petits marchés d'Europe ait établi une vocation à exporter alors que nous paraissons toujours un peu frileux. De même, l'expérience de Campina montre le réel pouvoir des producteurs - coopérateurs. « C'est nous qui faisons les prix » disent-ils. Il faut travailler sur les mentalités. Je suis frappée par la difficulté des éleveurs de bovins français à s'organiser. Face à cette perspective, ils commencent par dire qu'ils ne veulent pas de transfert de propriété, comme si le fait de travailler ensemble était une menace pour leur exploitation. Dans ce contexte, il est très difficile d'améliorer la situation des producteurs par rapport aux transformateurs et la situation des transformateurs par rapport aux distributeurs qui écrasent tout en prenant le prétexte de la défense du consommateur. Ce dernier ne se rend pas compte qu'il est totalement manipulé par des opérations de promotions parfois scandaleuses. La spécificité de l'agriculture doit être rappelée. L'alimentation ne doit pas être considérée comme un produit comme un autre. Si les mots de disette et de famine paraissent dépassés, la crise de 2007-2008 n'est pas si lointaine. La confiance dans la régulation par le marché, comme le répétait l'ancienne Commissaire à l'agriculture Mme Fischer-Boel, me paraît une totale illusion.

Nous sentons bien qu'il y a, en France, une difficulté à appréhender la concurrence européenne et qu'il y a même parfois des difficultés juridiques. Comme l'a indiqué notre collègue César, il me paraît fondamental de développer une économie contractuelle. Contractualiser est une façon de sécuriser les producteurs. Mais, d'une façon plus générale, il existe dans certains pays un climat favorable aux entreprises et même une culture de l'entreprise qui n'est pas si fréquente en France. C'est ce qui explique, pour répondre à M. Botrel, que nos interlocuteurs considèrent que le droit européen est un élément « mineur » de la concurrence, au sens où ce n'est qu'un aspect parmi beaucoup d'autres. Beaucoup d'entre vous se sont arrêtés à la notion de « marché pertinent ». C'est une notion centrale dans le droit de la concurrence, à la fois juridique et économique. Elle est définie par la Commission et par les Autorités nationales de la concurrence. La notion tient compte de deux éléments : le marché du produit et le marché géographique. Concernant le premier, les équipes qui travaillent sur ce sujet à l'occasion des concentrations ou des contentieux étudient la substituabilité du produit. Le consommateur va-t-il se reporter sur un produit équivalent si l'entreprise augmente ses prix ? Concernant le second, quelle est la zone dans laquelle les consommateurs peuvent se procurer le produit équivalent ? Le marché pertinent est étudié au cas par cas. Il n'y a pas des pays dans lesquels le marché pertinent est par essence le marché européen et des pays dans lesquels ce serait le marché national. Même si le Royaume-Uni est totalement ouvert aux échanges, le marché pertinent du lait frais en Angleterre est un marché national, par exemple. Il faut appréhender cette notion critique avec beaucoup de précaution. Je propose d'organiser une audition spécifique sur ce sujet à laquelle je convierai mes collègues.
Il n'y a rien de plus difficile que de faire évoluer les mentalités, comme le préconise très justement Mme Bourzai. Il faut s'attacher, au moins, à mieux partager la valeur ajoutée, de manière plus équilibrée, alors qu'aujourd'hui la grande distribution est en position dominante.
Pourquoi les OP sont-elles considérées comme des cartels par la DG Concurrence ? Parce que le règlement européen leur a donné la compétence sur les prix, même si en face il n'y a que 5 acheteurs.

On va redébattre de ce déséquilibre à l'occasion de la future loi de la consommation. L'expérience n'est pas très enthousiasmante. En mai 2011, un accord volontaire entre éleveurs, industriels et distributeurs sur la négociation tarifaire en cas d'une fluctuation de l'alimentation animale avait été conclu au ministère de l'agriculture. Cet accord avait signé par les grands distributeurs à l'exception de Leclerc. Il n'a jamais été appliqué. Les dispositions figurant dans la LME avaient été très vite détournées par la grande distribution. Lorsque des amendes avaient été infligées à certains distributeurs, ceux-ci avaient menacé de déférencement les industriels qui en réclameraient les paiements. Ce n'est ni plus ni moins qu'une intimidation ou, pour le dire en termes juridiques, un abus de position dominante. Face à cette menace, aucun transformateur n'avait osé réclamer quoi que ce soit. On aura toujours une loi de retard par rapport aux pratiques de la grande distribution. La solution serait la création de grandes OP, mais le chemin sera long.

Il y a un dernier point à notre ordre du jour. Vous vous souvenez que lors de notre réunion du 6 juin 2013, Jean Bizet nous avait présenté une communication sur les relations entre la France et l'Allemagne. La commission avait souhaité que cette communication soit complétée pour être publiée sous la forme d'un rapport d'information. Le projet de rapport de Jean Bizet vous a été adressé ; je n'ai pas reçu d'objection. Je vous propose donc d'autoriser sa publication.
Il en est ainsi décidé.