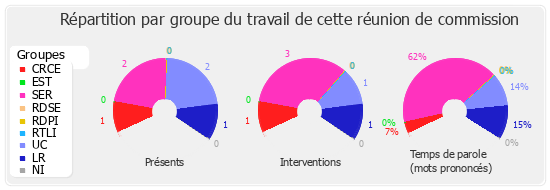Commission d'enquête Pollution des sols
Réunion du 1er juillet 2020 à 16h45
Sommaire
La réunion

Nous poursuivons aujourd'hui nos travaux par l'audition de Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire.
Nous avons entamé nos travaux il y a plusieurs semaines et auditionné de nombreux intervenants.
Notre commission attend de votre audition, madame la ministre, qu'elle puisse l'éclairer sur les intentions du Gouvernement pour renforcer la surveillance des risques de pollution des sols liés à des activités industrielles ou minières. La réglementation a certes connu des évolutions positives et le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit de compléter les obligations en termes de mise en sécurité et de réhabilitation pour les exploitants de certains types d'installations classées.
Néanmoins, nos auditions ont mis en lumière plusieurs insuffisances dans notre arsenal juridique. Les professionnels de la dépollution des sols s'expriment assez fortement en faveur d'une véritable loi sur la pollution, comme nous en disposons sur l'air ou encore l'eau, qui permette de mieux définir la notion de pollution des sols. En effet, la gestion des pollutions industrielles ou minières des sols est traitée différemment au regard de la loi selon qu'il s'agit de déversements actifs de polluants, de déchets, de sources concentrées ou de pollutions déplacées hors site, sans véritable cohérence d'ensemble.
Par ailleurs, sont ressorties de nos auditions plusieurs asymétries entre le code minier et le code de l'environnement dans la prévention des risques sanitaires et écologiques. Dans quelle mesure pensez-vous que la réforme à venir du code minier peut permettre de combler certaines lacunes dans ce domaine ? Des évolutions sont-elles envisagées pour les exploitants miniers en termes de renforcement de leurs obligations de constitution de garanties financières qui pourraient être mobilisées par l'État en cas de défaillance, ainsi qu'en termes de délai de prescription après la cessation d'activité pour rechercher leur responsabilité en cas de pollution ?
Avant de vous laisser la parole, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Je vous invite, madame la ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dites : « Je le jure ».
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Élisabeth Borne prête serment.
Je souhaite d'abord vous remercier de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur les questions de pollution des sols issues d'activités industrielles ou minières et sur les moyens qui sont mis en oeuvre par les services de mon ministère pour prévenir ces pollutions, faciliter le recyclage des friches industrielles et traiter des situations présentant des risques pour les populations.
Je souhaite tout d'abord rappeler que le meilleur moyen de lutter contre les pollutions des sols consiste à adopter les bonnes mesures de prévention en phase d'exploitation d'un site industriel ou minier.
Ainsi, dans le cadre du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations minières, l'État dispose d'un pouvoir de police pour prévenir les infiltrations de polluants dans les sols ou dans les eaux souterraines. Ainsi, les inspecteurs de l'environnement vérifient que les cuvettes de rétention sont conformes à la réglementation, que les conditions de stockage des produits chimiques sont respectées et que les valeurs limites de rejet dans les milieux sont tenues.
Ce sont ainsi plus de 18 000 contrôles qui sont réalisés chaque année. Je me suis engagée à augmenter ce nombre de contrôle de 50 % d'ici la fin du quinquennat : 50 nouveaux postes seront créés en 2021.
Lorsque les mesures de prévention n'ont pas été suffisantes, l'État se retourne vers les exploitants en application du principe pollueur-payeur.
Les exploitants d'ICPE sont soumis à des obligations de remise en état de leurs terrains après la cessation de leur activité. Il arrive néanmoins que l'activité s'arrête en raison d'une défaillance financière de l'exploitant. C'est pourquoi, depuis 2012, des garanties financières ont été rendues obligatoires pour la mise en sécurité d'ICPE susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes. Elles représentent un montant conséquent de 650 millions d'euros pour un total de plus de 800 sites. Afin d'être directement mobilisables, ces garanties sont confiées à la caisse des dépôts et consignations ou sont cautionnées par un organisme de crédit.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de réforme du code minier, j'ai tenu à ce que les obligations en fin d'exploitation soient alignées sur celles prévues par la réglementation ICPE : en renforçant la prise en compte des enjeux sanitaires dans les objectifs de remise en état des mines, en créant des garanties financières nouvelles pour couvrir la remise en état, et en étendant la responsabilité de l'exploitant jusqu'à trente ans après l'arrêt des travaux miniers.
Par ailleurs, mon ministère s'est engagé à faire preuve de la transparence la plus absolue concernant le recensement des pollutions historiques.
Plusieurs recensements sont mis à disposition du public pour avoir connaissance des sites pollués ou des sites potentiellement pollués par des activités industrielles.
Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a constitué une liste de tous les sites ayant pu héberger une activité industrielle. Cette liste, dénommée Basias (base nationale des anciens sites industriels et activités de service), recense aujourd'hui plus de 300 000 terrains.
Par ailleurs, dès lors qu'un inspecteur des installations classées a connaissance d'une pollution ou d'une suspicion de pollution, une fiche de recensement est créée avec l'ensemble des informations disponibles sur les polluants résiduels et les actions de dépollution en cours. La base Basol (base de données sur les sites et sols pollués) compte ainsi plus de 7 000 sites.
Au regard du nombre de friches industrielles, le recyclage urbain constitue un enjeu majeur pour répondre aux objectifs de maîtrise de l'étalement urbain et de dépollution des sols.
C'est pourquoi il est nécessaire de faciliter les opérations de dépollution qui ne trouvent pas naturellement d'équilibre économique compte tenu de la faible valeur foncière.
Plusieurs dispositifs sont à l'étude dans le cadre du groupe de travail sur la reconversion des friches industrielles et sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Un dispositif national de réhabilitation des friches abondé par une taxe sur l'artificialisation des sols pourrait être une piste. Il en est de même de la mise en oeuvre d'obligations de compensation en cas d'artificialisation et de la possibilité de déroger à certaines règles d'urbanisme pour faciliter le recyclage urbain.
Si le recyclage urbain est un enjeu primordial pour le ministère de l'environnement, il est néanmoins important de veiller à ce que de nouvelles habitations, de nouvelles crèches ou de nouvelles écoles ne s'implantent pas sur d'anciennes friches industrielles sans que les travaux de dépollution adéquats ne soient menés.
Ainsi, depuis 2014 et dans le cadre de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, des secteurs d'information sur les sols (SIS) ont été créés. Lorsque la pollution résiduelle des sols est importante, un aménageur qui souhaite modifier l'usage du site doit préalablement faire attester par un bureau d'études que le niveau de dépollution sera suffisant.
Néanmoins, lorsqu'un site pollué présente des risques sanitaires pour les populations, le ministère est en mesure d'intervenir à travers ses opérateurs.
Des crédits dédiés de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), à hauteur d'environ 20 millions d'euros par an, permettent de mettre en sécurité les sites qui présentent des risques sanitaires pour les populations, lorsque toutes les procédures pour rechercher la responsabilité du pollueur ont échoué. L'Ademe traite ainsi environ 20 nouveaux sites par an. Ces crédits sont utilisés pour réaliser les opérations les plus urgentes de mise en sécurité afin de protéger les personnes et de circonscrire une pollution environnementale qui menace de s'étendre.
Au total, à travers l'intervention de ses différents opérateurs l'Ademe, le BRGM, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et le groupement d'intérêt public Geoderis, plus de 290 millions d'euros ont été mobilisés sur les crédits du ministère entre 2010 et 2019 pour traiter des situations d'urgence, apporter de l'expertise et soutenir des projets de reconversion des friches industrielles.
L'État est engagé depuis plus de vingt ans pour renforcer la réglementation en matière de lutte contre les pollutions d'origine industrielle et minière.
Néanmoins, de nombreuses pollutions historiques sont antérieures à cette réglementation et nécessitent que l'État intervienne ponctuellement pour assurer la sécurité des populations et la préservation de l'environnement et qu'il assure systématiquement la conservation de la mémoire afin d'assurer une dépollution suffisante des terrains avant l'implantation de nouveaux aménagements.
Vous pouvez compter sur ma plus grande vigilance pour atteindre ces deux objectifs.

Je souhaite rebondir sur votre conclusion qui pose le problème de la résurgence des pollutions historiques qui sont prégnantes pour les populations sur site. Cette commission d'enquête a été créée à partir de ce constat. Quand un incident arrive, on a des populations et des élus démunis et des dispositifs qui manquent de réactivité. Au cours des auditions, nous avons bien vu que, suivant les secteurs géographiques, les élus et les collectivités ont compensé ces difficultés avec l'aide de l'État via la création d'établissements publics fonciers. On ressent un manque de cadre législatif. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention. L'accumulation des structures ne gagne pas en clarté. Concernant les sites à pollution historique, il faut revoir l'information et le suivi des travaux parce qu'il y a un changement permanent d'interlocuteurs. Nous nous retrouvons donc confrontés à la pollution et à une interface avec plusieurs ministères : l'écologie et la santé. Cela manque de cohérence et de réactivité. Nous sommes comme vous très attachés à l'intérêt général. Cette commission d'enquête a pour but d'améliorer le cadre législatif et non de mettre en cause qui que ce soit. C'est une question d'environnement et de santé. Nous vous avions envoyé un questionnaire très fouillé sur lequel votre ministère nous a répondu et je vous en remercie.
Je souhaiterais revenir sur la périodicité des contrôles et des inspections des installations classées mais aussi des installations minières.
Il semble que la question de la pollution des sols ne soit traitée que de manière ponctuelle pour un grand nombre d'installations : elle n'est vraiment abordée qu'au moment de la demande d'autorisation environnementale, pour établir un état initial des sols et des eaux souterraines, puis au moment de la fermeture du site, souvent plusieurs décennies après.
Entretemps, l'exploitant ne s'intéresse qu'à la pollution atmosphérique ou encore aux déchets et la question de la pollution des sols semble-t-elle, ne se poser dans cet intervalle qu'en cas d'accident impliquant un déversement de polluants. Seules les installations les plus polluantes, comme les installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED), font l'objet d'un suivi du milieu souterrain plus prégnant.
Dans ces conditions, ne pensez-vous qu'il faille s'orienter vers la mise en oeuvre de diagnostics des sols plus fréquents afin d'éviter à se retrouver, à la fin de l'exploitation, face à des pollutions des sols qui nécessiteront des travaux coûteux ?
Par ailleurs, certains ont pointé les difficultés à rechercher la responsabilité de certaines entités en cas de dommages écologiques liés à une exploitation industrielle, notamment la responsabilité des propriétaires et celle des sociétés mères.
Pourriez-vous notamment revenir sur la notion de « propriétaire négligent » et ce qu'elle implique en termes de répartition des responsabilités entre les responsables de premier rang (c'est-à-dire, l'exploitant ou le tiers demandeur) et les responsables de second rang comme le propriétaire : dans quelles conditions le propriétaire peut-il être contraint de procéder à la mise en sécurité ou à la dépollution ? L'absence d'usage futur du site peut-elle, par exemple, dispenser le propriétaire de procéder à la dépollution, notamment lorsque les responsables de premier rang sont défaillants ?
S'agissant des sociétés mères, il demeure difficile de prouver leur responsabilité puisqu'il faut que la société mère détienne plus de la moitié du capital social de la société liquidée ou en cours de liquidation judiciaire et qu'il faut également démontrer que la faillite de la filiale exploitante résulte d'une faute caractérisée de la société mère. Ne pensez-vous pas que la loi doive être changée à cet égard afin de mettre un terme aux montages consistant pour les sociétés mères à organiser la mise en liquidation de leurs filiales ayant exploité des sites industriels et ensuite se défausser de leurs responsabilités en matière de dépollution ?
Enfin, le Gouvernement a mis en place un groupe de travail sur la réhabilitation des friches industrielles. Pourriez-vous nous préciser les pistes que votre ministère pourrait retenir pour favoriser la reconversion de ces friches ? Dans quelle mesure pensez-vous que l'État puisse peser sur l'équilibre entre l'usage futur du site et l'ampleur des travaux de dépollution ? En effet, la dépollution est fonction de l'usage du site : si on compte installer une nouvelle usine sur le site, sa dépollution sera minimale. Trouvez-vous cela satisfaisant d'un point de vue écologique ?
Ce sujet est au coeur de la vie de nos concitoyens. Il faut un suivi réel et rigoureux des politiques de dépollution mises en place.
C'est un vaste sujet. La législation et la réglementation ont été mises en place au fil des années afin d'éviter que les exploitants en activité ne viennent polluer les sols et s'assurer qu'ils ont bien les ressources financières en cas de pollution accidentelle ou après la cessation de leur activité. Ces dispositifs sont relativement protecteurs en tout cas pour les ICPE. L'enjeu de la réforme du code minier est d'aligner les obligations pour les sites miniers sur celles des ICPE. Dans le cas des ICPE, on a la possibilité de rechercher la société mère en cas de défaillance de l'exploitant. C'est indispensable. Il faut un interlocuteur capable d'assumer les responsabilités. Dans le même esprit, on a prévu d'appliquer le principe des garanties financières. Ce n'est pas au contribuable de financer les travaux de dépollution d'un site.
La grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'existence d'un stock massif, 300 000 terrains. On découvre des choses incroyables. C'est le cas, par exemple, de la vallée de l'Orbiel, d'anciennes régions industrielles et minières de notre pays...
Le principe de l'intervention est un principe de gestion des risques. C'est également le cas en Belgique et en Grande-Bretagne. On vise à obtenir un niveau de réhabilitation compatible avec l'usage qui pourrait être fait du terrain. En cas de risque, comme une inondation par exemple, mon ministère intervient pour s'assurer que l'on maîtrise les risques pour les populations. C'est différent de mener les opérations de dépollution de terrains. J'ai conscience que ce n'est pas extrêmement satisfaisant. Mais les ordres de grandeur sont colossaux. Il existe aujourd'hui des garanties de 650 millions d'euros qui visent à couvrir le coût des interventions d'urgence pour confiner la pollution. Si on doit chiffrer le coût de la dépollution, on est sur des milliards. Les inspecteurs des installations classées ont pour objectif de vérifier la non re-pollution des sites avec la surveillance du redimensionnement des bassins de rétention, avec un contrôle des rejets sur les milieux et avec un contrôle des conditions de stockage.
On pourrait imaginer des dispositifs permettant la réutilisation des friches plutôt que d'aller artificialiser des terres agricoles ou des espaces naturels.
Je pense qu'il existe aujourd'hui des dispositions pour contrôler les sites en exploitation afin qu'ils ne produisent pas de pollution des sols, pour s'assurer que les exploitants assument leur responsabilité de « pollueur-payeur » en cas d'accident ou remettent en état le site en cas d'arrêt d'exploitation. Cela dit nous devons vivre avec un stock très important.

Je voudrais apporter un regard différent. Dans mon département, je connais des friches industrielles qui sont confrontées à des enjeux de pollution. Les entreprises ont fait faillite et il est difficile de démêler les titres de propriété. Les sols sont dégradés et, encore aujourd'hui, il y a une pollution des cours d'eau qui alimentent la Moselle. Cela pose la question de la succession des réglementations dans le temps qui étaient certainement moins exigeantes à l'époque et qui négligeaient la question de « l'après ». La dépollution a un coût élevé et si la problématique de la responsabilité est établie, le propriétaire est quelquefois difficilement identifiable.
J'ai bien compris qu'il existait des dispositifs mais il faut beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Le maire devient le responsable aux yeux de la population. Il a des obligations auxquelles il doit faire face sur son territoire.
Quel point de vue portez-vous sur le sujet ? Comment faire évoluer notre droit et la pratique afin d'avoir des circuits de décision permettant d'aller plus vite et de ne pas laisser au maire toute la responsabilité de réunir les personnes et organismes concernés. C'est un sujet d'une grande complexité.
Je souhaite aborder également le sujet de la pollution des éoliennes. Je vous parle des blocs de béton qui ont un démantèlement obligatoire sur la profondeur d'un mètre. Pourquoi ne pas envisager un démantèlement complet du socle de béton au moment de l'installation ?
Enfin, la responsabilité élargie du producteur issue de la loi sur l'économie circulaire permet de faire participer les entreprises à l'effort commun de préservation de l'environnement : prévoyez-vous de reprendre ce dispositif pour l'étendre aux entreprises et industries dont l'activité présente un risque de pollution des sols ?
La logique générale c'est que, quand on a un risque de pollution, le risque doit être confiné. Le circuit normal c'est le préfet qui doit pouvoir s'appuyer sur sa direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) qui doit mobiliser l'Ademe. Le confinement des pollutions doit être transparent pour le maire. Le chemin doit permettre de remonter jusqu'à la direction générale de la prévention des risques. Je pense comme vous que le nombre de dossiers traités par l'Ademe chaque année est insuffisant. C'est une question d'organisation au sein de mes services et de mobilisation des moyens. Je vais regarder attentivement les moyens d'intervenir plus efficacement et dans des délais plus courts.
S'agissant des éoliennes, un nouvel arrêté ministériel prévoit un démantèlement des fondations au-dessus d'un mètre, en accord avec les exploitants, afin de recycler le béton et les mâts.
Enfin, sur le principe « pollueur-payeur », la responsabilité élargie des producteurs permet de payer la gestion des déchets des filières concernées et de favoriser l'éco-conception des produits. C'est un autre sujet que celui de la pollution liée au site industriel lui-même. Aujourd'hui, le principe « pollueur-payeur » s'applique aux industriels qui peuvent polluer soit accidentellement, soit au fil du temps. Des contrôles sont prévus et lorsque l'exploitation cesse, l'industriel a l'obligation de remettre le site en l'état, en vue en général de pouvoir accueillir un nouveau site industriel ce qui est différent d'un site accueillant du public sensible.

Je suis d'accord avec vous sur la prévention comme moyen de lutter contre la pollution. Mais certaines pollutions sont anciennes et nous avons environ 300 000 friches aujourd'hui. Notre objectif de « Zéro artificialisation » ne nous permet pas de laisser ces friches sans rien faire. Cela a un coût. Nous avons un problème pour financer ces réhabilitations. Au cours des auditions, nous avons pu constater l'existence d'un frein juridique et le coût de cette dépollution. La création d'un fonds est revenue à plusieurs reprises. Mais qui seraient les contributeurs ? Je considère que ce n'est pas au contribuable d'assurer cette participation. Pourriez-vous précisez quelles sont vos pistes et le calendrier pour la mise en place d'une telle structure ?
Ma seconde question porte sur la convention citoyenne pour le climat : quelle est votre avis sur la création du crime d'écocide en droit pénal ?
On voit bien que le coût de dépollution peut être très important, selon les zones où l'on peut accepter un coût foncier important mais parfois le prix de revient de la mise à disposition du foncier est décalé par rapport à l'opération envisagée. C'est l'objet d'un travail notamment animé par Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Cet enjeu de la réutilisation des friches est très lié à l'arrêt de l'artificialisation des terres agricoles et zones naturelles. On voit bien aujourd'hui l'existence d'un écart de prix de revient entre une opération de lotissement sur un terrain agricole ou une opération de reconstruction sur un site industriel, qui est colossal. L'une des pistes est la création d'une taxe sur l'artificialisation qui pourrait être alimentée par ceux qui utilisent des terres agricoles. Une autre solution passerait par l'obligation de compensation. Nous pourrions également mobiliser les établissements publics fonciers (EPF), qui couvrent à peu près la totalité du territoire et qui ont le mérite d'avoir des équipes mutualisées en ingénierie, prêtes à les accompagner dans les opérations de dépollution. Comment booster les ressources des EPF par une taxe spécifique ou sur le budget pour permettre d'effacer tout ou partie des surcoûts liés à la dépollution ? Ce n'est pas simple.
Les entreprises ont une obligation dont il ne s'agit pas de les dispenser. Le montant des garanties de 650 millions d'euros n'est pas à mettre en face des 300 000 sites recensés dont on imagine qu'ils peuvent potentiellement être pollués. Dans la base Basol, nous avons 7 000 friches identifiées comme polluées. Les 650 millions d'euros sont à mettre en regard des seuls 870 sites exploités. On peut appeler ces garanties si l'exploitant d'un de ces sites ne remplissait pas ses obligations de dépollution à l'arrêt de l'exploitation.
Concernant l'écocide, j'en pense la même chose que le Président de la République. Ce sujet relève du niveau international. Mais nous devons aussi prendre en compte les propositions faites par la convention citoyenne dans notre droit national, notamment la création d'un parquet européen et aller vers un délit d'atteinte à l'environnement.

Pourriez-vous nous donner des éléments de calendrier du groupe de travail ? L'arbitrage ne peut-il avoir lieu lors du débat de la loi de finances pour 2021 ou 2022 ?
Beaucoup d'activités ont pris du retard du fait de la crise sanitaire. Il y a deux échéances à tenir : le projet de loi de relance avec les premiers éléments de financement pour accélérer la remise en l'état des sols et le projet de loi spécifique dans lequel on devra intégrer les propositions sur l'arrêt de l'artificialisation, à la rentrée.

Beaucoup de collectivités territoriales se retrouvent en grande difficulté face à ces terrains pollués. Je note que la prescription trentenaire est un obstacle à une remobilisation rapide, notamment des friches industrielles. Or la reconquête des friches industrielles est un enjeu majeur pour l'urbanisation de nos collectivités.
Est-ce que votre ministère réfléchit à un nouveau cadre pour proposer aux collectivités des solutions efficaces pour reconvertir ce type de terrain ?
J'ai également une question sur la réforme du code minier qui est un véritable serpent de mer législatif. Seules les carrières sont soumises à une législation sur la protection de l'environnement depuis 1964. En revanche, les exploitations minières, pétrolières et gazières échappent toujours à cette législation. Les dispositions du code minier leur sont très favorables. Votre ministère avait entamé des consultations à l'automne dernier, avez-vous des informations sur un éventuel projet de loi, quelles sont les mesures envisagées en matière de pollution et de responsabilité environnementale ? Quel avis portez-vous sur la chaîne de responsabilité dans la prévention et la gestion des risques sanitaires et écologiques ? Y a-t-il des améliorations en vue de la réglementation actuelle, la prescription trentenaire étant un frein important ? Si le tiers demandeur a produit incontestablement une avancée, on garde un sentiment d'impuissance à remobiliser des sols faute de cadre législatif et de moyens financiers. Les collectivités territoriales sont en attente d'outils leur permettant d'avancer sur ce terrain.
L'idée est d'aligner la législation aux exploitants miniers. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés c'est le manque de créneau pour examiner un tel texte d'ici la fin du quinquennat. Mais nous avons la volonté de faire aboutir ce travail.
Je partage vos remarques sur les friches. C'est le sens du travail que l'on mène. Comment faciliter la réutilisation des friches industrielles plutôt que d'aller urbaniser des terres agricoles ou des espaces naturels ?
J'ai conscience que dans de nombreux cas la recherche de responsabilité n'est pas simple. Cela appelle un mécanisme complémentaire afin d'éviter la rétention foncière sachant que les établissements publics fonciers doivent pouvoir avoir un droit de préemption. Je pense qu'il est utile d'avoir, dans les territoires, des structures réunissant des professionnels aguerris de ces sujets et de mutualiser les compétences à l'échelle régionale.

Je m'interroge sur plusieurs sujets. Le premier a été évoqué par la rapportrice sur le manque de recollement des données en matière de santé, les risques liés à la pollution et la zone géographique concernée. Nous avons des difficultés à mettre en place un suivi de cohortes qui permettrait de prendre en compte l'évolution dans le temps du risque de pollution et le suivi sanitaire de la population, notamment au niveau épidémiologique. Il faut des cohortes conséquentes. Ce serait également intéressant à suivre au niveau européen. Mais je comprends bien que c'est compliqué à mettre en oeuvre. La multiplicité des interlocuteurs a mis en évidence cette difficulté. Il faudrait avoir une réflexion plus efficace sur le sujet.
Ma deuxième question porte sur le recensement des pollutions. J'ai eu sur mon territoire de mauvaises surprises liées à des usages industriels. Faute d'évaluation et de surveillance, nous avons une méconnaissance du risque lié à l'usage que l'on voudrait faire du bien foncier. Nous avons un problème de compétence, d'expertise et d'ingénierie dans ce domaine. La pollution est une question techniquement très complexe, il faut un bon diagnostic pour savoir comment on dépollue, notamment lorsque c'est pour un logement. Nous avons déjà eu ce débat. L'État doit pouvoir vraiment nous accompagner sur le terrain.
Enfin, ma dernière remarque concerne le financement. Nous avons besoin d'argent public. Le surcoût de financement lié à la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement peut aller jusqu'à 30 %. L'équilibre économique est très difficile à trouver. L'accompagnement de l'État, à travers par exemple les contrats de plan État-région (CPER), pourrait se faire à partir de fléchage de projets incluant les modes de financement.
Je pense que l'on a intérêt à stimuler les recherches sur les méthodes de dépollution des sols, comme la phytoremédiation. L'Ademe lance chaque année un appel à projets pour faire émerger des méthodes de dépollution. Une centaine de projets ont été ainsi soutenu sur dix ans pour un montant de 42 millions d'euros. Nous avons intérêt à faire émerger des démarches innovantes. C'est au coeur des compétences du BRGM.
Les EPF ont des compétences sur le sujet, l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) peut être le point d'entrée. Avoir un guichet unique permettrait de lutter contre le grand nombre d'interlocuteurs.
Mon ministère a mis en place une méthodologie sur les normes de dépollution des sols. Nous avons 62 bureaux d'études qui sont certifiés pour faire ces diagnostics et proposer des méthodes de dépollution des sols. Dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificatif, il est prévu un milliard supplémentaire pour la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour accompagner les collectivités dans leur projet de transition écologique.
Concernant le suivi des cohortes, qui n'est pas dans le champ de mon ministère, je peux toutefois préciser qu'il n'y a pas de seuil de dépollution qui soit prédéfini. Il existe 450 valeurs toxicologiques de référence, qui guident les démarches de dépollution.
Sur la comparaison avec d'autres pays, je souhaite mentionner un travail réalisé au niveau européen, HBM4EU (European Human Biomonitoring Initiative) qui vise à avoir un état moyen de l'imprégnation des populations à divers polluants.

Nous sommes d'accord sur le diagnostic. Il y a des échelles nouvelles. Les coûts de dépollution étant si importants, certaines collectivités territoriales sont disqualifiées. Ce coût va aussi jouer sur la nature de l'activité.
Je rappelle que nous ne sommes pas dans l'investigation.
Sur la gestion des risques en fonction de l'usage, est ce que l'on hiérarchise le financement ? C'est un choix de société et un choix politique.
Quel est le chef de file au niveau interministériel ? Selon la nature des sujets, est-ce qu'il y a un ministère pilote ?
Sur la question du financement, est-on dans un fonds franco-français ou bien européen, est-on dans un emprunt spécifique dédié ? Je serai attentif à votre réponse.
La surveillance sanitaire relève du ministère de la santé. Le ministère de la transition écologique est concerné à la fois par la prévention de la pollution, la vérification que les sites en exploitation respectent leurs obligations de ne pas porter atteinte à l'environnement et la vigilance, donc la police administrative, à l'égard des anciens exploitants. L'Ademe est active sur les interventions en urgence. Nous partageons avec le ministère de la cohésion territoriale la préoccupation de pouvoir réutiliser les terrains en question.
Je pense effectivement que l'ampleur de la pollution contraint les usages.
Quand vous êtes la ville de Paris avec des gens prêts à acheter un terrain très cher pour construire des bureaux ou des logements, vous y arrivez, mais la charge foncière n'est pas à la portée de toutes les collectivités. Aussi est-il utile de réfléchir à des outils de mutualisation qui peuvent être soit des fonds, soit des opérateurs, soit à travers des contrats de plan État-région. Il pourrait y avoir des subventions dans le cadre d'un plan de relance européen, fléché sur des opérations de transition écologique et d'aménagement. Dans un certain nombre de cas, nous pourrions devoir passer par des utilisations transitoires. Mais nous aurons besoin d'argent public pour équilibrer ces opérations d'aménagement.

Il semble que la campagne de diagnostic des sols des établissements scolaires bâtis sur des sites potentiellement pollués ait été interrompue pour des motifs essentiellement budgétaires en 2016. Pourriez-vous nous indiquer dans quelles conditions cette campagne pourra reprendre afin d'identifier l'ensemble des établissements ? Deux départements n'avaient pas été recensés : le Rhône et Paris.
La situation des stations-service dont l'activité s'est arrêtée a laissé des traces dans les sols. Se pose également la question du traitement et du financement. Votre ministère a-t-il une action spécifique engagée sur ces sites anciennement occupés par des stations essence, l'exploitant étant souvent plus facile à identifier, émanant de grands groupes ?
Les chantiers du Grand Paris Express pourraient conduire à l'excavation de près de 45 millions de tonnes de terre. Selon les estimations, 10 % des gravats collectés pourraient être pollués : comment aborde-t-on, notamment au niveau de la société du Grand Paris, la problématique de la dépollution des terres excavées du Grand Paris ?
Il est très important de ne pas construire des établissements sensibles sur des sites pollués par d'anciens sites industriels. En 2010, le ministère de l'environnement avait lancé un diagnostic national sur la pollution des établissements sensibles situés sur d'anciens sites industriels. Un peu moins de la moitié ont bénéficié d'un diagnostic, soit 1 400 diagnostics. C'est une démarche qui ne peut se faire indépendamment des collectivités. À l'époque, un certain nombre de collectivités trouvaient curieux que le ministère de l'environnement vienne pointer un établissement scolaire dans une commune présentant un risque de pollution. Je suis favorable à aller au bout de cette démarche. Sur le financement, la méthodologie est acquise dans les grandes collectivités comme Paris. Pour les autres, le ministère doit pouvoir les épauler en termes de méthodologie et d'accompagnement financier.
S'agissant des stations-service, en cas de cessation d'activité, elles ont l'obligation de remettre le site en état. Le ministère peut être amené à intervenir, en contactant l'Ademe, pour confiner la pollution.
Sur le Grand Paris Express, la société du Grand Paris est chargée de la surveillance des terres excavées. Elles doivent être valorisées, et si elles sont trop polluées, elles doivent être traitées ou bien envoyées à la décharge.

Je reviens sur la question de la volonté politique. Je constate que nous manquons d'éléments législatifs pour le traitement de la dépollution des sols et de définitions. Nous n'avons pas défini de typologie de pollution des sols. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire et à quel moment il doit le faire. L'État ne doit pas se défausser de sa responsabilité en matière de gestion de la dépollution des sols. Il faut une cartographie beaucoup plus fine et plus cohérente. Je souhaite une volonté de l'État en la matière. Il faut une clarification des tâches de chacun lorsqu'il y a mise en danger de la population. Je pense également que la population dispose d'une mauvaise information, due à l'utilisation d'un langage peu accessible. À un moment donné, il faut avancer. Nous avons des problèmes de pollution historique pour lesquels on manque de suivi. Tout cela manque de contrôle, de suivi et de cohérence. Il faut que les collectivités et l'État soient au rendez-vous.

Je vous remercie madame la ministre, pour les réponses que vous nous avez apportées. Nous allons poursuivre nos travaux avec quelques visites sur le terrain et nous prévoyons de rendre notre rapport début septembre.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 18 h 30.