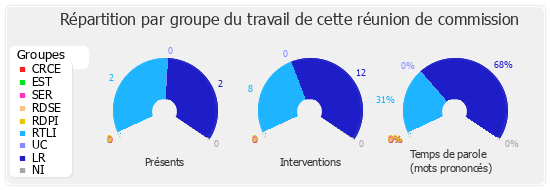Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du 20 février 2020 à 9h40
Sommaire
- Examen des conclusions de l'audition publique sur l'hésitation vaccinale jean-françois eliaou et cédric villani députés et florence lassarade sénatrice rapporteurs (voir le dossier)
- Examen des conclusions de l'audition publique sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels cédric villani député et gérard longuet sénateur rapporteurs (voir le dossier)
- Examen des conclusions de l'audition publique sur les fongicides sdhi cédric villani député et gérard longuet sénateur rapporteurs (voir le dossier)
- Désignation des membres du conseil scientifique pour 2020-2022
La réunion
Examen des conclusions de l'Audition publique sur l'hésitation vaccinale jean-françois eliaou et cédric villani députés et florence lassarade sénatrice rapporteurs
Examen des conclusions de l'Audition publique sur l'hésitation vaccinale jean-françois eliaou et cédric villani députés et florence lassarade sénatrice rapporteurs
La question des vaccins a été mise en avant par le gouvernement dès l'élection de 2017. Pendant la période séparant l'élection présidentielle des élections législatives, la ministre de la santé a souhaité augmenter le nombre de vaccins obligatoires, ce qui a donné lieu à des débats. Des études ont souligné le statut particulier de la France sur ce sujet, car elle est l'un des rares pays développés qui, simultanément, a rendu la vaccination obligatoire et présente une forte défiance envers la vaccination. L'Office a organisé une audition publique particulièrement intéressante sur l'hésitation vaccinale le 14 novembre dernier ; deux tables rondes ont permis d'appréhender la relation compliquée entre sciences et opinion publique. La première était présidée par Jean-François Eliaou, la seconde par Florence Lassarade, et j'avais conclu la matinée. Je vais donner la parole à Jean-François Eliaou, qui parlera en son nom et en celui de notre collègue Florence Lassarade.
Un an et demi après l'extension des vaccinations obligatoires pour les nourrissons, l'Office a publié une note scientifique sur la politique vaccinale en France qui a souligné l'existence d'une défiance vis-à-vis de la vaccination, plus marquée en France que dans les pays voisins. C'est pourquoi notre premier vice-président Cédric Villani, ma collègue sénatrice Florence Lassarade et moi-même avons souhaité poursuivre et approfondir ce travail par une audition publique portant sur le thème plus spécifique de l'hésitation vaccinale. Le phénomène est multifactoriel et l'audition a permis de présenter ses origines multiples et les réponses déjà en oeuvre ou envisageables qui découlent de ces observations.
Si le constat de l'ampleur du phénomène est partagé par tous, son interprétation et les solutions proposées suscitent des divergences. Il importait donc tout particulièrement que l'Office se saisisse de cette question pour l'examiner en détail, à la lumière des points de vue des différentes parties prenantes.
La défiance vis-à-vis de la vaccination est un phénomène ancien qui est aujourd'hui suivi avec beaucoup d'attention car, d'après Coralie Chevallier, il fait partie des comportements à risque qui menacent la santé publique.
Sylvie Quelet, de Santé publique France, a montré que les enquêtes à spectre large de l'agence, comme les baromètres de santé effectués à intervalles réguliers, permettent de suivre l'adhésion de la population à la vaccination. Il convient de distinguer le rejet catégorique de la vaccination de l'hésitation vaccinale, qui correspond à une attitude ambiguë, souvent caractérisée par l'accord avec le principe que la vaccination est importante pour la santé mais avec le rejet de certains vaccins ou de certains de leurs composants.
Laurent-Henri Vignaud a rappelé que la défiance envers la vaccination est un phénomène qui remonte au tout début de la vaccination et même à l'inoculation variolique, car ces deux techniques étaient associées à de réels risques pour la santé, bien qu'efficaces contre la variole, comme cela avait été démontré par les mathématiciens Bernoulli et d'Alembert.
La perspective historique a mis en exergue un certain nombre de biais cognitifs qui expliquent, encore aujourd'hui, la défiance. La mauvaise appréhension des statistiques conduit à mal estimer le rapport bénéfices/risques, bien que celui-ci se soit considérablement amélioré. Les exemples concrets ont une influence plus grande sur la décision.
Des biais spécifiques à certains vaccins ont été décrits, par exemple pour le vaccin anti-HPV (anti-papillomavirus), qui n'est prescrit quasiment qu'aux jeunes filles en France et qui est souvent associé au début de la vie sexuelle. Ainsi, on ne peut que se réjouir que le ministère de la santé ait récemment annoncé suivre l'avis de la Haute Autorité de santé d'étendre la recommandation de la vaccination aux garçons.
Des événements comme l'épidémie de grippe H1N1 ou l'arrêt de la campagne de vaccination contre l'hépatite B, repris par Annick Opinel, sont à l'origine d'un contexte culturel de défiance vis-à-vis des institutions, et en particulier des autorités sanitaires, spécifique à la France, qui explique probablement en partie la plus grande proportion d'hésitation vaccinale en comparaison des pays voisins.
Pour Jérémy Ward, il existe une différence notable par rapport au passé : les hésitants se disent maintenant souvent partisans de la vaccination et ne rejettent que certains vaccins ou que certains composants, différents selon les pays, et ils citent souvent des travaux scientifiques pour fonder leur argumentation, ce qui a pour effet d'instiller le doute dans leur entourage et parmi ceux qui les écoutent.
La question de l'obligation de la vaccination, deux ans après, a encore suscité des débats, et les intervenants, même s'ils ne sont pas accordés sur la méthode - obligation ou non - ont tous relevé les conséquences positives de la mesure sur l'acceptation vaccinale. Le Pr. Henri Partouche a indiqué que ces obligations étaient contraires à l'idée de mission de santé publique que se font de nombreux médecins, qui préféreraient réussir à convaincre les patients de se faire vacciner plutôt que d'avoir à brandir l'argument de l'obligation.
Tous les intervenants se sont accordés sur le fait que la question de l'information était une question centrale pour comprendre et pour trouver des solutions à l'hésitation vaccinale. Plusieurs facteurs jouent : présence des scientifiques ou des médecins dans les médias, écrits très documentés de scientifiques et de journalistes spécialisés pour vulgariser les connaissances sur le sujet, etc.
L'analyse détaillée de Manon Berriche et Sacha Altay portant sur l'interaction des internautes avec un site internet souvent décrit comme « modèle » de désinformation en santé, a laissé entendre que les internautes ne sont pas si crédules, et que les publications qui sont vraiment de la désinformation en santé sont finalement celles qui suscitent le moins d'interaction. Les médias plus traditionnels restent les principales sources d'information, conclusion qui était partagée par Jérémy Ward. Cyril Drouot a complété en indiquant que le discours du journaliste spécialisé, qui est parfois un médecin, est celui qui suscite le plus l'adhésion. C'est un point de stimulation sur lequel il est possible d'agir.
Plusieurs intervenants ont souligné que le biais cognitif, qui incite à considérer avec plus d'attention l'exemple concret que la démonstration statistique, pouvait être atténué par une amélioration de la littératie scientifique à l'école et une amélioration de l'appréhension des concepts statistiques. Jérémy Ward a, quant à lui, indiqué que la confiance dans la vaccination était avant tout une délégation de l'expertise du citoyen vers le médecin et les autorités de santé.
Plusieurs intervenants, dont le Pr. Alain Fischer et plusieurs parlementaires, ont suggéré de revenir à une vaccination par la médecine scolaire, qui serait assortie d'une éducation aux bonnes pratiques de santé. Sans que tous les intervenants s'accordent sur cette proposition, il est ressorti des discussions que l'école peut être un lieu d'éducation à la santé, ce qui serait un renouveau.
Coralie Chevallier et le Pr. Henri Partouche ont indiqué que trop chercher à rassurer des personnes suspicieuses peut paradoxalement conduire à les inquiéter encore plus. De plus, les maladies à prévention vaccinale sont généralement mal connues du grand public, par nature, puisque peu fréquentes du fait de la vaccination. Il conviendrait donc de focaliser la communication sur les risques associés à ces maladies plutôt que chercher à déployer des efforts considérables pour éteindre les controverses.
Coralie Chevallier a précisé que l'intuition n'était d'aucune aide pour élaborer des campagnes de vaccination, qu'il fallait toujours les tester en amont de façon à ce qu'elles soient plus efficaces et les « post-tester » de façon à évaluer leur impact effectif.
Isabelle Bonmarin a présenté l'initiative de Santé publique France pour informer le grand public qu'est le site internet vaccination-info-service.fr, dont on peut regretter que seulement 5 % des personnes interrogées l'aient déjà consulté.
Coralie Chevallier a indiqué que des mesures d'ordre organisationnel ou relationnel permettaient d'atténuer l'hésitation des patients : mise à disposition des vaccins dans les cabinets médicaux, possibilité pour les pharmaciens de vacciner, etc. L'attitude du médecin a également une grande influence sur la réalisation de la vaccination.
Nous proposons finalement que l'Office adopte les recommandations suivantes :
La facilitation de la réalisation des vaccinations en officine, par le pharmacien, ou en cabinet par un médecin, par la mise à disposition des vaccins sur place, devrait être mise en oeuvre rapidement.
Le service sanitaire des étudiants en santé étant un moyen d'éduquer les enfants aux bonnes pratiques de santé, par des interventions dans les écoles, il est nécessaire que ces étudiants soient formés sur la bonne façon de promouvoir la vaccination, en particulier en insistant plus sur les risques liés aux maladies à prévention vaccinale. La maternité, qui accueille des jeunes parents très réceptifs car très sensibles à la santé de leur nouveau-né, peut constituer un lieu privilégié d'information sur la vaccination.
Il conviendrait d'encourager la recherche comportementale, d'une part pour mieux apprécier les effets des infox circulant sur les réseaux sociaux sur le comportement des personnes et adapter la modération à la menace réelle qu'elles représentent, d'autre part pour assurer l'efficacité du message en santé publique, jusqu'à la décision effective du citoyen.
Plus généralement, il y a lieu d'encourager les médias et les maisons d'édition à se doter d'une expertise scientifique interne pour veiller à un traitement scientifiquement juste des informations liées à la vaccination.
Tout le monde s'est accordé pour dire que l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires a eu un impact positif, non seulement sur la couverture, mais aussi sur l'appréciation de l'intérêt de la couverture vaccinale. Il aurait peut-être été préférable de convaincre plutôt que d'obliger, mais en pratique, cela a bien fonctionné, et même mieux que ce que l'on aurait pu attendre.
La situation est paradoxale entre ce qui vient de nous être décrit, et le cas du coronavirus aujourd'hui, qui inquiète tout le monde et pour lequel tout le monde attend le vaccin miracle.

Je trouve que Jean-François Eliaou a bien restitué l'équilibre complexe entre la conviction, l'obligation et l'information. L'information doit rappeler que les maladies, même banales, tuent, ou que la rougeole ou la tuberculose peuvent encore tuer même si personne ne le croit. Un certain nombre de vérités doivent être rappelées.
L'hésitation vaccinale est bien une hésitation, et c'est une attitude extraordinairement fréquente dans les sociétés développées, mais en France en particulier, où le scepticisme est une forme d'intelligence paresseuse, ou plutôt de paresse intelligente. Cette attitude d'hésitation est l'expression d'un manque d'approfondissement, et les pouvoirs publics doivent mettre en place des obligations, de temps en temps, pour lutter contre ce scepticisme inutile. Je trouve que ce qu'a fait la ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, était parfaitement judicieux et pertinent.

Il faudrait insister sur le fait que ceux qui ne se vaccinent pas portent une grande responsabilité envers les autres, car au-dessous d'un seuil de couverture vaccinale d'environ 95 %, la maladie n'est pas éradiquée. La variole a par exemple presque été éradiquée grâce à un taux de vaccination de plus de 95 %, même si quelques traces existent encore en Éthiopie.

Pour ce qui est du scepticisme, il peut être passif et naturel, mais il est fréquemment induit, souvent par les réseaux sociaux et parfois par la presse. Nous avons affaire aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler des « révisionnistes », dans tous les domaines, et en particulier en médecine. Ils remettent en cause la vaccination et certaines médications à grands coups de fausses informations. Certains remettent même en cause la rondeur de la Terre. Cela induit du scepticisme, et il est difficile de faire du déminage car ces fausses informations circulent sur internet, et l'on connait la puissance des réseaux. Il serait peut-être bon de créer des comités scientifiques qui rétablissent certaines vérités.
Le discours vaccinosceptique s'est complexifié et s'est enrichi au cours des dernières années, citant des références, des graphiques, des évolutions, insistant sur les cas particuliers, sur le fait que les vaccins ne sont pas uniformes, qu'il y a des méthodes différentes, qu'il y a des types de transmissions différents, et cela nous oblige, en parallèle de l'énonciation de ces grands principes généraux, à aller dans le détail et à prendre au sérieux la contestation.

Des études épidémiologiques sur des milliers d'individus ont été menées, elles étaient parfaitement claires sur l'utilité des vaccins, notamment sur le vaccin contre l'hépatite B qui a été rendu obligatoire en milieu hospitalier. Ces études ne suffisent pas, je ne sais pas ce qu'il faut de plus.
Pour aller dans le sens de notre collègue Bruno Sido, il y a un vrai sujet quant à la répression, non pas de l'hésitation mais de l'abstention vaccinale, c'est-à-dire lorsque le parent prend l'irresponsabilité de ne pas vacciner son enfant. Une déscolarisation est-elle possible ? L'obligation est un premier pas, mais s'il n'y a pas de modalité répressive, c'est une obligation à géométrie variable.

Le carnet de santé numérique me semble assez intéressant. Je me suis récemment posé la question de savoir si j'avais été vacciné contre la fièvre jaune, et j'ai dû chercher dans des papiers perdus dans des fonds de tiroir.
Quand on est parlementaire depuis longtemps, on est suivi par le cabinet médical de l'assemblée dans laquelle on siège, mais le citoyen a été vacciné à un moment donné, et il ne sait pas très bien pourquoi ni dans quelles circonstances. Avoir un carnet de santé numérique pourrait contribuer à une appropriation individuelle de l'histoire vaccinale : « j'ai été vacciné depuis mon petit âge jusqu'à maintenant et je continue à mettre à jour mes vaccins » - certains doivent être refaits régulièrement, comme le tétanos. C'est important car il y a des cas de tétanos en France, malgré l'extrême salubrité de notre pays. Concernant la rage, ce n'est pas parce que l'on vit en France qu'on ne se fera pas mordre par un chien et que l'on ne contractera pas la maladie.
La prise de conscience pourrait être facilement acceptée par les jeunes, car cela fait partie de leur univers, davantage que du mien, et je pense que cela serait une bonne piste.

Je propose à l'Office d'adopter les conclusions de l'audition publique telles que présentées par le professeur Eliaou. Cela ne veut pas dire que le sujet est épuisé, mais cela constitue une progression. Ce que nous écrivons est lu, mais le travail que nous faisons sur chaque phrase n'est pas nécessairement fait par ceux qui veulent utiliser nos documents. Chaque phrase doit être cohérente avec l'ensemble et ne doit pas induire un risque d'interprétation.
Pour ce qui est du carnet de vaccination électronique, nous ouvrons la porte, mais nous ne sommes pas définitifs ni péremptoires. Le carnet de vaccination électronique faisait partie des recommandations émises par la concertation citoyenne en 2016, et nous restituons simplement tous les éléments et tous les arguments qui devraient militer en faveur de son adoption. Cela faisait aussi partie des recommandations qui figuraient dans la note scientifique sur la politique vaccinale.
La science de la vaccination évolue dans ses recommandations. Lors d'un débat sur le BCG, l'un de nos collègues rappelait les temps anciens où ce vaccin était obligatoire, et l'un des experts présents indiquait qu'il ne l'était plus, car, avec du recul, c'était un mauvais vaccin.
Une action doit être menée auprès de l'école, au niveau de la médecine scolaire qui est en déshérence depuis plusieurs années. Un certain nombre d'entre nous est passé, petit, par la vérification de son statut vaccinal concernant la tuberculose, test qui s'opérait avec le timbre que vous avez sûrement en mémoire ; cette contrainte et cette participation citoyenne à la couverture sanitaire était importante. L'hésitation vaccinale existe car un certain nombre de nos concitoyens ne se sentent pas concernés. La promotion de ce geste de santé à l'école doit contribuer à faire prendre conscience aux enfants de l'objet social qu'est la société. Le comportement individuel a un impact sur l'ensemble de la société, et il est possible de le faire comprendre aux écoliers, tout comme la gravité de certaines maladies.
Par ailleurs, nos concitoyens aiment s'informer et vont s'informer, mais les sources ne sont pas toutes fiables, ou risquent de ne pas l'être. L'apprentissage des statistiques permet d'intégrer qu'elles sont plus significatives qu'un cas anecdotique et concret, parfois déformé, et qui est pourtant perçu comme une information pertinente. Les statistiques souffrent d'être mal connues.
Enfin, le carnet de santé numérique est important. Depuis de très nombreuses années, la France essaie de numériser les informations médicales sans succès, et c'est un point sur lequel il faut insister.

Le dossier médical partagé a été pris en main par la CNAM et il y en a à peu près 8 millions aujourd'hui, mais il n'est pas encore complètement en état de fonctionnement. Il permettrait d'avoir un carnet de vaccinations à jour, car nous n'avons pas évoqué la négligence d'une partie de la population par rapport à l'observance de l'obligation vaccinale. C'est souvent par négligence plus que par scepticisme, que l'on ne se vaccine pas et le carnet de vaccination électronique permettrait de recenser ces cas.

Je propose à l'Office d'adopter ces conclusions.
L'Office adopte les conclusions présentées et autorise à l'unanimité la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu de l'audition publique du 14 novembre 2019 sur l'hésitation vaccinale.
Examen des conclusions de l'Audition publique sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels cédric villani député et gérard longuet sénateur rapporteurs
Examen des conclusions de l'Audition publique sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels cédric villani député et gérard longuet sénateur rapporteurs

Je vous présente les conclusions de l'audition publique du 6 février dernier sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et de la gestion des risques accidentels.
Cette audition faisait largement écho à deux événements qui nous ont marqués en 2019 : l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril - je rappelle que Cédric Villani était à l'initiative d'une audition passionnante sur l'apport des sciences et techniques à la future restauration de la cathédrale - et l'incendie de l'entreprise Lubrizol à Rouen le 26 septembre.
Dans les deux cas, des mesures sanitaires et environnementales ont été mises en place à la suite de la dispersion de polluants émis par les fumées, le plomb pour Notre-Dame et des produits chimiques, dont des hydrocarbures aromatiques polycycliques pour Lubrizol. La problématique de l'audition était de savoir ce que l'on pouvait faire pour mieux gérer ces crises, et l'audition a permis de mettre en lumière plusieurs points importants.
Le premier point est évident, il s'agit de la communication et du partage d'information dans les zones à risques, que ce soit avec les populations locales, les industriels ou les autorités publiques. Ensuite, vient la nécessité d'impliquer activement les populations dans les mesures de prévention, comme en Normandie ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le programme des « Nez experts », qui s'entraînent à reconnaître les odeurs caractéristiques de certains polluants afin de repérer rapidement les signaux faibles. En ce qui concerne les moyens de prévention, il est important qu'ils associent des instruments de mesure, fixes ou mobiles, avec des outils de simulation. Le lien entre les deux est très intéressant car les outils de simulation permettent, à partir d'instruments de mesure - à la fois nombreux mais jamais suffisamment nombreux - de mieux connaître et de mieux comprendre la dispersion et le transport des polluants et les trajectoires de panaches qui pourraient être dangereux, ce qui permet d'informer les populations.
Les axes d'amélioration portent, entre autres, sur le traitement des données massives issues des mesures. Cependant, il faut à la fois identifier et quantifier les molécules, ce qui n'est pas facile. L'urgence est d'acquérir, le plus rapidement possible après la crise, le maximum d'informations au plus près du sinistre. En particulier, la possibilité d'envoyer des drones afin d'effectuer des prélèvements a été évoquée, y compris dans des zones dangereuses ou d'accès difficile. Le choix des substances à mesurer doit s'effectuer en fonction des connaissances actuelles sur leur nocivité toxicologique et les spécificités locales, comme dans certains bassins industriels.
Nous avons eu une intervention très intéressante de l'INERIS qui est capable de simuler le comportement d'un panache de fumée sur une dizaine de kilomètres en quelques heures. Ceci nous a montré l'intérêt d'une grande précision des simulations numériques et de la rapidité des calculs, qui supposent une bonne connaissance de la topographie du site et des produits dispersés, ce qui n'est pas toujours facile.
En ce qui concerne les effets sanitaires sur les populations, les premiers exposés sont évidemment les sapeurs-pompiers. En tant que premiers arrivants, ils constituent une population particulière, potentiellement soumise à une exposition aiguë. Ils bénéficient, en général, d'un équipement de protection individuelle assurant une première barrière de sécurité et d'un suivi médical. En revanche, le suivi des populations civiles s'avère beaucoup plus problématique, car l'exposition est plus diffuse dans l'espace et dans le temps. C'est tout le problème du panache et de sa diffusion : pour des raisons de vent et de topographie, les populations peuvent être très inégalement exposées et la distance au lieu du sinistre n'est pas la seule explication. L'exposition est diffuse dans le temps, car dans certains cas elle dépend de la migration de l'air vers le sol puis, parfois, vers les nappes souterraines qui peut prendre plusieurs années. Tous ces phénomènes peuvent d'ailleurs aboutir à ce que la population soit exposée à des facteurs de risque multiples. Nous avions le sentiment, après cette audition, d'avoir encore des marges de progression sur cette question de l'exposition.
Si la crise et les éventuels effets aigus doivent être gérés à court terme, il faut également surveiller le risque chronique sur le long terme, ce qui implique un important travail préalable sur la détermination de valeurs dites « de référence » qui correspondent à l'état du milieu avant la crise. Ces valeurs permettent de mettre en perspective les concentrations mesurées après l'accident et d'attribuer, ou non, les éventuelles pollutions à tel ou tel événement.
En conclusion, par les recommandations qu'il vous est proposé d'adopter, l'Office préconise de poursuivre la recherche dans l'ensemble des directions mises en avant par les différents intervenants. Il estime également qu'il est important :
- de favoriser la mise en place de moyens plus performants, de coordination et d'échange de données entre les différents acteurs impliqués lors d'accidents comportant des risques sanitaires et environnementaux. Ceci paraît être une question de bon sens, car on se dit toujours, après les accidents, que les gens auraient dû se parler davantage. Je pense que les préfets passent beaucoup de temps à préparer des plans de crise mais manifestement, ce n'est pas complètement satisfaisant ;
- de mettre au point une méthodologie visant à établir des valeurs de référence avant contamination pour évaluer l'exposition à des substances polluantes des populations vivant dans des territoires déterminés, en vue de guider l'action des autorités dans le cadre de la gestion d'une crise, et ensuite d'élaborer un plan national de déploiement des mesures relatives à ces « valeurs de référence » - même si je ne suis pas complètement convaincu par ce dernier point ;
- de favoriser le développement de moyens permettant d'acquérir le plus rapidement possible une connaissance précise des substances émises au cours d'un accident industriel, par exemple l'emploi de drones équipés de capteurs. En effet, il existe une vraie inconnue dans le cas des accidents industriels c'est le fameux « effet cocktail », le mélange imprévisible, ou difficilement prévisible, de produits de nature différente qui se retrouvent sur un même site ou à proximité, l'explosion de l'un entraînant l'incendie de l'autre, dans un processus qui échappe bien souvent aux plans de crise, qui sont en général déterminés entreprise par entreprise ;
- de mettre systématiquement en place, après un accident, un suivi sanitaire et environnemental sur le long terme. Il est, en effet, important de pouvoir revenir sur ce qu'il s'est passé et de rechercher en priorité les contaminants les plus dangereux afin de limiter les expositions à des risques chroniques ;
- enfin, d'impliquer plus fortement et plus activement les citoyens dans les actions de prévention, par exemple en développant les groupes de « nez experts » capables de détecter et de reconnaître rapidement les odeurs caractéristiques de certains polluants. Pour ma part, je connaissais les « nez » dans l'industrie de la parfumerie et si notre excellent collègue Jean-Pierre Leleux, qui a été maire de Grasse, capitale de la parfumerie en France, était là, il pourrait nous en parler plus savamment. Mais il existe aussi des « nez experts » dans l'industrie pour prévenir les accidents industriels.
J'ai essayé de faire une présentation assez courte car, pour être franc, tout cela est compliqué. Sur le terrain, les risques sont quand même très spécifiques aux diverses activités industrielles. Je connais un peu Rouen, dont les activités portuaires font, en permanence, coexister des produits qui, en théorie, sont peu dangereux en tant que tels mais qui, juxtaposés, en fonction du déchargement des bateaux, peuvent aboutir à des mélanges dangereux en cas d'accident. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu, comme les participants à l'audition, que tout réside dans la coordination, l'échange et la préparation à d'éventuelles situations de risques. C'est aussi pourquoi nous devons faire attention à ce que nos conclusions ne donnent pas à nos compatriotes la certitude que tout serait prévisible et qu'une sécurité absolue pourrait être toujours garantie.
Ce qui m'a frappé pendant l'audition, c'est la façon dont chacun a un rôle individuel clairement défini mais que tout est beaucoup moins clair quand il faut porter un regard d'ensemble, un regard global. Il est difficile de déterminer qui doit donner l'impulsion pour faire en sorte que les procédures évoluent bien, que les retours d'expériences se font, etc. Le sujet est multi-tutelles, multi-organismes, et il gagnerait à avoir une prise en charge plus transversale.

Pour ma part, je suis en quelque sorte en conflit d'intérêts car j'ai toujours mon costume de sous-préfet dans mon armoire et le corps préfectoral a tendance à considérer que la crise est son coeur de métier. Sauf qu'il est difficile de concilier l'aspect scientifique et technique - qu'il ne maîtrise pas totalement - et l'information des citoyens de façon à éviter des effets d'amplification et des réactions excessives. En fait, le préfet est toujours partagé : il doit mettre en garde pour protéger et « ne pas trop » mettre en garde pour ne pas susciter des réactions de panique et l'inquiétude. Sa maîtrise technique se reconstitue à chaque événement ; mais, même en multipliant les plans - pour avoir vécu l'explosion d'une usine, je le sais bien -, les choses ne se passent jamais comme dans les exercices. C'est la raison pour laquelle je suis assez prudent. Il faut à la fois savoir planifier et être capable de réagir en dehors du plan.

J'ai été concerné par l'incendie de Lubrizol - on oublie que la Bresle, qui marque la limite entre les départements de la Somme et de la Seine-Maritime, n'est pas comme le Rhin qui aurait magiquement empêché de passer le panache nucléaire venant de Tchernobyl. Nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire que le nuage a passé la Bresle et est venu dans la Somme. Pourtant, le préfet et l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France n'ont pas été avisés. L'affaire est restée locale, à Rouen et au mieux à 30 ou 40 kilomètres autour de Rouen, mais pas davantage. Il y a un véritable problème de prise de conscience dans ce genre d'accident. J'ai été frappé par le fonctionnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui a une méthodologie spécifique : ils ne sont pas seulement un bureau « accident/analyse » comme il en existe sur les accidents aériens par exemple, mais ils ont un centre opérationnel permanent avec du personnel d'astreinte.
J'ai assisté à un exercice où un camion rempli de colis nucléaires était supposé être tombé dans un cours d'eau dans le Cantal, avec tout un ensemble de conséquences catastrophiques. Ce bureau se met à disposition immédiatement et en permanence des pompiers, du préfet, des autorités voisines, etc. Ils ont une vision globale de la situation nourrie de leur expérience. J'ai trouvé cette vision si intéressante que j'en ai parlé à notre collègue Hervé Maurey, qui préside la commission d'enquête du Sénat sur Lubrizol, afin qu'il auditionne le président de l'IRSN. Il me semble que cette piste est intéressante, notamment dans le cas des accidents industriels importants.
Imaginons que le préfet ne soit pas présent dans son département au moment de l'accident ; celui-ci va devoir être géré par un jeune directeur de cabinet, souvent sans expérience ; il peut être utile d'avoir à proximité une instance capable de vous épauler, comme le fait l'IRSN. J'ai quand même été étonné que personne ne s'intéresse aux départements voisins quand l'accident de Lubrizol est arrivé. Plusieurs centaines de cultivateurs ont été pénalisés dans la Somme, ce n'était pas anodin. Donc, attention à ne pas traiter le problème de manière trop locale alors qu'un regard extérieur ou national donne de la compétence et retire de l'émotion dans la manière de traiter le sujet.

Cher Jérôme, permets-moi de relever que l'IRSN bénéficie du privilège de devoir traiter un risque bien identifié. Pour les risques industriels, c'est tout à fait différent. Prenons par exemple l'affaire AZF de Toulouse : l'entreprise existait depuis plus de 50 ans et cette déflagration extraordinaire, spectaculaire, à la fois meurtrière pour les salariés et dévastatrice pour le secteur, était à peu près improbable compte tenu de l'activité de l'entreprise. Sauf que l'activité de l'entreprise avait changé peu à peu et que le danger s'est accru. L'IRSN a l'avantage de se focaliser sur un risque bien connu : le nucléaire, ce qui simplifie les choses ; la transposition de son savoir-faire aux accidents industriels ne va donc pas de soi. En revanche, je suis complètement d'accord sur le fait que le défaut du corps préfectoral est sa culture des limites administratives, qui deviennent assez facilement des frontières, alors que les trajectoires aériennes de fumées polluantes n'ont rien à voir avec les limites administratives.
Je n'ai pas eu la possibilité, et je m'en excuse, de participer à cette audition, mais je connais bien les participants et j'ai un regard un peu averti puisque j'étais docteur-ingénieur chimiste et je préside le Conseil national de l'air. Je connais donc bien la thématique des mesures de la qualité de l'air. Naturellement, à l'Assemblée nationale, je fais partie de la mission parlementaire sur l'accident de Lubrizol. Le Sénat est allé plus loin avec une commission d'enquête. Je voulais attirer votre attention sur quelques points.
Sans remettre en cause l'action des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), je me demande s'il ne serait pas intéressant d'avoir une autorité qui contrôlerait de façon un peu plus poussée qu'aujourd'hui l'ensemble des sites Seveso, notamment les sites Seveso « seuil haut ». Je crois que nous devons tirer les enseignements des malheureux accidents que nous avons vécus.
On se nourrit toujours de l'histoire et je voudrais faire remarquer que ce n'était pas la première fois qu'un accident est arrivé sur ce site-là. En 2013, de mémoire, un événement - beaucoup moins important - s'y était déjà déroulé. C'est d'ailleurs grâce au retour d'expérience de 2013, notamment des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA), qui travaillent en lien étroit avec l'INERIS, qu'il a été décidé de stocker en permanence sur ce site des canisters, dont les pompiers ont pu disposer rapidement pendant l'incendie et qui ont permis d'effectuer des mesures utiles pour les modélisations de l'INERIS.
Les choses auraient pu être bien pires sans le professionnalisme extraordinaire du corps des sapeurs-pompiers. C'est aussi notre rôle de le rappeler.
Cet événement a été une fois de plus - vous allez me dire que cela n'a rien de surprenant - l'occasion de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes très rapidement dans un rapport de défiance par rapport à la donnée scientifique. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé le lendemain de l'accident. J'ai été contacté, non pas en tant que parlementaire, mais en tant que président du Conseil national de l'air, par le directeur adjoint d'ATMO Normandie, avec qui j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Il faut d'abord savoir qu'aujourd'hui, tous les jours, la surveillance réglementaire de la qualité de l'air en France mesure les oxydes d'azote, le SO2, l'ozone et les particules fines - les PM 10 et, à partir de 2020, les PM 2,5 aussi. La mesure s'effectue à deux ou trois mètres de hauteur par rapport au sol. L'idéal serait de mesurer un peu plus bas, à hauteur de respiration ; malheureusement, si les capteurs sont posés trop bas, ils sont vandalisés - or une station de mesure d'entrée de gamme coûte 150 000 euros et il s'agit d'argent public.
Mes collègues d'ATMO Normandie me font part de leur problème : le panache est trop haut par rapport aux capteurs et les composés mesurés au sol ne correspondent pas forcément à la composition du panache. Ce dernier étant le fruit de la combustion de produits chimiques stockés chez Lubrizol, il contenait notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), que nous ne mesurons pas dans le cadre de la veille réglementaire quotidienne ; par ailleurs, les oxydes d'azote, que l'on mesure, n'ont pas été émis lors de l'accident. En définitive, les capteurs au sol, qui mesurent la qualité de l'air de tous les jours et les polluants de proximité qui nous importent le plus, indiquaient qu'il n'y avait rien de particulier ! Deux raisons : d'une part, ils mesurent seulement certaines substances - j'y reviendrai dans les conclusions -, d'autre part, les composés qui formaient le panache n'étaient pas encore présents à hauteur humaine, à hauteur de capteur, car ils n'étaient pas encore en phase de retombée.
Il y avait donc un réel dilemme, ce jour-là, pour savoir s'il fallait communiquer nos indices de qualité de l'air qui indiquaient que la qualité de l'air était bonne. Pendant ce temps-là, les populations locales étaient stressées, enfermées, et ne pouvaient pas penser une seule seconde que la qualité de l'air était bonne. En même temps, ne pas communiquer semblait signifier cacher quelque chose. Nous avons finalement choisi, en accord avec le préfet, de ne pas diffuser l'information. Il s'avère que le préfet de Normandie est le seul préfet qui siège au Conseil national de l'air, nous nous connaissons donc bien.
On parle souvent de la défiance par rapport aux acteurs publics ; je pense malheureusement qu'elle se tourne progressivement vers la science. Tout ce que l'on a entendu, à l'automne dernier, sur l'hésitation vaccinale l'a très bien illustré.
Pour conclure, vous écrivez dans les recommandations « acquérir [...] une connaissance précise des substances émises au cours de l'accident industriel [via], par exemple, l'emploi de drônes équipés de capteurs » ; c'est très bien, mais je suggère d'ajouter « les plus spécifiques possible », car aucun capteur ne pourra jamais mesurer toutes les substances susceptibles d'être émises lors d'un accident.
Une autre recommandation dit d'« impliquer plus fortement et activement les citoyens » ; je suis d'accord, c'est parfait. Cependant, cela interroge sur la manière de sensibiliser les citoyens au sujet des accidents. En matière de pollution de l'air, le vrai problème est la pollution de fond et pas les pics de pollution qui durent quelques heures ou une demi-journée et qui font le buzz médiatique. Au mieux, ils participent à la prise de conscience. Le problème, c'est la constance et l'ampleur de la pollution de fond : c'est elle qui impacte la santé, et non le pic de pollution. A titre personnel, je préconise une véritable démarche d'éducation au développement durable, au sens éclairé et sérieux du terme, en milieu scolaire. J'en ai parlé avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Pour l'instant, cela fait partie des sujets qui émergent difficilement, mais je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait aussi apprendre la notion de risque et de danger. Au Costa-Rica c'est obligatoire à l'école comme les maths et la langue maternelle.
Dernier point : les assureurs ont une bonne vision des risques industriels et il serait très intéressant que l'on prenne mieux en compte leurs travaux - que ce soit les assemblées parlementaires, dans l'organisation de leurs auditions, ou les services publics, dans leur politique de prévention des accidents. A cet égard, le rapport que les assureurs ont écrit sur l'incident survenu à Lubrizol en 2013 était riche d'enseignements, et il aurait peut-être fallu le lire un peu plus en détail... Je l'ai récemment expliqué à la ministre de la Transition écologique, Mme Élisabeth Borne, qui s'est engagée à tenir compte à la fois des conclusions de la commission d'enquête du Sénat et de celles de la mission d'information de l'Assemblée nationale. Même si nos conclusions reflètent un travail plus succinct, je suggère de les transmettre quand même à la ministre.

Merci Jean-Luc. J'ai le sentiment qu'avec ton expérience personnelle, tu apportes des réponses rationnelles à ce que nous ressentions intuitivement. C'est une affaire difficile parce qu'on ne peut pas tout expliquer et on ne peut pas tout mesurer au moment où il faudrait le faire. L'exemple que tu as donné sur les capteurs d'air est très intéressant. En effet, mesurer à trois mètres ou à un mètre de hauteur n'est pas la même chose ! De même, mesurer au bord d'un trottoir est différent de mesurer sur un lampadaire. Un autre aspect du sujet est bien connu des élus locaux, la propriété foncière : quand un industriel modifie son mode de production, la DREAL constate la différence et engage une révision du zonage de sécurité. Des terrains constructibles deviennent alors inconstructibles, ce qui pose des problèmes juridiques, politiques et financiers substantiels. L'élu local doit choisir entre garder des logements ou garder des emplois, ce qui n'est pas facile. De plus, il a affaire à des scientifiques compétents qui lui disent que la probabilité d'accident est très faible, mais pas nulle, ce qui met l'élu dans des contraintes extrêmement fortes. Restituer la complexité des choses et amener le maximum de personnes à y réfléchir serait donc un service que l'on pourrait rendre au sujet.
Les drones ne savent restituer que ce qu'on leur apprend à restituer. D'ailleurs, peuvent-ils tout analyser ? Je ne sais pas. Ajoutons donc « spécifiques » à la recommandation.
Je ne sais pas si la notion de « capteur » doit être mise en avant par la recommandation, et associée aux drones. L'INERIS nous expliquait que l'important est de faire des prélèvements d'air à certains endroits, prélever des échantillons et ensuite faire les analyses. Donc tant les notions de capteurs que de prélèvement et d'analyse sont importantes. La phrase m'a un peu gêné parce que j'ai trouvé qu'elle donnait trop l'idée du feuilleton américain de police scientifique : on arrive quelque part, on appuie sur un bouton et on a le résultat. Or la vie scientifique n'est pas celle-là. Un gros souci que nous avons rencontré dans la période post-Lubrizol, c'est qu'il fallait attendre dix jours pour obtenir le résultat d'un certain nombre de mesures ; certaines analyses ont été faites, par exemple, à Grenoble, donc il fallait y transporter les échantillons. J'ai été interpellé dans ma circonscription à ce sujet. J'ai essayé d'expliquer que les analyses prenaient du temps, qu'il n'y avait pas d'analyses immédiates. Les gens pensent que si on ne donne pas de résultats tout de suite, on leur cache quelque chose. Il faut remettre un peu de rationalité dans tout ça. Il revient aussi aux responsables publics de ne pas souffler sur les braises dans de tels moments car c'est irresponsable.

Je prends acte de ce que l'Office approuve les recommandations telles que rectifiées selon les propositions de Jean-Luc Fugit et qu'il autorise leur publication.
L'Office adopte les conclusions présentées et autorise à l'unanimité la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu de l'audition publique du 6 février 2020 sur les enjeux scientifiques et technologiques de la prévention et la gestion des risques accidentels.
Voici la présentation des conclusions de l'audition publique du 23 janvier 2020 sur les inhibiteurs de succinate déshydrogénase (SDHI).
L'Office a été saisi par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, elle-même interpellée par notre collègue Loïc Prud'homme, pour étudier la question posée par certains fongicides utilisés en agriculture, suspectés de constituer un danger sanitaire : les SDHI.
L'alerte vient d'un groupe de chercheurs mené par Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'hôpital Robert Debré. Il étudie l'enzyme succinate déshydrogénase (SDH) et les maladies génétiques et neurologiques rares ainsi que les cancers induits par une déficience de cette enzyme. Les chercheurs se sont rendu compte que les substances actives de ces fongicides étaient capables d'inhiber l'enzyme d'espèces non-cibles en plus de celle du champignon cible : les enzymes de l'abeille, du ver de terre et de l'homme sont également inhibées. Ils ont craint que l'exposition à ces fongicides puisse entraîner des effets similaires aux maladies génétiques étudiées, à savoir des cancers et des maladies neurologiques.
Ils ont lancé des alertes par voie de presse et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a mis en place un groupe d'expertise collective d'urgence (GECU) pour étudier l'alerte et en estimer la pertinence au regard de la littérature scientifique disponible et des données dont dispose l'Agence dans le cadre du dossier d'autorisation de mise sur le marché et de la phytopharmacovigilance. Le groupe de travail a conclu que les éléments apportés par les travaux du groupe de chercheurs mené par Pierre Rustin ne remettent pas en cause l'évaluation du risque inhérent à la classe de molécules. Cette évaluation a été réalisée dans le cadre réglementaire de l'autorisation de mise sur le marché : risque sur la santé humaine et risque sur l'environnement, la santé humaine comprenant aussi bien le consommateur que l'exploitant agricole.
Une partie des chercheurs auteurs de ces travaux conteste les conclusions de l'ANSES et continue à alerter sur le sujet. Ils ont notamment sollicité la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
L'objectif de l'audition publique n'était pas de conclure sur le caractère dangereux ou non des SDHI pour la santé humaine ou pour l'environnement, mais de comprendre d'où vient le désaccord entre le groupe de chercheurs et l'ANSES : est-ce au niveau de la procédure, des processus, de la façon dont le débat était engagé, de règles non respectées ? Nous étions aidés par une toxicologue indépendante en la personne du Pr. Francelyne Marano.
Les travaux publiés par le groupe de chercheurs de Pierre Rustin dans une revue à comité de lecture, que personne ne conteste, montrent la non-spécificité de l'action des SDHI, in vitro, sur extrait enzymatique. Ceci s'explique par le fait que les mitochondries sont des structures très stables à travers l'évolution et sont donc très proches dans toutes les espèces. Les travaux montrent aussi l'absence d'effet des SDHI sur la viabilité de cellules humaines en culture lorsque les conditions expérimentales sont classiques, mais un effet délétère des SDHI sur la viabilité lorsque les conditions expérimentales rendent les cellules exclusivement dépendantes de cette enzyme mitochondriale pour leur survie. Ils montrent également un effet plus important sur les cellules issues de patients présentant une déficience mitochondriale génétique ou ayant une maladie associée à une fragilité mitochondriale. Enfin, ils démontrent la production de stress oxydant par les cellules exposées aux SDHI. Ces deux derniers points inquiètent tout particulièrement les chercheurs, car une partie des hypothèses pour expliquer la survenue d'une maladie neurologique multifactorielle comme celle d'Alzheimer ou de Parkinson, est le dysfonctionnement mitochondrial et la production de stress oxydant. Les chercheurs estiment donc probable que l'exposition aux SDHI soit délétère et qu'elle puisse favoriser l'apparition de telles maladies. Ils réclament que les tests réglementaires évoluent pour prendre en compte la toxicité mitochondriale dont ils estiment qu'elle est masquée par les conditions expérimentales.
Jean-Ulrich Mullot, chercheur indépendant des deux parties, qui a conduit l'expertise collective de l'ANSES, a indiqué avoir revu toute la littérature scientifique disponible sur le sujet. Il a considéré que les informations et hypothèses scientifiques apportées par les lanceurs de l'alerte n'apportent pas d'éléments en faveur d'une exposition qui n'aurait pas été prise en compte dans l'évaluation des substances actives concernées. Il a également indiqué que certaines des hypothèses formulées dans l'alerte relevaient de considérations plus larges liées aux produits phytopharmaceutiques, voire à toutes les substances chimiques, à savoir « l'effet cocktail » et la cancérogénicité sans génotoxicité, à savoir la capacité d'une substance à être cancérogène sans provoquer de mutations de l'ADN. Selon lui, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur ces effets, ni de méthode rigoureuse validée pour les mesurer.
Comme vous vous en souvenez, ou comme vous le voyez à la lecture de ces débats, on a connu des séances plus simples à l'OPECST. Pourquoi les avis divergent-t-ils ? De l'avis des toxicologues interrogés, une extrapolation des résultats de l'équipe de chercheurs de Pierre Rustin à l'exposition réelle d'un organisme entier est actuellement impossible, ou au moins nécessiterait de plus amples investigations. On ne peut pas assimiler des résultats obtenus dans le cadre d'une recherche fondamentale in vitro et les résultats des tests toxicologiques effectués dans le but d'évaluer le risque associé à des substances. Ces tests, réalisés dans des conditions réglementées, sous l'égide de la Commission européenne et de l'OCDE, étudient la toxicité des substances de manière intégrée, sur l'organisme entier, tout au long de sa durée de vie. L'appréciation du risque est conduite de manière à ce que les conditions réelles d'exposition soient simulées et examine plusieurs paramètres tels que la cinétique d'absorption ou d'élimination de la substance. Cela a été rappelé dans le rapport établi par les députés Philippe Bolo et Anne Genetet, et les sénateurs Pierre Médevielle et Pierre Ouzoulias.
Que pouvons-nous retenir de tout cela ?
D'abord l'extraordinaire difficulté de déterminer quels sont les dangers, quels sont les risques, et comment les évaluer. Une partie du débat et de l'incompréhension venait de la distinction entre les expériences menées in vitro, les expériences menées en laboratoire pour simuler une exposition, et les expériences menées en conditions naturelles que peuvent constituer les études épidémiologiques, avec des différences considérables dans l'ampleur, la durée et le coût qu'elles représentent.
D'autre part, des points soulevés par l'étude sont incontestablement de nature à faire évoluer les textes réglementaires, en incluant à l'avenir la recherche spécifique de la toxicité mitochondriale dans des conditions expérimentales qui la révèle, pour les autorisations de mise sur le marché. Il peut aussi être intéressant d'identifier des sous-populations à risque pour chaque catégorie de substances phytopharmaceutiques, ou chaque catégorie de substances chimiques, pour adapter les seuils réglementaires à des populations plus fragiles. C'est déjà le cas pour certains critères, par exemple les enfants et les femmes enceintes sont plus sensibles au plomb ou aux perturbateurs endocriniens. Cette étude et ce débat suggèrent qu'il est légitime de considérer aussi les populations les plus fragiles pour ces questions de toxicité mitochondriale.
Le débat a aussi porté sur des questions de procédure : pour protéger l'environnement et la santé humaine, quelle est précisément la question scientifique à laquelle il faut répondre ? Les uns et les autres n'étaient pas d'accord. Des questions ont également été posées quant à la publicité des débats, puisqu'une partie de celui-ci a été transformé en polémique par voie de presse ; c'est la raison pour laquelle l'audition s'est faite de façon séparée et non pas de façon simultanée et contradictoire, comme c'est notre habitude.
Tous ces points doivent être pris en compte. Certains peuvent s'inscrire dans le cadre donné par le rapport de l'Office sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences, publié au printemps dernier, tandis que d'autres sont plus de nature à entrer dans le cadre du rapport sur l'intégrité scientifique que préparent Pierre Ouzoulias et Pierre Henriet. En toile de fond, se trouve la dimension pédagogique avec laquelle doit être effectuée l'évaluation des dangers et des risques.
Le groupe d'experts sollicité par l'ANSES a conclu qu'il n'était pas légitime de retirer de façon préventive l'autorisation de mise sur le marché des fongicides SDHI, estimant qu'il n'y avait pas de signal qui n'aurait pas été pris en compte dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque des substances actives.
Les travaux du groupe de chercheurs soulèvent des points intéressants à valider et à approfondir. La science doit avancer sur « l'effet cocktail » et les mécanismes cancérigènes non mutagènes.
L'Office recommande que les toxicologues, responsables de l'établissement de lignes directrices à l'échelle internationale se saisissent pleinement des potentiels effets mitotoxiques des substances phytopharmaceutiques, ceci pour mieux protéger les populations qui pourraient y être sensibles.
L'ANSES a bien rappelé que son travail consiste à répondre, en fonction des procédures, de la méthodologie et de la déontologie qui sont les siennes, à des questions spécifiques sur tel ou tel produit. L'Agence a aussi précisé que, si l'on souhaite interdire ou réduire les quantités de fongicides, la discussion ne doit pas reposer sur l'évaluation qu'elle réalise, mais sur une décision politique assumée de renforcement de la protection de l'environnement. Le politique ne doit pas remettre la décision dans les mains de l'expert technique qui conduit l'évaluation scientifique, même si elle doit être prise en compte.

Ce débat nous rappelle étrangement le débat autour d'une autre molécule célèbre : le glyphosate, même si des différences importantes existent. Pour le glyphosate, un retrait n'affecterait que les rendements et pourrait soulager l'hystérie collective qui s'empare de certaines populations quand on prononce son nom. Le cas des SDHI est différent, les contaminations par des champignons sont extrêmement fréquentes sur les céréales et le retrait d'antifongiques pourrait poser un problème de santé beaucoup plus important, par exemple avec le retour du célèbre feu de Saint-Antoine, dû à certains alcaloïdes qui sont produits par un champignon nommé l'ergot du seigle et qui a des conséquences sanitaires graves. Un retrait des fongicides SDHI en application du principe de précaution pourrait poser un problème sanitaire grave.
Cela faisait partie de la question sur l'importance de ces fongicides. Est-il possible de quantifier ce risque sanitaire grave ?

Sur des céréales non traitées, on observe le développement de ces champignons et leur consommation pose un problème de santé. Comme pour le glyphosate, il y aura débat sur la différence entre des expériences in vitro et les expositions auxquelles sont soumises les populations, ces dernières n'ayant jamais été évaluées pour les agriculteurs et les populations.

Le glyphosate est une icône que l'on essaie d'abattre, mais il n'y aura pas de conséquence sur la santé, qu'on l'utilise ou que l'on ne l'utilise pas, cela a été démontré. Comme le nucléaire, il faudrait simplement l'abattre. Les fongicides ont cependant eu un vrai impact sur la santé publique. Il faut le savoir : avant, on pouvait mourir en mangeant du pain parce qu'il contenait une toxine issue de l'ergot du seigle. Tant qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour supprimer les SDHI, il faut les utiliser, car ils protègent les céréales. Les questions des SDHI et du glyphosate sont complètement différentes.
En tant que co-rapporteur de la mission d'information sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate de l'Assemblée nationale, je connais bien ce sujet. Les choses se sont peut-être un peu « emballées » - pour le dire de façon modérée. J'en témoigne, car nos travaux ont mis en évidence des paradoxes. C'est le cas de l'agriculture dite de conservation des sols, qui est extrêmement vertueuse car elle limite le labour, ce qui réduit par trois la consommation de gasoil, améliore la structuration du sol, préserve la biodiversité et fixe le carbone, mais qui nécessite des herbicides comme le glyphosate. Paradoxalement, un choix que l'on fait en faveur de l'environnement peut conduire à des effets qui ne vont pas dans le sens de la neutralité carbone, l'objectif que nous avons pour 2050. Il est important d'examiner la balance des avantages et des inconvénients des décisions possibles, alors que notre société a souvent une vision trop binaire et ne voit que les avantages ou que les inconvénients.
En tant que scientifique, sincèrement, l'audition sur les SDHI m'a posé problème. Je ne dis pas que ce que Pierre Rustin a mis en avant avec son équipe est nécessairement faux, mais il y a pour moi un problème de répétabilité. L'alerte a été lancée en s'appuyant sur une seule étude. Il est urgent d'en avoir d'autres.
Nous avons eu des démonstrations qui m'ont paru peu convaincantes, à l'image des feuilles des végétaux : elles ne sont pas imperméables comme l'a dit l'équipe de chercheurs, car les végétaux respirent par les stomates des feuilles, par lesquels l'eau est évacuée et qui permettent la fixation du CO2. J'ai eu le sentiment de ne pas me trouver en face de scientifiques, mais de militants - le ton m'a d'ailleurs autant gêné que le fond. En bref, cela manque de rigueur scientifique. Il faut être prudent et lancer d'autres expertises, sur le modèle du consortium international qui réunit des équipes de recherche de quatre pays européens, dont la France, pour étudier à nouveau la toxicité du glyphosate. Glyphosate ou SDHI, ce genre de sujet est trop sérieux pour que des décisions soient prises sur la base des résultats d'une seule équipe.
Oui, il y avait un ton militant, mais d'un autre côté, l'équipe a publié dans une revue scientifique respectable et ses travaux n'ont pas été remis en cause par l'ANSES, même si, effectivement, ils n'ont pas été reproduits et c'est un problème. Cependant, dans ces domaines biologiques, le taux de reproductibilité est en général très bas, même dans les revues les plus prestigieuses. Ils ne sont pas du tout conformes à ce que l'on enseigne dans les lycées sur la valeur de la science reproductible. Nous n'avons donc pas de raison de remettre en cause le sérieux de l'étude en elle-même. Il est vrai qu'il manque des études complémentaires ; il est vrai aussi que certaines réponses ont pu rendre perplexe.
En simplifiant quelque peu, une grande partie du débat tournait autour du fait qu'un résultat issu de recherches in vitro pourrait être inquiétant, mais qu'on ne voit rien dans les expériences in vivo ni dans les données épidémiologiques. En fait, il est très difficile de faire une véritable étude épidémiologique dans un contexte où les pratiques agricoles mettent en scène une multiplicité de substances, de pratiques et de produits. Il y a cependant quelque chose de très clair, d'indiscutable, d'absolument incontestable par rapport à l'environnement : la dégringolade en flèche de la biodiversité. Elle est certainement multifactorielle, mais on a de bonnes raisons de penser que les cocktails chimiques qui sont utilisés comme engrais ou comme produits phytosanitaires jouent un rôle et que l'on appréhende encore très mal les effets « cocktail ». Il est sain, au regard des enjeux de santé, de se fixer un objectif global de réduction des produits phytosanitaires et des engrais - je rappelle que certaines équipes du CNRS et de l'INRAE travaillent sur de nouveaux modes de culture n'impliquant aucun produit ajouté.
Je rappelle l'interpellation lancée par l'équipe de Pierre Rustin, qui demandait où sont les études sur les bénéfices des SDHI (que permettent-ils d'éviter ? Servent-ils seulement à augmenter les rendements ?), et le rappel fait par l'ANSES, soulignant les contraintes qui encadrent son activité d'évaluation et l'opportunité de dégager ponctuellement des moyens supplémentaires, et mettant en avant le fait que la décision ne doit pas s'appuyer seulement sur l'évaluation des effets réalisée par l'organisme expert technique mais aussi sur un choix politique.

Par rapport à la biodiversité, c'est tout le modèle qui est à remettre en question. Je crois que nous souhaitons tous employer le moins possible de substances, mais si je prends l'exemple des néonicotinoïdes - j'étais l'un des premiers signataires de la pétition visant à les interdire -, la disparition des populations d'abeilles n'est pas résolue car on voit désormais qu'elle est multifactorielle. Elle viendrait notamment aussi de l'importation de reines non adaptées à notre climat. Il faut travailler sur l'ensemble et faire confiance à la science et la technique. On le voit avec l'intérêt des images satellitaires pour la surveillance des cultures : on peut repérer les insectes sur les plantes et traiter des parties de parcelles, selon le besoin, et non plus des centaines d'hectares, avec des épandeurs de plus en plus précis. Je crois en une agriculture qui serait aussi productive et satisfaisante pour nourrir nos populations, en utilisant beaucoup moins de substances.
Il est dommage que la presse ne se fasse pas l'écho de tous ces progrès, car les agriculteurs sont stigmatisés comme des empoisonneurs et le vivent très mal, notamment ceux qui habitent en périphérie urbaine, où ce sont les maisons qui ont « rattrapé » les exploitations. Je crois qu'il va falloir commencer par rétablir la confiance entre la communauté scientifique, la population et les agriculteurs.

Je souhaiterais reprendre la parole en qualité de président de l'Office pour vous dire que je ne suis pas un scientifique, je suis un homme politique et je me préoccupe des décisions puisque nous avons vocation à les évaluer. Je trouve ces conclusions satisfaisantes. Il y est très clairement dit que « les travaux du groupe de chercheurs soulèvent des points intéressants - ce qui montre que nous ne les méprisons pas -, dont certains nécessitent d'être validés et approfondis. » On peut difficilement être plus ouvert, dans un schéma qui était extrêmement conflictuel, voire caricatural. « Ils ne semblent toutefois pas suffisants pour légitimer une alerte sanitaire à la hauteur des craintes exprimées par voie de presse. » Les choses sont dites poliment mais de façon carrée. Je n'ai rien à redire à la phrase : « La science doit avancer sur l'effet cocktail et sur les mécanismes cancérigènes non mutagènes. »
La dernière phrase du paragraphe précédent me semble nécessiter une précision. « Il a été rappelé par Francelyne Marano pendant l'audition que les fongicides sont utilisés en agriculture pour lutter contre des champignons qui peuvent être toxiques pour l'homme » et la recommandation ajoute « mais l'intérêt des SDHI n'a pas été précisément examiné. » Or les interventions de Bruno Sido, Pierre Médevielle et Jean-Luc Fugit montrent que les SDHI sont nécessaires à la sécurité sanitaire pour le consommateur.
Pour s'en tenir au contenu de l'audition, il faudrait dire : « Mais l'intérêt des SDHI n'a pas été précisément examiné lors de cette audition. »
Il y a des antifongiques SDHI et des antifongiques non SDHI et s'il est possible de remplacer les SDHI par des antifongiques de meilleur rapport bénéfice-risque, il conviendrait de les adopter.

Cette nouvelle formulation restitue au mieux le travail collectif.
Je propose à l'Office d'adopter ces conclusions.
L'Office adopte les conclusions présentées et autorise à l'unanimité la publication du rapport présentant les conclusions et le compte rendu de l'audition publique du 23 janvier 2020 sur les inhibiteurs de succinate déshydrogénase (SDHI).
L'Office a désigné les membres de son conseil scientifique pour la période 2020-2022 : Alain Aspect, Robert Barouki, Frédérick Bordry, Hélène Budzinski, Catherine Cesarsky, Raja Chatila, Christine Clerici, Virginie Courtier-Orgogozo, Claudie Haigneré, Jean-Luc Imler, Béchir Jarraya, Astrid Lambrecht, Jean-Paul Laumond, Hélène Lucas, Valérie Masson-Delmotte, Patrick Netter, Hélène Olivier-Bourbigou, Didier Roux, François-Joseph Ruggiu, José-Alain Sahel, Marc Sciamanna, Virginie Tournay, Sophie Ugolini, et Guy Vallancien.
La réunion est close à 11 h 35.