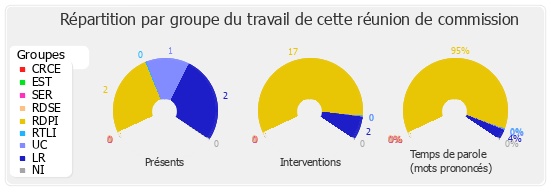Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables
Réunion du 22 mai 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mme laure lechertier responsable du département politique des produits de santé et m. vincent figureau responsable du département relations institutionnelles de la mutualité française (voir le dossier)
- Audition d'une délégation de la confédération nationale de l'esthétique parfumerie cnep composée de mme régine ferrère présidente représentant l'union des professionnels de la beauté et du bien-être upb et la fédération française des écoles de l'esthétique et de la parfumerie ffeep mm. jean-yves martin trésorier de l'union des marques du matériel umm jean-claude sirop président de l'union des marques de l'esthétique ume et hervé corlay vice-président du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine snpbc (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Laure Lechertier responsable du département politique des produits de santé et M. Vincent Figureau responsable du département relations institutionnelles de la mutualité française
Audition de Mme Laure Lechertier responsable du département politique des produits de santé et M. Vincent Figureau responsable du département relations institutionnelles de la mutualité française

Nous entamons ce qui est sans doute notre dernière série d'auditions, avant la remise du rapport à la mi-juillet.
Nous recevons aujourd'hui Mme Laure Lechertier, responsable du département Politique des produits de santé de la Mutualité française.
Nous avons assisté ces derniers mois à une multiplication d'incidents impliquant des dispositifs médicaux : prothèses PIP, sondes de défibrillation RIATA, prothèses de hanche DePuy. La Mutualité française réclame de longue date la mise en oeuvre d'une véritable autorisation de mise sur le marché (AMM), à l'image de celle du médicament, pour les dispositifs médicaux les plus risqués. Lors des Assises du médicament, elle a souligné la nécessité de refondre le marquage CE, de renforcer la matériovigilance et de développer les évaluations pré et post-commercialisation des dispositifs médicaux. Enfin, la traçabilité des dispositifs médicaux pourrait être liée à leur remboursement, sous réserve qu'ils puissent être individualisés.
Cette audition nous permettra de connaître précisément vos propositions et recommandations relatives à la sécurité des dispositifs médicaux mais aussi au développement des pratiques médicales à visée esthétique.

Pourriez-vous rappeler le rôle de la Mutualité française et les fonctions que vous y occupez ?
Je m'occupe des relations de la Mutualité française avec les pouvoirs publics français, en collaboration avec le département chargé des affaires européennes et celui de Mme Lechertier.
La Mutualité française est un acteur important de l'économie sociale. Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif, dont les bénéfices ne se partagent pas ; elles ne rémunèrent pas d'actionnaires, contrairement aux assurances privées. Leur activité repose sur les principes de solidarité et de non-sélection du risque. Les mutuelles sont financeurs et offreurs de soins ; elles sont aussi les premiers acteurs de la prévention et de la promotion de la santé après les pouvoirs publics et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).
La Mutualité française couvre 38 millions d'assurés. Elle a présenté des propositions en vue des élections présidentielle et législatives, visant à renforcer le rôle du médecin traitant, à réduire le reste à charge des patients et à assurer un droit réel à une complémentaire santé solidaire. L'accès aux soins égal pour tous reste en effet un problème majeur.
Le médicament est la première dépense de remboursement des mutuelles ; si on y ajoute les dispositifs médicaux, cela représente 42 % du total, soit 5 milliards d'euros.
En mars 2011, la Mutualité française a proposé un plan médicament, diffusé à de nombreux parlementaires.
Nous tentons de définir un positionnement stratégique au niveau national et européen, qui correspond à des actions très concrètes pour nos adhérents, centré sur le médicament et les dispositifs médicaux.

La place des dispositifs médicaux (DM), et plus particulièrement des dispositifs médicaux implantables (DMI), dans les dépenses des mutuelles a-t-elle évolué ces quinze dernières années ? Quelles spécialités, quelles populations sont concernées ?
Les mutuelles sont des payeurs aveugles qui, à la différence des régimes obligatoires, n'ont pas accès aux codes permettant une analyse fine de la dépense de remboursement. Cela vaut pour les médicaments comme pour les dispositifs médicaux. C'est un enjeu majeur pour les années à venir si nous voulons avoir une vraie gestion du risque. Nous combinons les sources pour collecter des données disponibles de la Cnam, de la Direction de la recherche, de l'étude, de l'évaluation et des statistiques (Drees), etc. et savons ainsi que la part des DM dans les dépenses des mutuelles est passée de 7 % à 15 % pour atteindre 2 milliards d'euros en 2010. A quoi imputer ce dynamisme ? L'évolution des dépenses liées d'une part aux pansements et au maintien à domicile, d'autre part aux orthèses et prothèses est particulièrement importante ; le ticket modérateur augmente chaque année.
Au niveau européen, nous ne disposons pas de données précises, le système français étant sui generis.
Les DMI font partie des GHS, la facturation a lieu au sein des établissements avec une prise en charge souvent à 100 %. Encore une fois, nous ne disposons pas d'informations assez précises.

Faut-il créer un registre exhaustif à partir des bases de données de l'assurance-maladie et des hôpitaux afin d'automatiser la remontée d'information vers les pouvoirs publics ?
La traçabilité est essentielle, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, tant pour les dispositifs médicaux intra-GHS que pour les autres. Les données de traçabilité devraient être rendues publiques. Cela permettrait de retirer du marché plus rapidement les dispositifs défaillants. La condition serait un système de codification harmonisé au niveau européen, avec un identifiant unique.

Avez-vous des préconisations pour enrichir le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et le codage des dispositifs médicaux ?
Le PMSI est un outil de gestion et de planification de l'activité. Peut-on y intégrer la traçabilité des DM ? Peut-être le système est-il encore trop récent. J'ajoute qu'il ne permettrait pas une traçabilité en médecine de ville. Quant à la tarification à l'activité, elle n'est pas arrivée à maturité.
Nous y sommes très favorables.
Procédons par étapes : au niveau européen, l'harmonisation est déjà très complexe. Un identifiant unique permettrait de faire des études longitudinales et épidémiologiques.

Mais l'économie est mondialisée. Pourquoi pas un code-barre mondial ? A défaut, nos dispositifs médicaux ne pourront pas sortir d'Europe...
Le système de mise sur le marché des dispositifs médicaux est très différent aux Etats-Unis. Nous devrions d'ailleurs nous inspirer de leur modèle d'évaluation. En Europe, la mise sur le marché des DM est très facile : la certification repose sur le marquage CE, qui s'applique à tout produit industriel, DM, grille-pain ou jouet ; on n'a pas besoin de prouver l'efficacité du dispositif, mais seulement la conformité aux exigences du marquage. Il y a une part d'autocertification par les fabricants, et une autre via soixante-trois organismes notifiés européens, qui ont des exigences très variables et ne font pas tous des audits de suivi. Il y a là un transfert de compétence du régulateur vers un opérateur privé, l'organisme de certification, lequel est lié contractuellement au fabricant et payé par lui. Ce système est archaïque.
Oui. La responsabilité doit incomber à l'autorité sanitaire, qui délivrera une AMM fondée sur des études cliniques irréprochables et randomisées. Ce rôle devrait être confié à l'Agence européenne du médicament (EMA).

Pas l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Afssaps)...
La notion de « données cliniques » figure dans la directive de 2007, mais cela peut être une simple recherche bibliographique... Le rapport du centre fédéral d'expertise des soins de santé belge a bien fait état des différences d'approche : études cliniques randomisées aux Etats-Unis, simples études de performance en Europe.

Vous admettez donc les circuits courts - je pense au traitement des dispositifs présentant une équivalence avec des produits déjà sur le marché aux Etats-Unis ?
Je parle de premarket approval.

Mais moins de 10 % des DM sont soumis à cette procédure d'approbation aux Etats-Unis.
Il faut généraliser ce système qui permet de sécuriser en amont et d'introduire de la sélectivité.

Cela ne renchérirait-il pas les produits et donc les dépenses de remboursement ? En allongeant les circuits, ne risque-t-on pas de retarder la mise en oeuvre d'une innovation ? Les sénateurs américains reprochent à leur système sa lenteur...
Nous n'avons pas une logique comptable : nous sommes prêts à rembourser au juste prix les DM innovants, plutôt qu'une foule de produits dont le bénéfice clinique n'est pas avéré.

N'allez-vous pas un peu loin ? Un chirurgien ne s'amuse pas à implanter des dispositifs non fiables...
L'affaire des sondes RIATA prouve le contraire !
Le rapport de l'Afssaps ne va pas dans ce sens ; il a pointé une défaillance des chocs électriques.
Nous sommes aujourd'hui dans une logique d'innovation incrémentale, pas de véritable innovation. Pour nous, la réglementation n'est pas un frein, mais un moteur de l'innovation : l'exemple américain le prouve. En 2010, le rapport de la Haute Autorité de santé (HAS) a montré que 75 % des produits en primo-inscription n'apportaient pas d'amélioration du service attendu.

C'est affaire de concurrence. Peut-on empêcher la mise sur le marché d'un produit sûr, même s'il n'apporte pas d'amélioration ?
Les Américains ont beaucoup plus d'argent que nous, beaucoup plus de laboratoires et d'instituts de recherche.
Seuls 20 % des fabricants européens ont tenté de pénétrer sur le marché américain...
car ils se heurteraient à la réglementation. Les prothèses PIP y ont été refusées...
En janvier 2012, les entreprises du médicament ont salué la déclaration du ministre qui appelait à la création d'une AMM pour les dispositifs médicaux.

Nous y sommes tous attachés et notre rapport devrait aussi aller dans le sens de la sécurisation des dispositifs. Mais l'innovation existe en France : voyez les valves aortiques implantables par voie intraveineuse, d'abord critiquées par les Américains et aujourd'hui très largement utilisées aux Etats-Unis.
J'attirais votre attention sur une contre-vérité, relayée par la Commission européenne. Non, la réglementation ne freine pas l'innovation. Voyez la feuille de route de Bruxelles, qui s'oriente vers un renforcement du contrôle ex post au détriment d'un contrôle ex ante. Toute la place au marché et à la compétitivité, au détriment de la santé !

Les études post-inscription amélioreraient elles le suivi des DMI ? Qui les financerait ? Faut-il en faire une condition du remboursement ?
Ces études sont effectivement très utiles, mais elles n'autorisent pas à se dispenser d'études ex ante. Il y a un équilibre à trouver.

Rien ne vaut le suivi en temps réel... Qui doit payer les études ex post, alors ?
A notre sens, la puissance publique.
Le financement public est, seul, gage d'indépendance et d'objectivité. On peut trouver des ressources.

Le financement public n'interdit pas les conflits d'intérêts : voyez le Mediator. Ne peut-on pas faire participer les fabricants ?
L'expérience prouve que le financeur exerce un contrôle sur les études.

Pourquoi l'industriel ne financerait-il pas un organisme indépendant qui, lui, mènerait les études ? Où est la difficulté, hors celle de le convaincre ?
Un financement public garantit l'indépendance des études. Le système que vous préconisez est envisageable, mais il faut s'assurer que les industriels n'exercent aucun contrôle sur la conception, le choix des indicateurs et la méthodologie. Il faut distancer le financement de la réalisation de l'étude. Par ailleurs, il devrait exister une exigence de transparence des données : les études négatives doivent aussi être publiées. Or un industriel financeur pourrait tout à fait interdire la publication d'une étude défavorable à son produit.

Quels sont vos arguments pour dire que la réglementation ne freine pas l'innovation ? Ce n'est pas ce que j'observe...
La comparaison avec les Etats-Unis, et les données publiées par la HAS : 75 % des produits en primo-inscription n'apportent pas d'amélioration du service attendu ou rendu, alors même que notre règlementation est peu contraignante.

Mais encore une fois, les sénateurs américains reprochent à la FDA la longueur de ses procédures... Les innovations viennent d'Europe...
Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est une innovation... Sans étude clinique, on ne peut pas le dire de façon objective.

N'est-ce pas avant tout une prédominance du modèle économique par rapport à l'intérêt médical?
La conception européenne, c'est d'autoriser la mise sur le marché à condition que les exigences de sécurité soient respectées.

Le modèle américain n'est pas parfait, notamment en ce qui concerne l'innovation.

Que vous inspire le développement du tourisme en matière de chirurgie esthétique ? Avez-vous eu à prendre en charge des patients ayant souffert de complications à la suite d'une intervention esthétique à l'étranger ?
Nous sommes payeurs aveugles. Ces informations ne quittent pas le dossier médical et ne sont pas transmises aux mutuelles.
Peut-être... Nous avons remboursé le Mediator hors AMM...
Tout le monde est payeur aveugle...
Non. Cela fait plus de dix ans que nous demandons l'accès aux données de santé. Nous ne sommes pas à égalité avec l'assurance maladie obligatoire ; nous ne pouvons pas avoir de politique de gestion du risque.
C'est d'autant plus regrettable que l'on fait toujours davantage appel aux mutuelles pour financer les dépenses de santé.
Audition d'une délégation de la confédération nationale de l'esthétique parfumerie cnep composée de Mme Régine Ferrère présidente représentant l'union des professionnels de la beauté et du bien-être upb et la fédération française des écoles de l'esthétique et de la parfumerie ffeep Mm. Jean-Yves Martin trésorier de l'union des marques du matériel umm jean-claude sirop président de l'union des marques de l'esthétique ume et hervé corlay vice-président du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine snpbc
Audition d'une délégation de la confédération nationale de l'esthétique parfumerie cnep composée de Mme Régine Ferrère présidente représentant l'union des professionnels de la beauté et du bien-être upb et la fédération française des écoles de l'esthétique et de la parfumerie ffeep Mm. Jean-Yves Martin trésorier de l'union des marques du matériel umm jean-claude sirop président de l'union des marques de l'esthétique ume et hervé corlay vice-président du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine snpbc

Nous poursuivons nos auditions en accueillant Mme Régine Ferrère, présidente de la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie (Cnep), représentant l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) et la Fédération française des écoles de l'esthétique et de la parfumerie (FFEEP), ainsi que MM. Jean-Yves Martin, trésorier de l'Union des marques du matériel (UMM), Jean-Claude Sirop, président de l'Union des marques de l'esthétique (UME) et Hervé Corlay, vice-président du Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC).
Le champ d'étude de notre mission s'étend à l'ensemble des interventions à visée esthétique, parmi lesquelles les actes réalisés par les professionnels de l'esthétique sans formation médicale.
Ce secteur de l'esthétique, en pleine expansion, voit apparaître de nouvelles techniques parfois controversées, comme la lyse adipocytaire... L'enjeu de notre mission est de définir les améliorations à apporter à la réglementation afin d'assurer la sécurité des consommateurs.
La Cnep est une confédération patronale fondée en 1997, au moment de l'édiction du décret du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets. Il s'agissait de créer un pôle économique puissant qui rassemble les acteurs de l'esthétique et de la parfumerie (la formation, socle fondamental de nos entreprises, la fabrication de cosmétiques, les équipementiers et les distributeurs, c'est-à-dire les instituts, les centres de bronzage en cabine, les spas et les stylismes de cils et d'ongles). La Cnep accompagne la filière beauté-bien-être dans ses évolutions et rassemble six syndicats autonomes.
Nos entreprises sont affiliées à 90 % aux chambres de commerce. Elles emploient près de 50 000 salariés dans environ 40 000 entreprises et réalisent un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros. La Cnep regroupe les plus grandes chaînes du secteur, en particulier les franchises nouvellement émergées.
Nous employons exclusivement des personnels qualifiés. Les personnels des instituts et des spas sont titulaires d'un diplôme d'État, conformément aux règles qui encadrent la qualification des esthéticiennes. Dans les centres de bronzage, nos salariés ont soit obtenu un diplôme d'Etat, soit passé la formation obligatoire. Pour les nouveaux métiers, les stylismes ongulaire et de cils, nos employés sont soit titulaires du diplôme de la branche, soit qualifiés par des certificats de compétence. Depuis 2009, nous nous attelons en effet à encadrer les formations. Nous mettons au point une norme Afnor qui verra le jour fin 2012. Cette norme « chapeau » sur les soins de beauté et de bien-être se déclinera en deux spécialités : les soins appareillés et les soins de stylisme de cils et d'ongles.
Nous représentons la filière auprès des ministères de tutelle et sommes une force de proposition, travaillant à l'actualisation de la réglementation

Quelles sont les principales évolutions du secteur ces dernières années ?
Nous sommes le quatrième secteur exportateur français. Nos activités ne sont pas délocalisables. Naguère confidentielles et réservées à une élite, nos activités se sont ouvertes à un public plus large et sont devenues plus accessibles financièrement. Nos soins répondent ainsi au besoin irrépressible de conserver une image acceptable socialement. En l'an 2000, l'avènement du spa a fait entrer nos activités dans l'ère du bien-être. La clientèle a changé : on voit de plus en plus de jeunes, d'hommes, de seniors.
De TPE, nos entreprises ont muté, les surfaces allant désormais de 150 à 2 000 m² pour les plus grands spas.
Force est de constater une mutation profonde de la société, aujourd'hui plus attentive à l'image de soi, facteur de bonne insertion sociale. Nous revenons aux codes des sociétés grecques et latines, qui ont empreint nos civilisations : Mens sana in corpore sano. On veut un corps souple et ferme, un visage sans les marques du temps. La course au jeunisme ne connaît pas de limites : liposuccion, bistouri, implants, injections, mésothérapie...
Nos pratiques, qui ont toujours utilisé les mains et les appareils, se sont adaptées et ont progressivement introduit dans leurs protocoles des techniques plus performantes, mais en restant toujours dans le cadre des soins de beauté, de bien-être et de confort.

Les formations initiales vous paraissent-elles suffisantes ? Existe-t-il une formation continue ?
La branche emploie des diplômés de niveau 5, 4 et 3. Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'esthétique cosmétique parfumerie, premier diplôme de la branche, se situe au niveau 5. Il est obligatoire pour pouvoir exercer. Les études menant à ce diplôme peuvent être poursuivies dans le cadre du brevet professionnel, de niveau 4, qui s'obtient exclusivement en alternance. Il correspond à un baccalauréat sans les matières générales. En 2005, avec la réforme Darcos, nous avons mis en place un baccalauréat professionnel en trois ans. Nous venons d'achever la grande réforme du brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme à bac +2. Au niveau du CAP, les esthéticiennes sont qualifiées pour assurer les soins du visage, des mains et des pieds, les épilations et le maquillage. Pour les soins du corps, il faut le brevet professionnel, avec un pôle technique mais aussi juridique et réglementaire. Le BTS mènera à des métiers de laboratoire, de formation, de cadre ou de manager.
Elle fait partie de notre culture : il faut se former tout au long de la vie. En 2010, une étude du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) a mis en lumière les axes d'amélioration possibles : la gestion, l'anglais et les nouvelles technologies, qui évoluent plus rapidement que nos diplômes. Nous organisons des stages permanents. La formation continue est au coeur de nos métiers et de la pérennité de nos entreprises.

Le décret du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique a été partiellement annulé par le Conseil d'État : son article 2 avait interdit cinq techniques non invasives de lyse adipocytaire, au motif que leur absence de dangerosité n'était pas prouvée. Quelle est votre position ? Quels sont les contrôles opérés sur les pratiques, comme l'épilation par lumière pulsée, sur les appareils utilisés et sur la pratique de l'instrumentation?
Ce décret nous a fauchés en pleine saison minceur : ce fut une catastrophe pour nombre d'entreprises qui venaient d'investir dans de nouveaux appareils. D'où notre action en référé, pour obtenir sa suspension, puis l'annulation de son article 2, l'article 1er ne nous concernant pas. Il faut définir précisément ce qu'est une pratique invasive. La technique invasive, c'est une effraction cutanée. Il y a amalgame, car les médecins dits « esthétiques » utilisent le même terme que nous pour qualifier leurs interventions. Nous pratiquons le non invasif depuis toujours...
Non, le rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) est parfaitement clair. Nous avons collecté des études scientifiques sur les dispositifs concernés : elles démontrent l'absence de problème de santé publique posé par les techniques non invasives.
Reste qu'il faut assurer la sécurité des consommateurs par la formation et par la réglementation des équipements, ce que nous réclamons en vain depuis quatre ans !

Quel type de réglementation demandez-vous, et quel est votre interlocuteur ? La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ?
En 2010, devant le mutisme des autorités, nous avons proposé un projet de réglementation dans le cadre de l'élaboration d'une norme Afnor. Nos interlocuteurs sont la DGCCRF, la Société française de dermatologie ou l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

La société française de dermatologie n'est pas d'accord avec vos affirmations, et souhaite réserver les techniques que vous employez aux médecins, voire à ceux spécialisés en « médecine esthétique », au nom du principe de précaution.
Discuter ne veut pas dire être toujours d'accord.
Nous la mettons sur les types d'appareil. Au-delà d'une certaine fluence, les appareils ne devraient être utilisés que par des médecins.
Il est impossible d'aller au-delà de fluences autorisées.
Une jeune femme chef d'entreprise ne prendra pas le risque d'acheter un appareil sur internet, sans formation ni service après-vente. Aujourd'hui, le risque est que le consommateur néophyte utilise, chez lui, les appareils vendus en ligne. Vous pointez ici une dérive : c'est bien pour cela qu'il faut une règlementation ! Je suis favorable à ce qui a été réalisé en matière de rayons ultraviolets : le décret de 1997 a imposé la déclaration des appareils en préfecture et la formation, permettant de débarrasser le marché des machines de mauvaise qualité.
Oui.
Si l'énergie est limitée à 18 joules, l'appareil est efficace sans être dangereux.
C'est ce que nous préconisons dans la norme Afnor.
Nous vous communiquerons un tableau récapitulant les normes et les fluences pour tous les dispositifs.

On sait que l'exposition aux rayonnements ultraviolets concourt aux cancers de la peau. Qu'en dites-vous ?
Nous sommes confrontés à un paradoxe : le soleil est indispensable à l'organisme, mais on ne cesse de mettre en garde contre ses effets nocifs. Seuls 2 % à 5 % de la population présentent des facteurs de risque qui rendent dangereux tant un bain de soleil qu'une séance de bronzage en cabine. Il faut changer la façon dont le débat est abordé. L'approche se fait par la statistique : en moyenne, une exposition accrue aux rayons ultraviolets accroît le risque de développer des problèmes de peau. Cette affirmation est exacte mais la situation apparaît différente lorsqu'on procède à une analyse plus détaillée : l'organisation mondiale de la santé (OMS) parle de l'équilibre bénéfice-risque, affirmant que l'exposition solaire est excellente pour la plupart des gens.

On ne peut pas comparer l'exposition au soleil et une exposition en cabine qui peut être faite n'importe quand et comment... Avez-vous des normes d'intensité ? Que faites-vous si une jeune femme à la peau très blanche vous demande un bronzage express ?
Beaucoup de gens parlent de ces questions sans rien y connaître, y compris dans les ministères. Pour un appareil donné, contrairement au soleil, le rayonnement en cabine est constant...
En cabine, le rayonnement ultraviolet est filtré : seules les longueurs d'ondes permettant de bronzer sont conservées. On réplique avec efficacité le phénomène naturel qu'est le bronzage qui, plus qu'un effet de mode, est avant tout un moyen pour la peau de se protéger.
Cependant, le rayonnement reçu au cours d'une séance d'ultraviolets en cabine est supérieur aux rayonnements reçus, en énergie, lors d'un bain de soleil. En termes de composition des rayonnements, une séance moyenne d'ultraviolets en cabine correspond à peu près au rayonnement solaire à dix-huit heures à La Rochelle le 21 juin. En termes de puissance, le rayonnement apparaît dix fois plus important : le même résultat obtenu en dix fois moins de temps.

Quid de la jeune fille qui veut être bronzée à son arrivée sur la plage quelques jours plus tard ?
Un centre de bronzage qui fait bien son travail part de l'aptitude du client à bronzer correctement. Le syndicat national des professionnels du bronzage en cabine a d'ores et déjà commencé à déployer dans les centres adhérents un diagnostic solaire, validé par des dermatologues et qui permet au client éventuel, à partir d'un auto-questionnaire, de savoir s'il présente des facteurs de risque.
Une de nos préconisations est que soient rendus obligatoires l'affichage et la mise à disposition du public de ce diagnostic. Nous attendons du décret une avancée dans ce sens. Un centre de bronzage qui fait bien son travail doit commencer par un diagnostic.
Quand on va chez son garagiste, on demande aussi un diagnostic !

Rien de plus difficile à faire qu'un diagnostic dermatologique, même pour un professionnel !
Il n'est pas question pour les instituts de se substituer aux dermatologues.
En effet.
Notre document, qui doit pouvoir servir à tous, vise à améliorer l'information du client, à lui permettre de se poser les bonnes questions. C'est tout.
Le décret de 1997 réglemente la mise à disposition de l'information au client. Mais bien qu'elle soit de bonne qualité, l'information est indiscriminée. Les personnes à risque, peu nombreuses, doivent être identifiées. Quant à votre jeune femme à la peau blanche, il se pourrait très bien qu'elle puisse bronzer sans risque...
Le programme de bronzage est adapté à chaque client. On peut, en trois ou quatre semaines, obtenir un hâle permettant de ne pas brûler sur la plage. La fréquence moyenne est de sept séances par an, ce qui correspond à 15 % de la limite règlementaire d'exposition préconisée. Seuls 4 % des clients font plus de deux séances par mois et eux aussi sont en-dessous de la limite.

Le soleil est là depuis très longtemps... Or les cancers de la peau augmentent depuis quelques années, comme augmente la pratique de l'exposition en cabine... Ce qui était exceptionnel ne l'est plus. Il y a bien une raison à cela...
Venons-en à un autre sujet : un décret définissant les interventions à visée esthétique réservées aux médecins est en préparation. Attendez-vous qu'il délimite votre champ de compétence et celui des médecins ?
Malheureusement, le décret ferait passer la plupart de nos techniques dans le champ médical. Nous ne pouvons qu'être contre.

Y voyez-vous une injustice ? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'appliquer un principe de précaution ?
Nous sommes d'abord choqués par le manque de concertation - mais nous y sommes habitués - et par le fait d'affronter deux professions.... A chacune de nos professions correspond un champ de compétence et une expertise. Nous travaillons depuis toujours sur la ride, le poil et la minceur. Tout d'un coup, les professions de santé veulent s'arroger ces pratiques sous couvert d'un problème de santé publique qui n'existe pas. Nous ne voulons pas un monopole.
En 2011, nous avons pratiqué onze millions de soins de beauté et de bien-être, dont six millions sur la ride, le poil et l'anti-âge. Sur ces six millions, aucun problème avéré n'a été rapporté.
En France, jamais ! C'est de l'invasif ! Du remodelage collagénique, uniquement. Nous travaillons sur l'aspect, non sur les tissus profonds. Nos clientes n'ont pas d'illusions...
Nous demandons à continuer de faire notre travail. Nous sommes fiers d'être diplômés d'Etat et de dire que nous connaissons la peau. Le décret mettrait 60 000 personnes au chômage, et 30 000 entreprises fermeraient : les activités visées représentent 88 % de notre chiffre d'affaires. La branche serait détruite ! Cela imposerait de devoir effectuer des études d'impact. Sécuriser les consommateurs, c'est évidemment une nécessité ; mais le risque zéro n'existe pas.
Les deux existent. La formation peut se faire en centre de formation d'apprentis (CFA), dans un lycée professionnel ou dans une école privée, où elle n'est pas toujours payante car il y a des systèmes d'alternance. Nous recevons également beaucoup de personnes en reconversion, notamment des infirmières ; le financement est alors assuré par Pôle Emploi.
Notre souci est d'améliorer la qualité des soins, nous participons donc activement à la formation des esthéticiennes - au moins deux fois par an, et pour l'essentiel gratuitement.
L'amincissement, l'anti-âge, l'épilation, cela représente 88 % de l'activité. Si les instituts disparaissent, les entreprises qui les fournissent disparaîtront aussi. Or elles exportent beaucoup, ne l'oublions pas...
La formation, la qualité, la sécurité, c'est l'unique voie possible. Nous en sommes conscients. Nous sommes une profession responsable. Ne cassons pas ce savoir-faire de la France.
D'où la norme Afnor et la nécessité de définir notre périmètre d'exercice.

Les propriétaires de cabines de bronzage sont-ils soumis à des obligations de contrôle et de maintenance du matériel ?
Oui, le décret de 1997 les précise très clairement.
Oui. Le décret de 1997 prévoit un contrôle des appareils au minimum tous les deux ans par un organisme agréé.
Bien sûr que non. Posez la question aux médecins esthétiques... Si tous nos clients vont chez eux, qui remboursera la consultation ? Et qui va payer la TVA ? Nous donnons 700 millions d'euros par an au Trésor français, je le rappelle !
Quid du contrôle des médecins ? Une esthéticienne ne fera jamais une piqûre, mais certains médecins pourraient être tentés de faire passer un soin esthétique en remboursement...
Le décret peut être source de dérives insoupçonnées...