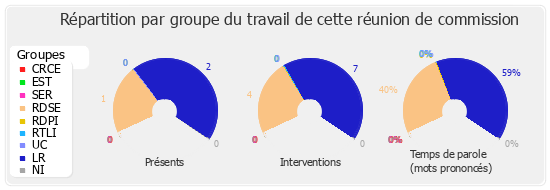Mission d'information sur les toxicomanies
Réunion du 12 janvier 2011 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mesdames et Messieurs, la mission commune d'information du Sénat et de l'Assemblée nationale sur les toxicomanies débute ses travaux aujourd'hui.
Nous avons organisé cette première audition autour de l'expertise collective consacrée par l'INSERM à la réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues.
Le rapport publié par l'INSERM en octobre dernier présente en effet un panorama particulièrement dense et bien informé de cette question, qui est évidemment au coeur de nos travaux.
Je remercie M. Gérard Bréart, Directeur de l'Institut thématique « Santé Publique » de l'Alliance pour les sciences de la vie et la santé et Mme Jeanne Etiemble, Directrice du Centre d'expertise collective de l'INSERM d'avoir bien voulu nous présenter les méthodes et surtout les constats et les enseignements de cette expertise pluridisciplinaire.
Ils interviendront chacun une dizaine de minutes, après quoi un premier échange aura lieu avec les membres de la mission.
Afin d'imprimer à nos travaux une orientation très concrète, nous avons décidé de donner d'emblée un coup de projecteur sur des aspects particuliers de la réduction des risques infectieux.
C'est pourquoi nous avons demandé à deux médecins qui ont participé à l'expertise de l'INSERM, l'un en tant que membre du groupe auteur du rapport, l'autre auditionné par le groupe en tant qu'acteur de terrain, d'intervenir devant la mission. Je les remercie d'être là. Le Docteur André Jean Rémy nous parlera pendant quelques minutes du risque de transmission virale en prison et le Docteur Yves Edel nous parlera des infections constatées sur les usagers hospitalisés ou reçus dans les services d'urgence.
Le débat reprendra ensuite.
La parole est à M. Gérard Bréart.
Je voudrais tout d'abord vous présenter le contexte dans lequel se situent les expertises collectives.
En effet, tout ce qui s'est dit cet été ne correspond pas totalement à la réalité d'une expertise collective. C'est donc l'occasion de préciser un certain nombre de choses.
Mme Etiemble, responsable du service expertise collective, vous en présentera les principaux enseignements.
Une expertise collective est un éclairage scientifique sur un sujet de santé ; elle est réalisée à la demande d'institutions, de groupes ou de ministères et rassemble les données récentes issues de la recherche La plupart des données qui sont utilisées en expertise collective sont publiées dans des revues scientifiques.
L'essentiel des éléments provient d'un certain nombre de données publiées, ce qui peut expliquer certaines discussions sur le fait que l'on a pris en compte telle publication mais pas forcément tel rapport. L'idée de ne prendre que des données publiées vient aussi du fait que celles ci ont été soumises à l'étude des pairs et sont donc a priori d'une meilleure qualité scientifique.
Comment cette expertise collective est elle réalisée ? Il existe un cahier des charges scientifique établi à partir de la question posée par le commanditaire. Le groupe d'experts est constitué en fonction des compétences scientifiques des personnes, en grande partie liées à leurs recherches et leurs publications. L'expert se définit comme quelqu'un ayant produit un certain nombre de données scientifiques sur le sujet.

Ces données scientifiques peuvent elles être publiées par des scientifiques de l'INSERM ?
Pas forcément...
Il faut deux éléments pour sélectionner un groupe d'experts : le groupe d'expert est nécessairement un groupe d'experts constitué en fonction de ses compétences scientifiques ; on choisit généralement des francophones pour pouvoir échanger et on réalise une analyse critique et une synthèse de la littérature scientifique internationale, dans la mesure où les expériences françaises ne sont pas toujours de même nature.
En ce qui concerne l'expertise portant sur la réduction des risques chez les usagers de drogues, le commanditaire était donc Mme Bachelot-Narquin, ministre de la santé ; le suivi administratif et scientifique a été assuré par la Direction générale de la santé. La convention sur la réalisation a été signée en novembre 2008.
Ce cahier des charges j'insiste sur ce point car l'expertise collective ne s'est pas limitée à la question sur les centres d'injection supervisés prévoyait d'analyser les données sur les usages de drogues et les dommages sanitaires et sociaux associés, de définir la réduction des risques, de décrire les programmes existants et l'impact qu'ils avaient pu avoir, de recenser les nouveaux outils pouvant se révéler utiles pour réduire les risques ainsi que les populations cibles.
Pourquoi a t on demandé à l'INSERM de réaliser cette expertise ? Si l'on regarde les derniers chiffres remontant à 2006, on voit que la fourchette des usagers problématiques de drogues se situe entre 210.000 et 250.000 personnes ce qui constitue un chiffre important.
Les risques liés à l'usage de la drogue et ceux liés à d'autres toxicomanies comme le tabac ou l'alcool n'ont évidemment rien à voir en termes de chiffres. On considère en effet que le tabac génère environ 60.000 décès par an contre 30.000 pour l'alcool, face à une centaine d'overdoses fatales par an pour les drogues illicites.
Il faut bien entendu également prendre en compte les populations concernées : celles ci sont plus jeunes. Par ailleurs, les hommes interpellés pour usage d'héroïne, de cocaïne ou de crack ont cinq fois plus de risques de décéder que les autres hommes du même âge.
En termes de risques infectieux, la prévalence de l'hépatite C est de l'ordre de 40 à 60 % et celle du VIH un peu en dessous de 10 %. Voilà qui, en dépit d'un certain nombre de progrès, justifie l'idée selon laquelle il faut continuer à trouver les moyens de diminuer ces risques.
Voilà ce que je voulais dire en introduction.
L'étude de l'INSERM est le résultat du travail d'un groupe de quatorze experts qui ont, durant un certain nombre de mois, auditionné des personnalités scientifiques, médecins afin d'enrichir cette expertise.
Trois grandes réunions ont également eu lieu avec les associations impliquées dans la réduction des risques ; la première a été tenue avant même le début de l'expertise, afin d'entendre leurs questions ; la deuxième a eu lieu en cours d'expertise et la dernière a permis de leur présenter les principales conclusions de l'expertise avant qu'elles ne les découvrent dans la presse.
Ce processus d'expertise collective est un éclairage scientifique qui doit apporter une aide à la décision et constitue une écoute d'un certain nombre d'acteurs de terrain qu'il est indispensable d'entendre. C'est néanmoins le seul groupe d'experts qui a procédé à l'analyse de la littérature internationale sur les questions de réduction des risques.
Le fruit de ce travail a donné lieu à un ouvrage volumineux et à une synthèse que je vous propose de vous présenter. Elle ne sera cependant pas forcément exhaustive et je vous invite, sur un certain nombre de points qui vous intéressent, à consulter le rapport.
Depuis plusieurs années, une politique de réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues a été mise en place en France comme dans bien d'autres pays.
Qu'est ce qui justifie une telle politique ? M. Bréart vous en a donné les éléments essentiels.
Les personnes concernées sont jeunes. La toxicomanie représente un coût non négligeable. Le coût social a été estimé en France en 2003 à 2,8 Md€ pour les drogues illicites et à 250 M€ pour les coûts directs de santé liés à l'infection par le virus de l'hépatite C. Ces mêmes chiffres s'appliquent au VIH.
Tous les plans gouvernementaux mis en place au cours des dernières années dans le domaine de la toxicomanie ou des hépatites présentent donc un volet consacré à la réduction des risques infectieux plan MILDT, plan Addictions, plan Hépatites, pour ne citer que ceux-là.
La politique de réduction des risques se décline en programmes. Deux grands types de programmes constituent cette politique, celui d'échange de seringues (PES) et les traitements de substitution aux opiacés (TSO).
Ces grands types de programmes ont été évalués et nous avons analysé dans l'expertise les résultats de ces évaluations qui figurent dans la littérature internationale. Ces évaluations ne sont, en effet, pas uniquement françaises.
Une question importante est de savoir quels types d'indicateurs on retient pour évaluer ces programmes. On peut s'intéresser à des indicateurs proximaux pour savoir si un programme va agir sur le comportement des usagers ou à des indicateurs distaux afin de connaître l'impact du programme sur l'incidence de l'infection par le VIH ou le VHC.
Ce dernier indicateur est le plus intéressant ; néanmoins, on a pu constater qu'il était plus difficile à mettre évidence dans les études d'évaluation.
Des études récentes ont montré un effet visible sur l'incidence des infections VIH et VHC si on prend en compte la combinaison des programmes PES et TSO.
Une troisième étude récente associant les programmes PES, TSO et l'éducation par les pairs a pu démontrer une efficacité de ce type de programme en milieu pénitentiaire sur l'incidence du VHC.
Un autre moyen d'évaluer des programmes est d'étudier le rapport coût efficacité. Les résultats viennent confirmer les précédents et on peut dire que, globalement, ces deux grands types de programmes ont fait la preuve de leur efficacité dans la réduction des risques d'infection VIH et VHC même si cela reste plus difficile à démontrer pour le VHC.
Une politique, des programmes, un dispositif : un dispositif de réduction des risques existe en France. Rappelons quelques dates marquant la mise en place de ce dispositif : en 1987, décret autorisant la vente libre des seringues en officines ; en 1994 et 1995, diffusion des Stéribox en kit et PES ; en 1994, prescriptions possibles par tous les médecins de buprénorphine haut dosage (BHD) ; en 2003, prescriptions par tous les médecins exerçant en établissements de santé de la méthadone ; en 2006, mise en place des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues CAARUD).
Quelle est la disponibilité de ce dispositif et l'accessibilité de ses outils ?
En 2008 en France, près de 14 millions de seringues ont été vendues ou distribuées. La répartition est la suivante : 9,5 millions de seringues ont été vendues à l'unité ou distribuées en Stéribox en pharmacie, le reste - 4,3 millions - étant fourni par les CAARUD ou par des automates. Cela correspond à 170 seringues par an et par usager en moyenne. Pour certains ce dispositif apparaît satisfaisant pour d'autres encore insuffisant.
Le programme concernant les traitements de substitution aux opiacés - buprénorphine et méthadone - fait apparaître que 130.000 usagers de drogues ont reçu une prescription de TSO en 2009. Ce chiffre est issu de deux sources, les usagers vus par les centres spécialisés et les usagers vus par les dispositifs de réduction des risques (RDR), ce qui pourrait signifier que la majorité des usagers injecteurs sont sous traitement.
Cinq recommandations ont été formulées par le groupe d'experts à propos de ces programmes et des dispositifs existants.
La première concerne le déploiement du dispositif au niveau territorial et en particulier une modernisation nécessaire du réseau d'automates, vieillissant. Soulignons également que deux départements n'ont ni CAARUD ni centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
La deuxième recommandation insiste sur une prise en charge globale multidisciplinaire à la fois somatique, psychologique, sociale des usagers. Par ailleurs il apparaît indispensable d'adapter les traitements de substitution à la sévérité de la dépendance en termes de posologies, de produits eux-mêmes, de galénique et de proximité du suivi médical.
Une troisième recommandation concerne la prévention du passage à l'injection ou encore la promotion de modes d'administration à moindres risques comme le fait de passer de l'injection à l'inhalation par exemple ; je n'insiste pas : vous aurez l'occasion d'auditionner les personnes de l'INPES qui s'intéressent à ce type de prévention.
Enfin le groupe d'experts a souhaité formuler deux recommandations qui s'adressent à des populations particulières, comme la population des femmes toxicomanes : il est nécessaire de développer des programmes spécifiques pour les femmes - suivi de grossesses, assistance en cas de violences - et de mettre en particulier en place des centres d'accueil mère enfant.
Une autre recommandation importante pour le groupe consiste à promouvoir une politique de soin et de RDR en milieu pénitentiaire. Cela implique de réaliser un état des lieux, de pallier les carences et d'appliquer le principe d'équité d'accès aux soins et aux mesures de RDR pour les personnes détenues. Vous aurez sans toute l'occasion d'y revenir...
Enfin, l'expertise collective a fait un point de la littérature scientifique sur un dispositif complémentaire à ceux précédemment évoqués, les centres d'injection supervisés (CIS), ainsi désignés dans la littérature.
La plupart sont déjà anciens et sont ciblés essentiellement sur l'injection. La définition donnée au niveau des instances européennes est la suivante : un centre d'injection supervisé peut être défini comme une structure où les usagers de drogues par injection peuvent venir s'injecter des drogues qu'ils apportent et qu'on ne leur fournit pas de façon plus sûre et plus hygiénique sous la supervision de personnel qualifié. Cette structure est insérée dans un réseau de services dont elle représente un élément très spécialisé lié à la question de l'injection.
Les CIS ont une histoire. Ils ont été mis en place à la suite d'une succession d'événements dont les trois principaux sont le développement d'une épidémie de consommation de drogues par injection héroïne et plus récemment cocaïne l'arrivée de l'épidémie de VIH et la présence constante de consommateurs de drogues en situation d'extrême précarité, souvent sans domicile fixe, se piquant dans l'espace public.
Le premier centre ayant reçu une autorisation est celui de Berne, en Suisse, en 1986.
Les objectifs premiers des centres d'injection supervisés étaient donc de diminuer les nuisances, les délits, éviter les problèmes de santé publique liés au matériel d'injection abandonné dans l'espace public et obtenir l'adhésion des habitants du quartier.
Les objectifs pour les usagers sont de répondre à leurs besoins, de réduire les risques liés à l'injection, réduire la morbidité et la mortalité, améliorer l'accès aux soins et ne pas engendrer d'effets secondaires en augmentant par exemple le nombre d'injecteurs.
La littérature présente quelques évaluations de ces centres. Les évaluations réalisées ont pris en compte quatre types d'indicateurs.
Ces centres permettent ils d'atteindre les injecteurs à hauts risques ? Généralement, les centres remplissent cette mission...
Améliorent-ils l'état de santé des usagers ? Oui, ils permettent de diminuer les comportements à risque même si l'on a plus de difficultés à démontrer l'effet sur l'incidence du VHC.
Ils permettent de réduire la mortalité, en particulier par overdose et ont un impact sur l'ordre public puisqu'ils permettent de réduire la consommation dans les lieux publics et les nuisances.
Un autre indicateur utilisé est le coût efficacité : comme pour les programmes d'échanges de seringues, les résultats sont efficaces pour le VIH mais beaucoup plus difficiles à mettre en évidence pour le VHC.
Une question importante concerne les règles de fonctionnement, très différentes d'un lieu à l'autre : le centre doit il être réservé aux majeurs ou peut-il être ouvert aux mineurs ; peut-il être ouvert aux résidents, aux femmes enceintes, aux personnes en traitement ? Quelles sont les durées de séjour ? L'enregistrement est il nominal ou anonyme ? Faut-il une carte, un règlement intérieur qui fixe des interdits et des sanctions pour non respect des règles en vigueur ? Autorise t on une première injection ? Quelle est la réglementation par rapport aux substances illicites ? Quels sont les sites d'injection autorisés ? Ces quelques exemples témoignent de la diversité des questions à aborder en ce qui concerne le fonctionnement d'un centre.
Compte tenu de ces éléments, la recommandation du groupe d'expert est que toute expérimentation de ce type de dispositif doit être précédée d'une étude des besoins afin de définir des objectifs spécifiques. Il faut prendre en considération le problème de l'injection en public, celui du nombre d'injecteurs sans contact ou en rupture avec des structures de soins, celui du nombre d'overdoses mortelles ainsi que la question de l'évolution des modalités de consommation. Doit-on privilégier le crack plutôt que l'héroïne par exemple ?
Voilà un ensemble de questions importantes à prendre en considération.
Par ailleurs un tel dispositif complémentaire ne peut être expérimenté que sous une forme intégrée à un dispositif plus large de services, avec une bonne communication entre ces services.
Enfin, pour garantir un fonctionnement adéquat, il faut qu'il y ait un consensus entre les acteurs locaux, les acteurs de santé bien sûr mais aussi la police, les autorités politiques, administratives, la population en général, le voisinage immédiat et les usagers eux mêmes.

Merci.
Vous avez à juste titre rappelé que cette étude est passée au tamis de la communauté scientifique. Vous nous avez également fait mesurer ce que nous savions déjà qu'avant d'avoir un avis, il fallait que nous connaissions celui des autres et que nous nous informions. Je me réjouis donc que la mission ait commencé ses travaux sur ces premiers propos.
Mes chers collègues, vous pouvez dès à présent formuler des questions sur ces éléments généraux, réservant pour la suite celles portant sur les deux points extrêmement précis que nous aborderons ensuite...
Avez-vous une idée du nombre de personnes touchées par les programmes d'échange de seringues, de traitements de substitution et d'éducation par les pairs ? Les chiffres peuvent ils progresser ?
Par ailleurs la question peut également s'adresser au Docteur Rémy qui intervient en milieu carcéral avez vous l'impression qu'il existe des milieux moins réceptifs que d'autres en matière de politique de santé ou constate t on des hauts et des bas ?
Le chiffre de 230.000 qui a été donné ne concerne pas les seuls consommateurs de drogues injectables mais l'ensemble des usagers problématiques, quelle que soit la forme d'utilisation. Ce peuvent être des amphétamines, etc. Pour ce qui est des autres chiffres, 145.000 usagers par voie intraveineuse ont consommé au cours de leur vie.
J'aimerais vous poser un certain nombre de questions sur vos chiffres et sur la méthodologie.
Vous avez dit avoir travaillé sur des publications. Comment le choix de vos publications a-t-il été fait ? S'agit-il d'évaluations scientifiques ou d'évaluations faites par des organismes indépendants, nationaux ou internationaux ?
Dans certains pays, il existe des polémiques comme il peut y en avoir chez nous : certains préfèrent ne prendre en compte que les évaluations faites par ceux qui proposent telle ou telle thérapie mais non l'ensemble des arguments apportés par les uns ou par les autres.
Vous avez dit avoir été sollicités par le ministre de la santé. Vous a t on demandé de traiter de la lutte contre la toxicomanie ? La réduction des risques n'est en effet qu'un élément de ce sujet. Est ce celui sur lequel vous avez fait porter vos travaux ?
Au-delà du débat qui a eu lieu cet été sur les salles d'injection, il nous faut réfléchir et faire des propositions sur la prise en charge des toxicomanes en général. Vous avez fait un certain nombre de recommandations en direction de l'accès aux soins des femmes et notamment des personnes incarcérées.
Pour en revenir aux centres d'injection supervisés, vous êtes moins affirmatifs dans le rapport d'expertise que dans les résultats que vous avez énoncés. En matière de VIH, ils sont peut être probants mais non en matière d'hépatite C ! J'ai lu un certain nombre de passages de votre rapport : qu'est ce qui vous permet d'affirmer que le coût bénéfice est important ? Je souhaiterai avoir des réponses en la matière.
S'agissant des chiffres que vous avancez, je croyais que sur les 250.000 usagers réguliers environ de drogues de synthèse ou autres que compte notre pays, seuls 2 % de personnes se piquaient. Or, vous en annoncez 80.000. Je n'avais pas connaissance de ces chiffres. Pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse à ce sujet ?
Je suggère de recueillir l'ensemble des questions...
Parmi les populations concernées, vous avez oublié les pharmaciens. Or c'est la première porte que poussent les toxicomanes en grande errance qui vivent dans la rue !
Vous envisagez par ailleurs la mise sur le marché de la méthadone et la prescription d'un traitement par l'intermédiaire du médecin de ville. C'est une nécessité, mais pensez vous que les médecins de ville soient assez bien formés pour cela ?
D'autre part, a t on une idée du taux de couverture vaccinale contre l'hépatite C dans la population toxicomane ? Les centres, là où ils existent, ont-ils permis la vaccination de cette population de manière plus importante ?
On a parlé de réduction des risques au sujet des centres d'injection. Y recourt-on à l'Interféron pour le traitement contre l'hépatite C ?
Sa mise en oeuvre a été demandée en France mais l'Interféron est difficile à supporter en début de traitement ; les toxicomanes qui se le voient prescrire ne le font que deux ou trois fois et l'interrompent dès lors qu'ils retournent vivre en squat car cela les rend malades dans un premier temps.
Enfin, les centres d'injection permettent ils un suivi et une bonne observance ?
J'aurais une approche moins technique que ma collègue. Je crois qu'il faut que l'on s'entende bien au cours des auditions que l'on va avoir : la lutte contre toutes les formes de toxicomanie nous rassemble tous, qu'il s'agisse de drogues licites ou non. Les moyens, la prévention, l'information, l'éducation, la répression, la prohibition constituent un autre sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui
Le sujet que l'on doit aborder légitimement est celui de la lutte contre les effets de la toxicomanie, notamment sur le plan sanitaire.
Or, il ne faut pas se méprendre : la problématique de la lutte contre la toxicomanie et l'augmentation de cette pratique est une réalité qui est devant nous. Elle nous occupera sûrement encore assez longtemps et la façon de lutter contre ses effets ne vient qu'ensuite.
Les politiques conduites depuis des années ont parfois donné lieu à polémique ; elles ont été surmontées. C'est le cas de la libéralisation de la vente de seringues, particulièrement en pharmacie. Les échangeurs et les distributions ne font plus débat aujourd'hui.
J'ai donc envie de poser une question en marge pour aborder le thème des salles de consommation à moindres risques qui, elles, posent actuellement question c'est même la raison pour laquelle nous sommes réunis.
Vous avez évoqué les expériences étrangères. La France s'interroge sur la manière d'accentuer la lutte contre les effets de la toxicomanie, notamment la transmission du VIH et de l'hépatite C. Il existe pour ce faire d'autres moyens que les échanges de seringues ou la libéralisation de leur vente : il s'agit des salles de consommation à moindres risques. La création de structures associatives avec des professionnels de terrain pour offrir des lieux d'accueil et d'aide médicalisée à des gens qui ne savent pas le faire eux mêmes est une pratique utile qu'il faut développer.
Dans le XVIIIe arrondissement de Paris, on a créé une structure de coordination, « Coordination Toxicomanie 18 », qui travaille en direction des publics toxicomanes et des publics qui subissent l'environnement des toxicomanes, car cela doit aussi nous préoccuper.
Les échanges de seringues et leur distribution sont entrés dans les moeurs. Vous avez donné des chiffres : ils sont probants. La polémique porte à présent sur les salles de consommation, qui sont un pas supplémentaire.
L'argument qui vient essentiellement contrebattre ceux qui pensent qu'il faudrait mener l'expérience et apporter une aide aux toxicomanies réside dans le fait que l'on va selon eux favoriser l'accès à l'injection. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse ! Je pense que l'injection a lieu en tout état de cause. Ce n'est pas une incitation.
En quoi le fait de favoriser l'accès à la seringue et à l'échange sanitaire de seringues serait il moins complice que des salles de consommation à moindres risques ? C'est le débat essentiel qui anime les politiques en cette période. On ne veut pas franchir le pas et aider un toxicomane à s'injecter ce venin ! C'est un débat que j'ai connu au Conseil de Paris. Je pose la question : pensez-vous que le fait de favoriser la vente et l'échange de seringues soit moins grave que d'aider à une injection propre dans des salles de consommation à moindres risques ?

Il faut surtout se poser la question de savoir comment sortir un toxicomane de la toxicomanie.
Mettre en oeuvre une structure afin de permettre au toxicomane de réaliser son injection de la manière la plus hygiénique possible plutôt que dans une cage d'escalier ou dans la rue n'est pas le point essentiel. La question essentielle, c'est de savoir ce que l'on apporte de plus aux toxicomanes !
L'implantation de ces maisons d'injection en France n'est elle pas aujourd'hui déjà obsolète dans les autres pays ? La possibilité d'échanger ou de distribuer des seringues a été une très bonne chose. Je sais ce que cela a pu apporter en termes de santé et d'accompagnement à une partie de ma génération mais ces maisons d'injection même dans les pays où ils existent ne sont elles pas dépassées ? Ne faudrait-il pas y réfléchir ?

N'a-t-on pas intérêt, nous, Français, à accueillir un jeune qui va venir se shooter, à lui offrir un café, vérifier que tout va bien avant de le laisser repartir sans être sûr de savoir ce qu'il va faire ensuite ni pouvoir exercer un suivi ? N'a-t-on pas intérêt à créer des structures permettant d'accueillir les jeunes qui ont envie de s'en sortir et de leur offrir les moyens de pouvoir le faire ?
Aujourd'hui, en France, pour un jeune qui a envie de s'en sortir, c'est le parcours du combattant. Un drogué qui a envie de s'en sortir en a envie sur le moment. Si cela ne se fait pas tout de suite, c'est trop tard : il repart dans son monde.
Ma question est donc de savoir si ces maisons d'injection ne sont pas aujourd'hui dépassées.

Certaines des personnes que nous auditionnerons seront peut être plus aptes que nous à répondre à ces questions.

Vous avez présenté cinq recommandations. Dans la première, vous estimez nécessaire de prévoir le redéploiement territorial du dispositif. A quel niveau territorial pertinent pensez vous si l'on veut rendre notamment cohérentes les articulations entre politiques publique, pénale, sanitaire et sociale ?
Qui va coordonner la poursuite d'une lutte contre les risques sur le terrain tout en résolvant les problèmes d'infections dues à la drogue ?
J'aimerais que l'on puisse avoir une approche qui puisse ensuite être appliquée aux territoires. Je suis vice président d'un département où l'on se préoccupe de ces problèmes. Je préside un conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique où on se pose ces problèmes : qui fait quoi ? A quel niveau cela se passe-t-il ? Autant de problèmes importants si on veut aller plus loin !
Les voeux peuvent rester pieux : si on veut aller plus loin et faire des propositions qui soient actées par les élus de terrain qui ont des responsabilités tout en s'inscrivant dans le cadre d'une politique générale, il faut dire qui fait quoi ? Le Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) devra-t-il être coordonnateur en chef ?
Comment la France se situe-t-elle en Europe pour ce qui est du nombre d'utilisateurs de drogues ? De mémoire, je crois que l'Angleterre est le pays où il y en a le plus, soit 1 million...
Par ailleurs, vous avez parlé de 100 overdoses par an. Où surviennent-elles ? En effet, le débat ne sera pas le même en fonction du lieu où elles se produisent.
Par ailleurs, vous avez évoqué Berne. Il s'agit d'une expérience régionale et non nationale puisqu'elle a eu lieu dans un canton. Cela ne concerne donc pas l'Etat suisse. Il est important de le souligner. Depuis 1986, combien de salles ont été mises en place, où et pour quel résultat final ?
Enfin, je voudrais faire un rappel à la loi en disant qu'aujourd'hui, l'utilisation de la drogue est illégale !

Nous allons auditionner M. Costes, qui va nous présenter ses chiffres dans quelques instants.
Vous avez évoqué un cahier des charges dans votre présentation. Je suis surpris qu'il puisse en exister un : qui va contrôler l'identité, l'âge, l'état sanitaire des personnes et refuser que certaines se piquent dans un centre d'injection ? Existe t il des expériences en ce domaine ?

J'ai regardé votre synthèse avec attention mais je n'ai pas lu le rapport en totalité car il est complexe.
Dans les premières phrases vous dites que le concept de la réduction des risques recouvre une diversité de conceptions philosophiques et politiques et soulève de nombreux débats concernant la place de l'abstinence, de la morale et de la loi.
Cela résume bien le problème des toxicomanes de notre pays. La réduction des risques passe essentiellement par une prise en charge différente des toxicomanes, quelles que soient les drogues utilisées. C'est peut être sur ce sujet que l'INSERM et le corps médical pourraient suggérer des pistes pour remédier à ce qui paraît constituer un certain échec.
Les décès de toxicomanes sont de l'ordre d'une centaine par an. Les risques de contamination par le VIH ou le virus de l'hépatite C sont négligeables.
Les gens qui se rendent dans les salles d'injection, faut-il les admettre pour une première injection ? Cela constitue un problème assez délicat sur le plan de la loi et de l'éthique. Les toxicomanes sont des gens qui s'injectent d'une manière plus ou moins propre un certain nombre de substances. Sont ils contaminés en arrivant, ne le sont ils pas ? Il existe d'autres sources de contamination dans cette population marginalisée, comme les tatouages.
Nous avons, en France, une organisation qui n'existe pas dans tous les pays : les CAARUD ont une certaine efficacité. Va t on passer par dessus et aller vers d'autres types de centres ?
D'autre part, il ne faut pas se voiler la face : superviser l'injection d'un produit dont on ne connaît quelquefois pas la teneur pose un problème de responsabilité pénale et morale difficile à contourner !
Par ailleurs, la connaissance précise de la réduction des risques manque un peu : comment aborder le problème de l'usage des drogues quelles qu'elles soient et des moyens qui sont mis en place ?
La prévention n'est elle pas insuffisante ? On a du mal à faire pénétrer la prévention en milieu scolaire.
Ce problème des salles d'injection est un problème qui occupe le premier plan ; nous attendons des scientifiques qu'ils nous orientent sur le sujet de la prévention des risques chez les usagers de drogues en général.

Je partage ce que vient de dire le rapporteur.
Un des objectifs est de réduire la mortalité par overdoses mais, dans votre rapport, vous écrivez, au sujet d'une expérience qui a eu lieu à Vancouver, qu'une étude a estimé à deux par an le nombre de décès liés au VIH. Or, ce chiffre a été jugé un peu trop élevé. Si deux cas paraissent trop élevés, cela signifie qu'il n'y en a qu'un voire pas du tout. Dans ces conditions, cette expérience n'apporte rien ! Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous : « Il semble que l'efficience économique du projet soit remise en cause par les auteurs »...
Si cela n'apporte pas d'améliorations, pourquoi fixer cet objectif ?
Monsieur le Président, vous avez dit que nous nous déplacerions pour voir les choses sur place. C'est ce qui manque à l'étude qui a été faite : il s'agit d'une expertise collective fondée uniquement sur des documents et non sur une enquête. Cela me rappelle furieusement les conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique !

Il n'était pas dans la mission de l'INSERM d'effectuer des déplacements, ce que nous ferons dans la nôtre : nous irons voir sur place !
Je n'essaierai pas de synthétiser les questions qui ont été posées par crainte de les dénaturer. Pour autant, il me semble que l'on peut recenser quatre grands thèmes...
Le premier est le suivant : quel jugement global portez-vous sur l'efficacité des dispositifs existants ?
En second lieu, quels sont les points forts et les points faibles des dispositifs de réduction des risques ?
J'aimerais y ajouter une question. L'apparition de nouvelles communautés ou de nouvelles techniques dans l'usage des drogues justifie-t elle selon vous de nouveaux dispositifs ? Vous en avez parlé en disant que les dispositifs existants mériteraient d'être modernisés, en particulier les automates que vous avez qualifiés de « vieillissants ».
Enfin, de manière générale, comment décririez-vous la place de la politique de réduction des risques infectieux dans le cadre de la politique de lutte contre les toxicomanies ?
Dans l'expertise collective que nous avons réalisée, la politique de réduction des risques est totalement intégrée dans la politique de lutte contre la toxicomanie.
Je suis étonnée par votre remarque : les traitements de substitution aux opiacés sont bien des traitements pour les usagers dépendants aux opiacés. Ces programmes, nous les avons parfaitement intégrés dans l'expertise et analysés. Plusieurs chapitres traitent de ces questions.
Le traitement de la toxicomanie en tant que telle figure dans la politique de réduction des risques, elle même comprise dans l'ensemble de la politique de lutte contre la toxicomanie. Il n'y a pas là d'ambiguïté là dessus : l'expertise a bien été conçue de cette façon.

Est-ce une solution pour les toxicomanes d'être sous Subutex à vie ? Une véritable politique de réduction des risques voudrait que l'on arrive à sortir de ces produits de substitution qui ont par ailleurs toute leur place parmi les traitements existants.
Il semble que, dans notre pays, les centres se contentent de fournir des substituts mais manquent de prises en charge médicalisées ou psychologiques pour sortir définitivement ces gens de la toxicomanie. En fait, on en arrive à une toxicomanie par produits licites Subutex, méthadone...
Non : la prescription médicale permet d'éviter les mauvais produits.
M. Daniel Vaillant, député Il s'agit d'une vraie différence, avec une prescription médicale et un achat en pharmacie.
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mme Branget à propos du problème des publications faites par des gens favorables aux CIS. C'est un sujet important...
Il y a des polémiques dans tous les pays ! Quels sont les ouvrages que vous êtes allés chercher ? Quelle a été votre manière de les sélectionner ? Il existe des polémiques en Suisse, en Allemagne... Au Canada, des salles ont été fermées. Certains organismes internationaux en préconisent la fermeture et leur efficacité n'a pas été prouvée.
Dans votre rapport, page 35, vous affirmez que le coût efficacité n'est pas à la hauteur des attentes. L'Office fédéral de la santé publique a demandé la fermeture de ce genre de salles d'injection parce que les résultats n'étaient pas probants. Une étude avance que sur 2.900 toxicomanes accueillis dans ces centres, seuls trois patients sont arrivés à l'abstinence.
Comment avez vous arrêté le choix de vos publications ?
Le choix s'est porté sur les publications de revues ayant un comité de lecture. Ces articles ont été relus par un certain nombre de gens qui ont dit qu'ils étaient valables sur le plan méthodologique et méritaient d'être publiés. C'est ce qui se passe pour les revues scientifiques.
Pour en revenir à un cadre plus général, je n'ai pas eu la même lecture que vous du rapport. Je ne crois pas que l'on y affirme que les centres d'injection supervisés ont prouvé leur efficacité. Ce n'est pas ce que l'on dit : nous disons que ce dispositif peut être intéressant. En tant qu'homme de santé publique, quand je vois dans la littérature un dispositif qui pourrait être intéressant, ma réaction est de voir si on peut l'adapter et l'expérimenter.
L'expérimentation est un problème majeur en France. Cela suppose d'étudier ce qui se passe et d'arrêter si l'on se rend compte que l'expérience n'est pas concluante. Malheureusement, il est extrêmement difficile, en France, de lancer un projet et de conclure qu'il n'est pas viable. On est plus dans l'augmentation que dans la substitution. Ce seul dispositif va t il tout régler ? Evidemment non !
En tant qu'homme de santé publique, je suis plutôt partisan de la prévention primaire mais je considère aussi que si on lance des programmes de prévention primaire, il faut aller jusqu'au bout et les prendre en charge complètement.
Je suis surtout hépatologue, c'est à ce titre que j'interviens en prison et que je coordonne les unités médicales du Centre hospitalier de Perpignan.
La loi qui régit la prise en charge des personnes détenues a créé les unités de consultation extra ambulatoires (UCSA) et a transféré la prise en charge de la qualité et de la continuité des soins ainsi que la prévention et l'éducation à la santé au ministère de la santé. Plusieurs pays ont suivi la même voie récemment. Son principe de base est l'égalité entre la prison et l'extérieur.
La prison est en effet un lieu de contamination virale. L'Institut de veille sanitaire (InVS), dans son enquête sur la prévalence des hépatites en France, a démontré que la prison multiplie par dix le facteur de risques relatifs à l'hépatite C et par 4 celui de l'hépatite B. Actuellement, 3.300 détenus sont atteints d'hépatite C, 1.700 de l'hépatite B et 800 du VIH. Entre 60 et 100 détenus sont contaminés chaque année en prison, selon l'estimation des professionnels de terrain.
Il existe des pratiques à risques en prison du fait de l'absence d'activités et de la relative disponibilité de produits illicites ou de médicaments détournés de leur usage thérapeutique.
Les pratiques à risques sont multiples : injections, « sniffs », tatouages artisanaux, piercings, scarifications ou relations sexuelles non protégées.
Selon l'enquête « Coquelicot », sur 61 % d'usagers de drogues ayant souvent fréquenté la prison, on dénombre 12 % d'injecteurs dont 30 % avec échange de matériel non stérile.
Ces pratiques à risques en milieu carcéral sont connues des équipes soignantes. Les données françaises de terrain sont les suivantes, selon les résultats d'une enquête de pratiques 2010, deux tiers des UCSA ont eu connaissance de pratiques de « sniff » , la moitié connaissance de partage de paille, un tiers connaissance d'injection et de partage de seringues entre détenus, un quart de partage de coton ou de cuillères. On compte 60 à 100 nouvelles contaminations virales par an.
En fonction de l'objectif actuel de réduction des risques inscrit dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les programmes d'échanges de seringues sont possibles et légaux au dehors mais la réduction des risques s'est arrêtée aux portes des prisons et il n'existe pas de politique réelle de RDR en prison, en France !
Les injections et autres pratiques sont plus fréquentes à l'extérieur de la prison qu'à l'intérieur mais comportent moins de risques, un tiers donnant lieu à échange de seringues.
L'efficacité du programme d'échange des seringues est prouvée, notamment en Espagne, pour ce qui est des contaminations au VIH ou au VHC.
En conclusion, la fréquence des infections virales est plus élevée en prison qu'en milieu libre. De nouvelles contaminations se produisent chaque année.
Il faut donc, selon nous, définir une véritable politique de réduction des risques en prison comprenant l'ensemble des mesures, y compris les programmes d'échange de seringues et de traitements de substitution aux opiacés.
Pour répondre à la question de Mme Lemorton sur le taux de couverture vaccinale des populations toxicomanes, 30 % de toxicomanes sont vaccinés contre l'hépatite C. Les expériences internationales menées dans les centres de prise en charge montrent que l'on peut vacciner les patients contre une hépatique C quel que soit leur environnement. Certains programmes ont prouvé leur efficacité.
Est-il pertinent de distribuer des seringues stériles en prison ? Il ne serait pas normal de ne pas le faire alors qu'on l'accepte à l'extérieur !
Actuellement, hormis la distribution de préservatifs qui dépend de la direction de chaque établissement et de kits d'eau de javel, un peu « à la tête du client », aucun programme de réduction des risques n'existe en prison. Quel regard portez-vous sur les programmes d'éducations sanitaires en prison ?
Disposez-vous de chiffres sur les personnes toxicodépendantes ? Il en existe assez peu... Quels sont les produits consommés ?
Quelle politique de réduction des risques les prisons suivent elles en dehors de l'accompagnement ? Combien de personnes doit on accompagner ? J'ai eu beaucoup de mal à obtenir des chiffres de la justice car ils sont établis dans chaque maison de détention : on ne connaît donc malheureusement les publics qui en ont besoin.

Je considère que la méthadone est une bonne chose et permet à des toxicomanes de retrouver une existence normale et d'avoir une vie sociale. Je connais des toxicomanes qui utilisent la méthadone depuis vingt ans et qui ont des enfants, une vie de famille. Je préfère cela à un jeune ou à un père de famille qui attend le dealer pour obtenir sa dose !
Certes, il est dérangeant de distribuer des seringues en prison mais si on ne se donne pas les moyens d'aller au delà, ce n'est même pas la peine de discuter de ce que l'on veut faire pour aider les toxicomanes à s'en sortir ! Il ne s'agit pas de se donner bonne conscience en créant des salles d'injection : il faut aller au delà !
Comment délivrer de la méthadone et accompagner les toxicomanes ? On distribue bien des préservatifs en sachant qui y a des violences dans les prisons...
Que l'on puise être contaminé par le Sida ou l'hépatite dans un établissement géré par l'Etat est inadmissible !

e vous demanderai de cibler vos questions : les débats n'ont pas à avoir lieu durant les auditions !
Docteur, ces sujets sont ils de nature à susciter chez vous un certain nombre de réflexions ?
Sur la politique globale et le préservatif, je serai moins pessimiste...
Les préservatifs sont payés par la Justice et distribués par les UCSA où ils sont disponibles, avec la méthadone, si l'approvisionnement n'est pas en rupture. Il faut d'ailleurs rendre hommage aux personnels des UCSA, qui sont très motivés en matière d'éducation sanitaire.
Quant aux consommations de drogues, la direction de l'administration pénitentiaire a fait une enquête en août 2009 dont on n'a jamais eu les résultats. Toutes les seringues - comme à la prison de Perpignan - ne viennent pas de l'unité médicale mais de l'extérieur. Certaines sont pré remplies et contiennent des anabolisants. On ne s'injecte pas que des stupéfiants en prison : certains détenus font du sport et sont à la recherche d'anabolisants, comme d'autres sportifs amateurs. Ils en font donc entrer. On trouve des produits illicites mais aussi d'autres produits. S'il n'y avait pas de drogues en prison, on n'aurait pas besoin de se poser la question des risques d'infection. Il faut faire avec !
Je veux témoigner ici du travail des personnels et des volontaires des UCSA, qui sont très dévoués. On trouve parmi eux beaucoup de gens de grande qualité.
Je souhaite en premier lieu longue vie à cette mission.
Je voudrais remercier mes collègues de l'INSERM de nous avoir associés à leur étude en tant qu'acteurs de terrain. J'interviens pour ce qui me concerne à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, que l'on peut considérer comme un observatoire des pratiques et des complications liées à l'usage des drogues. Les choses étaient fort différentes il y a vingt ans, lorsque Marc Gentilini m'a demandé de créer la première équipe de liaison appelée « ECIMUD », dont les équipes de liaison et de soins en addictologie ont pris aujourd'hui la place.
C'est vous qui l'avez autorisé, en votant le budget qui a permis de répandre une culture de la prise en charge des addictions. C'est cela qui, en 1996, a permis au Professeur Gentilini de faire appel à un psychiatre qui ne s'occupait pas de toxicomanie. J'étais en effet alors à Sainte Anne, plutôt formé à la prise en charge des psychotiques et des comorbidités psychiatriques importantes. C'est ce qui a donné à Marc Gentilini l'idée que les toxicomanes de l'époque pourraient avoir accès à des traitements de substitution et aux antiviraux.
Aujourd'hui, les toxicomanes, qui représentaient 90 % de mon activité hospitalière en 1996, constituent 5 à 10 % de mes patients, les autres étant des usagers problématiques de drogues.
Mon intervention portera sur des populations ayant des pratiques intraveineuses : on peut être usager problématique de drogues et avoir, pour des raisons que je qualifierai de psychiatriques ou de compulsives, des comportements compulsifs. L'existence dans les hôpitaux d'équipes de liaison et de soins en addictologie permet d'aller au devant de ces personnes. Il s'agit de populations qui, du fait de la stigmatisation des familles, ont des pratiques à l'insu des tiers et souvent à l'insu du médecin qui prescrit un traitement de substitution.
L'hôpital est un filtre important qui permet de déceler certaines addictions : grossesse, infections, rhumatismes, problèmes orthopédiques dont les accidents de la voie publique sont pourvoyeurs.
Cela n'a pas été évoqué ici : on n'est plus aujourd'hui face à des mono consommateurs mais des poly consommateurs ; les usagers adoptent différents menus de consommation, peuvent s'arrêter 5 jours et reprendre à la faveur d'un moment festif, d'une souffrance, d'une angoisse.
On s'en rend parfaitement compte à l'hôpital, lors de nos interventions quotidiennes aux urgences. C'est une des raisons du renforcement de nos équipes de liaison. Même si notre activité n'est pas uniquement centrée sur les usagers de drogues à pratiques intraveineuses, c'est souvent à la faveur d'un dépistage, d'un contact, le plus souvent au détour d'une ivresse aiguë que l'on dépiste ces addictions. La plupart de nos patients dont la toxicomanie remonte aux années 1990 sont en train de mourir d'alcoolo dépendance et non du Sida ou du VHC !
Il est donc important de considérer un dispositif global et de pouvoir, à partir des urgences, accueillir ces patients car nous sommes complémentaires du plan « Addictions 2007 2011 ».
Vous avez évoqué la question du sevrage. Oui, le sevrage est d'actualité mais dans le cadre d'une politique de réduction des risques et d'un accès aux traitements de substitution qui respectent l'itinéraire des usagers de drogues.
De ce point de vue, à l'hôpital, le binôme pharmacien médecin est important. J'ai dans mon équipe un pharmacien qui assure le suivi de la réduction des risques. En tant que psychiatre, je me vois mal en train de parler d'échange de seringues pour des raisons qui peuvent être théoriques.
J'insiste sur les facteurs de risques et de complications qui ont été mis en évidence à La Pitié Salpêtrière : augmentation des pratiques d'auto injection et résurgence des injections de comprimés.
Cette épidémie s'explique par l'effet de nombre, qui entraîne un détournement des substances, certains usagers considérant qu'il est plus facile dans leur rituel d'utiliser la voie intraveineuse. Retarder l'accès à la seringue reste un objectif prioritaire à l'hôpital car les gens que l'on voit aux urgences subissent déjà les effets et les complications de leurs pratiques.
Deux mots concernant ces pratiques. Même s'il faut modérer ce que je dis, je le dis avec une certaine conviction, car je ne puis le dire autrement, notre observatoire constate qu'aujourd'hui que les pratiques d'échange de matériels se sont nettement réduites.
Ces pratiques d'injection peuvent aller d'une par an à une par semaine, en passant par 10 par jour. La cocaïne, produit vraiment inquiétant, conduit à des compulsions liées à la courte durée d'action des produits injectés. Une des caractéristiques du crack réside dans sa courte durée d'efficacité. Je le vois chez nos malades injecteurs.
On dispose d'énormément d'informations sur le VIH et sur le VHC mais il existe des pratiques clandestines et intimes au même titre que les pratiques sexuelles à risque que les gens ne connaissent pas ! Nous avons été les premiers surpris de voir apparaître aux urgences des candidoses ophtalmiques associées à des abcès à l'oeil.
Pendant vingt ans, on a accusé le citron employé pour chauffer les produits d'en être responsable mais on n'en utilise pas avant d'injecter de la buprénorphine, des amphétamines ou d'autres produits ! L'auto contamination se fait par une candidose buccale, nous en avons tous, au moment de l'usage.
Les salles d'injection ne sont pas une création mais une extension des missions d'un certain nombre de centres, que je souhaiterais personnellement médicaliser. On peut en discuter avec le milieu associatif et médico-social. On assiste à une extension de pratiques que les usagers eux mêmes n'arrivent pas à nommer.
Je peux témoigner du choc que reçoit un homme de 40 ans, manutentionnaire, inséré, avec des enfants, une femme, un salaire et à qui l'on dit : « Vous avez un abcès grave à l'oeil dû à une candidose systémique. C'est une urgence ophtalmique ». Il y en a eu 80 à la Salpêtrière ces dix dernières années ! Les gens arrachent le filtre avec les dents, souillent celui ci avec leur salive et utilisent la seringue...
Tout cela n'était pas connu auparavant. On a redoublé d'attention et on a réussi à comprendre. Certains patients ont dû subir des interventions sur des valvules cardiaques du fait d'endocardites à candida !
Les injecteurs sont donc aujourd'hui nos meilleurs vecteurs d'information. J'en veux pour preuve que, depuis 2000, les candidoses ophtalmiques ont diminué de 50 % !
Nous disposons également d'un réseau francilien, ainsi qu'en grande couronne et dans les régions de Tours et d'Orléans qui font remonter vers nous certaines pathologies. Cependant, il arrive que certains laboratoires ne veuillent pas mentionner les risques intraveineux que comporte l'utilisation d'un de leurs produits.
Pour en revenir à l'expérience suisse, elle est très intéressante. Je connais bien l'expérience bâloise. Les Suisses ne comprennent pas notre débat qui, chez eux, ne fait pas l'objet d'une polémique politique : il s'agit d'une offre de santé publique et d'une question de dignité de la personne. Je connais la situation à Berne car j'ai fait partie d'un certain nombre de commissions dont l'avis est en effet nuancé quant à l'efficacité des CIS. Vous avez raison de rappeler que l'on peut avoir des divergences sur leurs résultats en termes d'accueil mais ils peuvent permettre de toucher une population peu habituée à recourir aux services sanitaires et sociaux.
Il y a vingt ans, les centres s'appelaient centres d'injection supervisés ; aujourd'hui, on les appelle officiellement des centres d'accueil et de contact. Le mot le plus important est celui de « contact ». C'est grâce à eux que la scène ouverte de Berne a disparu et que la scène ouverte de Zurich n'existe plus. La scène ouverte de Bâle a été réduite avec le concours des forces de police.
Je terminerai en disant qu'à La Pitié Salpêtrière, 50 % de ma clientèle prise en charge pour une toxicomanie présente une comorbidité psychiatrique. La politique de réduction des risques nous a aidés à garder le contact avec ces patients.

Nous avons pris acte avec grand intérêt de votre propos qui a le mérite d'apporter des réponses à certaines des questions qui ont été posées.
Vous avez raison de dire que l'hôpital constitue un filtre important pour les conduites à risque. Nous en sommes parfaitement conscients.
Vous l'avez dit, certains usagers détournent les traitements de substitution et s'injectent du Subutex...
Il est vrai que notre politique est tournée vers la diminution des risques. La substitution a jusqu'à présent porté ses fruits mais on doit également - c'est le but de la mission - faire des propositions et l'on aimerait pouvoir aller vers l'abstinence.
C'est ce qui se fait dans certains pays, notamment la Suisse. La lutte contre la toxicomanie comporte la substitution mais également le sevrage, l'abstinence et l'accompagnement sur le long terme qui est une forme d'accompagnement social.
J'avais par ailleurs cru comprendre que les traitements de substitution pouvaient provoquer des pathologies. J'aurais aimé vous entendre à ce sujet. La candidose peut être due à l'injection, le produit injecté étant un produit toxique. Or, le traitement de substitution, même s'il s'agit d'une drogue légale, est également un produit toxique. Quelles sont les éventuelles pathologies qui peuvent être développées du fait des traitements de substitution ? Commencez-vous à en voir ?
La Suisse, qui est en avance et qui a mis en place une politique d'accompagnement depuis plus longtemps que nous, voit la perversité de son système puisqu'elle est aujourd'hui obligée de construire des « homes » pour des retraités précoces, sous traitement de substitution depuis dix, quinze, vingt ans !
Enfin, je voulais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai évoqué la page 35 de votre rapport : il s'agit en fait de la page 31... Vous dites que les centres d'injection n'apparaissent pas être des dispositifs coût efficaces dans la lutte contre le VHC. Je ne l'ai pas inventé !
Il faut prendre conscience que nous parlons d'une population qui présente de multiples problèmes sanitaires, sociaux, psychologiques, voire psychiatriques. En 1995 1996, quand le Subutex est arrivé, tous les réseaux disaient que ce produit ne s'injectait pas. C'était faire fi du rite de l'injection et les réseaux ont dû le prendre en compte pour accompagner les toxicomanes le mieux possible et accepter qu'ils se l'injectent.
Un fumeur, lorsqu'il arrête, reste dépendant de son geste ; pour un toxicomane, c'est la même chose. On a été obligé de l'intégrer dans l'accompagnement, tout en conservant l'objectif de voir les toxicomanes arrêter les injections et se séparer du Subutex.
Je rejoins ce qu'a dit ma collègue sénatrice : il y a des gens qui prennent 2 mg de PVB par jour, ont fondé une famille et trouvé un travail !
Chaque vie vaut la peine d'être sauvée, même lorsqu'il s'agit de trois sur cent ! Il ne faut pas se fixer d'objectifs, on n'est pas dans ce contexte là ! C'est très complexe... Est ce que je me trompe en présentant les choses ainsi ?

Vous passez de la toxicologie à l'addictologie. Cela sous entend il que vous traitez de la même manière les drogues licites ou illicites ?
L'utilisation de la cocaïne est de plus en plus fréquente. Avez-vous une approche particulière pour les utilisateurs de crack ?
Enfin, j'ai été choqué par le fait que vous considérez que l'arrêt du traitement est nocif puisqu'il entraînerait des décompensations psychiatriques graves. Les psychiatres ont d'autres possibilités de traitement dans ce domaine, notamment la prise en charge psychanalytique ou chimique...
L'arrêt des traitements de substitution de façon brutale : pression de l'entourage, du médecin ou à la demande de l'usager lui même, entraîne bien des décompensations psychiatriques. Certains services psychiatriques, en France, commencent par arrêter tout traitement de substitution lorsqu'un patient est hospitalisé, entraînant un certain nombre de décompensations psychiatriques avec psychoses carcérales secondaires dues à cet arrêt trop brutal.
Je répète que l'abstinence est un projet et que nous ne décidons pas de son calendrier. Les itinéraires sont extrêmement variables et différents d'un individu à l'autre. Je suis pour une approche singulière des patients, même si notre dispositif doit être le plus ouvert possible.
Je tiens à dire que la plupart de mes confrères addictologues ont constaté 2 à 5 % d'arrêts spontanés des traitements de substitution. Les modes d'arrêt, comme pour les antidépresseurs, sont progressifs ou brutaux, à l'initiative des individus. Pour un sur deux, le transfert de dépendance se fait en faveur d'un autre produit que la cocaïne : l'alcool dans 90 % des cas, le cannabis ou le tabac.
Je le répète, il s'agit le plus souvent de poly consommateurs ; ce n'est pas parce qu'on a réglé le problème des traitements de substitution que les autres co-addictions où comorbidités le sont aussi. Je le redis très clairement : les guérisons spontanées ne se font pas sur ordonnance, non plus que sur ordre de l'entourage ! Je n'en ferai pas non plus un objectif de santé publique mais il existe des réinsertions sociales qui sont de vrais succès.
Oui, la cocaïne constitue un souci majeur. L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP HP) dispose d'un certain nombre de traitements efficaces, à condition que le programme de suivi et d'accompagnement soit régulier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
On dispose de trois ou quatre molécules « anti craving » ; d'autres facilitent le sevrage mais la facilité avec laquelle on peut se procurer ce produit nous laisse pantois ! Ce n'est pas une question de santé publique : c'est à un autre niveau que cela se joue. Il y a aujourd'hui aux urgences environ une complication grave par semaine liée à la cocaïne, avec des conséquences d'ordre cardiaque, neurochirurgical ou neurovasculaire...
Drogues licites ou illicites ? En tant que médecin, je considère la transgression comme une épreuve très importante pour le sujet. L'individu qui utilise des substances illicites doit se confronter à la loi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les complications liées à l'alcool sont bien plus graves que celles liées à l'héroïne...
Je ne suis pas en mesure de garantir que tel produit entraînera moins d'effets secondaires qu'un autre. Il n'y a pas de cohérence entre le degré de licéité et d'illicéité par rapport aux complications que l'on observe.
Le crack par voie intraveineuse permet d'obtenir un effet « flash » de 10 secondes, le « kiff », la voie inhalée de 8 à 9 secondes. On ne peut faire passer cette information dans le grand public elle serait considérée comme incitative mais il faut proposer d'autres modes de consommation pour éviter des complications aussi graves qu'une candidose. Dix patients ont perdu un oeil du fait d'un retard de diagnostic ou d'un diagnostic insuffisamment précis. Une fois qu'ils arrivent à La Pitié Salpêtrière, c'est trop tard !
Enfin, l'abstinence est une chose importante. La Suisse, par exemple, a toujours des lits de sevrage libres dans chaque canton. Il existe d'ailleurs des comités thérapeutiques. Le sevrage est quelque chose qui se prépare non aux urgences mais en centre.
Enfin, le détournement de la BHD est connu depuis le début mais il réduit cependant les risques de Sida et de VHC. Utilisée seule, il présente en outre des risques d'overdoses moins importants.
La méthadone, quant à elle, était non injectable mais un certain nombre de patients sont prêts à s'injecter n'importe quoi. Il existe des attitudes compulsives qui obligent à adopter des réponses particulières.
Je pense qu'il est important de renforcer les dispositifs des centres et de prévoir une extension de leurs missions actuelles. Oui, je le répète, l'hôpital est un filtre pour les conduites à risque et les complications liées à l'usage de drogues.

Il me reste à vous remercier d'avoir secoué les convictions des uns et des autres.
Merci. N'hésitez pas à nous envoyer un document si vous le souhaitez !

Nous allons maintenant procéder à l'audition de M. Jean Michel Costes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Je vous remercie de m'avoir invité. C'est la mission naturelle de l'établissement que je dirige de rendre compte aux autorités nationales mais aussi aux instances européennes de l'état de l'usage de drogues en France, de ses conséquences et de son évolution.
Cela fait maintenant quinze ans que l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a été créé. Il s'agit d'un établissement public dans le conseil d'administration duquel siègent tous les ministères en charge de cette question, aussi bien dans le champ préventif que dans celui de l'application de la loi, en passant par celui de la santé.
Je dirige une équipe pluridisciplinaire d'une trentaine de personnes qui mènent un travail collectif. La collecte des données par triangulation est au coeur de notre méthode. On peut opposer dans le débat une étude à une autre, l'important est de les mettre en perspective car il existera toujours une étude pour affirmer le contraire de la précédente. Je pense d'ailleurs qu'il serait souhaitable que l'on puisse rendre compte de l'évolution de l'usage de drogues en France devant le Parlement.
Il m'a semblé que le champ d'action de votre mission parlementaire était ciblé sur la question des toxicomanies. J'ai donc centré ma présentation sur les usages problématiques de l'utilisation de drogues pour la santé, qui constituent une partie de l'ensemble du phénomène et plus précisément sur la question des drogues illicites, même si je fais état de l'usage de drogues licites.
Une grande confusion dans le débat public provient de la différence entre l'usage de drogues et l'usage problématique de drogues. Dans la population générale, un certain nombre de personnes font usage de drogues illicites ; l'usage problématique, tel qu'il est défini par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l'OEDT, est un usage qui débouche sur des dommages sanitaires et sociaux importants.
Un toxicomane est quelqu'un pour qui la recherche et l'usage de ces produits est le centre de l'existence et absorbe toute son attention.
12 millions de Français ont essayé au moins une fois du cannabis, qui est la drogue la plus consommée, alors que l'usage problématique concerne 230.000 individus.
Cela ne veut pas dire que les usagers ne peuvent pas subir des conséquences dommageables : je pense par exemple à la conduite automobile sous cannabis. Cependant, l'essentiel des dommages sanitaires et sociaux est concentré sur des populations ayant des usages problématiques de drogues.
Cela n'appelle pas les mêmes réponses. L'usage de drogues requiert des approches de santé publique et de prévention primaire ou secondaire, les usages problématiques nécessitant quant à eux des traitements et une politique de réduction des risques. En termes de visibilité sociale, la réduction des risques s'applique aux usages problématiques.
La consommation régulière de cannabis concerne 1,2 million de consommateurs, la cocaïne 1 million de personnes. Il est intéressant de constater que l'usage régulier de cannabis chez les jeunes, si on prend une perspective plus large, s'inscrit dans une tendance assez globale qui va vers la diminution du tabagisme. Aucune tendance n'étant jamais définitive, il faudra toutefois vérifier ces chiffres, certains indicateurs pouvant laisser augurer un retour de celui ci.
On constate également une augmentation de l'ivresse et des formes plus excessives de consommation régulière d'alcool.
Le cannabis, après deux décennies d'augmentation régulière, a connu un changement de tendance qui s'est traduit, en 2002-2003, par une stabilisation à un niveau assez haut et, depuis quelques années, par une diminution de la consommation chez les jeunes.
On note par ailleurs une amorce significative de la consommation d'autres produits stimulants comme la cocaïne, qui est passée de 1 % en 2000, chez les jeunes de 17 ans, à 3,3 % en 2008, les indicateurs montrant une tendance à l'augmentation dans la population générale. Les jeunes Français se situent à 15 % par rapport à la consommation européenne, suivant en cela le modèle de certains pays dans la décennie précédente, comme l'Italie, l'Espagne ou le Royaume Uni.
La consommation de cocaïne est encore à un niveau relativement faible, ce qui fait dire qu'il s'agira d'un enjeu important au cours des cinq ou dix prochaines années.
J'en viens à présent au coeur du sujet que constitue l'usage problématique de drogues. Il s'agit d'usages qui conduisent à des dommages sanitaires et sociaux importants. Selon une étude menée dans les années 2006, on estime qu'il existe environ en France 230.000 usagers problématiques de drogues opiacées et de stimulants ou d'hallucinogènes. Ce sont pour la plupart de poly consommateurs : la figure de l'héroïnomane ne se rencontre plus parmi les populations d'usagers problématiques de drogues !
Sur 230.000 usagers problématiques de drogues en France, on estimait, en 2006, que 74.000 faisaient un usage actif d'héroïne, 145.000 un usage actif de la voie intraveineuse au cours de toute leur vie et 81.000 un usage actif par voie intraveineuse au moins une fois par mois.
La prévalence d'usagers problématiques de drogues situe la France à un niveau moyen en Europe, inférieur à celui de l'Angleterre ou de l'Italie mais supérieur à celui de l'Allemagne.
Le chiffre de 230.000 personnes représente bien l'ensemble des usagers problématiques de drogues en France ?
En effet.
Cette population se caractérise par un âge moyen de 35 ans. C'est une population vieillissante, qui reste majoritairement masculine, même si des tendances récentes montrent qu'il y a de nouvelles générations d'usagers problématiques de drogues et que la part des femmes est plus importante. Elle se caractérise également par trois faits majeurs : ce sont des poly consommatrices de produits licites et illicites, tous fumeurs et qui détournent certains médicaments (BHD, méthadone, psychotropes) de leur usage.
La prévalence de la morbidité psychiatrique est extrêmement élevée. Cette population se caractérise enfin par sa précarité. Ces deux éléments me semblent importants à souligner car la politique de réduction des risques en matière de toxicomanie ne peut résoudre tous les problèmes de la France en matière de psychiatrie ou de précarité sociale.
Quelles sont les évolutions marquantes des dernières années en matière de populations et de produits ? Un nouveau public émerge : jeunes migrants, mineurs en rupture sociale et familiale consommateurs de produits psycho actifs. Une des caractéristiques marquante de cette nouvelle toxicomanie réside dans le fait qu'elle se diffuse sur les territoires ruraux et en zone périurbaine.
On assiste par ailleurs au développement de la poly consommation. Les stimulants connaissent une importance accrue, notamment la cocaïne. On ne peut dire que l'héroïne soit à la fin d'un cycle car un certain nombre d'indicateurs démontrent que si les évolutions sont souvent cycliques, les nouveaux publics en fument ou en « sniffent » aussi.
La place des drogues de synthèse et des médicaments détournés est également très importante, ainsi que l'auto culture du cannabis.
La seconde partie de mon propos portera sur les conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie. Il me faut auparavant vous donner quelques données de cadrage sur les dispositifs de réduction des risques, afin de vous permettre de juger des évolutions épidémiologiques sur la morbidité et sur la mortalité liées à la drogue.
Il existe trois grands axes dans la politique de prise en charge des usagers de drogues en France : les SCAPA, les CAARUD et le recours aux TSO.
Les CSAPA sont des centres de soins spécialisés dans le traitement des usagers de drogues ; ils travaillent dans une perspective d'abstinence et reçoivent 90.000 personnes.
Les CAARUD mettent en place une politique de réduction des risques et d'accompagnement. Le seuil d'exigences pour y avoir accès est faible, ce qui permet à certains usagers de drogues d'entrer dans ces dispositifs. Ils prennent en charge environ 48.000 personnes.
Enfin, les TSO concernent les usagers de drogues ayant une ordonnance pour un traitement de substitution. Ils relèvent de la médecine de ville et constituent un acteur majeur du système.
L'estimation globale de cette population s'élève à environ 200.000 individus, ce qui permet de dire aujourd'hui que 85 % de la population des usagers problématiques de drogues bénéficient d'une forme de prise en charge. La France n'a pas, de ce point de vue, à rougir de son dispositif : c'est un taux de couverture très nettement supérieur à celui que l'on connaît en alcoologie !
En 1994, cinquante personnes bénéficiaient d'un traitement de substitution. En cinq ans, on est passé à 80.000 du fait de la mise en oeuvre massive de ces traitements et l'on estime à 50 % le nombre d'usagers couverts par un traitement de substitution. Ce taux de couverture est plutôt assez élevé par rapport aux autres pays européens.
La couverture territoriale est relativement bonne, même si certains départements connaissent un certain nombre de trous dans le dispositif.
En termes d'indicateurs, le programme le plus symbolique dans la mise en place de la politique de réduction des risques est l'accessibilité aux seringues, comme l'a déjà mentionné Mme Etiemble : 14 millions de seringues sont distribuées par an, soit un ratio d'une seringue par usager injecteur tous les deux jours. La France se positionne, dans ce domaine, à un niveau relativement élevé en Europe.
J'en viens à présent aux dommages sanitaires. Je me suis concentré sur les deux maux majeurs que sont les décès et l'infection par le VIH et le VHC.
Le risque majeur - cela ne fait pas débat dans la littérature scientifique - est l'utilisation de la voie intraveineuse. C'est un paramètre important à surveiller. Malheureusement, la France ne s'est dotée d'un instrument de mesures qu'au milieu des années 1990. On a donc peu d'informations sur les périodes antérieures. On constate cependant en France, depuis cette date, une baisse du nombre d'usagers problématiques de drogues, ce qui est plutôt une bonne chose.
Il est intéressant de relever que, dans la seconde moitié des années 1990, la diminution du nombre de décès a correspondu à la montée en charge de la politique de réduction des risques et au recours à des produits de substitution. Cela a été confirmé par deux études de cohortes rétrospectives.
Comme toute évolution, celle ci n'est cependant pas définitive et on a, au cours des cinq dernières années, enregistré une certaine augmentation des décès. Cela figure dans le rapport de l'INSERM et constitue un point important à prendre en compte.
J'apporterai toutefois un correctif à l'indicateur de 330 décès, dernière donnée dont nous disposions. On sait en effet, pour avoir mené d'autres études, que l'on sous estime de 25 à 30 % le nombre des décès. Il est même probable que les décès liés à l'usage problématique de drogues soient plus proches du millier que de 300. Cela reste à relativiser par rapport à la position de la France, dont le taux de mortalité est inférieur à la moyenne européenne.
Pour le VIH, les courbes sont extrêmement bonnes quelles que soient les sources, la prévalence, apparaissant à la baisse. Cela amène la France à rejoindre la grande majorité des pays européens.
Cependant, les niveaux de prévalence relatifs au VHC sont plus élevés. Il faut toutefois prendre conscience du fait que, pour des raisons de coûts, les sources utilisent pour l'essentiel la prévalence déclarée, qui entraîne une sous estimation de l'ordre de 15 à 20 %. Il est donc probable que la prévalence du VHC soit plus proche de 60 % que de 40 %. Même si on voit s'amorcer une diminution qui reste à surveiller, cette prévalence demeure élevée et constitue un problème général en Europe.
Cela dépend des pays... Tous n'ont pas une culture de santé publique identique à celle des pays du Nord de l'Europe. Les petites imperfections méthodologiques n'enlèvent rien au fait qu'il existe des différences importantes. Certains pays de l'Est ont des taux de prévalence élevés, comme l'Estonie.
Beaucoup de facteurs interviennent. Les décès proviennent d'un certain nombre de facteurs comme le mode de consommation. Les overdoses se produisent essentiellement à la suite d'une rechute ou à la fin d'une incarcération, l'usager de drogues ayant oublié que la méthodologie a changé. Il existe également une disparité dans la qualité des produits. Actuellement, l'héroïne est autour de 5 % mais on en trouve à 40 ou à 45 % !

Selon vous, la création de centres d'injection supervisés peut elle apporter quelque chose à vos statistiques ? Est ce contraire à la loi ou à la déontologie ?
Ce sont des questions différentes. En premier lieu, la mission de l'OFDT est d'établir des statistiques. Puisque je suis devant une mission parlementaire, je dirai ce que je pense et j'insisterai sur la richesse de l'expertise collective menée par l'INSERM. Le groupe d'experts comptait 14 personnes. Je vous renvois à la monographie de l'OEDT sur la question...
Les salles d'injection sont elles efficaces pour réduire la morbidité due aux infections et les décès ? Sont-elles efficaces pour prendre contact avec la population que l'on n'arriverait pas à toucher sans ce dispositif ? Sont-elles efficaces pour réduire les nuisances sociales ? On trouvera toujours des résultats contradictoires. On ne peut se baser sur une seule étude. C'est là tout l'intérêt de l'expertise collective.
Les centres d'injection supervisés sont uniquement efficaces pour diminuer les pathologies, les abcès, les overdoses, faire chuter le nombre de pratiques à risques, réduire les cas d'infections dues au VIH et au VHC encore que ceci soit plus délicat à démontrer car on vise là une population moins nombreuse, d'où un impact limité en termes de santé publique.
Quant à l'impact sur les nuisances sociales, les salles d'injection n'incitent pas à l'usage de drogues ni ne créent ou n'augmentent le deal autour de l'endroit où elles sont implantées. En effet les salles d'injection ont été créées sur des sites où ces pratiques avaient déjà lieu auparavant.
Cette question est différente de celle de l'impact sur la santé publique. Les chiffres seront d'autant plus limités que la population est limitée.
On veut renforcer le dispositif existant, dans lequel les centres d'injection supervisés doivent s'incorporer. On propose en fait d'élargir la palette de leurs missions.
La diminution des cas de VHC est elle liée à la diminution des injections ?
Les centres d'injection supervisés sont ils compatibles avec les engagements internationaux ? L'ONU a demandé la fermeture de tels lieux dans un certain nombre de pays...
Vous avez dit que les centres d'injection supervisés s'inscrivaient dans un continuum. C'est possible mais va t on en arriver à prescrire de l'héroïne, comme cela s'est passé dans d'autres pays ? Va t on pouvoir consommer une drogue achetée dans la rue ?
La responsabilité du médecin sera t elle engagée, la personne qui se pique le faisant en se conformant aux recommandations d'usage mais avec un produit potentiellement dangereux, voire mortel ?
Va-t-on arriver, dans une seconde étape, à une distribution d'héroïne ? Je ne vois pas comment autoriser ce genre de choses, même à titre expérimental !
Quelques précisions par rapport au message concernant la substitution... Avez-vous une idée du coût que celle ci peut représenter ?
Par ailleurs, la Suède distribue peu de seringues ; malgré tout, on y enregistre peu de contaminations par le Sida ou par d'autres épidémies. Or, la Suède a développé un programme de prévention qui semble efficace.
Enfin, existe t il des overdoses dues aux produits de substitution ?
Vous avez dit que les centres d'injection supervisés offraient des résultats sans doute limités du fait de populations restreintes. Il faut donc travailler sur des populations captives, en milieu carcéral, qui restent durant un certain temps à la disposition des professionnels de santé...
S'agissant du lien entre diminution du VHC et nombre d'injections, il faut rappeler que l'injection reste un risque majeur. Il existe un programme en cours de développement pour le crack avec pipes, cutter, etc., mais d'autres vecteurs favorisent la contamination.
Cette baisse s'explique aussi par le fait que les usagers de drogues peuvent changer de comportement et prendre les messages en compte. Les sorties spontanées de la toxicomanie sont une voie majeure, non que les traitements ne servent à rien mais l'usager, de lui même, peut être moteur.
Pour ce qui est des centres d'injection supervisés, la loi de 2004 est très différente de celle de 1970 et la France a démontré qu'elle pouvait s'en satisfaire.
Je ne suis pas juriste et je ne comprends pas que l'on mêle aux questions de réduction des risques les questions de légalisation et de dépénalisation. La France a bien montré, depuis quinze ans, qu'elle pouvait avoir une approche pragmatique de la réduction des risques. Il n'est pas nécessaire de créer des dispositifs ad hoc : on peut très bien implanter des centres d'injection supervisés au sein de structures existantes.
L'INSERM va au bout de la réflexion et évoque l'héroïne médicalisée pour les populations en échec de traitement de substitution ou très précaires, qui se l'injectent elles mêmes. Il s'agit là d'élargir la palette thérapeutique.
Le mésusage de traitements de substitution est documenté. Selon l'OFDT, en 2004, on en comptait 5 % et l'on pouvait aller jusqu'à 20 % avec des « intermittents de la substitution » : il s'agit d'usagers de drogues prêts à recourir à un traitement de substitution ou objets de rechute...
L'exemple de la Suède n'est pas transposable à la France : les normes sociales y sont très différentes.
Quant aux overdoses suivies de décès impliquant la méthadone et la BHD, les relations sont difficiles à établir s'agissant de poly consommateurs.
Enfin, oui, les centres d'injection supervisés connaissent de faibles résultats mais ils peuvent avoir un impact sur des scènes précises. Il faut donc que tous les acteurs se mettent d'accord.
Il existe des préconisations internationales pour fermer les centres...
Les centres ne semblent pas contraires aux traités mais, encore une fois, je ne suis pas juriste...