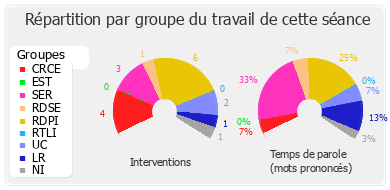Ce site est une archive.
Il reflète uniquement l'activité des sénateurs sur la période d'octobre 2004 à mars 2023.
Séance en hémicycle du 21 novembre 2023 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sophie Primas.

La séance est reprise.

Madame la présidente, lors du scrutin n° 56 sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ma collègue Samantha Cazebonne et moi-même souhaitions nous abstenir.

Acte est donné de votre mise au point. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution, sur les partenariats renouvelés entre la France et les pays africains.
La parole est à Mme la ministre.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, il est important de débattre dans cet hémicycle des relations que la France entretient avec les pays d’Afrique. Nous l’avions déjà fait le 6 juin dernier, et je me réjouis que nous le fassions de nouveau aujourd’hui. Il s’agit en effet d’une priorité de notre politique étrangère, et il est donc légitime d’y associer pleinement la représentation nationale.
Tout aussi légitimes sont les questionnements qu’ont pu susciter les différentes crises qui se sont succédé au Sahel. Je reviendrai plus en détail tout à l’heure sur notre action depuis dix ans concernant cette zone, mais je veux tout d’abord insister sur un point essentiel : l’attitude à notre égard de trois juntes militaires ne doit pas occulter les bonnes relations, je dirai même les très bonnes relations, que nous entretenons avec l’immense majorité des 54 pays africains. Ce serait une erreur grave que de réduire l’Afrique, qui est diverse et vaste, au seul Sahel.
Je commencerai par ce qui concerne nos relations avec la grande majorité des pays africains, donc par ce qui va bien, plutôt que par le Sahel.
Depuis 2017, sous l’impulsion constante du Président de la République, nous avons voulu renouveler notre politique à l’égard du continent africain, et ce renouvellement porte ses fruits.
Vous vous demandez peut-être, mesdames, messieurs les sénateurs, pour quelle raison l’Afrique constitue l’une des grandes priorités de notre diplomatie. La réponse réside dans un constat simple : c’est un continent qui émerge, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan démographique, bien sûr, avec une population qui dépasse déjà un milliard d’habitants. Celle-ci est même en passe de doubler d’ici à 2050 et de quadrupler d’ici à 2100, pour représenter le quart environ de la population mondiale.
Dans les années à venir, l’Afrique va compter de plus en plus dans les grands équilibres du monde, dans la croissance mondiale, dans la création, dans l’innovation. C’est aussi là que se joue l’avenir de la francophonie, et je parle d’un continent où vivent plus d’un million de Français, dans nos collectivités de Mayotte et de La Réunion, sans oublier nos 130 000 compatriotes qui résident dans des pays d’Afrique subsaharienne.
Parce que nous avons besoin de nos partenaires africains pour résoudre les grands défis qui nous attendent, pour la paix, pour la sécurité et pour l’adaptation au changement climatique, il est indispensable que la France noue des liens étroits, solides et confiants avec les gouvernements et avec les sociétés africaines.
Il y a encore quelques années, notre dialogue avec les pays de ce continent se limitait encore trop aux crises régionales qui l’affectaient.
Aujourd’hui, nous entretenons un dialogue étroit et exigeant sur l’ensemble de nos sujets d’intérêt commun : la guerre en Ukraine – nous en avons évidemment beaucoup discuté depuis un an et demi –, le climat, les forêts, la réforme de la gouvernance mondiale. C’est exactement ce que nous avons fait, en juin dernier, à Paris, lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, auquel ont notamment participé plus d’une vingtaine de chefs d’État africains.
Pour autant, la France est toujours aussi engagée pour aider à résoudre les crises du continent, en appui aux organisations régionales. Je pense en particulier aux terribles conflits dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan, où nous restons en contact avec les deux camps pour faciliter un processus de paix durable.
J’étais encore hier et ce matin avec mes homologues du Rwanda et de la RDC. Mais la France accompagne également le processus de sortie de crise en Éthiopie, un accord ayant été signé voilà un an. Je m’y suis ainsi rendue en janvier dernier, avec mon homologue allemande, Annalena Baerbock.
Nous pouvons également être fiers du chemin parcouru avec le Rwanda, grâce à un travail de mémoire honnête et à un engagement diplomatique volontariste, qui nous ont permis de relancer nos partenariats bilatéraux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, notre diplomatie a un objectif principal en Afrique : que la France soit un partenaire crédible, compétitif et également attractif, aussi bien pour les acteurs économiques, les étudiants et les artistes que pour l’ensemble des sociétés civiles.
Il faut le dire et le répéter : nos entreprises sont compétitives en Afrique. Elles le prouvent chaque jour. La France y est aujourd’hui le deuxième investisseur étranger. En quinze ans, le nombre des filiales d’entreprises françaises sur le continent a doublé, de même que nos investissements.
Nous aidons nos start-up, nos PME et les entrepreneurs de la diaspora à y investir, en finançant leurs projets ou en facilitant leur accès au marché africain. J’étais voilà trois semaines au Nigéria : dans cet immense pays de 216 millions d’habitants, qui sera bientôt le troisième le plus peuplé au monde, nous avons doublé nos investissements en dix ans. Il le fallait ; nous l’avons fait !
J’ai bien conscience que ce constat va à rebours de bien des idées préconçues. Les réflexes pavloviens et les images d’Épinal ont un point commun, que je déplore : ils voudraient nous faire croire que tout va forcément mal en Afrique et que la France est forcément à la traîne.
Pourtant, il faut bien se rendre compte que nos jeunesses, qu’elles soient françaises ou africaines, nous demandent de leur construire un monde plus juste, plus vivable, plus durable, et ce grâce à des partenariats. Elles ont raison. Il faut les écouter, car c’est pour elles que nous travaillons.
La réalité de notre politique en Afrique, c’est cette volonté d’investir dans l’avenir, dans les secteurs les plus prometteurs pour l’économie de demain. Il faut avoir à l’esprit que ce continent est le plus jeune du monde, quelque 60 % de la population ayant moins de 25 ans.
À cet égard, la priorité donnée aux industries culturelles et créatives est exemplaire. Depuis la bande dessinée jusqu’au jeu vidéo, en passant par l’e-sport ou la création d’univers immersifs, ces industries sont porteuses à la fois de croissance économique, d’émancipation individuelle et de renouvellement de nos imaginaires. C’est pourquoi elles ont un immense potentiel en Afrique. Et c’est pourquoi la France entend se situer comme une partenaire de référence avec les pays africains, qui sont déjà extrêmement prometteurs en la matière.
C’est ce que nous avons entrepris avec le premier forum international Création Africa, qui a réuni à Paris au début du mois d’octobre dernier des centaines de jeunes créateurs français et africains, dont j’ai pu moi-même admirer le talent.
Pour les accompagner, mon ministère a lancé cette année un fonds de 20 millions d’euros, afin que nos ambassades soutiennent directement les artistes et les créateurs du continent qui veulent développer leurs entreprises sur ce créneau des industries culturelles et créatives, tant régionalement qu’internationalement. Enfin, avec la future Maison des mondes africains, nous voulons que Paris devienne l’un des cœurs battants de la créativité africaine.
De manière plus classique, la France reste un partenaire crédible de l’émergence du continent africain par son investissement solidaire.
Depuis 2017, notre aide publique au développement est passée de 10 à 15 milliards d’euros annuels, avec plus de 5 milliards d’euros par an pour l’Afrique. Désormais quatrième bailleur mondial, notre pays a dépassé le Royaume-Uni. Nous sommes surtout le seul État à avoir augmenté ses financements en direction du continent africain l’an dernier.
Notre attractivité reste aussi très importante pour les étudiants africains, c’est-à-dire pour les élites du continent de demain. La France est leur première destination étrangère. Ils sont désormais près de 95 000 à faire le choix de nos universités, soit une augmentation de 40 % depuis 2017.
Je salue le travail remarquable qu’accomplissent nos ambassades, jour après jour, pour faire la promotion des études en France et pour attirer des étudiants anglophones en complément des étudiants francophones. J’ai pu en dresser le constat, en juin dernier, lors de mon déplacement en Afrique du Sud. Nous attirons ainsi en France beaucoup plus de jeunes qu’auparavant.
La France est aussi résolument du côté des démocrates africains. Cela ne signifie nullement donner des leçons ni s’ingérer dans les affaires intérieures : il s’agit d’aider les acteurs engagés de la société civile, comme la Fondation de l’innovation pour la démocratie, dirigée par le professeur Achille Mbembe, mais aussi tous les influenceurs et journalistes africains qui luttent contre la désinformation, pour une information fiable et de qualité, condition sine qua non de l’existence de sociétés ouvertes et démocratiques.
J’en viens à la question des visas, que vous aborderez sans doute. J’ai évidemment bien conscience des griefs classiques qui sont formulés autour de la délivrance des visas. Nous rénovons en ce moment même notre politique, pour mieux atteindre ensemble nos objectifs d’attractivité, de rayonnement et de prévention de migrations illégales, dans le cadre d’une feuille de route dont nous avons fixé les contours avec Gérald Darmanin, en nous inspirant du rapport fait par M. Hermelin.
Depuis les engagements pris par le Président de la République à Ouagadougou en 2017, réitérés au Sommet de Montpellier en 2021 et encore en février dernier dans son grand discours sur l’Afrique prononcé à l’Élysée, nous réinventons notre manière de travailler avec nos partenaires africains.
Nous voulons bâtir des partenariats respectueux, responsables, où chacun assume ses intérêts réciproques sans fard. Il faut que ces partenariats soient empreints de respect, d’écoute et de dialogue. Cela implique parfois de briser certains tabous, comme celui de la restitution des œuvres d’art, ou de regarder notre passé en face, comme nous l’avons fait avec le Rwanda ou avec le Cameroun.
Enfin, nous devons nous appuyer sur nos atouts, qui nous distinguent de nos voisins : je pense notamment au rôle de nos diasporas, mais aussi, alors que nous accueillerons en 2024 le Sommet de la francophonie – nous venons de reprendre le témoin à la conférence interministérielle de Yaoundé –, à cette belle langue française que nous avons en partage avec des millions et des millions d’Africains.
J’en suis convaincue, cette méthode est la bonne. Le Gouvernement la poursuit sans relâche depuis 2017, tous nos agents déployés sur le continent la mettant en œuvre avec détermination et conviction.
Cependant, j’en appelais tout à l’heure au devoir de lucidité. À ce titre, il faut donc aussi considérer ce qui se passe au Sahel, c’est-à-dire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, trois pays sur cinquante-quatre, j’y insiste, mais trois pays tout de même, trois relations complexes sur lesquelles je veux maintenant revenir.
Depuis dix ans, notre pays a consenti de très importants efforts, sur les plans militaire, financier, politique et diplomatique, jusqu’au sacrifice de nos soldats. Le ministre des armées s’attachera après moi à nous rassembler tous dans un hommage à nos forces armées, mais je veux en cet instant saluer la mémoire de ceux qui se sont battus pour nos valeurs et nos idéaux. Je les remercie de leur courage.
En 2013, à la demande des autorités maliennes et des pays de la région, le Président de la République, François Hollande, avait pris la décision courageuse d’engager nos forces armées. Nos militaires ont combattu le djihadisme avec bravoure, et ils ont contribué à éviter que le Mali ne devienne un État terroriste. Nous devons être fiers de ce qui a été accompli à cet égard.
J’entends parfois que nous aurions trop investi sur le volet militaire et négligé le développement et la diplomatie. Je vous le dis clairement : c’est faux !
Notre investissement pour le développement du Sahel depuis 2013 a été massif. Ce sont 3, 5 milliards d’euros d’aide bilatérale en dix ans, à 80 % sous forme de dons, qui ont été apportés à cette région. Entre 2012 et 2022, notre aide annuelle pour le Sahel a tout simplement doublé. Non seulement il n’y a pas eu de désengagement, mais il y a eu plutôt un renforcement de notre action. Aussi, que l’on ne dise pas que nous avons négligé le volet développement !
Parallèlement, la France a investi un capital diplomatique considérable, à Bruxelles, notamment, pour convaincre les Européens de se rapprocher de nos vues et de l’importance d’aider cette région. C’est ainsi que plus de 7 milliards d’euros d’aide européenne ont été apportés au Sahel depuis dix ans. Ils se sont ajoutés aux 3, 5 milliards d’euros que j’ai cités précédemment.
Il y a aussi eu l’intervention directe, y compris militaire, de certains partenaires européens, qui étaient jusqu’alors rarement présents en Afrique. Je veux citer notamment l’Estonie et la République tchèque, qui sont intervenues dans Takuba, ou encore l’Allemagne, dans la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). L’Alliance Sahel, quant à elle, nous a permis de fédérer vingt-sept bailleurs internationaux, qui ont investi comme jamais dans la région.
Nous avons également accru nos efforts diplomatiques auprès de l’ONU, pour créer la Minusma, puis renouveler chaque année son mandat. Au moment où les derniers Casques bleus quittent le Mali, dans des conditions extrêmement difficiles, et alors que 310 d’entre eux ont perdu la vie depuis 2013, je veux saluer le travail mené par cette mission des Nations unies.
Enfin, et surtout, pourrait-on dire, nous n’avons ménagé aucun effort pour convaincre les autorités maliennes de mettre en œuvre l’accord d’Alger, d’améliorer la gouvernance et de rétablir les services de l’État sur tout le territoire. En effet, s’il y a bien un enseignement à tirer de la crise au Sahel, c’est que la gouvernance est fondamentale. Les partenaires extérieurs que nous sommes, même crédibles, fiables et proches, peuvent aider, encourager et inciter, mais ils ne peuvent ni ne doivent se substituer aux autorités locales.
Aujourd’hui, les coups d’État survenus au Mali, au Burkina Faso et, dernièrement, au Niger, fragilisent tous les efforts consentis depuis 2013. La situation sécuritaire s’est dégradée ; la crise humanitaire est dramatique et les libertés et les droits de l’Homme reculent jour après jour. J’ajoute que le choix de Wagner, qu’a fait notamment le Mali, est celui de la prédation économique et des crimes de guerre, qui sont dûment documentés.
Contrairement à ce que voudrait nous faire croire leur propagande, ces juntes ne sont pas motivées par une volonté de rupture avec la France. Elles sont en réalité dans une logique de rupture avec l’ensemble de la communauté internationale, à commencer par leurs voisins, les organisations régionales, et jusqu’aux Nations unies. Ce n’est pas tant la France qui est visée que tout un système international de coopération et de valeurs que ces régimes récusent.
Pour ce qui nous concerne, face à de tels régimes, nous ne pouvons pas maintenir nos coopérations comme si de rien n’était. Nous ne pouvons pas poursuivre la lutte antiterroriste avec des putschistes. Nous ne pouvons pas financer des projets de développement qui les entretiennent. Bref, nous n’avons pas vocation à les entretenir dans leurs errements.
Bien sûr, nous maintenons notre aide humanitaire, pour ne pas faire payer aux populations les comportements de leurs dirigeants du moment. Contrairement à ce que l’on a pu lire ici ou là, nous maintenons nos coopérations avec les sociétés civiles, avec les étudiants et avec les artistes. Je veux le dire clairement : ils sont toujours les bienvenus en France. Nous tenons à maintenir ces liens.
Aujourd’hui, il est de notre responsabilité de prendre de la hauteur, pour examiner en toute lucidité la situation.
Toute la région est déstabilisée. Depuis notre retrait militaire du Niger, après dix années de lutte antiterroriste française au Sahel, les choses ne se sont pas améliorées, au contraire. Nous devons maintenant repenser collectivement l’architecture de sécurité dans cette partie du continent. Nous nous y employons avec les pays africains, ainsi qu’avec nos partenaires européens et notre allié américain.
Une chose est sûre, ce n’est plus à la France de porter seule, ou presque, la lourde charge de l’action antiterroriste en Afrique de l’Ouest. C’est aux pays de la région de fixer le cap et aux partenaires de les soutenir. La France prendra sa part, mais dans un cadre collectif.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de conclure, permettez-moi de réaffirmer haut et fort l’importance des relations entre la France et les pays africains. Nous mettons tous les moyens possibles au service de cette ambition. Ainsi, à la suite des États généraux de la diplomatie, j’ai pris des mesures pour renforcer le nombre de nos personnels sur le continent, dans nos chancelleries, dans nos services de communication et dans nos services d’action culturelle.
J’ai voulu également redonner des moyens financiers aux ambassades, via le Fonds Équipe France et le Fonds d’appui à l’entrepreneuriat culturel, évoqué tout à l’heure, pour qu’elles mènent sur place, sous l’autorité des ambassadeurs, de petits projets visibles, rapides et importants pour nos publics prioritaires.
J’ai aussi pris des mesures pour valoriser la filière africaniste au Quai d’Orsay, avec désormais un concours dédié et de nouvelles langues proposées aux épreuves, à savoir le peul, le haoussa, le mandingue et le wolof. Nous nous efforçons aussi de diversifier davantage le recrutement et d’attirer plus de talents issus de nos diasporas.
C’est avec un sentiment de profonde reconnaissance pour les agents de mon ministère qui sont déployés en Afrique que je veux conclure.
Ils travaillent parfois dans des conditions très difficiles. Quand nos ambassades sont violemment attaquées, comme à Ouagadougou ou à Niamey, quand il s’agit d’évacuer des civils sous le feu de la guerre, comme à Khartoum, dans tous ces moments de vérité, lorsque l’engagement professionnel implique des questions de vie ou de mort, ils savent toujours faire preuve d’un courage sans faille, d’un sens de l’État et d’un dévouement à toute épreuve. Qu’ils en soient remerciés !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Guillaume Chevrollier applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis d’avoir ce soir ce débat devant le Sénat, à la demande, notamment, de plusieurs de ses groupes politiques.
Il fait écho à l’engagement pris par le Président de la République devant les présidents des deux chambres et les chefs de partis réunis à Saint-Denis le 30 août dernier. Il permettra d’approfondir les fondamentaux de notre coopération militaire avec nos partenaires, d’en clarifier certains aspects, si besoin en était, et de faire un point sur leurs évolutions à venir. Nous aurons l’occasion de revenir sur certains points évoqués lors d’un autre débat, à la demande notamment du groupe SER, qui s’est tenu ici voilà quelques mois.
Je sais votre assemblée très mobilisée sur le sujet. Je connais l’engagement de votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui mène des travaux sérieux, hier sous la présidence de Christian Cambon, aujourd’hui sous celle du président Cédric Perrin.
Avant de revenir plus précisément sur la situation sécuritaire et, par là même, sur la question de la présence militaire française sur le continent africain, je pense utile de faire un court rappel historique et politique du sens de cette présence.
Il faut à la fois distinguer la nature de nos engagements militaires, dont certains reposent sur des accords de défense anciens, tenir compte des particularités qui distinguent chacun des pays où nos militaires ont été engagés, et préciser les menaces que nous avons combattues et que nous devons continuer à combattre.
On peut, au fond, distinguer deux grandes périodes depuis le début des années 2000, pour ne pas remonter plus avant et être ainsi trop long.
Tout d’abord, de 2000 à 2010, de nombreuses interventions françaises ont été menées dans le cadre de missions d’interposition ou de maintien de la paix sous l’égide des Nations unies. La plus connue est sans doute l’opération Licorne, avec la participation des forces armées françaises au maintien de la paix en Côte d’Ivoire.
Ensuite, la période de 2010 à 2020 a été marquée par la lutte contre les groupes armés terroristes au travers des opérations Serval et Barkhane au Sahel, qui ont été décidées courageusement par le Président de la République François Hollande, à chaque fois à la demande de nos partenaires au Sahel. Cette menace demeure ; nous y reviendrons.
Nous devons ensuite distinguer les géographies des théâtres d’engagement. Il n’y a pas une Afrique, mais autant de particularités qu’il y a d’États sur ce continent : nous ne pouvons pas comparer la lutte contre le terrorisme au Sahel avec celle qui est menée actuellement au Mozambique dans le Cabo Delgado.
De la même manière, on ne peut pas mettre sur le même plan l’Afrique francophone, anglophone ou lusophone, voire les diverses organisations régionales. Les différences sont parfois même infra-étatiques, mais je m’arrêterai là pour ne pas être trop long.
Il faut enfin discerner les différents types de menaces que nous combattons.
Premièrement, il s’agit de la piraterie et plus généralement des enjeux de sécurité maritime, dans le détroit de Bab el-Mandeb ou dans le golfe de Guinée. Je sais que le Sénat suit cela de très près : j’en veux pour preuve le rapport d’information consacré à la stratégie française dans le golfe de Guinée de mars 2023 des sénateurs Bernard Fournier, Gisèle Jourda et François Bonneau.
Deuxièmement, la France doit lutter contre les trafics de tous ordres : traite d’êtres humains, trafic de drogue ou d’armes.
Troisièmement, nous devons combattre la menace terroriste que j’évoquais à l’instant. Je ne reviens pas sur le bilan de Barkhane, auquel la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat a consacré un rapport d’information remis au mois de juin dernier et dont je salue les excellents auteurs, Pascal Allizard, Olivier Cigolotti et Marie-Arlette Carlotti.
Tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas lieu de remettre en question le succès militaire de l’opération, dont nous avons su tirer le principal enseignement sur le plan politique, à savoir ne pas nous substituer à l’action de nos partenaires, ou en tout cas pas sur une période trop longue.
Parmi ces menaces, celle qui est la plus susceptible de nous toucher directement et de déborder sur l’Europe est, bien entendu, la menace terroriste. Ses effets dramatiques sur les populations, en outre, peuvent représenter un enjeu migratoire. Ne nous leurrons pas : la reconstitution progressive d’un sanctuaire djihadiste au Sahel, sur le modèle jadis de l’Irak ou de la Syrie, peut faire peser à terme sur la région et sur l’Europe les mêmes menaces endogènes, projetées ou inspirées, que nous avons connues ces dernières années à partir d’autres théâtres.
Il est un principe qui caractérise les missions de combat de nos armées : c’est l’intervention. Jadis, nous aurions parlé de « logique expéditionnaire » ! En effet, les interventions n’ont par nature pas vocation à s’établir durablement sur un théâtre d’opérations, dès lors que le partenaire ne fait pas de la lutte contre le terrorisme une priorité.
C’est pourquoi nos soldats présents au Niger sont en cours de rapatriement vers la France. Nous aurons quitté ce pays avant la fin de l’année, comme le Président de la République l’a annoncé.
On peut alors légitimement s’interroger aujourd’hui, et nous l’avions fait dans cet hémicycle au début du mois de juillet dernier : fallait-il répondre présent lorsque nos partenaires africains nous ont appelés ? Pour ma part, je pense que oui, car la France ne pouvait laisser sans réponse l’appel à l’aide – pour ne pas dire l’appel au secours – des autorités autrefois légitimes de ces pays exposés à un péril plus qu’imminent.
Pourquoi partir aujourd’hui ? Parce que la France respecte la souveraineté des États africains : elle ne s’ingère pas dans les affaires d’un autre pays, quelle que soit la direction politique que prend celui-ci et même si nous ne pouvons que regretter cette orientation. Là encore, pas de double standard !
Nos objectifs sont clairs : lutter contre la menace terroriste islamiste, garantir la sécurité de nos ressortissants sur place et approfondir nos partenariats stratégiques d’intérêts communs, comme cela a été rappelé par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Je sais que ces objectifs sont aussi largement partagés par la plupart des groupes politiques représentés au Sénat.
La réarticulation entreprise depuis le début de l’année vise à renforcer l’attractivité de notre offre et la solidité de nos partenariats avec les États africains qui le souhaitent, en répondant aux grandes évolutions du moment, dans un environnement beaucoup plus compétitif qu’auparavant.
Avant de vous présenter cette réarticulation plus en détail, je veux vous présenter l’état actuel de notre présence militaire sur le continent africain.
Nous avons deux grandes familles de forces de présence.
Tout d’abord, nous disposons de deux pôles de coopération, au Sénégal et au Gabon. Ces bases ont des éléments prépositionnés depuis l’indépendance de ces pays et la conclusion des premiers traités de défense. Elles permettent l’accès à des infrastructures qui peuvent être utilisées à des fins militaires et proposent de nombreuses formations à ces partenaires, ainsi qu’à d’autres pays situés à proximité.
Les armements, sur ces bases, sont très limités et servent essentiellement, voire, exclusivement, à la formation.
Ensuite, d’autres bases disposent de capacités opérationnelles. Je pense aux forces prépositionnées en Côte d’Ivoire et à Djibouti. La base d’Abidjan regroupe un peu moins de 1 000 soldats et celle de Djibouti quasiment 1 500 militaires ; ceux-ci se sont encore illustrés récemment lors de l’évacuation de ressortissants français et européens du Soudan dans le cadre de l’opération Sagittaire.
Enfin, nous avons des bases de nature différente au Tchad, comme nous en avions jusqu’à l’été dernier au Niger. Nos forces avaient vocation à agir sur demande et en soutien des forces armées locales, dans le cadre d’opérations antiterroristes précises. Elles ont contribué à freiner l’expansion de la menace et menaient des actions de coopération et de formation des armées partenaires. C’est toujours le cas au Tchad.
Ces capacités de projection depuis l’Hexagone seront par ailleurs renforcées grâce à la loi de programmation militaire. Nous en avons déjà largement débattu ici même, avant votre vote l’été dernier.
La France est donc présente aux côtés de ses partenaires africains, lorsqu’ils le souhaitent, pour mieux assurer leur propre sécurité et en répondant à leurs demandes.
Certains d’entre eux, comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou le Gabon, par exemple, ont accompli des efforts remarquables dans la montée en puissance de leur appareil de sécurité ; c’est vrai tant pour leurs services de sécurité que pour leur armée. Ces pays ont obtenu de belles victoires sur le terrain face aux groupes armés terroristes.
Par ailleurs, et c’est un point central, nous faisons évoluer notre accompagnement en le renforçant à travers nos offres de formation, comme je l’avais souligné en juin, mais également d’un point de vue capacitaire et par le biais de notre réseau diplomatique de défense.
En matière de formation, tout d’abord, nos efforts ont ainsi porté sur nos capacités d’accueil en Afrique et au sein de nos écoles militaires françaises, avec l’objectif de doubler les places de formation : à la rentrée 2023, nous comptons déjà une centaine de places supplémentaires, d’ores et déjà attribuées à des sous-officiers et officiers africains.
En 2022, en outre, près de 3 000 stagiaires africains sont passés par notre réseau des Écoles nationales à vocation régionales (ENVR).
À l’appui de cette dynamique, 25 000 militaires africains ont été formés sur le continent depuis le début de l’année. Quelque 10 000 militaires français et africains suivent des entraînements conjoints, pour se former ensemble aux défis sécuritaires d’aujourd’hui et de demain. Nous poursuivrons ces missions communes. Nous tournons ainsi la page de la réduction de ces capacités, engagée depuis la moitié des années 1990 et accélérée dans les années 2000, pour y mettre enfin un terme.
D’un point de vue capacitaire, ensuite, je veux insister sur notre volonté de mobiliser davantage nos industriels et équipementiers, afin de fournir un accompagnement capacitaire moderne, mais adapté aux besoins de nos partenaires africains. C’est vrai pour le prix comme pour la nature des équipements, sans oublier les sauts technologiques pour les drones ou le cyber, envers lesquels les attentes sont importantes.
Le délégué général pour l’armement (DGA) s’est rendu sur le continent africain – une première depuis 1961, qui en dit long sur la relation sur ce terrain entre les différents pays d’Afrique et la France jusqu’alors. Les équipes pour l’Afrique ont été renforcées à cet effet.
En matière de diplomatie de défense, enfin, notre réseau en Afrique se densifie, en coordination avec la ministre Catherine Colonna : de nouveaux postes d’attachés de défense ont été ouverts au Rwanda, aux Comores, en Guinée-Bissau, ainsi que des postes d’attachés d’armement au Sénégal et en Côte d’Ivoire.
Au-delà de ces principaux axes d’effort, le volet renseignement est un élément essentiel que je ne puis développer ici dans le détail ; j’ai toutefois eu l’occasion d’informer la représentation nationale à l’occasion d’une audition devant la délégation parlementaire pour le renseignement, avec le directeur général de la sécurité extérieure.
Nous prendrons également soin de continuer à engager nos alliés en Afrique, en associant plus encore nos partenaires européens et américains à ces missions, comme la ministre l’a souligné.
Enfin, et j’en terminerai par-là, la France et ses partenaires africains sont liés par un honneur commun au combat et une singulière histoire partagée, que nous avons à cœur de faire vivre. Nous ouvrons une période mémorielle importante, qui mettra à l’honneur l’action de l’armée d’Afrique tout au long des commémorations de la Libération, avec, en 2023 et en 2024, le quatre-vingtième anniversaire de sa participation à la libération de la Corse, à la campagne d’Italie et, bien sûr, au débarquement de Provence.
Je veux ainsi conclure en rendant hommage à ces combattants d’Afrique tombés sous les couleurs de la France et pour la liberté aux côtés de leurs frères d’armes. Je pense également à nos soldats morts au Sahel, ainsi qu’à nos blessés et à leurs familles.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. André Reichardt applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. François Bonneau applaudit également.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, après le Mali, la République centrafricaine et le Burkina Faso, c’est aujourd’hui du Niger que nos forces armées sont sommées de se retirer.
En l’espace de quelques mois, ce sont dix ans d’engagement politique et militaire au Sahel, dix ans de lutte, pour laquelle 58 des nôtres ont sacrifié leur vie, qui ont été abruptement désavoués. En toile de fond, la montée du sentiment anti-français s’est accélérée, dépassant désormais le seul cercle des activistes et des désinformateurs.
Face à cette réalité qui sature médias et réseaux sociaux, c’est parfois au crépuscule africain de la France que nos compatriotes ont le sentiment d’assister. Et pour cause : notre retrait du Sahel est l’acmé d’un phénomène de reflux par lequel notre influence politique, diplomatique, économique ou culturelle n’a cessé de faiblir. Au fil du temps, les liens construits depuis les indépendances se sont distendus.
La raison en est que notre pays a désinvesti sa relation à l’Afrique. Il s’en est en quelque sorte éloigné, en démantelant par exemple son appareil de coopération technique, qui était pourtant un formidable levier de développement, d’influence et de présence au plus près des populations.
Toutefois, si la France a moins regardé vers l’Afrique, la réciproque est vraie ; car, tout simplement, l’Afrique a profondément changé. L’avènement d’une jeunesse nombreuse, largement urbaine et connectée, a transformé le visage du continent. Cette jeunesse est entrée de plain-pied dans la mondialisation ; pour elle, la France n’est plus qu’un partenaire potentiel dans la longue liste des pays qui portent désormais leur regard vers l’Afrique.
Reconnaissons au Président de la République le mérite d’avoir eu l’intuition qu’une bascule s’opérait. Dès 2017, il ambitionnait d’écrire une « nouvelle relation d’amitié » avec le continent. Pourtant, la réalité des années qui suivirent fut tout autre.
La montée en puissance de nos compétiteurs et la tendance de certains gouvernements à se défausser sur la France n’expliquent pas tout.
Ce sont bien les maladresses et les incohérences, les erreurs d’analyse et les stratégies illisibles, qui ont précipité la phase critique que nous connaissons aujourd’hui.
Dans ce contexte, le chef de l’État a proposé une stratégie désormais « partenariale ». Dont acte. Par la force des choses, cette évolution était de toute façon devenue incontournable. Mais, pour qu’elle porte ses fruits, encore faudra-t-il l’ancrer dans une approche pragmatique, fondée sur des constats lucides et des principes clairs.
Au rang des constats, admettons tout d’abord cette évidence : l’ère du monopole dont la France a bénéficié dans certains pays est terminée. Son rôle et sa place ne seront pas demain ceux qu’elle a tenus hier. Intégrer ce changement de paradigme, c’est comprendre que l’Afrique est devenue un espace de compétition à investir pour ne pas en être exclu.
C’est comprendre que la France doit s’adapter à la réalité d’une relation qui est non plus automatique, mais choisie, et qu’elle doit donc rompre avec cette attitude qui l’a conduite ces dernières années à osciller entre deux écueils : d’une part, la repentance, qui nous dévalorise ; de l’autre, l’arrogance, qui dévalorise nos partenaires.
Comment en effet présenter une image attractive de notre pays et construire une relation sereine si nous faisons nôtre la vision de ceux pour qui la France est une éternelle coupable et l’Afrique son éternelle victime ? Cette rhétorique ne peut mener qu’à l’impasse. Ne soyons donc pas naïfs et gardons à l’esprit que, bien souvent, elle est instrumentalisée au service d’agendas politiques qui n’ont rien à voir avec le devenir des Africains.
Citons simplement le cas du groupe Wagner. En exacerbant le narratif anti-Français, la compagnie russe ne vise aucunement à soutenir une quelconque affirmation des souverainetés africaines. Elle cherche à appuyer son déploiement en Afrique francophone, avec, en ligne de mire, l’affaiblissement de la France – bien sûr, en gagnant des positions stratégiques à son détriment, mais aussi en créant, par le pourrissement de situations sécuritaires déjà dramatiques, les conditions d’une nouvelle crise migratoire.
Moscou a parfaitement observé les effets déstabilisateurs sur l’Europe de tels phénomènes, ainsi que la prime électorale qu’ils offrent à des formations politiques réputées proches de la Russie.
À cet égard, si nous devons dénoncer les discours hostiles à la France, il nous faut aussi bien mieux les contrer. Notre réponse demain devra sortir des sentiers battus de la seule communication institutionnelle et trouver d’autres types de relais et de formats, davantage adaptés aux codes de la lutte informationnelle.
Pour autant, ne restons pas sourds aux reproches qui nous sont adressés ! Reconnaissons ainsi que le procès en condescendance ou en paternalisme, si souvent instruit à l’encontre de la France, n’est pas sans fondement. Le plus élémentaire respect dû à nos partenaires consisterait à ne pas prétendre savoir mieux qu’eux-mêmes la manière dont ils doivent gouverner ou se développer.
Nos conditionnalités politiques sont perçues comme un messianisme démocratique déplacé, qui plus est appliqué à géométrie variable. Elles sont vues comme une volonté de modeler les sociétés africaines à notre image, en imposant des valeurs qui ne sont pas toujours les leurs.
Face à des compétiteurs stratégiques pour qui ces questions n’ont aucune importance, notre attitude doit renouer avec davantage de réalisme, pour ne pas donner le sentiment que nous cherchons à faire l’Afrique à la place des Africains, ou pire, en dépit des Africains. Et c’est ce même réalisme qui doit nous amener à assumer que le principe d’un partenariat est avant tout de servir des intérêts mutuels.
Les contacts noués par notre commission confirment que les attentes sont d’abord économiques et que cette dimension doit être placée au cœur de nos relations.
Ces attentes concernent l’aide au développement, bien sûr, à condition que celle-ci puisse s’appuyer de nouveau sur un réseau de coopération et d’expertise technique à la fois dense et décentralisé.
Il est aussi nécessaire que notre aide soit concentrée sur les domaines fondamentaux qui font une véritable différence pour les populations : l’agriculture, la santé, l’éducation, l’accès à l’eau et à l’énergie, ou encore la construction d’un modèle de développement adapté aux effets déjà redoutables du changement climatique.
Surtout, les partenariats que nous bâtirons seront utiles s’ils permettent d’accroître les investissements de long terme dans les infrastructures et l’industrialisation. Ce sont des leviers essentiels pour permettre aux économies africaines de se diversifier et de créer de la valeur, mais aussi, sur un continent en pleine expansion démographique, pour développer un emploi de masse.
Dans cette perspective, l’État doit inciter nos entreprises à se projeter sur le marché africain. Il doit les accompagner pour s’adapter à la demande, mais aussi négocier des cadres leur permettant de s’implanter et d’investir pour produire ou coproduire avec les entreprises africaines.
Bien sûr, la France ne pourra rivaliser seule face aux volumes d’investissements, publics comme privés, que certains sont en mesure de mobiliser. C’est pourquoi elle devra développer des synergies avec d’autres partenaires, tout en cherchant à peser bien davantage sur l’orientation des fonds considérables décaissés par l’Europe.
Quant aux intérêts que notre pays peut trouver dans une relation forte avec le continent africain, s’ils existent, encore faut-il affirmer sans fard que nous cherchons à les défendre et à les promouvoir.
Ces intérêts sont d’abord politiques et diplomatiques. Oui, l’influence que la France exerce en Afrique participe de sa stature internationale, mais, plus globalement, elle prend une autre dimension au regard de la compétition stratégique actuelle.
Certaines puissances, cherchant à redessiner la carte des rapports de force, veulent créer une césure entre ce qu’elles appellent « l’Occident collectif » et le « Sud global ». Dans leur stratégie de basculement de l’ordre international, l’Afrique, futur poids lourd mondial dans de nombreux domaines et réserve importante de votes à l’ONU, tient une place centrale.
Notre coopération devra intégrer cette nouvelle donne, y compris en orientant notre aide au développement de manière plus politique.
Tourner le dos à l’Afrique, comme certains le suggèrent face aux difficultés du moment, est une option dont il faut prendre le ferme contre-pied. À rebours de cette approche, notre implication doit grandir.
Soulignons à cet égard que si l’Afrique francophone – c’est bien légitime – entend nouer des relations hors de toute coopération exclusive, nous gagnerions à suivre la même logique. En conséquence, accélérons l’élargissement de nos horizons en direction de toutes les Afriques, notamment anglophone et lusophone, qui constituent des pistes de partenariat très prometteuses.
Nos intérêts, ensuite, sont économiques. Le continent africain représente une part très faible de notre commerce extérieur. Mais, à terme, son expansion démographique et ses dynamiques économiques, que nous devons accompagner dès maintenant, en feront un gigantesque marché et un puissant relais de la croissance mondiale.
Ses ressources, en minerais essentiels à la transition écologique, par exemple, en feront un fournisseur stratégique de premier ordre.
Nos intérêts, enfin, sont stratégiques et sécuritaires. N’oublions pas que la géographie est têtue et que l’Afrique sera toujours voisine de l’Europe ; elle sera toujours un jalon sur la route qui nous relie à l’Indo-Pacifique et à certains de nos outre-mer. Ses instabilités et ses fragilités sont aussi les nôtres, lorsqu’elles suscitent des flux migratoires massifs dont l’Europe ne peut être le déversoir. Il nous faut légitimement les prévenir, les maîtriser et les endiguer.
La sécurité de l’Afrique est aussi la nôtre, lorsqu’elle met en jeu la lutte contre le djihadisme, aujourd’hui au Sahel, demain dans le golfe de Guinée, ou lorsqu’elle soulève des menaces contre nos 200 000 ressortissants établis sur place.
Dans ce contexte, notre coopération militaire reste essentielle. Elle devra néanmoins tirer toutes les leçons du piège politique et stratégique qui s’est peu à peu refermé sur l’intervention française au Sahel. Elle doit se concentrer avant tout sur le renforcement des forces africaines.
Nous pouvons y contribuer notamment au travers de formations et d’échanges étoffés ou par la fourniture de capacités de renseignement et d’équipements militaires, adaptés aux besoins et aux moyens de nos partenaires.
Notre action bilatérale devra rechercher une forme de symbiose avec les initiatives entreprises par les organisations régionales, pour définir l’architecture de sécurité globale qui fait encore défaut au continent.
Quant à nos bases militaires, elles demeurent fondamentales. L’actualité l’a montré : leur existence n’est envisageable qu’avec le plein soutien des États qui les accueillent. Mais ne désertons pas ce champ essentiel à la sécurisation de nos intérêts et, quoi que l’on en pense, à notre influence.
Je suis bien évidemment ouvert à la définition de nouvelles modalités de travail de ces bases et à l’élargissement de la palette de leurs activités. J’ai en revanche plus de mal avec le principe de leur cogestion, car si leur maintien relève d’un choix africain souverain, n’oublions pas qu’elles sont un morceau de France. Leur gestion ne peut relever que d’une seule souveraineté : celle de la France.
Face au nouveau monde qui se dessine, face à la nouvelle Afrique qui advient, l’heure est peut-être à l’introspection, mais pas au doute ; au changement, mais pas à l’effacement. Au contraire, tout nous incite à refaire de l’Afrique la priorité de notre politique extérieure et à redoubler d’efforts pour adapter notre action et démontrer sa valeur ajoutée face à celle, bien souvent prédatrice, de nos adversaires stratégiques.
Au cours de l’année à venir, notre commission prendra toute sa part à cette entreprise, en conduisant un ambitieux programme de travail sur l’Afrique. Sur ce sujet, nombre de ses recommandations faites par le passé se sont révélées pertinentes. Elles auraient permis, si elles avaient été suivies, d’éviter certaines erreurs. Je me permets donc, madame la ministre, de prendre un peu d’avance en invitant dès maintenant le Gouvernement à s’inspirer de ses travaux à venir !
D’ici là, comme il n’y a pas d’influence sans présence, renouons nos liens de proximité dans tous les domaines.
Réinvestissons notre coopération technique, en densifiant notre réseau diplomatique, en stimulant notre présence économique et nos échanges culturels et en préservant notre dispositif militaire.
Affirmons que l’Afrique est l’intérêt de la France, et prouvons que la France est l’intérêt de l’Afrique. Alors, nous pourrons enfin projeter nos relations dans le XXIe siècle – celui de tous les risques, mais aussi celui de toutes les opportunités.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les coups d’État au Mali, puis au Burkina Faso, le putsch qui a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier, contraint la France à revoir de fond en comble sa politique à l’égard de l’Afrique et les conditions de sa présence dans la région.
Certes, le désamour de la France n’est pas nouveau ! Mais, dorénavant, dirigeants et opinions publiques africaines l’expriment de plus en plus bruyamment.
À Bamako, à Kinshasa, Dakar ou N’Djamena – c’est-à-dire dans les limites du pré carré des anciennes colonies françaises ou de l’espace francophone, comme en République démocratique du Congo – un faisceau de raisons complexes explique notre perte d’influence, voire, le rejet de la France.
Partout, le ressentiment est vif ! L’Afrique veut prendre ses distances avec la France.
Déjà en 2017, à Ouagadougou, le président Macron avait proclamé la fin de la Françafrique, comme nombre de ses prédécesseurs l’avaient fait avant lui. Pourtant, nous avons continué à surfer sur nos relations anciennes, fondées sur notre histoire coloniale.
« Aucun président français sous la Ve République n’a pu se départir d’une forme de paternalisme arrogant » : c’est ce qu’a récemment déclaré un responsable politique africain. En effet, je pense que la France n’a jamais pu accepter que ses anciennes colonies soient désormais indépendantes et n’a jamais su, ou voulu, les traiter en conséquence.
Emmanuel Macron a tenté de faire bouger les lignes. Il a ouvert plusieurs chantiers : restitution d’œuvres d’art, travail de mémoire, réforme du franc CFA ou initiatives sur la dette, mais il n’y est pas parvenu. Le 27 février dernier, le Président de la République a prononcé un nouveau discours, qui, de nouveau, se voulait fondateur, mais dont les objectifs restent encore flous.
Nous en attendons donc une clarification ; nous n’avons pas bien saisi les contours de celle que vous avez esquissée dans votre déclaration liminaire, madame la ministre.
Aujourd’hui, c’est d’abord la présence militaire française en Afrique qui pose problème. Nous devons changer de modèle. Le Président de la République l’a affirmé : l’influence de la France ne se mesurera plus au nombre de nos bases ou de nos opérations militaires.
Cependant, nous avons toujours quatre bases permanentes sur le continent, lesquelles accueillent plus de 3 000 soldats français et assurent une présence continue depuis les indépendances. Nous sommes donc très loin d’un retrait de l’armée française de ses anciennes colonies. Certes, il serait démagogique de laisser penser que tout cela peut se faire en un jour, j’en suis consciente.
Les états-majors et les officiers sont d’ailleurs très favorables au maintien de nos soldats sur le continent africain. Ils sont très attachés à cette terre, qui est saluée comme un théâtre d’entraînement exceptionnel. Cependant, les temps ont changé ! Les Africains n’en veulent plus ou, du moins, ils en veulent moins.
Nous devons nous interroger sur l’utilité de ces bases. Quel est leur rôle ? Sont-elles là pour protéger les Français et les binationaux, ou pour protéger les chefs d’État adoubés par la France – pour leur offrir une assurance vie en quelque sorte, comme ce fut le cas par le passé ?
Ces dernières années, c’est la lutte contre le terrorisme qui a justifié la présence française, notamment au Sahel. Je tiens de nouveau à rendre hommage à l’engagement de nos soldats lors des opérations Serval et Barkhane. Nous avons limité la casse et éliminé d’importants chefs terroristes, ce qui n’est pas rien. Il est évident que nous avons connu des succès, d’un point de vue militaire.
Toutefois, nous n’avons pu endiguer l’avancée des groupes djihadistes – il faut dire que nous étions assez seuls… Le mouvement descend maintenant vers les pays côtiers : la Côte d’Ivoire et le nord du Ghana, du Togo et du Bénin font l’objet d’attaques récurrentes.
L’enlisement d’une vaine solution militaire et la multiplication des problèmes politiques et sociaux ont retourné progressivement l’opinion publique malienne contre la présence française.
Au fil du temps les libérateurs sont devenus des occupants. Les acteurs locaux en ont profité pour présenter leur coup d’État comme une libération du colonisateur.

Ce ne fut donc pas un échec militaire, mais bien un échec politique : celui de ne pas avoir su partir à temps et de ne pas avoir cherché des solutions alternatives à ces conflits extrêmement meurtriers.
Si elle reste en l’état, la présence militaire va compliquer toute tentative d’amélioration de l’image de la France. Si, comme le Président de la République le dit, elle doit être moins visible, il serait utile, monsieur le ministre, d’en débattre avec le Parlement.
Un autre symbole de la domination française est le franc CFA. Soixante-quatorze ans après sa création, il fait toujours l’objet de multiples critiques : instrument de stabilité pour les uns, vestige colonial lié aux élites pour les autres. Son existence même prouve que le processus de décolonisation n’a pas été achevé. La promesse de 2019 de réformer le franc CFA doit aboutir.
Cependant, au-delà de la sortie du franc CFA, la question qui se pose est celle de la monnaie dont les pays africains ont besoin pour transformer leur économie et leur société. Cette monnaie devrait avant tout être servir le crédit, l’emploi et l’écologie de ces pays, et non pas être livrée à tous les vents de la spéculation.
Il est temps de permettre aux Africains de décider de la ligne politique et économique qu’ils souhaitent suivre. Ils veulent une rupture franche, vous le disiez, madame la ministre, avec un Occident vieillissant. Ils regardent désormais vers d’autres partenaires, comme les Brics – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.
L’Afrique veut être considérée comme un acteur de plein droit sur la scène internationale. C’est un défi géopolitique majeur, que le Président de la République a pointé du doigt et qu’il convient de traduire dans les faits.
Depuis six ans, Emmanuel Macron prétend s’adresser à la jeunesse et à la société civile, et il a vu juste ! Or il a continué à s’afficher aux côtés des représentants de la Françafrique, ces dinosaures ou leurs successeurs dynastiques. Peut-être les croit-il garants d’une stabilité illusoire ?
La France prétend soutenir les démocraties, mais elle n’est pas toujours regardante quant à la gouvernance : on condamne le pouvoir militaire au Mali, on l’accepte au Tchad ! Au fil du temps, ce double langage nous a fait perdre toute crédibilité. Aux yeux des Africains, la France doit rester fidèle à ses valeurs : le respect des droits humains, le droit des peuples et l’universalisme.
Sur ce point, que dire de notre politique de l’immigration et l’attribution des visas, qui a suscité d’immenses frustrations à l’égard de la France, particulièrement de la part des jeunes ? Les empêcher de rendre visite à leur famille, de faire un stage ou de suivre une formation, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, ne rime à rien et ne permettra certainement pas de juguler l’immigration illégale ! Si l’on veut engager une nouvelle relation avec l’Afrique, il faut revenir à une politique des visas plus ouverte.
La contestation anti-française s’est répandue parmi la jeunesse – une jeunesse moins scolarisée, plus perméable aux manipulations et à laquelle les dirigeants n’ont rien d’autre à proposer que cet os anti-français à ronger.
Cet os, c’est également celui que proposent en Afrique de l’Ouest certaines élites religieuses, qui s’attaquent à la France et à ses valeurs laïques.
La société civile africaine a changé, et nous n’avons pas compris qu’une époque s’achevait à nos dépens. Être à l’écoute des populations, c’est comprendre leurs aspirations. À titre d’exemple, le refus de la France de soutenir la proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud de suspendre temporairement les droits de propriété industrielle sur les vaccins pour lutter contre la covid-19 nous a discrédités et placés du côté des égoïstes.
L’Afrique subsaharienne est la région où la démographie connaît la plus forte croissance. Quelque 30 millions de jeunes travailleurs arrivent chaque année sur le marché du travail, mais seuls 10 % à 15 % d’entre eux trouveront un emploi.
Par désœuvrement, certains rejoindront des sectes islamistes. Beaucoup seront condamnés à vivre dans l’extrême pauvreté. L’ONU est consciente de la crise humanitaire qui se prépare : selon cette organisation, « si la tendance actuelle se poursuit, en 2030 l’Afrique abritera plus de la moitié des personnes qui souffrent de manière chronique de la faim dans le monde ».
L’Agence française de développement (AFD) est le principal outil de notre politique de solidarité internationale, mais elle prend trop souvent la forme de prêts et pas assez celle de dons. De ce fait, elle ne parvient pas à capter les véritables enjeux.
On constate d’ailleurs la persistance des problèmes de santé et de malnutrition, les faibles progrès de la scolarisation ou de la lutte contre la marginalisation des femmes.
C’est pourquoi nous devons faire de nos ONG les partenaires privilégiés de nos actions de solidarité : non seulement elles sont actrices, mais, par leur expérience et leur expertise, elles ont la capacité de participer à la définition et à la mise en œuvre de notre politique.
Pourtant, on les a mises en danger ! Au Sahel, on a ressorti du placard la coopération civilomilitaire, avec l’idée que le développement et la sécurité dépendaient l’un de l’autre. C’est faux et dangereux. Nous l’avons théorisé dans la stratégie 3D – diplomatie, défense, développement –, qui a échoué et qu’il convient de définitivement abandonner.
De la même façon, nous avons assisté à l’effacement de la diplomatie française au profit du sécuritaire – cela a été souligné tout à l’heure. C’est la même erreur ! Cette vision sécuritaire ne peut plus être la nôtre.
Depuis lors, une digue a cédé. À l’issue des coups d’État au Sahel, le Gouvernement a décidé de suspendre l’aide au développement. Suspendre toute coopération avec un gouvernement est une chose, arrêter les projets menés par les ONG en est une autre !
Désormais, le ministère veut traiter les dossiers « au cas par cas ». Un double standard s’installe donc : ceux qui seraient dignes de la coopération et ceux qui ne le seraient pas. Sur quels critères allez-vous décider d’abandonner des populations particulièrement vulnérables et de les replonger dans l’extrême pauvreté, madame, monsieur les ministres ? Près de 9 millions de personnes sont concernées.
Qui décide ? On ne sait pas ! En tout cas, ce ne sont certainement pas les parlementaires, ce qui pose un problème de démocratie. On sait en revanche que ce sont les ONG de terrain qui devront, par exemple, annoncer aux 5 000 femmes des organisations paysannes produisant du beurre de karité au Burkina Faso que c’est désormais fini ! Pensez-vous que cela va améliorer l’image de la France ?
En inféodant ainsi les enjeux de développement à la politique étrangère de la France, je crains que les acquis de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dont nous sommes les garants, ne soient menacés à la fois dans l’esprit et dans la lettre. Nous appelons donc à sanctuariser l’aide publique au développement (APD), qui n’a qu’un seul objectif : répondre aux besoins fondamentaux où qu’ils soient et quels qu’ils soient.
Dans cette même loi du 4 août 2021, la France a pris un engagement clair : allouer 0, 7 % du revenu national brut à l’APD à l’horizon de 2025. Cette trajectoire doit être maintenue, pour soutenir prioritairement les dix-neuf pays les plus pauvres.
Que dire en conclusion ? Que jusqu’à présent le Président de la République a échoué à engager un véritable renouveau qu’il a pourtant souhaité. Il répète rituellement qu’il n’y a pas de politique africaine de la France – si c’était vrai, il ne serait pas obligé de le répéter !
Notre politique africaine s’effondre au profit de nouveaux partenaires. Les nouvelles générations ne veulent plus des effets nocifs de la dépendance. Elles souhaitent tisser avec le reste du monde des relations qui libèrent.
La France doit-elle pour autant se résigner à abandonner l’Afrique ? Certainement pas ! Le désengagement de la France serait catastrophique pour la défense de nos intérêts, ceux de l’Europe, mais, surtout, ceux de l’Afrique elle-même. La Russie et la Chine en tireraient immanquablement les bénéfices en y pillant par ailleurs les ressources.
La politique de la France au Sahel et en Afrique doit être révisée en profondeur. Nous devons sortir de notre isolement, donner une dimension européenne à nos relations avec les pays d’Afrique et inscrire notre action dans le cadre de leurs propres priorités.
Alors, non, n’abandonnons pas l’Afrique, mais trouvons un chemin entre le renoncement et l’acharnement !
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la ministre, vous avez souhaité organiser un nouveau débat sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution. Le groupe Union Centriste forme le vœu que ce débat puisse être utile et ne soit pas, une nouvelle fois, l’occasion d’écouter les différents groupes parlementaires sans prendre en considération les opinions qu’ils expriment.
Que de travaux des groupes d’amitié, que de rapports d’information émanant des commissions, que de colloques organisés ici, au Sénat ! Tous soulignent, au travers de témoignages précis, des événements que nous aurions pu mieux anticiper, plutôt que, trop souvent, les subir, notamment en Afrique de l’Ouest.
Au nom de notre groupe, je vous invite, madame la ministre, à mieux prendre en considération la diplomatie parlementaire, qui, vous en conviendrez, est la parente pauvre de notre diplomatie.

J’en viens maintenant au cœur du sujet qui nous réunit ce soir. La France et le continent africain sont liés par une histoire particulière. Soulignons au passage que l’avenir de la francophonie passe par le continent africain.
L’Afrique se trouve au carrefour d’un grand nombre de débats qui nous animent, en particulier sur le réchauffement climatique et l’explosion démographique. Sur ces deux sujets d’ampleur, la France a la capacité de jouer un rôle important.
Le réchauffement climatique est un défi planétaire pour la survie de la population mondiale. Il y a urgence à agir, et cela passe notamment par le défi énergétique.
À l’heure où nous parlons, l’Afrique est le continent le moins électrifié de la planète ; il y a urgence à travailler cette question. Même si l’on peut constater une hausse de l’accès à l’électricité, elle ne se traduit pas nécessairement par le développement de grandes infrastructures de production et de diffusion.
L’accès à l’électricité est généralement corrélé au développement économique des territoires. Ainsi, les pays ayant le moins accès à la ressource énergétique sont ceux dont les populations sont les plus pauvres. L’électricité permet à l’inverse le fonctionnement d’usines, de centres de soins et de chaînes de froid et facilite l’accès à l’éducation, à l’information et au développement des projets.
Pourtant, les capacités en Afrique sont proches des moyennes mondiales. Un soutien français serait bénéfique pour aider les États intéressés à développer leurs infrastructures. Actuellement, certaines régions souffrent de coupures fréquentes, en raison du manque d’entretien des réseaux, de leur non-rentabilité et de connexions sauvages. Par exemple, le Nigéria connaît vingt-cinq coupures d’électricité par mois. Pour pallier cela, la moitié de la population nigériane dépend de générateurs électriques, plus polluants, mais plus fiables que le réseau classique.
Une fois ce constat dressé, comment agir ?
La France et l’Union européenne doivent aider l’Afrique à lutter contre le réchauffement climatique en l’accompagnant dans la création de sa propre électricité, car elle dispose d’importantes ressources permettant de constituer un mix énergétique vertueux.
Le nucléaire a sa place en Afrique. Le Ghana, le Nigéria, le Soudan et le Kenya sont désireux d’en bénéficier. Il revient à la France de se montrer compétitive en la matière, pour lutter face à la Chine et à la Russie notamment, à l’heure où 20 % des réserves d’uranium se trouvent sur le continent africain.
D’ailleurs, il est crucial d’aborder la question des ressources nécessaires aux industries du futur et à la décarbonation. Le graphite, les terres rares, le cuivre, l’aluminium et la platine sont des éléments essentiels pour les technologies vertes contre le réchauffement climatique. Sachant que la Chine domine actuellement la fourniture de ces ressources, la France et l’Europe font face à une dépendance stratégique préoccupante. Diversifier nos sources d’approvisionnement et établir des partenariats équilibrés avec les nations africaines riches de ces matières premières devient impératif.
Ce processus nécessite une coopération économique et un engagement à garantir que l’exploitation de ces ressources respecte les normes internationales. En renforçant ces partenariats, la France peut sécuriser son approvisionnement tout en contribuant au développement durable de l’Afrique.
L’hydraulique est également un axe intéressant pour la fabrication d’une électricité propre : le Nil, le Congo, le Niger et le Zambèze sont autant de vecteurs qui pourraient produire de l’énergie couvrant la plupart des besoins du continent.
Le potentiel le plus prometteur réside bien entendu dans l’énergie solaire, notamment en Afrique subsaharienne, la région la plus ensoleillée au monde. La France doit mettre à disposition son savoir-faire pour soutenir des projets de centrales photovoltaïques dans ces régions. Il faut également organiser l’acheminement de cette énergie et son stockage à terme.
Le solaire et l’éolien représentent seulement 2 % du mix énergétique de l’Afrique subsaharienne. La capacité de progression est donc immense.
La diffusion de l’électricité constitue un enjeu majeur, allant au-delà de sa production. Actuellement, les réseaux électriques se concentrent principalement sur les capitales africaines et leurs environs immédiats, négligeant les 63 % d’Africains vivant en dehors des villes. La ruralité est ainsi souvent laissée de côté.
Avec l’Union européenne, nous devons mettre des moyens ciblés sur l’électrification et les réseaux d’eau et d’assainissement de ce continent pour accompagner les besoins des habitants et, ainsi, éviter de voir partir une bonne partie de la jeunesse sans perspective dans son pays, ce qui serait l’un des mouvements de population les plus massifs de l’histoire de l’humanité.
J’en viens au second choc qu’aura à affronter l’Afrique : son explosion démographique.
Dérèglement climatique et dérèglement démographique sont souvent liés, les populations notamment victimes de sécheresse sont condamnées à partir, ne pouvant plus assurer leur subsistance. Dans moins de trente ans, l’Afrique comptera près de 2 milliards d’habitants, le Nigéria devenant le troisième pays le plus peuplé au monde en 2050. Le défi démographique et humain, souvent sous-estimé, est particulièrement complexe. Exacerbé par les conditions climatiques difficiles du continent, il représente un immense défi pour l’Afrique et, par extension, pour le monde entier.
La croissance démographique rapide pourrait rendre le continent inhospitalier en raison du réchauffement climatique et du manque de ressources alimentaires disponibles. Il est impératif d’agir et de soutenir l’Afrique.
La France et a fortiori l’Union européenne doivent soutenir les États africains dans l’accompagnement économique, logistique, médical et humain, pour combiner développement et amélioration du niveau de vie.
Ce faisant, associée à une offre éducative de plus grande ampleur, la croissance démographique se rapprochera de celle des autres pays du monde et contribuera à la croissance du PIB et à l’amélioration du niveau de vie.
L’Afrique est le continent de tous les risques et de tous les possibles du prochain demi-siècle. La France, en raison de sa proximité, peut et doit l’accompagner dans un avenir dont les Africains doivent eux-mêmes définir les contours. Ce n’est surtout pas à nous de le faire ; c’est bien à eux de le construire.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, au mois de février dernier, le Président de la République affirmait : « Nous avons un destin lié avec le continent africain. » Les États africains sont confrontés à d’immenses défis. S’ils ne trouvent pas de solutions, la France et l’Europe en subiront aussi les conséquences.
Les effets du dérèglement climatique ne font que commencer à se faire sentir. Ils aggraveront sans nul doute les crises auxquelles ces pays font déjà face.
Avec une abondance de terres arables et de minerais, le continent africain dispose de solides atouts. Pourtant, la majorité des économies africaines connaissent une croissance économique insuffisante. Parfois tragique, cette situation ne peut nous satisfaire.
Les causes sont multiples, mais l’absence de sécurité est un facteur clé. Elle décourage bien sûr les investisseurs, aussi bien locaux qu’étrangers. Elle entraîne également des surcoûts qui nuisent à la rentabilité, qu’ils soient liés au besoin de protection ou bien à la réparation des dégradations.
S’y ajoute le caractère très perfectible des réseaux d’infrastructures. Encore dégradés par l’insécurité, ils pèsent eux aussi sur la croissance économique.
Les pays européens, notamment la France, bien entendu, entretiennent des relations particulières avec les pays africains. Pour des raisons historiques, mais aussi géographiques, nous devons veiller à les préserver et à les améliorer.
Le renouveau de nos relations a été engagé par le Président de la République au début de cette année. Nous nous félicitons de ses orientations.
En effet, cette évolution était plus que nécessaire. La France a fortement œuvré pour la sécurité du continent, particulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Malheureusement, 53 de nos soldats sont tombés au cours de ces combats et bien d’autres ont été blessés. Nous n’oublions pas leur sacrifice et nous rendons hommage à leur engagement, en ayant une pensée pour leurs familles.
Notre pays a été bien mal récompensé de ses efforts. Succombant à des putschs alimentés par la désinformation russe, certains gouvernements ont demandé le départ de nos forces.
Ces revers ne signifient pas pour autant que nous devons nous désintéresser de la sécurité du continent africain. Nous restons convaincus qu’elle a des incidences directes sur la sécurité de la France et sur celle de nos partenaires européens.
Dans les pays avec lesquels nous continuons de travailler, il est nécessaire de réduire l’empreinte de nos forces, afin d’éviter d’apparaître comme une force d’occupation, ce que nous ne sommes pas.
La France dispose d’une très longue expérience des conflits. Nous savons que la force militaire ne suffit pas à elle seule à les résoudre. Parvenir à des compromis politiques est nécessaire. Au plus près des forces locales et des populations, nous croyons que le développement de coopérations, y compris internationales, sera d’une grande efficacité pour y parvenir.
La France peut conseiller, elle peut contribuer, mais il ne lui revient pas d’assumer la sécurité du continent africain. Cette tâche incombe nécessairement aux gouvernements locaux.
Dans le domaine économique, l’approche impulsée par le Président de la République nous semble également cohérente et pertinente.
Cohérente, tout d’abord, car elle correspond aux travaux menés en matière d’aide au développement, abandonnant une démarche d’assistance pour aller vers l’investissement constructif.
Pertinente, ensuite, car les logiques de prédation nous paraissent archaïques et inefficaces.
Avec ses méthodes, Pékin s’est proposé d’améliorer les infrastructures de plusieurs pays africains dans le cadre des nouvelles routes de la soie. En ne demandant pas de contrepartie politique et en mettant à profit une main-d’œuvre bon marché, les entreprises chinoises ont remporté bon nombre de contrats.
Le Sud, prétendument global, s’est quelque peu lézardé à la découverte des micros au siège de l’Union africaine construit par la China à Addis-Abeba… Le piège de la dette chinoise a achevé de refroidir les angélismes.
Nous ne sommes pas pour autant dispensés de faire évoluer nos relations avec les pays africains. Elles présentaient des vulnérabilités qui ont été exploitées par nos rivaux.
Nos partenaires africains attendent légitimement d’être traités en égaux. Parallèlement, nous pensons que la France doit assumer de rechercher son intérêt dans ses relations avec les pays africains tout comme avec ses autres partenaires.
Dans les années à venir, l’économie africaine sera l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale. Les défis de l’éducation, de la santé ou encore de la transition énergétique sont autant d’occasions de développement pour nos entreprises. En s’attachant à des projets concrets et précis, ancrés au sein des sociétés civiles, nous pouvons faire progresser les deux économies de nos deux continents.
Nous conservons d’importantes marges de progression : moins de 5 % de nos importations sont destinées à l’Afrique. Elles n’ont pas progressé aussi vite que l’économie africaine dans son ensemble.
Réussir ces nouveaux partenariats implique d’accorder une attention particulière à l’information, notamment à la désinformation. Notre pays est régulièrement visé par des attaques de désinformation, qui portent une atteinte grave à notre réputation. Nos réussites sont insuffisamment mises en valeur, alors que nous sommes aisément désignés comme coupables.
Le ministère des armées en sait quelque chose. L’affaire du charnier de Gossi a fait l’objet d’une réponse rapide et adaptée. Elle rappelle que nous devons collectivement être très vigilants quant aux manipulations de l’information. Afin de mieux faire connaître ce que nous faisons et ce que nous ferons, il nous faut développer nos capacités de communication.
L’audiovisuel, qui bénéficie de fonds publics, doit travailler en ce sens, afin de ne pas laisser le champ libre à nos compétiteurs.
Dans la nouvelle ère qui s’ouvre, nous devons prendre garde à ne pas alimenter les rumeurs qui nous accusent de tenir un double discours. Nous devons continuer à soutenir la démocratie. Celle-ci a d’ailleurs beaucoup progressé depuis les années 1970, au cours desquelles la quasi-totalité des pays africains étaient autocratiques. Même lorsque les gouvernements s’écartent de la démocratie, nous souhaitons que la France continue de travailler avec les populations.
Accompagner le mouvement démocratique n’est pas seulement un impératif moral. C’est également une nécessité pratique, puisqu’il s’agit du régime de gouvernement le plus efficace à long terme.
Par des projets modestes, en lien avec la société civile, la France peut œuvrer pour son bénéfice et celui de ses partenaires.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, depuis de nombreux mois, certains entonnent un refrain selon lequel la France ferait l’objet d’un désamour de la part de l’Afrique. Je crois qu’il n’en est rien
Marques d ’ ironie sur les travées du groupe SER.

Ce débat, le Président de la République l’a souhaité le 30 août dernier, un mois après le putsch mené au Niger contre le président Bazoum, répliquant les coups d’État menés au Mali et au Burkina Faso.
Abordons la question du Sahel dès maintenant, pour évoquer ensuite l’Afrique tout entière, qui ne saurait se résumer à ces arpents de sable sur lesquels 58 enfants de France ont payé de leur vie la lutte contre le terrorisme et la protection des populations. Permettez-moi ici de leur rendre hommage, ainsi qu’à leurs familles.
Leur sacrifice n’a pas été vain, n’en déplaise aux Cassandre de tout poil. Serval et Barkhane ont permis qu’aucune capitale ne soit prise par les factions islamistes et qu’aucun pays ne devienne un autre califat. C’est en gardant cela en mémoire qu’il faut examiner la situation actuelle.
La multiplication des putschs dans la zone sahélienne est-elle la remise en cause de l’action de la France ? Non. Ces coups d’État sont avant tout dirigés contre leurs dirigeants, leurs constitutions et leurs institutions.
Alors que la vie quotidienne est encore plus difficile pour les populations sahéliennes, madame la ministre, nous devons maintenir des liens humains forts avec les sociétés civiles – je pense ici à la problématique des visas –, tout comme avec les acteurs de terrain que sont les ONG, ces véritables partenaires, avec un ancrage résistant aux aléas politiques.
Pour autant, dans ce nouveau paysage politique, militaire et stratégique, faut-il renoncer à tout ? Renoncer, non ; reformater, oui. Le temps est venu de repenser notre empreinte militaire et sécuritaire. Nous sommes là pour faire non pas « à la place de », mais, le cas échéant, « à la demande de » et « avec ».
Nous pouvons aussi faire beaucoup pour le renforcement des capacités des unités locales, par la formation notamment. Je pense au rôle joué par les multiples ENVR, les écoles nationales à vocation régionale, rôle qu’a rappelé M. le ministre. Étudions aussi le succès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT), à Abidjan, que vous avez visitée, je crois, madame la ministre, voulue par le président Alassane Ouattara, exemple d’un partenariat réussi entre Côte d’Ivoire et France, étendu ensuite à une multitude d’autres partenaires.
Cela dit, notre débat est consacré aux partenariats renouvelés entre la France et les pays africains. Chaque mot a son importance. Notre débat ne saurait donc se réduire au Sahel. Il doit plutôt porter sur les partenariats que nous devons construire avec les 54 États africains pour relever les défis globaux.
En effet, nous avons partie liée : Européens, Français, Africains, notre avenir s’écrira ensemble, n’en déplaise aux adeptes du repli sur soi, à coups de « la Corrèze avant le Zambèze », et quoi qu’en pensent les escouades de followers des néo-gourous pseudo-panafricanistes, ces derniers n’étant que le cache-sexe de puissances autoritaires qui font de l’Afrique un terrain de prédation et un terrain de jeu parmi d’autres sur leur grand échiquier.

Comment vouloir délivrer l’Afrique de prétendues chaînes et se passer autour du cou la laisse de feu Prigojine ou de son maître Poutine ?…
Ce n’est pas cela être panafricain. Être panafricain, c’est plutôt répondre à l’appel lancé par le président Nana du Ghana, qui trace la seule perspective souveraine et révolutionnaire : « Soyons autosuffisants, sortons de l’aide. »
Être panafricain en 2023, ce n’est pas rejouer l’ère des indépendances. Être panafricain en 2023, c’est plutôt agir à l’ère des interdépendances. Ces interdépendances impliquent une coopération d’égal à égal sur le climat, les migrations, le développement durable : soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble.
La France agit.
Elle agit pour accroître les ressources financières permettant au Sud de mener à bien ses investissements, avec l’allocation de droits de tirage spéciaux.
Elle agit aussi pour un nouveau pacte financier mondial, qui ne sera pas juste un sommet, mais qui sera bien un processus avec un suivi, confié au président Macky Sall.
Elle agit pour les forêts tropicales aux côtés des acteurs des trois bassins, réunis en sommet à Brazzaville par le président Sassou-Nguesso.
Ces exemples montrent bien que la France n’est pas sur le reculoir. À l’instar d’Hervé Gaymard dans son rapport de 2019, tordons le cou à quelques mythes, à celui de la toute-puissance comme à celui du retrait.
Mme la ministre l’a rappelé, en vingt ans, les exportations françaises vers le continent africain ont doublé. La France est aujourd’hui le deuxième investisseur étranger sur le continent, avec un stock d’investissement qui a été multiplié par dix, passant de 6 milliards d’euros en 2000 à 60 milliards d’euros en 2022.

D’ailleurs, les impôts payés par les entreprises françaises dans les dix plus gros pays s’élèvent à 14 milliards d’euros, c’est-à-dire trois fois le montant de l’APD pour cette même zone !
Si la France n’est plus désirée, leitmotiv des agitateurs à la solde du Kremlin, pourquoi 100 000 étudiants viennent-ils étudier en France – sans compter ceux qui viennent dans le cadre de la formation continue avec des programmes spécifiques, comme l’Africa Infrastructure Fellowship Program (AIFP), lancé par Thierry Déau, qui permet de renforcer les compétences des ingénieurs et des acteurs de la commande publique africaine ?
La relation entre la France et les cinquante-quatre partenaires africains est donc plus vivace que jamais, mais elle évolue, dans son périmètre et dans ses projets.
Cette relation se normalise, au sens où nous sommes l’un des partenaires de l’Afrique comme l’Afrique est l’un de nos partenaires. Au risque de provoquer, je dirai que, plus cette relation se banalise, mieux c’est ! En effet, quand une chose devient banale, c’est qu’elle est devenue un réflexe ou une habitude.
Habituons-nous à cette nouvelle Afrique. Participer aux côtés des Africains à la nouvelle Afrique, c’est tout le sens de l’action engagée depuis 2017 par le Président de la République, avec de nombreux gestes concrets. Je pense aux restitutions d’œuvres ou à la profonde réforme du franc CFA, qui deviendra l’eco dans quelques mois.
Avec des événements comme le Forum Création Africa, la France est toujours plus et toujours mieux au contact de celles et ceux qui façonnent l’avenir de l’Afrique, lui-même continent de l’avenir. Il est en effet un continent de l’avenir au regard de sa dynamique démographique et de sa dynamique économique.
« Les fondamentaux sont donc là, solides et prometteurs », pour reprendre les propos du président du Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian), Étienne Giros.
Certains relèveront que la dynamique démocratique semble marquer le pas, ce qui pourrait être une menace pour l’avenir. Pourtant, dans de nombreux pays, les dirigeants se succèdent au terme de processus électoraux : au Nigéria, au Kenya et, ce week-end, au Libéria.
Par ailleurs, la démocratie française elle-même n’est pas identique en tout point à la démocratie suisse ou américaine. La Ve République peut d’ailleurs apparaître à certaines autres démocraties comme bien verticale. Acceptons donc que la démocratie africaine ait ses caractères propres, synthèse faite par chaque peuple de son histoire, de sa géographie et de son environnement.
Acceptons que les peuples et États africains fassent leurs propres choix. Qu’ils nous choisissent ou pas, nous répondrons toujours présent au rendez-vous, s’ils le souhaitent.
Oui, il y a une compétition et elle est accrue depuis deux décennies. Assumons-la, n’en ayons pas peur, montrons ce que nous savons faire ! Il n’y a pas à avoir de « doctrine Monroe » française ou européenne en Afrique. On peut regarder droit dans les yeux nos concurrents que sont la Chine et la Russie.
La France n’a ni à rougir ni à pâlir. Elle a une politique globale et panafricaine, avec une offre qui va de la culture au sport, en passant par le numérique et l’environnement. Le caractère universel de notre réseau diplomatique fait que nous la mettons en œuvre de la Gambie au Lesotho en passant par la Guinée-Bissau.
Tout cela fait que la France est un partenaire crédible, qui a toujours plaidé pour une meilleure participation de l’Afrique à la gouvernance mondiale.
Ces appuis témoignent de la position singulière de la France, par la langue française, que nous avons en partage avec nombre d’États, comme par les outre-mer. Avec le million de Français de La Réunion et de Mayotte, nous sommes en effet de plain-pied dans les enjeux de l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien.
La France peut aussi s’appuyer sur des liens très forts avec les diasporas que constituent les Français établis hors de France en Afrique.
Ces liens permettent également d’amortir les chocs dans les relations interétatiques. Je pense naturellement au Maroc. Je crois que nous devons avoir un réflexe franco-marocain dans l’espace eurafricain. Je me réjouis d’ailleurs que les deux rives de la Méditerranée aient pu dialoguer lors du Choiseul Business Forum qui s’est tenu voilà quelques jours.
Dans un registre différent, la filière d’Orient au sein du Quai d’Orsay est un véritable trésor qui permet de maintenir cette connaissance du continent.
Vous l’avez compris, madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, c’est donc de façon résolument optimiste pour l’Afrique et pour les partenariats de la France avec les peuples et les États d’Afrique que je terminerai mon propos.
Si, par le passé, cette relation a pu être « ressentie comme déséquilibrée, teintée de paternalisme » – pour reprendre les mots de « l’appel des 40 », lancé cette semaine dans Jeune Afrique –, aujourd’hui, je crois que, avec l’esprit nouveau qui nous guide autour de « partenariats réciproques et équilibrés », nous préparons bien les prochaines décennies.
Comme toutes les idées sont bonnes à prendre, du rapport d’information Tabarot-Fuchs aux propositions d’élaboration d’un livre blanc, je me réjouis que notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ait décidé d’y consacrer une part significative de son programme de travail pour l’année à venir.
Cap sur l’Afrique et sur la France de 2050 !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, à l’occasion d’un précédent débat, le groupe CRCE-K a dénoncé les fondements de nos rapports économiques, politiques, monétaires, diplomatiques et militaires, qui, de son point de vue, entravent depuis des années le développement des pays africains.
Aujourd’hui, c’est la confiance même dans notre relation à l’Afrique qui est en jeu et mise en cause par ces rapports anachroniques, d’un autre temps, à mille lieues de tous les nouveaux enjeux du XXIe siècle.
Je pense au franc CFA, aux traités de libre-échange ultralibéraux et au fait que la France n’a pas porté le fer contre le démantèlement des services publics et des embryons d’État social dans ces pays.
Je pense aussi à notre silence face à la course au moins-disant fiscal, au nivellement par le bas de la protection des travailleurs, aux politiques de prédation et de maxi-bénéfices des multinationales, dont certaines sont françaises, puisque des groupes comme Bolloré et Bouygues agissent en toute impunité avec la complicité d’élites locales corrompues.
Je pense bien évidemment à la persistance d’une logique néocoloniale de présence et d’interventions militaires, de moins en moins supportée notamment par les jeunesses africaines.
Nous ne sommes pas seuls à alerter sur ce propos. Soyons attentifs aux propos de Gérard Araud, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU, qui estime que nous devons « changer du tout au tout la forme de notre présence ».
Malgré les alertes, les conseils, les propositions que nous avons nous-mêmes formulées depuis plusieurs années, force est de constater que la position et la vision de la France n’évoluent guère.
Depuis le coup d’État au Niger, la France persiste à commettre les mêmes erreurs qu’au Mali et au Burkina Faso, avec une politique faite de coups de menton, de sanctions et d’appui aux velléités d’intervention militaire de la Cédéao, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
Entendons-nous bien : nous condamnons ce coup d’État, …

… à l’instar de nombreux démocrates africains, tout comme nous avons condamné ceux qui ont été perpétrés au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso.

Mais engager un tel bras de fer, comme la France a pu le faire dans le passé au Burkina Faso et au Mali, avec les pays les plus pauvres au monde, n’a conduit qu’à renforcer la popularité des putschistes, notamment auprès de la population nigérienne.

Autrement dit, le rejet de la politique française en Afrique devient un levier pour qui veut asseoir son pouvoir. C’est dire si le problème est profond et la nécessité de changer de politique urgente.
Cette image dégradée n’aurait pour explication que l’influence malveillante d’autres puissances à notre égard. Si ce phénomène est bien réel, il ne doit pas détourner notre regard de nos propres responsabilités. Les autorités françaises doivent tirer les leçons de ces différents échecs diplomatiques et adopter une politique humble et sans œillères face à la situation sahélienne.
Tendons une oreille attentive à l’aspiration des jeunesses africaines à une seconde indépendance et respectons la volonté des États africains de diversifier leurs partenariats stratégiques. Si les autorités françaises ne tiennent pas compte de cette lame de fond, en s’efforçant de trouver notre place dans ce nouvel environnement, nous continuerons à mener une politique empreinte de relents néocoloniaux.
La droite sénatoriale nous a montré, lors des débats sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que nous sommes encore bien loin d’une telle prise de conscience. Lorsqu’elle vote une mesure visant à conditionner l’aide au développement à la coopération en matière migratoire des États bénéficiaires, nous ouvrons la porte à une logique de punition collective et, par là même, couvrons de honte la France.
Pour entamer cette mue, notre groupe a formulé et continue de défendre ses nombreuses propositions.
Tout d’abord, en recommandant une augmentation des recettes fiscales des pays africains, car celles-ci ne représentent qu’à peine la moitié de celles des pays de l’OCDE, nous proposons de flécher 10 % de l’aide publique au développement vers le soutien au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays, afin de leur donner, à terme, des moyens budgétaires pérennes pour relever les défis de développement et de changement climatique auxquels ils font face.
Ensuite, plus globalement, il est nécessaire de revoir en profondeur la philosophie de notre aide, pour la tourner résolument vers la construction des bases solides d’un développement propre des pays destinataires et la dégager de toutes les logiques de pillage, qui persistent encore largement.
Sans doute conviendrait-il de travailler en plus étroite relation avec les ONG présentes sur le terrain. Efforçons-nous également d’octroyer plus de dons que de prêts, puisque ces pays sont dans l’incapacité de rembourser.
Tout en soutenant le développement du financement endogène dans ces pays, nous devons réviser les règles d’attribution des droits de tirage spéciaux (DTS) au Fonds monétaire international (FMI), en favorisant les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Si nous n’allons pas en ce sens, soyons sûrs que les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) seront actifs en ce domaine – ils ont d’ailleurs déjà commencé.
Agissons également en faveur d’une agroécologie vivrière qui a fait ses preuves, plutôt que de soumettre les pays africains à des accords commerciaux qui déstructurent leurs filières agricoles et de pêche.
Œuvrons en faveur de l’industrialisation indispensable de ces pays. Au cours des dernières décennies, les relations économiques ont maintenu dans les États africains une économie de rente. Dans notre intérêt, il faut rompre avec cette dernière. En vue d’atteindre cet objectif, ne faudrait-il pas réfléchir à des mécanismes au niveau national, européen et international, favorisant une transformation sur place des matières premières de ces pays ?
Du point de vue énergétique, nous pourrions faire profiter les États africains de notre savoir-faire, notamment en matière nucléaire, en étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Comment se fait-il que le Niger nous fournisse depuis des décennies de l’uranium pour le fonctionnement de nos centrales nucléaires, sans que nous lui proposions en échange une expertise technique pour le lancement d’un programme nucléaire civil ?
De plus en plus de dirigeants et de décideurs africains réfléchissent de cette manière. Si nous ratons le coche, d’autres pays, comme la Russie, l’Inde, le Canada et la Chine, saisiront cette occasion. J’en veux pour preuve les derniers accords passés avec des États africains, dont la République centrafricaine, le Burkina Faso et le Rwanda.
Il est temps de changer de logique et d’engager une stratégie à long terme, fondée sur la coopération et sur le soutien des choix endogènes de développement de ces pays. Il s’agit du seul moyen de réparer nos liens avec eux, ainsi qu’avec leurs peuples.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

M. Akli Mellouli . Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, nous sommes ici pour échanger sur la relation entre la France et les pays africains. Autrement dit, entre la France et 54 pays – selon Mme la ministre et Google – ou 55 pays – selon l’Union africaine. Nous devrons nous mettre d’accord : cela rappelle les chiffres des manifestations, selon que l’on se réfère à la police ou aux organisateurs…
Sourires.

Chacun de ces États, en tout cas, a son histoire propre, sa singularité linguistique, sa diversité culturelle et, surtout ses propres enjeux stratégiques. Peut-être serait-il plus approprié, la prochaine fois, par respect et considération pour nos frères africains, de ne pas mettre toute l’Afrique dans le même panier.

Sans doute est-ce là l’héritage d’un regard daté sur l’homme africain… ( Mme et M. le ministre se récrient.) Essayons, dans nos débats sur ce sujet, d’adopter collectivement une approche moins caricaturale.
Dans le temps qui m’est imparti, je concentrerai mon propos sur la relation entre la France et les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, qui est au cœur de notre politique étrangère.
Cette relation revêt à la fois une dimension affective et historique, en même temps qu’elle constitue un enjeu stratégique majeur : de son évolution dépendront la place et l’influence de la France dans le monde de demain. Or cette relation a fait les frais, ces dernières années, d’un certain nombre d’erreurs dans notre approche, qui ont conduit à des échecs cuisants.
La première erreur est de considérer notre relation avec ces pays sous un prisme trop étatique. Bien entendu, les États sont des acteurs clés, qui doivent demeurer au cœur de la relation. Mais on ne peut faire l’économie d’une analyse plus fine des acteurs non étatiques, des réseaux des sociétés civiles, soucieux du maintien d’une relation mutuellement profitable entre la France et les pays africains.
Ces réseaux doivent compléter les dispositifs institutionnalisés. Ils permettront de percevoir des dynamiques qui n’apparaissent pas de manière évidente quand on se concentre uniquement sur le système interétatique. Dans son discours devant les ambassadeurs, le Président de la République a bien sûr appelé le corps diplomatique à aller plus à la rencontre des sociétés civiles. Mais c’est un discours que nous entendons depuis plusieurs années… Il est temps de passer de la rhétorique à la pratique.
La seconde erreur est un manque de cohérence entre nos discours de politique intérieure et extérieure. La diplomatie française a l’ambition, légitime, de faire rayonner notre pays à travers le monde en se fondant sur l’universalisme de ses valeurs.
Je partage cette ambition, madame la ministre, mais elle doit être en cohérence avec notre discours en matière de politique migratoire. On ne peut pas dénigrer – pour ne pas dire insulter – les populations étrangères, comme cela a été le cas lors des débats sur le projet de loi sur l’immigration que nous avons examiné récemment et espérer avoir une belle image en Afrique. Les liens entre les sociétés civiles et les acteurs économiques et culturels dépendent des échanges et des déplacements.
C’est aussi par les politiques de visas que le bât blesse, quand on empêche injustement nos amis, les personnes attachées à la France et à la francophonie, de nous rendre visite. Notre ambition doit être alignée avec nos discours et nos actes.
Ces deux erreurs dans notre approche ont malheureusement conduit à des échecs retentissants ces dernières années.
Je pense notamment aux nombreux pays du Sahel qui se sont détournés brutalement de nous au profit d’autres puissances étrangères, comme la Chine et la Russie.
Je pense aussi à cette jeunesse africaine, de plus en plus connectée, de plus en plus anglophone et qui, à tort ou à raison, voit en notre politique africaine la continuité d’une Françafrique qui, au mieux, n’a rien apporté de positif, au pire, est la source de tous ses maux.
Cette forte dégradation de la perception de la France survient dans un contexte où l’Afrique fait face à une crise de plus en plus multidimensionnelle, dont le dérèglement climatique est un catalyseur.
Malgré ces échecs récents, je suis convaincu que la relation avec l’Afrique, et plus particulièrement les pays francophones, demeure pleine de promesses. Je suis persuadé que nous sommes en mesure de relancer très rapidement une nouvelle dynamique positive et d’ériger des passerelles entre nous et nos frères africains. Les atouts sont là, sous nos yeux. Permettez-moi de vous en citer quatre.
Le premier atout est, bien entendu, la francophonie qui, malgré la progression de l’anglais, demeure bien ancrée.
Le deuxième est la diaspora africaine, diverse et engagée. Les nombreux jeunes Français, talentueux et dynamiques, issus des différentes diasporas, sont autant de passerelles entre nous et nos frères africains. Ils sont à même, par leur engagement, de créer un nouvel élan positif.
Ces diasporas seront l’atout majeur de la France dans les années à venir, face aux puissances étrangères qui ne disposent pas d’un tel avantage. Je vous invite donc, madame la ministre, à encourager l’émergence d’une véritable diplomatie parlementaire, qui pourra travailler sur la relation avec les diasporas et les sociétés civiles africaines.
Le troisième atout est la multitude de projets de coopération culturels, économiques et sociaux engagés par nos ONG et les sociétés civiles africaines. Mais, pour valoriser cet atout, il faut adopter une approche humaniste et nous donner les moyens de nos ambitions. Or l’aide publique au développement est malheureusement instrumentalisée au détriment des populations, et ce à l’encontre de l’esprit de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales d’août 2021.
Nous avons la chance que des Françaises et des Français s’engagent, dans de nombreuses ONG, auprès des populations et des sociétés civiles du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il est impératif, indépendamment du contexte politique, de maintenir tous ces financements.
Ces ONG, qui travaillent dans la santé, l’éducation et bien d’autres domaines essentiels permettent de venir en aide à des populations en prise avec de nombreuses vulnérabilités. Elles sont les meilleures ambassadrices d’une France ouverte, tolérante et humaniste. Donnez-leur, madame la ministre, les moyens financiers nécessaires à leur action ! Celle-ci permet en effet aux populations locales de mieux vivre sur leurs territoires, alors que la France tend à durcir, en ce moment même, ses conditions d’accueil des migrants.
Ainsi, je vous recommande de continuer à accroître l’aide publique au développement de la France, pour atteindre l’objectif de 0, 7 % du revenu national brut (RNB), et ce dès le prochain PLF. Ces ONG, ces sociétés civiles, seront le lien grâce auquel nous pourrons réparer notre relation avec ces pays. Si ténu soit-il, c’est grâce à lui que nous y reprendrons pied.
Enfin, le quatrième atout est la possibilité historique d’engager une coopération avec nos partenaires africains pour lutter conjointement contre le dérèglement climatique qui ravage économiquement et socialement de nombreuses régions.
Lançons cette coopération dans la lutte contre la déforestation, la lutte contre le commerce illégal d’espèces de faunes et de flores sauvages protégées – celui-ci, je vous le rappelle, est estimé à 20 milliards de dollars par an – ou encore la lutte contre l’une des plus grandes injustices du réchauffement climatique, qui fait de l’Afrique le continent le plus affecté, alors qu’il est le moins émetteur.
En conclusion, madame la ministre, il faut que notre pays ait une vision et une politique sur le long terme. C’est la vision court-termiste que l’on appelait Françafrique qui est la source de nos difficultés actuelles.
Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Ne donnons pas l’impression que notre relation avec les pays africains n’est qu’une histoire d’intérêts politiciens et économiques, et que, au moindre soubresaut, nous coupons les vannes aux populations les plus vulnérables. Surtout, madame la ministre, il est grand temps d’aligner nos discours et nos actes avec nos ambitions !
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, depuis quelques années, les relations entre notre pays et le continent africain sont devenues un long bulletin de mauvaises nouvelles qui, malheureusement, ne cessent de se répéter.
Dans ce contexte, les échanges qui nous rassemblent ce soir revêtent une importance que nul ne doit sous-estimer. Au risque d’être lapidaires, nous pourrions les résumer de manière prosaïque par une question : comment sauver la place de la France en Afrique ? Cette formulation peut sembler brutale, j’en conviens, mais il serait sans doute présomptueux d’imaginer que les solutions sont faciles.
Un récent rapport d’information sur les relations entre la France et l’Afrique analyse sans concession la situation et esquisse des pistes qui doivent être entendues et discutées. Oui, les relations actuelles avec certains États africains sont contestées, affaiblies, voire inexistantes, et les raisons du ressentiment sont multiples.
L’impératif d’aide au développement pour ce continent s’efface derrière nos leçons en matière de démocratie, s’estompe à mesure que notre présence sécuritaire est remise en cause et succombe à nos débats européens sur la gestion migratoire.
Il appartient au Gouvernement et à l’ensemble des acteurs concernés de dégager une autre voie. Cela suppose des réformes allant au-delà des traditionnelles déclarations d’intention et des grands discours, dont nous sommes malheureusement friands en matière de relations internationales.
Inutile de cacher que notre politique africaine a suscité bien des promesses, régulièrement suivies de bien des désillusions. Je mesure avec une pointe d’amertume que le constat dressé par ce rapport est cruel et sans appel. Alors que le continent africain est entré de plain-pied dans la mondialisation, nos perceptions et conceptions sont trop souvent restées imprégnées d’une culture datée.
Oui, mes chers collègues, nous pouvons le regretter et le déplorer, mais le diagnostic de ces relations bien affaiblies et erratiques est posé : l’Afrique n’est plus notre pré carré. Elle est devenue une mosaïque de territoires, qui ne ressemble plus à l’univers postcolonial qui a pu guider nos choix.
En 2050, un Africain sur deux aura moins de 25 ans, et cette jeunesse ne se privera pas de contester le pouvoir de ses élites, toujours fortement francophiles. Ces critiques, si nous ne changeons pas de cap, se renforceront et entraveront sérieusement le rétablissement de relations partenariales sereines.
Nos intérêts, que nous croyions solidement ancrés par des liens tissés sur le temps long et que l’on pensait solides malgré les heurts qui ont accompagné les différents processus de décolonisation, sont désormais directement concurrencés par la Chine conquérante, la Russie milicienne et la Turquie pragmatique.
Comment, face à cette évolution irréversible, mettre en place et faire vivre des relations équilibrées et responsables ? Sans céder à la provocation, je suis tenté de m’interroger à haute voix : avons-nous, face à ces fractures, face à ces ruptures, une stratégie ?
Depuis l’intervention française au Mali, en 2013, notre stratégie est essentiellement militaire, et elle a pris le pas sur les efforts diplomatiques mis en place au cours de la seconde moitié du siècle dernier. Cette évolution répondait à d’évidentes et indispensables motivations, liées à la lutte contre le terrorisme et à la nécessité de sécuriser la bande sahélienne. À plusieurs reprises, nous avons débattu ici de l’opportunité des interventions militaires et des difficultés associées à notre présence armée.
Sans négliger les impératifs de ces engagements, j’insiste sur la nécessité de retisser des liens avec les pays africains, en se gardant de renouveler les errements et les erreurs du passé. Mais serons-nous suffisamment résilients ?
C’est le point sur lequel j’entends insister devant vous, mes chers collègues. Au demeurant, plusieurs interventions du Président de la République ont souligné la nécessité de bâtir une nouvelle politique africaine, en évoquant l’importance de sortir des pièges de ce qu’il est convenu d’appeler la Françafrique.
Prenons pour exemple l’impact, relatif, du bon travail réalisé par l’AFD. Celle-ci a permis d’investir sur le continent quelque 16 milliards d’euros entre 2020 et 2022. Pourtant, les populations locales ne perçoivent pas ces aides, considérées comme trop orientées vers les infrastructures, au détriment d’initiatives moins ambitieuses, mais repérables par les habitants.
D’aucuns insistent sur l’importance d’une communication plus soutenue, qui permettrait, je n’en doute pas, de valoriser le réel savoir-faire dont nous disposons en ce domaine. Mais peut-on se contenter de circonscrire ces efforts à un faire-savoir, qui les réduit à une politique d’influence, dont les volumes seront toujours dévalorisés s’ils sont comparés à certaines opérations engagées par une Chine omniprésente ?
Oui, refaire de la coopération un élément précis est indispensable, mais ce changement doit s’accompagner d’une réelle redéfinition des enjeux en faveur d’une coopération novatrice et dynamique. Afin d’être efficace et placée au diapason des conséquences du réchauffement climatique sur les mouvements de population, elle appelle une ambition plus soutenue et plus marquée.
Les propositions de financements innovants dans cette région ne manquent pas. Nos domaines de coopération devront en tenir compte et privilégier des axes ambitieux en faveur du développement des énergies renouvelables, de l’éducation et de l’économie numérique.
Alors que l’Afrique est désormais inscrite dans un cadre de développement privilégiant le multilatéralisme tout en redéfinissant ses outils, la France devrait s’engager sur le chemin de coopérations stratégiques et tourner la page de l’action unilatérale. Elle est une actrice historique, qui doit pouvoir jouer un rôle clé dans cette évolution des partenariats pour construire l’avenir du continent africain.
Afin de donner un plein essor à ces politiques, tout en retrouvant une crédibilité émoussée par certains en matière de respect des droits démocratiques, pourquoi ne pas s’inscrire avec audace dans ce mouvement ?
Pour être crédible, la France doit apporter la preuve que sa volonté d’action ne témoigne pas de la volonté de maintenir un ordre suranné et dépassé. C’est très vraisemblablement dans des initiatives de coconstruction, rassemblant plusieurs partenaires, et en affichant sans cesse le souci de s’inscrire dans la résolution des difficultés concrètes que nous reconstruirons ces relations.
Profitons donc des difficultés actuelles pour effectuer le changement que les crises imposent. Il faut du courage, de la volonté et sans doute un peu d’audace. Autant de qualités qui ne font pas défaut à notre pays, ni, j’en suis convaincu, à nos ministres, à nos diplomates, à nos décideurs et aux élus que nous sommes !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, voilà la seconde fois en quelques mois que le Gouvernement présente sa feuille de route pour l’Afrique devant le Parlement. Nous vous en remercions, madame, monsieur les ministres, mais nous avons l’impression que vous prêchez dans le désert : si le Président de la République multiplie les déplacements et les déclarations, l’Afrique ne nous écoute plus.
Rappelons la réalité démographique. En 2050, c’est-à-dire demain, une personne sur quatre dans le monde sera africaine. Alors que la population européenne vieillit et stagne, l’âge médian en Afrique est de 20 ans. L’Afrique est jeune. Elle n’attend plus la France.
De son côté, le Sud global se développe en Afrique, avec comme dénominateur commun d’être opposé à l’Occident, donc particulièrement à la France. Les Brics tiennent un sommet extraordinaire en ce moment même. Ayant accueilli l’Afrique du Sud en leur sein en 2010, les pays de cette communauté représentent déjà 41 % de la population mondiale, 31 % de la production mondiale et 18 % du commerce mondial. Déjà, 22 pays africains ont demandé à en devenir membres, dont le Nigéria, le Sénégal et l’Algérie.
Au dernier sommet des Brics, en août dernier, 53 États africains étaient invités. L’Égypte et l’Éthiopie, deux pays qui atteignent ou dépassent les 100 millions d’habitants, viennent de rallier cette influente communauté internationale. Pour mémoire, l’Égypte jouit d’une position géostratégique sur les routes commerciales et des gisements de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale. L’Éthiopie, elle, est au centre de l’Union africaine et vise une croissance de 20 % cette année, selon le FMI.
En Afrique, la Chine a déjà construit plus de 6 000 kilomètres de voies de chemin de fer. La cause de ce succès est notre échec. Les pays du Sud global ont su proposer des modèles de partenariat alternatifs, alors que nous sommes encore empêtrés dans nos litiges de colonisation, décolonisation, post-colonisation, néocolonisation – j’en passe, et des meilleures ! –, qui incitent au rejet, voire à la haine de la France, malgré le sacrifice de nos soldats.
Dès 2009, l’économiste zambienne Dambisa Moyo affirmait que l’aide publique au développement n’aidait pas l’Afrique. Selon elle, le continent aurait bénéficié de plus de 1 000 milliards de dollars d’aides publiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
En France, les gouvernements n’ont jamais eu aucune exigence sur l’utilisation de ces sommes, qui viennent de la poche du contribuable et qui, souvent, servent à soutenir l’incurie d’une certaine classe politique africaine.
L’Empire britannique s’est disloqué avec perte et fracas, provoquant des millions de morts dus aux guerres civiles ayant suivi la décolonisation. Les Britanniques ont cessé de s’en excuser. Et cela n’a pas empêché le Gabon et le Togo, pays pourtant francophones, de rejoindre le Commonwealth l’année dernière.
Aujourd’hui, le Premier ministre britannique a assuré qu’il ne permettrait pas à la Cour européenne des droits de l’homme de bloquer le projet de son gouvernement d’expulser des demandeurs d’asile vers le Rwanda. Il a promis de faire tout ce qu’il faudra pour faire décoller des avions. Tout cela en bonne intelligence avec son homologue africain… Voilà ce qu’est un partenariat volontariste !
Pour la paix, la sécurité et la stabilité du monde, nous avons besoin de développer notre influence, notamment culturelle, en Afrique, et d’en finir avec l’assistanat et nos complexes, pour adopter enfin des partenariats bilatéraux pragmatiques.

Nous en avons terminé avec le débat sur la déclaration du Gouvernement sur les partenariats renouvelés entre la France et les pays africains.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 22 novembre 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
Ordre du jour réservé au groupe SER

Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, présentée par M. Hussein Bourgi et plusieurs de ses collègues (texte n° 864, 2021-2022) ;
Proposition de loi constitutionnelle visant à faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée, présentée par M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues (texte n° 571, 2022-2023).
À vingt-deux heures :
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.