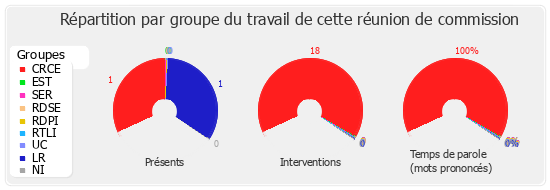Mission commune d'information Inondations dans le Var
Réunion du 29 mai 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. patrick lavarde directeur général de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques onema et de m. alexis delaunay directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale (voir le dossier)
- Audition de m. paul-henri bourrelier vice-président de l'association française pour la prévention des catastrophes naturelles afpcn et de m. rené feunteun trésorier (voir le dossier)
- Audition de m. robert slomp conseiller au service de la gestion de l'eau du rijkswaterstaat et de m. carel de villeneuve conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du royaume des pays-bas en france (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Patrick Lavarde directeur général de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques onema et de M. Alexis delauNay directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale
Audition de M. Patrick Lavarde directeur général de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques onema et de M. Alexis delauNay directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale

L'Onema, placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, est un établissement public créé en 2007 en application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006. En collaboration étroite avec les services de l'État, les agences et offices de l'eau ainsi que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il assure essentiellement deux missions : la coordination de la recherche et des systèmes d'information, la surveillance. Il contribue également au financement des politiques publiques au titre de la solidarité entre bassins. Comment l'établissement concilie-t-il ses différentes missions ? Qu'en est-il, en particulier, de l'entretien des cours d'eau si nécessaire à la réduction du risque d'inondation ? C'est pour répondre à ces questions que nous avons invité M. Patrick Lavarde, son directeur général.
L'Onema, vous l'avez dit, est une institution récente. Elle est la traduction concrète de la loi sur l'eau de 2006, qui a été si difficile à adopter et a usé bien des ministres... Pour l'essentiel, l'Office contribue indirectement à la prévention du risque d'inondation. De fait, nous coordonnons la recherche nationale sur l'eau et participons à l'initiative européenne de programmation conjointe sur l'eau, sauf pour ce qui concerne l'analyse et la prévention des crues qui relève du Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (Schapi). Cette distinction n'est peut-être pas totalement opérante, les cycles hydrographiques étant désormais perturbés et les inondations succédant aux sécheresses...
Nous sommes membres de leur comité d'orientation. Nous tentons de travailler, autant que faire ce peut, en bonne intelligence. Cela n'est pas anodin car nos moyens financiers sont supérieurs aux leurs.
Notre deuxième mission est la coordination du système d'information sur l'eau et le rapportage communautaire. Là encore, nous sommes responsables, non de l'excès d'eau, mais du manque d'eau. En l'espèce, le suivi des étiages. C'est à ce titre que nous conseillons les préfets en cas de sécheresse, que nous publions un bulletin de situation hydrologique mensuel et que nous participons au financement du réseau piézométrique national mis en place par le Bureau de recherches géologiques et minières. En revanche, la banque Hydro, soit la banque nationale de données pour l'hydrométrie et l'hydrologie, relève du Schapi.

Votre contribution financière en faveur du BRGM est-elle forfaitaire ou à la tâche ?
Au titre de cette mission, le BRGM reçoit une subvention qui n'est pas strictement à la tâche. Cela n'exclut pas les collaborations. Pour exemple, nous assurons le monitoring des températures des masses d'eau, qui est une obligation européenne, à partir de sondes thermiques installées dans les stations de suivi hydrométrique pour éviter des dépenses inutiles. Autre signe de notre collaboration, le Schapi siège au sein du comité d'orientation du système d'information sur l'eau que nous pilotons.
Cette répartition correspond, en fait, aux champs de compétences de deux directions au sein du ministère de l'écologie : la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, dont nous sommes le bras armé, et la direction générale de la prévention des risques. D'où des besoins réguliers de coordination.
Pardonnez-moi cette litote : elle est techniquement pertinente, quoique l'essentiel, pour la gestion des alertes et des crises, dépende d'abord de la mutualisation des moyens et de la rapidité de la réaction. Les élus du Sud-est sont bien placés pour le savoir. Lorsque survient une crue cévenole et qu'il pleut 400 mm d'eau en douze heures comme en 2010, on peut raconter tout ce que l'on veut, mais l'important est de sécuriser les systèmes d'information et d'alertes. En 2010, l'agent, que nous avions envoyé surveiller les eaux de la Nartuby, s'est retrouvé coincé dans sa voiture. Son téléphone portable n'a pas fonctionné, il a heureusement pu envoyer un SMS vers minuit. Sinon, il aurait été emporté par les flots.
Ce qui compte, c'est la synergie sur les mêmes objectifs ; la question des structures est secondaire.

Une plainte unanime monte du terrain : la police de l'eau fait du zèle, intervenant et verbalisant, nous disent les acteurs de terrain, à temps et surtout à contretemps. Pour ne rien vous cacher, c'est la raison principale pour laquelle nous vous avons fait venir. Résultat, les cours d'eau ne sont plus entretenus, ce qui parfois d'ailleurs arrange bien ceux qui en auraient la responsabilité. Prenons le cas de la Nartuby en s'appuyant sur l'étude qui a été rendue. Il en ressort que, faute d'entretien, le lit de la partie amont de la rivière, divisée en deux branches, est totalement végétalisé de sorte qu'un premier embâcle s'est formé dans un bras ; lorsqu'il a lâché, il a libéré une vague qui est venue se bloquer sur le pont de Rebouillon. Même les vieux habitants, habitués aux crues, se sont laissé surprendre, d'où les trois décès. Même phénomène dans le second bras d'où est résulté l'affouillement de la route départemental qui s'est affaissée. Le manque d'entretien du lit de la rivière, le rapport l'indique clairement, expliquerait la forme violente prise par la crue. Partout, du Var au Vaucluse en passant par le Gard, on s'est plaint de ce que la police de l'eau a empêché et empêche d'agir. Peut-être a-t-elle de bonnes raisons juridiques pour le faire, mais le résultat est là.

Je confirme ces propos : la police de l'eau a verbalisé des maires de petits villages qui pensaient bien faire. Nous avons le sentiment d'une coupure avec la base.
Je reconnais des incompréhensions, encore dernièrement dans les Pyrénées où votre collègue M. Fortassin s'est fait le porte-parole efficace de la population. Objectivement, des excès sont à déplorer de part et d'autre. A la création de l'Onema, les agents de terrain étaient orientés vers la protection de la biodiversité ; il faut donc modifier la culture interne. Des PV ? Oui, les agriculteurs pourraient également s'en plaindre par rapport aux mesures de régulation pour parer à la sécheresse. Face à des évènements exceptionnels comme en 2010, le mauvais entretien des cours d'eau n'a pas un rôle significatif dans l'ampleur de la crue.

Dans le cas de la Nartuby, la formation d'embâcles explique l'importance des dégâts et au moins les décès de Rebouillon. Les trois personnes emportées par les flots, bien que connaissant la rivière, ne se sont pas méfiées.
Il faut distinguer le travail courant des situations de crise et post-crise. Après des épisodes violents, la tentation, pour montrer que l'on agit, est de prendre des décisions rapides et de lancer une succession de travaux non coordonnés. Des exemples nombreux le prouvent. L'élévation d'une digue pour régler le problème en amont a abouti à ce que la fois suivante, la masse d'eau la contourne pour engloutir des habitations qui n'étaient plus protégées. Accélérer le passage de l'eau sans se soucier de l'aval peut créer une dégradation de la situation en aval. La maîtrise d'ouvrage doit absolument porter sur l'ensemble du bassin, au besoin avec une déclaration d'intérêt général pour plusieurs années.

Je connais la théorie : un plan d'ensemble qui concilie la sécurité des habitants et la préservation des écrevisses...

C'est pourtant bien de cela dont il s'agit ! Viser la perfection du plan d'ensemble conduit à l'immobilisme. Nous ne sommes pas au paradis ! Or le Var est touché tous les cinq ans ; la crue n'est pas un phénomène exceptionnel. Nous devons apprendre à faire face à ces phénomènes récurrents.
Je comprends. Cela dit, vous ne pouvez pas accuser la police de l'eau de ne pas faire le travail d'entretien qui incombe aux riverains.

Précisément, les riverains, qui se mêlent d'intervenir, sont verbalisés ! Les formalités sont trop lourdes pour inciter les riverains à le faire. Et puis, encore une fois, avoir une justification à son immobilisme est parfois bien pratique.
Non ! Ils ne le sont que si c'est nécessaire. Souvent, les gens croient bien faire. Six mois plus tard, lorsqu'un agent effectue une visite, il constate que les trois souches d'arbre pour lesquelles l'autorisation a été accordée n'ont pas été seulement déplacées, c'est tout un canal qui a été creusé ! Le cas s'est présenté dans les Hautes-Pyrénées.
La prévention des inondations doit passer par un plan d'ensemble au financement et à la maîtrise d'ouvrage assurés, là résident les difficultés.

Pour le dire avec mes mots, il est incontestable que les retours que nous avons du terrain sont négatifs vis-à-vis des agents de l'Onema, d'où un sentiment de coupure avec la base et d'incompréhension. Je suis donc désireux d'avoir les exemples que vous évoquiez à l'instant. Nous devons trouver, ensemble, le moyen de diffuser une culture de la gestion des cours d'eau en distinguant les truands, qu'il faut sanctionner, des gens de bonne volonté. Il existe également un problème de forme : vos agents devraient apprendre à intervenir avec un gant de velours. Un maire nous a relaté son expérience : la rivière était tarie ; on a seulement donné, de bonne foi, un coup de pelle pour que les voitures passent comme cela était l'habitude ; nous avons été verbalisés.
Nous avons prévu des formations à la prévention des conflits pour tous nos agents : 100 d'entre eux sur 600 en ont déjà suivi une.
Les consignes données aux agents les invitent justement à distinguer les situations selon la bonne foi des contrevenants. Il est même envisageable de dresser un constat sans verbaliser, sous réserve de régulariser la situation constatée. Nos agents, ne l'oublions pas, interviennent sous l'autorité des parquets, à l'intention desquels nous avons rédigé un vade-mecum. La prévention est primordiale pour une police technique comme la nôtre, qui ne fonctionne pas au chiffre. Néanmoins, nous devons consentir, il est vrai, de gros efforts de pédagogie. Nos agents n'ont pas encore intégré la culture du changement, ils privilégient encore trop la biodiversité.

Il faut cesser d'avoir une approche exclusivement morale du problème. Et si je puis me permettre, il faut en finir avec l'approche perfectionniste; elle est paralysante...Dans l'attente des études qui permettront de tout concilier, on ne fait rien.
Quand je parle de plan d'ensemble, je me situe au plan géographique, au moins celui du sous-bassin.

et, quand la catastrophe survient, on s'agite, éventuellement on construit des monuments aux morts mais rien ne change vraiment. Mieux vaut un plan incomplet mais rapidement mis en oeuvre qu'un plan exhaustif qui concilie tout mais qui ne voit jamais le jour.
La réflexion est engagée sur les syndicats d'eau potable. Les préfets ont voulu réduire leur nombre pour réaliser des économies d'échelle. Or c'est à leur niveau que doit être assurée la maîtrise d'ouvrage ! Chaque territoire a sa dynamique avec des disparités selon les secteurs géographiques.
Le problème est également financier. Le système diffère selon les collectivités. La redevance pour service rendu est peu utilisée car il est délicat de définir le service rendu et d'identifier son bénéficiaire. Aucune fiscalité propre n'existe pour la prévention de l'inondation.

Une taxe spécifique alimente les établissements publics fonciers régionaux. Pourquoi ne pas envisager un tel système pour l'eau ?
Un pas a été fait en ce sens avec la création d'une taxe additionnelle pour financer le fonctionnement des établissements publics territoriaux de bassin. Il faut trouver une assiette et un vecteur pour assurer la ressource financière. Les agences de l'eau savent déjà collecter cette taxe dont le principe a été décidé par l'EPTB ; on peut donc joindre une contribution accessoire à celle principale déjà collectée.
Plusieurs pistes d'assiette fiscale existent : le montant de la facture d'eau, les taxes d'assurance des biens, le foncier bâti ou non bâti... La réflexion sur la fiscalité pour financer l'aménagement des cours d'eau en est seulement au début. La loi a toutefois autorisé, après de nombreuses années de réflexion, les communes à instituer une taxe sur l'imperméabilisation des sols.
L'échelle doit être pertinente pour financer de façon solidaire des travaux à l'échelle d'un bassin.
Non, la taxe additionnelle est supportée par tous les préleveurs d'eau.

Le syndicat mixte serait plus maniable que l'établissement de bassin. Quelle est votre position ?
Certains établissements de bassin sont déjà des syndicats mixtes...

Quand votre plan de formation à la prévention des conflits des 600 agents aboutira-t-il ?

Je vous suggère de mettre l'accent sur la pédagogie avec les élus, c'est votre gros problème.
L'an dernier, nous avons fait parler les élus, durant le salon des maires, pour qu'ils témoignent directement de plans d'aménagement réussis.

Est-il normal que le poids de l'aménagement des cours d'eau repose seulement sur certaines communes ?
Pour protéger l'aval, il faut travailler sur l'amont et la notion de territoire de solidarité. On pourrait imaginer une taxe sur les zones imperméabilisées, une contribution des villes pour service rendu.
ainsi qu'en Alsace qui a repris le modèle allemand pour le polder d'Erstein qui a été réinondé pour préserver, en cas de crue du Rhin, les villes à l'aval.
Un système qui, finalement, n'est pas si éloigné des servitudes dans le Bassin parisien avec les grands lacs en amont.

Pourquoi infliger des servitudes à certains territoires, et non à d'autres ? C'est fondamentalement inéquitable !
Le territoire de l'eau et les territoires administratifs ne se recoupant pas, il faut organiser des solidarités. Et, plutôt que de servitude, je préfère parler de service rendu...

et d'aménagement du territoire ! Car la question est de rendre vivable un territoire menacé. L'inondation, considérée comme une catastrophe naturelle, est assurable. En fait, elle est, cela est prouvé historiquement, un phénomène récurrent qui devrait relever de la solidarité nationale.
L'amont rend un service à l'aval ; ce service a une valeur qui doit être évaluée. Comme la sécurité sociale, le système se fonde sur la réparation. Mieux vaudrait travailler dans la durée et prévenir.

Vous travaillez beaucoup pour les préfectures, pour un tiers de votre activité environ. Comment cela fonctionne-t-il ? Les préfectures, touchées par la RGPP, sont certainement heureuse de s'appuyer sur vous...
Les conventions entre l'Onema et les préfectures définissent des priorités qui diffèrent selon les départements. En Bretagne, on se souciera davantage de la pression agricole. La direction départementale des territoires et de la mer se charge du volet réglementaire, l'Onema des avis techniques et du contrôle des prescriptions ; les deux se coordonnent au sein de la mission interservices de l'eau et de la nature qui fonctionnent plus ou moins bien selon les départements. Pour vous donner une idée, dans le Var, la DDTM compte une quinzaine d'agent et notre service environ six à sept personnes, soit une vingtaine d'agents au total. Le fait que le préfet ne soit pas le délégué territorial pour l'Onema, comme il est désormais prévu pour d'autres établissements publics nationaux, n'est pas un problème ; les difficultés se règlent par convention.

Pour conclure, votre office a pris conscience des incompréhensions sur le terrain et travaille à les aplanir. Outre les difficultés de financement que vous avez soulignées, quels sont les points qu'il faudrait améliorer ? Nous sommes ouverts à toutes les propositions que vous nous adresserez par écrit.

Des dispositifs se sont multipliés qui ne sont pas cohérents. Des choix s'imposent donc pour parer aux urgences.
On ne gère pas un bassin en posant des rustines comme on le fait sur une route.
Nous vous ferons parvenir une note complémentaire.
Audition de M. Paul-Henri Bourrelier vice-président de l'association française pour la prévention des catastrophes naturelles afpcn et de M. René Feunteun trésorier
Audition de M. Paul-Henri Bourrelier vice-président de l'association française pour la prévention des catastrophes naturelles afpcn et de M. René Feunteun trésorier

Nous accueillons M. Bourrelier, ingénieur retraité du corps des mines qui, après une longue carrière comme directeur général du BRGM et comme président des Houillères du Centre et du Midi, s'est spécialisé dans l'expertise sur les risques majeurs. Il est notamment l'auteur de Les catastrophes naturelles, le grand cafouillage paru en 2000. Il est membre fondateur de l'Association pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN), dont la vice-présidente est Mme Marie-France Beaufils.
Cette association regroupe l'ensemble des acteurs publics et privés qui concourent à la réduction des risques et à renforcer la résilience de la société. Ses activités, qui s'appuient essentiellement sur le bénévolat, consistent en des rencontres, des débats et la publication de notes de réflexion. Elle dispose d'un conseil scientifique composé d'experts indépendants couvrant les différentes disciplines de la prévention et de la gestion des risques ainsi que d'une structure légère de trois permanents pour son fonctionnement. M. Bourrelier a développé une analyse intéressante et originale sur l'appréhension des risques naturels, notamment les inondations. Il nous montrera comment la prise en considération du risque a évolué au cours des dernières années et quelles ont été les réponses des pouvoirs publics.
J'ai lu avec intérêt le compte rendu de vos auditions précédentes et j'ai constaté que M. le président et M. le rapporteur font montre d'un excellent esprit critique. Dans notre pays, il existe bien des usines à gaz.
L'AFPCN est composé d'experts et dispose d'un réseau de partenaires : Institut des risques majeurs (IRMa), Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (IRSTEA), etc. Notre association est bipartisane et le conseil d'administration va devenir un organe politique pour développer ses réseaux. L'AFPCN est financée par des conventions avec le ministère du développement durable. Le conseil scientifique est plus indépendant et éclectique : en sont membres des philosophes comme Jean-Pierre Dupuy - je vous renvoie à son ouvrage Pour un catastrophisme éclairé - et Michel Juffé ou encore le directeur de recherche de l'université de Pennsylvanie, en pointe sur les systèmes d'assurance et d'indemnisation.
Les inondations de 2011 ont été exceptionnelles, mais l'exceptionnel, c'est le quotidien qui évolue sans cesse. L'avenir reste préoccupant, même si les choses ne se sont pas trop mal passées en novembre 2011, notamment s'agissant de la question des futurs grands aménagements.
Jusqu'au XVIIIème siècle, on s'en remettait à la providence. A partir du Siècle des Lumières, la rationalité s'est progressivement imposée, avec la construction d'ouvrages et la diffusion de cartes des zones inondables. En 1981, le Commissariat aux risques naturels présidé par Haroun Tazieff a été créé afin de couvrir le territoire. A la même date, la loi d'indemnisation a été votée à l'unanimité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, Haroun Tazieff avait dénoncé le risque de déresponsabilisation que cette loi faisait courir. Parallèlement à la création du GIEC en 1989, la décennie des risques naturels a été lancée et les deux initiatives se sont rejointes l'an dernier à l'occasion de la parution d'un rapport.

Peut-on faire un lien entre cette évolution et les changements sociétaux, notamment la disparition de la paysannerie ?
Tout à fait.
Les cyclones qui se sont abattus sur les Etats-Unis ont sensibilisé ce pays et les recherches internationales, mais aussi nationales, se sont amplifiées. Comme l'a récemment dit le secrétaire général des Nations Unies, nous sommes à un tournant.

Ne confond-t-on pas des phénomènes très différents de par leur ampleur et leur fréquence ? Dans le Var, les phénomènes de 2010 et 2011 n'avaient rien de comparable. On pensait que l'on pouvait maîtriser des crues, mais certaines, comme en 2010, se sont révélées incontrôlables. Ne commet-on pas actuellement l'excès inverse en estimant que plus rien n'est maîtrisable ?
Non, il faut établir une typologie et segmenter les phénomènes.
En 1981, on ignorait tout de ces phénomènes et les assureurs n'avaient jamais couvert ces risques. Le système mis en place a duré 30 ans. Des modèles ont été créés, mais on a modélisé à tour de bras ! La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a ainsi modélisé... pour augmenter ses tarifs !
Bien sûr ! Les conséquences dramatiques de Xynthia sont dues au fait que les modèles sur le vent, les marées et les digues n'étaient pas connectés.
Le BRGM, Météo France, l'IRSTEA... Chacun construit son modèle. C'est un mode de travail qui n'est pas magique : les modèles expliquent, ils ne prévoient pas. Les dissipations d'énergies brutales ressortissent de la théorie du chaos.
Des progrès décisifs ont été réalisés dans la vigilance et l'alerte. Dans mon livre Les catastrophes naturelles : le grand cafouillage, je poussais un cri d'alarme après les tempêtes de décembre 1999. Jusqu'alors, tout passait par les préfets. Depuis, le système d'alertes a été réorganisé et il est beaucoup plus rapide. En revanche, des problèmes dans la transmission d'information et la prévention perdurent.

Vous pointez l'ignorance, la vulnérabilité, la mauvaise sensibilisation des populations et l'implication réticente des personnels territoriaux. Vos analyses ont une vertu décapante !
C'est évident et Mme Beaufils, qui préside l'AFPCN, le reconnaît. Pour un maire, le danger, c'est le Plan de prévention des risques (PPR), pas le risque en lui-même ! Il est difficile pour un élu local de résister à la pression foncière. On observe de véritables dénis de risques, de Xynthia à Fukushima. L'implantation des centrales nucléaires a été décidée dans les années 1970 alors que la théorie de la tectonique des plaques était connue depuis seulement dix ans. Nous avions alors des échanges houleux avec EDF...

Selon vous, les Japonais savaient qu'il s'agissait d'une zone à risque ?
Pas au moment où ils ont construit la centrale de Fukushima en 1970. Mais en 2000, ils disposaient de toutes les données. Seulement, ils espéraient que rien ne se produirait avant le démantèlement de la centrale. Bref, l'ignorance des vulnérabilités est due à des facteurs humains.

Le problème ne vient-il pas du fait que l'on raisonne en terme de risques et non pas d'aménagement du territoire ?
Tout à fait d'accord : il faut effectivement envisager le problème d'une toute autre façon. Nous sommes à un tournant : il va falloir gérer au plus près des territoires, impliquer les citoyens, utiliser la révolution des réseaux sociaux.

Cette révolution ne fait-elle pas aussi des dégâts ? Des rumeurs délirantes se répandent à grande vitesse sur ces réseaux.
Pas seulement. Le Centre sismologique euro-méditerranéen (Csem), dirigé par Rémy Bossu et qui dépend du CEA, détecte tous les mouvements sismiques. Il a remarqué que dès que se produisait un évènement, les réseaux sociaux s'en faisaient l'écho, plus rapidement encore que les détecteurs sismiques...
Enfin, il est nécessaire de segmenter les risques en trois niveaux : risques courants, risques collectifs concentrés, risques extrêmes et globaux.

Le régime assurantiel s'impose-t-il face à des risques qui, en définitive, ne sont pas si aléatoires qu'on veut bien le dire ?
Il convient d'objectiver les facteurs de catastrophe naturelle tout en évitant un système trop centralisé. Les assureurs sont bien armés pour gérer l'indemnisation des victimes. En revanche, il faut revoir le système mixte avec l'Etat. L'envoi de rapports à une sous-commission du ministère de l'intérieur peut encourager le clientélisme. Je vous transmettrai une note à ce sujet.
De nouveaux outils émergent pourtant : je pense en particulier à l'excellente directive européenne et à l'Observatoire des risques naturels majeurs. La CCR a été obligée de lui transmettre les informations et les données dont elle disposait mais qu'elle gardait jalousement par devers elle au motif qu'elle était liée par accord avec les compagnies d'assurance alors que ces dernières se plaignaient de ne pas avoir accès à ces documents. En fait, c'est le refus de la CCR de délivrer ses informations qui a conduit à la création de l'Observatoire des risques naturels majeurs.

L'Observatoire a-t-il récupéré les trente années de mémoire de la CCR ?
Oui. Nous avons aussi demandé la création d'un Comité des utilisateurs au sein de cet observatoire.
D'autres améliorations ont eu lieu : le régime « cat nat » a été réorganisé au plus près des territoires et des instruments mondiaux ont été créés.
Aujourd'hui, quatre occasions doivent être saisies : la première priorité, c'est la gouvernance. Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) doit fonctionner avec les élus, qui n'y siègent aujourd'hui que rarement. Il faut éviter que ce conseil ne se bureaucratise. Nous essayons donc de modifier son fonctionnement pour que les élus l'investissent. Nous avons signé avec la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) une convention triennale afin d'en modifier la gouvernance. La directive sur les inondations de 2007 a été transposée en 2010 mais son mode de fonctionnement reste très lourd. M. Doligé a fait adopter par le Parlement le principe d'une stratégie pour mieux délimiter les territoires concernés par les inondations mais, depuis, rien n'a bougé.
Le régime de « cat nat » doit évoluer pour ne plus faire remonter systématiquement les dossiers à Paris. Pourquoi ne pas mettre à contribution les commissions départementales auxquelles participent les assureurs ? Evitons la centralisation excessive.
Le département pourrait instruire les dossiers qu'il transmettrait à la région. Ces questions doivent être traitées au plus près des territoires.
Enfin, un comité des utilisateurs de l'Observatoire doit être mis en place avec les réseaux des collectivités locales.
La réforme du régime « cat nat », aujourd'hui piloté par le ministère de l'intérieur, est difficile à mettre en oeuvre. La direction générale du Trésor a concocté sa réforme. Après divers compromis, le projet de réforme est devenu très complexe.

Autrement dit, vous êtes favorable à cette réforme, sous réserve que le principe de subsidiarité s'applique.
Au départ, la direction du Trésor voulait supprimer le régime « cat nat ». Heureusement, ce n'a pas été le cas.

J'en viens à la question de la responsabilité partagée entre préfets, maires, collectivités et particuliers.
Il faut distinguer la responsabilité civile et pénale. Nous connaissons une judiciarisation de notre société, à l'image de ce qui se passe aux Etats-Unis.

Certes, mais les Etats-Unis judiciarisent au civil, nous au pénal ! Ainsi pénalise-t-on les décisions publiques. Paradoxe, s'il n'y a pas de PPRI, les franchises des particuliers augmentent, bien qu'ils ne soient pas responsables.
N'allons pas dans ce sens : l'augmentation des franchises touche inutilement les particuliers. En revanche, je suis favorable à la modulation des primes, ce qui ne devrait pas être pénalisant. A mon sens, un tel système permet d'envoyer un signal intéressant. Cela dit, la modulation doit rester raisonnable. Fixer les primes dans les zones inondables en fonction du risque serait tout bonnement impossible : il faudrait les multiplier par cent.

Ne peut-on moduler en fonction des efforts réalisés par les particuliers ?
Ce serait une bonne chose. Le projet de loi qui a été préparé ne s'applique qu'aux grandes entreprises, lesquelles négocient leurs contrats avec les assureurs. Une telle mesure ne présente donc guère d'intérêt : c'est du pur affichage ! La modulation s'applique aussi aux biens des collectivités.
De quels aléas parlons-nous ? Des séismes, des inondations ?
Le maire de Bordeaux estimait avoir fait beaucoup d'efforts pour traiter les eaux de ruissellement et se désolait qu'on ne lui en témoignât aucune reconnaissance, et que ses administrés n'en tirent aucun avantage, notamment au niveau assuranciel. Le développement de l'intercommunalité est prometteur sur ce plan : voyez l'exemple du Havre.
Il faut penser aménagement du territoire, terrain et vulnérabilité.
Si l'on oppose risque à aménagement du territoire, l'élu se trouve dans l'impossibilité d'agir.
Audition de M. Robert Slomp conseiller au service de la gestion de l'eau du rijkswaterstaat et de M. Carel de Villeneuve conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du royaume des pays-bas en france
Audition de M. Robert Slomp conseiller au service de la gestion de l'eau du rijkswaterstaat et de M. Carel de Villeneuve conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du royaume des pays-bas en france

S'il est un État européen qui a su faire face et s'adapter au risque d'inondation, c'est le royaume des Pays-Bas. Son territoire, dont un quart de se trouve en dessous du niveau de la mer, constitue un débouché naturel pour le Rhin, la Meuse et l'Escaut. MM. Slomp et de Villeneuve auront donc beaucoup à nous dire sur la résilience du territoire, la manière de continuer à l'habiter et à y mener des activités économiques.
Je travaille depuis trois ans pour le ministère de l'environnement après avoir construit des retenues d'eau au Tchad et au Bénin pendant neuf ans. La question de l'eau ne m'est donc pas étrangère !
« Plus jamais ça ! », voilà l'impératif qui a guidé les Pays-Bas depuis les inondations catastrophiques de 1953 qui ont causé la mort de plus de 1 800 personnes. L'organisation du pays en a été bouleversée, les lois ont été modifiées. La gestion de l'eau est devenue un sujet apolitique pour une raison simple : la menace de l'eau pèse sur tout le monde.
Le territoire des Pays-Bas couvre environ la même superficie que celui de la Suisse, soit 40 000 km2 mais, et la différence est importante, 26 % de sa surface se trouve en dessous du niveau de la mer et 55 % de ses terres sont inondables. Nous avons donc fait la guerre contre la mer, non contre nos voisins, avec un niveau de protection qui s'accroît sans cesse. Une tempête avec une période de retour de 10 000 ans se solderait par 4 300 km2 inondés, 10 000 morts et 120 milliards d'euros de dégâts. Ce chiffre est bien plus élevé que le coût du sinistre à la Nouvelle-Orléans, qui est de 2 milliards. Cela dit, il faudrait considérer les conséquences pour toute l'économie américaine, ce qui multiplie le bilan par dix. Le réseau de protection actuel est prévu pour une période de retour de 10 000 ans pour les crues venant de la mer.
Après la catastrophe de 1953, nous avons réorganisé le territoire, réduit de moitié les municipalités et créé 25 autorités régionales de l'eau. Ces assemblées d'élus sont présidées par un « comte de l'eau » nommé, ce qui prouve le caractère apolitique de la gestion de l'eau. Chez nous, il n'existe pas de préfecture ; il fallait donc trouver une solution pour éviter la dispersion.
Après la survenue d'autres catastrophes, nous avons également regroupé les municipalités en 25 unités territoriales de sécurité, qui sont présidées par un maire désigné parmi d'autres. Aux Pays-Bas, tous les maires sont nommés par la reine, leur tâche étant de défendre l'intérêt de la municipalité devant le gouvernement au-delà des partis.
Oui, il date peu ou prou de Napoléon. Les échevins gèrent les grands dossiers dans les municipalités. Le maire ne dispose que d'une voix. Autrement dit, il n'est pas le chef de l'exécutif, si ce n'est sur les questions de police. Récemment, le système a évolué : les élus opèrent un premier choix, proposent le nom de deux ou trois personnes, puis la reine procède à la nomination.
Autres institutions importantes, le centre national de gestion des crises et le centre de coordination logistique et organisationnel, qui veillent à la mutualisation des moyens en cas de crise touchant plus de deux municipalités.
A la suite des catastrophes de 1916 et de 1953, la carte du pays a été modifiée : nous avons fermé le delta de l'Escaut sauf sa partie occidentale pour laisser libre le port d'Anvers, manière de réduire la surface des zones inondables. A l'époque, les inondations étaient surtout liées à la formation de barrages de glace.
Venons-en aux leçons que nous avons tirées de la tempête de 1953 et de ses 1 800 morts. Cet événement majeur, dû à une surcote importante, s'explique d'abord par une mauvaise communication de l'alerte, des missions mal définies entre les acteurs, un mauvais entretien des ouvrages et un financement local insuffisant en raison de la trop petite échelle des municipalités. Pour être complet, il faudrait ajouter que le pays sortait à peine de cinq années de guerre et de la récession des années trente. Les premières décisions n'ont rien coûté, comme réunir les hydrologues et les météorologues dans le même bâtiment afin d'améliorer la prévision et la communication. Cette mesure a été appliquée rapidement. En revanche, le regroupement des pouvoirs publics locaux a pris 50 ans. Des normes nationales de sécurité ont été définies d'abord pour la côte, puis pour les grands fleuves.

Des visites techniques tous les cinq ans, un rapport au Parlement : la prévention des inondations est clairement une cause nationale au Pays-Bas.
Effectivement. Le Parlement tranche sur la répartition des fonds entre digues, postes d'infirmiers et de médecins, etc. L'entretien des digues relève de la solidarité régionale, les constructions neuves de la solidarité nationale.

Qu'en est-il exactement des financements : sont-ils prélevés sur le budget de l'État ou prennent-ils la forme d'une taxe affectée ?
Il y a un impôt national et une taxe régionale prélevée par les autorités régionales de l'eau et décidée par les élus, qui finance le système de pompage et l'entretien des cours d'eau, sauf les grands fleuves qui relèvent de l'État.
D'autres événements majeurs nous ont obligé à améliorer notre gestion de crise : le crash du Boeing 747 d'El Al à Amsterdam en 1992, l'explosion d'un établissement pyrotechnique à Enschede en 1998 qui a nécessité l'envoi de pompiers depuis 100 kms alentour ou encore l'incendie d'une discothèque à Volendam en 2000 où une partie des blessés a été transférée en Belgique. A chaque fois, nous avons réagi trop lentement. Et, dans ces circonstances, chaque minute perdue représente une vie.
Pour la prévention des inondations, il n'existe pas de solution unique.
Il faut analyser les problèmes avant de les résoudre : faut-il privilégier l'alerte ou la sauvegarde ? La réponse dépend du contexte. Ainsi, certaines communes ont décidé de relever le niveau du sol de leur territoire pour réduire les risques d'inondations. Mais c'est une décision locale.

Qui fixe les règles de sécurité lorsqu'une ville décide de créer un nouveau quartier ?
L'autorité régionale de l'eau procède à une analyse. Une négociation intervient ensuite entre la province, qui décide des zones constructibles, et la municipalité, qui délivre les permis de construire. Ce système fonctionne bien dans certains cas, parfois moins bien dans d'autres. Les contrôles sont obligatoires, mais on ne leur donne aucune suite légale.
Les autorités de l'eau donnent leur avis, qui reste consultatif.
La décision est prise par la municipalité, mais la province peut la casser.
Chez vous, on détruit les maisons. Pas chez nous. Plutôt que de démolir, nous construisons des digues.

La loi Barnier permet de détruire des maisons. Vous ne pouvez donc le faire ?
Nous pouvons proposer de les racheter plus cher qu'au prix du marché et espérer que les propriétaires les vendront. En revanche, aucune destruction de maison n'est possible, même si elles ont été construites de façon illégale.
Les échevins. Mais la province donne, ou non, son accord. Elle peut donc bloquer un projet.
Nous avons 95 anneaux fermés qui impliquent des dunes, des digues, des ouvrages d'art.
Oui, et certains sont vieux de 800 ans ! Autrefois, chacun devait donner des heures de travail collectif avant qu'on autorise les paysans à payer une amende lorsqu'ils ne participaient pas aux travaux. Petit à petit, l'amende s'est transformée en taxe.
Notre pays a compté jusqu'à 2 500 anneaux, dont certains n'étaient d'ailleurs pas fermés. Nous avons réorganisé tout cela mais les ouvrages restent locaux.
Il y a 15 000 kms de digues secondaires à l'intérieur des 95 anneaux qui eux-mêmes font 3 500 kms. Quand un fleuve traverse un anneau, il est prévu des réservoirs.
Du sable, de l'argile, des pierres.... En fait, nous avons recours aux matériaux qui se trouvent à proximité de façon à pouvoir réparer ou rehausser les digues. En cas de risque de vagues de 10 mètres, des revêtements spéciaux sont prévus. Enfin, chaque région a ses propres digues construites avec des matériaux spécifiques, afin de réduire les frais de construction.
Il existe des polders de débordement, notamment en Belgique où la réglementation est très rigoureuse. Nous passons des accords avec nos voisins pour éviter des inondations transfrontalières et nos contacts s'améliorent encore grâce à la directive européenne.
Les plages et les zones d'immersion sont gérées par l'autorité nationale de l'eau avec un système de réalimentation de sable pris en mer du Nord et les dunes sont interdites aux touristes afin d'éviter l'érosion. Pour les fleuves, le lit majeur est géré par l'Etat et les digues par l'autorité régionale de l'eau.
Elle est de 1 250 ans pour les fleuves et de 10 000 ans pour la mer.

C'est une construction théorique ! Ce modèle fonctionne jusqu'au jour où les faits le démentent.
C'est un calcul utile néanmoins pour savoir comment utiliser au mieux les 400 millions d'euros disponibles chaque année pour la reconstruction des digues.
Nous bénéficions de nombreuses données, y compris en amont, par exemple les chiffres de Cologne pour le Rhin.
La majorité des ingénieurs le cautionnent et la minorité de sceptiques aide à l'améliorer. Dans les grandes lignes, ces modèles sont fiables, même s'il est toujours possible des les ajuster à la marge.
Parce que la mer monte beaucoup plus vite que les fleuves. Autrefois, on tirait le canon pour alerter la population. En 1953, ne sachant pas quelle zone allait être touchée par la tempête, il fut impossible de savoir où prendre des mesures. Aujourd'hui, il existe un système de surveillance sur toute la côte avec des personnes postées tous les cinq kilomètres, et tous les 500 mètres en zone urbaine. Ces correspondants, qui sont des volontaires bien formés, restent sur les digues durant toute la tempête pour vérifier qu'aucun incident ne survient.
Oui. L'analyse des photos aériennes s'est révélée trop lente, même si elle est utile.
Les choix faits il y a 50 ans ont été bons, même s'il faut sans doute améliorer la protection de la partie centrale du pays.
Oui, il faut prévoir un cycle de huit ans pour l'adoption de nouvelles normes de sécurité par le Parlement afin de protéger la zone qui est restée sensible. De fait, nous avons protégé la côte durant 50 ans, puis les fleuves durant vingt ans ; nous devons maintenant traiter la jonction entre la côte et les fleuves.

Toutes les zones industrielles sont volontairement surélevées, n'est-ce pas ?
Oui, y compris le port de Rotterdam. C'est une question de communication : on est mieux protégé en zone surélevée que derrière une digue. De la même manière, les centrales électriques sont toutes à 5 mètres au-dessus de la mer derrière des digues de 20 mètres de haut.
J'en viens au financement des waterschappen, les autorités régionales de l'eau. Il repose sur trois principes : l'intérêt, le paiement, le droit de vote. Autrement dit, le montant varie selon la valeur du bâtiment et du terrain. Autrefois, le droit de vote était strictement corrélé au montant de la taxe acquittée. Depuis peu, la population détient 50 % des droits de vote.
Ce sont deux choses différentes, mais la base est la même. La municipalité fixe la valeur de la maison, laquelle détermine le montant de la taxe municipale, de celle de l'autorité régionale de l'eau et de l'impôt national.
La révision, désormais annuelle, de la valeur de la maison se fonde sur le prix du marché...
Les propriétaires s'en plaignent car l'immobilier augmente de 5 % par an.
Un budget annuel de 5 milliards d'euros est consacré à l'eau, de l'assainissement à la gestion des canaux et des voies de navigation. Pour les digues, le budget est de 1 milliard d'euros, dont la moitié pour l'entretien et l'autre pour la construction de nouveaux ouvrages. J'ai présenté des chiffres globaux car les waterschappen, installées sur les bassins versants, ont une approche globale de l'eau, de l'assainissement jusqu'aux digues. Les agences ont leur propre banque, notée triple A, gérée par un petit groupe de vingt à trente personnes, qui s'alimente sur le marché. Il n'y en a pas de meilleure en Hollande ! Les collectivités ont aussi leur propre banque...
On dénombre 40 000 emplois dans le secteur de l'eau, dont 15 000 agents publics, auxquels il faut ajouter les 40 000 personnes qui travaillent dans le secteur des deltas technologiques, soit la reconversion de grands ports, sur une population totale de 16 millions d'habitants.
Nous avons également lancé des grands travaux : le plan Delta pour les grands fleuves. Après la première visite technique, nous avons dépensé 1 milliard d'euros ; 2,5 milliards d'euros après la deuxième. Nous avons également un programme pour améliorer l'écoulement du Rhin et de la Meuse.
Les autorités régionales de l'eau ont une obligation d'entretien.
Les autorités régionales de l'eau en sont responsables, sauf pour les petits cours d'eau. Les agriculteurs ont obligation de s'occuper des petits cours d'eau de drainage. S'ils sont pris en défaut, une amende est infligée et le coût des travaux facturé.
La police de l'eau existe depuis le Moyen-âge. Les visites techniques ont lieu deux fois par an. Autrefois, les paysans prenaient en charge les frais d'hôtellerie de l'inspecteur jusqu'à ce que le travail soit accompli. Une technique efficace !
Un troisième programme de 6 milliards d'euros de travaux est en cours de négociation avec probablement un partage entre région et État du coût des réfections, l'État continuant à financer la totalité des constructions neuves. Depuis 2009, il est obligatoire de tenir compte du changement climatique pour les ouvrages neufs, ce qui renchérit le coût des investissements. Un commissaire de la reine a été également chargé de réfléchir à notre modèle de protection à l'horizon 2050 et 2100, qui défendra son projet en conseil des ministres. Un milliard d'euros par an est prévu pour ce programme de recherche. Les budgets sont fixés très à l'avance. C'est un système rigide mais qui garantit que les fonds sont bien utilisés comme prévu.
S'agissant de l'urbanisme, les personnes habitant derrière les digues primaires installées sur les cours d'eau sont intentionnellement exclues de l'assurance : c'est à l'État de payer une partie des dégâts sur ses fonds propres en cas d'inondation, ce qui n'exonère pas les particuliers de couvrir leurs maisons contre le risque d'incendie ou de dégât des eaux dû à une rupture des canalisations.
Dans une région, l'État a remboursé les deux tiers des dégâts. Les propriétaires sont allés en justice pour le tiers restant ; ils ont gagné, mais aucune indemnisation supplémentaire ne leur a été accordée.
Certains partis sont, par principe, contre l'assurance parce qu'elle est assimilée à un jeu de hasard. Cette position bloque la réflexion sur l'articulation entre assurance et solidarité.
Non. En revanche, ils refusent l'assurance-maladie. Il s'agit de 100 à 200 000 traditionnalistes protestants qui sont installés sur la côte depuis 1 600.
Cela dit, la solidarité est très forte à l'intérieur de ce groupe.
D'une part, il ne peut pas couvrir les gros dégâts. D'autre part, il déresponsabilise.
S'agissant de la directive européenne sur le risque d'inondation, nous n'avons pas eu à envoyer de rapport préalable à Bruxelles. Nous nous sommes fixés trois objectifs : 3 600 kms de digues primaires, 15 000 kms de digues secondaires et les 100 000 personnes habitant dans les zones non protégées ainsi que les berges transnationales non protégées.
Enfin, la préparation à la gestion de crise. Chaque année, est effectuée une analyse nationale des risques où l'inondation tient la place plus importante. Les exercices pluridisciplinaires quinquennaux sont essentiels, nous l'avons vu lors de Katrina à la Nouvelle-Orléans, pour trouver un langage commun entre les différents services. Le ministère de l'intérieur a également un programme de communication intitulé « Réfléchis avant ! » ; l'idée est de considérer tous les risques.
Qu'il faut réfléchir à l'organisation dans les moindres détails. Par exemple, on ne peut pas évacuer 1 million de personnes en 24 heures. On a vu des directeurs de maisons de retraite, impuissants, abandonner les personnes âgées dans leur chambre. En Hollande, 4,5 millions de personnes vivent derrière les digues.
Le manque d'entretien et de réseaux fermés provoque également des catastrophes. Un gestionnaire unique est donc indispensable et les agents doivent faire le tour des installations dont ils sont responsables à pied, et non pas en voiture.