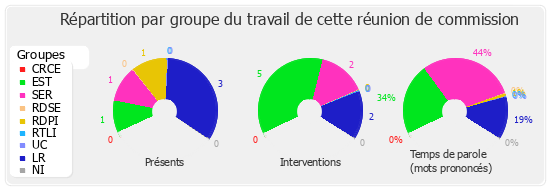Mission d'information sur les pesticides
Réunion du 5 juin 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mm. philippe guichard et patrice marchand [institut technique de l'agriculture biologique itab] (voir le dossier)
- Audition de m. françois veillerette porte-parole de l'association générations futures et mme nadine lauverjat chargée de mission (voir le dossier)
- Audition de m. jean-denis combrexelle directeur général du travail au ministère du travail et de mme patricia le frious chargée de mission sur les équipements de protection individuelle (voir le dossier)
La réunion

Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le détonateur de cette mission fut le cas de l'agriculteur Paul François. La première phase de nos travaux concerne toute la chaîne des pesticides : de ceux qui les fabriquent à ceux qui les utilisent. Elle vise à comprendre les liens entre pesticides et santé. La sûreté d'utilisation peut-elle être améliorée ? Quelles sont les solutions alternatives ? Quid de la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) ? L'agriculture biologique est-elle une solution ?
L'ITAB, depuis peu, centre son travail sur les intrants ; de concert avec l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et la direction générale de l'alimentation (DGAL), il réfléchit à la régularisation des intrants naturels et préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Un dossier pilote est en cours d'élaboration pour la presle. Il y a deux documents provisoires, un dossier-modèle et un document-guide. Mais il existe des blocages, notamment financiers. La loi de finances a fixé la redevance de dépôt entre 40 000 et 200 000 euros...
Nous avons conclu une convention avec le ministère de l'écologie et nous travaillons avec l'ANSES à synthétiser la montagne d'informations nécessaires au dossier pilote. Le critère qu'on nous demande de retenir est l'utilité plus que l'efficacité.
L'utilité, c'est ce qu'il y a dans le Règlement européen. Pour nous, l'efficacité veut dire davantage ; mais il est difficile de la quantifier.

Un produit est utile s'il prévient des maladies mais on ne peut en mesurer l'efficacité dès lors qu'il ne les guérit pas...
En effet. Je suis censé élaborer cinq dossiers sur des substances de base. Il a fallu faire évoluer les mentalités. Quel sens cela a-t-il de s'interroger sur la dose létale du sucre pour les abeilles ? Même chose pour le vinaigre, par exemple, dont on sait qu'il est fongicide. Nous avons une autre convention relative au biocontrôle : quatre dossiers pilote doivent être montés.

Les agriculteurs sont-ils perméables aux techniques biologiques ? Quelles sont les motivations de la conversion de certains ? Opportunité économique ? Volonté d'avoir un label ? Peur du danger ?
Cela fait dix-huit ans que je suis agriculteur bio dans le Lot-et-Garonne. J'étais auparavant chef de culture dans une exploitation de 1 000 hectares en Seine-et-Marne et j'ai eu de graves problèmes de santé à cause d'un pesticide utilisé sur les betteraves.
La situation est complexe. Les groupes de pression agrochimiques cherchent à verrouiller les choses. Moi, j'utilise des substances végétales sans autorisation de mise sur le marché (AMM), qui ne sont pas reconnues comme substances de base, mais qui marchent très bien. On nous empêche d'avancer alors que le bio ne nuit à personne -si ce n'est à certains intérêts économiques.
Il y a de perpétuels blocages administratifs. Il est impératif d'alléger les procédures d'AMM pour ce type de substances. Pour les agriculteurs, c'est invivable. J'utilise des substances interdites et je le revendique ! Mes amis basques aussi utilisent des produits non autorisés, comme les farines de piment. On applique au bio les mêmes réglementations qu'aux phytosanitaires et à la chimie industrielle !
Pour travailler en agriculture biologique, il faut être convaincu : ce n'est pas un choix d'opportunité. J'ai dû faire abstraction de beaucoup de ce que j'avais appris en agronomie. Il faut éviter de calquer un système de production sur un autre.

L'INRA collabore-t-il avec vous pour les expérimentations ? Il semble que 3,5 % seulement de son budget soit consacré au bio.
L'INRA devrait consacrer davantage de moyens au bio. Il faut dire que tous les financements de l'Institut ne sont pas publics. Or les agriculteurs biologiques n'ont pas les moyens de mandater des chercheurs et manquent de soutien politique.
Les études de l'INRA sont plutôt macroéconomiques que techniques. Ce n'est pas notre conception à l'ITAB.
Ah ! En 2012, nous devions recevoir 170 000 euros de FranceAgrimer, soit 15 % de notre budget, mais rien n'a été versé. La situation est malsaine, à croire qu'il y a une volonté de tuer le bio. Il faut pourtant faire de la place à tout le monde. Mon père était agriculteur conventionnel, je ne lance la pierre à personne ; mais, si on privilégie certains systèmes agricoles, il y a un problème d'équité ! Nous recevons aussi 400 000 euros en direct du ministère de l'agriculture. C'est peu, pour vingt salariés et ingénieurs.
Non, nous sommes les seuls, hormis pour les fruits et légumes où le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) intervient -mais la part de recherche et d'expérimentation dans ces domaines est insignifiante.
Oui. Il existe aussi des projets de recherche financés par la taxe qui alimente le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (Casdar), anciennement association nationale pour le développement rural (Anda).

Si les agriculteurs dits conventionnels sont réticents, c'est entre autres parce qu'ils craignent des pertes de rendement. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous fait des études sur le sujet ?
Dans les années 2000, on disait que l'écart de rendement se situait aux alentours de 20 %. Mais il est devenu insignifiant, vu la stagnation des rendements conventionnels.
On généralise trop. Pour les céréales, l'écart est significatif. Mais si l'on prend en compte la matière sèche, le rendement en bio est équivalent, voire supérieur. Pour les oléagineux, les protéagineux ou l'élevage, il n'y a pas de différence. Pour la vigne, la production à l'hectare est largement inférieure en bio, mais c'est délibéré de la part des agriculteurs ; ils font beaucoup d'égrappage et d'effeuillage pour éviter les maladies de la vigne.
Malheureusement, les données des centres de gestion ne reflètent pas la réalité du terrain car beaucoup d'agriculteurs bio n'y adhèrent pas. Ce que je sais, pour avoir de nombreux contacts partout en France, c'est que, sur certains territoires et pour certaines productions, les systèmes bio sont très performants.

Les parcelles bio sont-elles suffisamment protégées des pesticides utilisés dans les parcelles voisines ?
Très clairement, non. Le règlement bio n'impose aucune distance entre les parcelles bio et les autres ; le droit commun s'applique. Mais le contrôle est plus strict, y compris sur la chaîne de transformation.
La cohabitation ne pose pas problème. Je suis le seul paysan bio de ma commune. Je veille à ce que des adventices n'envahissent pas les champs des voisins et ceux-ci veillent à ne pas polluer mes champs. Mais les pollutions fortuites sont inévitables et le ministère devrait mieux les prendre en compte : elles relèvent de la responsabilité civile. Le risque pollution n'est pas assurable. Et il n'y a pas que la pollution industrielle : quid des pollutions intra-agricoles ? Je l'ai d'ailleurs dit au ministère de l'agriculture.

Vous avez choisi le bio à la suite de maladies liées aux pesticides. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je ne cherche pas à apitoyer qui que ce soit... En 1985-1986, j'étais chef de culture sur 1 000 hectares de céréales, betteraves, pommes de terre... en Seine-et-Marne. J'étais chargé du traitement phytosanitaire.
Nous n'avions pas de contact avec elles. Je savais à quel moment traiter.
Avec un tracteur et un pulvérisateur, sans protection : la réglementation était inexistante. D'ailleurs, la moitié des filtres à charbon sont inefficaces, même encore aujourd'hui ! Et puis les vents tournent...
Sept ans. Des plaques rouges sont apparues sur tout mon corps et le lien avec l'utilisation de bétanal a été très vite établi par un grand professeur parisien. Je descendais dans la cuve du pulvérisateur pour la nettoyer...
Nous étions conscients des risques pour les insectes, comme les abeilles. Je faisais attention, je traitais tôt le matin ou tard le soir, en absence de vent... Mais, après être descendu dans la cuve de 3 000 litres, la tête me tournait ! Mon médecin m'a dit d'arrêter ce travail pendant un an. Les symptômes ont disparu. Alors j'ai repris mes études et je me suis installé comme paysan bio dans le sud-ouest.

N'avez-vous plus de séquelles ? Savez-vous si d'autres personnes ont été atteintes ? Le produit a-t-il été interdit ?
Je n'ai plus de séquelles. Pour le reste, je ne sais pas.
Bien sûr. Certaines plantes sont très efficaces, mais la direction générale de l'alimentation (DGAL) nous ennuie ; elle nous demande des études à n'en plus finir ; l'usage de l'Armicarb est interdit, par exemple, alors que ce produit est inoffensif et efficace.

Dans l'autre sens aussi : il y a bien une entreprise qui commercialise l'Armicarb !
Les producteurs utilisent des produits sans autorisation. Heureusement, les contrôleurs savent que nous ne sommes pas des fraudeurs et nous aident parfois à obtenir des autorisations. Ou ils ferment les yeux...

En préambule à votre audition, vous avez déclaré que le déplacement de la mission d'information vous a paru orienté. Pourquoi ?
D'après l'article de Sud-Ouest, vous avez visité l'exploitation du plus grand maraîcher bio du département, celui-là même qui refuse de nous aider à mener des études... Et vous êtes allés voir le plus gros producteur de produits chimiques de France...
Vous êtes aussi allés dans les caves de Buzet, très traditionnelles. Il y a pourtant dans le secteur d'excellents viticulteurs bio.

Nous avons reçu un peu tout le monde et nous allons partout pour avoir une vision objective.
Votre visite dans le Lot-et-Garonne m'a semblé trop orientée...
Je vous invite à lire un article fort intéressant dans Sud-Ouest sur l'utilisation de la presle en maraîchage. Nous essayons d'accompagner ceux qui veulent faire régulariser leurs pratiques. Il y a deux couches de réglementation, phytosanitaire et bio.
Il existe une vraie disparité de réglementation avec les pays tiers.

Travaillez-vous avec vos homologues des pays voisins ? Sont-ils mieux aidés ?

Il nous a semblé utile de vous entendre dans le cadre de cette mission sur les pesticides et la santé. Nous essayons d'avoir les points de vue les plus divers pour nous faire une opinion objective. Nous allons commencer par le plan Ecophyto et la formation agricole.
Merci de nous avoir invités.
Notre association a participé à la conception même du plan Ecocophyto, dans la continuité du Grenelle. L'objectif est la réduction de 50% en dix ans de l'usage des pesticides. Le premier bilan en a été dressé il y a quelques mois : il n'est pas très bon puisque l'indicateur le plus pertinent, le nombre de doses standard à l'hectare (NODU), a augmenté de 2,6 % entre 2008 et 2010. Il ne s'agit pas d'une question de moyens puisque les personnes qui sont en charge d'Ecophyto en ont suffisamment.
C'est l'adhésion des agriculteurs qui fait défaut. Au lieu de changer de système agronomique, d'être en rupture, on optimise l'existant, d'où des objectifs de réduction de 15% à 20 %, pas plus. Or, on n'atteindra l'objectif du plan qu'avec des systèmes de production intégrés, concept un peu neuf en France dans la période récente. A l'inverse, la culture raisonnée est une autre forme d'agriculture intensive, ce que l'INRA reconnaît. Les systèmes de production intégrés sont conçus pour être plus robustes, plus résistants, grâce à des choix variétaux différents ou à des démarches agronomiques différentes.
Les fermes de référence DEPHY n'ont pas toutes les mêmes ambitions : moins 50 % pour certaines, beaucoup moins pour d'autres. Il faudrait mettre en place des réseaux de centaines de fermes visant les moins 50 %, qui seraient les éclaireurs de la profession. Sinon on n'atteindra pas les objectifs du plan.
Il existe de très bons formateurs qui animent des réseaux et font eux-mêmes moins 50 %, voire moins 60 %, avec des performances économiques excellentes.

Pourquoi les choses ne vont-elles pas plus vite ? A cause de rendements moindres ?
Les rendements sont inférieurs, mais la rentabilité est équivalente, voire meilleure.
C'est une question centrale. En céréales, à partir de 200 € la tonne, la course au rendement redevient intéressante ; mais en deçà, les systèmes à bas niveau d'intrants sont rentables. Il n'y a pas d'avantage comparatif vraiment clair pour un système ou un autre.
On va perdre 10% de rendement mais il ne faut pas confondre rendement et rentabilité. Je ne crois pas que la France ait une vocation exportatrice au-delà d'un certain niveau. Certes, l'humanité devra nourrir neuf milliards d'humains mais la France n'y suffira pas ! Nous devons parvenir à un équilibre satisfaisant pour la France comme pour l'Europe. En outre, nos exportations subventionnées ont plombé la production agricole des pays tiers. En Afrique, une meilleure agronomie, voire le passage au bio feront augmenter les rendements ! Nous devons laisser ces productions émerger, vivre par elles-mêmes. Et puis nous pouvons exporter nos savoir-faire en agronomie.

Parlez-vous de systèmes de production sans pesticides ou atteignant l'objectif d'une baisse de 50 %?
Je parlais des systèmes de production intégrés, qui font du moins 50 %, pas du bio.

Dans mon département, je plaide pour que tous les agriculteurs fassent partie d'un centre de gestion, y compris les agriculteurs bio. Mais j'ai du mal à convaincre.
Il faut accompagner les agriculteurs qui veulent se lancer dans cette aventure, les centres de gestion y contribuent. Les retours d'expérience existent, les bilans agro-économiques aussi. On sait le faire.
Les objectifs que l'on s'est assignés sont un peu faussés puisque 70 % des parcelles étaient déjà en deçà du seuil fixé. Il y a des biais évidents. Les indicateurs de référence sont anormalement élevés. Un message politique fort et clair est nécessaire, pour obtenir l'adhésion de tous sans contraindre.
Le cadre européen nous aide, notamment l'article 14 de la directive 2009/128 qui impose de privilégier, chaque fois que c'est possible, les méthodes non chimiques et ,à la fois, les pratiques et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé et l'environnement ; il fait, en outre, obligation aux États de mettre en place des plans d'action nationaux - pour la France, c'est Ecophyto. Si l'on veut que ce plan réussisse, le dialogue avec la profession agricole est très important. Dans les années 1950, il fallait produire plus. Désormais, la société demande à l'agriculture de produire mieux et de préserver l'environnement - ce que la France fait lentement. Nous devons avancer, aller de l'avant, mais sans accuser.
Le Danemark, par exemple. Mais les Danois ne sont pas bons pour l'élevage de cochons ! Ils le sont pour les céréales.

Les pressions de l'industrie agro-alimentaire sont une contrainte... C'est compliqué pour un agriculteur d'être parfaitement en adéquation avec ce qu'attend de lui la société...
Un agriculteur a besoin de formation et d'information pour surmonter ses appréhensions et passer à un système de culture intégré.

Que pensez-vous de la formation initiale et continue des agriculteurs ?
La formation initiale progresse mais elle peut encore s'améliorer quant au bio. Même si l'on arrivait à 20 % de surfaces bio, que faire des 80 % restants ? Des systèmes intégrés performants seront nécessaires.
Il faudrait que le bio soit enseigné obligatoirement dans les lycées agricoles. Les techniciens des chambres d'agriculture n'ont pas changé depuis 2007 et tous ne sont pas convaincus de la nécessité ou de la possibilité de réduire de 50 % les intrants.
En Picardie, région de forte production, la perte de rendement est de 20 à 30 quintaux pour les céréales. Si on avait investi davantage dans la recherche en bio ces vingt dernières années, sur les techniques, la fertilisation, les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), les variétés, les rendements en bio seraient bien supérieurs. Il ne s'agit pas de reprendre la course aux rendements, mais je ne suis pas pour une agriculture bio de témoignage ! Il faut favoriser l'homologation des PNPP.
Nous nous trouvons dans un contexte économique difficile. Pourquoi concentrer toute la recherche dans la génétique ? La recherche sur les systèmes à bas niveau d'intrants, celle sur la diversité variétale mériteraient d'être davantage financées. Ce sont des choix politiques. Comme il sera ardu d'obtenir des crédits supplémentaires, on peut agir autrement, par exemple en rééquilibrant les coefficients pour l'entrée des variétés au catalogue ; ce serait assez simple et ne coûterait pas un centime. Pour les cultures pérennes, de gros efforts de recherche restent à faire : lorsqu'on change de variétés de pommiers ou de vigne, il vaut mieux ne pas se tromper ! Et ce sont des cultures qui ont un indicateur de fréquence de traitement élevé.
J'en viens à l'aspect santé. J'ai été choqué de la présentation des derniers travaux d'Agrican. On y dit haut et fort que les agriculteurs vivent plus vieux, souffrent moins du cancer, et l'on passe sous silence les données les plus préoccupantes : voyez le communiqué de presse !

Nous avons entendu l'auteur de l'étude, autant le laisser s'exprimer lui-même.
Il n'est pas lui-même en cause : il ne maîtrisait pas la communication de la MSA. Mais celle-ci peut mettre à mal des années de sensibilisation à la dangerosité des produits.
D'autant que la littérature scientifique est abondante. Selon une revue bibliographique canadienne, plus de 80% des études scientifiques depuis 2004 montrent un lien entre l'exposition aux pesticides et des maladies neuro-dégénératives, des cancers, des troubles respiratoires ou de comportement. Aux États-Unis d'Amérique, un rapport remis au président Bush a mis en évidence les problèmes liés aux pesticides : cancers, maladie de Parkinson, troubles comportementaux... Sans compter que les coûts budgétaires directs et indirects des nouveaux cas de cancers dans le monde sont extrêmement élevés, estimés à 12,8 milliards de dollars.

Grâce à cette mission, nous allons progresser, j'en suis persuadé. Personnellement, je crois qu'il y a un lien entre les pesticides et le développement de certaines maladies. Tout récemment, l'assemblée générale de l'association Phyto-victimes, s'est tenue dans mon département, avec une table ronde et la projection du film « La mort est dans le pré », cependant la mobilisation dans mon département n'est pas encore au rendez-vous.
Les agriculteurs sont des gens de mieux en mieux sensibilisés aux problèmes de santé mais ils ne se voient pas travailler en combinaison de cosmonaute... Que proposez-vous pour qu'ils s'impliquent ? Je pense qu'il faut les aider davantage avec le concours des professions de santé.
On dit aux agriculteurs que leurs pratiques peuvent être nocives pour l'environnement et pour leur santé, mais on ne leur donne pas la possibilité ni les moyens d'en changer. Ils sont dans un entre-deux difficile à vivre, entre l'impératif de production et l'attention à porter à l'environnement et à la santé. C'est aux pouvoirs publics d'intervenir, de tirer la profession mais également la société ! Il y aussi un problème de la qualité des aliments.
Nous avons remis un cahier de doléances. Avant même de parler de protection individuelle, qui est une solution de bout de tuyau, il faut changer l'agronomie, ce qui passe par de la formation sur le terrain - « par-dessus la haie » - puis par de l'accompagnement et du conseil, . C'est le sens du plan Ecophyto. Des fermes de référence sont indispensables afin que tous les acteurs se saisissent de ces questions.
Nous avons notre part de responsabilité ; nous parlons avec les agriculteurs. Mais notre rôle, c'est aussi de donner un coup de pied dans la fourmilière. Nous devons trouver des valeurs communes plutôt que de mener des guerres de tranchée car, sinon, à l'échéance du plan Ecophyto, nous établirons un constat d'échec. D'abord en matière de santé. En dépit de l'industrie du doute.
En second lieu, il faut interdire un certain nombre de substances véritablement nocives. Ecophyto n'est pas allé assez loin. Je pense aux perturbateurs endocriniens. Notre crainte est qu'on en revienne à l'évaluation du risque, alors que l'idée de départ, c'était un critère d'exclusion. Ce sont l'Allemagne et l'Angleterre qui poussent parce que ce sont elles qui fabriquent pas mal de ces produits. La France devrait taper du poing sur la table pour que les perturbateurs soient définitivement interdits. La stratégie européenne sur les effets des mélanges a aussi été affaiblie ; le Gouvernement français devrait peser contre cela..
Sans parler des systèmes dérogatoires... La législation européenne a parfois été dévoyée. La France en a usé et abusé - notamment la dérogation de cent vingt jours. Et l'Union européenne a inventé une procédure allégée de re-soumission. On dit au producteur : vous manquez de données ? On verra plus tard, en attendant votre produit est autorisé... On est en procédure face à la commission européenne là-dessus. Les vieux produits, comme le Malathion, doivent dégager du marché... L'épandage aérien est soumis à un principe d'interdiction - mais il y a tellement de dérogations...
Les AMM se décident entre trois ministères : santé, écologie, agriculture. On a avancé depuis que l'ANSES a davantage de moyens pour évaluer les dossiers, mais les dossiers restent soumis par les industriels eux-mêmes.
On l'a vu avec le Roundup, quand on veut un contrôle citoyen sur l'AMM d'un produit, on se heurte au secret industriel. Comment avoir la preuve que c'est bien la formule exacte qui a été testée ? Il faut supprimer ce plafond de verre.
L'État n'est d'ailleurs pas en mesure d'évaluer correctement les dossiers remis par les industriels. Le choix des experts et les conflits d'intérêt doivent être examinés de plus près. L'État doit rendre son système plus exigeant.
Enfin, l'EFSA, qui évalue les substances actives et a posé quelques problèmes ces années passées, a proposé une procédure simplifiée d'homologation pour les produits chimiques et les pesticides, appelée seuil de préoccupation toxicologique, en cédant à une vieille demande de l'industrie chimique. Cela entraînerait une hausse des seuils de tolérance d'exposition aux produits... au lieu de rendre le système d'évaluation plus exigeant.

La France est-elle toujours le premier pays utilisateur de pesticides ?
En Europe, oui, mais pas dans le monde où elle se situe au quatrième rang.
Audition de M. Jean-Denis Combrexelle directeur général du travail au ministère du travail et de Mme Patricia Le frious chargée de mission sur les équipements de protection individuelle
Audition de M. Jean-Denis Combrexelle directeur général du travail au ministère du travail et de Mme Patricia Le frious chargée de mission sur les équipements de protection individuelle

Quel est le rôle de la direction générale du travail (DGT) en ce qui concerne la fabrication et l'utilisation des pesticides ? Que pouvez-vous nous dire des équipements de protection ?
A la direction générale du travail, une sous-direction est en charge des conditions de travail ; un bureau est plus précisément en charge des équipements de protection. Le dossier des pesticides est partagé avec le ministère de l'agriculture.
La DGT n'a pas la religion de l'équipement de protection individuelle (EPI). Le principe de base, conformément aux directives communautaires et au code du travail, c'est de tout faire pour que les produits utilisés n'exigent pas de tels équipements : pour que soient utilisés, dans la mesure du possible, les produits les moins nocifs pour les salariés. C'est le principe de substitution. Au niveau de l'entreprise, un document unique sur la prévention des risques doit traiter la question. Le deuxième niveau, c'est l'organisation de la protection collective grâce à des modes de fabrication industriels sûrs. L'équipement individuel ne vient qu'ensuite. Cela ne vaut pas que pour les pesticides.
S'agissant des EPI, le rôle de la direction générale du travail est triple. Les directives dites « de nouvelle approche » de 1989 concilient liberté de circulation et protection des salariés : dès lors que les équipements répondent à des normes européennes harmonisées, ils bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences de la directive. La DGT travaille à l'élaboration de textes communautaires. Ensuite, nous organisons, par l'intermédiaire d'organismes notifiés, des tests sur les équipements mis sur le marché et, en cas de risque grave ou mortel, des tests sur les équipements en cours de fabrication. Enfin, la DGT est chargée, avec d'autres administrations dont les douanes, de la surveillance du marché. Il peut résulter de tout cela des modifications des normes applicables.
Quels sont les risques ? On parle beaucoup dans le monde agricole d'intoxication par voie respiratoire ou digestive, mais le principal risque, c'est la contamination par voie cutanée.
Oui et sur des études scientifiques. Le risque cutané est sous-évalué.
Les fabricants sont souvent spécialisés. En France, il existe quelques grandes entreprises comme Dupont de Nemours ou Kimberly Clark...

Les combinaisons sont-elles conçues eu égard à la dangerosité des substances ?
Elles sont conçues pour protéger contre quelques substances bien identifiées. Les résultats des tests figurent sur la notice qui doit obligatoirement accompagner le vêtement. A ma connaissance, un seul fabricant de pesticides a créé sa propre combinaison. Lors des tests, on voit ce qui traverse le tissu et ce qui ne le traverse pas.
A priori, oui. Dans les conditions d'utilisation finale.

Si un agriculteur équipé tombe malade, le fabricant de la combinaison est-il responsable ?
Nous nous interrogeons sur les modes de fabrication, les procédures d'AMM... Mais je ne crois pas que la question de la responsabilité soit centrale.

Mais on reproche à un agriculteur charentais de ne s'être pas assez protégé ! Qui est responsable ?
Je ne nie pas qu'il y ait des responsabilités, mais je ne crois pas qu'il faille commencer par là...
Certaines protègeront contre huit produits, d'autres contre deux. Mais le problème, c'est le produit qui est réellement utilisé, sans compter que les pesticides sont souvent des mélanges. Utilisée de manière non conforme, une combinaison est-elle efficace ? On n'en sait rien.

Qui réalise les essais préalables ? Y a-t-il des contre-expertises ou toute confiance est-elle faite au fabricant ? Le ministère délivre-t-il lui-même l'autorisation ?
Les tests sont réalisés par les organismes de contrôle. Non, il n'y a pas d'AMM ou équivalent pour les équipements de protection.
Les organismes notifiés sont indépendants des fabricants...

Mais qui est responsable en dernier ressort ? Le producteur de molécules ? Le fabricant de l'EPI ?
De même qu'on ne peut pas poser dans l'absolu la question de l'efficacité de chaussures de sécurité, puisque tout dépend du chantier, l'efficacité de la protection varie selon les cas. Le premier responsable de la santé des salariés, c'est l'employeur, qui peut éventuellement faire jouer un recours en garantie contre le fabricant.
Il n'y a pas d'homologation, nous parlons d'évaluation, de certification CE. L'État ne délivre pas d'AMM mais exerce un contrôle a posteriori.
Nous coopérons avec la douane, qui contrôle les produits à l'importation. Par la suite, la DGCCRF et la DGT peuvent aussi les contrôler ; nous avons interdit deux modèles de combinaisons en 2007.

Les agriculteurs sont-ils informés ? Faites-vous des campagnes de prévention auprès d'eux ?
Nous avons constaté que l'information délivrée sur les points de vente était médiocre. Il y a de gros efforts à effectuer dans ce domaine. Nous avons déjà créé des espaces « santé-sécurité » en Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées, dans les Pays de la Loire et en Bretagne.

Les combinaisons sont-elles jetables ? Peuvent-elles être lavées ? Recyclées ?
Pas toujours. Les équipements usagés sont traités comme le sont les pesticides.

Le mieux, est-ce de jeter une combinaison après l'avoir portée une journée ?
Oui, car les produits l'ont déjà imprégnée. Les fabricants n'indiquent pas comment les laver, puisqu'elles sont censées être à usage unique. Les normes sont en cours de révision : une étude de l'ANSES en 2007 en a montré les lacunes. Nous souhaitons que la notice indique clairement quant l'EPI doit être jetée.
Comme le reste. Outre la conception, les conditions d'utilisation d'un équipement peuvent le rendre inadapté. Ce n'est pas propre aux pesticides.

Vous avez dit qu'un fabricant de pesticides produisait aussi une combinaison qu'il testait lui-même. L'industrie des pesticides ne devrait-elle pas assumer la charge des essais ?
Je ne suis pas sûr qu'il suffise d'assigner des responsabilités pour améliorer la prévention et la santé des salariés...
Actuellement, des pesticides sont autorisés sans que l'on soit sûr que des EPI adaptés existent : c'est à l'organisation du système qu'il faut réfléchir. La question centrale est celle de l'adéquation entre le produit et l'EPI.

Pourtant, les tests sont réalisés par l'ANSES en situation de port d'un EPI.
En théorie. Il faut tout faire pour que les entreprises utilisent les produits les moins toxiques ; à défaut, il faut être sûr que des EPI adaptés existent.

C'est ce qu'ont tendance à croire les agriculteurs. Ils font confiance aux fabricants. Dans la réalité, ils ne sont pas toujours protégés...
Portent-ils toujours leurs EPI ? Tout le monde doit avoir conscience des problèmes de santé que posent les pesticides : en ce sens, on peut parler de responsabilités partagées, celle des entreprises, de l'État, mais aussi celle des salariés et des utilisateurs. Si un maillon de la chaîne ne joue pas le jeu, c'est toute la chaîne qui est fragilisée.

L'existence d'une AMM rassure... Il y a une question de confiance ! Mais il semble qu'on puisse douter de la fiabilité des EPI, notamment si les adjuvants ne sont pas testés.
Un vêtement de protection ne protège pas contre tout !

S'il existait un EPI universel, les utilisateurs seraient protégés mais pas l'environnement...

La société qui veut commercialiser un pesticide n'est-elle pas la mieux placée pour commercialiser l'EPI idoine ?
En effet. Mais là où l'on peut progresser le plus, c'est sur les conditions de mise sur le marché.

La firme serait responsabilisée. Combien coûte une combinaison ? Une protection complète ?
Je ne connais pas le détail des prix mais le coût n'est pas négligeable.
Vous dîtes que ceux qui fabriquent des pesticides sont les mieux à même de créer des vêtements... Les fabricants d'EPI se plaignent de ne pas avoir accès à la formule des produits. La recherche s'en trouve compliquée...

Les scientifiques s'en plaignent aussi... L'État ne fait-il pas trop confiance aux fabricants ?
L'État n'est pas là pour être confiant mais vigilant. S'il faut modifier une procédure, nous le faisons.
L'État n'a pas des moyens illimités. Mais il n'est pas seul : l'ANSES a son rôle à jouer ainsi que les organismes notifiés.

On pourrait exiger des fabricants de produits qu'ils procèdent eux-mêmes aux tests et, pourquoi pas, fournissent les EPI. Ils exerceraient alors pleinement leur responsabilité.
La responsabilité du fabricant existe. Si son produit ne répond pas aux préconisations, elle est engagée.

Puisque les fabricants ne veulent pas livrer leurs secrets de fabrication, qu'ils fournissent les protections !
Tout en respectant le secret des affaires, une meilleure coopération entre fabricants de pesticides et d'EPI serait souhaitable. Je rappelle que le secret industriel n'est pas opposable à l'ANSES.
Sans doute. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un marché franco-français.

Des bassins industriels qui ont souffert de la crise du textile pourraient utilement se reconvertir : il existe à Castres un laboratoire sur le textile-santé.
C'est vrai, mais tout le monde n'en est pas persuadé. La meilleure protection, c'est l'absence de danger. Le message n'est pas toujours facile à faire passer.