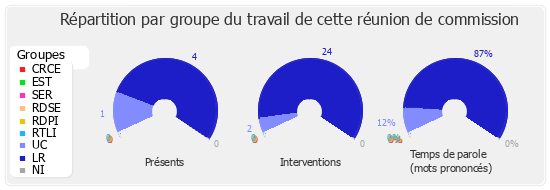Mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe
Réunion du 19 juin 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. julien bigand trésorier adjoint responsable du dossier viande et mme suzanne dalle conseillère en production animale du syndicat professionnel des jeunes agriculteurs ja (voir le dossier)
- Audition de mm. michel prugue président et christian marinov directeur de la confédération française de l'aviculture (voir le dossier)
- Audition de m. gilles rousseau président et mme aurore guénot conseillère de la fédération française des marchés de bétail vif fmbv (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Julien Bigand trésorier adjoint responsable du dossier viande et Mme Suzanne dalle Conseillère en production animale du syndicat professionnel des jeunes agriculteurs ja
Audition de M. Julien Bigand trésorier adjoint responsable du dossier viande et Mme Suzanne dalle Conseillère en production animale du syndicat professionnel des jeunes agriculteurs ja

Notre mission commune d'information, constituée à la suite du scandale de la viande de cheval s'intéresse à tous les aspects de la filière viande, et nous sommes particulièrement inquiets sur la question de l'installation et du renouvellement des générations en élevage.

Qu'est-ce qui, selon vous, rend l'installation des jeunes agriculteurs si difficile en France, notamment dans l'élevage. Les contraintes sont-elles plus lourdes dans notre pays qu'ailleurs ? Que faut-il faire pour redonner de la jeunesse à notre agriculture ?
Je commencerais par la polémique de la viande de cheval.

Ce n'est pas une polémique mais un scandale ! Il y a eu tromperie, et par conséquent la confiance des consommateurs a subi une grave atteinte.
Les conséquences ont été faibles sur la consommation de viande de boeuf. Les restaurants et boucheries hippophagiques ont, elles, attiré les foules.

Le tonnage de viande de cheval n'a toutefois pas considérablement augmenté pour les éleveurs français.
C'est un autre problème. Les producteurs et les consommateurs ont été, il est vrai, trahis. Nous rejoignons là les questions de traçabilité et d'installation, car en définitive la question qui se pose est celle du sens que l'on donne au métier d'éleveur. Nous produisons pour satisfaire la demande du consommateur. Le consommateur a le droit de savoir ce qu'il achète. De la même façon, le producteur doit savoir à qui il vend sa production, qui la transforme, et qui la consomme. Nous sommes allés trop loin dans l'opacité. Améliorer la traçabilité des produits, c'est le sens de l'histoire. D'importants progrès ont été réalisés à la suite du scandale de la vache folle : bouclage des bêtes, généralisation des passeports sanitaires des animaux, traçabilité des différentes parties des bêtes abattues. Cela participe de la valeur ajoutée de la production animale.

Nous sommes d'accord. La traçabilité des viandes fraîches a été un grand progrès pour tous. La question est de savoir s'il faut aller plus loin, en appliquant les mêmes règles aux produits transformés à base de viande.
En parlant, à juste titre, de scandale de la viande de cheval, vous avez-vous-même répondu... La balle est désormais dans votre camp !
Il faudra peut-être faire encore plus...

Tout le monde est favorable à davantage de transparence. Mais laquelle ? L'origine des bêtes ne pose pas de problème. Faut-il indiquer la race - race à viande, race laitière, race mixte ? Les transformateurs et l'Union européenne défendent la mention « viande européenne ». Qu'en pensez-vous ?
Je suis favorable à l'idée d'indiquer la race. Ceux qui s'y opposent se disent libéraux, mais ne cherchent qu'à protéger des minerais sur lesquels ils ont tout pouvoir. Nous avons en France la plus grande variété de races bovines, donc les moyens de nous différencier. Confondre d'excellentes races comme la montbéliarde ou la normande avec le premier minerai venu, c'est saccager le travail des syndicats de race depuis leur création - et les livres généalogiques des races existent depuis plus de cent ans.

Les transformateurs, lorsqu'ils fabriquent du minerai, et nous l'avons constaté, ont les plus grandes difficultés à distinguer les races. Ils ne peuvent faire la différence qu'entre le veau et la bête adulte. Je partage votre souci de restaurer la confiance du consommateur, mais comment faire ?
Chacun son problème ! Aux transformateurs de trouver une solution. Lorsque l'on abat 40 000 à 50 000 tonnes d'un coup, il y a bien un moyen de faire des lots, quitte à ce que les produits transformés d'une même marque, pris séparément, ne soient pas tous composés de viande de la même race bovine. En tant que consommateur, ces informations me suffiraient.
C'est un minimum.

Mais chez certains transformateurs, l'origine des viandes change tous les jours, dans des proportions elles-mêmes variables. C'est pourquoi j'avais proposé que l'on impose pour chaque produit un pourcentage fixe de viande française.
Il ne faut pas sous-estimer la puissance des industriels, et donc ne pas avoir peur d'aller trop loin. Ceux-ci ajustent la composition de leurs produits en fonction de leurs stocks de matière première et de son coût. On pourrait à la rigueur l'accepter, à la condition qu'ils s'engagent à être transparents : si le lundi ils transforment de la viande allemande, le mardi de la viande polonaise, le mercredi de la viande française, qu'ils changent alors chaque jour l'étiquette. On arrive bien à aller sur la lune : on doit pouvoir mentionner ces informations.
Vous connaissez les chiffres de la statistique agricole de décembre 2012 : la santé des éleveurs est mauvaise. L'écart est important avec les céréaliers, et la situation est en outre très hétérogène. Les revenus annuels des éleveurs de porcs subissent d'immenses fluctuations, entre une perte de 4 000 euros pour les plus malheureux et un gain de 40 000 pour les plus performants. Les professionnels de la filière acceptent cette volatilité, inscrite dans le marché depuis toujours, mais ils auraient besoin d'outils pour la gérer.
Les éleveurs de vaches laitières et allaitantes perçoivent un revenu de l'ordre de 5 euros de l'heure. Quand on connaît les contraintes auxquelles ils sont soumis, ce n'est pas admissible. Certes, le prix de la viande a beaucoup augmenté, mais il demeure au même niveau, en monnaie constante, qu'il y a vingt ans. Les subventions et primes de l'Union européenne déversées sur les exploitations ont donc été absorbées par les autres acteurs de la filière, puisqu'elles ne vont pas dans la poche des producteurs.

Dès lors, comment convaincre les jeunes agriculteurs de reprendre des exploitations dédiées aux productions animales ?
Il y a des bassins de production animés d'une vraie dynamique : les producteurs de lait à comté n'ont par exemple pas de mal à trouver un repreneur. De même pour l'AOC reblochon. Dans ces deux cas, les aides à l'installation et le prix de vente sont élevés. Les productions moins rémunératrices suscitent moins d'engouement.
Faire venir des jeunes dans nos métiers est compliqué. Il ne faut pas se limiter au métier d'éleveur, car nous avons aussi besoin de gens dans les abattoirs et les industries de transformation. Il faut travailler sur la promotion du métier. Au Salon de l'agriculture, nous tenons des stands dans le cadre de l'opération « demain je serai paysan ». Nous intervenons dans les lycées pour présenter le métier de producteur, et essayons ainsi de soustraire une partie de la communication sur notre secteur à ceux, souvent anti-viande, qui s'y emploient le plus fréquemment.

Lorsqu'un jeune s'oriente vers une filière de qualité, il a moins de difficulté à gagner sa vie ?
Il n'est pas plus facile de s'installer, mais l'existence d'un noyau dur de passionnés qui font le maximum pour reprendre les exploitations crée une dynamique positive. Le niveau de revenu est quant à lui assuré par la qualité de la production, et la faculté qu'ont les exploitants à gérer leur production en fonction de ce qu'ils sont capables de vendre.

Ceux qui proposent de déménager le site de l'Institut national des appellations d'origine (Inao) de Poligny à Dijon, parce que c'est une capitale régionale, n'ont rien compris.
Il y a certes peu d'agents à l'Inao de Poligny, mais le nombre important d'AOC fromagères de qualité dans le Jura et le Doubs justifierait de l'y maintenir.
Elles sont plus dispersées.

Le ministre de l'agriculture actuel, comme son prédécesseur, ou comme Jean-Paul Bigard, vont répétant que le prix de la viande payé au producteur a augmenté considérablement depuis deux ou trois ans. Ces affirmations camouflent des réalités très disparates, et ne servent pas le combat que les agriculteurs mènent pour s'assurer un niveau de revenus décent. Qu'en pensez-vous ?
On ne pourra pas dire que le Sénat traite ces sujets avec légèreté... Nous avons déjà effectué beaucoup d'auditions. Nos travaux m'ont rendu inquiet de la position qu'occupe Bigard sur la chaîne de production. L'entreprise accapare entre 55 % et 65 % du marché de la viande en grande surface. Cela me semble dangereux. Le secteur coopératif, pas assez puissant, a été lessivé, et ne peut plus être tenu pour une référence alternative. Quelle est la position de votre syndicat sur cette question ?
Il y a quelques années, les prix de la viande étaient si bas qu'ils ne pouvaient qu'augmenter. Cette évolution a en effet été rapide au cours des vingt-quatre derniers mois. Une vache de réforme se vendait alors entre 2,50 et 2,70 euros, contre 3,50 à 3,70 euros aujourd'hui, et plus de 4 euros pour une vache allaitante.
Mais il faut compléter l'information, en mettant en parallèle la hausse des charges imposées aux exploitations : hausse du prix du pétrole, des céréales, exigence de mise aux normes des bâtiments, des équipements, augmentation des charges sociales. Entre 2002 et 2006, le coût des bâtiments a augmenté de 55 %. L'investissement dans des bâtiments performants peut se justifier, mais il faut pouvoir le consentir... Le capital à mobiliser pour un jeune qui s'installe en lait ou en viande bovine est aujourd'hui estimés entre 300 000 et 400 000 euros, 500 000 dans le porc.

Ces normes vous sont imposées lorsque vous agrandissez votre exploitation ?
Oui, mais aussi lorsque vous vous installez. La reprise d'une exploitation est assortie d'un délai de trois ans de mise aux normes.

Avez-vous des statistiques précises sur le coût d'une installation selon le type de production ?
Une installation coûte environ 378 000 euros en viande bovine. Il est difficile d'avoir des chiffres précis, qui agrègent ceux que l'on peut collecter à l'échelle d'une exploitation. J'en profite pour attirer votre attention sur le manque de moyens des organismes chargés de récolter ce type de données, comme Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, dont le budget recule chaque année.

Au niveau syndical, vous avez sans doute des études ou des informations permettant de se faire une idée.
Au Congrès des jeunes agriculteurs, le président des jeunes agriculteurs François Thabuis a demandé que les jeunes agriculteurs animent l'Observatoire national de l'installation, dont les informations ne permettent pas aujourd'hui de dépasser l'échelle régionale à laquelle nous sommes encore cantonnés.

Les services statistiques des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) fournissaient dans le passé de telles informations.
Pourquoi ne le font-ils plus ? Il faut préserver ces outils.
Nous avons rencontré Jean-Paul Bigard, qui nous est un excellent professionnel. Il nous a déclaré détenir 40 % du marché de la viande française, et 80 % des steaks hachés, issus des vaches de réforme laitières. Mais ce n'est certainement pas de lui qu'il faut attendre une augmentation des prix payés aux producteurs ! Ce sont les exportations vers les pays tiers, comme la Turquie, dont la demande a mis notre offre sous tension, qui ont poussé les prix à la hausse.
Si Bigard fait 40 % du marché, la coopération représente tout de même 30 % de celui-ci. Nous lui avons demandé pourquoi elle ne parvenait pas à faire augmenter les prix : elle nous a répondu que son pouvoir de marché n'était pas suffisant. Il y a peut-être un problème de répartition de la valeur. Ces deux acteurs sont mus par des logiques différentes. Lorsque j'achète de l'aliment à ma coopérative, l'une de ses entités achète des céréales, une autre revend des aliments, or elles ne se font pas forcément de cadeaux. Il y a peut-être également un problème de connivence entre le maillon qui vend les bêtes vivantes, et celui qui les vend une fois abattues.
Certes. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toujours bien gérées. Bigard a repris et redressé des coopératives qui étaient dans le rouge. Inversement, si le groupe Bigard était en vente demain, la profession saurait-elle le reprendre ? Laisser partir le centre de décision dans un autre pays aurait des conséquences nettement plus graves que celles que l'on prête aujourd'hui au poids de ce groupe sur le marché.

Spanghero appartenait à la coopérative Lur Berri. Cela pousse à s'interroger sur leurs pratiques.
Une coopérative reste une entreprise privée. Elle appartient à des coopérateurs, mais ceux-ci attendent d'elle qu'elle soit puissante et qu'elle ramène de l'argent. Je délègue à la mienne la commercialisation de ma viande bovine ou de mes céréales, et j'entends qu'elle le fasse au meilleur prix. Lorsqu'une entreprise périclite, on frappe souvent à la porte de la coopérative pour qu'elle la reprenne. La coopérative étend son activité, ce n'est pas un mal mais complique l'appréciation de son fonctionnement par les adhérents, à plus forte raison lorsqu'ils n'ont pas accès aux comptes des filiales.
Il n'y a aucune obligation dans ce sens. Les administrateurs n'ont pas de droit de regard sur la gestion des filiales.

C'est pire que ce que je pensais ! Un groupe industriel publie les comptes des ses filiales, et pas les coopératives ? J'ai travaillé dans l'Aisne plus de trente ans. Les coopératives devraient apporter un plus à l'agriculture. Or certaines souffrent financièrement !

Il y aurait un effort à accomplir, y compris sur la situation des filiales. Elles devraient publier des comptes consolidés. Mais les coopératives s'enferment dans le ronronnement de leur fonctionnement quotidien, et leurs adhérents ont d'autres priorités, ils sont le nez sur le guidon dans leur exploitation. Les torts sont partagés.
En matière de gouvernance des coopératives, les propositions de notre rapport d'orientation se sont davantage portées sur le cumul des mandats, et sur la longévité de certains administrateurs ou présidents. Nous défendons le renouvellement des générations de dirigeants, pour redonner de la dynamique au secteur.

Mais y a-t-il des candidats ? Les éleveurs ont d'autres préoccupations, rechignent à abandonner leur ferme le temps d'une réunion, il faut supplier certains de se présenter, et ce ne sont pas toujours les plus compétents qui acceptent.
Absolument. Le problème est amplifié dans l'élevage, métier dans lequel il est extrêmement difficile de se libérer de ses obligations professionnelles. Il faudrait un système de remplacement de l'éleveur sur l'exploitation.

Etes-vous stagiaire dans le conseil d'administration de votre coopérative ? Le syndicat des jeunes agriculteurs postule-t-il pour occuper ces fonctions ? Vous critiquez la coopération, mais encore faut-il connaître son fonctionnement, et oser s'y engager.
Encore faut-il que les anciens laissent la place ! La question s'est déjà posée : y va-t-on parce que l'on a une casquette syndicale, ou parce que l'on est jeune et désireux de s'investir ? Allons ! Les jeunes, même syndicalistes, ne sont pas entendus.

J'ai commencé comme stagiaire, et je suis devenu président de ma coopérative cinq ans plus tard ! J'ai ouvert la porte moi-même !
En tant que paysan ou en tant que syndicaliste ?
Et voilà : vous avez répondu vous-même à la question...

Le maintien du crédit d'impôt remplacement suffit-il pour vous rendre plus disponible et vous investir dans les coopératives ?
Au risque de vous offenser, je serais partisan de le doubler. L'enveloppe est la même depuis dix ou vingt ans.
Pas celui des organismes qui les entourent, et qu'il faut financer et animer, cela ne vous a pas échappé.
On nous demande de plus en plus : cela explique qu'il y ait de plus en plus d'organismes à nos côtés. Nous ne pourrions pas faire autrement.
Un mot pour finir sur la promotion de l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut d'abord parler du métier de manière positive. Ensuite, la visibilité des prix pose problème. Nous pourrions y remédier par la contractualisation. Nous sommes capables aujourd'hui d'acheter des engrais un an à l'avance. Sauf que l'on ne connaît alors pas encore le prix de la viande. Nous pourrions fixer un prix en fonction de ce que l'on est capable de produire, donc de ce que l'on achète. Connaissant le prix des engrais, on sait que l'on peut vendre, en céréales, deux ou trois campagnes à l'avance. Si vous connaissez votre coût de production, que vous vous couvrez sur vos intrants, vous êtes capable de vendre et d'acheter à deux ans à des prix connus : quel risque courez-vous ?
Si vous vendez dix-huit mois à l'avance pour 200 euros, et achetez pour un coût de production de 150 euros, vous ne risquez rien. Vous prenez un risque en revanche si vous vendez à 200 euros mais ne savez pas à quel coût vous allez produire.
C'est un manque à gagner, pas une perte.
Boursicoter, c'est ne pas savoir. Dans ce cas, il ne s'agit que d'anticiper.
En quoi cela est-il gênant ? Le marché est libre.

Si vous vous en accommodez, n'allez pas ensuite accuser les grands groupes de vous faire de la concurrence !
En viande bovine, le drame consiste à ne pas connaître le prix de vente. La solution consiste à anticiper : vous pouvez acheter à terme du tourteau de soja au mois de mars pour le mois de novembre de la même année. L'un de mes collègues proposait à l'abattoir un contrat à 1,70 euro le kilo de cochon, sachant qu'il achetait à terme l'aliment à 1,50 euro. L'abatteur a refusé. Puis le prix du porc est passé à 2 euros, et l'aliment à 1,80 euro : avec un contrat, le producteur aurait pu connaître sa marge à l'avance, le transformateur aurait acheté le cochon moins cher, et le consommateur aussi !
Pour aider à la reprise des exploitations, nous proposons d'abord de doubler la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA), qui date de 1976. Depuis, le niveau des prix a été multiplié par cinq. Il ressort du rapport que nous avons publié il y a deux ans sur le sujet que l'installation est plus fréquente là où elle est soutenue financièrement. Dans les zones de plaine, il n'y a plus d'aide à l'installation : on dénombre peu de nouvelles exploitations. Certains crédits européens apportent leur concours. Nous proposons aux entreprises, fondations, associations, coopératives, et aux collectivités territoriales d'y joindre leur soutien. Nous souhaitons réaliser un portail des aides à l'installation, que nous avons baptisé « mur bancaire » car nous le souhaitons solide. Nous pensons que les financements publics ne suffiront bientôt plus.
Certes. Nous souhaitons regrouper tous ces financements et les rendre plus transparents pour le jeune qui souhaite s'installer.

Demander à une coopérative de participer à ce type de financements, c'est la mettre en difficulté par rapport à ses concurrents industriels.
C'est mal connaître le marché actuel : nous sommes en sous-production. Le marché de demain appartient à ceux qui seront capable de capter la production, donc à ceux qui aident les plus jeunes à se lancer ! Le fonds national de l'élevage finance déjà l'achat de vaches allaitantes par de nombreux jeunes agriculteurs : ceux qui les ont aidés font tourner plus facilement leurs outils d'abattage et de transformation...

La production ovine a baissé de moitié en vingt ans, la production porcine de 8 % à 10 %. Nous venons de perdre 300 000 bovins lors du dernier exercice. Ne parlons pas de la volaille. Si vous aviez les manettes, que feriez-vous pour enrayer cette crise de production ?
On ne devrait plus parler de zone de plaine à propos de la DJA, mais plutôt de zone céréalière ou zone d'élevage. Dans certaines plaines en effet, les céréaliers n'ont pas de problèmes pour produire, tandis qu'il en est d'autres, dans le Morvan par exemple, où l'on doit faire de l'élevage comme en montagne, faute de pouvoir mettre en marche la charrue et espérer les mêmes rendements. Il y a là deux politiques différentes à mener.
Réformée en 2014, la PAC ne sera pas revue avant 2020. Nous souhaitions moduler les aides selon la conjoncture - bonnes ou mauvaises années - mais le ministre nous a dit que c'était impossible.
Le rapport d'orientation du syndicat l'a montré, là où il n'y a pas d'aides à l'installation, personne ne s'installe et ce sont les exploitations existantes qui s'agrandissent. Demain, si un jeune céréalier n'a que 100 hectares, il se posera peut-être la question de cultiver des légumes de plein champ, et plus seulement le triptyque colza-blé-orge.
La Marne est un bon exemple de la marche à suivre. Il y a quelques années, sur le plan agricole, le département n'existait pas. Il a fallu défricher de nombreux hectares, comprendre que le sol était une éponge calcaire mais que la luzerne permettrait de s'en sortir. Une filière de déshydratation de luzerne a été construite. Puis une catastrophe climatique a conduit le département à se réorienter sur l'orge de printemps brassicole. Lorsque les brasseurs leur en ont demandé à nouveau, ils se sont mis à commercialiser du malt...
Prenez un agriculteur disposant de 150 hectares : il peut valoriser son blé à 196 euros au marché à terme, le transformer en lait, en viande bovine, en porc. L'éleveur, lui, valorise sa production à 160 euros, c'est-à-dire travaille 365 jours par an pour trente euros de moins. Heureusement que les gens ne réfléchissent pas trop !
Je devrais en effet réfléchir davantage, puisque je fais de l'élevage. Mais j'ai 40 hectares de terres inondables et 70 % d'herbe, sur du sol sableux. Il faut soutenir l'élevage, mais non opposer l'élevage aux grandes cultures.

Peut-on en venir aux normes qui s'appliquent aux exploitations et contraignent les jeunes agriculteurs ?
Mettre son exploitation aux normes, lors de l'installation ou progressivement, cela coûte cher. Lorsque les normes rendent le travail de l'exploitant et la vie des animaux plus confortables, elles sont bienvenues. Reste que l'administration les applique de façon un peu rigide.
Se mettre aux normes n'est pas toujours facile, mais l'agriculteur est le premier à en bénéficier. S'il ne le fait pas, c'est qu'il en est empêché. Idéalement, il faudrait garantir la stabilité des normes, et se garder de vouloir en faire plus que nos voisins. L'installation de porcs est soumise à déclaration à partir de 450 têtes en France, contre 2 000 en Allemagne.
Nous sommes sur les mêmes marchés, les prix sont identiques, mais pas les conditions de travail, ce qui n'est pas acceptable. Enfin, le consommateur doit savoir ce qu'il achète.

Nous allons bientôt examiner un projet de loi sur les retraites. Pensez-vous que les cotisations versées par les jeunes agriculteurs soient au bon niveau ?
En cas de bonne année, les agriculteurs cotisent plus, du fait de la suppression d'un certain nombre de mécanismes régulateurs. Le niveau de retraite n'est pas élevé, mais au bout de 10 à 15 ans de retraite, l'agriculteur récupère l'essentiel de ses cotisations. Pendant les premières années d'installation, il n'est cependant pas envisageable de cotiser plus qu'aujourd'hui.

Si l'on veut que les agriculteurs touchent des retraites semblables à celle des autres Français, faut-il augmenter les cotisations ?
Certes, le montant des retraites doit être revalorisé, mais les jeunes ne peuvent cotiser plus qu'aujourd'hui. En outre, l'effet démographique ne permet pas de faire payer les actifs agricoles pour les retraités actuels.
Pendant les élections aux chambres d'agriculture, j'ai croisé le président des anciens qui avait demandé à sa ministre de tutelle si une pension mensuelle de 700 euros lui semblait acceptable. Elle lui a répondu : « Combien de terres agricoles possédez-vous ? » Cette réponse en dit long. Certains agriculteurs bénéficient effectivement d'une capitalisation foncière, mais pas tous. Si le montant de la retraite était calculé en fonction de la richesse de chacun, les agriculteurs seraient loin dans le bas du tableau...

Nous avons effectué la semaine dernière une longue visite en Bretagne, nous avons beaucoup appris sur les filières porcine et avicole. Vous allez nous apporter des informations complémentaires.

Quelles sont les pistes pour sauver cette filière avicole, qui semble en perdition ? Nous importons 45 % de notre viande de poulet.
La filière volaille française a été très puissante lorsqu'elle bénéficiait d'un avantage concurrentiel et investissait massivement à l'exportation, tout en satisfaisant la demande du marché intérieur. Celui-ci est très segmenté, notamment du fait des labels.
Aujourd'hui, le marché international reste en plein développement et le marché intérieur continue à croître lentement, mais nos positions s'affaiblissent, car depuis l'époque des investissements massifs, les années soixante-dix et quatre-vingt, notre appareil productif a vieilli. Et les marchés que nous avions pris en Allemagne et en Grande-Bretagne se réduisent car les producteurs de ces pays, plus performants, ont réussi la reconquête de leur marché intérieur.
La grande distribution en France a été un formidable moteur pour l'agro-alimentaire pendant des années mais, depuis quelque temps, elle capte les marges sur les acteurs de l'amont de la filière. La perte de marchés à l'étranger a exacerbé la concurrence entre les entreprises.
La segmentation de l'offre a un coût. Or le consommateur souhaite désormais dépenser le moins possible. Les importations de volailles européennes se sont considérablement accrues ces dernières années, ce que confirme une récente étude de FranceAgriMer. Dans la restauration collective, les importations représentent 84 % des achats. Ce phénomène se retrouve dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), qui ont voulu pratiquer les mêmes prix que les hard discounters allemands.
Il y a encore dix ans, notre filière se préoccupait essentiellement des segments export et label ; le coeur de gamme a été délaissé. Les pays du nord de l'Europe, eux, ont travaillé sur l'environnement et sur le bien-être animal. La France n'a pas su le faire, peut-être parce que la production bretonne, la principale en volume, était focalisée sur l'exportation, même si d'autres régions de France, Pays-de-Loire, Grand Sud-ouest, étaient tournés vers le marché intérieur.
Les labels ont fait notre force, mais ce n'est plus le cas puisque désormais c'est le prix qui fait la différence pour le consommateur. Il est dommageable que les opérateurs milieu de gamme ne puissent pas mentionner sur les emballages le mode d'élevage.
Les pouvoirs publics, et la profession, laquelle est très organisée, mais par segments. Nous travaillons sur une interprofessionnalisation globale, car aujourd'hui, chacun défend l'intérêt de son segment et oublie celui de la filière.
En 2000, le groupe Bourgoin a fait faillite : on aurait pu en profiter pour restructurer l'ensemble, mais un nouvel opérateur a émergé. Ce fut la même chose récemment avec le groupe Doux.
Ces derniers temps, la situation s'est aggravée du fait du dumping salarial auquel se livrent les Allemands. Les porcs bretons sont envoyés à l'abattage outre-Rhin ! Je comprends que l'on ne doive pas, par des subventions à un secteur, créer des avantages illégitimes, mais ici, il s'agit simplement de compenser les effets du dumping, qu'il soit salarial en Allemagne ou monétaire au Brésil !
Quand les revenus ne sont pas suffisants, il n'y a pas d'investissements et la compétitivité s'érode. Dans les pays concurrents, les bâtiments d'élevage sont souvent producteurs et non consommateurs d'énergie - mais cela suppose des équipements coûteux...
En outre, l'opinion française préfère le petit au grand. Or, les élevages compétitifs allemands couvrent 10 à 12 000 mètres carrés tandis que les nôtres plafonnent à 3 000. Les Hollandais et les Allemands ont convaincu les protecteurs de l'environnement que la taille des exploitations n'était pas la vraie question, mais qu'il fallait en revanche maîtriser les conséquences de la production, nuisances, effluents, etc... Dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le secteur de la volaille a servi de monnaie d'échange. La France, elle, résiste à cette logique.
Comme l'avait annoncé un ministre à l'époque : « il y a maintenant un trou dans la coque, le bateau finira par couler... » Ce n'est pas encore le cas, mais il a parfois du mal à flotter. Les négociations du Gatt ont entraîné des dérèglements dans la production. Deux plans de cessation d'activité se sont soldés par des milliers de mètres carrés de bâtiments d'élevage perdus, et ce sont souvent les meilleurs qui se sont retirés, ayant les premiers amorti leurs investissements. Comment faire aujourd'hui pour retenir les plus performants et faire progresser les autres ? Comment rationaliser la production afin de réduire les coûts ?
Les industriels ne restent pas inactifs. Certains se restructurent dans le but d'attaquer le segment du coeur de gamme. Aujourd'hui, les exportations sont menacées et notre marché intérieur est envahi par les importations. Or, quand on exporte de la volaille, on exporte aussi des céréales et de l'emploi.
Nos importations en provenance de l'Asie, notamment de Chine, augmentent très rapidement, même si les volumes ne sont pas considérables. Tout de même, quand on connaît la situation sanitaire dans ces pays, cela fait frémir. Notre système sanitaire fonctionne très bien ; il en va autrement là-bas.

J'ai vu un reportage sur un élevage chinois, dans un bâtiment à étages à claire voie : les canards sont placés sous les porcs. Nous pouvons donc retrouver dans nos assiettes des canards nourris de la sorte...
Il y a des modèles d'élevage qui fonctionnent par recyclage permanent. Je ne suis pas sûr que la société française les accepte.
Nous importons à prix bas sans regarder comment les aliments sont produits, pendant que nous nous imposons des règles de production très strictes.
Je le dis à des patrons de grande distribution : « Arrêtez de vouloir réduire toujours plus les prix payés aux éleveurs ! » Il y a quinze ans, un ministre voulait réunir les producteurs laitiers pour résoudre une crise du lait : d'accord, avons-nous répondu, si tous les coupables sont présents autour de la table. Je pensais aux distributeurs...
L'an dernier, les prévisionnistes annonçaient une récolte de céréales normale. Les prix ont été négociés, mais des conditions climatiques extrêmes ont touché les Etats-Unis et l'Europe de l'est, d'où une spéculation inattendue. Mais pour les producteurs eux-mêmes, les hausses de prix, qui auraient dû être de 15 ou 16 %, n'ont pas dépassé 8 à 9 %. Pour faire pendant à ce retard, nous avions proposé que, lorsque les cours des céréales reflueraient, on attende six à huit mois pour réduire les prix des volailles, afin de protéger nos entreprises. Hélas cela n'a pas été possible, en raison d'une concurrence exacerbée. De fait, les prix ont immédiatement recommencé à baisser.
Le système est déréglé. Que faire ? Je n'ai pas de solution clé en main, mais voici des pistes de réflexion. Sur le court terme, il faut alléger les contraintes administratives et réduire le poids des normes. Par exemple, nous n'avons plus le droit de stocker les fumiers de volaille aux champs, en attendant le résultat d'études de sol : soit, mais dans l'intervalle, nous sommes pénalisés. Il faut aussi veiller à ce que les règlementations provenant des ministères de l'agriculture et de l'environnement ne se contredisent pas. La complexité de cette réglementation est difficilement supportable.
La France veut-elle rester un pays exportateur de volailles ou veut-elle recycler sa production sur le marché intérieur ? La question ne peut se poser ainsi, car il ne s'agit pas des mêmes marchés : les circuits, les produits et les entreprises diffèrent. Les distorsions de concurrence pourraient être compensées grâce à la promotion de l'exportation : cela coûterait 40 à 50 millions d'euros à l'Europe, sur le budget de la PAC, et ce serait une manière habile de soutenir les exportations de céréales transformées dans la production de poulet.
Pour inciter les entreprises à se restructurer et les producteurs à investir, encore faut-il avoir une bonne visibilité sur le marché intérieur. Le ministre de l'agriculture avait proposé de communiquer sur la volaille française en mettant en avant les logos commerciaux, le bien-être animal et le caractère local de la production. Nous y sommes bien évidemment favorables. Nous sommes aussi d'accord aussi pour privilégier la sécurité et le plaisir gustatif.
Sur le moyen et long terme, nous proposons de repenser nos schémas d'amélioration de la productivité par la génétique et la nutrition animale. En partant des produits dont nous aurons besoin demain, nous pourrions définir les types de volailles à retenir. Les Etats-Unis se sont déjà lancés dans cette voie et ils proposent des volailles de bonne qualité, nourries à base de maïs et de soja. Nous devons aussi veiller à remettre notre société de consommation en phase avec la réalité de la production. On ne nourrira pas les 60 millions de Français avec des poulets élevés dans des cours de ferme. L'élevage de volaille, c'est de la transformation de céréales en protéines animales, ce qui n'empêche pas de travailler sur l'immatériel et l'imaginaire de nos concitoyens. Il y a une grande différence entre le poulet rôti du dimanche et les nuggets de la restauration collective, ce que l'on appelle le minerai, terme que je n'aime pas, car il dévalorise le travail des éleveurs.

Faut-il oublier les labels et les produits bio, qui pourraient améliorer l'image du secteur ?
Il ne faut pas les laisser de côté, bien sûr. Le bio doit se développer à son rythme. Les poulets produits sous label ont longtemps dominé le marché du poulet entier. La situation est aujourd'hui plus difficile : la découpe et le prix bas l'emportent.

N'y a-t-il pas deux marchés : un marché intérieur avec des produits labellisés et un marché export où le label n'a pas prise ?
Oui, car le critère essentiel aujourd'hui, je le répète, est le prix.
Sur le poulet entier, le label représente 15 % de la production totale, mais 45 % des ventes en GMS. Sur la découpe, le label n'a pas une place importante.
On achète les découpes pour cuisiner : la différence gustative est alors moins perceptible qu'avec un poulet entier.

Il y a le sapin et le chêne : l'un pousse plus vite que l'autre. Pour les poulets, c'est la même chose.
Chacun ses qualités. On a trop eu tendance à dénigrer le produit standard. Je le dis bien que mon entreprise soit spécialisée en volaille à label.
Les labels n'existent pas à l'étranger. En revanche, nous exportons environ 10 % de notre production de poulets label. Dans d'autres pays, on produit néanmoins des poulets élevés en free range, qui vivent à l'extérieur.
En France, le label est attribué aux poulets élevés en 80 jours minimum, qui vont dehors à partir de 40 jours et qui sont nourris selon des formules spécifiques. Dans le nord de l'Europe, certaines catégories de poulets sont élevés dans les bâtiments non claustrés, ouverts sur une courette ; ils grossissent en 56 jours et sont nourris aux céréales.
Le « fermier » est défini au niveau communautaire tandis que le label rouge est une réglementation française qui date des années soixante.
Non, nous importons des poulets entiers standards et des pièces de découpe.
Nous avons réussi à restreindre les échanges de poulets entiers, au plan européen, aux poulets de 80 jours. La révision actuelle comporte un risque car ce critère pourrait être abandonné.
Je n'en sais pas plus que vous. Nous attendons de voir ce que vont faire la famille et les actionnaires. Accepteront-ils de perdre le contrôle de l'entreprise ? Un redressement est-il possible ? Ne faudrait-il pas réunir les deux sociétés qui font de l'export, Tilly-Sabco et Doux, avec des capitaux venant des grands industriels de la volaille, des céréaliers, de la Banque publique d'investissement (BPI), pour créer une grande structure spécialisée sur les marchés extérieurs, centralisant les aides ? Celles-ci doivent irriguer toute la filière, avec une contractualisation de bout en bout, voire une indexation. La filière souffre cependant d'un manque de transparence généralisé. Il faudrait reconstruire le modèle en définissant pour chaque maillon le bon niveau des marges, afin que celles-ci ne soient nulle part confisquées. Ce dossier est difficile à faire avancer. Serge Papin, au nom des distributeurs, est d'accord pour en parler, mais le sujet fait peur aux autorités de la concurrence.

Je ne suis pas un chaud partisan des organismes génétiquement modifiés (OGM) : mais sur ce sujet, ne sommes-nous pas un peu hypocrites ? Nous refusons d'en cultiver mais nous importons des porcs et des volailles nourris à base d'OGM. Les sojas que nous importons ne sont-ils pas non plus génétiquement modifiés ?
Ne pourrions-nous pas vanter davantage nos produits qui, tout chauvinisme mis à part, sont excellents ? Notre marché intérieur est-il suffisamment rémunérateur ? Les volumes de production animale chutent de façon vertigineuse. Ce sont les grandes surfaces qui sont responsables. Leclerc ne jure que par les prix bas ! Quelques centimes de plus à l'achat par les distributeurs et l'on pourrait assurer le renouvellement des exploitations !
Nous nourrissons nos volailles et nos bovins avec du soja OGM puisque provenant d'outre-Atlantique. Les experts estiment que le processus de production des tourteaux, lors du chauffage, enlèvent toute nocivité aux OGM.
Certains pensent que faire de l'Europe une zone sans OGM serait une belle opération marketing et aurait pour vertu de protéger notre marché contre les importations. Je serais plus prudent. Il est regrettable que l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ait cédé aux pressions et renoncé aux travaux qu'elle menait pour éclairer le législateur et l'opinion publique sur les OGM. C'est comme si nous avions refusé, il y a dix ou vingt ans, les recherches sur la génétique animale et végétale. Bien sûr, comme père de famille et comme citoyen, je m'interroge sur les risques à long terme, mais ce n'est pas en fermant les yeux que l'on règlera le problème. Il est vrai qu'un certain nombre de pays ont acquis, grâce aux OGM, un avantage concurrentiel.
Les enseignes de la GMS ne cherchent pas le prix le plus bas, mais un prix plus bas que celui du concurrent. Sur la volaille, la marge est importante...
Quand les prix des céréales ont flambé, les grands distributeurs ont tout de suite voulu répercuter la hausse sur le consommateur de volaille. Ils affirment vouloir avant tout défendre le pouvoir d'achat des Français, ce qui est faux. Je ne veux pas rejeter sur eux toute la responsabilité, mais ils en portent une lourde part. Une réflexion générale sur les marges s'impose si l'on veut éviter un effondrement du système.

Les modes de consommation ont beaucoup évolué en quelques décennies : on mange de la viande non plus une ou deux fois par semaine mais à tous les repas. Ne faudrait-il pas consommer moins et mieux ? Cela éviterait une fuite en avant vers une production bas de gamme. Comment aller vers une meilleure qualité ?
Attention : la consommation de volaille de label ne peut augmenter à l'infini ; son prix de revient est élevé, puisqu'il faut deux fois plus de temps, donc de grain, par kilo de poulet. Nous avons besoin de protéines animales. La question est donc : comment les produire le moins cher possible ? Les Français ont réduit leurs achats de viande bovine à cause des prix. La consommation de dinde recule parce que le poulet de qualité standard est meilleur marché.
A travers le monde, la consommation de volaille se développe car c'est la protéine animale la moins chère et elle ne souffre pas d'interdits religieux. Dans le bassin méditerranéen, la population augmente. Or les pays concernés n'ont pas les capacités de production animale correspondantes, les ressources en eau sont limitées et les températures excessives. N'est-il pas de notre responsabilité collective d'exporter vers ces pays ? Jusqu'à présent, l'agriculture a été la variable d'ajustement dans les négociations internationales. N'est-il pas temps de penser autrement ?

Merci pour votre contribution, qui a utilement complété ce que nous avons appris lors de notre déplacement en Bretagne.

Notre mission commune d'information s'intéresse à tous les aspects de la filière viande, et notamment à la commercialisation des animaux de boucherie.
C'est pour nous très importants d'être auditionnés par votre mission. Les marchés aux bestiaux que nous représentons existent dans notre pays depuis très longtemps, et la France est le seul Etat membre de l'Union européenne où ces marchés fonctionnent encore. On en dénombre 53. Ces marchés ont une utilité : en leur sein sont assurés les arbitrages entre acteurs de la vente d'animaux de boucherie. Ces échanges permettent d'établir des indicateurs de prix et constituent donc des repères pour les consommateurs, pour les industriels, comme pour les éleveurs. La tradition sur ces marchés est celle d'une faible formalisation. Les accords sont souvent conclus en « topant » Les transactions sont parfois encore exprimées en francs. Un tiers des ventes de broutards français destinés à l'export s'effectuent sur les marchés aux bestiaux.
Sur les marchés aux bestiaux transitent 15 % de l'ensemble des échanges de bétail en France.
On en est même à 50 % pour les veaux de qualité comme par exemple les veaux de l'Aveyron, qui sont des animaux de très haute qualité. Globalement, sur les veaux, les marchés aux bestiaux assurent 15 à 20 % de la commercialisation. Mais cette part est en baisse car, du fait du développement de la politique de filières, les animaux ne viennent plus sur les marchés. Les industriels, pour avoir de l'approvisionnement régulier, préfèrent contractualiser. La conséquence en est simple : il n'y a plus de discussion directe sur les prix et les indicateurs de prix deviennent plus difficiles à établir. Ce qui n'est pas commercialisé sur les marchés aux bestiaux l'est directement par les coopératives, les négociants ...
Il existe des marchés aux bestiaux de toutes tailles : en Normandie, par exemple, existent encore beaucoup de petits marchés aux bestiaux. Mais ils ne relèvent pas tous de notre fédération. On va de marchés rassemblant 2 500 à 3 000 animaux toutes les semaines, comme à Bourg-en-Bresse, qui est le plus important, à des marchés de 200 animaux. Les marchés de Cholet ou encore de Chateaubriand sont aussi de taille importante.
En 2012, 1,3 millions d'animaux se sont échangés sur les marchés aux bestiaux relevant de notre fédération.

D'où viennent les animaux présentés sur les foirails : peuvent-ils venir d'autres pays européens ?
Non.
Les marchés aux bestiaux se divisent en deux types : les marchés de producteurs - essentiellement de producteurs ovins - et les marchés au cadran. Les négociants jouent un rôle essentiel sur nos marchés. Ils vendent pour leur propre compte ou pour le compte des éleveurs, souvent à d'autres négociants. Les foirails jouent un rôle important de deuxième mise en marché. Les négociants passent aussi par les marchés aux bestiaux pour vendre des animaux maigres, qu'ils ont allotés, à des engraisseurs. Il existe aussi des variations saisonnières dans l'activité de nos marchés.

Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les conséquences pour vous de la mise en place de l'écotaxe poids lourds ?
C'est une catastrophe pour la filière. Cela représentera 12 à 15 centimes du kilomètre. Si ce n'est pas l'éleveur qui paiera, c'est lui qui en supportera le coût, qui lui sera répercuté.
Les négociants estiment que cette taxe représentera environ 15 % de leur marge. Ils seront obligés de répercuter cette charge nouvelle sur les éleveurs lors de la discussion sur le prix des bêtes. Vous devez vous battre pour trouver une solution. Des investissements lourds ont été effectués sur les routes pour permettre de recouvrer l'écotaxe poids lourds. Elle doit être rentable pour l'Etat.

Ceux qui fabriquent et installent sur les routes les équipements comme les capteurs sont ceux qui gagneront le plus d'argent.
Pouvez-vous nous indiquer ce que vous pensez du dispositif français de traçabilité des animaux ?
On a une traçabilité forte en France qui fonctionne bien. Actuellement, il est question de dématérialiser le passeport des animaux. Cela nous pose problème car les marchés aux bestiaux devront les réimprimer.

Y a-t-il des acteurs qui cherchent à écouler des bêtes sur les foirails sans respecter les règles, notamment de traçabilité ?
Non, nous contrôlons beaucoup les acteurs des marchés. A l'entrée, la carte d'opérateur est contrôlée. Ensuite, les documents d'accompagnement de chaque bête sont lus. Il arrive, sur des marchés frontaliers, que des bêtes provenant de pays voisins soient échangées, mais c'est marginal.

Les services vétérinaires sont-ils présents sur les marchés aux bestiaux ?
Oui. Je souligne que, comme centres d'allotement, tous les marchés aux bestiaux sont soumis à un agrément sanitaire français et européen. Nous sommes très contrôlés, par exemple sur la concordance entre les boucles des animaux et les passeports.
Non, c'est l'inverse : nos broutards partent en Italie pour être engraissés et sont abattus en Italie, où ils sont consommés, car en France, on ne mange pas de jeunes bovins.

Je viens de faire un rapide calcul du coût du l'écotaxe poids lourd au kilomètre. J'arrive à un coût de 0,01 € le kilo.
Même à ce niveau, cela reste un coût supplémentaire. Les marges des négociants ne sont pas énormes.
Cela ne va pas nous aider. Notre fédération a signé l'accord interprofessionnel sur la contractualisation dans l'intérêt collectif de la filière. Tout le monde ne passera pas par la contractualisation. Il faut conserver des échanges significatifs sur les marchés aux bestiaux pour disposer de références de prix sérieuses, fondées sur un nombre suffisant de transactions. Le jour où ces références disparaîtront, ce seront les gros industriels seuls qui fixeront les prix et les éleveurs seront perdants.

Ces industriels, comme par exemple le groupe Bigard, achètent-ils aujourd'hui sur les marchés aux bestiaux ?
Oui, et ils doivent se battre avec les autres acheteurs. Mais les industriels ont parfois des arguments qui permettent de ne pas avoir à se battre sur les marchés aux bestiaux. Le groupe Bigard peut ainsi promettre de payer les bêtes à leurs apporteurs un franc de plus au kilo.

Pouvez-vous nous indiquer ce que vous pensez de la récente réforme des cotations ?
On a voulu simplifier le système à l'extrême. Les marchés aux bestiaux permettent un classement plus fin. On dispose encore de quelques agents de FranceAgriMer sur nos marchés. C'est important car c'est par ce contact avec le terrain qu'ils connaissent bien leur métier. En outre, l'avantage des marchés aux bestiaux, par rapport au système des cotations, c'est qu'ils donnent des prix sur toute la France.
La machine à classer ne donne qu'une indication. L'oeil d'un professionnel expérimenté est plus précis. Les négociants sont des professionnels aguerris. Ils vendent les bêtes aux abattoirs au classement donc ne se trompent pas entre un animal classé O, classé R ou classé U.

Quelles pistes suggérez-vous pour les marchés aux bestiaux au sein de la filière viande ?
Notre fédération cherche à améliorer le fonctionnement des marchés aux bestiaux. Nous travaillons à un dispositif de garantie de paiement, avec un paiement rapide à trois jours.
Ils sont d'environ 15 à 20 jours.
Nous rencontrons quelques soucis de paiement avec les acheteurs italiens, à cause de la crise. Nous sommes probablement à la veille d'avoir de sérieux soucis sur ce plan.

Ne faudrait-il pas s'inspirer des dispositifs existants pour le marché du bois.
Peut-être. Je souligne un autre point : les marchés aux bestiaux ont besoin de représenter une part significative de la commercialisation car plus il y a d'animaux sur un marché, plus il y a de concurrence.
J'ajoute que la piste consistant, dans le cadre de la réforme de la PAC, à majorer la prime pour les premiers hectares, va dans le bon sens. Mais il faudrait réserver cette aide à ceux qui ont une certaine surface en herbe. Les céréaliers sont aujourd'hui bien lotis. Il faut avantager l'élevage, d'autant que les conditions de travail y sont terribles.
Il est également nécessaire de trouver des solutions pour la transmission des fermes, qui sont devenues grandes. Le droit fiscal français n'est pas adapté aux cas de transmissions de fermes comptant plus de 250 vaches.
Enfin, les éleveurs doivent retrouver de la rentabilité pour sortir de la dépendance aux primes. Le secteur de la viande bovine a vécu pendant 25 ans grâce aux primes. Il faut trouver les moyens de sortir de ce système.
Oui mais payés par des emprunts, qu'il faut un jour rembourser. L'enjeu aujourd'hui est celui du maintien de l'élevage en France. Nous sommes à la veille d'un affaiblissement durable de l'élevage au profit des grandes cultures. Pour s'en sortir, les prix de la viande à l'étal doivent être augmentés. Les industriels et les distributeurs doivent aussi pouvoir gagner leur vie sur la viande.
La viande française est de qualité. Lorsqu'elle ne l'est pas, ce n'est pas toujours la faute de l'élevage. Il faut savoir travailler la viande, la faire maturer.
La bonne viande bovine risque de devenir un produit rare. Nous perdons du cheptel et la fin des quotas laitiers aura encore un impact négatif. La PAC permet d'avoir des aides directes couplées pour le secteur de l'élevage, utilisons ces possibilités !

C'est ce que nous entendons défendre. Il faut sauver notre modèle d'élevage.
Le risque, en effet, c'est de transformer notre modèle d'élevage extensif par des feed lots à l'américaine, comme j'ai pu en visiter lors d'un voyage d'étude récent d'Interbev.

L'élevage est incontestablement l'échelon fragile de notre agriculture.
N'oublions pas que l'alimentation du bétail constitue l'un des débouchés majeurs de notre production céréalière. Il faut conserver une agriculture diversifiée, qui repose sur les cultures mais aussi les productions animales. Nous ne mangerons pas demain des biftecks de blé.