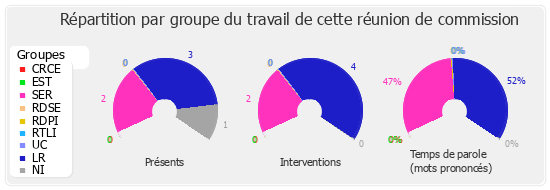Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Réunion du 7 novembre 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jacques Legendre sur les crédits de la mission « Aide publique au développement » du projet de loi de finances pour 2008.

a noté que le français se situait au 11e rang mondial en tant que langue maternelle, au 9e rang en tant que langue seconde, mais était à la 2e place des langues de communication présentes sur l'ensemble des continents et la 2e langue la plus enseignée dans le monde. Ces éléments chiffrés démontrent l'efficacité de la politique de la francophonie.
Relevant que certains esprits avaient l'air de considérer la francophonie comme un combat d'arrière-garde, le rapporteur a estimé que cette attitude participait d'une ambiance qu'il a qualifiée de « blues » de la francophonie. En effet, la situation est étrange puisque la francophonie est contestée alors même qu'elle est en bonne santé, qu'elle constitue une opportunité unique pour faire entendre la voix de la France dans le monde, que, de plus, elle a, pour des raisons démographiques, un bel avenir devant elle, pour peu que les politiques menées soient cohérentes.
Pour sortir de cet état dépressif, il a considéré que la francophonie devait, d'une part, persister dans sa démarche -à ce titre le maintien des crédits qui lui sont consacrés sont une bonne nouvelle- et d'autre part, constituer une action cohérente non seulement à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur, afin que l'ensemble des énergies soient mobilisées.
a déploré que les crédits de la francophonie soient dispersés dans pas moins de quatre bleus budgétaires, et que les principaux montants soient inscrits dans la mission de l'« Aide publique au développement ». Cette répartition des crédits n'a en effet aucun sens : la francophonie n'est pas de l'aide publique au développement, mais bien une stratégie de rayonnement de la France dans le monde.
Il a supputé que la confusion était liée au fait qu'historiquement, les crédits de l'aide au développement étaient concentrés sur des pays d'Afrique francophone. Or d'une part ce n'est plus le cas aujourd'hui, et d'autre part, la politique francophone a une vocation mondiale, non pas centrée sur les Etats, mais sur un réseau constitué de tous ceux qui parlent français, même quand ils sont très minoritaires dans leur pays.
Il s'est montré, en revanche, satisfait du maintien des crédits de la francophonie institutionnelle : comme en 2007, 58,4 millions d'euros seront attribués à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et à ses opérateurs, tels que l'Agence universitaire de la francophonie, l'université Senghor d'Alexandrie, ou encore l'Association internationale des maires francophones.
Il a relevé que TV5, la lucarne de la francophonie dans le monde, bénéficiait quant à elle d'une hausse de ses crédits de 2,3 %, leur montant étant porté à 65,7 millions d'euros, ce qui devrait permettre à la chaîne de poursuivre sa politique de sous-titrage des programmes. Les crédits de Radio France internationale sont également augmentés et s'élèvent à 71 millions d'euros dans le projet de loi de finances. Les crédits relatifs à l'enseignement du français dans le monde, axe essentiel de la politique francophone, sont quant à eux stabilisés. Ils seront utilisés dans le cadre du plan de relance du français, notamment dans l'Union européenne et en direction des alliances françaises. Enfin, l'importance de la politique de défense de la langue française menée par la délégation générale à la langue française, est reconnue par l'attribution à la délégation de 4 millions d'euros.
Il s'est réjoui du maintien du niveau des crédits de la francophonie, regrettant cependant l'absence d'un document de politique transversale qui permettrait de suivre plus précisément l'évolution des crédits, pour l'instant éparpillés dans le budget de l'Etat.
a consacré la seconde partie de son intervention à la politique francophone, dont il a considéré qu'elle manquait d'objectifs stratégiques.
Il a jugé essentiel de comprendre que les deux démarches de protection de la langue française et de sa promotion à l'étranger étaient parfaitement complémentaires et pouvaient constituer un cercle vertueux. Une langue est vivante lorsqu'elle sait s'adapter aux transformations de la société. C'est ensuite par sa vitalité et sa modernité qu'elle va séduire ceux qui souhaitent l'apprendre. Enfin, l'élargissement du nombre de locuteurs permet de faire vivre la langue et d'augmenter à la fois son rayonnement et celui des valeurs qu'elle véhicule. Il en a conclu que la première étape était de défendre le français dans un contexte où il est contesté par certains tenants du tout anglais.
Le rapporteur pour avis a indiqué qu'il préconisait tout d'abord l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi sénatoriale complétant sur certains points précis la loi Toubon. En effet, au cours de l'année 2007, des personnels d'entreprises françaises rachetées ont été mis en difficulté du fait de la diffusion de documents en langue étrangère dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, l'inspection générale des affaires sociales a évoqué l'absence de guide d'utilisation en français d'un logiciel de dosimétrie pour expliquer le fait que plus de 4.000 patients traités par radiothérapie aient subi une surdose de radiation, dans un hôpital d'Epinal, et dont certains en sont malheureusement décédés. Il a en a conclu qu'il était grand temps que l'Assemblée nationale adopte les quelques adaptations de la loi Toubon proposées par le Sénat.
Il a considéré, ensuite, qu'à l'heure où certains invoquent les coûts de traduction trop élevés pour justifier l'utilisation d'une langue unique dans les enceintes internationales, la politique de défense du français devait être renforcée. C'est le cas au niveau européen, où une attention permanente doit être maintenue pour que le français soit utilisé. Il a ajouté qu'il ne reviendrait pas sur la malheureuse adoption du protocole de Londres, mais qu'il serait attentif à ses conséquences. C'est aussi le cas au niveau international, par exemple dans le cadre olympique, dans lequel le français est supposé être la langue de référence.
Il a rappelé que la défense du français relevait d'un objectif plus général qui est celui de la diversité culturelle et linguistique, qui fait la richesse des échanges entre pays et permet à n'en pas douter de faire progresser les sociétés par le dialogue entre les cultures.
A ce titre, il s'est félicité de l'adoption de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, de l'engagement de la France à verser, dès 2008, l'équivalent d'un point de sa contribution à l'UNESCO au Fonds international pour la diversité culturelle.
Il a souhaité, à cet égard, rappeler son attachement à la politique d'apprentissage des langues étrangères, estimant que si l'on souhaitait que sa langue soit respectée, il convenait aussi d'apprendre celle des autres. Il a estimé également qu'il fallait soutenir des projets tels que celui de la bibliothèque numérique européenne. Ce projet essentiel, dont la France est le fer de lance, nécessitera un effort financier important. Pour que vive ensuite le français dans cette diversité, le programme de formation de nouveaux professeurs mené par le ministère des affaires étrangères semble par ailleurs très utile et le rôle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose d'un budget en hausse cette année, doit également être mis en relief.
Il a développé, enfin, la question du soutien à la francophonie institutionnelle, à savoir l'OIF et ses opérateurs, au sujet desquels une vraie réflexion de fond doit être menée. Il a ainsi considéré qu'il ne pouvait être question pour l'OIF d'intégrer tous les pays ayant un tropisme francophile, aussi flatteur soit-il. L'OIF est avant tout une organisation réunissant des pays francophones dont l'objectif est de diffuser la langue française dans le monde, en tant que langue première ou seconde. En interne, les statuts de membre de l'OIF, membre associé et observateur doivent par ailleurs être clarifiés, afin que chaque pays respecte ses obligations, notamment en matière de diffusion du français.
Si les problèmes financiers de l'OIF ont fait la une des médias ces dernières années, l'organisation a aujourd'hui mené plusieurs réformes institutionnelles et un programme d'économies qui l'ont replacée sur la voie de l'orthodoxie. M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis, a donc considéré qu'il était temps que la France tienne sa promesse de mettre à disposition de l'organisation une « Maison de la francophonie » qui regrouperait les différents acteurs de la Francophonie, en vue de mutualiser leurs moyens et de donner une vitrine médiatique à leurs actions. La commission des finances du Sénat est intervenue l'année dernière afin que la discussion sur le projet de loi approuvant la convention passée entre la France et l'OIF soit reportée. Un rapport proposant un site alternatif pour la maison de la francophonie devrait prochainement être publié. Le rapporteur a déclaré qu'il serait attentif aux suites qui seraient données à ce rapport, car la crédibilité de la France dans le monde francophone est en jeu.
En dépit des réserves émises, notamment sur l'absence de vision stratégique de l'action francophone, il a enfin proposé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits dont le montant est globalement satisfaisant.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.

a déploré, au même titre que le rapporteur pour avis, que des ambassadeurs français fassent parfois des interventions en anglais, au prétexte d'un manque de moyens financiers ne leur permettant pas de recourir à des traducteurs.

a indiqué que dans le cadre des prochaines rencontres franco-chinoises de coopération décentralisée organisées à Bordeaux, outre la traduction simultanée permettant à chacun de s'exprimer dans sa propre langue, il avait proposé de faire appel à des étudiants comme « traducteurs de courtoisie », ce qui est de nature à protéger la francophonie. Il a rappelé son soutien à la proposition de loi complétant la loi dite Toubon, adoptée à l'unanimité par le Sénat, et s'est engagé à faire une démarche auprès de M. Roger Karoutchi, ministre chargé des relations avec le Parlement, afin qu'elle soit inscrite rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

a rappelé que la foire du livre à Brives était une manifestation s'inscrivant dans une démarche de défense de la langue française et de la francophonie, et a signalé que sa 27e édition, se déroulant en novembre 2008, aurait pour thème « la francophonie et le développement durable ». Il y a invité ses collègues et proposé que la commission s'y implique concrètement, par l'intermédiaire, le cas échéant, de l'organisation d'un colloque.

a considéré que le thème était d'importance, M. Claude Hagège ayant bien démontré que des langues disparaissaient, et qu'il fallait réfléchir à une politique d'écologie des langues, qui sont des espèces en voie de disparition.

Evoquant la réforme envisagée de l'audiovisuel extérieur, M. Jack Ralite a rappelé que la France n'était qu'un actionnaire parmi d'autres de TV5 Monde et qu'elle ne pouvait donc prendre des décisions unilatérales relatives à cette chaîne.

Notant que le débat autour de TV5 Monde était récurrent, M. Jacques Valade, président, a jugé difficile que France 24 puisse l'englober, dans la mesure où leurs objectifs ne sont pas similaires.

a insisté sur les différences entre ces deux chaînes : France 24 exprime, en effet, la position de la France à l'étranger dans la langue du pays où elle est reçue, alors que TV5 a une vocation culturelle et francophone. TV5 est, en outre, multinationale, la France n'en détenant que 72 % des parts.
Conformément aux propositions de son rapporteur pour avis, la commission a enfin donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Aide publique au développement » au titre de la francophonie dans le projet de loi de finances pour 2008.
La commission a procédé ensuite à l'examen du rapport pour avis de M. David Assouline sur les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat » du projet de loi de finances pour 2008.

a constaté que les crédits du programme « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'Etat » étaient en hausse de 2,3 % et s'en est félicité, au vu, d'une part, de l'importance de ce programme pour l'image de la France dans le monde, et d'autre part, des critiques récurrentes émises les années précédentes sur le manque d'ambition de ce programme.
Il a estimé toutefois qu'il ne fallait pas céder à un optimisme béat. En effet, disposer de crédits est pour les ministères une heureuse nouvelle, mais dans le contexte budgétaire actuel, il existe un impératif de gestion efficace de ces sommes. Or le ministère des affaires étrangères et européennes ne fait pas, selon lui, la meilleure utilisation de ces crédits dans la mesure où :
- il peine à définir des politiques globales susceptibles d'orienter son action, notamment dans le domaine de la promotion de l'enseignement supérieur ;
- sa politique vis-à-vis de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est ambiguë ;
- le périmètre actuel du programme n'est, enfin, pas satisfaisant. Les crédits de l'action culturelle en direction des pays en développement restent en effet inscrits dans la mission « aide publique au développement », comme si les échanges avec ces pays ne pouvaient qu'être économiques, et la politique culturelle en direction des pays en développement n'avait pour objectif que le gain de points de croissance. M. David Assouline, rapporteur pour avis, a estimé, que non seulement ce prisme lui semblait être hérité de notre passé colonial, mais qu'en plus il était néfaste à la lisibilité des crédits de la diplomatie culturelle. Il a déploré également que les crédits de l'audiovisuel extérieur soient insérés au sein de la mission « Médias », alors que l'objectif premier de chaînes de télévision comme TV5 et France 24 est indéniablement le rayonnement de la France et de ses valeurs à l'étranger.
Il a souligné que le ministère des affaires étrangères et européennes a par ailleurs défini plusieurs objectifs principaux d'actions pour le programme « Rayonnement culturel et scientifique », sans pour autant développer sa réflexion sur les moyens de les atteindre. Ainsi le ministère souhaite-t-il :
- le renforcement de l'attractivité de l'enseignement supérieur. Cet objectif, dont l'intérêt est incontestable, se concrétise à travers les crédits attribués à CampusFrance d'une part, et à la politique des bourses aux étudiants étrangers, d'autre part. Or, il s'avère que ces deux canaux d'intervention, pour intéressants et légitimes qu'ils soient, sont mal utilisés ;
- assurer le service public d'enseignement français à l'étranger, conformément aux missions confiées à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger par le code de l'éducation. Il est prévu que l'AEFE doit assurer un enseignement aux élèves français à l'étranger d'une part, et participer au rayonnement de la langue et la culture françaises par l'accueil d'élèves étrangers, d'autre part. C'est la double mission assignée à l'agence. M. David Assouline, rapporteur pour avis, a considéré que la récente décision du Gouvernement, faisant suite aux déclarations du Président de la République, de passer à la gratuité pour les élèves français de ces établissements, risquait de nuire à leur rayonnement, sans véritablement améliorer l'exercice de la mission de service public ;
- enfin, établir la créativité culturelle et intellectuelle française comme une référence mondiale. Le rapporteur pour avis a souligné que cet objectif fort louable passait notamment par la création d'une agence culturelle unique, comme la commission des affaires culturelles le préconise depuis plusieurs années.
Puis M. David Assouline, rapporteur pour avis, a évoqué la problématique de la promotion de l'enseignement supérieur français.
Notant que la France n'accueillait que 9 % des étudiants faisant leurs études supérieures en dehors de leur pays contre 30 % pour les Etats-Unis, ou 12 % pour l'Allemagne, il a affirmé que l'attractivité de nos universités était indéniablement en cause.
A cet égard, il a considéré que, si le classement de Shanghaï ne devait pas être la référence ultime en termes de valeur des universités, il avait un impact sur les décisions des étudiants, notamment les meilleurs, et a donc estimé que la France devrait être à l'initiative de la création d'un indicateur européen, susceptible de prendre en compte les spécificités et traditions des universités européennes.
Il s'est toutefois réjoui que les effectifs d'étudiants étrangers soient en hausse constante. Ils représentent aujourd'hui 15 % des étudiants à l'université et tant leurs origines géographiques que les filières qu'ils choisissent se sont diversifiées.
Pour autant, il a considéré que la politique menée aujourd'hui manquait d'ambition :
- tout d'abord, la stagnation voire, dans certains cas, la réduction des crédits consacrés aux bourses en direction des étudiants étrangers est clairement néfaste aux ambitions de la France. Ainsi le montant des bourses accordées aux étudiants étrangers est-il passé de 104 à 97,3 millions d'euros de 2005 à 2006, alors que dans le même temps le nombre d'étudiants a augmenté ;
- ensuite, la mise en place de CampusFrance, agence de la mobilité universitaire réunissant EduFrance, Egide et la partie des services du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) consacrée aux étudiants étrangers, tarde à être concrétisée. Il a insisté sur le fait que le but n'était pas que le Gouvernement utilise cette rationalisation de l'organisation administrative pour supprimer des crédits mais bien pour renforcer les actions en faveur de l'attractivité de l'enseignement supérieur français ;
- par ailleurs, les centres pour les études en France peinent à se mettre en place, ce qui retarde d'autant les procédures de facilitation de délivrance des visas étudiants ;
- enfin, l'attractivité des universités est une politique très large qui doit inclure l'amélioration des conditions de vie étudiante, la construction massive de logements étudiants afin de pallier l'absence de campus, et la mise en place de cursus attractifs pour les étrangers, sans lesquels l'intérêt pour les universités françaises, qui est pour l'instant réel, risque de se reporter sur d'autres pays. Il a souhaité, à cet égard, ouvrir le débat sur l'ouverture de cursus bilingues dans les universités françaises.
Il a ensuite abordé la question de l'enseignement assuré par les établissements français à l'étranger. Il a remarqué que les moyens étaient en hausse, notamment afin que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) puisse faire les investissements immobiliers requis par les transferts de bâtiments de l'Etat vers l'Agence.
Il a ensuite souligné que la mesure de gratuité pour les élèves français dans ces établissements, proposée par le candidat M. Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle, avait fondu comme neige au soleil pendant l'été, les seules classes de lycées étant finalement concernées.
Cette mesure constitue un effet d'aubaine pour des personnes qui ont, jusqu'au lycée, les moyens d'intégrer leurs enfants dans le réseau français et qui, a-t-il rappelé, ne sont pas contribuables en France.
a considéré que les bourses devaient certes être augmentées, comme il le propose au demeurant depuis plusieurs années dans son rapport pour avis, et être attribuées sur critères sociaux afin que seules les familles qui ne peuvent faire admettre leurs enfants dans les lycées français alors qu'elles le souhaiteraient, soient favorisées. Par ailleurs, les classes bilingues doivent absolument être encouragées dans les établissements scolaires étrangers. D'une part, il est essentiel que les Français expatriés puissent bénéficier de cours dans leur langue, même lorsqu'ils ne résident pas à côté d'un établissement français, et d'autre part, cette pratique aurait un impact fort sur la diffusion de la culture française. Il a ajouté que le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile prévoyait des cours de français pour le regroupement familial, dont le financement ne semble pas assuré.
Enfin, il a abordé la question du renforcement du réseau culturel français à l'étranger. Il s'est félicité de la poursuite de l'effort de rationalisation du réseau, mais a regretté que la proposition de loi de M. Louis Duvernois sur la transformation de CulturesFrance en établissement public, adoptée à l'unanimité par le Sénat, n'ait toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le Gouvernement.
Il a également regretté que le projet de création d'une agence culturelle unique, qui permettrait que l'action culturelle extérieure de la France gagne en notoriété et en cohérence, ne semble pas figurer dans les projets du secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie.
Il a estimé, en conclusion, que ce budget ne répondait pas suffisamment aux ambitions que l'on était susceptible d'avoir pour l'action extérieure de la France. Il a donc proposé de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits destinés aux relations culturelles extérieures dans la mission « Action extérieure de l'État ».
Un débat s'est ensuite engagé.

a tout d'abord observé que l'objet du projet de loi évoqué par le rapporteur pour avis n'était pas d'encourager l'immigration.

a ensuite indiqué qu'il n'approuvait pas les démarches d'établissements d'enseignement supérieur visant à proposer des cursus entièrement en anglais, mais qu'il n'était pas opposé à ce que des formations soient mises en place, dans des cas précis, en langue étrangère.

Evoquant la question du nouveau groupement d'intérêt public CampusFrance, M. Jacques Valade, président, a informé ses collègues qu'il avait été invité à se rendre à son premier conseil d'administration le 13 novembre prochain et qu'il en rendrait compte à la commission.
Quant au problème du logement étudiant, il a rappelé que Mme Valérie Pécresse avait indiqué, lors de l'audition organisée la veille par la commission, que des efforts importants allaient être engagés dans ce domaine au cours des prochains mois.
Contrairement à la proposition de son rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat » du projet de loi de finances pour 2008.
Au cours de la même réunion, la commission a désigné Mme Brigitte Gonthier-Maurin comme rapporteur de la proposition de loi n° 44 (2007-2008) de Mmes Annie David et Brigitte Gonthier-Maurin, tendant à créer au sein de l'éducation nationale un service de la psychologie pour l'éducation et l'orientation des élèves.

Puis elle a décidé de proposer à la nomination du Sénat M. Jean-Luc Miraux, comme titulaire, et M. Pierre Martin, comme suppléant, pour siéger au sein de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
Enfin, la commission a approuvé les propositions du bureau de la commission visant à la création de deux groupes de travail :
le premier relatif au baccalauréat sera animé par M. Jacques Legendre ;
le second sur la scolarisation des jeunes enfants sera animé par Mme Monique Papon.
Par ailleurs, elle a décidé de confier à Mme Catherine Morin-Desailly un rapport d'information sur la décentralisation des enseignements artistiques.