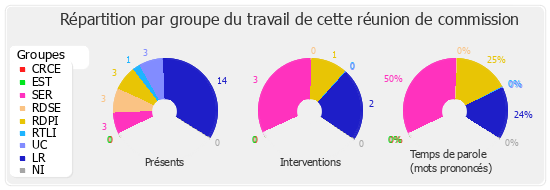Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 27 septembre 2016 à 14h35
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 14 h 35
La commission auditionne M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur la situation internationale, en particulier sur la Syrie, l'Irak et la Libye.

Nous vous remercions, monsieur le ministre, d'être présent devant notre commission, dès le début de notre session, pour faire le point sur les dossiers les plus brûlants. Nous proposons de nous concentrer sur les sujets les plus graves du moment - la Syrie, l'Irak et la Libye -, même si vous pouvez bien sûr évoquer les sujets que vous souhaitez.
Je précise que la conférence des présidents devrait valider ce soir l'organisation le 18 octobre prochain d'un débat de politique étrangère avec vous, monsieur le ministre. Nous pourrions définir comme thème pour ce débat « la France et l'Europe face à la crise au Levant », ce qui permettrait de traiter de nos rapports sur les migrants et la Turquie, en partenariat avec la mission d'information sur la position de la France à l'égard de l'accord de mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en oeuvre de cet accord. Je signale donc à cet égard à Mme Aïchi et à MM. Gorce, Malhuret et Haut qu'il serait opportun qu'ils demandent à leur groupe respectif du temps de parole pour pouvoir s'exprimer à cette occasion.
Enchaînons tout de suite avec notre sujet. Quelle est votre analyse, monsieur le ministre, de la situation syrienne ? Notre diplomatie est sommes initialement partie avec les États-Unis contre Bachar Al-Assad et nous nous trouvons maintenant en négociation avec les Russes, et un peu moins contre Bachar Al-Assad. La situation est donc confuse, d'où la clarification demandée par la France.
Par ailleurs, vous nous direz où nous en sommes en Irak, notamment en ce qui concerne l'offensive sur Mossoul, puis vous évoquerez la Libye, dont les nouvelles sont particulièrement préoccupantes puisqu'on y est proche de la guerre civile.
Je reviens de l'Assemblée générale des Nations unies et ces questions, en particulier celle de la Syrie, étaient au coeur de nos échanges et ont fait l'objet de multiples réunions. La France a pris l'initiative de commencer par une réunion avec les pays dits « affinitaires », puis il y a eu deux réunions du groupe international de soutien à la Syrie, le GISS, et la réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel. En outre, de nombreuses rencontres bilatérales ont été organisées.
Vous connaissez la situation. Nous étions tous dans l'attente de la mise en oeuvre de l'accord russo-américain, négocié depuis des semaines et qui a abouti le 9 septembre dernier. Cet accord est très fragile, il y a eu beaucoup d'accrocs dans sa mise en oeuvre. Une frappe américaine contre Daech a provoqué, parmi des soldats syriens, 60 tués et 150 blessés, ce qui a fourni un prétexte à des ripostes, un convoi humanitaire étant attaqué par des tirs d'aviation a priori russes, bien que la Russie le nie, ce qui a entraîné de nombreux morts parmi des travailleurs humanitaires (Croissant rouge et ONU). Cet enchaînement a fait voler l'accord en éclat.
Le régime a alors accentué ses attaques, prétendument sur des groupes terroristes, en réalité sur Alep. Cette ville est ainsi privée de toute aide humanitaire depuis des mois et cette situation ne peut rester sans réponse. Or j'ai assisté, je vous le dis franchement, avec beaucoup de consternation aux réunions du GISS, durant lesquelles se manifestaient des tensions fortes et des échanges verbaux très durs entre Sergueï Lavrov et John Kerry.
Dans ce contexte, que faire ? Nous nous battons pour l'instauration d'un nouveau cessez-le-feu, mais il faut changer de méthode. On le voit, on a atteint les limites de la négociation russo-américaine, qui n'est pas efficace. C'est pourquoi la France a pris l'initiative de demander un cessez-le-feu, en priorité à Alep, afin de permettre aux organisations humanitaires d'y accéder. Elle a aussi proposé au GISS et au Conseil de sécurité de mettre en place un mécanisme, ouvert à tout pays volontaire, en vue d'un suivi collectif de ce cessez-le-feu. Après une discussion très franche, cette idée a fait sont chemin et recueilli un large soutien des membres du GISS ou du Quint, qui s'est réuni à Boston à l'issue de la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Cette réunion du Quint (Etats-Unis, Royaume Uni, Italie, Allemagne, France et Union européenne) a abouti à une déclaration qui met en cause le soutien russe aux bombardements du régime à Alep, appelle à une action du Conseil de Sécurité, appelle un une condamnation de l'usage d'armes chimiques par le régime de Damas par l'ONU et inclut une référence au mécanisme de suivi que j'évoquais.
Il faut maintenir notre position sur la Syrie, d'autant qu'il existe un débat de fond avec la Russie en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nos positions sont claires vis-à-vis de Daech et la coalition, à laquelle nous participons activement, lutte contre cette organisation. La Russie met l'accent sur la lutte contre l'ex-Front Al-Nosra - il a récemment changé de nom -, affilié à Al-Qaïda. Nous sommes d'accord sur le principe - l'accord russo-américain portait d'ailleurs principalement sur la séparation des groupes de l'opposition modérée d'Al Nosra et sur une coordination des opérations contre cette organisation, ce qui supposait une localisation précise des différents acteurs présents sur le terrain.
Au cours des derniers mois, Al-Nosra s'est renforcé. Plus le régime frappe les opposants modérés, plus il encourage leur radicalisation et renforce leur proximité d'Al Nosra. Nous avons donc demandé à Riad Hijab, le président du haut comité des négociations, d'encourager toutes les forces de l'opposition modérée à se distinguer d'Al-Nosra. Il en est d'accord, mais il a du mal à être entendu du fait d'une radicalisation des combattants sur le terrain qui luttent pour leur survie. Les Russes en déduisent qu'il existe une ambiguïté au sein de l'opposition syrienne et qu'il faut donc soutenir le régime, qui frappe tant Al-Nosra que les autres groupes de l'opposition, alors que ces frappes poussent ces groupes sans cesse davantage dans les bras d'Al Nosra.
Les objectifs du régime, qui bénéficie de l'appui russe - 5 000 hommes - et iranien - 2 000 à 3 000 hommes -, sont de prendre Alep pour obtenir une victoire militaire avant toute négociation et de créer une « Syrie utile » incluant, entre autres, Damas, Homs, Alep et Lattaquié. Cette approche va à l'encontre des objectifs de la France qui estime qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique au conflit en Syrie, résultant de négociations de paix à Genève.
Notre but demeure en effet une Syrie unitaire, non confessionnelle, qui respecte les minorités et qui prépare une transition ayant pour finalités des élections libres et le départ de Bachar Al-Assad, avec qui la perspective d'une Syrie en paix est devenue impossible. Comment en serait-il autrement alors que sa stratégie consiste à perpétrer des massacres ? Ce que disait d'ailleurs le ministre syrien des affaires étrangères au Conseil de sécurité était épouvantable. À part le Venezuela, qui comparait la situation de la Syrie à celle du Mali - un pays indépendant qui a été attaqué par des groupes terroristes et s'est défendu -, personne ne le soutenait.
Je conclus sur la Syrie en répondant à une remarque que j'entends régulièrement. On demande parfois si une nouvelle résolution de l'ONU ou une condamnation de l'usage d'armes chimiques suffisent et s'il ne faudrait pas plutôt une intervention militaire visant à clouer l'aviation syrienne au sol. Je vais être franc : en 2013, alors que la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques a été franchie, la France s'est retrouvée seule, du fait de la défection des États-Unis et du Royaume-Uni, et l'intervention n'a pas eu lieu. Une telle hypothèse n'est donc pas crédible, alors que la complexité de la situation s'est encore accrue. Il faut garder le fil avec la Russie, même si c'est difficile, et la convaincre que son intérêt est d'avoir la paix, car le risque encouru est l'installation durable de forces terroristes dans cette région. On peut certes faire reculer Daech, mais, si la radicalisation se poursuit, cela représente une menace pour tout le monde : la France, l'Europe, les États-Unis et la Russie.
J'en arrive à la situation en Irak. Je ne retracerai pas l'histoire de l'intervention américaine dans ce pays ni la façon dont les suites ont été gérées. Ce pays a également fait l'objet de discussions au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut continuer de permettre à l'armée irakienne de reprendre les territoires conquis par Daech, en particulier Mossoul.
Cela dit, il faut aussi pousser en faveur d'une gouvernance en Irak plus inclusive. En effet, si les conditions militaires sont réunies pour reconquérir Mossoul, la France y prenant d'ailleurs sa part, deux problèmes subsistent : le départ, auquel nous nous préparons, de nombreux réfugiés de Mossoul et la gouvernance à venir de cette ville une fois libérée de Daech. Il faut en effet définir un schéma politique incluant notamment, après les opérations militaires, les Kurdes et les sunnites. Le Président de la République et moi-même avons rencontré le président irakien et avons abordé ce sujet.
En ce qui concerne la Libye, le Président de la République et moi-même allons recevoir cet après-midi le Premier ministre El-Sarraj, qui verra aussi M. Jean-Yves Le Drian. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, nous avons largement abordé ce sujet. La communauté internationale a renouvelé sa confiance au gouvernement libyen, mais les forces du général Haftar ont pris le contrôle des puits de pétrole à l'est du pays. Si rien n'est fait, si la ressource nationale est dans les mains d'un concurrent, le risque de guerre civile que vous évoquiez est réel ; la situation s'est d'ailleurs considérablement dégradée.
Nous allons donc rappeler que seule la société nationale d'exploitation pétrolière peut contrôler le pétrole et que le Gouvernement doit décider de l'utilisation de cette ressource dans l'intérêt de la population, qui en a besoin. Mais M. El-Sarraj doit aussi avoir une attitude ouverte vis-à-vis des forces politiques de l'est et rechercher avec elles un compromis. C'est le message que nous allons faire passer.
On voit toutefois les limites de cette méthode. Aussi allons-nous réunir à Paris dans les prochains jours tous les pays qui ont quelque chose à dire ou à faire pour faciliter l'émergence d'une Libye rassemblée. Cela concernera notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie. Il est compliqué de mettre tous ces États autour de la table, mais c'est notre objectif et nous allons y parvenir.
Je voudrais aborder, pour terminer, deux derniers points.
Le premier concerne l'initiative française de paix au Proche-Orient. Je ne dis pas qu'elle est facile à mettre en oeuvre, mais elle a fait bouger les lignes. Nous en avons beaucoup discuté lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La France a été reçue par le Quartet et j'ai organisé une rencontre de tous les participants à la réunion du 3 juin dernier au niveau des hauts fonctionnaires ; j'ai aussi participé à la réunion du groupe ad hoc de soutien aux Palestiniens. De nombreuses initiatives se font jour de l'Égypte, de la Russie ou des États-Unis qui peuvent peut-être avancer sur ce sujet, notamment si le président Obama en prend l'initiative avant la fin de son mandat. En tout cas, nous avons pu remettre la question du Proche-Orient à l'ordre du jour, bien que ce soit compliqué, compte tenu de la persistance de fortes divergences entre Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou qui se sont clairement exprimées à l'occasion de l'Assemblée générale.
Le second point concerne le Gabon. La politique française a toujours été claire : pas d'ingérence, rappel de certains principes et utilisation des voies juridictionnelles en cas de recours. Nous avons d'ailleurs calé notre position avec nos voisins européens, d'autant que l'Union européenne avait envoyé des observateurs, lesquels ont relevé des insuffisances dans le déroulement du scrutin, la cour constitutionnelle gabonaise ayant elle-même souligné quelques zones d'ombre. Il ne faut pas déstabiliser le Gabon - ce pays et cette région n'en ont pas besoin -, mais il faut encourager l'Union africaine à définir les conditions dans lesquelles le président élu pourrait inclure l'ensemble des forces politiques gabonaises dans leur diversité. L'objectif est que le Gabon ne s'éloigne pas des standards démocratiques internationaux.

On peut tous tenter d'agir pour trouver des voies de sortie aux situations que vous avez décrites, monsieur le ministre. Les sujets sont, il est vrai, nombreux, mais il faudrait tout de même faire le point sur la Turquie, où la situation est très préoccupante, ainsi que sur le Brexit et Calais. Le temps vous est aujourd'hui compté, mais j'aimerais que l'on puisse revenir ultérieurement sur ces deux sujets.
Sur le Proche-Orient, je constate qu'il y a de petits mouvements et, à force de petits mouvements, on arrivera peut-être à une avancée importante...

Vous avez parlé, monsieur le ministre, du comportement des Russes et des Américains à l'ONU. Qu'en est-il des Iraniens ? Comment se comportent-ils ?

Je m'interroge sur le sens de nos interventions militaires en Syrie, en raison de trois déclarations réalisées au cours des derniers mois. La première a été faite ici même par de hauts responsables militaires, qui estimaient qu'environ 20 % des 100 000 combattants rebelles sont fiables, c'est-à-dire non terroristes ni salafistes extrémistes. Notre situation est donc ambiguë. Deuxième déclaration, pendant l'été, le procureur de la République de Paris, M. François Molins, a dit que les victoires sur Daech accroissent le risque d'attentats sur notre sol. Enfin, votre déclaration sur l'accord russo-américain sous-entendait que notre engagement militaire ne permet pas d'influencer les positions de notre allié américain. Dans ces conditions, ne devrions-nous pas suspendre notre intervention dans la région, le temps que les buts de guerre soient clairement définis ?

Cette question est effectivement grave et l'on sent qu'elle se pose de plus en plus dans le pays.

On estime qu'il y a 5 000 Européens parmi les 20 000 combattants djihadistes, dont 200 Français. Est-ce le cas ?
Par ailleurs, il y a eu des enlèvements d'Italiens et de Canadiens en Libye. Quelle est la présence française dans ce pays aujourd'hui et de quelles protections bénéficient nos compatriotes ?
Ensuite, contrairement à ses engagements internationaux, la Russie emploierait des bombes à fragmentation. Peut-on faire pression pour qu'elle n'utilise pas ces armes ?
Enfin, je regrette que la rupture du cessez-le-feu en Syrie n'ait pas été plus condamnée par les chancelleries européennes.

Monsieur le ministre, vous terminez votre entretien avec le journal Libération, dans son édition d'aujourd'hui, en affirmant que nous soutenons le pays syrien et que nous l'aiderons à se reconstruire quand la transition démocratique sera engagée. J'ai deux séries de questions à ce sujet. Tout d'abord, quels sont les Syriens que l'on peut qualifier de démocrates, que représentent-ils, dans la guerre, et que pensez-vous des connivences que l'on prête à certains d'entre eux vis-à-vis d'Al-Nosra ? Ensuite, au Moyen-Orient, ce sont les systèmes reposant sur un homme fort, voire les dictatures - je pense à l'Égypte, à l'Iran, ou encore à l'Arabie saoudite -, qui fonctionnent. N'est-il pas temps que les Occidentaux laissent les Syriens, et les autres, décider de leur sort et évitent d'interférer ?

Il y a un drame humanitaire sans nom à Alep. Nous arrivons trop tard et l'aide est insuffisante. En outre se pose une question migratoire sans précédent en France. On parle de Calais, mais la résolution des conflits syrien et libyen apporterait une solution durable. Or on paraît impuissant... Quel est l'engagement réel des autres pays ? La France, les États-Unis sont engagés, mais existe-t-il une motivation assez forte, notamment de la part de l'Europe, pour apporter une réponse globale ?
En ce qui concerne la Turquie, nous avons vu la situation politique interne, mais il y a aussi un contexte international, avec la position ambiguë de ce pays vis-à-vis de Daech. La place de la Turquie dans l'OTAN pourrait-elle être remise en question ?

Je voudrais pour ma part savoir où nous en sommes de la coopération avec la Tunisie.
La Tunisie fait justement partie des intervenants que j'évoquais pour résoudre problème libyen.
Plusieurs d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont évoqué la question des migrations. La situation libyenne est très difficile et les migrants qui viennent en France via la Libye font des récits terribles de leur passage dans ce pays. Ils font ainsi état de l'exploitation des migrants dont se rendent coupables les passeurs et de viols de femmes. Le passage le plus terrible de tout leur parcours est donc la Libye. Or cela a des conséquences, du point de vue tant du terrorisme que des migrations - des bateaux ont encore coulé récemment avec des migrants à leur bord. Si l'on n'avance pas sur la question libyenne, la question se posera à nous de façon dramatique.
L'Union européenne est très engagée pour lutter contre les passeurs. Son action inclut notamment un programme de formation des garde-côtes, mais l'on part de très loin et l'on se heurte à une corruption importante. L'opération Eunavfor Med Sophia a vu son mandat élargi à la lutte contre le trafic d'armes, grâce à une résolution dont nous avons pris l'initiative au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons fait avancer cette cause au niveau européen.
En ce qui concerne la Turquie, il faut que ce pays reste dans l'OTAN.

Je posais cette question en raison du rapprochement de ce pays avec la Russie et de son positionnement ambigu vis-à-vis du conflit syrien.
Rappelons tout de même deux ou trois éléments. Même si beaucoup de choses ne nous plaisent pas, la Turquie reste un État de droit. Les 28 membres de l'Union européenne ont reçu le ministre turc des affaires européennes à Bratislava et il ne faut pas sous-estimer l'impact sur ce pays de la tentative de coup d'État militaire de juillet dernier. Les autorités turques ont eu le sentiment que les Européens sous-estimaient l'importance de cet événement - cela n'a pas été le cas de la France, puisque nous avons réagi tout de suite. Or on ne peut nier à un État le droit de poursuivre les auteurs d'une tentative de coup d'État, même s'il est vrai que la Turquie en profite pour procéder à des « purges », visant notamment les membres du mouvement Gülen, au sein de l'armée, de l'administration et de la presse.
Pour ce qui concerne l'application de la peine de mort, il est clair qu'un pays membre du Conseil de l'Europe ne peut revenir en arrière.
Quant à la question kurde, nous assumons clairement notre position selon laquelle le PKK est un groupe terroriste, mais nous poussons au dialogue pour régler la question kurde.
Vous évoquez également les relations de la Turquie avec certains pays, mais ne sous-estimons pas le poids des liens qui l'unissent à l'Europe. Certes, elle a renoué avec la Russie, ce qui est plutôt positif, ainsi qu'avec Israël et l'Iran, mais cela n'a pas eu pour effet de réduire notre dialogue avec elle. Nous avons un partenariat stratégique avec la Turquie et y avons des intérêts importants.
La Turquie est intervenue militairement en Syrie pour, d'abord, protéger sa frontière, avec un effet non négligeable pour la France : ce faisant, elle empêche le passage des membres de Daech.
L'objectif de la Turquie était ensuite d'empêcher la jonction de deux cantons kurdes en Syrie, pour éviter l'établissement d'une zone contrôlée par les Kurdes à ses portes. C'est pour elle fondamental.
La Turquie est donc devenue un acteur engagé en Syrie, comme en Libye où elle soutient les milices de Misrata. Il faut par conséquent parler avec elle.
J'en viens à la crise migratoire. La France accueille des demandeurs d'asile dans le respect de ses engagements internationaux. Elle le fait dans la clarté et l'humanité, d'où la décision du Gouvernement, rappelée par le Président de la République hier, de démanteler la jungle de Calais, qui pose un problème majeur pour la région, mais aussi pour l'image internationale de la France - certains s'en servent contre nous.
Mais démanteler ne suffit pas. Il faut aussi gérer l'accueil de façon équitable et répartir les demandeurs d'asile par petits groupes sur l'ensemble du territoire national. C'est faisable pour un pays de 67 millions d'habitants. Pour l'essentiel, les demandeurs d'asile sont syriens, soudanais ou afghans. Ils viennent de régions exposées à la guerre. Mais soyons clairs : les autres, les migrants qui n'ont pas vocation à rester en France, doivent repartir.
J'en viens à l'Iran. Nous avons eu une réunion intéressante à l'ONU sur le nucléaire iranien. Globalement, les experts indépendants de l'Agence internationale de l'énergie atomique le disent, l'accord est respecté. La levée des sanctions économiques, engagement pris dans le cadre de cet accord, pose en revanche problème du côté des États-Unis. Cela tend les relations avec les Iraniens, qui s'en plaignent et accusent les Américains de jouer un double jeu. Pour notre part, nous ne cessons de leur demander de lever ces sanctions.
L'Iran, vous le savez, soutient Bachar Al-Assad et souhaite sa victoire. Mon homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, à qui j'ai posé la question, affirme être défavorable à la partition de la Syrie et à la préservation de la Syrie utile.
La France, quant à elle, tient sa place. Elle a fermement dénoncé les violations du cessez-le-feu en Syrie. Si nous n'avions pas été aussi fermes dans nos positions - au Conseil de sécurité, dans les réunions ministérielles du Quint -, les lignes n'auraient pas autant bougé.
Les Américains ont cru que, en discutant avec les Russes, la situation allait s'arranger. C'est tout le contraire qui s'est passé. Notre marge d'action est réduite, mais nous devons l'utiliser. C'était très clair lors de la réunion ministérielle du Quint dont je vous ai parlé : nous avons fait bouger les Américains et les Britanniques et ainsi fait en sorte que le Conseil de sécurité se réunisse en urgence à l'initiative de nos trois pays.
Gaëtan Gorce, quant à lui, me demande s'il ne vaudrait pas mieux suspendre notre intervention militaire pour faire baisser le nombre d'attentats en France.
C'était presque cela ! Mais peut-être ai-je mal compris ? Vous vous appuyiez même sur les propos du procureur de la République de Paris. Je les comprends différemment. Pour lui, avec le recul de Daech en Irak et en Syrie, il faudra se préparer au retour des Français partis y faire le djihad.
Il n'y a quasiment plus de départs de France vers l'Irak et la Syrie, grâce aux mesures que nous avons prises et à la coopération que nous avons avec les pays voisins, notamment avec la Turquie. Mais il faudra, le procureur Molins a raison de le dire, être d'une grande vigilance avec les Français déjà partis, endoctrinés et formés militairement, et qui veulent revenir.
Notre engagement militaire se fait dans le cadre de la coalition internationale contre Daech, et seulement dans ce cadre. Il ne faut pas y mettre fin. Cela ne suffira pas, bien sûr, à combattre le terrorisme, car la bataille est aussi politique, mais cela y contribue.
Ceux qui pensent qu'il suffit d'arrêter nos interventions contre Daech pour être protégés s'illusionnent. Daech nous attaque pour notre modèle de société, notre démocratie. Et la France n'est d'ailleurs pas la seule attaquée. Il y a eu des attentats à New York, quand j'y arrivais pour l'Assemblée générale des Nations unies, motivés par la même cause. L'Allemagne est également visée. Je ne parle pas des pays musulmans, qui sont les plus touchés. C'est une réalité nouvelle, durable, à laquelle nous devons nous confronter entièrement, sans baisser la garde.
Bernard Cazeau, dans sa question, se demande qui sont les Syriens sympathiques. Je soulignerai seulement qu'il y a 10 millions de déplacés et de réfugiés syriens. Ils sont presque plus nombreux hors du pays, au Liban par exemple, où j'en ai vu certains, en Turquie et en Jordanie. Ces gens-là n'aspirent qu'à revenir dans leur pays, mais une fois qu'il aura retrouvé la paix.
De la même façon, les dirigeants libanais, par exemple, ne souhaitent qu'une chose, le départ des réfugiés syriens, qui sont 2 millions et qui s'ajoutent aux camps palestiniens.
Nous sommes prêts à aider à la reconstruction du pays, je l'ai dit. Il y a énormément de villes, d'équipements, d'écoles et d'hôpitaux détruits. Toutefois, nous ne participerons à cet effort que si les conditions politiques sont réunies. Cela vaut aussi pour l'Union européenne, qui est prête à consacrer beaucoup de moyens.
Nous condamnerions par ailleurs, si les enquêtes diligentées le prouvaient, l'usage par la Russie de bombes à fragmentation ou de bombes incendiaires. Il faut, en la matière, procéder de la même façon que pour l'utilisation des armes chimiques par le régime de Damas : une enquête internationale doit établir les faits et permettre au Conseil de Sécurité de prendre ses responsabilités en condamnant les actes qui le méritent. Si la Russie utilisait de telles armes, cela aggraverait encore ses responsabilités.
J'en viens au Brexit. Notre position n'a pas changé : la négociation doit démarrer au plus vite. Cette situation d'entre-deux est néfaste pour tout le monde. Il y a toutefois une difficulté : les Britanniques ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Boris Johnson est pressé ; il a dit clairement qu'il fallait assumer le résultat du référendum. C'est moins clair pour le reste du Gouvernement, notamment pour le Premier ministre.
L'article 50 doit donc être activé au plus vite, et je souhaite que Michel Barnier, qui a reçu mission de la Commission européenne de négocier la sortie du Royaume Uni puisse se mettre au travail.

La coalition internationale contre Daech a évolué. Qui compte-t-elle désormais, notamment parmi les pays du Golfe ?

Plus largement, qui sont nos alliés pour préparer la suite ? Qui sont nos partenaires fiables ? Quand on connait le coût des interventions extérieures -accru par le déploiement récent du porte-avions Charles-de-Gaulle qui vient encore renforcer notre dispositif- il est légitime de se demander s'il ne faudrait pas dépenser cette somme plutôt pour la prévention et le développement : je pense notamment à l'aide nécessaire à la jeune démocratie tunisienne... Avons-nous une influence autre que marginale sur la conduite des opérations militaires par la coalition, et quelles sont les possibilités de sortie de crise politique ? Ces questions se posent.
L'envoi du porte-avions ne bouleversera pas la donne militaire, mais il manifeste notre engagement clair et durable.
Les membres de la coalition se sont réunis à Washington en juillet dernier. Tous les pays du Golfe en font partie, hormis le Koweït et Bahreïn. Tous les membres participent à l'effort, en fonction de leurs moyens. Et tous les pays qui en ont la capacité ont plutôt augmenté leur niveau d'engagement.
La lutte contre la source du terrorisme en Syrie et en Irak est un objectif militaire, politique et stratégique.
Je n'opposerai pas, monsieur le président, la politique de développement, en faveur de la Tunisie, mais aussi de toute l'Afrique, à la politique de défense. À chaque Conseil des affaires étrangères, j'essaie de convaincre nos partenaires européens, notamment les Allemands, qu'il faut combiner la solidarité dans la protection - au Mali, avec l'opération Barkhane, ou encore la lutte contre Boko Haram - et la nécessité de monter en puissance dans l'aide au développement de l'Afrique. J'ai d'ailleurs noté que Mme Merkel faisait référence, pour la première fois à ma connaissance, à la complémentarité entre sécurité et développement, lors de la réunion du Quint en marge du sommet de l'OTAN de Varsovie. C'est un progrès, car, si le ministère français des affaires étrangères a aussi compétence en matière de développement, l'Allemagne dispose d'un ministère dédié au développement qui voit avec méfiance cette approche globale.
C'est souvent avec les Britanniques que nous avons une certaine identité de vues sur ces questions, même si je les pousse à s'engager plus contre Boko Haram. En l'espèce, sécurité et développement vont de pair. Le Niger, par exemple, pays pauvre, mais sérieux, est très fragilisé par Boko Haram. Il faut l'aider à la fois à se protéger et à se développer, sans se substituer aux efforts qui doivent venir de lui. Le G5-Sahel doit être aidé, car la solidarité en matière de défense a un coût pour les pays qui en font partie et c'est autant d'argent qu'ils ne placent pas dans le développement.
Les perspectives démographiques du continent africain doivent être bien comprises par les Européens : il y a énormément de potentiel, mais aussi énormément de risques.
Bernard Cazeau disait que nous n'avions pas à imposer le modèle démocratique. Les Tunisiens, pourtant, ont fait le choix de la démocratie. C'est le seul pays ayant connu le printemps arabe dans ce cas. Cela nous engage à les aider.
Avec le Qatar, qui a des moyens, nous allons d'ailleurs co-présider une conférence à la fin du mois de novembre sur l'investissement en Tunisie. Il faut aider la population tunisienne, sa jeunesse, qui sans cela s'impatientera, avec les risques de radicalisation que cela emporte.
Je suis admiratif des choix faits par les Tunisiens. La situation est fragile, mais la tendance est constante. Il faut donc les aider sans se substituer à eux.