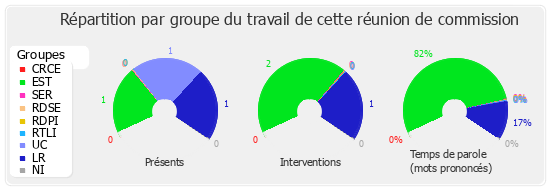Délégation aux collectivités territoriales
Réunion du 19 décembre 2019 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

La question de l'alimentation place les élus locaux en première ligne. Sur le plan législatif : la loi agriculture et alimentation du 30 octobre 2018 - dite « Égalim » - fixe, pour la restauration collective publique, l'objectif d'ici à 2022 de servir au moins 50 % de produits durables ou de labels de qualité, avec un minimum de 20 % de produits bio. Sur le plan « sociétal » : la demande des administrés en matière de santé, de traçabilité, de qualité de l'alimentation, notamment dans les cantines scolaires, n'a jamais été aussi forte. L'enjeu est considérable avec, par exemple, 1,15 milliard de repas par an.
À ce jour, moins de 4 % de produits bio sont proposés pour l'approvisionnement des cantines. Quels circuits d'approvisionnement mettre en place ? Une production locale en circuit court ? Faut-il favoriser la grande distribution bio ?
Une réponse classique consiste à fixer des clauses dans les marchés publics de restauration. Y a-t-il d'autres voies à explorer plus innovantes ?
Au niveau de « l'assiette », certaines collectivités ont fait le choix du 100 % bio et participent à des programmes européens. Par exemple, la ville de Mouans-Sartoux, ici représentée par M. Gilles Pérole, est cheffe de file dans le programme européen Biocanteens pour diffuser de bonnes pratiques.
Des intercommunalités ont lancé des projets sélectionnés dans le cadre du programme d'investissements d'avenir « Territoires d'innovation » pour créer des filières agroécologiques d'approvisionnement en circuit court. C'est le cas de Dijon Métropole, avec le projet « Alimentation durable 2030 », dont M. Benoît Bordat nous parlera.
Enfin, sur un mode plus médiatique et politique, la prise d'arrêtés municipaux anti-pesticides, initiée en mai 2019 par le maire de Langouët, a relancé le sujet des moyens d'action concrets à la disposition des élus locaux. Après l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Rennes, le 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en novembre dernier, décidé de ne pas suspendre les deux arrêtés anti-pesticides pris par les maires de Gennevilliers et de Sceaux sur le territoire de leur commune, au motif que « les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées ». MM. Daniel Cueff et Patrice Leclerc, respectivement maires de Langouët et de Gennevilliers, nous éclaireront sur les procédures en cours et les raisons locales et juridiques qui les ont conduits à prendre ces arrêtés.
Je précise que cette table ronde n'a pas pour objet de rentrer dans un débat scientifique sur la pertinence des décisions prises par ces communes. Ce qui nous intéresse, ce sont les moyens juridiques, les logiques de projets employées par les élus locaux pour développer une politique d'alimentation sur leur territoire.
Je remercie les collègues qui se sont joints à notre délégation ce matin : Mme Françoise Cartron, qui travaille sur le thème de l'alimentation à l'horizon 2050 au sein de la délégation à la Prospective, et M. Joël Labbé, qui est à l'origine de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires.
Ma commune, située entre Rennes et Saint-Malo, compte 602 habitants. Nous sommes engagés depuis vingt ans dans la transition écologique : toutes les décisions municipales sont examinées à l'aune de cette question. La commune produit 100 % de son électricité pour les besoins communaux, construit du logement social très écologique, récupère les eaux de pluie pour les sanitaires, et nous avons appliqué -- dix-huit ans avant la « loi Labbé » -- l'interdiction des pesticides dans l'entretien des espaces communaux, y compris le cimetière et le terrain de foot. Nous avons été la première cantine 100 % bio de France, il y a seize ans ; nous voulons éviter que les enfants ne consomment des pesticides et nous souhaitons soutenir une agriculture moins polluante pour les sols et l'eau.
La population est donc très sensibilisée aux questions des pesticides et elle a été abasourdie par la démission de Nicolas Hulot, parti en déplorant de ne pas obtenir les arbitrages qu'il voulait pour la transition écologique. Et c'est dans ce contexte que l'on a constaté, à partir d'une analyse d'urine, des taux de glyphosate 30 fois supérieurs à la norme pour une petite fille, dont les parents consomment bio, qui mange à la cantine. Cela a fait événement dans la commune, les gens sont venus me demander de faire quelque chose. Or, j'avais déjà pris en 2016 un arrêté pour protéger les ruches contre les pesticides tueurs d'abeilles dans un rayon de 3 kilomètres. Le préfet n'y avait rien trouvé à redire et personne n'en avait entendu parler... J'essaie alors de convaincre les agriculteurs que les conversions bio sont profitables dans le territoire, à proximité de Rennes, mais ils me répondent que ce n'est guère possible pour eux, qu'ils ont déjà engagé bien des investissements pour l'agriculture raisonnée.
C'est alors que j'ai pris un arrêté, non pas d'interdiction des pesticides, mais imposant une distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres, distance que nous avons trouvée dans une étude sur des terrains de sports en Allemagne. Des solutions techniques existent pour cultiver dans ces 150 mètres, nous y avons travaillé et la configuration du village s'y prête. Malheureusement, Mme la préfète de la République, qui n'avait manifestement pas pris la mesure de là où elle venait d'arriver en tant que fonctionnaire, a adressé un communiqué de presse à Ouest-France - journal le plus lu en France et seul journal vraiment très lu en Bretagne - disant qu'elle me traduirait en justice si je ne retirais pas mon arrêté... Cette réaction a déclenché une avalanche de soutiens venus de partout, y compris de l'étranger. Les gens se mobilisent pour des raisons personnelles, contre les pesticides, parce qu'ils pensent que les pesticides sont néfastes, mais aussi pour des raisons institutionnelles, ils ne comprennent pas pourquoi un maire ne pourrait pas protéger la population. Le Président de la République, d'ailleurs, a déclaré que mes intentions étaient bonnes, mais que j'avais tort sur la forme... ce qui n'est guère compréhensible, en particulier vu de New York ou de Suisse...
Quelque 130 maires ont pris un arrêté similaire au nôtre, y compris en ville ; c'est très important, parce que notre message n'a rien contre les agriculteurs. Nous sommes contre des produits, contre l'usage de produits dont on n'évalue pas précisément les effets sur la santé humaine. Je vous invite à regarder une émission diffusée hier sur France 5, où l'on voit le ministre Didier Guillaume assurer que le Gouvernement fondera sa décision sur les études de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et un directeur-adjoint de l'Anses affirmer de but en blanc que l'Agence ne dispose pas d'étude sur le sujet : c'est un retournement spectaculaire, en direct...
En réalité, les effets des épandages de pesticides ne sont pas étudiés d'assez près. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) nous dit que les agriculteurs respectent les indications, en particulier les procédés anti-dérives, mais il faut tenir compte du temps pendant lequel il ne faut pas pénétrer sur les surfaces traitées, et l'effet des vents pendant cette période -- pour le colza, dans ma commune, c'est 48 heures... pendant lesquelles de véritables cocktails se forment.
En outre, des mesures ont été faites par les agences de l'air, à la demande de Nicolas Hulot quand il était ministre, mais n'ont pas été rendues publiques. Pourquoi ? C'est incompréhensible, inacceptable. Enfin, il faut savoir que 96 % de nos compatriotes, selon un sondage de l'Ifop, approuvent les arrêtés que nous avons pris.
Ma commune compte 46 000 habitants et 46 000 emplois, dont beaucoup sont industriels -- nous venons d'être labellisés territoire d'industrie par le Gouvernement. Pourquoi avoir pris cet arrêté anti-pesticides dans une telle ville ? D'abord, sur un plan personnel, parce que je suis apiculteur amateur et que je regrette que les abeilles soient détruites à la campagne et qu'elles vivent mieux en ville. Ensuite, parce que, sur le fond, la décision est politique : l'objectif est de changer de mode de production -- cela ne se fait pas en un jour -- : il faut soutenir nos agriculteurs pour cette transition. Ma commune s'est engagée, dès 2008, à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour le traitement des espaces publics -- la SNCF a continué de le faire durant plusieurs années sur les lignes qui traversent notre territoire, sans que les habitants le sachent toujours... Quoiqu'il en soit, je peux dire que toute la population soutient ces mesures, à quelques exceptions près, car il se trouve toujours quelqu'un pour dire que le nucléaire c'est bien et que l'amiante ce n'était pas si mal...
Les décisions de justice intervenues contre les arrêtés ne suivent pas toutes le même raisonnement. La différence de traitement repose sur le point de vue des juges. À Rennes, la présidente a appuyé sa démonstration sur le fait que l'action du maire était légitime, mais illégale. Elle a considéré qu'une loi était nécessaire et nous a renvoyés vers les parlementaires ou le Gouvernement. À Cergy, en revanche, la juge a pris en compte la dangerosité des produits ainsi que la carence de l'État, considérant que l'action des maires était légitime parce que l'État n'agissait pas en urgence. C'est important, parce que ces éléments, que beaucoup de tribunaux administratifs ne relèvent pas, vont nous permettre de construire notre action sur le fond : nous avons pris ces arrêtés dans l'attente d'une action de l'État, pour protéger les populations. Il est donc important pour nous, maires, que l'on reconnaisse notre capacité à défendre nos populations, comme c'est le cas en situation de crise grave ou d'accident industriel.
L'interdiction des pesticides vise également à encourager la transition écologique dans le mode de production agricole. Nous avons ainsi prévu de produire en maraîchage bio, dans la ville voisine d'Argenteuil, sur quarante hectares de terres agricoles que nous allons acheter et reconvertir pour nos cantines, mais aussi pour les associations en faveur du maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) qui s'approvisionnent aujourd'hui à plus de cent kilomètres de Paris. Faire reculer les zones d'épandages autour de l'agglomération, c'est faire reculer la pollution et permettre la transformation des terres agricoles autour de Paris afin d'alimenter les écoles de la métropole en 100 % bio et en circuit court. En zone urbaine, c'est particulièrement difficile : à Gennevilliers, nous avons aujourd'hui atteint 30 % en bio. De ce point de vue, la loi est trompeuse car elle impose un pourcentage de la somme consacrée, mais pas du nombre de produits employés.
Nous avons créé un syndicat intercommunal de trois villes pour produire les mets de nos cantines. Nous en profitons pour modifier notre chaîne de cuisson afin de supprimer le plastique, comme nous y sommes contraints. Tout cela a un coût, évalué au total à plus de 1 million d'euros. Nous penchons vers des récipients en verre, dont nous discutons de la production avec des industriels, qui dégagent moins de matière à la cuisson que l'inox.
C'est donc une politique globale, avec des surcoûts importants mais aussi des limites : par exemple, il faudra maintenant stocker les gamelles, alors qu'auparavant on jetait les pochettes en plastique.

Ces regards croisés entre urbain et rural sur des objectifs communs sont très intéressants.

Merci à la délégation de nous permettre d'entendre les collectivités territoriales qui ont déjà expérimenté dans ce domaine. Les uns et les autres, vous êtes dans une logique globale de développement durable, de prise en compte de la santé des Français et de la biodiversité.
S'agissant de Langouët, je connais M. Daniel Cueff depuis longtemps : il a été à l'origine du réseau Bretagne rurale et développement durable (Bruded), qui rassemble aujourd'hui 172 communes de toutes tendances politiques pour mutualiser les connaissances sur tous ces sujets. J'avais été l'un des premiers adhérents lorsque j'étais maire de Saint-Nolff, c'est une structure exemplaire que la délégation devrait auditionner.
Monsieur Leclerc, vous évoquez les « trous dans la raquette » de la loi Labbé s'agissant des cimetières et des terrains de sport. En effet, ces espaces avaient été écartés du texte pour dégager une majorité, car ils sont très sensibles. Nous travaillons aujourd'hui sur un complément : nous avons constaté qu'une révolution culturelle était en cours dans les cimetières, avec une végétalisation sans pesticides mise en oeuvre par les maires en dehors de toute obligation. De même, pour ce qui concerne les terrains de sport, ce sont les parents eux-mêmes qui viennent nous demander pourquoi les épandages y sont encore permis. À mon sens, il convient de discuter plutôt que d'imposer. Enfin, il restera à traiter les espaces verts privés, relevant des copropriétés ou des entreprises, qui doivent être concernés aussi, par souci de cohérence.

À propos de ces « trous dans la raquette », observons nos propres comportements. J'habite à Mulhouse, une ville dans laquelle il y a de nombreux jardinets. Il est frappant de constater combien, en quinze ans, nos pratiques ont évolué.

Je reviens sur cette notion de niveau global : nous devons réfléchir à des politiques volontaristes à long terme et globalisantes. Mais, en même temps, il nous faut mettre en place des transitions afin d'éviter les incompréhensions. Dans ma commune, nous n'utilisions pas de pesticides afin d'amener à des changements de comportements par l'exemple. Il est pourtant difficile de dépasser les habitudes de pratiques et nous nous retrouvons face à des confrontations catégorielles, alors que l'objectif en lui-même nous réunit : il y va en effet de la santé humaine, de la santé du vivant et de la terre. Cela n'est pas suffisamment mis en perspective et il importe donc d'établir en commun des transitions pour permettre d'avancer à petits pas. L'exemple des cimetières est significatif : faut-il préférer une loi idéologiquement parfaite ou une avancée contenant des dérogations qui lui permettent d'être adoptée et appliquée ?
Comment appréhendez-vous cette question dans votre pratique d'élus locaux ? Qui décide des transitions : les citoyens, le conseil municipal ou vous-même ? Comment parvenez-vous à construire une conscience partagée et une progression collective ?

S'agissant du bio en restauration collective, de l'approvisionnement, de l'organisation des circuits courts, comment avez-vous organisé la filière ? Je sais que les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles souhaitent ne pas rester de côté ; avez-vous pu les sensibiliser localement pour aboutir à des résultats ?
Sur votre commune, vous indiquiez que des agriculteurs ont spontanément réorganisé leur mode de production. Dans ce contexte d'« agribashing », il n'est pas facile d'accompagner l'agriculture. L'achat de terres agricoles est, à ce titre, une solution intéressante, car il faut des parcelles pour les circuits courts.
Ces questions sont fondamentales. Comment parvenir à la transition ? Sur l'usage des pesticides en agriculture, la France est soumise à une directive européenne qu'elle doit transposer afin de protéger les riverains. Or, elle ne l'a toujours pas fait. C'est une carence manifeste et le maire est donc dans son bon droit en agissant.
Les plans Écophyto ont été confiés, à grands frais, au syndicat majoritaire, avec pour objectif une réduction de 50 % de l'usage des pesticides. Ceux-ci ont pourtant augmenté de 17 % dans mon secteur. Je connais bien les agriculteurs, ils me disent que cette histoire de glyphosate ne débouchera jamais sur rien, que les ministres passent, mais que le syndicat reste et qu'il les protégera toujours. Je ne constate pas du tout de préparation de la profession à un changement de modèle, car ces agriculteurs sont encombrés par la notion d'agriculture raisonnée, inventée en 2002 par la FNSEA et l'industrie chimique, et ils se félicitent de faire des efforts par rapport à leurs parents. Ils n'imaginent pas un instant nuire à la population du voisinage et cette idée leur est insupportable.
On peut échanger sans difficulté avec les agriculteurs, mais le syndicat lui-même ne veut pas discuter. En Bretagne, il préside 100 % des coopératives qui vendent des pesticides, suite à des décisions de cogestion prises après la guerre. M. Edgar Pisani, qui avait été ministre du Général de Gaulle, me disait que c'était un grand succès que d'avoir réussi à nourrir la France et à sortir l'agriculture de sa misère après la guerre, mais qu'il aurait fallu que la machine productiviste s'arrête. Or de puissants intérêts empêchent cette transition.
Les agriculteurs sont perdus : on leur annonce la fin du glyphosate, puis on recule, puis on trouve encore des arguments pour en repousser la date. Si on leur disait fermement « dans cinq ans, c'est terminé ! », on ouvrirait au contraire des possibilités, car les paysans ont des solutions.
Monsieur le sénateur Antoine Lefèvre, votre question touche au « métabolisme territorial » : la fourniture des cantines bio est liée aux circuits courts, c'est ainsi que l'on fait des économies, car les menus sont conçus selon les saisons. L'agriculture conventionnelle est trop coûteuse en logistique pour cela, elle est mieux adaptée à l'exportation, à l'international. Techniquement, il n'est pas possible de se fournir localement en conventionnel, c'est pourquoi ces démarches dégagent un espace magnifique pour l'agriculture bio.
À Langouët, cette transition est portée par quatre, bientôt cinq, anciennes familles du village, mais dans le silence. On s'en rend compte quand des agriculteurs demandent le développement de haies bocagères pour protéger les terres et les bêtes. S'ils fanfaronnent à ce sujet, ils sont en revanche rattrapés par un monde agricole qui les accuse de le trahir.
L'agriculture laitière intensive chimique a commencé à Langouët, dans les années 1960, et la totalité des haies bocagères ont été arrachées pour permettre la mécanisation. Jean-Michel Lemétayer, ancien président de la FNSEA, était d'ici -- je le connaissais très bien --, il défendait ainsi le productivisme, la mécanisation et l'agriculture raisonnée qui devait, disait-il, empêcher de se passer des pesticides !

J'habite non loin de la centrale nucléaire de Fessenheim et je constate que, contrairement aux Suisses, par exemple, nous ne savons pas bien gérer les transitions en fixant des objectifs précis auxquels tout le monde doit se tenir.
Les discussions les plus vives sur l'agriculture sont celles que j'ai avec les membres de ma famille qui sont agriculteurs dans la Manche. L'agriculture raisonnée est un piège : les agriculteurs ont le sentiment de respecter la nature et les hommes, alors que les pesticides sont toujours répandus et font toujours autant de dégâts. Il serait intéressant de voir comment on pourrait enseigner dans les écoles d'agriculture un autre mode de production, moins productiviste et sans pesticides.
Je reviens sur le débat entre la tradition et la rupture. Je suis issu d'une tradition politique plutôt portée sur la rupture, mais je partage votre idée, on peut inscrire la rupture dans le temps. L'interdiction de fumer a été brutale et a profondément bouleversé nos vies. Chacun avait beau savoir qu'il était dangereux de fumer, il était très difficile de s'arrêter. Lorsque l'on ne fumait pas et que d'autres fumaient, il fallait tout simplement que les non-fumeurs sortent de la pièce. En définitive, cette interdiction brutale a permis à ceux qui le désiraient d'arrêter de fumer. Ainsi la rupture peut être nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit de questions de santé.
Comme maire, il faut acter la rupture. On peut mesurer la capacité d'acceptation de la population. À Gennevilliers, on a interdit les produits phytosanitaires dans les cimetières en 2008. Il a fallu deux ans pour que les gens s'habituent, comme lorsque l'on a instauré le fauchage raisonné des pelouses publiques ou que l'on a réintroduit des herbes au pied des arbres. C'est le temps nécessaire aux personnes pour redéfinir leur rapport au beau et, dans les cimetières, à la dignité. L'effort est d'ailleurs sans doute plus difficile dans les villes populaires qui aspirent à reproduire les canons classiques du chic, symbolisés couramment par des gazons anglais ou des buissons bien taillés.
Les maires doivent donc dire non seulement ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font. Il convient en fait de donner du sens et de faire oeuvre de pédagogie, notamment à travers des débats publics pour associer les populations. La politique passe par le conflit, qui permet d'avancer par la délibération commune et de parvenir à un compromis dans le sens de l'intérêt général. Mais pour cela, il faut afficher une position de rupture pour donner un sens et permettre d'organiser la transition. Mais, à l'inverse, si on privilégie la transition sans afficher d'objectif de rupture, il n'y aura pas de transition et on maintiendra l'existant, comme l'a bien montré Yves Salesse dans Réformes et révolution.

Je vous remercie. J'ai été très intéressé par vos propos. Lorsque j'étais président d'agglomération, j'éprouvais parfois un sentiment d'échec sur certains points qui n'avançaient pas assez vite. On m'expliquait que les transitions prenaient du temps... Je l'avais dit à mon successeur, les choses se sont accélérées. En fait, quand on veut, on peut !
Passons maintenant à une deuxième séquence, consacrée à un échange sur les bonnes pratiques pour mettre en oeuvre une alimentation saine et durable -- souvent, les bonnes pratiques précèdent la loi ou l'inspirent.
À l'origine du projet de cantine 100 % bio à Mont-Sartoux, on trouve le principe de précaution. L'idée est née en 1998, au moment de la crise de la vache folle. Comme il était interdit de servir du boeuf dans les cantines, nous sommes passés au boeuf bio. On a pris conscience des effets possibles des techniques agricoles sur la santé et l'environnement. M. André Aschieri, à l'époque député-maire de la commune, présidait un groupe de travail sur la santé et l'environnement d'où est sortie l'idée de créer l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui a depuis été intégrée à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il essayait de mettre en oeuvre localement le principe de précaution. Les scientifiques nous alertent sur les risques sanitaires liés à l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture. La question pour les décideurs publics est de trouver les moyens pour en tenir compte dans leurs décisions. Les citoyens sont aussi très informés. Il existe une attente sociétale forte.
À Mouans-Sartoux, nous organisons un festival du livre depuis trente ans, au cours duquel nous accueillons 60 000 personnes en trois jours. Ce festival, lieu de débats et de discussions, a alimenté nos réflexions et nous avons construit notre projet à la lumière de ces sources d'information. C'est un élément important à noter, ce festival a servi de base à la construction d'une culture commune avec la population.
J'en reviens à l'alimentation. Le Grenelle de l'environnement avait fixé un objectif de 20 % de bio dans les cantines en 2012. Nous n'en sommes encore, au niveau national, qu'à 4 %... Si le bio est important, pourquoi ne pas basculer totalement ? On a donc décidé, en 2008, de passer le plus vite possible au 100 % bio. On voulait le faire à coût constant. En fait, en passant de 20 % d'aliments bio en 2008 à 100 % en 2012, on a économisé 6 centimes par repas sur le coût des achats - le coût d'achat des repas est passé de 1,92 euro à 1,86 euro. L'économie réalisée tient au changement des pratiques et à la réduction du gaspillage alimentaire, qui représente un tiers des volumes en restauration collective !
Outre la question du coût, il fallait résoudre la problématique de l'approvisionnement. Le département des Alpes-Maritimes n'est plus une terre agricole, à l'exception des fleurs pour les parfums. L'élevage et le maraîchage dans l'arrière-pays ont disparu au profit d'une urbanisation galopante. Il est possible d'acheter local par le biais de marchés publics -- on a essayé --, mais personne n'a répondu puisqu'il n'y avait plus de producteurs. On a donc créé une régie municipale agricole. Depuis 2011, nous produisons les légumes de notre cantine. Sur un terrain de 6 hectares, nous avons salarié trois agriculteurs qui produisent 27 tonnes de légumes et couvrent 95 % de nos besoins pour fournir les 1 300 repas servis chaque jour dans la commune. La conclusion est donc que les solutions viennent souvent des territoires et que les élus locaux sont capables de les construire.
Dans le plan local d'urbanisme de 2012, nous avons classé 112 hectares en zone agricole, contre 40 précédemment, la commune ayant une superficie de 1 350 hectares. Cela ne suffit pas à nourrir la population, mais cette décision a constitué un marqueur politique à quelques mois des municipales.
Nous partageons notre expérience avec d'autres villes européennes, dans le cadre du programme de coopération territoriale européen « Urbact » au sein du réseau « Biocanteens », ainsi qu'avec neuf villes françaises dans le réseau « Cantines durables - Territoires engagés ». Nous accompagnons ces collectivités pendant deux ans pour les aider à impulser une dynamique adaptée aux problématiques locales. On a aussi créé, avec l'université Côte-d'Azur, une formation universitaire pour former des chefs de projet en alimentation durable dans les collectivités. Ainsi, en trois ans, une cinquantaine de personnes ont été formées.
Le réseau des territoires « Un Plus bio » regroupe 280 communes, sept départements et une région, avec l'objectif de travailler ensemble pour développer la restauration collective bio locale et durable. Il s'agit d'un échange de bonnes pratiques entre territoires. Nous organisons chaque année les « Victoires des cantines rebelles », à l'Hôtel de ville de Paris, qui récompensent et mettent en lumière les expériences réussies afin de donner des idées à d'autres territoires. Nous souhaitons aussi faire évoluer les lignes au niveau national. Lorsque le Sénat hésitait sur l'objectif de 20 % de bio dans les cantines, lors de l'examen de la loi Égalim, nous avions publié avec Joël Labbé une tribune dans Libération pour défendre cet objectif et réaffirmer qu'il était accessible. Finalement, le seuil de 20 % de produits bio a été adopté. Ce seuil, qui figurait déjà dans le Grenelle de l'environnement, représente une étape, mais nous considérons qu'il faut aller au-delà. Il ne doit pas constituer un plafond de verre pour l'alimentation bio. Je vous invite à engager la réflexion pour aller vers une loi Égalim 2 et poursuivre la dynamique après 2022.
Nous travaillons aussi sur les enjeux de production. Dominique Granier, président de la Safer Occitanie, ancien président de la chambre d'agriculture du Gard et ancien président départemental de la FNSEA, a identifié 58 000 hectares de friches en Occitanie qui pourraient être dédiés à la production d'alimentation bio. Le potentiel existe, il faut l'exploiter.
Un mot sur les marchés publics. En jouant sur les critères d'attribution, il est possible de favoriser l'approvisionnement local, mais les petits agriculteurs ne peuvent pas répondre aux marchés publics, car il faut s'inscrire sur une plateforme avec une procédure administrative lourde. Surtout, comment s'engager à l'avance à fournir une production que l'on n'est pas sûr de pouvoir produire ? Les aléas climatiques, comme les inondations ou les canicules, peuvent détruire les récoltes. En juin prochain, à l'invitation de Marc Tarabella, député européen belge, nous plaiderons au Parlement européen pour la création d'une exception alimentaire dans les marchés publics, en nous inspirant des travaux de François Collart-Dutilleul, chercheur en droit de l'alimentation. L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. Elle devrait être traitée différemment dans les marchés publics. Nous souhaitons qu'il soit autorisé de procéder à l'octroi en gré à gré d'une partie de chaque lot d'un marché public, sous réserve d'un approvisionnement auprès de petits producteurs locaux qui travaillent en bio.

Merci pour ces éléments. Les marchés publics ont permis de rendre plus transparentes les procédures, mais ils ne doivent pas être rigides en effet. Je cède la parole à M. Benoît Bordat, conseiller métropolitain de Dijon Métropole délégué à l'agriculture périurbaine, en charge du projet « Alimentation durable 2030 ».
Au printemps dernier, le maire de Dijon, François Rebsamen, a pris un arrêté interdisant le glyphosate, car, si les agents de la collectivité et les particuliers n'utilisaient plus de pesticides de synthèse, certaines entreprises ou copropriétés privées en utilisaient encore.
Avant de vous présenter notre projet « Territoires d'innovation - grande ambition » (TIGA), un mot sur l'historique. La métropole entretenait des liens étroits avec le monde agricole, la chambre d'agriculture et les syndicats, à travers le réseau Terres en ville ; nous avions institué des marchés fermiers ; établi un partenariat avec la chambre d'agriculture et la Safer. En 2015, nous avions fait l'acquisition de 300 hectares de terres agricoles dans un souci de reconquête agricole ou viticole, ce qui nous a permis de réinstaller des jeunes agriculteurs ou viticulteurs travaillant en bio. Nous possédions aussi une régie municipale pour la restauration scolaire. Faute d'une légumerie, nous sommes obligés d'acheter des légumes de 4e gamme.
Nous avons répondu à l'appel à projets de l'État « Territoires d'innovation - grande ambition » dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, et avons eu la chance d'être retenus avec notre projet d'alimentation durable. Ce projet s'inscrit dans une durée de dix ans. Il vise à associer les partenaires qui ont un lien avec le territoire, comme les entreprises SEB, Orange, etc. Les collectivités n'ont pas l'obligation de s'occuper des questions d'alimentation. Mais les citoyens sont très vigilants sur leur alimentation et nous sollicitent. Vous disiez que l'on ne savait pas gérer les transitions en France, mais il me semble que l'on y est maintenant bien obligé car ce sont les citoyens qui nous demandent d'agir.
C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un grand projet de transformation, en associant les entreprises locales, y compris de l'agro-alimentaire. On a noué des alliances avec les territoires agricoles environnants, rencontré des groupes d'éleveurs, des laitiers, des producteurs maraîchers. Puis, nous avons regroupé les marchés publics de tous les établissements publics de la ville. Cela représente un marché public de 14 millions de repas par an. Nous avons calculé les surfaces agricoles nécessaires ; cela représenterait 100 hectares de légumes, 50 hectares de pommes de terre, 35 hectares de légumes racines, etc. Cela semble énorme, mais si l'on rapporte ce total à la surface agricole du département -- 460 000 hectares --, on constate que l'effet de levier est bien modeste. Il convenait donc d'associer à notre démarche « du champ à l'assiette » les industriels, les supermarchés locaux, qui sont aussi confrontés, de leur côté, à une baisse de la fréquentation et à des changements dans les modes de consommation sous l'effet du numérique et de certaines applications comme Yuka. Nous pensons que les nouvelles applications peuvent être intéressantes, que de nouvelles technologies, comme celles développées par Seb, permettront de faciliter la transformation des produits bruts et d'inciter les gens à changer d'alimentation. Ainsi avons-nous défini 24 actions, qui doivent être déclinées sur une dizaine d'années.
On a aussi identifié un millier de familles en situation de précarité et qui ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes. Nous allons donc tester pendant six mois un système de tickets alimentaires pour voir si l'on parvient à changer leurs habitudes.
Pour que les circuits courts fonctionnent, il faut qu'ils procurent un prix rémunérateur à l'exploitant agricole, tout en restant abordables pour le consommateur. Nous sommes en train de développer un label agro-écologique avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), avec un système de flashcode, pour garantir que les produits respectent trois conditions : sociale, environnementale et locale. L'INRA de Dijon travaille aussi, par ailleurs, à des solutions alternatives au glyphosate.
Ce projet sera doté de 45 millions d'euros en dix ans. Le Premier ministre avait annoncé une grande enveloppe de 450 millions d'euros, mais en ce qui concerne le programme TIGA, nous pourrons mobiliser 26 millions d'euros du secteur privé, tandis que l'État va nous accompagner « généreusement » à hauteur de 3 millions d'euros avec éventuellement des participations de 7 à 8 millions... Nous avons la chance d'avoir des partenaires privés, je ne sais pas comment feront ceux qui n'ont pas d'autres sources de financement !
Un mot aussi sur les projets alimentaires territoriaux (PAT) : ils sont très en vogue, mais il manque un référentiel partagé. Il conviendrait de réfléchir à une trame commune.
En conclusion, je veux souligner l'importance de nouer une alliance des territoires autour de la ville. Dijon est entouré de terres d'élevage, de polyculture, de maraichers. On peut envisager de prendre des parts dans un abattoir local : pourquoi faire venir la viande de loin alors que l'on a un abattoir à proximité ? C'est aussi une question de bien-être animal.

Merci. Je ne voulais pas paraître pessimiste en parlant des difficultés à réaliser les transitions : quand il y a un projet, on trouve les moyens, mais si le projet n'existe pas ou que l'on se décourage, la question des moyens reste ouverte.
Je souscris tout à fait à vos propos sur l'alliance des territoires. C'est indispensable. Les démarches volontaristes de rapprochement entre collectivités sont une voie d'avenir.

Il faut trouver les équilibres dans les usages de la nature, lieu d'agrément, lieu de production ; c'est une question d'aménagement du territoire. Comment rester dans l'équilibre, éviter le grignotage urbain ? Pour lancer la vigne communale, nous avons dû abattre des arbres, qui avaient eux-mêmes un impact et une fonction dans le paysage. On ne peut s'arrêter au nombre d'arbres, la réflexion doit être globale.
Quand j'ai créé le Parc naturel, nous nous sommes demandé, avec l'industrie grassoise du parfum, comment retrouver des emplois : il nous a fallu dix ans...
Il faut donc dépasser le périmètre de la commune, nous devons avoir une vision plus vaste du territoire. Comment changer d'échelle dans un département qui, à l'instar des Alpes-Maritimes, compte plus d'1,5 million d'habitants ? Avec quelle production locale ? Comment privilégier les circuits courts, plutôt qu'une labellisation bio qui peut ne pas suffire sur le territoire et conduire à importer plus d'aliments, avec donc plus de transports, de pollution ?

Je crois centrale la question de la relocalisation de l'alimentation, et donc celle de la sûreté alimentaire. Tout ce qu'on pourra relocaliser sera autant de gagné pour la rémunération des agriculteurs, mais aussi pour la réconciliation avec le monde agricole. Je suis convaincu que la grande majorité de nos concitoyens aiment les agriculteurs. J'attends qu'autour de la table on en discute, au nom du bien commun et des générations futures. Il faut également prendre en compte les travaux sur la résilience alimentaire et la sécurité civile : si les circuits sont coupés, notre pays ne peut se nourrir au-delà de quelques jours : il faut en être conscient.
Merci et bravo pour le choix des intervenants ; des territoires agissent déjà, on a besoin d'audace politique.
Enfin, si les projets alimentaires territoriaux sont facultatifs dans la loi d'avenir agricole, il nous manque un référentiel qui éviterait la dispersion. Pourquoi ne pas prendre exemple sur l'organisation territoriale avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ?

Nous pourrions organiser une table ronde plus large, avec des représentants du monde agricole ; nous sommes dans notre rôle en entendant tous les points de vue et en cherchant des solutions d'équilibre.
En matière de production locale, nous sommes tout de même attachés à la certification, comme la Haute valeur environnementale (HVE), par exemple, et nous devons donner des moyens aux agriculteurs, en bio notamment, car le local en soi n'est pas une garantie de qualité. Ensuite, l'alliance des territoires ne concerne pas seulement la production, mais offre aussi des opportunités pour des unités de transformation.
Nous avons une part de responsabilité dans l'« agribashing », parce que nous ne disposons pas d'instances locales dans lesquelles l'urbain et le rural seraient obligés de se croiser et d'échanger. Il est primordial de créer ces espaces de dialogue.
Cela dit, nous sommes disponibles pour qui le souhaite, nous collaborons déjà avec beaucoup d'opérateurs et ces nombreuses initiatives ont donné lieu à des publications.
Enfin, je souhaitais vous soumettre une difficulté juridique : nous peinons à accompagner des projets agricoles par des financements, car notre métropole ne dispose pas de la compétence agricole. Nous avons des leviers au titre du développement économique, mais rien qui touche spécifiquement au secteur agricole.

L'association France urbaine, en lien avec le Parlement et l'exécutif, peut réfléchir à cette dimension, mais gardez à l'esprit que ce qui n'est pas interdit est possible.
Comment organisez-vous votre relation avec les territoires qui se situent en dehors de la métropole sur ces sujets ?
Nous avons rencontré treize communautés de communes, que nous avons fédérées dans une alliance territoriale, avec lesquelles nous avons passé des contrats écologiques en fixant ensemble des objectifs. Nous contractualisons donc avec les territoires. L'alimentation est une porte d'entrée, qui nous permet ensuite d'aborder la question des déchets, de l'eau et d'envisager des partenariats. La mise en place d'un PAT, qui coûte très cher, nous permet donc ensuite de les accompagner par l'exemple, car l'alimentation fait consensus au-delà des clivages politiques.
Je vous enverrai la référence de l'observatoire de « Un Plus Bio » : on apprend beaucoup de choses intéressantes d'un échantillon de 600 000 repas par jour ! Le déclencheur de ces projets, c'est à 65 % la volonté politique.
Il faut également réfléchir à l'aménagement : aujourd'hui, toute la ceinture alimentaire est devenue ceinture économique, avec des commerces et des bureaux, alors que l'on envisage de créer une agriculture urbaine sur les toits, des fermes verticales en ville, etc. C'est marcher à l'envers : il faut sauver les terres agricoles en périphérie.
La meilleure entrée, c'est la souveraineté alimentaire, une expression chère à « Un Plus Bio » : chaque territoire doit décider de ce qu'il accepte de manger, de la provenance et de la qualité de la nourriture, et ce, pour chaque aliment. Je ne suis pas d'accord pour considérer, comme cela a été dit, que le local était préférable au bio. Il faut les deux ; à défaut, cela signifierait que l'on fait passer les pesticides sur nos territoires. On a vu le changement qu'a entraîné, il y a quelques années, le passage du bio au local « raisonné » : attention à la qualité ! Ce point est intimement lié au PAT, car construire la souveraineté alimentaire, c'est mettre en ordre de marche les acteurs locaux de l'alimentation.