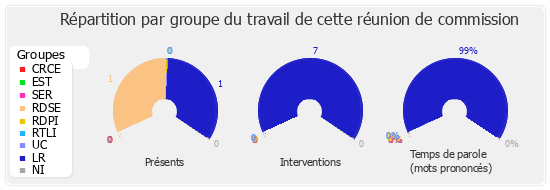Mission commune d'information impact emploi des exonérations de cotisations sociales
Réunion du 7 mai 2014 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion

Au cours de nos premières séries d'auditions, nous avons cherché à comprendre les mécanismes économiques qui sous-tendent les politiques d'allègements de cotisations, à situer cette politique parmi les politiques de l'emploi, à tenter quelques comparaisons internationales. Nous avons recueilli le point de vue du ministre et des partenaires sociaux et entendu des économistes ayant procédé à des évaluations. Nous entamons un nouveau cycle consacré à la mutation récente qui affecte cette politique, avec la prise en compte nouvelle de la compétitivité de nos entreprises.
Dans un document de janvier 2012, la direction générale du Trésor a procédé à une évaluation de la politique d'allègements de cotisations, en collaboration avec la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), et a conclu que cette politique « a fait la preuve de son efficacité » et qu'elle constitue « l'un des instruments les moins coûteux à moyen terme en termes de création d'emplois ». Si ce constat semble largement partagé, d'aucuns considèrent que ce dispositif a renforcé la spécialisation de notre économie sur des secteurs intenses en emplois peu qualifiés et affaibli son positionnement dans la concurrence internationale.
Une des questions centrales de nos travaux est celle du ciblage des allègements : quels secteurs en sont les principaux bénéficiaires ? Je remercie M. Michel Houdebine de contribuer à nos travaux en nous apportant son expertise.
Les travaux menés avec la Dares ont été publiés dans le n° 97 de Trésor Eco et, dans une version plus complète, dans la revue de la Dares. Les dispositifs actuels d'exonérations de cotisations sociales sont le résultat de trois vagues successives d'allègements. Entre 1993 et 1997, suite à un rapport du Commissariat général au plan qui signalait une hausse rapide du taux de chômage des travailleurs peu qualifiés, le Gouvernement a souhaité réduire le coût du travail des salariés dont la rémunération était égale au Smic ou légèrement supérieure, car la population active comportait beaucoup de travailleurs peu qualifiés. Le coût du travail était une barrière à la création d'emplois ; pour ne pas toucher au pouvoir d'achat, il a fallu réduire les coûts associés à la rémunération.
La deuxième vague a accompagné la politique de réduction du temps de travail. Afin que celle-ci ne se traduise pas par une baisse de la rémunération mensuelle, et si l'on ne voulait pas non plus que le coût de l'heure travaillée augmente, il fallait soit accroître la productivité, soit instaurer une modération salariale durable, soit diminuer les cotisations. C'est une combinaison des trois qui a été choisie. A la fin de la mise en place des 35 heures, différentes garanties de rémunération mensuelle coexistaient : le gouvernement de M. Fillon a décidé d'aligner l'ensemble des garanties sur la plus généreuse, et de compenser la hausse du coût du travail qui en résultait par une troisième vague d'allègements généraux, de 18,2 à 26 points de cotisation.
Au cours des vingt dernières années, le niveau des allègements de cotisations s'est donc progressivement accru, les objectifs qui leur ont été assignés se sont multipliés et transformés. Un dernier renforcement du système d'exonération, en faveur des entreprises de moins de vingt salariés, est intervenu début 2008, faisant culminer son coût brut annuel, qui a depuis légèrement décru pour s'établir autour de 20 milliards d'euros par an. Les déterminants du coût brut des exonérations sont le barème des allègements, bien sûr, et la dynamique de la population rémunérée au Smic - qui a atteint un maximum entre 2007 et 2008, pour ensuite progresser de façon beaucoup plus modérée. En France, le salaire net perçu par les salariés touchant le Smic est relativement élevé par rapport à d'autres économies avancées : il est un peu supérieur à 65 % du salaire médian.
Il n'y a pas de salaire minimal. Dans certaines branches, les travailleurs les moins bien payés gagnent sans doute autant qu'en France, mais dans d'autres, comme la filière porcine, ils reçoivent beaucoup moins : le salaire horaire peut descendre à 4 euros, contre plus de 9 euros pour le Smic.
Si l'on examine le salaire net après impôt au niveau du Smic rapporté au salaire médian, le salaire minimum est plutôt élevé. Mais la France étant atypique par l'ampleur des politiques mises en oeuvre, le coût du travail au niveau du Smic se situe dans la moyenne haute des économies de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). On observe une forte progressivité des cotisations entre salaire minimum et salaire médian, autrement dit une forte progressivité du « coin fiscalo-social ».
Comme le coût du travail au niveau du Smic reste relativement élevé par rapport à nos voisins européens, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, le Gouvernement a complété le dispositif d'allègements par le crédit d'impôt compétitivité emploi (Cice), par le pacte de responsabilité, pour traiter, outre la question des rémunérations, celle de la compétitivité. Les entreprises pourront donc déduire de leur impôt sur les sociétés 6 % du coût que représentent les salariés dont la rémunération est inférieure à 2,5 Smic, ce qui coûtera environ 20 milliards d'euros par an. Le pacte de responsabilité élargit le nombre de cotisations faisant l'objet d'exonérations : les cotisations recouvrées par l'Urssaf - sauf la cotisation à l'assurance-chômage (4 points) - seront concernées. Il restera toutefois des charges sociales au niveau du Smic : les cotisations patronales à l'Agirc et à l'Arrco. Enfin, une exonération de 1,8 % est prévue pour les salaires inférieurs à 3,5 Smic, pour un coût global de 9 milliards d'euros.
Oui. A long terme, les cotisations patronales et salariées pourront être traitées pareillement, mais à court terme il en va différemment.
Ainsi, le coût du travail est diminué de 35 % au niveau du Smic. La progressivité du barème n'est pas atypique : seule l'est peut-être sa pente, qui répond au niveau élevé de notre salaire minimal. Le niveau des cotisations patronales au niveau du Smic a continuellement décru depuis 1994...
Le Cice fait baisser de six points le coût du travail rémunéré au Smic.

En somme, le coût pour la collectivité est le même : mais il est transféré du producteur au consommateur, et au contribuable...

Le Cice est un crédit d'impôt : les entreprises doivent tout de même débourser les sommes, qui leur seront ultérieurement remboursées.
L'effet escompté n'est guère décalé dans le temps, il reste proche.
Pour avoir un effet sur les bas salaires avec le niveau actuel des cotisations, il aurait fallu réduire les cotisations résiduelles qui sont les cotisations patronales à l'assurance-chômage. C'est pourquoi le Gouvernement a préféré procéder par crédit d'impôt.
Les allègements de cotisations ont plus d'effet sur l'emploi au niveau du Smic que pour des salaires plus élevés. La demande d'emploi des entreprises est moindre aux niveaux de salaire plus élevés ; l'offre de travail, elle, augmente avec la rémunération. L'équilibre se situe là où les deux courbes se croisent. Pour le travail peu qualifié, les courbes se croisent à un niveau inférieur au Smic (comme l'a confirmé une étude menée par le Conseil d'analyse économique, prenant appui sur le cas de l'Allemagne, où le salaire minimum administré n'existe pas), mais l'équilibre s'établit bien sûr au niveau du salaire minimum. En baissant par les exonérations le coût du travail, on augmente, pour un niveau donné de salaire, la demande. On déplace l'équilibre vers le haut. Pour les personnes plus qualifiées, l'équilibre se déplace aussi mais de façon moindre.

Les schémas auxquels vous faites référence sont complexes. Surtout, ces conclusions sont-elles vérifiées par les évaluations ?
Les économistes parlent d'élasticité pour désigner l'augmentation de l'emploi induite par une baisse donnée du coût du travail. Il existe des travaux mesurant cette élasticité au niveau du Smic - où elle est proche de 1 - ou pour l'ensemble de la population active - environ 0,5 - mais nous ne disposons pas de données pour tous les niveaux de salaire. Il est toutefois possible de construire une courbe hypothétique : l'élasticité doit forcément être inférieure à 0,5 sur certains segments, et il y a consensus sur l'idée qu'elle décroît régulièrement quand le salaire augmente. C'est ce profil d'élasticité, qui fait consensus, que le Haut Conseil du financement de la protection sociale a utilisé pour évaluer les mesures du pacte de responsabilité.
Quel est le coût pour la puissance publique de chaque emploi ainsi sauvegardé ou créé ? Les études sur ce point, centrées sur les mesures prises dans les années 1990, convergent vers un coût brut annuel moyen compris entre 20 000 et 40 000 euros.

C'est une dépense qu'il faut donc renouveler chaque année pour maintenir l'emploi...
Il est difficile d'évaluer le dispositif mis en place par le gouvernement Fillon.

Nous nous fondons donc sur l'évaluation de dispositifs vieux de vingt ans...
Mais qui sont encore en vigueur. Bien sûr, les coûts évoqués sont bruts : ils ne tiennent pas compte des recettes créées par les emplois supplémentaires.

Certains disent que le coût net est inférieur de moitié. Nous avons entendu ce chiffre dès les premières auditions, mais je comprends que le Trésor ne s'engage pas sur une telle estimation...
Il est très difficile de le mesurer, car tout dépend de la situation de chaque personne : si un travailleur au RSA passe au Smic, le gain pour les finances publiques est de 12 000 euros, soit, en effet, la moitié du coût.

Il est vrai que les parcours sont chaotiques, la précarité augmentant...
Les situations individuelles sont trop différentes pour que l'on puisse procéder à une évaluation unique.
Combien d'emplois les exonérations créent-elles ? Les évaluations divergent, selon que l'on retient une hypothèse de rendement équivalent à ceux observés dans les années 1990, ou d'efficacité décroissante. Cependant, nous disposons de l'évaluation Cahuc-Carcillo sur le dispositif zéro charge créé pour les très petites entreprises (TPE)...
On peut tout de même en tirer ce message : il ne faut pas croire à l'épuisement de l'efficacité de la mesure. Les deux économistes sont parvenus à une estimation d'élasticité de 2 autour du Smic. Le dispositif zéro charge semble avoir eu un effet puissant. Il était certes temporaire...
Je ne pense pas. C'est le maintien du dispositif qui préserve l'emploi.
La part du travail peu qualifié dans l'emploi a été stabilisée. La qualification moyenne des travailleurs a progressé en France, mais faiblement, en raison de l'effet de stock : il faut du temps pour que les travailleurs non qualifiés sortent du marché du travail.
Quelle est l'effet des exonérations sur la qualification des travailleurs et les salaires ? En principe, l'effet sur les salaires, nul par définition au niveau du Smic, apparaît au-delà. Comme le niveau de cotisation augmente avec le salaire, le coût du travail augmente plus vite que le salaire perçu. C'est une incitation à maintenir les salaires à un bas niveau. Pour le salarié, c'est un frein à la formation, puisque ses nouvelles compétences seront mal reconnues. En somme, le risque est de créer une trappe à bas salaires. S'est-il réalisé ? Les études empiriques ne sont guère concluantes.
Notre impression est que le risque s'est peut-être partiellement réalisé, mais dans des proportions modestes. Cela doit nous inciter à ne pas accroître trop fortement la pente du dispositif d'allègements - le Gouvernement s'en est d'ailleurs bien gardé.
Dans les pays n'ayant pas instauré d'allègements sur le travail peu qualifié, où les salaires des travailleurs peu qualifiés sont faibles et le taux d'emploi, élevé - comme par exemple l'Allemagne ou les Etats-Unis - cette situation ne constitue pas un obstacle à la montée en gamme technologique. Les mesures en faveur des bas salaires ne doivent pas être vues comme des mesures favorisant la croissance de long terme.

En Allemagne, le poids du travail qualifié, par rapport au travail peu qualifié, est plus important que chez nous. C'est ce qui explique que de faibles salaires n'y entravent pas la montée en gamme.
C'est vrai que la qualification des travailleurs est plus élevée en Allemagne qu'en France, comme le montre le niveau de rémunération. Cela découle de la meilleure qualité du système d'éducation et de formation professionnelle. Quoi qu'on en dise, les études de l'OCDE, et notamment les rapports Pisa, révèlent chez nous de réelles faiblesses à cet égard.
Quels sont les secteurs auxquels les allègements profitent le plus ? L'industrie, qui ne représente plus que 13 % de la valeur ajoutée en France, bénéficie d'environ 14 % des allègements généraux et 20 % du montant du Cice. Quel que soit le dispositif, il est difficile de cibler les allègements sur l'industrie, car la structure de l'emploi est à peu près semblable dans les autres secteurs, à part la grande distribution, qui concentre des emplois peu qualifiés, ou la finance, qui rassemble les hautes rémunérations. Cela dit, l'effet pour l'industrie passe aussi par les consommations intermédiaires de services.
Dans l'industrie, le coût du travail et le coût des consommations intermédiaires sont équivalents. Infléchir les prix de celles-ci est donc aussi efficace que d'agir sur le coût du travail, même si l'impact n'est pas immédiat et mécanique.

La compétitivité est aussi liée au coût du capital. Le manque d'investissement par les entreprises françaises est-il imputable à l'exigence de rémunération des actionnaires ? La part des dividendes dans la valeur ajoutée semble avoir récemment augmenté... Quant au ciblage des exonérations, pourquoi l'élasticité est-elle plus faible pour les rémunérations élevées ? Comment quantifier l'impact des exonérations de charges centrées sur les secteurs à bas salaires sur la compétitivité ?

Avez-vous croisé vos résultats avec les données sur l'investissement productif par salarié ? Les coûts d'investissement par emploi créé sont de plus en plus lourds, ce qui relativise le facteur salarial. On voit bien en Allemagne ou aux Etats-Unis que les bas salaires n'empêchent pas la hausse de la productivité, si l'investissement par salarié se développe. Salaire, charges et investissement productif sont les trois leviers d'action. J'ai été ministre de l'industrie dans le gouvernement de M. Balladur. Nous souhaitions alors enrichir la croissance en emplois, en multipliant les embauches dans ce que nous appelions les petits métiers. Or on observe aujourd'hui un déficit d'investissement productif par emploi. Les allègements de charges ont un effet à court terme mais la productivité dépend de la qualité de l'outil de travail et du niveau de formation. Avec Maastricht, nous nous sommes engagés à ne plus dévaluer pour réajuster nos coûts relatifs de production ; d'où la tentation de basculer les charges des producteurs sur les consommateurs - mais ceux-ci étant des salariés, ils finissent par demander des hausses de salaires ! Autre option : accroître la part de capital investi par salarié. Quant à la répartition par secteur, n'oublions pas qu'il est parfois difficile de faire le départ entre service et industrie. La distinction entre business to business (« B to B ») et business to consumer (« B to C ») me semble plus pertinente.

Ramener vers l'emploi des personnes peu qualifiées et accroître notre compétitivité internationale, sont-ce deux objectifs convergents, contradictoires ou indépendants ?

En 1992, président de la région Lorraine, je m'étonnais du montant important des investissements allemands sur notre territoire. C'est que le coût du travail en Moselle était alors inférieur de 20 % à celui que connaissait l'Allemagne ! Aujourd'hui, il lui est supérieur de 3 % à 4 % dans l'industrie. La politique d'exonération de charges ne doit pas se substituer à l'encouragement à la formation brute de capital fixe, ni nous dispenser de veiller à notre compétitivité.

Nous poursuivons, avec un même outil, deux objectifs : lutter contre le chômage des travailleurs non qualifiés et améliorer la compétitivité de nos entreprises. Mais nous avançons sans visibilité ; les évaluations sont incertaines.
C'est vrai, les statistiques montrent un accroissement des dividendes, mesurés en part du PIB. L'Insee a étudié cette tendance ; nous nous y sommes nous aussi intéressés. Un premier facteur explicatif est la séparation des entreprises en plusieurs entités, qui provoque des doubles comptages en comptabilité nationale, alors même que la somme versée aux actionnaires ne change pas. Deuxième explication : les entreprises françaises ont renforcé leurs fonds propres au cours de la dernière décennie, ce qui a accru le volume des dividendes versés. Si l'on tient compte de ces deux éléments, il n'est pas sûr que la hausse de la part des dividendes qui apparaît dans les statistiques corresponde à une augmentation du volume de rémunération des actionnaires.
Non. L'Insee non plus, je crois.

Sur quoi se fondent, alors, les économistes qui ont affirmé que la part des dividendes avait augmenté ?
C'est ce que les statistiques paraissent exprimer, tout simplement.
Par sécurité, ou faute d'opportunités d'investissements.

Et parce que les banques ne prêtent pas, même si les taux affichés sont très bas...
Les entreprises françaises sont à présent bien capitalisées, contrairement à ce qu'on entend parfois dire.

Quelle part des dividendes de nos entreprises part à l'étranger ? La moitié des actionnaires du CAC 40 sont des fonds de pension anglo-saxons, dont le but est de pressurer autant que possible les entreprises !
Les entreprises paient moins cher leur dette que leurs fonds propres, ce qui est logique puisque les créanciers sont les premiers servis en cas de faillite et les actionnaires, les derniers.

Il y a aussi des logiques démographiques : la retraite par capitalisation des pays anglo-saxons se heurte aux mêmes difficultés - accroissement de l'espérance de vie et donc de la durée passée à la retraite - que notre propre système. Résultat : une obligation de rentabilité accrue pour les fonds de pension.
Ajoutons que la crise les a malmenés...
Que font les entreprises des exonérations de charges ? Selon l'enquête Insee, elles les consacrent d'abord à l'investissement, puis à l'emploi, aux salaires et enfin à une baisse des prix. Des baisses de charges sur des emplois relativement qualifiés se traduisent, à long terme, par des hausses de salaires et, dans une bien moindre mesure, à des créations d'emplois. La transition peut être longue avant que la compétitivité et les marges s'accroissent. Le Gouvernement voulait des mesures qui ciblent les hauts salaires mais avec un effet économique à court terme.
Je partage votre sentiment sur le fait que l'industrie et les services sont de plus en plus difficiles à différencier. Que penser d'Apple, par exemple ? Les Etats-Unis le considèrent comme une industrie. En France, cette entreprise serait classée parmi les services.
Le secteur des services contribue de plus en plus aux échanges internationaux. Je ne crois pas que la politique de l'emploi soit incompatible avec la lutte pour la compétitivité. L'objectif du Cice est de faire baisser de 1 % le taux de chômage. Les baisses de charges destinées à ramener vers l'emploi les travailleurs peu qualifiés ne suffisent pas à développer la compétitivité : il faut aussi investir et accroître la qualification des travailleurs.
Les entreprises françaises, contrairement à ce qui est souvent dit, n'ont pas décroché en termes d'investissement. Elles ont fait davantage d'efforts que leurs homologues européennes pour continuer à investir pendant la crise. Certes, leurs marges se sont sensiblement réduites depuis une dizaine d'années, surtout dans l'industrie, où la modération salariale allemande s'est fait ressentir. Certains investissements ne sont pas productifs - notamment ceux dans l'immobilier - mais elles ont tout fait pour rester dans la course. Combien de temps le pourront-elles avec des marges réduites ? Pour l'heure, elles s'endettent.

Merci pour cet exposé.
La réunion est levée à 11 h 10.
La réunion est ouverte à 15 h 45.