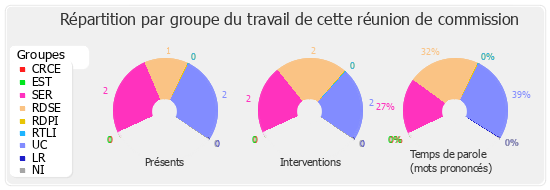Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 22 janvier 2015 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La délégation auditionne tout d'abord Mme le Pr. Karine Clément, directrice de l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition (ICAN) sur le thème « Maladies cardio-métaboliques - Trajectoire entre biologie, comportement et environnement - Santé de la femme, y a-t-il des spécificités ? ».

Nous poursuivons ce matin nos auditions sur le projet de loi relatif à la santé, pour lequel la commission des Affaires sociales a saisi notre délégation, en accueillant le Professeur Karine Clément, spécialiste des maladies cardio-métaboliques.
J'informe Mme Karine Clément que nos rapporteures sur ce texte sont Françoise Laborde et Annick Billon, qui ne manqueront pas de vous poser des questions à l'issue de votre intervention.
Ce projet de loi nous offre l'occasion de travailler de manière générale sur la santé des femmes, sans nous en tenir nécessairement aux articles du texte qui concernent a priori spécifiquement les femmes.
Madame la professeure, c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Après votre intervention, mes collègues vous poseront quelques questions.
Je voudrais pour ma part vous solliciter sur le point suivant : lorsque l'Institut hospitalo-universitaire sur le cardio-métabolisme et la nutrition a été créé à votre initiative en 2010, vous étiez la seule femme à avoir présenté un projet parmi les dix-neuf candidats. Un professeur de médecine dont les propos ont été rapportés par la presse s'est estimé « frappé par le machisme et la jalousie du milieu hospitalo-universitaire parisien ». Souhaitez-vous vous exprimer sur ce sujet ? Votre carrière a-t-elle jusqu'à présent été un parcours d'obstacles plus compliqué, à votre avis, que si vous étiez un homme ?
Pr. Karine Clément, directrice de l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition (ICAN). - Professeure de nutrition, j'associe depuis longtemps une activité de recherche à la pratique clinique, un parcours peut-être plus difficile pour une femme que pour un homme. Je dirige l'Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN) et, au sein de celui-ci, l'équipe Inserm-Pierre et Marie Curie, qui travaille sur les maladies métaboliques, l'obésité et le diabète. J'ai préparé cette intervention avec ma collègue Geneviève Derumeaux, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor.
La création de l'ICAN, en 2011, a regroupé des équipes de recherche qui travaillaient jusque-là de manière isolée sur des sujets comme l'obésité, les maladies métaboliques et cardiaques ou le diabète, tout en y associant le pôle clinique, sous la direction d'Agnès Hartemann, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Nous menons des projets associant recherche et soins, avec un volet consacré à l'enseignement. L'originalité de notre institut repose sur ce décloisonnement des compétences - je réalise depuis trois ans à quel point j'avais sous-estimé les frontières entre disciplines. Les pathologies (obésité, diabète et maladies cardiaques) ont un lien entre elles, et les critères environnementaux (mode de vie ou vulnérabilité sociale) influent sur la biologie. D'où la nécessité d'une vision globale et d'une approche intégrée : ceci constitue une démarche innovante.
Les maladies cardiométaboliques évoluent dans le temps, le vieillissement de la population entraînant leur chronicisation. De même, l'obésité se développe sur un terrain à risque, et peut devenir un handicap au fil des ans, avec des différences de trajectoires selon les patients. Certains, diabétiques, mourant d'infarctus avant cinquante ans, d'autres n'ayant aucun problème cardiovasculaire. La sensibilité aux changements environnementaux et le stress font partie des facteurs expliquant ces variations. Des facteurs internes entrent également en jeu, comme la génétique, la nutrition maternelle, l'épigénétique, les hormones ou la longévité. Enfin, des études sont en cours sur des causes plus spécifiques, comme l'influence des changements environnementaux sur les modifications de la flore intestinale.
Vous voulez parler des comportements alimentaires ?
Pr. Karine Clément. - Pas seulement. Certains types de polluants peuvent avoir des effets sur les hormones. Le sommeil, l'activité physique et le niveau de sédentarité sont aussi à prendre en compte pour adapter les traitements. Par exemple, les données scientifiques ont montré que la réduction des apports alimentaires et la pratique d'une activité physique adaptée protégeaient du diabète et des maladies cardiovasculaires. L'obésité étant une maladie chronique qui évolue tout au long de la vie, la réponse oscille entre contrainte et astreinte. À côté des médecins, les coachs sportifs et les diététiciens ont un rôle à jouer : il est nécessaire de mobiliser une grande diversité d'expertises.
Depuis quinze à vingt ans, partout dans le monde, les sociétés savantes constatent régulièrement des différences de réponse entre hommes et femmes, en ce qui concerne le traitement des maladies cardiométaboliques. Malgré de récents progrès, les essais thérapeutiques se concentrent sur les hommes, et la Société européenne de cardiologie mentionne une moindre prise en charge des femmes. Cela tient essentiellement à l'idée préconçue que les femmes seraient protégées contre les maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, même des femmes ayant fait un infarctus du myocarde continuent à craindre davantage le cancer du sein qu'une maladie cardiaque...
Une recommandation européenne préconise de faire attention au coeur des femmes. En juin 2010, un article de la revue « Nature » intitulé « Putting gender on the agenda » constatait que l'approche genrée était insuffisante dans beaucoup de pathologies, qu'il s'agisse de la recherche où il est plus facile de tester des souris mâles que des souris femelles soumises au cycle hormonal, que de la prise en charge clinique. La prise en compte du sexe fait partie des items dans Horizon 2020. Travailler sur les différents modèles augmente certes les coûts, mais évite que l'expérience clinique perde de vue cette nécessité. En effet, on parle de « evidence-based medecine » mais, à bien des égards, on peut y voir une « male evidence-based medecine ».
Avant la ménopause, la production d'oestrogènes contribue à diminuer le risque de pathologie cardiaque pour les femmes. Mais le tabagisme annule une grande partie de leurs effets bénéfiques. Après la ménopause, la déficience en oestrogènes multiplie par sept le risque d'accident vasculaire. Il faut le souligner, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité chez les femmes ; la cardiopathie ischémique les touche dans une proportion de 1 sur 2,6 contre 1 sur 6 pour le cancer. La Fédération française de cardiologie dénombre 89 000 femmes victimes de maladies cardiovasculaires contre 76 000 hommes.
Lors des Jeux olympiques de Vancouver, le décès de la mère de la patineuse Joannie Rochette, victime d'une maladie cardiovasculaire à 55 ans alors qu'elle n'avait pas d'antécédent familial, a été la première étape d'une prise de conscience : les femmes meurent tout autant que les hommes de maladies coronariennes ou d'insuffisance cardiaque avec hypertension.
Les femmes sont plus vulnérables aux facteurs de risque de ces maladies que sont la surcharge pondérale, le diabète, l'hypertension, le tabac... Et pourtant, on tarde beaucoup plus à prendre en compte les symptômes annonciateurs quand il s'agit d'une femme. Lorsqu'un homme se plaint d'une douleur précordiale, sa femme appelle le SAMU ; quand c'est une femme, le mari lui conseille de prendre un doliprane ! Voilà qui signale un véritable enjeu d'éducation. Même les signes biologiques sur un électrocardiogramme sont moins typiques chez la femme.
Enfin, les complications post-opératoires sont plus fréquentes chez les femmes, avec la possibilité de saignements importants ou le développement d'effets secondaires et de complications chroniques, comme l'insuffisance cardiaque.
Par ailleurs, l'obésité, autre facteur de risque, a progressé de manière impressionnante, à l'échelle mondiale, plus particulièrement chez les femmes. Au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, plus de 45 % des femmes en souffrent contre 30 % des hommes ; elle touche 15 % de la population en France. Le risque tient à l'augmentation du tissu graisseux, mais aussi à la distribution des graisses. La morphologie féminine a évolué, avec une prise de graisse au niveau abdominal, sous la peau et dans le ventre. Or la graisse viscérale favorise le diabète. Mon équipe travaille plus particulièrement sur le « tour de taille à risque ».
Contrairement à ce qu'on croit, les femmes sont tout autant victimes d'hypertension que les hommes, et cela quel que soit leur âge. Lorsqu'elles ont du cholestérol ou qu'elles souffrent de dyslipidémie, elles sont souvent moins bien dépistées et bénéficient moins souvent des traitements existants.
Jusqu'à cinquante ans, le risque d'infarctus du myocarde est le même pour tous les diabétiques. Cela signifie que nous sommes extrêmement vulnérables aux facteurs de risque cardiométaboliques. Or, si l'on sait que des changements de mode d'activités physiques ou de mode d'alimentation constituent des facteurs importants d'amélioration, la littérature souffre d'une sous-représentation féminine dans les études : sur 300 articles recensés dans un travail de 2015, trois seulement mentionnent une analyse différenciée selon le sexe.
L'information aux femmes enceintes ne prend pas assez en compte le risque de diabète et d'hypertension artérielle, dont les effets peuvent être immédiats pour la mère et l'enfant, ou postérieurs à la grossesse. La prévention du risque cardiovasculaire est vraiment très importante mais reste peu prise en compte dans les recommandations. Enfin, il faudrait renforcer la prévention du tabagisme, car beaucoup de femmes continuent à croire que fumer évite de grossir, comme l'affirmaient certaines affiches publicitaires représentant des femmes enceintes en train de fumer pour éviter de prendre trop de poids pendant une grossesse.
Après la ménopause, la production hormonale se modifie et les femmes redistribuent les graisses au niveau de l'abdomen. Le développement du tissu graisseux viscéral, qui perturbe les interactions entre les organes (foie, muscles et cerveau) et la flore intestinale, rend la perte de poids encore plus difficile. Quand l'on grossit, les cellules inflammatoires qui entourent les cellules graisseuses s'infiltrent dans le tissu viscéral, provoquant des altérations au niveau biologique. De plus, la déficience en oestrogènes après la ménopause réduit l'activité du tissu dit brun ou beige, celui qui brûle les graisses.
On ne peut pas traiter séparément les maladies du coeur et celles du métabolisme. Les maladies cardiovasculaires sont le produit d'un système, où interviennent des éléments aussi différents que la pression sociale, la psychologie, l'exposition au stress, l'activité physique etc. Sa complexité évolue dans le temps. C'est pourquoi il est nécessaire de développer une médecine de précision, de plus en plus personnalisée, qui tienne compte de l'originalité du parcours de chacun. Une différenciation entre hommes et femmes y aurait toute sa place et contribuerait à battre en brèche les idées reçues.
Le système hospitalo-universitaire est-il aussi machiste qu'on le dit ?
Pr. Karine Clément. - Il y a eu des changements à l'ICAN : la directrice de l'Institut est une femme - moi - et il y a une directrice du pôle des maladies cardiométaboliques. Malgré cela, je ne suis pas sûre que pour se faire entendre dans le monde hospitalo-universitaire, être une jeune femme avec pour spécialité l'étude du métabolisme soit la situation la plus favorable !

Beaucoup de jeunes filles souffrent de boulimie ou d'anorexie. Quelles seront les répercussions à long terme de ces dysfonctionnements sur leur métabolisme ? Les hommes sont parfois touchés, également. Si l'on considère que l'alimentation joue un rôle important dans l'évolution des morphologies, que penser de la viande que l'on vend dans les supermarchés, dont on sait qu'elle est pleine d'hormones ? Sa consommation peut-elle influer sur la puberté plus ou moins précoce des jeunes filles ? Dans mon territoire, situé en bord de mer, il semble qu'il y ait moins de cas d'obésité, car l'environnement favorise une activité physique régulière. Disposons-nous d'études scientifiques pour appuyer cette théorie ? En France, les rythmes scolaires sont lourds, notamment si on les compare à ceux de l'Australie, où l'école finit à 15 heures. Nos jeunes ont moins d'activité physique qu'ailleurs, et la charge de travail liée aux études secondaires empêche certains d'avoir la moindre activité sportive.
Pr. Karine Clément. - Les jeunes filles sont très tôt soumises au diktat médiatique de la minceur. Une étude britannique a montré, il y a quelques années, que des fillettes de huit ans avaient de leur silhouette une perception faussée par rapport à celle des garçons : elles se voient toujours plus fortes qu'elles ne sont en réalité. Il y a aujourd'hui beaucoup de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes filles (anorexie ou boulimie). Chez les hommes, les troubles alimentaires vont souvent de pair avec des maladies psychiques plus sévères que chez les femmes. Dans tous les cas, ils perturbent les signaux biologiques et le dialogue entre les organes. Des études anglaises ont montré que le surpoids augmentait le risque des maladies cardiovasculaires chez les garçons. Des perturbations des signaux biologiques peuvent avoir des conséquences sur le long terme. L'expérience clinique nous enseigne que de grandes variations pondérales répétées induisent une altération des signaux biologiques et des organes qui diminue la réponse à une perte de poids.
Les hormones et les polluants, notamment les dérivés des dioxines, qui se stockent dans les tissus graisseux, ont certainement des effets de nature biologique, mais beaucoup demeurent encore inconnus. Des études sont en cours sur l'interaction de l'environnement et de l'alimentation avec l'organisme. Elles restent compliquées à mener du fait de la multiplicité des polluants à traiter. Au fond, votre question illustre l'interaction de l'environnement avec notre biologie. Il existe des données très intéressantes sur les rythmes biologiques, l'obésité et le surpoids ainsi que sur l'influence de la réduction du temps de sommeil sur les rythmes biologiques. Les développements actuels de la recherche autour du traitement de ce que l'on désigne par le terme générique « Big data » devraient enrichir ce type d'études et montrer l'interaction entre notre biologie et l'environnement. Dans les villes, la pratique d'activités physiques n'est pas toujours chose aisée.

Le stress, l'anxiété et la dépression sont des pathologies souvent féminines. Les médecins prennent-ils en compte le fait qu'une dépression peut amener d'autres risques ? Je ne suis pas sûre qu'ils nous alertent là-dessus, notamment sur les risques cardiovasculaires. Quant aux médicaments, ils produisent des effets différents sur les hommes et sur les femmes.
Pr. Karine Clément. - Une fois le diagnostic établi, la prise en charge thérapeutique est la même chez les hommes et chez les femmes. On traite les facteurs de risque plus tard, dans un deuxième temps. Personne ne réagit de la même façon au traitement. Cela dépend sans doute des hormones ou des bactéries intestinales qui métaboliseraient de manière différente certains médicaments. Les acteurs de l'industrie pharmaceutique commencent à étudier la question. La génétique n'est pas seule en cause. Certains antidépresseurs favorisent la prise de poids, parfois jusqu'à 25 kilos chez les femmes. On touche là à des enjeux d'éducation médicale.

Une approche de soins sur mesure n'est-elle pas contraire aux intérêts des laboratoires qui cherchent à produire et à vendre massivement ? La mode anglo-saxonne d'alcoolisation massive expresse (« binge drinking ») nous arrive : le projet de loi relatif à la santé le prend en compte. Disposons-nous d'études sur l'impact, sur le long terme, de la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes filles ? Lorsque les graisses fondent, que deviennent les produits chimiques qui y étaient stockés ? Le corps les absorbe-t-il ? Peut-on considérer que les graisses constituent une protection pour le corps ?
Pr. Karine Clément. - Il y a une attrition des médicaments contre les maladies cardiométaboliques. L'obésité ou le diabète ne sont jamais des pathologies isolées. Les personnes sont très diverses, on ne saurait donc résoudre ces problèmes par un traitement de masse. Par ailleurs, les laboratoires pourraient se heurter à des difficultés économiques s'ils décident de personnaliser les traitements.
Les laboratoires en sont-ils capables ?
Pr. Karine Clément. - Certains développent déjà des traitements « de niche ». Quant au phénomène de l'alcoolisation massive chez les femmes, il n'est pas nouveau. Il sévissait déjà aux États-Unis il y a quelques années. Or les filles sont biologiquement plus sensibles à l'alcool que les garçons.
S'agissant des graisses, une étude a montré qu'après un amaigrissement massif, lors d'une chirurgie de l'obésité par exemple, le taux des polluants dans le sang augmentait. Ce n'est qu'une piste qui mérite d'être explorée beaucoup plus largement.

On manque de statistiques et de connaissances genrées dans le domaine de la santé plus que dans d'autres. Quid du rôle de l'éducation et de l'école dans la prévention des maladies cardiométaboliques ?
Pr. Karine Clément. - Je suis tout à fait d'accord avec vous. Depuis vingt ans, les connaissances scientifiques sur l'obésité ont considérablement évolué. On sait pourquoi l'on prend du poids ; on a identifié les facteurs environnementaux en cause. Néanmoins un fossé subsiste entre cette connaissance scientifique très précise et les messages transmis au grand public. L'école a certainement un rôle à jouer pour le combler. Nous en avons pris conscience et allons établir des messages à disséminer.

Il faudrait impliquer les adultes et transformer un système médical qui ne semble pas, au vu des modes de remboursement qu'il pratique, favorable à la diffusion de ces messages.
Pr. Karine Clément. - Un médecin généraliste qui exerce de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa formation.

Entre 2001 et 2004, la santé était l'une des compétences du département, notamment la santé publique primaire. Dans ce cadre, j'ai eu l'occasion de mettre en oeuvre deux actions : la maîtrise du syndrome d'alcoolisation brutale et la lutte contre l'obésité infantile. Nous avions travaillé avec les cuisiniers des cantines scolaires pour qu'ils contribuent à changer l'alimentation des enfants. Le système a ensuite été étendu aux écoles primaires. Cela avait été un vrai succès. Bien que la santé soit désormais une compétence de l'État, notre action perdure depuis lors. Au Canada, les enfants emportent des « lunch boxes » à l'école. Le contenu de ces boîtes est souvent effarant, car il favorise largement l'obésité. On n'apprend pas aux enfants à bien manger. Enfin, des recherches récentes menées dans mon département ont établi un lien entre intestin et cerveau dans le cas de l'autisme. Cette partie-là de notre corps est à protéger sans modération...
Pr. Karine Clément. - En matière de nutrition, le reste du monde, qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou de la Chine, porte un regard positif sur la France. Dans les familles où le niveau socio-économique est le plus élevé, l'obésité s'est stabilisée. Il n'en reste pas moins que l'obésité massive a été multipliée par trois depuis la fin des années 2000, notamment dans les catégories sociales les plus défavorisées. Les disparités régionales sont importantes, le Nord et l'Est étant les plus touchés. Des actions ciblées seraient nécessaires en matière de consommation.
Pour en revenir au lien entre flore intestinale et cerveau, on a constaté qu'en greffant la flore intestinale de souris à comportement autistique sur des souris saines, celles-ci adoptaient le comportement autistique des premières. Notre cerveau et notre intestin entretiennent un dialogue permanent.

Vous insistez sur la nécessité de genrer la recherche. C'est une perspective optimiste. Dans quelle mesure l'obésité a-t-elle un caractère héréditaire ?
Pr. Karine Clément. - Oui, les connaissances dont nous disposons sur le génome humain valident ce que les études épidémiologiques avaient établi : le patrimoine génétique joue un rôle dans le cas de l'obésité. Nous avons commencé à identifier les gènes en cause, mais surtout à mettre ceux-ci en relation avec notre environnement et les bactéries présentes dans notre système viscéral, car nous ne sommes que les marionnettes de notre génome bactérien.

Je vous remercie pour cette audition passionnante. Comme le dit le professeur Gilles Boeuf, « nous sommes une ode à la biodiversité ». Vous l'avez largement confirmé.
Présidence de Mme Chantal Jouanno, présidente, puis de Françoise Laborde, vice-présidente -
La délégation auditionne ensuite Mmes Caroline Rebhi, responsable de la commission « éducation à la sexualité », et Catherine Kapusta-Palmer, membre du Conseil national du sida, responsable du programme « femmes et VIH » du Mouvement français pour le Planning familial (MFPF), sur le thème « Approche genrée de la prise en charge et de la prévention concernant le VIH/SIDA ».

Nous accueillons maintenant, pour poursuivre nos auditions sur le thème « femmes et santé », deux représentantes du Planning familial : Mme Catherine Kapusta-Palmer, membre du Conseil national du Sida et responsable du programme « femmes et VIH », et Mme Caroline Rebhi, responsable de la commission « éducation à la sexualité » du Planning familial.
Je précise à l'attention de Mmes Kapusta-Palmer et Rebhi que la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances va rendre un avis sur le projet de loi relatif à la santé. Au sein de notre délégation, nos collègues Françoise Laborde et Annick Billon sont les rapporteures de ce texte. La délégation a saisi l'occasion de ce projet de loi pour travailler sur le thème de la santé des femmes en général, sans se limiter nécessairement aux articles portant sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et la contraception d'urgence qui nous concernent directement.
Je propose, Mesdames, de vous céder dès à présent la parole pour exposer la spécificité genrée de la prise en charge du sida et des infections sexuellement transmissibles (IST). Ensuite, nous aurons des échanges avec les membres de la délégation et les rapporteures qui, j'en suis sûre, auront de nombreuses questions à vous poser
Je vous présenterai en premier lieu quelques éléments de contexte, puis je laisserai Catherine Kapusta-Palmer développer plus spécifiquement la question de l'approche genrée « femmes et VIH ».
Je me référerai, pour ces éléments de contexte, à l'étude « Les comportements sexuels en France », menée en 2007 par Nathalie Bajos. L'auteure y révèle notamment qu'en termes d'âge, l'entrée dans la sexualité diffère peu entre les femmes et les hommes. L'écart se limite à quelques mois. En revanche, une différence significative est constatée s'agissant du nombre de partenaires déclarés : 13 partenaires environ pour les hommes et 5,1 en moyenne pour les femmes. Selon Nathalie Bajos, les femmes pourraient sous-estimer le nombre réel de leurs partenaires. Socialement, la multiplicité des partenaires est en effet moins bien vue pour les femmes que pour les hommes.
Nous entendons souvent que les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes qui, elles, s'inscriraient davantage dans la recherche d'un lien sentimental, privilégiant la dimension relationnelle. Or, cette asymétrie dans la perception entre les hommes et les femmes, entre des besoins biologiques et sexuels d'une part et l'affectivité d'autre part, induit des différences dans la prévention et dans la gestion des risques.
L'approche classiquement adoptée par les femmes reste souvent cantonnée à la problématique de la contraception. Nous soulignons pour notre part la nécessité de proposer une approche de prévention globale, incluant le VIH, les IST, la reproduction et la contraception. Nous insistons par ailleurs sur l'importance que soit reconnu aux femmes séropositives un droit à mener une vie affective. Au centre de nos préoccupations figure en outre la question de la prévention et de la prise en charge de l'infection à VIH pour les femmes de plus de 50 ans. Catherine Kapusta-Palmer développera plus particulièrement ce dernier point.
Je souhaite dire quelques mots aussi des violences à l'encontre des femmes, dont l'importance et les spécificités ont été mises en évidence dans un rapport de l'ONU publié en 2012. La question des violences s'intègre d'ailleurs pleinement dans le cadre d'une approche de prévention globale en santé sexuelle : une femme sur cinq dans le monde sera victime de viol ou de tentative de viol entre 14 et 55 ans. La prévalence des violences à l'encontre des femmes dépasse donc celles des cancers, des accidents cardiovasculaires et même du paludisme. Aujourd'hui, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Enfin, une étude révèle qu'entre 40 et 50 % des femmes résidant dans l'Union européenne seront victimes de harcèlement moral au travail.
Dans son travail sur les comportements sexuels en France, Nathalie Bajos indique que « si les femmes sont plus touchées par le VIH et les IST, ce n'est pas parce que ce sont des femmes au sens biologique du terme, mais parce que leur sexualité s'exerce dans un contexte marqué par de nombreuses inégalités ».
Un cumul de facteurs explique que les femmes soient, de manière générale, plus vulnérables que les hommes au VIH et aux IST. Aujourd'hui dans le monde, elles représentent plus de la moitié des personnes séropositives. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, les femmes sont restées invisibles. Les politiques publiques de lutte contre le VIH ont retenu pour base la notion de prévalence. Or, effectivement, la « photographie » de l'épidémie, dès ses débuts, a identifié parmi les populations à forte prévalence les hommes homosexuels, les usagers de drogues et, s'agissant des femmes, les prostituées puis les femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Cette photographie initiale a eu et a toujours des conséquences en termes de prévention, de prise en charge et donc d'évolution de l'épidémie. Encore aujourd'hui, elle se répercute sur la visibilité des femmes séropositives. Elle a eu pour effet que, depuis le début de l'épidémie, les femmes sont « passées au travers » des messages de prévention, ceux-ci ne leur étant pas réellement adressés. Je rappelle que la première campagne de prévention destinée aux femmes ne date que de 1997. Les femmes ne se sont pas senties concernées par l'infection à VIH. En conséquence, nous constatons depuis plusieurs années une augmentation des contaminations chez les femmes de plus de 50 ans qui, après un divorce ou une rupture, retrouvent une vie sexuelle diversifiée. Nous recevons de plus en plus de femmes, mères ou grands-mères, qui découvrent aujourd'hui leur séropositivité.
Ce constat, qui vaut également pour les IST, appelle une grande vigilance. En effet, le corps médical ne pense pas à évoquer la prévention et le dépistage auprès des femmes de plus de 50 ans, supposant manifestement qu'elles n'ont plus de vie sexuelle.
Nous estimons essentiel d'adopter une approche globale de la santé sexuelle qui, au féminin, est trop souvent réduite à la santé reproductive. Il convient d'aborder la réduction des risques dans leur ensemble, qu'il s'agisse de l'infection à VIH, des IST ou encore des grossesses non prévues. Cette approche doit en outre tenir compte du contexte relationnel puisque, aujourd'hui encore, les inégalités entre les hommes et les femmes engendrent des difficultés supplémentaires dans la prévention et dans la prise en charge médicale. Dans un contexte de rapports violents, le risque de contamination des femmes est multiplié. Les violences se répercutent en effet sur l'estime que les femmes ont d'elles-mêmes : les femmes victimes de violences se protègent moins et sont moins en mesure, par exemple, d'imposer l'utilisation du préservatif à leur partenaire. La question des inégalités doit donc s'inscrire au coeur de cette approche globale de prévention et de prise en charge.
Les femmes séropositives que nous rencontrons se posent de nombreuses questions sur leur santé, leur vie affective et leur vie sexuelle. Or elles ne trouvent quasiment aucune réponse. Aujourd'hui encore, pour l'infection à VIH comme pour d'autres maladies, les études et les recherches ne sont pas réalisées de manière genrée ou ne le sont que très peu. Les femmes sont encore sous-représentées dans les cohortes. Alors qu'en France, environ 35 % des personnes contaminées sont des femmes, leur représentation dans les études est en baisse et ne dépasse pas 15 % aujourd'hui. Les femmes sont exclues des études sous prétexte qu'elles risqueraient de fausser les données ou de biaiser les résultats si elles devenaient enceintes pendant les essais. Encore une fois, elles sont réduites à leur statut de mères ! Dans ce contexte, les femmes testent les effets des traitements dans la vraie vie. Or l'argument même selon lequel l'inclusion de femmes dans les essais risquerait d'en fausser les résultats souligne bien que le virus et les traitements ne produisent pas les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes.
Ces différences dans les effets s'expliquent bien évidemment par des différences physiologiques. Les traitements du VIH perturbent le système hormonal. Ils induisent des problèmes cardiovasculaires et osseux, ainsi qu'une dystrophie, c'est-à-dire une transformation du corps. Il ne s'agit pas d'affirmer que les effets secondaires seraient plus difficiles pour les femmes que pour les hommes, mais simplement de reconnaître qu'ils sont différents. Pourtant, aujourd'hui encore, les femmes séropositives rencontrent des difficultés à le faire entendre. Seules des études genrées permettraient d'apporter des réponses aux questions des femmes sur les conséquences des traitements, qu'il s'agisse des aspects cardiovasculaires, de la transformation du corps ou encore des fluctuations hormonales, notamment au moment de la ménopause. L'absence de données scientifiques, mais également d'études en sciences sociales sur le vécu et l'isolement des femmes séropositives nous semble extrêmement problématique.
L'enquête VESPA (VIH-Enquête Sur les Personnes Atteintes) de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) a notamment souligné la situation de précarité dans laquelle se trouvent souvent les femmes atteintes par le VIH. L'isolement, la précarité sociale - notamment des femmes originaires d'Afrique subsaharienne - ou encore la co-infection par une hépatite constituent autant de facteurs de vulnérabilité cumulés face à la maladie. Socialement, celle-ci est moins bien acceptée lorsqu'elle touche les femmes. A l'occasion de colloques que nous organisons avec des femmes séropositives, nous rencontrons souvent des interlocutrices restées dix, quinze ou vingt ans sans jamais parler de leur maladie, si ce n'est à leur médecin.
Pour apporter des réponses aux femmes, il convient de tenir compte de leurs spécificités physiologiques et sociales. Le travail que le Planning familial mène notamment auprès des jeunes s'inscrit bien dans cette perspective.
Aujourd'hui, les traitements permettent aux personnes séropositives de vivre plus longtemps. Le contrôle de la charge virale leur permet d'être « moins contaminantes ». En matière de sexualité, le préservatif n'est plus l'unique outil de prévention : il existe toute une palette de moyens permettant de prévenir la transmission de la maladie. Cependant, ces moyens sont très peu étudiés chez les femmes. Le préservatif féminin reste trop peu mis en avant, alors qu'il permettrait aux femmes de gérer elles-mêmes leur prévention. De la même manière, les microbicides font l'objet de très peu de recherches. Voilà deux ans, l'Organisation des Nations unies (ONU) a annoncé que l'utilisation du contraceptif injectable Depo-Provera, l'un des contraceptifs les plus utilisés dans les pays du Sud, était susceptible d'augmenter le risque d'infection à VIH pour les femmes. Or, à la suite de cette annonce, très peu d'études ont été menées. Aucun investissement n'a été réalisé pour poursuivre les recherches.
Pour terminer, je souhaite aborder la pénalisation de la transmission du VIH, un sujet souvent évoqué dans les colloques que le Planning familial organise avec d'autres associations. Bien qu'en France, les plaintes portées émanent souvent des femmes, j'insiste sur le fait que pour la majorité des femmes que nous rencontrons, la transmission du VIH ne peut s'appréhender en termes de « coupable » ou de « victime ». Il serait certes trop simpliste de parler d'une responsabilité partagée dans la prévention, en raison des inégalités évoquées plus tôt. Pour avancer sur cette question, plutôt que d'apporter une réponse d'ordre juridique, il convient de permettre aux femmes de gérer leur prévention.

Merci. Je propose de céder la parole aux deux rapporteures pour ouvrir nos échanges sur les questions posées par la transmission du VIH.

Vous avez toutes les deux, Mesdames, défendu l'idée d'une approche globale. Cette volonté que vous partagez m'interpelle, car en matière de communication, il a toujours été affirmé qu'une approche ciblée sur une population était beaucoup plus efficace. Ne pensez-vous pas que la communication devrait être différenciée selon les catégories de population auxquelles elle s'adresse ?
Nous sommes favorables à ce que des messages spécifiques soient délivrés aux différentes populations. Catherine Kapusta-Palmer l'évoquait notamment au sujet des femmes de plus de 50 ans qui, par exemple, ne se sont pas senties concernées par les messages adressés aux jeunes.
L'approche globale que nous défendons porte avant tout sur la prise en charge. Il s'agit que les personnes aient la possibilité, en un même lieu, d'effectuer un dépistage, d'avoir accès à une contraception d'urgence, d'être prises en charge dans le cadre d'une IVG ou encore de s'interroger avec des professionnels sur le fonctionnement de leur couple, dans une optique de prévention des violences.

Selon le rapport sur la santé des femmes commandé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, alors ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, alors que le nombre de cas de sida a été divisé par deux chez les hommes entre 1996 et 2006, il n'a connu qu'une très faible diminution chez les femmes. La proportion de femmes atteintes du sida a par ailleurs doublé entre 1987 et 2006. Il est possible que ces évolutions traduisent une récente tendance des femmes à se faire dépister lorsqu'elles débutent une nouvelle vie affective et sexuelle. J'y vois également un lien avec les messages d'information essentiellement centrés sur la contamination au cours de rapports homosexuels et par l'échange de seringues, alors que ces modes de transmission ne représentent qu'une part des contaminations. Ce point me semble très inquiétant.
En ce qui concerne l'approche globale dans l'information, il me semble que le message adressé aux jeunes concerne plus la prévention de grossesses non désirées que la protection contre les maladies sexuellement transmissibles, et donc contre le sida. Les jeunes filles qui prennent la pilule et ont confiance en leur compagnon ne se sentent pas touchées, peut-être, par les messages de prévention. Il se peut que nous nous trouvions face à une perte de vigilance vis-à-vis du VIH.
Écartées des messages de prévention, les personnes de plus de 50 ans n'ont pas été éduquées à se protéger elles-mêmes. De manière générale, nous notons ici l'absence d'une éducation globale par rapport au VIH : il n'est pas suffisamment souligné que même une femme hétérosexuelle peut être concernée par cette problématique.

Dans l'interview datée du 2 avril 2014 que vous avez donnée à « Notre temps.com », vous évoquiez les études cliniques menées essentiellement sur les hommes. Vous indiquiez alors avoir participé à un essai clinique VIH/maladies cardiovasculaires, à l'issue duquel le médecin vous a signifié qu'il ne servait à rien d'interpréter les résultats des hommes par rapport aux femmes. Ce point m'interpelle, car il soulève un enjeu d'information et de formation du corps médical.
Vous soulignez le lien entre les traitements du VIH et les infarctus et expliquez que les traitements déforment le corps des femmes. Ces points font écho à notre audition précédente.
Je souhaite par ailleurs revenir sur la « perte de vigilance » évoquée par Françoise Laborde, que je mettrai en relation avec l'éducation à la sexualité dans les écoles. Lorsque j'étais enseignante en activité, nous faisions régulièrement appel au Planning familial pour intervenir dans les écoles, mais étions face à des élèves qui estimaient ces interventions inutiles, jugeant qu'ils étaient déjà au fait de ces problèmes. Quelle approche, en matière d'éducation à la sexualité, devrait être dispensée actuellement dans écoles, selon vous ?
La loi de 2001 rend obligatoire l'éducation à la sexualité de la maternelle au lycée, à raison de trois séances par classe et par an. En réalité, ce n'est pas ce que nous observons. Le Planning familial intervient essentiellement, me semble-t-il, à l'initiative des infirmières scolaires.

Les professeurs principaux travaillent également avec les infirmières scolaires sur ce sujet.
D'après ce que nous observons, il s'agit principalement d'initiatives communes aux infirmières scolaires et aux professeurs de sciences de la vie et de la terre (SVT), le sujet étant en lien avec le programme de cette matière.
La difficulté se pose essentiellement en termes de financements. L'intervention en milieu scolaire devrait faire l'objet d'une prise en charge par l'État, dans le cadre des financements destinés aux établissements d'information, de consultation ou de conseil conjugal (EICCF). Pourtant, en réalité, les établissements ne disposent que de peu de moyens et doivent donc hiérarchiser leurs priorités. Par exemple, les académies qui ont testé les « ABCD de l'égalité », désormais abandonnés, ne disposent plus de financement, aujourd'hui, pour les questions d'éducation à la sexualité.
Il est important que la loi de 2001 soit appliquée, et ce même si les élèves affirment tout savoir, notamment grâce à Internet.

Malheureusement, les élèves ne sont pas demandeurs de telles interventions.
Le Planning familial touche environ 230 000 jeunes chaque année en France. Effectivement, la première réaction de certains jeunes est de ne pas percevoir l'intérêt d'une éducation à la sexualité, estimant qu'ils peuvent trouver toutes les réponses à leurs questions sur Internet, l'information y étant aisément accessible et, en outre, de manière anonyme.
Lorsque nous intervenons dans les classes en tant que mouvement d'éducation populaire, nous nous attachons, à partir des questions que se posent les jeunes que nous rencontrons, à adopter une approche genrée. En abordant le sujet de la contraception, nous leur demandons par exemple si, selon eux, il revient uniquement aux filles de gérer la contraception. Lorsque les jeunes nous répondent par exemple que la pilule est à la charge des filles, le préservatif à celle des garçons, nous pouvons engager une discussion sur la question.
Nos interventions sont également l'occasion d'échanger sur les violences. À l'école maternelle, au primaire et au collège, nous demandons par exemple aux enfants si le fait de soulever la jupe des filles constitue une violence, puis plus tard, s'il est dérangeant de toucher les fesses ou la poitrine des filles, et si l'on ferait de même aux garçons...
Si les élèves pensent tout connaître et n'ont effectivement pas besoin de nous pour s'informer sur les aspects « pratiques » de la sexualité, nous percevons bien qu'il est essentiel d'aborder avec eux les questions de l'approche genrée, des IST et des violences. Il est notamment important que les filles et les garçons se parlent, qu'ils confrontent leurs discours.
Je souhaite évoquer les tests rapides à orientation diagnostique (TRODs), qui désignent les tests de dépistage rapide du VIH. Nous estimons nécessaire que ces dispositifs soient développés non seulement dans les centres de dépistage, mais également dans les lieux associatifs, où des personnels formés pourraient les pratiquer.
Des personnels associatifs commencent à se former à la question, mais il convient de généraliser cette pratique, ce qui implique de former un certain nombre de personnes dans l'ensemble des associations concernées.
Je souhaite également évoquer le dépistage des personnes mineures. Actuellement, certains centres de dépistage nous indiquent ne pas pouvoir prendre en charge les mineurs, car cela impliquerait de prévenir leurs parents. Ces centres pratiquent pourtant un dépistage gratuit et anonyme, ce qui devrait autoriser les personnes à ne pas dévoiler leur âge. La question semble être celle du financement.

Elle est également de nature juridique.
- Présidence de Mme Françoise Laborde, vice-présidente -
Effectivement. Les mineurs qui se tournent vers ces centres sont donc renvoyés vers les centres de planification, par exemple au Planning familial, où il existe également une prise en charge anonyme et gratuite, mais uniquement pour la contraception. Il conviendrait de mettre les deux dispositifs en parallèle.
Par ailleurs, en termes de financement, nous estimons que la tarification à l'acte n'est pas compatible avec l'approche globale que nous appuyons.

Actuellement, lorsqu'un individu se rend dans un laboratoire pour une analyse, il lui est proposé de réaliser un test de dépistage du VIH. Il est ainsi plus facile de proposer un dépistage aux personnes déjà suivies pour une pathologie. L'enjeu porte véritablement sur les personnes qui socialement sont moins suivies ou qui refusent systématiquement le dépistage, estimant ne pas faire partie des populations « à risque ». Comment toucher ces personnes ?
Nous savons que les risques de contamination de l'homme à la femme et de la femme à l'homme ne sont pas identiques. Par ailleurs, si de nombreux progrès ont été réalisés s'agissant des femmes enceintes, bien suivies aujourd'hui, celles-ci n'apprennent souvent leur séropositivité qu'à l'occasion de leur grossesse, soit trop tardivement. Nous mesurons bien que le travail à accomplir sur les aspects sociaux et genrés reste très important et que vous y oeuvrez, Mesdames. Comment notre délégation peut-elle y participer ?
Le Planning familial pratique une prise en charge globale de la santé des femmes. Les femmes qui se rendent dans les centres de planification familiale peuvent bénéficier d'une prise en charge médicale (consultation gynécologique) et obtenir des informations sur la contraception, les IVG, les IST et le VIH.
Il est important que la prise en charge dans les centres de santé puisse porter sur l'ensemble de ces questions, en tenant compte de la spécificité des besoins des femmes. Celles-ci doivent savoir qu'en ces lieux, elles obtiendront des réponses à leurs questions.
De nombreuses femmes vivant avec le VIH sont isolées. Elles subissent le cercle vicieux de la discrimination. L'infection à VIH n'est pas une maladie comme les autres et ne le sera jamais, même si certains cherchent aujourd'hui à la classer parmi les maladies chroniques classiques. L'isolement des femmes séropositives et leurs difficultés à être suivies reflètent bien la spécificité de cette maladie. Plusieurs enquêtes révèlent que la discrimination que subissent les personnes séropositives s'exprime également dans le milieu médical, souvent en raison d'une méconnaissance de la maladie. Aujourd'hui encore, nous observons des refus de soins par des dentistes et des gynécologues. Or le suivi gynécologique des femmes séropositives est primordial, au vu des effets des traitements sur les fluctuations hormonales, les infections et les risques de cancer du col de l'utérus.
Face à cet isolement, le Planning familial a pris la mesure du rôle qu'il devait jouer. Outre les actions de prévention, il s'agit de proposer aux femmes séropositives un lieu vers lequel se tourner, où elles peuvent bénéficier de l'expérience des conseillères conjugales pour parler de prévention, de contraception, d'avortement, d'IST et de sexualité. Les enquêtes indiquent que les trois quarts des femmes séropositives n'ont pas eu de rapport sexuel depuis au moins trois ans.
Un travail considérable doit donc être mené sur la question des représentations que la société a des personnes séropositives.

Il est essentiel d'aborder la question des moyens. Nous constatons aujourd'hui une diminution du nombre de centres de planification familiale, pourtant si utiles, ainsi que la suppression de certaines spécialités dans les centres de santé. Je l'observe, notamment dans ma ville, en gynécologie. Ces constats doivent nous interpeller. Ils soulèvent la question des moyens à mobiliser pour créer des espaces dans lesquels la réponse globale que vous évoquiez peut être apportée.
Je partage votre point de vue.

Moi aussi. Pour le développement d'une véritable approche genrée en santé, au-delà des paroles, il faut des moyens et des actes. Si nous n'insistons pas sur cette nécessité, personne ne le fera.
Je souhaite insister encore une fois sur l'importance de « casser » les représentations sociales. Je citerai par exemple l'idée selon laquelle les femmes de plus de 50 ans n'auraient plus de sexualité et ne seraient donc plus exposées au risque de contracter des IST ou le VIH. Un autre cliché laisse entendre que les femmes seraient uniquement intéressées par la procréation.
J'insiste également sur l'importance de travailler sur la question des inégalités. Aujourd'hui encore, il est difficile pour de nombreuses femmes d'imposer l'utilisation du préservatif, pour se protéger et protéger l'autre. Les outils qui leur permettraient de gérer leur protection ne sont que très peu étudiés et mis en avant.
Dans le domaine médical mais également en sciences sociales, tout est bâti sur le modèle de l'homme. Les quelques enquêtes dont nous disposons sur le sujet soulignent que les femmes séropositives se trouvent davantage dans des situations de précarité et d'isolement que les hommes. Nous voyons bien que les études genrées sont essentielles pour identifier les problèmes et apporter des solutions adaptées.

En lien avec les représentations que vous évoquiez, j'observe que si l'on parle beaucoup du vieillissement de la population, on ne s'intéresse pas suffisamment au vieillissement de la sexualité, en particulier s'agissant des femmes. La vie sexuelle des couples d'un certain âge reste aujourd'hui taboue, sans parler de celle des femmes seules. Il est essentiel ici de casser les stéréotypes.

Dans mon département, le Finistère, des maisons de retraite pilotes sur la question ont été identifiées. Nous observons que ce sont souvent les enfants des résidents qui ont le plus de mal à admettre que leurs parents puissent encore avoir une sexualité. Encore une fois, le poids des stéréotypes est important.
Pour terminer, je souhaite faire part de mon inquiétude sur la situation de pays tels que le Nigeria, où les femmes sont utilisées comme des armes de guerre, avec des implications certaines sur la propagation du VIH. Je suis terrifiée par ces actes de barbarie qui engendreront bien des catastrophes.

Je remercie vivement les deux intervenantes pour leur apport décisif à notre réflexion et pour l'ensemble des combats qu'elles mènent.