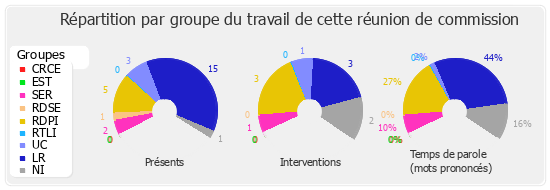Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 11 mars 2015 à 9h11
La réunion
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission procède à l'audition de M. Bruno Bézard, directeur général du Trésor.
La réunion est ouverte à 09 h 11

Nous accueillons pour la première fois Bruno Bézard en sa qualité de directeur général du Trésor - nous l'avions déjà entendu en tant que directeur de l'Agence des participations de l'État et directeur général des finances publiques.
Cette audition sera l'occasion d'aborder de très nombreux sujets. Lundi prochain, nous délibérerons en séance publique du projet de loi de ratification de l'accord intergouvernemental relatif au Fonds de résolution unique (FRU), dont l'adoption nous ferait franchir un pas de plus dans la mise en oeuvre de l'union bancaire. Mercredi, nous examinerons le rapport d'Albéric de Montgolfier sur une proposition de résolution relative au plan d'investissement lancé par Jean-Claude Juncker, à laquelle nous consacrerons une audition spécifique ultérieurement ce matin.
Un autre grand chantier, lancé par la nouvelle Commission européenne et en particulier son commissaire Jonathan Hill - que nous recevrons au mois de mai - est celui de l'union des marchés de capitaux. Vous nous direz, monsieur le directeur général, quelles sont les implications de ce chantier pour le financement de notre économie. La zone euro est également au coeur de nos préoccupations et nous évoquerons sûrement la situation de la Grèce, mais aussi le fonctionnement des procédures mises en oeuvre à la suite de la crise de 2010 : le pacte de stabilité rénové et la procédure de correction des déséquilibres macroéconomiques, dans un contexte de nouvelle politique monétaire et économique en Europe. Tous ces sujets donnent lieu à des négociations auxquelles vous participez au nom de la France. Il nous est donc précieux de vous entendre.
Avant que le rapporteur général, le rapporteur spécial de la mission « Défense » Dominique de Legge et nos collègues vous interrogent, pouvez-vous nous dire quels projets sont susceptibles d'être cofinancés par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, dans quelle mesure la France pourrait bénéficier des fonds mobilisés et quel rôle sera dévolu pour la mise en oeuvre du plan à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque publique d'investissement (BPI) d'une part, à la Banque européenne d'investissement (BEI) d'autre part ? La BEI est-elle capable de conduire un plan d'une telle ampleur ?
Merci de me recevoir. Un mot d'abord sur la réforme de structure des banques, complexe techniquement et sensible politiquement. En adoptant, conformément à l'engagement du Président de la République, la loi du 26 juillet 2013 qui oblige à séparer avant le 1er juillet 2015 les activités de marché spéculatives des banques de celles dites « utiles à l'économie », la France a été précurseur dans le monde. Je vous sais sensible à l'application des lois que vous votez : le décret du 8 juillet 2014 a fixé le seuil d'application de la loi, qui s'imposera aux établissements dont la part des activités de négociation sur instruments financiers excède 7,5 % de leur bilan. Seront ainsi concernés les principaux groupes français : BNP Paribas, BPCE, Crédit agricole, Crédit mutuel, HSBC France, Société générale, etc. L'arrêté du 9 septembre 2014 a complété les mécanismes de mise en oeuvre de la loi. Le dispositif est donc en cours de déploiement. À compter du 1er avril, les établissements devront transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la cartographie de leurs activités, et chaque trimestre une série d'indicateurs d'activité et de risques de leurs opérations de tenue de marché.
La réforme ne raisonne pas en fonction du volume d'activité - ce qui serait une approche un peu rustique. Elle impose des règles strictes de contrôle interne, et habilite le superviseur à contrôler les activités de marché. Nous avons là une divergence avec le projet de règlement de la Commission européenne de janvier 2014, qui prévoit - ou prévoyait, je ne sais pas comment il faut désormais en parler - une séparation quasi automatique des activités bancaires selon un unique critère de taille : on pénaliserait ainsi certaines activités de tenue de marché utiles, tout en laissant se développer des activités spéculatives non contrôlées. Autre défaut de ce texte : l'aménagement obtenu par le Royaume-Uni, qui pose un problème juridique et politique, soulevé à juste raison par la résolution votée par votre assemblée en avril 2014. Michel Sapin s'en est entretenu hier avec le commissaire Hill et la présidence lettonne de l'Union européenne. Cette dernière réfléchit à un nouveau système de classification en rouge, orange et vert ; il faudra veiller à ce que l'on ne pénalise pas les pays dont les banques sont universelles.
L'union des marchés de capitaux ou Capital Markets Union (CMU) est une initiative européenne très positive, bien que son contenu soit encore flou. La France doit y prendre une part active, en faisant en sorte que cette réforme ait des effets concrets, perceptibles par nos concitoyens. Elle peut, par exemple, faciliter le financement des entreprises en capitaux propres - car le problème global actuel est moins celui de la liquidité que de l'accès à l'equity - et favoriser le développement de la titrisation, non pas celle qui nous a menés où nous sommes, mais la titrisation de haute qualité, qui repose sur des actifs solides. Sachons aussi défendre nos intérêts industriels : comme l'a rappelé Michel Sapin lors du dernier comité « place de Paris 2020 », celle-ci représente de nombreux emplois qualifiés. Enfin, l'union des marchés de capitaux est un moyen de réduire la fragmentation de la zone euro, où les conditions de financement des entreprises diffèrent grandement d'un pays à l'autre, et de créer ainsi de la valeur.
Le Fonds de résolution unique (FRU) est essentiel à la mise en place effective de l'union bancaire que la France appelle de ses voeux. L'un des objectifs est de briser le lien entre crise bancaire et crise des finances publiques : il doit être possible de recapitaliser les banques sans puiser dans les budgets nationaux. Nous avons donc souhaité que l'union bancaire s'accompagne à la fois de mécanismes de supervision et de résolution - anglicisme qui désigne le traitement ordonné d'une banque en difficulté. Le Mécanisme de surveillance unique (MSU), opérationnel depuis novembre, remplit la première fonction ; il est piloté par un conseil de surveillance unique, qui supervise directement les 130 établissements bancaires les plus importants de la zone euro, et indirectement les banques de plus petite taille. L'exercice pan-européen de résistance et de mesure de la qualité des bilans des banques mené récemment a mobilisé plusieurs milliers d'auditeurs et abouti à la publication de l'état de santé des établissements de la zone.
Deuxième pilier de l'union bancaire : le Mécanisme de résolution unique (MRU), destiné à éteindre les incendies dont le déclenchement n'aurait pu être empêché par le MSU. Il est en cours de mise en place. La Bank recovery and resolution directive, ou directive BRRD, est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. C'est une étape essentielle pour que les contribuables ne supportent plus seuls le coût des faillites bancaires : désormais, on sollicitera d'abord les actionnaires et certains créanciers. Nous avons appris de nos erreurs passées...
Le FRU, qui complète le MRU, est de taille importante : 55 milliards d'euros, soit 1 % des dépôts couverts dans les pays membres de l'union bancaire. Au terme de milliers d'heures de négociation, un juste équilibre a été trouvé dans la répartition de l'alimentation du fonds.
J'en viens au « plan Juncker ». Il a un premier mérite : celui de mettre l'investissement au coeur de l'agenda européen. C'est une grande satisfaction pour la France, qui plaidait en ce sens depuis longtemps. Le premier volet du plan est financier : 315 milliards d'euros d'investissements additionnels - c'est-à-dire qui n'auraient pas été réalisés en l'absence de plan - seront injectés dans l'économie européenne. La BEI s'appuiera sur le budget européen pour attirer des capitaux privés vers des projets un peu plus risqués. Le deuxième volet est thématique : il s'agit de définir un pipeline ou « tuyau » de projets susceptibles de bénéficier de la garantie financière, afin de stimuler les co-investissements avec le secteur privé. Enfin, le plan comporte un volet réglementaire : il faut aller au-delà de l'aspect financier et revoir un certain nombre de réglementations qui freinent l'investissement. Il faut créer un environnement favorable à l'investissement en approfondissant le marché unique dans les domaines du numérique, de l'énergie ou des marchés de capitaux. À nouveau, nul besoin d'inonder le marché de liquidités ; ce dont les entreprises ont besoin, c'est de garanties, de subventions ou de capital, afin de sortir certains projets de leurs cartons.
Les États membres qui abonderaient le premier volet du « plan Juncker » en amont pourraient déduire ces sommes de leur déficit maastrichtien. Nous avons cependant rétorqué que cela restait du « vrai argent », financé par de la dette qu'il faut effectivement rembourser... Tous ont annoncé privilégier les contributions en aval, par le co-financement des projets au moyen de leurs organismes ou banques nationales de développement. La Caisse des dépôts et consignations et la BPI participeront ainsi à hauteur de 8 milliards d'euros aux projets retenus dans notre pays.
Additionnalité et rapidité doivent être les maîtres mots de ce chantier. Nous veillerons à ce qu'il porte sur des projets qui n'auraient pas vu le jour sinon, et à ce qu'il ne s'englue pas dans la bureaucratie. Un préfinancement de la BEI sera même possible pour accélérer les choses. Le règlement fixant l'architecture du plan vient d'être adopté. Les projets ne seront pas sélectionnés selon des quotas nationaux, mais selon leurs mérites propres.
Le comité de pilotage du fonds définira, comme tout comité de fonds d'investissement professionnel, les thèmes prioritaires.
J'en viens à l'adoption par le Conseil Ecofin de la recommandation de la Commission européenne - qui ne fait en effet qu'une proposition aux ministres de l'économie des États membres - relative à notre retour sous la barre des 3 % de déficit public. Les deux instances ont estimé que les conditions fixées par le traité étaient réunies. Nous avons prouvé que, même si nous n'avions pas respecté l'objectif de déficit nominal, en raison notamment de la faiblesse de la croissance et de l'inflation, notre politique budgétaire respectait les critères de sérieux qui rendent possible l'application des clauses de flexibilité du traité. En cas de choc économique imprévu ou de circonstances défavorables, le traité autorise en effet la Commission à proposer une nouvelle trajectoire de retour sous les 3 %, sous réserve toujours que l'État concerné ait pris des mesures effectives pour réduire ce déficit. La Commission et le Conseil ont également tenu compte des réformes structurelles entreprises ou annoncées, qu'ils ont jugées suffisamment ambitieuses : allégements de charges pour les entreprises, projet de loi Macron, programme national de réforme. La France n'a donc pas obtenu de dérogation, ni bénéficié d'une lecture favorable ou d'une interprétation complaisante du traité : le pacte de stabilité a été appliqué à la lettre !
La recommandation de la Commission européenne a été adoptée hier à l'unanimité du Conseil ECOFIN. Nous avons donc deux ans pour repasser sous les 3 % de déficit public. Des rendez-vous sont prévus en avril et en mai-juin pour détailler les réformes qui permettront d'y parvenir, et un quantum d'économies structurelles devra être respecté annuellement. Toutes ces mesures de sérieux ont convaincu nos partenaires.
J'en viens au cas de la Grèce, qui occupe beaucoup l'Eurogroupe, car il y a urgence : les banques grecques, qui ont été recapitalisées, subissent en revanche une fuite de liquidités, les épargnants retirant leurs dépôts ; l'État grec, de son côté, peine à se financer, car les banques du pays n'achètent plus d'obligations souveraines... Or le nouveau gouvernement a été élu sur la promesse de s'opposer à la discipline européenne, à la troïka et aux mesures d'assainissement qu'elle propose. Un accord était-il possible pour prolonger le programme d'assistance tout en lui apportant des assouplissements, afin de donner satisfaction à Athènes ?
Je suis convaincu qu'une convergence est possible : par exemple si le gouvernement grec s'engage à lutter contre la fraude fiscale, qui s'apparente parfois à une exemption fiscale généralisée, ce que l'Europe réclame depuis longtemps, et s'il s'attaque à la corruption et aux rentes générées par un marché des biens et services très protégé. De même, si le gouvernement Tsipras adopte une doctrine souple au sujet des privatisations, en n'acceptant de céder des actifs publics qu'à leur juste prix et sous réserve qu'ils ne présentent pas un intérêt stratégique pour le pays, cela me choquerait d'autant moins que c'est la position constante de la France... Pour l'heure, l'Eurogroupe et le gouvernement grec se jaugent mutuellement. Ce dernier a commis quelques maladresses de communication, en disant ne pas vouloir rembourser certains de ses créanciers...
Dans ce débat, la France constitue un trait d'union. Michel Sapin a incité ses collègues de l'Eurogroupe à trouver un accord qui garantisse le respect par la Grèce de ses engagements, tout en apportant plus de flexibilité au programme d'assistance, afin de ne pas donner le sentiment de faire fi du résultat des élections. Les membres de l'Eurogroupe se sont finalement entendus le 20 février sur une déclaration, dont les termes devront être respectés. À présent, il convient que des négociations s'ouvrent rapidement entre la Grèce et les « institutions » - terme préféré à celui de « troïka » - c'est-à-dire avec la Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI), en vue de trouver un accord. Car, pendant ce temps, les banques grecques se vident de leur substance et l'État grec a de plus en plus de mal à lever ses emprunts...

Merci de cet exposé très complet. La France devra tout de même réaliser cette année un effort structurel de l'ordre de 0,2 % de son PIB. Où trouver ces 3 ou 4 milliards d'euros ?
La Commission européenne comme les Allemands attendent de nous des réformes structurelles, notamment du marché du travail. La loi Macron ne suffira pas... Quant aux revues de dépenses annoncées, elles semblent bien anecdotiques. Avez-vous des précisions à nous apporter sur l'agenda de réformes qui sera soumis à nos partenaires ?
En cas de restructuration de la dette de la Grèce ou de tout autre pays ayant bénéficié de l'assistance financière du FMI, de la BCE et des États membres de l'Union - via le Mécanisme européen de stabilité (MES) et des prêts bilatéraux - dans quel ordre ces créanciers seraient-ils payés ? Le montant des engagements hors bilan de la France est-il bien de 200 milliards d'euros ? Comment les risques sont-ils couverts ?
Nous avons émis un avis favorable au FRU, mais nous souhaitons que l'information du Parlement soit complétée, en particulier sur la part des contributions versées en engagements de paiement, et non en décaissements « cash ».
Enfin, le projet de loi de transition énergétique rend possible la création de nouvelles sources de financement, comme les sociétés de tiers-financement. Qui les supervisera ? N'est-il pas dangereux de créer de tels outils échappant aux mécanismes de régulation bancaire ?

Nous connaissons tous la fragilité du budget de la défense, qui repose sur 2 milliards d'euros de recettes exceptionnelles. Or un amendement au projet de loi Macron déposé par le Gouvernement modifie son article 50 en créant des sociétés de projet. Est-ce à dire que le gouvernement renonce aux recettes exceptionnelles liées à la vente de fréquences ? Cela conduirait au dépôt d'une loi de finances rectificative...
Quel sera l'impact des sociétés de projet sur le solde maastrichtien ? Un rapport, classé confidentiel défense mais dont la presse s'est fait l'écho, l'estime non nul... Ces sociétés ont-elles vocation à nous faire surmonter une mauvaise passe ou seront-elles pérennisées ? Quelle sera la rémunération du capital investi ? Ce capital sera-t-il uniquement tiré de la réalisation d'actifs d'État, ou fera-t-on appel à des capitaux extérieurs ? Enfin, quelles garanties donnera-t-on aux investisseurs, le matériel militaire étant, par définition, exposé à la destruction ?
Monsieur le rapporteur général, la Commission européenne demande effectivement à la France un effort structurel de 0,5 % pour 2015 ; selon elle, il manque 0,2 point, soit environ 4 milliards d'euros - ce que nous contestons, mais c'est la Commission qui dit le droit. Cet écart s'explique par la faiblesse de l'inflation, qui réduit non seulement les recettes, mais aussi le rendement des mesures d'économie, en France comme ailleurs. Michel Sapin a annoncé que les voies et moyens d'obtenir le rendement attendu seraient trouvés.
La Commission européenne a jugé complet le programme national de réforme présenté le 18 février. Elle a simplement demandé davantage de précisions sur le calendrier et les modalités de sa mise en oeuvre. Vous connaissez ses grands axes : réforme du marché du travail, simplification administrative et réduction de « l'impôt papier » des entreprises... Notre pays a parfois la réputation d'être incapable de se réformer, mais lorsqu'on explique les efforts que nous faisons, le regard change : je m'en suis aperçu lors d'une rencontre avec les députés allemands.
Vis-à-vis de la Grèce, la France est engagée à hauteur de 42 milliards d'euros, soit directement, soit par le biais du Fonds européen de stabilité financière. Si la question de la dette publique a été largement abordée au cours de la campagne électorale en Grèce, aucune discussion n'a eu lieu jusqu'à présent, au niveau européen, sur le traitement de cette dette. L'Eurogroupe avait cependant indiqué dans un communiqué qu'il se pencherait sur la soutenabilité de la dette grecque dès lors que ce pays aurait dégagé un excédent primaire : c'est chose faite, puisque l'excédent primaire de la Grèce s'est élevé en 2014 à 1,5 % du PIB. Encore faut-il qu'Athènes respecte les engagements pris dans l'ancien programme, sans doute appelé à être modifié, et dans un éventuel nouveau programme. Nous serons très attentifs au respect par l'État grec des échéances de ses emprunts, particulièrement importantes en mars, puis en juillet et en août.
S'agissant du FRU, j'aurais dû préciser que nous avons obtenu qu'une partie des engagements des banques ne donnent pas lieu à des décaissements immédiats.
En ce qui concerne les sociétés de projet, la seule question qui relève de la compétence de la Direction générale du Trésor est la question de l'inclusion ou non dans le périmètre des administrations publiques. Le statisticien national ou européen ne peut y répondre que sur la base d'un projet précis. Tant qu'il n'y a pas de projet précis, on ne peut pas dire s'il est consolidant ou déconsolidant. Comme l'a dit Christian Eckert, il y a un certain nombre de critères pour que ce soit déconsolidant et les projets examinés à ce stade ne respectent pas tous ces critères. Je ne peux pas vous dire si, in fine, le schéma retenu respectera ces critères - encore faut-il qu'Eurostat ait ensuite la même appréciation. Tout dépend du schéma juridique et financier retenu.
Sur le tiers-financement, il me semble que nous sommes parvenus à un bon équilibre dans le texte sur la transition énergétique. Il n'est évidemment pas question, alors que l'on soumet les établissements de crédit à une régulation toujours plus stricte, de laisser se développer un shadow banking soustrait à tout contrôle.

Vous avez dit que nos partenaires européens reconnaissaient le sérieux de notre politique budgétaire, et qu'ils avaient bien accueilli le programme national de réforme. Pourtant, les parlementaires britanniques que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur inquiétude de voir la France rester à la traîne, alors que le Royaume-Uni enregistre un taux de croissance de 2,5 %. Tous les États membres partagent cette préoccupation : les Allemands aussi, sans vouloir brutaliser la France, attendent d'elle des réformes ambitieuses. Le Gouvernement s'apprête-t-il donc, à l'occasion d'un collectif budgétaire, à nous proposer enfin des économies structurelles et non plus conjoncturelles ?
S'agissant du « plan Juncker », la liste publiée par Les Échos reprend pour l'essentiel de vieux projets : on chercherait en vain les investissements additionnels dont vous avez parlé. Quel sera le processus français de sélection ?

Avec le report indéfini du retour à l'équilibre des finances publiques, la dette ne risque-t-elle pas d'atteindre un niveau dangereux ?

Si l'actuel gouvernement a une si lourde tâche, c'est que les précédents n'ont pas pris de mesures assez énergiques. L'effort accompli aujourd'hui est sans précédent, des économies considérables sont demandées à toutes les administrations publiques, y compris aux collectivités territoriales.
Je crains que l'Europe ne montre un peu trop de mansuétude à l'égard de la Grèce. Il ne faudrait pas que le cas fasse école, et que dans d'autres pays, on commence à croire que l'on peut se faire élire en annonçant que l'on s'affranchit de ses engagements, que l'on cesse de payer ses échéances...
Que pensez-vous de la qualité des projets français dans le cadre du « plan Juncker » ?

À la suite de la revue de la qualité des actifs des banques européennes, on s'est félicité qu'aucune banque française ne figure parmi les vingt établissements les plus à risque, mais j'aurais aimé connaître en détail les résultats de nos banques. Le Parlement n'a pas été correctement informé.
Le FRU, avez-vous dit, sera doté de 55 milliards d'euros, ce qui paraît bien peu, d'autant que le Fonds ne sera effectivement constitué qu'en 2024 et que ses mécanismes d'intervention sont fort complexes. Que se passera-t-il si un accident grave se produit au cours des quatre ou cinq prochaines années ? Le Trésor a-t-il envisagé ce scénario ?

Alors que Bruxelles nous demande un effort budgétaire supplémentaire, pouvez-vous nous préciser le produit attendu de la taxe sur les transactions financières ? Les évaluations varient de 8 à 24 milliards d'euros... À quelle date cette taxe pourrait-elle entrer en vigueur ?

Je reviens sur le FRU : les 55 milliards d'euros suffiront-ils, alors que le renflouement des banques irlandaises et espagnoles a coûté respectivement 30 et 40 milliards d'euros ? Le contribuable risque toujours d'être mis à contribution.
Comment mieux contrôler le shadow banking, notamment dans le secteur des assurances ?
Avez-vous une idée du volume des projets français qui seront retenus dans le cadre du « plan Juncker » ? Comment s'assurer de leur qualité ? Vu l'abondance des liquidités disponibles, les bons projets trouvent aujourd'hui à se financer ; il est à craindre, en revanche, que le « plan Juncker » ne serve à financer des projets plus discutables.

Merci de votre exposé particulièrement clair. J'aimerais avoir votre sentiment sur le niveau actuel de l'inflation. Longtemps considérée comme le problème numéro un, l'inflation est aujourd'hui trop faible, alors qu'elle pourrait alléger le poids de la dette. La faiblesse de l'inflation anticipée pose également problème. La politique de quantitative easing menée par la BCE, la baisse du cours de l'euro, la hausse des salaires en Allemagne n'ont pas suffi à inverser la tendance. Le doute gagne les esprits, qui se traduit aussi dans les urnes...

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a récemment donné tort à la BCE, qui voulait imposer que les chambres de compensation assurant une activité importante sur les dérivés libellés en euros soient installées dans la zone euro. Quelles sont les conséquences de cette décision pour la compétitivité de la place de Paris. Cette décision menace-t-elle par ailleurs la stabilité financière en Europe ?
Le commissaire général à l'investissement Louis Schweitzer s'est prononcé pour un troisième programme d'investissements d'avenir. Comment s'articulerait-il avec le « plan Juncker » ?
J'étais récemment au Royaume-Uni : il est vrai que le pays a renoué avec la croissance, et nous pouvons sans doute nous inspirer de certaines mesures prises outre-Manche. Mais n'oublions pas que le déficit britannique atteint toujours 5,4 % du PIB...

Je ne parlais pas seulement des Britanniques. Ce sont les vingt-sept autres États membres de l'Union qui attendent de la France de vraies réformes, capables de la redresser !
Les États membres se sont exprimés hier lors du conseil Ecofin. Il est évidemment possible d'approfondir la discussion avec chacun d'entre eux...
On ne peut pas dire, monsieur Canevet, que le retour à l'équilibre des finances publiques soit reporté indéfiniment. La trajectoire adoptée hier fixe l'échéance à 2017, et elle nous oblige. Il est vrai que par le passé, nous n'avons pas toujours tenu les délais impartis. C'est pourquoi des rendez-vous ont été fixés, qui porteront aussi bien sur le retour à l'équilibre financier que sur les réformes structurelles. Notre dette publique est effectivement trop élevée, les États membres et la Commission européenne veilleront à ce qu'elle soit maîtrisée, comme le prévoit la trajectoire. Le Gouvernement a annoncé des cessions d'actifs à cet effet.
S'agissant de la supervision bancaire, les résultats de la revue de la qualité des actifs ont été rendus publics le 26 octobre par la BCE. Cette transparence exemplaire est de nature à rassurer les marchés. Les 55 milliards d'euros du FRU suffiront-ils ? N'oublions pas que ce Fonds n'est destiné à intervenir qu'après que les actionnaires, mais aussi les créanciers auront été sollicités. Ce renflouement par les actionnaires et créanciers, ou bail-in, doit porter sur 8 % du bilan. Devrait également être mis en place un coussin supplémentaire dénommé TLAC (total loss-absorbing capacity). Le calibrage du Fonds paraît donc approprié ; nous examinons cependant l'opportunité d'instituer une garantie publique, au moins pendant la période transitoire, au cas où sa taille ne serait pas suffisante.
Pour ce qui est du « plan Juncker », les projets ont été identifiés par une task force associant, dans chaque pays, des représentants de la Commission européenne, de la BEI et de l'État membre concerné. En France, c'est le commissariat général à l'investissement, en la personne de Thierry Francq, qui y a participé. Ce n'est pas parce que les projets étaient déjà connus qu'il n'y a pas d'additionnalité, car ils n'étaient jusque-là pas financés. Au niveau européen, l'enveloppe se monte à 1 300 milliards d'euros, dont 450 milliards pourraient être investis d'ici trois ans ; en France, les projets identifiés représenteraient 120 milliards d'euros. Précisons que cette liste, qui a servi à calibrer le plan, n'a qu'une valeur indicative. Les projets effectivement financés seront sélectionnés selon une procédure que nous avons voulue très professionnelle : il ne s'agit pas de financer des éléphants blancs, ni des projets qui se traduiraient in fine par des pertes pour les finances publiques. Il existe en France beaucoup de projets intéressants, notamment dans le secteur de la rénovation thermique des bâtiments, très créateur d'emplois, mais aussi dans celui des infrastructures, du haut débit... Le CGI pilotera l'opération.
Le niveau de l'inflation, monsieur Germain, concerne au premier chef la BCE. Il est vrai qu'il nous faut changer de paradigme : jusque récemment, tout le monde s'accordait à dire que l'inflation était dangereuse... Aujourd'hui, c'est sa faiblesse qui inquiète. La BCE a pris le problème à bras-le-corps, comme en témoigne le discours de Mario Draghi à Jackson Hole. Mais Mario Draghi rappelle aussi que la politique monétaire ne peut pas tout, car l'inflation est également liée à la faiblesse de l'activité, ainsi qu'à des phénomènes externes comme la chute du cours du pétrole ou de l'euro. Aussi appelle-t-il les États membres à mener une politique budgétaire sérieuse et à poursuivre les réformes, pour soutenir la croissance et la compétitivité.
Nous sommes en train d'analyser la décision de la CJUE sur les chambres de compensation, madame la présidente. À première vue, il ne semble pas que l'on doive en tirer de conclusions définitives.
Par shadow banking, il faut entendre les modes de financement des entreprises situés hors du champ de la supervision bancaire. Malgré les connotations de cette expression, il existe des formes parfaitement légitimes de financement désintermédié, beaucoup plus développées aux États-Unis qu'en Europe. Cela dit, on ne peut effectivement imposer une régulation toujours plus contraignante aux établissements de crédit et laisser de côté tout un secteur du financement de l'économie. Nous en discutons au niveau européen avec le commissaire Hill, et au niveau international avec nos partenaires du Financial Stability Board (FSB), qui réunit les régulateurs nationaux. Selon le FSB, le shadow banking représenterait plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars... La régulation de ce secteur rejoint la lutte contre la fraude fiscale et le financement du terrorisme, domaines dans lesquels la France est en première ligne, au niveau européen comme au sein du G20 : nous proposons par exemple un mécanisme de gel européen des avoirs, et notre insistance n'est pas étrangère à l'annonce par la Commission d'un projet de directive sur l'optimisation fiscale.
Quant à l'éventualité d'un troisième programme d'investissements d'avenir, c'est prématuré à ce stade.

Puisque les recettes attendues font défaut, notamment à cause de la faible inflation, ne risque-t-on pas de voir augmenter les prélèvements fiscaux ?
Je n'ai rien à ajouter sur ce point aux déclarations du Président de la République.