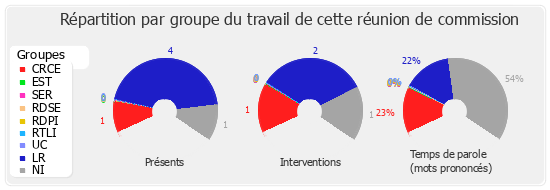Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 25 juin 2015 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, je tiens à remercier en votre nom le président du Sénat d'être des nôtres ce matin. Nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Angel Gurría. Ancien ministre des finances et des affaires étrangères du Mexique, il occupe brillamment les fonctions de secrétaire général de l'OCDE depuis 2006 et vient d'ailleurs d'être réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat de cinq ans.
Je voudrais également remercier de sa présence Pierre Duquesne, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'OCDE, poste que j'ai eu l'intense privilège d'occuper de 2009 à 2011. Je sais combien ce rôle est difficile. L'OCDE a son siège à Paris et porte certes un regard affectueux sur la France, mais elle n'oublie pas de dresser un constat extrêmement objectif sur la situation économique et sociale de notre pays, ce qui conduit l'ambassadeur représentant permanent à connaître un moment d'émotion quand il doit aller remettre aux autorités françaises le rapport de l'OCDE qui nous concerne !
Monsieur le secrétaire général, vous êtes à la tête d'une organisation respectée dans le monde entier, reconnue pour la valeur de ses analyses, de ses études, dont l'activité de prospective constitue un volet important, et formée de personnels d'une remarquable compétence. Comme j'ai pu le constater moi-même, les meilleurs postulent à l'OCDE.
Je laisse maintenant la parole à M. le président du Sénat pour quelques mots d'introduction.

Monsieur le président de la délégation à la prospective, monsieur le secrétaire général de l'OCDE, monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues, je remercie de son invitation le président Karoutchi, qui, je tiens à le souligner, avait pris très à coeur sa fonction et sa mission d'ambassadeur auprès de l'OCDE. Nous avons convenu de nous retrouver à la rentrée, avec l'ensemble du bureau de la délégation, comme cela se fait avec les commissions, pour un moment d'échanges afin d'envisager les moyens de valoriser les thèmes de réflexion retenus par la délégation.
Qu'il me soit permis, monsieur le secrétaire général, de vous féliciter à mon tour de votre réélection à l'unanimité - ce n'est pas si fréquent ! -, le 26 mai dernier. Le Sénat a eu la grande satisfaction de vous accueillir en tant qu'invité d'honneur dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine, et j'ai eu le plaisir de vous remettre, le 1er juin, la plus belle médaille de la Haute assemblée. Sous votre autorité, l'OCDE a élargi son horizon territorial. Après le Chili, Israël et les pays baltes, la Colombie fait partie des pays susceptibles d'entrer à l'OCDE. J'ai accueilli récemment au Sénat le président de la République de Colombie et j'aurai le plaisir de recevoir celui du Mexique, le 13 juillet prochain.
Je voudrais vous poser une question sur un sujet que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ensemble, à savoir le financement du développement, et ce à l'approche de la conférence d'Addis-Abeba. C'est un sujet extrêmement important, qui nous renvoie à celui des migrations, lesquelles sont liées à la situation politique, économique, sociétale, aux tensions interethniques ou interreligieuses.
Le programme de développement pour l'après-2015 est un enjeu essentiel. Un certain nombre d'initiatives sont déjà connues, je pense à celle de Jean-Louis Borloo sur l'électrification de Afrique ; d'autres peuvent paraître plus utopiques. En tout état de cause, la question migratoire est au coeur des débats, et ce n'est pas en construisant un mur comme le fait la Hongrie que l'on pourra résoudre le problème, notamment en Europe.
En remerciant de nouveau Roger Karoutchi et en vous redisant le plaisir que nous avons à vous accueillir, monsieur le secrétaire général, je vous laisse la parole.
Monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la délégation à la prospective, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est pour moi un grand honneur de m'exprimer aujourd'hui devant vous et je tiens à remercier le président Karoutchi de son invitation.
Afin d'illustrer le dialogue constant que l'OCDE promeut avec ses États membres, je me permettrai tout d'abord de vous distribuer une série de publications que notre organisation a consacrées à la France. La première s'intitule Promouvoir la croissance et la cohésion sociale et date de juin 2012. Au même moment se tenait le sommet du G20 à Los Cabos. Ce fut pour nous l'occasion d'engager avec le président Hollande, alors nouvellement élu, et les autorités françaises une discussion très utile et constructive. L'OCDE a poursuivi son travail et publié France : Redresser la compétitivité, document qui a fait l'objet d'actualisations régulières en 2013 et 2014.
Plus récemment, l'OCDE a fait connaître ses estimations sur les impacts potentiels de la future loi Macron sur la croissance et transmis au gouvernement français, en octobre 2014, une étude intitulée Pour un système social plus efficace, atteindre les objectifs français de solidarité et d'emploi. Il y était notamment souligné le faible taux de capillarité sociale ainsi que la persistance d'un certain élitisme dans l'éducation française alors que votre pays consacre près de 32 milliards d'euros par an à la formation professionnelle.
Je citerai enfin une étude datée de janvier 2015 : Chiffres clés sur l'éducation et l'accueil des jeunes enfants en France. Voilà illustré, en quelques exemples, le type de dialogue que nous entendons nouer avec les pays membres. Notre objectif est de leur apporter notre expertise sur les enjeux importants. Nous n'avons pas la prétention de faire la une des journaux. D'ailleurs, nombre de ces publications n'étaient pas destinées à être publiées. C'est le gouvernement français qui a fait ce choix.
Nous ne sommes pas en capacité d'avoir avec l'ensemble des pays membres un dialogue aussi intense et riche que celui que nous avons engagé avec la France. Tout dépend également de l'intérêt que ceux-ci montrent à nos travaux.
Je reviens un instant sur la question du financement du développement, qu'a évoquée le président Larcher. Une conférence internationale sur ce sujet se tiendra à Addis-Abeba dans un peu plus de deux semaines, sous l'égide des Nations unies. Le calendrier retenu en la matière est pour le moins surprenant.
En effet, après Addis-Abeba, les pays se retrouveront à New York en septembre pour dresser le bilan des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et fixer de nouveaux objectifs pour l'après-2015 en matière de développement durable. Puis, en décembre, Paris accueillera la Cop21.
Autrement dit, il nous est demandé de traiter la question du financement avant que soient fixés les objectifs à financer. C'est quelque peu contradictoire. Certes, les nouveaux objectifs de développement ne nous sont pas totalement inconnus et les négociations en vue de la Cop21 se poursuivent. Il n'en demeure pas moins que le calendrier aurait pu être différent. Peut-être faudrait-il organiser une deuxième conférence une fois déterminés des objectifs précis.
L'OCDE a notamment pour mission de suivre les flux d'aide publique au développement accordés dans le cadre du comité d'aide pour le développement (CAD). Ceux-ci ont atteint près de 140 milliards de dollars par an en 2014, niveau acceptable compte tenu des contraintes budgétaires de chacun. Mais c'est la chute des montants versés aux pays les plus pauvres qui nous préoccupe. Il est en effet toujours plus facile de prêter aux pays relativement plus développés, ceux qui ont des institutions plus stables et une meilleure capacité d'absorption de l'aide.
Au demeurant, l'aide au développement ne représente qu'un dixième des flux nécessaires au développement d'un pays. Elle doit donc absolument servir de catalyseur, de levier pour attirer d'autres sources de crédit et d'investissement. Je me souviens de ce commentaire formulé par l'un des participants à un forum organisé à Accra, au Ghana : pour épeler le mot aid, mieux vaut utiliser les lettres t, a et x, comme tax. La priorité devrait être de mobiliser les ressources intérieures pour attirer les flux de financement plutôt que de dépendre principalement de l'aide au développement. Pour certains pays, celle-ci représente 60 % des capacités d'investissement, pour d'autres, elle est marginale : c'est l'un des problèmes.
Oui, il y a un réel problème de calendrier. Le secrétaire général Ban Ki-moon, que nous avons rencontré voilà un mois environ, a insisté sur la nécessité de ne pas limiter la réunion d'Addis-Abeba à une discussion sur les pays africains et de privilégier une vision beaucoup plus globale. D'où l'importance d'y associer les pays donateurs, dans l'idéal les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes, au minimum leurs ministres des finances.
Tel est le grand défi qui nous attend. Nous travaillons en liaison avec les Nations unies. L'OCDE héberge en son sein deux structures, le CAD et le centre de développement, ce dernier étant appelé à accueillir prochainement la Chine comme nouveau membre. C'est un premier pas. Je rappelle que le Chili, l'Estonie, Israël et la Slovénie sont les pays membres les plus récents de l'OCDE, tandis que la Colombie et le Costa Rica sont en phase d'adhésion.
Le président Larcher a également évoqué les migrations, grand sujet d'aujourd'hui, que l'OCDE traite en particulier sous l'angle économique. Aujourd'hui, dans le monde, on dénombre soixante millions de réfugiés en raison des guerres, du terrorisme, des catastrophes naturelles, du changement climatique. C'est l'un des défis pour l'humanité, pour l'Europe spécialement, au regard des épisodes dramatiques survenus au cours des derniers mois.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'avenir dépend de nos actions du présent et des legs du passé. De ce point de vue, la crise nous a légué quatre très lourdes charges : une croissance faible ; un chômage en hausse ; l'accroissement des inégalités ; une confiance en berne, à l'égard des gouvernements, des banques, des multinationales, des organisations internationales, voire de la démocratie même. Le danger serait de laisser le cynisme l'emporter.
Force est de constater que les grands moteurs de la croissance ne fonctionnent qu'à moitié. L'investissement, autrement dit la croissance de demain, affiche un taux de croissance d'environ 4 %, alors qu'il devrait être de 6 % ou 7 %. Quant au commerce, il devrait croître deux fois plus fort que la croissance mondiale.
Pour mesurer l'effet de la crise, apparue voilà huit ans maintenant, il suffit d'observer que la croissance mondiale commence à peine à se rapprocher de son rythme traditionnel de croisière, à savoir 4 %. Avec un tel taux, il faudrait enregistrer une augmentation de 8 % du commerce mondial. Ni l'investissement, ni le commerce, ni même le crédit n'ont un rôle moteur. Rien d'étonnant alors à ce que la croissance soit si faible.
Dans les dix, vingt, trente prochaines années, voire jusqu'en 2060, si rien n'est fait, la croissance plafonnera à 2 % dans les pays de l'OCDE. Il faut de réelles réformes structurelles, c'est-à-dire, tout cela est connu, de profondes évolutions en termes d'éducation, d'innovation, de concurrence, de régulation, de flexibilité du marché du travail, etc. La fiscalité devrait favoriser l'investissement et le travail au lieu de les punir. Le système financier est également appelé à évoluer : des banques bien capitalisées, bien régulées, bien supervisées, qui prêtent, tout en faisant de l'intermédiation entre épargne et investissement, tel est l'objectif.
J'entends déjà vos remarques : il faut du temps pour mettre en oeuvre tout ce que je viens de mentionner. C'est vrai, d'où l'importance de s'atteler immédiatement à la tâche. La réforme, c'est d'abord un état d'esprit, une attitude. Peu importe qu'il faille toujours ajuster, corriger ; tout ne peut pas être parfait du premier coup. La réforme ne doit pas faire peur. Il n'y a pas de début et de fin bien déterminés. C'est un processus continu.
À cet égard, les gains de productivité vont devenir le moteur essentiel de la croissance. Par « productivité », j'entends le niveau de production atteint par un travailleur en une heure ou une journée de travail. La France se caractérise par une productivité haute mais un faible nombre d'heures travaillées.
Pour augmenter la productivité, il faut commencer par agir sur les leviers que j'ai évoqués : l'éducation, l'innovation, ce qui renvoie à l'enjeu central, celui des compétences. Il importe d'améliorer l'adéquation des compétences acquises dans le cadre de la formation initiale, continue et professionnelle avec les exigences du marché. Faire entrer l'école, l'université dans l'entreprise est l'une des solutions. L'OCDE a pu mesurer objectivement combien, dans de nombreux pays, les compétences acquises en lecture, en mathématiques, voire en informatique ne correspondaient pas aux profils des postes offerts sur le marché. Un paradoxe est apparu : d'un côté, Japonais et Coréens sont très bien formés, ont toutes les compétences nécessaires, mais n'en profitent pas ; de l'autre, Américains et Britanniques accusent un déficit en termes de compétences, qu'ils parviennent à combler grâce à un système concurrentiel qui permet d'extraire chaque petite « goutte » de compétence chez le travailleur. L'idéal serait de pouvoir combiner formation à la japonaise et système concurrentiel à l'américaine.
La France se situe plus ou moins dans la moyenne. Je le disais, la productivité y est très élevée mais le nombre d'heures travaillées, comparé à la moyenne des pays de l'OCDE qui travaillent le plus, y est inférieur de 30 % à 35 %. Naturellement, certains, à l'instar du Mexique, du Japon, travaillent beaucoup, voire trop, ce qui peut même devenir un problème comme en Corée du Sud.
Autre inquiétude, la progression très rapide, accélérée par la crise, des inégalités de revenus. Au sein de l'OCDE, les 10 % les plus riches ont un revenu d'activité 9,6 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres, alors que la proportion était de 7,1 dans les années quatre-vingt et de 9,1 dans les années deux mille. Au-delà des questions éthiques, morales, politiques que pose l'augmentation des inégalités, l'OCDE a pu mesurer combien celle-ci constituaient un frein à la croissance.
Tous ces constats devraient inciter à agir différemment pour dessiner un autre horizon de croissance à dix, vingt ou trente ans. Quel paradoxe de voir le nombre de personnes au chômage et, dans le même temps, des entreprises qui veulent embaucher mais, ne trouvant pas les compétences demandées, sont contraintes de faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère. On se rend compte à quel point on n'a pas été brillant en termes d'adéquation des compétences aux besoins de l'industrie et des services.
Par ailleurs, lorsqu'il est question de l'avenir, il est question du climat, et pas seulement du climat des affaires. Partout dans le monde, on subit déjà, au quotidien, les dommages liés au changement climatique : inondations, sécheresse, feux de forêt... Pour illustrer les enjeux liés au climat, sur lesquels les scientifiques nous alertent, je prendrai l'image d'un parking où les voitures qui y entrent sont toujours plus nombreuses que celles qui en sortent. Il arrive un moment où celui-ci est saturé. C'est le même processus avec les émissions de dioxyde de carbone. Comme il n'est pas possible de tout arrêter du jour au lendemain, il faut, de manière graduelle, parvenir à un arrêt total des émissions nettes provenant de combustibles fossiles d'ici à la fin du siècle. Cela permettra peut-être de limiter à deux degrés le réchauffement climatique.
Si rien n'est fait aujourd'hui, les conséquences seront dramatiques dans une dizaine d'années. L'OCDE a publié ce mois-ci une étude intitulée Aligner les politiques au service de la transition vers une économie bas carbone et s'apprête à en publier une autre pour en appeler à une révision des taxes sur l'énergie. Par exemple, la taxation sur le charbon est totalement disproportionnée et incohérente.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire général, de cet exposé très complet. Nous passons maintenant aux questions de nos collègues.

Monsieur le secrétaire général, je tiens d'abord à saluer la qualité des travaux menés par l'OCDE, que nous consultons avec beaucoup d'intérêt. Notre délégation s'est intéressée à la question de l'avenir des métropoles à long terme, sous l'égide de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Son rapport décrit une perspective inquiétante, notamment dans les pays du Sud que vous avez évoqués.
Ayant moi-même réalisé une étude sur les maladies infectieuses, j'ai pu constater, par exemple, que le virus Ebola s'est développé parce qu'il a rejoint la ville, une ville déstructurée, sans réseau d'assainissement ni de gestion des déchets, sans réseau de santé. On pourrait ajouter, même si ce n'est pas pertinent pour Ebola, sans réseau scolaire ni de transport.
À moyen et long termes, il est à craindre que les pays du Sud ne voient émerger nombre de très grandes métropoles, surtout en Afrique et en Asie - mais le Mexique est également concerné -, qui ne seront pas forcément bien structurées, d'où des risques accrus pour la population. Or l'aide publique au développement n'est pas à la hauteur de ce défi. Dakar, où je me suis récemment rendue, connaît une croissance de sa population de 10 % : pour l'essentiel, c'est une ville « spontanée ».
Je me réjouis de vous voir extrêmement mobilisé tant sur la question de l'ampleur de l'aide au développement que sur le problème du réchauffement climatique, qui impose la double peine aux pays du Sud. Ils en subissent les conséquences alors qu'ils n'en sont pas les auteurs. Notre regard doit évoluer : en l'espèce, ce n'est pas de l'aide, c'est une compensation normale des effets négatifs dont ces pays pâtissent en plus de difficultés déjà énormes.
Vous avez évoqué le sommet d'Addis-Abeba puis la Cop21. Quels sont les leviers à mobiliser ? Faut-il travailler sur de nouvelles ressources financières ? La taxation sur le fioul maritime et aérien, aujourd'hui inexistante, est selon moi une piste à explorer. Comment faire pour voir émerger une prise de conscience planétaire ? Le président Larcher l'a indiqué, les problèmes sont interdépendants : l'immigration, résultante de la pauvreté et de l'écart grandissant des inégalités, est au coeur de l'actualité européenne.
L'urbanisation est inévitable et, aujourd'hui, la majeure partie de l'humanité vit déjà dans les villes. Dans les pays de l'OCDE, c'est le cas de 75 % à 80 % de la population. La Chine, qui a d'ailleurs demandé notre appui, va, au cours des cinq prochaines années, voir 105 millions de ruraux - 21 millions par an ! - se déplacer vers les zones urbaines. L'enjeu dépasse largement le seul problème des maladies infectieuses, même si Ebola est toujours présent en Afrique et se propage de manière dramatique.
Vous l'avez souligné, madame la sénatrice, l'urbanisation dans les pays du Sud n'est ni coordonnée ni contrôlée, la planification y est quasi inexistante.
La réponse au problème de la pauvreté, du manque d'éducation, de santé, d'infrastructures, d'accès à l'eau, c'est précisément le développement qui l'apportera, non seulement dans les zones urbaines mais aussi dans les zones rurales. On ne devient pas moins pauvre en allant dans une ville, bien au contraire.
Quant à la taxation sur la consommation des énergies, je suis favorable à une taxe sur toutes les émissions, sans exception. À l'échelle mondiale, le transport contribue pour 23 % aux émissions de dioxyde de carbone. Il paraît illusoire de ne taxer que la production de combustibles. Les pays appliquent des taux d'imposition sur l'énergie très variables, allant d'à peine plus de zéro euro par tonne de CO2 à 107 euros en Suède. Si l'objectif est de réduire les émissions, au moins faut-il se mettre d'accord sur certaines conditions minimales.
Ainsi est-il étonnant de financer des usines à charbon, qui sont les plus polluantes. N'avons-nous pas l'objectif de réduire les émissions ? Je vous invite à lire notre rapport sur l'alignement des politiques publiques parce qu'il dit non seulement tout ce qu'il faut faire mais aussi, plus intéressant encore, tout ce qu'il ne faut pas continuer à faire.
Faire accepter le changement est politiquement difficile. C'est l'un des défis du sommet d'Addis-Abeba sur le financement du développement. Il faut aller au-delà d'une simple aide, comme vous-même l'avez suggéré.

Je souhaite compléter les observations de Fabienne Keller car j'ai participé à l'atelier de prospective sur le thème des maladies infectieuses émergentes, que la délégation a organisé le 9 avril dernier. Au cours des échanges, a été évoquée l'urbanisation anarchique, spontanée, sans structuration. Certains acteurs de santé publique ont souligné qu'elle était aggravée par une perte de confiance, conséquence d'une désinstitutionnalisation liée à la fois à la crise et à la décolonisation. Il n'y a plus, sur place, les outils de confiance pour mener des actions de manière coordonnée. Si les maladies s'arrêtaient auparavant aux portes des villes, c'est parce qu'il y avait des autorités institutionnelles, sanitaires suffisamment organisées pour y veiller.
La fragilité de certains pays, faute d'institutions dignes de confiance, ne leur permet pas de s'inscrire dans cet objectif de développement et de faire face à une pauvreté galopante.
Pis encore, madame la sénatrice, si nous considérons que, dans le domaine des maladies infectieuses, nombre d'entre elles sont non pas émergentes mais réémergentes, avec des caractéristiques génétiques différentes, contre lesquelles on ne trouve pas de vaccins.
Les laboratoires ne sont pas prêts à investir des centaines de millions d'euros pour développer un vaccin contre une maladie qui ne touche que de petits groupes isolés. Or on ne peut pas utiliser d'anciens médicaments pour traiter de nouvelles maladies. Voilà qui s'ajoute à la problématique du manque de confiance envers les institutions et des effets de la décolonisation. La crise de confiance envers les institutions n'est pas un phénomène nouveau dans les pays en développement. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'elle s'étend désormais aux pays développés, qui ne sont plus en capacité d'offrir des emplois à tous.
Nous assistons à un changement de stratégie s'agissant de l'aide au développement. Les nouveaux objectifs de développement durable qui seront approuvés par l'ONU auront cet intérêt de fixer des obligations non seulement pour les pays les plus pauvres, mais également pour les pays les plus riches. Beaucoup plus universels que les OMD, ils constitueront un vrai agenda pour le développement.

Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé des legs de la crise, ce qui laisse entendre que, pour vous, elle est terminée et vraiment derrière nous. D'ailleurs, cette crise, personne ne l'avait vue venir et surtout pas nos grands spéculateurs et autres experts, qui pensaient la chose tout à fait impossible.
Pour ma part, quand je vois la spéculation repartir de plus belle, les émissions de monnaie à un niveau jamais atteint et que l'on nous dit qu'il y a peut-être un peu moins de créances douteuses, je me demande si nous sommes complètement sortis d'affaire. Ne sommes-nous pas à la merci d'une autre crise bancaire, qui, cette fois, serait doublée d'une crise sociale et politique ? Ce n'est tout de même pas pareil d'affronter une crise quand tout le monde a l'impression que tout va bien ou quand on est « à l'os » et que le moral est au plus bas.
Suis-je trop pessimiste ou n'y a-t-il pas un risque ?
Le risque est là, mais nous avons beaucoup appris de la dernière crise, surtout en ce qui concerne la gestion du système financier, lequel est d'ores et déjà, en moyenne, dix fois mieux capitalisé qu'avant. Les dépôts sont maintenant garantis jusqu'à 100 000 euros. Le système est donc mieux préparé, la probabilité d'un incident réduite. Nous devons cependant faire face à trois nouveaux défis.
Premier défi, l'apparition de bulles du crédit aux particuliers dans certains pays. C'est le cas, par exemple, aux Pays-Bas, où l'augmentation des prêts hypothécaires pose un problème. La Hongrie a également été touchée car nombre de crédits immobiliers y sont contractés en franc suisse, dont la déliaison par rapport à l'euro a entraîné une dévaluation du forint et une hausse des créances de 20 %. Au final, un certain nombre de personnes ont vu leurs mensualités augmenter de 30 % à 40 % alors que le bien immobilier qu'elles ont acheté ne prenait aucune valeur. Le gouvernement a dû intervenir pour protéger les familles affectées.
Deuxième défi : alors que nos pays connaissent un sous-investissement palpable en raison de l'incertitude sur l'avenir et du manque de clarté en termes de régulations, les pays en développement affrontent, eux, un problème de surinvestissement, à l'origine de surcapacités dans de nombreux secteurs, d'où une chute des rendements. Cela risque de provoquer des krachs ou des banqueroutes de certaines entreprises importantes dans ces pays.
La crise n'est donc pas terminée. Ses dernières manifestations se sont déplacées des pays développés, où elle a commencé, aux pays en voie de développement. Nous devons être vigilants.
Troisième défi : le taux d'intérêt à zéro. Prenons l'exemple d'une compagnie d'assurance ou d'un fonds de pension de retraite qui voient arriver à échéance des obligations acquises à 5 % ou 6 % voilà dix ans. Les obligations émises par le Trésor français n'étant pas suffisamment rémunératrices, ils cherchent des opportunités ailleurs, avec des rendements supérieurs, donc une plus grosse prise de risques.
Ils se tournent alors vers les pays en développement. Naturellement, le prêt à taux zéro semble attirer de nombreux foyers et entreprises. Problème : seront-ils assez disciplinés pour contrôler leurs finances ?

Le chômage de masse est une réalité en France, où il touche 3,5 millions de personnes. À vous entendre, monsieur le secrétaire général, l'une des difficultés serait l'insuffisance des heures travaillées. Raisonnez-vous par salarié ou au niveau global, auquel cas, s'il y avait moins de chômeurs, il y aurait plus d'heures travaillées et donc plus de richesses créées en France ?
Par ailleurs, dans tous les pays de l'OCDE, la révolution numérique est en train de détruire de nombreux emplois, des millions même si l'on en croit une étude britannique. L'OCDE a-t-elle engagé une réflexion sur le sujet ? Quelles sont les conséquences réelles de la révolution numérique sur les emplois d'aujourd'hui ? Comment mieux anticiper pour accélérer la création de nouveaux emplois en vue de compenser les emplois détruits, voire aller au-delà et lutter contre ce chômage de masse qui plombe véritablement l'économie française ?
Monsieur le sénateur, le niveau de rémunération d'un travailleur dépend de sa productivité. Un problème apparaît, qui peut devenir insoutenable à terme, quand cette dernière se met à stagner ou même baisser et que, dans le même temps, le salaire continue à augmenter. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce, en Italie, en Espagne et en France. Ce phénomène est bien antérieur à la crise.
Il arrive un moment où les pays concernés doivent reconnaître la réalité et s'ajuster. Auparavant, ils le faisaient au travers de leur monnaie. Maintenant que l'euro est la monnaie commune, toute dévaluation est impossible. L'ajustement ne peut se faire que par les salaires ou une hausse de la productivité. Le coût salarial unitaire rapporte le coût horaire de la main-d'oeuvre à la productivité horaire du travail.
Le problème de la France, c'est qu'elle a déjà perdu en productivité totale et qu'elle commence à perdre en compétitivité à l'exportation. Et ce alors même que, je le répète, la productivité par salarié est élevée : le paradoxe est là, car c'est plus difficile d'obtenir une productivité plus élevée que de travailler une heure de plus chaque jour.
La haute productivité, en France, c'est culturel, ce sont des compétences. Mais le budget de 32 milliards d'euros que vous consacrez aux différents systèmes d'aide au travail dans le cadre de la formation professionnelle sont-ils bien utilisés et répondent-ils aux souhaits des employeurs et des marchés ? La réponse est non. La bonne nouvelle, c'est que vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin d'en chercher : il faut simplement mieux l'utiliser.
J'en viens au numérique. Son développement menace, selon les pays, entre 20 % et 40 % des emplois, surtout ceux des niveaux inférieurs. La menace sur les emplois les moins qualifiés est réelle et grandit de jour en jour. Cette proportion s'accroît avec le temps. La réponse tient en trois mots : compétences, compétences, compétences. Il faut agir non seulement sur le niveau mais aussi sur la portabilité des compétences d'un poste à l'autre, donc raisonner en termes d'employabilité et non plus d'emploi.
Le numérique, c'est aussi une promesse, une source de développement, un moyen de promouvoir l'éducation, de faciliter, dans les zones plus éloignées, l'accès à l'information, voire aux soins. De toute façon, il s'agit d'une évolution inévitable : soit vous prenez le train en marche, soit vous restez sur le quai.

Je remercie le président de la délégation à la prospective de m'avoir convié à cette audition.
Monsieur le secrétaire général, je souhaite vous interroger sur la fiscalité. La France perçoit le double de recettes fiscales par habitant que la moyenne de l'OCDE. De nombreux travaux sont menés actuellement sur les érosions de recettes fiscales, les coûts de transfert, les moyens d'éviter la fraude fiscale.
L'OCDE travaille-t-elle sur la question plus spécifique de l'érosion des recettes de TVA ? La commission des finances s'y intéresse beaucoup, car on constate en ce domaine une très forte érosion, liée notamment à la révolution numérique et au développement du commerce électronique.
Je remercie Elsa Pilichowski, qui m'accompagne, d'avoir préparé une note à ce sujet. L'OCDE est au coeur de la lutte contre l'évasion fiscale et joue un rôle pivot. L'une des solutions réside dans la création d'une nouvelle norme internationale sur l'échange de renseignements automatique à des fins fiscales. C'est une énorme révolution. Les banques de Turquie, du Mexique ou des îles Caïman, pour prendre ces exemples, seront dans l'obligation d'informer leurs autorités de toute création de compte, lesquelles autorités informeront à leur tour leurs homologues des pays concernés. Les pays estiment avoir d'ores et déjà collecté plus de 37 milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce à ces programmes de déclaration spontanée.
Il y a un second volet : grâce aux systèmes d'optimisation fiscale, un certain nombre de multinationales ne paient pas d'impôt ni dans leur pays d'origine ni dans le pays dans lequel elles opèrent. C'est une autre bataille que nous sommes en train de mener.
Le 1er octobre prochain se réunira, à Lima, le G20 des ministres des finances. Puis ce sera au tour des chefs d'État et de gouvernement de se retrouver à Antalya en novembre pour lancer le plan d'action en vue d'enrayer l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). L'OCDE a identifié quinze aspects spécifiques des règles fiscales internationales qui devront faire l'objet de mesures d'ici à la fin de 2015. La mise en oeuvre du plan d'action BEPS conduira à modifier le réseau actuel de conventions fiscales bilatérales en vigueur à travers le monde, constitué de plus de trois mille accords. L'instrument multilatéral qui doit être rédigé constituera un outil unique grâce auquel les États conduiront une mise à jour rapide et cohérente de leur réseau de conventions fiscales.
Nous travaillons également sur la question des prix de transfert, autre domaine qui pourrait faire l'objet d'une révolution fiscale, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée. Nous sommes particulièrement vigilants par rapport à ce que l'on appelle la fraude carrousel. C'est une fraude très typique, bien connue, qui consiste à obtenir le remboursement d'une taxe jamais acquittée en amont. Là aussi, le système d'échange d'informations renforce nos moyens de lutte.
Dans le domaine de l'ingénierie fiscale, la créativité des criminels est incroyable, sans limite. Il faut sans cesse avancer pour continuer à lutter contre la fraude.

Le secrétaire général de l'OCDE que vous êtes a forcément un avis sur les incidences, pour l'Europe et pour la France, d'une sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro.
Monsieur le sénateur, ma réponse est simple : la Grèce ne va pas sortir de la zone euro !
Dès 2010, je recommandais de procéder à une restructuration de la dette grecque quand elle était intégralement d'origine privée, comme cela s'était fait pour d'autres pays, le Mexique notamment, qui avait ainsi vu sa dette réduite de 35 %. C'était le moment de restructurer les obligations, ce qui, avec une garantie même partielle de l'Union européenne, aurait permis de diminuer de moitié la dette grecque.
Un autre choix a été fait, celui d'épargner les banques européennes, en mauvaise posture à l'époque. Nul doute que les ministres des finances ont agi en toute responsabilité à l'égard de leur propre système financier. Ce fut un choix politique, un choix de politique, un choix respectable, mais dont les conséquences étaient prévisibles. Maintenant, il faut vivre avec.
Il n'y aura pas de Grexit parce que les conséquences sont imprévisibles. Les solutions, elles, sont connues, tout comme leur coût. À l'instar du changement climatique, on sait que les solutions seront toujours moins chères que le coût de l'inaction. Quand on veut trouver une solution - et c'est le cas -, on y parvient toujours.
Voilà trois mois, les Grecs étaient dans la rue pour crier leur ras-le-bol de l'austérité et de la dette. Ils ont porté au pouvoir M. Tsípras, dont le gouvernement a obtenu la confiance du Parlement grec le 11 février dernier. Le 12 mars, l'OCDE a reçu M. Tsípras pour connaître sa vision de la situation. En un mois, c'était un tout autre homme, et il n'a eu de cesse d'évoluer depuis. Lui et ses ministres ont multiplié les rencontres avec Mme Merkel, M. Hollande, M. Draghi, le FMI. Ils ont alors pu se rendre compte des contraintes légales pesant sur les institutions financières européennes et internationales. Prendre en considération les contraintes de l'autre est un premier pas pour trouver une solution.
Nous sommes sur le bon chemin et je reste optimiste. Compte tenu des échéances à venir, il faut introduire une certaine souplesse pour éviter un avenir d'incertitudes. Ce rôle revient aux leaders politiques, certainement pas aux négociateurs du FMI ou de la BCE.

Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de tous ces éclaircissements et de l'ouverture d'esprit que nous donnent vos analyses et vos observations.

Mes chers collègues, à la suite de décisions du Conseil constitutionnel en date du 11 juin dernier, la délégation a perdu deux de ses membres, Jean-Patrick Courtois et Aymeri de Montesquiou. Je vous informe que le groupe Les Républicains présentera la candidature d'Alain Vasselle et que nous attendons la proposition du groupe UDI-UC.
Par ailleurs, il nous faut aujourd'hui valider l'étude de faisabilité du rapport consacré à la prospective de l'eau.
Les rapporteurs, Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach, ont déjà procédé à plusieurs auditions pour « border » leur futur rapport et ont établi le projet de budget que je vous propose d'adopter. Outre un programme d'auditions classiques, ils iront visiter deux agences de l'eau : celle d'Adour-Garonne et celle de Seine-Normandie. Ils se rendront évidemment à Bruxelles, qui est désormais un point de passage obligé pour l'établissement de tous nos rapports, ainsi qu'à Barcelone, qui constitue un exemple éclairant pour le retraitement des eaux usées et la désalinisation de l'eau de mer. Le budget total prévisionnel s'élève à 23 260 euros.
Personne ne demandant la parole, je soumets l'étude de faisabilité au vote.
La délégation approuve l'étude de faisabilité.