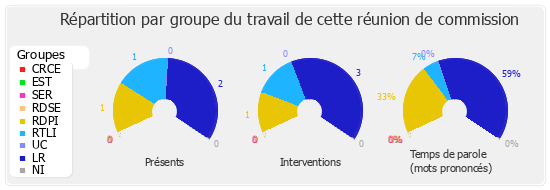Commission des affaires européennes
Réunion du 1er juillet 2014 à 15h00
Sommaire
La réunion

Le Gouvernement nous saisit en urgence d'un texte qui nous a été transmis la semaine dernière et qui doit être adopté dès demain en Conseil.
Il s'agit d'une proposition de règlement modifiant les possibilités de pêche de certains stocks de poissons par les navires de l'Union européenne pour l'année 2014. Ce texte concerne principalement le quota de pêche applicable au capelan du Groenland, qui s'établit à environ 8% de la quantité maximale de capture autorisée pour l'espèce dans cette zone de pêche. Le Danemark est le principal État intéressé dans cette pêcherie.
La saison de pêche du capelan est très brève et se concentre en juin et juillet, ce qui explique cette procédure d'examen en urgence. Le Gouvernement nous indique qu'il n'a pas de difficulté avec ce texte. Dans ces conditions, je crois que nous pouvons lever la réserve du Sénat.
Il en est ainsi décidé.

Indépendant depuis 2006, le Monténégro s'est vu reconnaître le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne en décembre 2010. Les négociations se sont ouvertes un an et demi plus tard et mettent en avant conformément à la nouvelle approche promue par l'Union européenne les questions relatives à l'État de droit et au fonctionnement de la justice. Si le Monténégro a été relativement épargné par les guerres de sécession qui ont déchiré l'ancienne Yougoslavie au cours des années quatre-vingt-dix, il reste aux plans juridique et économique un pays en transition vers les standards européens. S'il donne l'image d'un pays résolument tourné vers un avenir euro-atlantique, celui-ci suscite encore des réserves au sein de l'opinion publique qui semble crispée sur la question de son identité, huit ans après la séparation d'avec la Serbie.
La question de l'adhésion à l'Union européenne mais aussi à l'OTAN n'est par ailleurs pas anodine au sein d'un pays dont le premier partenaire économique reste la Russie. La crise ukrainienne a de surcroît des conséquences directes sur la scène politique monténégrine alors que le gouvernement a opté pour un discours de fermeté à l'égard de Moscou.
C'est à l'aune de ces événements, que je me suis rendu au Monténégro du 27 au 30 mai dernier, à l'invitation de mon homologue du Parlement monténégrin. La présidence de la commission de l'intégration européenne a été attribuée à un parlementaire issu de l'opposition, afin de souligner combien la perspective de l'adhésion était soutenue par toutes les formations politiques du pays. L'opposition est par ailleurs en large partie pro-serbe.
Les autorités monténégrines ont fait de l'adhésion à l'OTAN la priorité de leur politique étrangère, considérant cette intégration comme la première étape en vue de rejoindre l'Union européenne. Elle est, selon elles, avant tout censée permettre de stabiliser la région. Le gouvernement monténégrin met régulièrement en avant le rôle de facilitateur que joue le pays dans un environnement régional complexe mais au sein duquel il n'a aucun contentieux avec ses voisins. L'intégration au sein des structures atlantiques doit dans ces conditions conforter cette position. La volonté d'adhérer à l'OTAN n'est pas non plus dénuée d'objectifs économiques. Ses promoteurs estiment que l'intégration renforcerait la crédibilité du pays et attirerait ainsi de nouveaux investisseurs.
L'engagement militaire du Monténégro est par ailleurs indéniable tant au titre des opérations menées par l'OTAN que celles supportées par l'Union européenne. Le parlement monténégrin a ainsi voté un texte autorisant l'envoi de soldats au Mali et en République centrafricaine. Le Président du Sénat a reçu le 24 juin son homologue du Parlement monténégrin, M. Krivokapic, en visite en France et dans d'autres pays pour défendre cette candidature.
La démarche atlantique reçoit un accueil mitigé auprès de la population. Ainsi, une enquête d'opinion réalisée en mars 2014 soulignait que 46 % de la population était favorable à une intégration au sein des structures atlantiques, contre 31 % un an plus tôt. 30 % de la population affiche dans cette même enquête une opposition irréductible. Ce qui reflète à peu près le clivage politique au sein du pays. La question de l'adhésion a d'ailleurs été l'un des thèmes de campagne du scrutin municipal du 25 mai 2014. Certains partis pro-serbes, des associations issues de la société civile, l'église orthodoxe serbe et quelques médias affichent ouvertement leur hostilité à cette intégration. Le souvenir du bombardement meurtrier des Alliés au nord du pays lors des opérations au Kosovo en 1999 est régulièrement avancé, le risque de tensions avec la Russie également. Une adhésion à l'OTAN pourrait être considérée comme une nouvelle provocation par Moscou. Cette perspective pourrait inciter les Alliés à reporter cette intégration tant que la crise russo-ukrainienne n'est pas réglée, au risque de décrédibiliser les autorités monténégrines sur la scène intérieure. Les États membres attendent par ailleurs des progrès tangibles dans quatre domaines : services de renseignements, État de droit, réforme de la justice et réforme de la défense. Le gouvernement monténégrin espère néanmoins qu'une invitation à adhérer à l'OTAN pourra lui être adressée à l'occasion du sommet de l'Alliance atlantique organisé à Cardiff les 4 et 5 septembre prochains.
Venons-en maintenant à la deuxième étape du projet euro-atlantique du Monténégro, l'adhésion à l'Union européenne.
Le Monténégro a signé un accord de stabilisation et d'association (ASA) avec l'Union européenne dès le 15 octobre 2007, soit à peine plus d'un an après son accession à l'indépendance. Cette signature rapide n'est pas étonnante compte tenu du fait qu'alors qu'il était uni avec la Serbie, le Monténégro s'inscrivait dans la dynamique lancée par l'Union à destination de la région suite au Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000. Les pays des Balkans occidentaux y ont notamment obtenu le statut officieux de « candidats potentiels ».
Après l'entrée en vigueur de l'ASA le 1er mai 2010, le Monténégro s'est vu reconnaître le statut de candidat le 17 décembre 2010. L'ouverture des négociations d'adhésion a été autorisée par le Conseil le 26 juin 2012, six mois après un rapport positif de la Commission.
Les négociations portent pour l'heure principalement sur les chapitres 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) et 24 (Justice et droits fondamentaux), ouverts le 18 décembre 2013. La priorité accordée aux questions ayant trait à l'État de droit est conforme à la nouvelle approche des négociations d'adhésion validée en décembre 2011 par le Conseil.
Le rapport de progrès 2013 présenté par la Commission en octobre dernier insiste sur la réforme de l'administration afin de pouvoir mettre en oeuvre les chapitres 23 et 24. Celle-ci doit déboucher sur une dépolitisation effective et une professionnalisation de la fonction publique. La Commission juge ainsi préoccupante l'existence de lettres de démission non datées. Plus largement, le Monténégro est fragilisé par la faiblesse de ses capacités administratives. La fonction publique d'État comprend dans un pays composé de 620 000 habitants, 10 000 agents dont 5 000 sont employés dans la police et dans l'armée. Ce chiffre reste trop faible au regard de l'ampleur du chantier de l'adaptation de la législation monténégrine à l'acquis communautaire. Le gouvernement a ainsi mis en place une stratégie d'adaptation de la législation à l'acquis communautaire prévue pour la période 2014-2019. Le programme d'accession envisage sur cette période l'adoption de 228 lois et de 845 décrets.
Le vote par le Parlement monténégrin des amendements constitutionnels sur l'indépendance de la justice, le 31 juillet 2013, constitue néanmoins un gage de bonne volonté. Une telle révision était bloquée depuis deux ans en raison de l'opposition des formations pro-serbes. Ces textes répondent aux observations en la matière de la commission pour la démocratie par le droit du Conseil de l'Europe, dite commission de Venise.
Il s'agit désormais d'appliquer concrètement les orientations des plans d'action, ce qui peut apparaître pour l'instant délicat faute de ressources administratives adéquates ou d'accord politique. La réforme judiciaire n'est ainsi pas encore totalement mise en oeuvre en l'absence de vote au parlement sur la nomination du procureur général d'État. Une majorité qualifiée est nécessaire pour sa désignation (deux tiers aux deux premiers tours puis trois cinquièmes au troisième tour). Si l'essentiel du cadre législatif semble adapté aux exigences européennes, l'absence de résultat concret tend à inquiéter, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption de haut niveau. L'annulation d'un jugement concernant une affaire immobilière impliquant la mairie de Budva et le demi-frère du vice-président du premier parti du Monténégro, le DPS, et d'un autre arrêt visant une affaire de blanchiment d'argent lié à un trafic de drogue ont pu apparaître comme de mauvais signaux. Deux angles permettent d'appréhender de telles décisions. Le premier tient à la corruption possible d'une partie de l'appareil judiciaire. Le deuxième est structurel et tient à la qualité de la formation des juges. La mise en place récente d'une académie ne règle pas, en effet, tous les problèmes.
La clôture des chapitres 23 et 24 est soumise à la validation de 83 critères intermédiaires, soit autant que ceux auxquels a dû satisfaire la Croatie pour l'ensemble des chapitres des négociations. Ce souci du détail ne constitue pas un traitement particulier destiné au seul Monténégro. Les négociations qui viennent de s'ouvrir avec la Serbie répondent aux mêmes exigences. Il s'agit surtout pour l'Union européenne, instruit des cas bulgare et roumain, d'éviter l'adhésion d'un État encore en décalage avec les pratiques de ses partenaires et la mise en place ensuite d'un mécanisme de coopération et de vérification, d'autant plus vexant pour le nouvel adhérent et in fine moins efficace.
Au-delà de la question judiciaire, la Commission s'interroge sur la situation macro-économique à court terme, qu'il s'agisse du déficit public, des aides publiques, des créances douteuses ou de la situation de la principale usine du pays, KAP, qui produit de l'aluminium. Le rapport de progrès insiste sur la nécessité pour le pays de ne pas uniquement s'appuyer sur le tourisme et l'immobilier, qui ont tiré la croissance en 2013, pour alimenter son développement. La reprise de l'acquis communautaire dans le domaine économique demeure, par ailleurs, assez lente.
Plus largement, il est possible de s'interroger sur les liens économiques entre l'Union européenne et le Monténégro. La relance des investissements dans le pays est en effet le fruit d'un rapprochement avec une entreprise chinoise en ce qui concerne le projet d'autoroute ou avec des sociétés égyptienne, azérie ou canadienne en matière de tourisme. Comme je vous l'ai indiqué, la Russie constitue par ailleurs le principal partenaire commercial du pays. En dépit de l'ouverture des négociations, la tendance ne semble pas favorable : les échanges commerciaux avec l'Union européenne ne représentaient que 36,8 % en 2012 contre 41,3 % en 2011 et se concentrent sur la Grèce, la Hongrie et l'Italie.
L'adhésion rencontre cependant un large consensus au sein de la population monténégrine selon les enquêtes d'opinion. Reste que compte tenu des conséquences de la crise économique, les Monténégrins attendent des résultats à court terme, ce qui peut paraître en décalage avec la longueur attendue des négociations d'adhésion. L'ambition affichée par les autorités monténégrines consiste en une adhésion dès 2020, ce qui supposerait une fin des négociations courant 2018. Le Monténégro souhaite pouvoir bénéficier dès 2021 du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Au regard des réformes à mener et des défis auxquels est confronté le Monténégro, ce souhait peut apparaître un peu présomptueux.
Aux faiblesses structurelles que je viens de décrire s'ajoute également le poids de l'histoire. Le pays semble toujours en transition, ayant subi deux dissolutions en 16 ans, celle de la Yougoslavie puis celle de l'Union de Serbie et Monténégro. Cet état de fait contraste avec un discours résolument ambitieux et optimiste au terme duquel le Monténégro serait en avance sur la plupart des pays candidats des Balkans occidentaux. Cet avantage est indéniable en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Il l'est beaucoup moins à l'égard de la Serbie, pour lequel les négociations viennent à peine de s'ouvrir mais qui semble progresser rapidement.
Nous avons toujours au sein de notre commission effectué un suivi attentif à l'égard des pays issus de l'ex-Yougoslavie. Ce fut le cas en son temps avec la Slovénie et la Croatie et plus récemment avec la Serbie où une délégation s'est rendue en novembre 2013. Il s'agit là d'anticiper une probable adhésion en nouant des relations avec ceux avec qui nous allons être appelés à travailler dans les prochaines années et les aider à s'adapter aux exigences européennes. Pour le Monténégro, il s'agit d'un défi de taille, compte tenu de la taille du pays. Le Président Krivokapic rappelait la semaine dernière qu'il existait bien une tradition étatique au Monténégro, liée à son passé d'État indépendant résistant à l'Empire Ottoman au dix-neuvième siècle, mais pas de véritable tradition démocratique. C'est sur cette voie-là qu'il convient notamment de les aider.

L'élargissement met constamment en lumière le décalage entre la lourdeur des procédures d'adhésion, leur technicité et leur longueur et l'absence de réelle formation des cadres des pays qui sont censés adapter l'acquis communautaire. L'Union européenne devrait participer à la formation des élites locales ! Vous concluez sur l'absence de tradition démocratique au Monténégro. Je remarque que ce constat s'applique à la plupart des pays d'Europe de l'Est. Le même modèle semble se reproduire : à l'effondrement des régimes communistes et à une certaine tradition administrative succède une pratique du pouvoir de type oligarchique pour ne pas dire mafieuse, conduite par d'anciens cadres des partis uniques, enrichis par les vagues de privatisation et porte-voix de l'ultra-libéralisme. Ce fut notamment le cas en République tchèque.
Le problème de la taille du pays n'est également pas anodin. Dans un autre ordre d'idée, le Groenland est appelé à négocier avec l'Union européenne et d'autres partenaires économiques pour la gestion d'importants contrats miniers. Sur 57 000 habitants, seuls 500 ont accompli des études supérieures. Ce qui n'est pas sans poser problème dès lors qu'il s'agit de faire émerger une élite apte à étudier ces contrats.
Je dirai également un mot sur l'adaptation de l'acquis communautaire. Oui l'Union européenne favorise la consolidation de l'État de droit chez les pays candidats. Vous avez parlé des amendements constitutionnels récemment adoptés en ce sens au Monténégro. Cela va effectivement dans le bon sens. Mais la question de la mise en pratique de celle-ci demeure. Et celle-ci ne pourra être assurée que par une élite formée. Or cet apprentissage prend du temps, une à deux générations.
Je m'interroge enfin sur le poids d'un si petit État appelé après son adhésion à exercer des responsabilités au sein du Conseil.

Comme vous l'avez dit dans le rapport, l'adhésion est in fine logique dès lors que le Monténégro satisfait à tous les critères. Je suis tout de même étonnée par l'utilisation depuis 2002 de l'euro comme monnaie ! Le parallèle avec les micro-États comme Andorre ne me semble pas opportun tant leurs situations diffèrent de celle du Monténégro.

Je suis assez gêné devant ces micro-États appelés à intégrer l'Union européenne. Micro-États en raison de leur population : 620 000 habitants c'est la moitié de la population de la communauté urbaine de Lille, par leur superficie, ou par leur budget. Le PIB monténégrin équivaut au tiers de l'amende qui vient d'être infligée au groupe BNP Paribas ! L'adhésion risque in fine de déséquilibrer un système déjà fragile.

Regardons près de nous le Luxembourg pour voir que la taille d'un pays importe peu ! Je vois plutôt d'un bon oeil l'adhésion de ces États à l'Union européenne. N'oublions pas que les négociations d'adhésion permettent de tirer vers le haut ces pays, en les poussant à se mettre en conformité avec les procédures et les usages au sein de l'Union européenne. J'espère que cela sera notamment le cas pour prévenir les phénomènes de corruption constatés dans ce pays. J'ai rencontré récemment des parlementaires monténégrins dans le cadre d'un séminaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Tous me disaient combien la perspective d'adhésion à l'Union européenne permettait de faire passer des réformes qui n'auraient pu aboutir dans un autre contexte.
Un mot sur l'OTAN tant il m'apparaît indispensable de ne pas faire vivre au Monténégro ce qu'a connu récemment la Géorgie. Ce petit pays, qui est un des premiers contributeurs à l'effort de guerre en Afghanistan, s'est vu refuser l'adhésion alors qu'elle lui est promise depuis le sommet de Bucarest en 2008. Il s'agit d'un signal négatif adressé à Tbilissi mais aussi aux autres candidats.

Je partage les inquiétudes d'André Gattolin sur la formation des élites dans ces petits États. Mon département, le Gard, compte 100 000 habitants de plus que le Monténégro ! Je n'imagine pas que puissent lui être attribuées des fonctions régaliennes et qu'il soit appelé à intégrer l'Union européenne ! Reste néanmoins une vocation pour tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie à intégrer l'Union européenne, qui ont tant de valeurs en partage et une langue commune qui les relie, même si je peux comprendre les réserves de Jean-René Lecerf. On peut effectivement être surpris par l'utilisation de l'euro. L'explication qui m'a été donnée est que l'euro a succédé au Deutsche Mark qui était très utilisé en raison de la forte fréquentation de touristes allemands. Nous devons, je le répète, nouer des contacts réguliers avec les autorités de ces pays qui siègent déjà en tant que pays candidats dans certaines réunions européennes, à l'image de la COSAC, et qui seront nos futurs partenaires.
À l'issue de ce débat, la commission a autorisé, à l'unanimité, la publication du rapport.

Je vous ai présenté l'an dernier le fonctionnement et les activités de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée au sein de laquelle je représente le Sénat depuis bientôt trois ans. La France dispose de trois sièges au sein de cette Assemblée, dont deux sont occupés par des députés. A l'occasion de la présentation de mon rapport sur la Jordanie, je vous avais fait état des travaux de la commission environnement dont je suis membre et qui accompagne les projets de canal Mer rouge - Mer morte et Desertec. La réunion à Barcelone de cette commission les 12 et 13 juin derniers a été l'occasion de m'entretenir avec M. Fathallah Sijilmassi, le secrétaire général de l'UpM, dont les locaux sont situés dans la capitale catalane.
Il s'agissait, notamment, de lui présenter les travaux de notre commission sur les questions euro-méditerranéennes, qu'il s'agisse du rapport que nous avons publié avec Bernadette Bourzai, Catherine Morin-Desailly et Jean-François Humbert sur l'avenir de la politique méditerranéenne de l'Union européenne après le printemps arabe, au travers des cas du Maroc et de la Tunisie, ou celui présenté il y a quelques semaines sur le statut avancé de la Jordanie auprès de l'Union européenne.
Ces deux documents insistaient sur la nécessité de renforcer le lien entre l'Union européenne et les pays de la rive Sud de la Méditerranée. Nous avions souligné la nécessité de valoriser une logique de projets, destinés à consolider les valeurs démocratiques qui ont pu émerger dans la foulée du printemps arabe - ou un peu avant en ce qui concerne le Maroc - mais aussi à créer les conditions d'un développement économique durable.
Cette ambition économique et sociale est au coeur des missions de l'Union pour la Méditerranée, qui réunit les 28 États membres de l'Union européenne et 15 pays du bassin méditerranéen. Créée sous la présidence française de l'Union européenne le 13 juillet 2008, elle était initialement destinée à relancer les relations entre les États membres de l'Union européenne et leurs partenaires méditerranéens. Elle s'inscrit dans la lignée du processus de Barcelone. L'ambition affichée à l'époque consistait en la mise en place de nouveaux projets régionaux et sous-régionaux, présentant un véritable intérêt pour la population du bassin méditerranéen. Ces projets portent sur des domaines tels que l'économie, l'environnement, l'énergie, la santé, la migration et la culture.
Six priorités avaient alors été définies :
- dépolluer la Méditerranée ;
- mettre en place des autoroutes maritimes et terrestres qui relient les ports et améliorent les liaisons ferroviaires en vue de faciliter la circulation des personnes et des biens ;
- assurer la sécurité civile des populations ;
- développer un plan solaire méditerranéen qui explore les possibilités de développer des sources d'énergie alternatives dans la région. C'est ainsi que l'UpM a apporté son soutien au projet Desertec, qui prévoit l'exploitation du potentiel énergétique des déserts. Je vous avais présenté les contours de ce dispositif à mon retour de Jordanie ;
- créer une université euro-méditerranéenne (EMUNI) dont le siège est situé en Slovénie. L'ouverture, en septembre 2015, de l'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) viendra compléter ce dispositif. Elle se concentrera sur les questions euro-méditerranéennes et accueillera 6 000 étudiants ;
- favoriser le développement des petites et moyennes entreprises en évaluant dans un premier temps leurs besoins, puis en leur offrant une assistance technique et un accès au financement.
Cette logique de projet devrait commencer à porter ses fruits en 2015 avec la livraison de l'autoroute transmaghrébine, dont le coût est estimé à 670 millions d'euros. Elle traversera la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Elle est composée d'un axe atlantique de Nouakchott à Rabat et d'un axe méditerranéen de Rabat à Tripoli passant par Alger et Tunis. 55 villes sont concernées par le tracé, soit 50 millions de personnes. Combiné à l'axe autoroutier Rabat-Tanger, la Transmaghrébine devrait faciliter les échanges avec le continent européen. Deux tronçons restent à livrer, il s'agit des plus délicats puisqu'ils doivent permettre de relier le Maroc et l'Algérie, alors que la frontière entre ces deux pays est toujours fermée, ainsi que l'Algérie et la Tunisie. Le drame de cette région tient d'ailleurs à l'absence d'unité du Maghreb. Un renforcement de la coopération entre ces pays pourrait contribuer à la croissance de leurs produits intérieurs bruts respectifs d'un à deux points.
La construction d'un réseau ferroviaire jordanien aboutira de son côté en 2017. Il permettra de connecter le Royaume hachémite au réseau turc et donc à l'Europe. L'usine de dessalement de Gaza devrait, quant à elle, être opérationnelle en 2017. 55 millions de mètres cube d'eau seront ainsi traités afin de pallier à la pénurie qui affecte la région. Le coût du chantier est estimé à 310 millions d'euros.
La lutte contre la pollution passe par un soutien au programme de protection du Lac de Bizerte, au Nord de la Tunisie.
La dimension sociale n'est pas non plus absente des activités de l'UpM, à l'image de nombreux programmes en faveur de la défense des droits des femmes. Le dernier projet labellisé par l'UpM, le 3 juin dernier, concerne un projet de développement urbain au Caire, en Égypte, sur le site de l'ancien aéroport d'Imbaba. Il s'agit de fournir à 700 000 habitants les services et infrastructures de base nécessaires : installations médicales, écoles, parcs de loisirs, équipements sportifs, etc. Le projet fait partie des 12 projets sélectionnés par l'Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI). Celle-ci est gérée par l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement en liaison avec le Commission européenne et dans le cadre du Secrétariat de l'UpM. La banque allemande KFW, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont aussi associées.
Je tiens en effet à préciser que l'action de l'UpM n'est pas celle d'un bailleur de fonds. Elle ne dispose pas à cet égard des crédits ou des effectifs suffisants pour répondre à une telle ambition. Soixante personnes travaillent à son service à Barcelone, qu'il s'agisse de diplomates, d'ingénieurs, de chefs de projets ou de correspondants des bailleurs de fonds internationaux. L'UpM labellise les projets répondant à ses priorités pour qu'ils puissent bénéficier de financements adéquats. Elle participe à cet effet à l'élaboration de l'étude de faisabilité de chacun de ces chantiers. Elle les présente devant la Commission européenne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement ou toute autre organisation internationale qui pourront, quant à elles, accorder les crédits adaptés.
Au regard de l'état d'avancement des chantiers que je viens de décrire, le bilan de l'UpM six ans après son lancement peut apparaître positif. Il est néanmoins possible de s'interroger, avec son secrétaire général, sur le risque de limiter son action à un soutien technique pour ne pas dire technocratique à la mise en oeuvre de projets. L'Union pour la Méditerranée, dont la visibilité peut apparaître de surcroît insuffisante, manquerait alors d'âme. Le parti pris initial de vouloir l'ancrer dans le concret a pu en effet laisser l'impression d'une organisation en décalage avec les réalités socio-politiques de la rive Sud de la Méditerranée. Ce fut particulièrement criant au moment du printemps arabe.
Pour répondre d'avance à ces critiques, je tiens à rappeler que l'UpM reste le résultat d'un compromis. La logique de projets visait à associer la plupart des acteurs de la région, à déconnecter la relation entre l'Union européenne et Israël du processus de paix, et offrir dans le même temps un espace de compensation à la Turquie, dont les négociations d'adhésion à l'Union européenne étaient alors au point mort. Par ailleurs, même si son ambition politique était dès l'origine modeste, l'UpM a été très rapidement victime du contexte international. Six mois après son lancement, l'opération israélienne « Plomb durci » dans la bande de Gaza est venue fragiliser cette organisation, incapable d'incarner l'espace de dialogue qu'elle était censée être. Je constate ainsi que les parlementaires israéliens ne se sont pas rendus en Jordanie pour la session plénière de l'AP-UpM en février dernier pour des raisons de sécurité. Cette assemblée constitue pourtant un espace de dialogue essentiel.
En dépit de ces difficultés, il est néanmoins souhaitable que l'UpM prenne toute sa place dans l'appui aux transitions démocratiques sur la rive Sud de la Méditerranée et que les projets qu'elle promeut puissent servir un tel objectif. Je pense en particulier à la Libye qui concentre actuellement toutes les difficultés de la région : guerre civile, trafic d'armes, immigration clandestine, radicalisme islamiste et défaillance de l'État. Ce pays dispose de frontières poreuses avec l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie, pays qui sont déjà fragilisés au plan interne. 1,8 million de Libyens vivent en Tunisie, ce qui représente près de 20 % de la population tunisienne. 1 million de réfugiés sont attendus dans les prochaines semaines. Ses frontières maritimes le mettent également en contact directement avec l'Union européenne, via l'Italie ou Malte.
Plus largement, il est indispensable que l'UpM puisse prendre toute sa place pour accompagner des projets de coopération dépassant la rive Sud de la Méditerranée stricto sensu en faveur du développement de l'Afrique subsaharienne, dont les difficultés constituent aujourd'hui une des causes de l'immigration clandestine vers l'Union européenne tout en posant des problèmes de sécurité à l'égard des intérêts européens dans la région. Le 20 mai dernier, c'est une centaine d'enfants en provenance de cette région qui ont été récupérés par les autorités italiennes sur deux embarcations de fortune. Leurs parents avaient préféré les envoyer en mer, au risque qu'ils y disparaissent, plutôt que de les garder dans une région où ils n'ont aucun avenir. C'est cette ambition partagée par une large partie de ces populations qui font de la Méditerranée aujourd'hui un gigantesque cimetière humain.
A l'occasion de notre entretien, le secrétaire général de l'UpM s'est montré favorable à un renforcement de la coopération avec les parlementaires nationaux, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'UpM mais aussi en bilatéral, via des rencontres avec les élus des États membres de l'Union européenne. Il sera sans doute utile de l'auditionner à terme pour qu'il précise un peu plus devant notre commission les prochains projets sur lesquels son organisation travaille et les écueils auxquels il est confronté.
En attendant, il me semble indispensable de continuer à appuyer l'action de l'UpM qui répond à un objectif auxquels nous souscrivons tous : celui de la prospérité et de la sécurité sur la rive Sud de la Méditerranée. L'Europe a tout à gagner à la réussite d'une telle ambition.
Lorsqu'elle a présidé l'Union européenne au deuxième semestre 2013, la Lituanie a fortement insisté sur le Partenariat oriental avec les pays de l'Est du continent européen. J'ai rappelé lors des COSAC qui ont été organisées durant cette période qu'il ne fallait pas pour autant négliger la politique méditerranéenne de l'Union européenne, qui représente tout de même les deux tiers des crédits de la politique de voisinage. Il s'agit bien évidemment de contribuer au développement de cette région mais aussi de défendre les intérêts européens en Méditerranée. N'en doutons pas, l'avenir de l'Union européenne est aussi au Sud.

Je souhaite également souligner tout l'intérêt d'une organisation comme l'Union pour la Méditerranée. Les institutions européennes me semblent encore trop tournées vers l'Est du continent et pas assez vers le Sud. Il ne s'agit pas d'un désintérêt mais d'une priorité moindre accordée au développement de cette région, même si les choses me semblent en train de changer.
Comme l'a souligné le Président, l'UpM constitue le cadre idoine pour permettre à un certain nombre de projets d'obtenir des financements. Ceux portés dans le cadre de la future exposition universelle de Milan organisée en 2015 et dédiée à l'alimentation de la planète pourraient peut-être bénéficier de cette labellisation. L'assemblée internationale des représentants des expatriés que souhaite mettre en place un certain nombre de pays à l'image de l'Algérie pourrait également s'inscrire dans ce cadre. À l'occasion d'un entretien que j'ai eu avec lui à Paris, le président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Russie, Mikhaïl Margelov, a insisté sur la nécessaire coopération franco-russe en Méditerranée autour de projets concrets. Là encore, l'UpM pourrait nous aider à disposer des financements nécessaires.

Je voulais également rappeler la pertinence du concept même de l'Union pour la Méditerranée, qui n'a peut-être pas assez été bien compris par l'Allemagne. La solution aux problèmes rencontrés aux frontières de l'espace Schengen passe pourtant clairement par l'Union pour la Méditerranée ! Celle-ci constitue également le cadre adapté pour la mise en place dans cette région de projets environnementaux ou énergétiques de première ampleur. La prospérité de l'Europe et le développement de la rive Sud ne pourront avoir lieu sans montée en puissance de l'UpM, qui ne saurait être résumée à une idée franco-française. Il faut aller de l'avant et permettre l'organisation, grâce à l'UpM, de tours de tables permettant de financer des projets.

D'autant plus que la plupart des établissements financiers internationaux sont représentés au sein du Secrétariat général de l'UpM.
La réunion est levée à seize heures vingt.