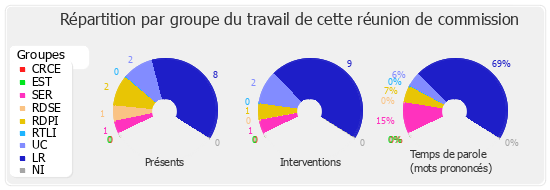Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du 30 novembre 2011 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission procède à l'audition de M. Jean-Ludovic Silicani, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Je suis heureux de recevoir, pour la première fois, le président de l'ARCEP. Notre commission compte nombre de spécialistes de ces sujets, et les interrogations sont nombreuses, sur l'arrivée de la 4G, la couverture du territoire, ou encore la fracture numérique. Sur ce dernier point, la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey a été votée à l'unanimité en commission, et sera, je l'espère, bientôt examinée par le Sénat. C'est avec intérêt que j'ai lu, la nuit dernière, le rapport de l'ARCEP sur les durées d'amortissement des actifs de la boucle locale cuivre.
Le Parlement est le seul organe de l'État, en dehors du juge, en cas de contentieux, à contrôler les autorités administratives indépendantes. Il est donc normal que nous vous rendions compte régulièrement de nos travaux et répondions à vos questions. J'ai fréquemment été entendu par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, mais jamais par la commission des affaires économiques du Sénat, depuis ma nomination.
Nous nous apprêtons à fêter les quinze ans de l'autorité de régulation, et je vous invite tous aux voeux de l'ARCEP, le 18 janvier à la Sorbonne. Le concept d'économie régulée est aujourd'hui assez consensuel, sans doute parce qu'il constitue le juste point d'équilibre entre l'économie administrée et l'économie dérégulée. L'ARCEP veille à assurer une concurrence suffisante pour bénéficier au consommateur : les prix des services de communications électroniques ont baissé de 20 % en 15 ans, quand l'indice général des prix augmentait de 20 %, ce qui représente une baisse réelle d'un tiers ; les tarifs français de l'offre triple play sont parmi les plus bas au monde, à 33 euros environ, contre 100 dollars, par exemple, aux États-Unis. Mais, au-delà de la concurrence, l'ARCEP poursuit d'autres objectifs d'intérêt général : l'innovation, l'investissement et l'aménagement du territoire.
L'Autorité a toujours cherché à être exemplaire, et est considérée comme une référence par la Commission européenne, dont elle a inspiré nombre de projets. Elle joue un rôle actif au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece). Son impartialité et son indépendance son reconnues, et je remercie le Sénat d'avoir oeuvré afin d'éviter la création d'un commissaire du gouvernement auprès de l'ARCEP.
L'ARCEP est très vigilante en matière de gestion. Ses dépenses hors personnel ont baissé de 20 % en cinq ans, ses effectifs sont stables : 174 personnes depuis cinq ans, collège compris, malgré un accroissement continu de nos missions à la suite de la transposition du nouveau « paquet télécom » et de la loi postale de 2011. Mais nous ne demandons pas d'augmentation de nos effectifs : nous préférons la qualité à la quantité, et n'avons aucun mal à attirer les talents.
J'en viens aux grands chantiers sur lesquels travaille l'ARCEP.
Premier sujet, les services mobiles. On lit souvent que le marché mobile serait saturé. C'est faux : le nombre de clients s'élève à 67 millions, et le taux d'équipement, qui dépasse 103 %, peut encore considérablement augmenter. Cela représente un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. La croissance des volumes est continue depuis huit ans, compensée, pour partie, par la baisse des prix, de 3 % par an depuis 2006, et qui va s'accélérer avec l'entrée en lice d'un nouvel opérateur mobile, Free. L'augmentation des abonnements s'accompagne de celle de la consommation de données, qui nécessite des débits croissants. D'où l'importance stratégique du dividende numérique et de l'attribution des licences de quatrième génération, qui vient d'avoir lieu pour la bande des 2,6 GHz et interviendra en début d'année prochaine pour celles de la bande des 800 MHz.
À mon arrivée à l'ARCEP, à l'été 2009, j'ai constaté que les opérateurs n'avaient pas rempli leurs obligations en matière de déploiement du réseau 3G.
Dès l'automne 2009, nous avons mis Orange et SFR en demeure de rattraper leur retard. Les premières étapes du calendrier fixé ont été respectées. L'objectif est d'atteindre 98 % à la fin 2011, et 99 % fin 2013. Nous serons très vigilants.
Un mot sur la définition du taux de couverture. Pour l'ARCEP, comme pour les autres régulateurs européens, un territoire est « couvert » quand on peut établir une communication réussie dans 95 cas sur cent pendant plus d'une minute sans coupure, à l'extérieur (définition outdoor), devant un bâtiment. La couverture est mesurée, non sur la seule base du centre bourg, comme le prévoit le programme zones blanches suivi par la DATAR, mais par « plaques » de cent mètres carrés environ. La population couverte est donc seulement celle qui réside sur les plaques effectivement couvertes au sens que je viens d'indiquer. L'ARCEP est ouverte à toute initiative du Parlement ou du Gouvernement pour réfléchir à une définition plus ambitieuse, étendue par exemple à la couverture à l'intérieur des bâtiments, sous réserve qu'elle soit techniquement réalisable.
S'agissant des licences 4G, les fréquences hautes ont été attribuées en octobre aux quatre opérateurs en place, de manière équilibrée. La recette a été de 936 millions d'euros. La loi Pintat de 2009 a fait de l'aménagement numérique du territoire un objectif prioritaire, et l'ARCEP s'est battue, avec succès, pour que cet objectif figure comme principal critère d'attribution de la bande des 800 MHz. C'est une obligation exceptionnelle en comparaison de celles posées pour la 2G et la 3G et « super-exceptionnelle » en comparaison de ce que font les autres pays européens ! Ainsi en Allemagne, la 4G est déployée en priorité uniquement dans les territoires qui n'ont pas d'autre mode d'accès au très haut débit. En France, l'objectif est de couvrir à terme 99,6 % de la population en très haut débit mobile. Ont également été fixés des objectifs de couverture par départements, de 90 % de la population au minimum, les opérateurs pouvant s'engager à aller jusqu'à 95 %. Enfin, une zone prioritaire, correspondant aux deux tiers du territoire, est définie : les zones rurales les moins denses seront aussi couvertes en priorité. L'ARCEP veillera au respect des engagements des opérateurs, et n'hésitera pas à user de ses pouvoirs de mise en demeure et de sanction.
J'en viens aux risques de brouillage entre le haut de la bande des 700 MHz, toujours consacrée à l'audiovisuel, et le bas de la bande des 800 MHz, désormais attribuée à la téléphonie mobile. Selon le bilan d'une expérimentation récemment menée à Laval, le taux de plaintes des téléspectateurs s'élève à deux pour mille, dont 40 % seraient imputables à la bande 4G, soit un taux très faible de 8 pour 10 000. Le problème vient le plus souvent des amplificateurs posés par les antennistes dans les immeubles collectifs, et peut être facilement réglé en installant un filtre qui coûte une vingtaine d'euros. Toutefois, d'autres expérimentations pourraient être menées après l'attribution des licences.

L'objectif de couverture est élevé ; la fixation d'un taux départemental bienvenue. Cependant, les délais sont bien longs : douze à quinze ans avant que le territoire ne soit entièrement couvert ! C'est excessif, même si je ne mésestime pas le coût pour les opérateurs.
En Grande-Bretagne, les risques de brouillage sont plus grands que ce que l'on a constaté à Laval. Or, le projet de loi de finances ne prévoit que 2 millions pour faire face aux éventuelles plaintes. Qui paiera si les brouillages sont plus importants que prévu ?

Le trafic sur le mobile double tous les ans. Les infrastructures sont saturées, d'où la problématique de la neutralité.
Je remercie l'ARCEP, dont l'action a été déterminante pour faire accepter l'objectif fixé par la loi Pintat. Le critère de l'aménagement du territoire a prévalu. C'est le premier dispositif en Europe à encadrer de la sorte l'attribution des fréquences.
Les opérateurs se montrent bien moins impatients depuis que les conditions d'attribution des nouvelles fréquences ont été précisées. Pensez-vous qu'ils consentiront les investissements nécessaires pour un déploiement rapide ? Etant donné les progrès technologiques et l'explosion du trafic, à quel horizon peut-on attendre un nouveau dividende numérique ?

Je vous présente mes excuses, Monsieur le Président, pour la comparaison un peu rapide que j'avais faite entre l'ARCEP et la Federal Communications Commission (FCC) américaine. Cette FCC, que j'avais découverte toute puissante lors d'un voyage avec Gérard Larcher, je l'ai retrouvée en lambeaux, décrédibilisée, contestée par le Congrès : les opérateurs de télécom ont lancé des procédures contestant ses avis, et ont gagné !
L'ARCEP aussi a des contentieux, mais les gagne.

L'ouverture de la 4G ne risque-t-elle pas, sauf à suivre le modèle allemand, d'inciter les opérateurs à ne pas achever la couverture en 3G ?
Le Conseil d'État a déclaré les maires incompétents sur le déplacement et la dépose des antennes. Enfin ! Il fallait leur ôter cette pression. Je sais d'expérience que ceux qui réclament la dépose des antennes sont les premiers à se plaindre de la mauvaise couverture ! La 4G n'est-elle pas de nature à renforcer significativement les besoins en antennes ?

À Saint-Barthélemy, le taux de couverture est de 98 %. Le vrai problème y est celui de la formation des prix au consommateur, qui varie selon les opérateurs : certains appliquent une TVA à 8,5 %, d'autres à 0 %... Quand on quitte l'île pour la métropole, on bascule dans le roaming : en deux jours, la facture dépasse 350 euros ! Est-il possible d'aller vers une harmonisation des tarifs, au moins sur le territoire français ?
Le câble qui relie la Guadeloupe aux îles du Nord, financé à 75 % par de l'argent public, n'est exploité qu'à 1 % de sa capacité, et à des prix prohibitifs, interdisant à des opérateurs de louer le câble pour offrir des services. Y a-t-il moyen d'imposer la pratique des prix concurrentiels, après un certain délai ?
Enfin, le bruit d'une suppression de TV5 Monde outre-mer nous inquiète. Pouvez-vous nous en dire plus ?

On ne se contente pas de mesurer la réception mobile devant la mairie ou l'église, mais sur l'ensemble du territoire de la commune : je m'en félicite.
Les pays émergents font l'impasse sur les réseaux fixes, et sont passés directement aux antennes-relais : la réception est excellente sur les plateaux du Laos ou en Mongolie extérieure. Y a-t-il des recherches en ce sens en France ?
Enfin, ma ville de Mortagne-au-Perche possède un réseau câblé depuis vingt ans ; elle est encore engagée pour dix ans avec Numéricable. Il faut tenir compte de l'effacement du câble ; or, tout le monde se désabonne car le service rendu est exécrable.

Il me revient de parler des antennes-relais. Nos concitoyens veulent une couverture partout, mais des antennes nulle part. Aux élus que nous sommes de dénouer leurs contradictions, de les aider à dégager l'intérêt général. Les connaissances sur la dangerosité des antennes-relais progressent. Ce n'est pas la marotte de quelques arriérés ou illuminés : les études établissent une corrélation entre les troubles de la concentration ou du sommeil, par exemple, et la présence d'antennes-relais.
Or les décisions prises par les municipalités ont été invalidées par le Conseil d'État, qui a rappelé que les maires n'ont pas ce pouvoir de police. Il faut dès lors trouver une solution, et sans doute changer le droit. L'ARCEP pourrait-elle proposer d'avancer vers une réflexion partagée, qui n'exclut pas les élus locaux ? Je vous renvoie aux amendements déposés sur la loi Grenelle II, mais repoussés par le Gouvernement : le principe ALARA de protection contre le rayonnement devrait s'appliquer en la matière.
Les téléphones portables produisent une masse de déchets, y compris toxiques, difficiles à gérer sur le long terme. Or les opérateurs incitent les consommateurs à changer régulièrement d'appareil. L'ARCEP réfléchit-elle à une limitation des appareils inutilement mis sur le marché, ou préfère-t-on faire tourner la machine productiviste ?

N'oublions pas le chargeur universel. Nos tiroirs sont pleins de vieux chargeurs inutiles !

Je rencontre dans ma commune les mêmes problèmes que M. Jean-Claude Lenoir avec Numéricable...
Ne peut-on inciter les opérateurs à mutualiser leurs émetteurs ? La communication est systématiquement coupée quand on passe d'une zone couverte par un opérateur à une zone couverte par un autre ! Avec les appareils performants d'aujourd'hui, ce ne devrait pourtant pas être un problème. À l'étranger, cela fonctionne. Il faut améliorer la continuité du signal.

Je ne suis pas sûr que les choses se passent ainsi sur le plan technique...
Les pouvoirs publics informeront les téléspectateurs sur la manière de procéder en cas de brouillage, quelque temps avant l'ouverture des nouveaux services mobiles, sans doute en 2013. Les usagers seront invités à faire vérifier par un antenniste que le brouillage n'est pas dû à une autre cause que les émissions des stations de base 4G. Les plaintes seront adressées au service d'appel unique de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), dont le fonctionnement sera financé, à hauteur de 2 millions d'euros, par les opérateurs. L'ANFR contactera les opérateurs concernés. En vertu de la règle d'antériorité, le dernier installé est réputé être à l'origine du brouillage, et doit prendre toute mesure pour le faire cesser : réduire la puissance, poser un filtre, voire arrêter l'émetteur jusqu'à résolution du problème.
Bruno Retailleau, je peux vous indiquer que j'ai beaucoup de raisons de penser que le déploiement de la 4G commencera très rapidement et donc que les premiers services mobiles 4 G seront, sans doute, disponibles avant la fin 2013.
Compte tenu des données disponibles et des études menées par l'ANFR sur les ressources et les besoins en fréquences à dix ans, j'ai indiqué à l'IDATE qu'il me paraissait nécessaire de prévoir un deuxième dividende numérique avant la fin de la décennie, pour répondre aux besoins croissants en très haut débit.
Certes, Pierre Hérisson, des opérateurs pourraient être tentés de ralentir leurs investissements en matière de 3G. N'ayez crainte : nous les avons mis en demeure d'avoir achevé le déploiement de la 3G à plus de 99 % fin 2013. S'ils devaient ralentir leurs efforts, ils s'exposeraient à de très lourdes sanctions. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition.
Les antennes relais présentent-elles un danger ou pas ? La réponse relève de la médecine ou de la psychosociologie. Curieusement, le débat ne porte pas sur la question des terminaux alors qu'ils représentent probablement un danger à long terme en cas d'utilisation intensive, notamment pour les enfants et les adolescents. En revanche, pour les antennes relais, les études scientifiques n'ont pas été suffisamment longues et poussées pour conclure objectivement à un danger. La population exprimant néanmoins une crainte, les travaux doivent se poursuivre pour parvenir à un consensus suffisant pour fixer des normes. Convient-il de baisser les seuils d'émission, à quel niveau et comment vérifier leur respect ? Quelle sera l'autorité administrative chargée de mettre en oeuvre les règles existantes et à venir ? Le Conseil d'État a jugé récemment que de telles vérifications ne relèvent pas du pouvoir de police générale des maires, mais du pouvoir de police spéciale du ministre chargé des télécommunications.

Nous sommes confrontés à un véritable paradoxe : pour abaisser les champs, on multipliera les antennes et les terminaux deviendront plus puissants pour compenser les baisses de signal. Suffit-il d'éviter le haut-parleur, sachant que le kit oreillette réduit par dix les émissions ?
La norme doit être mise en place au niveau européen.
Non, les normes doivent être les mêmes au sein du marché intérieur européen.
Vous m'avez interrogé sur l'outre-mer : l'ARCEP est compétente pour les prix de gros, pas pour les prix de détail. Les anomalies concernant les prix de détail doivent être signalées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et celles sur les taux de TVA, aux services fiscaux. Il est, en effet, difficilement acceptable pour les populations concernées que les tarifs outre-mer ne soient pas identiques à ceux pratiqués en métropole, en raison de tarifs d'itinérance applicable... entre pays. L'ARCEP souhaite parvenir à une solution qui soit bien sûr compatible avec le droit communautaire.
En ce qui concerne TV5, il faudrait que vous posiez la question au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Les mesures de couverture, comme je l'ai dit, sont réalisées par plaques de 100 mètres carrés environ, par les opérateurs, puis l'ARCEP contrôle par sondage leurs chiffres. En cas de différence, l'opérateur doit « revoir sa copie ».

Les personnes qui réalisent ces mesures sont bien discrètes, car on ne les voit jamais dans nos campagnes.
C'est normal. Les cartes sont d'abord faites au travers d'un modèle de simulation prenant en compte toutes les caractéristiques topologiques du territoire concerné, puis complétées par des mesures ponctuelles sur le terrain. L'ARCEP contrôle, ensuite, de façon aléatoire, la carte de couverture fournie par les opérateurs.
Si Numéricable ne remplit pas ses obligations, saisissez-nous pour que nous puissions intervenir.
J'en arrive aux déchets de terminaux : quand, dès 2010, l'ARCEP a prôné la séparation entre offre de services et vente de terminaux, les opérateurs nous ont presque tous dit que cette idée n'avait aucun sens. Mais six mois plus tard, les premières offres de service sans terminal apparaissaient sur le marché ! Le découplage va permettre de réduire les achats de terminaux et, partant, la quantité de déchets. En outre, la France importe des terminaux pour un coût annuel de 3 milliards. Il ne serait pas négligeable de réduire cette facture de moitié.

Le projet de loi renforçant les droits des consommateurs que nous examinerons à partir du 20 décembre traite, entre autres, de la séparation entre les offres de services et les ventes de mobiles.
Nous avons tous constaté des discontinuités dans la communication entre mobiles, mais je n'ai jamais entendu dire que tel n'était pas le cas à l'étranger. Je vérifierai.

Chez moi, SFR passe, mais pas Orange, alors qu'à 150 mètres, c'est l'inverse. J'en conclus qu'il n'y a pas de mutualisation entre opérateurs.
Ce n'est pas un problème de mutualisation, mais d'accord d'itinérance.

Il s'agit d'une volonté délibérée des opérateurs pour interdire aux abonnés de communiquer entre eux.

Il s'agit d'un accord d'itinérance. Il y a effectivement des sautes lorsqu'on passe d'un opérateur à l'autre. Les nouvelles mutualisations sur la 4G réduiront ces inconvénients.
Ce problème existe dans tous les pays européens.

Ma fille vit à Pékin : lorsque je vais la voir, on passe d'un opérateur à l'autre sans discontinuité. Avec le même appareil, je n'ai pas du tout le même résultat en France alors que ma fille, avec son abonnement chinois, passe d'un opérateur à l'autre sans discontinuité lorsqu'elle vient en France.
J'examinerai cette question précisément et je vous répondrai par écrit.
On compte désormais - au 3ème trimestre 2011 - plus de 22 millions d'abonnements au haut débit et 600 000 abonnements au très haut débit, dont 175 000 abonnements à la fibre optique, soit 71 % de progression en un an. De plus, 1 350 000 logements sont éligibles à la fibre optique qui arrive jusqu'aux immeubles, soit une progression de 40 % en un an. Reste maintenant aux ménages à s'abonner. Au total, en prenant en compte le très haut débit, via des réseaux du câble, ce sont 5,5 millions de logements qui sont éligibles au très haut débit, soit 20 % des logements, ce qui est un des taux les plus élevés des grands pays européens. Nous sommes pourtant en deçà de l'Asie, mais qui a commencé à s'équiper il y a plus de dix ans, et des États-Unis, où, il est vrai, le haut débit est de médiocre qualité.
Nous avons essayé de modéliser le coût global du réseau en fibre optique. La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar) est parvenue, il y a deux ans, à un coût de 30 milliards. Nous avons affiné les calculs, à partir, cette fois-ci, de données précises sur la topologie des réseaux, département par département, donnée par France Télécom, pour aboutir, il y a six mois, à 24 milliards, puis à 21 milliards il y a une dizaine de jours, compte-tenu de la collecte des données de presque tous les départements. Étant donné que 2 milliards ont déjà été investis dans la fibre optique, restent 19 milliards d'investissements à réaliser pour couvrir la totalité de notre territoire en très haut débit d'ici à 2025, soit en 13 ans. Ces chiffres concernent la boucle locale ; ils ne comprennent pas les réseaux de collecte, en amont, ni les raccordements finaux c'est-à-dire la partie terminale du réseau.
Nous ferons très prochainement aux opérateurs, au Parlement et au Gouvernement des propositions pour avancer sur la modernisation des réseaux de collecte qui pourront être éligibles aux fonds européens.
Ces 19 milliards que j'ai mentionnés sont à comparer aux 60 à 70 milliards qui seront investis, dans les quinze prochaines années, pour le réseau routier.
Le réseau de communication du XXIe siècle ne mérite-t-il pas qu'on y consacre un tiers des sommes allouées à la route ? Le coût de ces investissements, à réaliser d'ici 2025, se répartira entre les opérateurs privés (environ la moitié) et les financements publics (les collectivités territoriales ; l'État, dans le cadre des investissements d'avenir, puis du fonds national d'aménagement numérique des territoires ; et des crédits européens). La charge incombant aux collectivités territoriales pourrait se limiter à 5 ou 6 milliards d'euros en 13 ans. On rappellera qu'elles ont investi 3 milliards d'euros en 6 ans sur le haut débit.
Pour les communes hors des zones très denses, l'ARCEP souhaite la plus grande mutualisation possible, afin que le coût des investissements soit partagé entre plusieurs acteurs. Dans ces zones moins denses, France Télécom et SFR, d'une part, France Télécom et Free, d'autre part, ont signé des accords de co-investissement très précis portant au total sur 3 500 communes et couvrant 60 % de la population. Nous avons donc un chiffrage et un calendrier : chacun va donc pouvoir suivre la réalité de ces déploiements.
La création des réseaux fixes étant libre, elle ne nécessite aucune autorisation préalable. Un opérateur privé, mais aussi une collectivité publique, peuvent donc réaliser un réseau où ils le veulent. Mais aucun opérateur ne bénéficiant d'un monopole, il doit accepter le risque de voir arriver un concurrent. Il est donc recommandé de bien vérifier ex ante la pertinence du modèle économique des réseaux envisagés et de développer la concertation entre les acteurs.
A cette fin, la loi Pintat de 2009 a prévu des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numériques (SDTAN) pour les réseaux à très haut débit. 98 départements les ont lancés, voire réalisés. C'est un premier pas qu'il faut applaudir, mais ils comportent des imperfections que les prochaines versions corrigeront. Les collectivités territoriales ont aussi un rôle de planification. En outre, les opérateurs privés ayant annoncé leurs projets pour 60 % de la population, un dialogue doit s'instaurer entre eux et les autorités locales sur le calendrier précis du début et de fin des travaux, commune par commune. En contrepartie, les collectivités préciseront leurs priorités et les facilités qu'elles accorderont aux opérateurs (droit de passage, autorisation de voirie ou d'occupation du domaine public). Tout ceci devra être rassemblé dans une convention passée entre l'opérateur et la collectivité territoriale concernée.
Je décris la méthode qu'il faut viser.
Il n'est pas possible de rendre les intentions des opérateurs obligatoires, car si tel était le cas, ils refuseraient de se lier les mains et les SDTAN seraient des pages blanches. En outre, si ces derniers étaient prescriptifs, deux problèmes constitutionnels se poseraient : il s'agirait en effet d'une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et d'une méconnaissance de la règle de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre, puisque les schémas sont rédigés par une collectivité (département ou région) et qu'ils s'imposent à toutes les collectivités se trouvant sur le territoire couvert par le schéma.
Enfin, j'indique, en réponse à une des questions posées, que les tarifs de dégroupage devraient diminuer.

Les opérateurs ont annoncé des projets... sans échéancier. Marquer ainsi les territoires risque de dissuader les collectivités. Si les schémas directeurs ne sont pas contraignants, ils ne se feront pas, surtout dans certaines zones. En outre, je m'interroge sur les subventions affectées à certaines zones et non mutualisées.

Avec les élections, ma proposition de loi connaîtra une sorte d'itinérance...
La situation du haut débit en France n'est pas mauvaise, grâce aux 3 milliards d'euros investis par les collectivités territoriales. Pour faire passer l'article L. 1425-1 du code des postes et communications électroniques permettant aux collectivités d'être des opérateurs, nous avons dû bagarrer : France Télécom a eu des comportements dignes d'un western et, au Sénat, tous nos collègues ne croyaient pas que cela relevait des collectivités. La bataille du haut débit a été gagnée grâce aux collectivités, mais l'intégralité du territoire rural n'est pas encore couverte. Il faut donc achever son déploiement, en prenant garde à ne pas ralentir celui du très haut débit. Pour ce dernier, les schémas directeurs devront avoir valeur contractuelle, une fois que les opérateurs auront manifesté leur intérêt pour telle ou telle zone. C'est d'ailleurs ce que prévoit ma proposition de loi. Il faudrait aussi que les collectivités territoriales n'aient pas le sentiment d'être les supplétives des opérateurs privés, mais des opérateurs à part entière. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Elles devraient être associées à tous les groupes de réflexion et de concertation qu'anime l'ARCEP avec les autres opérateurs.

On ne peut avoir de boucle locale sans réseaux de collecte. Ce chaînon manquant devrait être financé par l'Etat. Quand pensez-vous que l'on en disposera ? Leur coût, de l'ordre du milliard, est acceptable compte tenu de l'éligibilité aux crédits européens.
L'on fait fausse route en opposant les collectivités aux opérateurs, et l'on ne parviendra ainsi qu'à freiner le déploiement de la fibre. Collectivités et opérateurs sont complémentaires. Or, certaines collectivités ont dupliqué des investissements privés, ce qui est du gaspillage d'argent public. Quand un opérateur fait une déclaration d'intention, il doit s'agir d'un engagement contractuel, avec un suivi longitudinal. Si cet engagement n'est pas respecté, qu'il devienne caduc !
Il convient aussi de connaître l'état des réseaux : dans mon département, l'opérateur m'a menti. Comment éviter de doublonner les investissements privés si les collectivités ne sont pas mieux informées ? On annonce un décret. Les opérateurs doivent aussi s'engager sur leurs intentions et rendre leurs réseaux transparents.

Les réseaux de collecte ont une fonction essentielle d'aménagement du territoire, ce qui est une compétence régalienne.

Il ne faut pas que l'achèvement du haut débit freine le déploiement de la fibre optique. Depuis qu'il a été question de séparation fonctionnelle des réseaux, voire de séparation juridique, les opérateurs ont déclaré que la mutualisation était nécessaire. Les choses progressent donc - la peur est le commencement de la sagesse... C'est en maintenant la pression maximale sur les opérateurs qu'on avancera.
Pour avoir été en charge du texte avec Bruno Sido, je sais les nombreux débats autour de l'article L. 1425-1. La majorité sénatoriale est parvenue à un compromis en imaginant une complémentarité véritable autour de l'opérateur d'opérateur. Il serait dangereux que les collectivités territoriales deviennent des opérateurs de contenu. Il convient donc de mieux équilibrer les rapports de force entre les collectivités et les opérateurs afin d'accélérer le déploiement des réseaux.
Lorsque nous sommes passés du monopole à la concurrence, il y a quinze ans, tout le monde s'attendait à une catastrophe pour la téléphonie fixe, mais elle marche aujourd'hui très bien pour un prix modique.

Le SDTAN de la Somme est aujourd'hui quasiment terminé et je voudrais que vous m'éclairiez. Vous avez dit qu'il y avait une soixantaine de zones urbaines pour lesquelles il y a des engagements.
A l'heure actuelle, 3 500 communes font l'objet de projets d'investissement par des opérateurs privés.

Certaines ne figurent pas dans cette liste, comme Amiens ou Abbeville. Comment imposer aux opérateurs privés de réaliser les travaux dans des délais donnés ? En outre, le financement du réseau optique devra être mutualisé, faute de quoi il ne se fera pas. Comment pérenniser le financement de ce réseau sans créer de recette spécifique ?

Élu local, je regrette que le très haut débit ne soit pas un service public. Les perspectives de son déploiement dans les zones urbaines, suburbaines et rurales ne sont pas du tout les mêmes. L'Indre-et-Loire hésite à élaborer un schéma numérique. Si Tours a le haut débit, ma communauté de communes, dans la même agglomération ne l'a pas : il n'y a pas de mutualisation possible. Avec une autre communauté de communes, nous avons lancé une étude mais, en vous écoutant, je crains que nous n'arrivions pas à mener notre projet à bien sans schéma départemental. Et quid des financements ?

Examinant les crédits de la mission « politique des territoires » lundi dernier, nous avons appris que, selon l'ARCEP, 99,5 % du territoire était desservi en haut débit. Est-ce exact ? La 4G ne risque-t-elle pas de faire renoncer certains territoires à développer la fibre ?

S'il n'y a quasiment plus de difficulté majeure pour la téléphonie fixe, c'est que depuis la loi de 1996, elle est devenue un service universel. Il n'en est pas de même avec le plan national pour le très haut débit et, vous l'avez dit, l'ARCEP n'a pas les moyens de faire respecter les engagements des opérateurs qui veulent intervenir en zones 1 et 2. Vous proposez de rendre obligatoire l'élaboration d'un schéma directeur dans tous les départements alors qu'aujourd'hui, en vertu de la loi Pintat, ils ne sont que facultatifs. Ne faudrait-il pas aller plus loin en décrétant le très haut débit service universel ?
Enfin, les collectivités territoriales vont devoir s'occuper de la zone 3 alors que les profits réalisés par les opérateurs en zones 1 et 2 justifieraient qu'ils les accompagnent dans ces investissements. C'est d'autant plus choquant que si les collectivités veulent faire de la péréquation, elles ne seront pas aidées dans les zones très peu denses si elles veulent couvrir en même temps des territoires qui relèvent de la zone 2.
Je veux rappeler quelques principes de base : le déploiement de réseaux fixes est libre. Les collectivités territoriales, qui ont la qualité d'opérateurs, peuvent donc réaliser les réseaux de communications électroniques qu'elles veulent, là où elles le veulent. Tous ceux qui disent le contraire se trompent. Dans des zones rentables, d'abord, mais en investisseurs avisés, sans subvention. Dans les zones non rentables, ensuite, ce qui implique une subvention.
Il ne faut pas confondre la réglementation du déploiement, telle qu'elle est fixée par la loi et précisée par l'ARCEP, et les critères du guichet de financement mis en place par le Gouvernement dans le cadre du plan national pour le très haut débit.
Je reviens donc aux règles de déploiement : dans les zones rentables de chaque territoire, le déploiement d'un réseau public peut donc se faire concurremment avec ceux des opérateurs privés, d'où l'utilité d'une concertation en amont. En outre, il s'agit de réseaux de gros, à louer ensuite à des opérateurs de détail. Il faut donc s'assurer que l'on peut offrir un prix de location concurrentiel. Dans les Hauts-de-Seine, le département a décidé de déployer un réseau mais des concurrents privés en ont fait de même. Le réseau public sera-t-il rentable ? Si un réseau coûte 200 millions mais ne rapporte que 100 millions, les 100 millions restants seront considérés comme une aide d'Etat et devront, à ce titre, être remboursés. Il faut donc être extrêmement prudent. C'est normal : la liberté est toujours liée à la responsabilité.
En zone non rentable, si un opérateur privé n'envisage pas d'engager la réalisation d'un réseau dans les trois ans, une collectivité pourra le faire en le subventionnant. L'opérateur ne peut se borner à formuler une simple déclaration d'intention ; il doit présenter un véritable projet avec un calendrier précis de réalisation. S'il ne remplit pas ses obligations, le projet est réputé caduc : les opérateurs ne sauraient gagner sur tous les tableaux. Il apparaît nécessaire que les engagements des opérateurs privés soient confirmés chaque année afin de réduire l'incertitude pour les collectivités.
Ce délai de trois ans est fixé par le droit communautaire, mais avec le rendez-vous annuel que j'ai évoqué, le délai d'incertitude sera sensiblement réduit pour les collectivités territoriales. En outre, comme je l'ai déjà indiqué, nous proposons qu'une convention entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales décrive les conditions précises du déploiement des réseaux privés et les facilités accordées par les collectivités, lesquelles ont des moyens de négocier avec les opérateurs.
Bien sûr, la convention doit être cohérente avec les schémas directeurs.
Enfin, les collectivités territoriales peuvent faire de la péréquation dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (SIEG), mais dans les limites fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans les zones non rentables, il n'y a pas de péréquation, ce qui n'est pas normal.
Au sein de ces zones, il y a aussi, de fait, une péréquation qui s'opère.
Il faut bien distinguer, d'une part, les règles, fixées par le cadre communautaire, la loi et le régulateur, qui sont les seules applicables en matière de déploiement de fibre optique, avec, d'autre part, les règles d'attribution des aides du commissariat général à l'investissement (CGI), qui sont plus restrictives. Une chose est de pouvoir déployer un réseau ; une autre chose est, en outre, d'obtenir une subvention de l'État. Pour cela, il faut remplir un certain nombre de conditions supplémentaires. Chaque collectivité doit d'ailleurs s'interroger avant de solliciter l'aide de l'État : c'est une facilité mais c'est aussi une contrainte. Il y a un bilan à faire.

Nous y reviendrons lorsque nous examinerons la proposition de loi de MM. Hervé Maurey et Philippe Leroy, en février je l'espère. Il faudra aussi parler, à une autre occasion, de la pertinence de la dualité entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'ARCEP...

Il faudra nous y pencher avec nos collègues de la commission de la Culture.
Je vous confirme que le haut débit à 512 kilobits couvre 99,5 % de la population. Il reste 300 000 foyers qui n'ont pas accès au haut débit.
Nous pouvons vous communiquer les chiffres pour votre département. Le déploiement de la 4G concerne prioritairement les zones les moins denses, celui de la fibre, comme d'abord les zones denses : il y a donc complémentarité plutôt que rivalité. Le très haut débit mobile, qui devrait démarrer fin 2013, couvrira donc des zones qui ne seront couvertes que plus tard par la fibre.