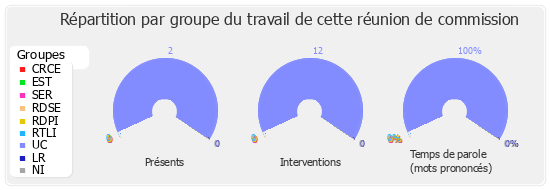Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 5 avril 2006 : 3ème réunion
Sommaire
La réunion

Au cours d'une troisième séance tenue dans l'après-midi, la commission a entendu une communication de M. Joël Bourdin portant sur le rapport d'information n° 261 (2005-2006) relatif à l'accès des ménages au crédit en France, qu'il avait présenté au nom de la délégation du Sénat pour la planification.
Procédant à l'aide d'une vidéo-projection, M. Joël Bourdin a considéré que la stratégie de réduction des déficits publics, assimilable à un objectif de réépargne publique, supposait que les agents privés prennent le relais de l'Etat pour soutenir la demande intérieure. Il a, en outre, estimé que des discours contradictoires entraînaient un besoin de clarification, la Banque centrale européenne et la Banque de France ne souhaitant pas que le crédit aux particuliers se développe, alors que, selon l'OCDE et le gouvernement, son développement serait, au contraire, favorable à la croissance.
Il a indiqué que l'endettement des ménages avait fortement augmenté ces dernières années, l'encours des crédits aux ménages étant passé de 44,2 % en 1989 à 52,5 % du revenu annuel des ménages en 2004, les crédits immobiliers étant ceux qui avaient progressé le plus rapidement. Il a souligné que l'endettement des ménages avait donc crû plus vite que leur revenu et que le PIB.

En réponse, M. Joël Bourdin a indiqué qu'il s'agissait de l'encours des crédits, non diminué des actifs.
Il a estimé que, malgré cette augmentation de l'endettement des ménages, la France se caractérisait toujours par une situation de sous-endettement de ces derniers, dans la mesure, en particulier, où l'endettement des ménages y était nettement plus faible que dans les autres pays développés, à l'exception de l'Italie. Il a souligné que l'endettement par habitant était en France trois fois plus faible qu'au Danemark et qu'aux Pays-Bas, et près de deux fois moindre que dans les douze principaux pays européens. Il a ajouté qu'en France, l'encours d'endettement des ménages avait été de 59,4 % du revenu disponible brut des ménages (RDB) en 2002, contre 194,2 % du RDB au Danemark, 198,2 % du RDB aux Pays-Bas, et 109,6 % du RDB dans les douze principaux pays européens.

s'est interrogé sur ce taux de 59,4 % du RDB en 2002, M. Joël Bourdin ayant auparavant avancé celui de 52,5 % du RDB en 2004.

En réponse, M. Joël Bourdin a indiqué que ces taux correspondaient à des notions différentes, celui de 59,4 % du RDB comprenant l'ensemble des dettes des ménages, et non les seules dettes bancaires.
Il a ajouté que, si en 2001 la France « pesait » 17,6 % du PIB des douze principaux pays européens, elle ne représentait que 8,1 % de leurs crédits hypothécaires.
Il a souligné que l'augmentation de l'endettement des ménages en France devait être d'autant plus relativisée qu'elle s'était accompagnée d'une amélioration de leur situation patrimoniale, qui était passée de + 4,6 milliards d'euros en 1998 à + 5,7 milliards d'euros en 2002.

S'appuyant sur la vidéo-projection, M. Jean-Jacques Jégou s'est inquiété de la diminution, sur la même période, des actifs constitués par les actions et les titres d'OPCVM, revenus de 1.073 millions d'euros en 1998 à 922 millions d'euros en 2002.

a souligné que ces données s'interrompaient après 2002, de sorte qu'elles ne prenaient pas en compte l'appréciation des indices boursiers qui avait eu lieu ultérieurement.

a indiqué que, malgré l'augmentation de la dette des ménages, la part des charges d'emprunt (remboursement en capital et versement d'intérêts) dans leur revenu annuel était restée stable, l'augmentation de la part des remboursements en capital ayant été compensée par une diminution des intérêts versés.

et Jean-Jacques Jégou, ont considéré qu'une augmentation des taux d'intérêt pourrait mettre un terme à cette situation.

a estimé qu'appréciée par décile de revenu, la charge de la dette apparaissait supportable. Il a précisé que les premier et dernier déciles étaient ceux qui, en part de leur RDB, supportaient la charge de la dette la plus faible, alors que le cinquième décile était le plus « chargé ».

a considéré que les classes moyennes seraient les plus fortement touchées, en cas d'augmentation des taux d'intérêt.

a souligné que, malgré l'augmentation de l'endettement des ménages, la proportion des ménages endettés avait décliné, reculant de 52,8 % en 1989 à 50,2 % en 2004.
Il a estimé qu'au total, il ressortait des éléments qu'il avait évoqués que les ménages disposaient globalement, en France, d'une « marge d'endettement significative ».
Il s'est alors interrogé sur les coûts d'un insuffisant accès des ménages au crédit et sur les risques d'une mobilisation de leurs marges d'endettement. Il a considéré qu'au plan macroéconomique, un accès plus large au crédit favorisait la consommation des ménages, et donc la croissance, que le crédit était le principal canal de transmission de la politique monétaire, et qu'il ressortait de plusieurs études empiriques que l'augmentation de l'encours du crédit avait pu, aux Etats-Unis, contribuer à la croissance de la consommation à hauteur de 0,8 point, chaque année, depuis 2001.
a considéré que les risques que représenterait en France un développement du crédit aux ménages étaient très réduits. Sur le plan macroéconomique, il a estimé que le risque inflationniste était faible, de même que le risque récessif et celui d'éviction de l'épargne. Il a jugé que les risques sectoriels étaient, eux aussi, modestes, soulignant que les créances douteuses des banques, en nette diminution depuis 1995, atteignaient désormais un très faible niveau, et avaient même donné lieu à des provisions négatives en 2005.

a estimé que ce dernier phénomène avait contribué à améliorer le résultat des banques en 2005. Il a déclaré que les banques ne faisaient plus de bénéfices sur le crédit immobilier. M. Jean Arthuis, président, a considéré que les banques avaient tendance à moduler leurs provisions, dans un souci d'optimisation fiscale.

a minimisé le risque d'inflation des prix d'actifs, notamment immobiliers, qui découlerait d'une augmentation de l'endettement des ménages, soulignant que le cycle de l'immobilier dépendait, en grande partie, de la réaction de l'offre à la demande, et que la construction de logements, en forte reprise depuis deux ans, contribuerait à lisser les prix de l'immobilier.

a estimé que la contribution du crédit à l'inflation des prix d'actifs était incontestable.

a considéré que l'augmentation des prix de l'immobilier ne provenait pas du faible niveau des taux d'intérêt, mais du dynamisme de la demande. Il a jugé qu'il n'existait pas actuellement de « bulle » immobilière. Il a, néanmoins, estimé qu'une augmentation des taux d'intérêt pourrait mettre un terme à l'actuelle hausse des prix.

a considéré que la rareté des cas de surendettement (3 % des ménages endettés, soit 1,5 % des ménages) en faisait un risque individuel, et non un risque systémique. Il a indiqué que les cas de surendettement résultaient le plus souvent d'accidents de la vie, seulement 0,5 % des ménages étant surendettés par excès de crédit.

S'appuyant sur la vidéo-projection, M. Jean-Jacques Jégou a souligné que ces accidents de la vie étaient, non seulement le chômage et la maladie, mais aussi la séparation et le divorce, qui étaient la deuxième cause de surendettement.

a considéré que la concurrence avait des effets ambigus sur l'offre de crédit. Il a indiqué que les banques utilisaient le crédit immobilier comme un produit d'appel, ce qui suscitait d'importantes subventions croisées, et que la gamme des produits offerts était plus réduite en France que dans les autres pays européens.
Il a estimé que l'organisation du marché n'était pas favorable en France à l'accès au crédit, évoquant l'exemple des Etats-Unis, qui, contrairement à la France, ne faisaient pas reposer le risque sur les seules banques, mais aussi sur les ménages, le Trésor public des Etats-Unis, et un grand nombre de prêteurs internationaux, dont les banques centrales. Il a souligné, à cet égard, que certains des ménages les plus pauvres étaient, aux Etats-Unis, solvabilisés par des organismes publics spécialisés.
Il s'est déclaré opposé au maintien du régime d'indemnités en cas de renégociations d'encours entre les banques et leurs clients.

et Jean-Jacques Jégou ont considéré qu'il incombait aux banques et à leurs clients de convenir, dans un cadre contractuel, de la possibilité ou non de telles renégociations.

se référant à un récent rapport de M. André Babeau sur le crédit à la consommation (« La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements nécessaires pour y répondre », Bureau d'information et de prévisions économiques, janvier 2006), a estimé que le taux de l'usure devait être aménagé pour les crédits de faible montant, afin de ne pas évincer certaines personnes du système de crédit. Il a, en outre, déploré l'absence en France de « fichier positif » partagé, c'est-à-dire d'un fichier qui comprenne l'ensemble des clients, et non les seuls « mauvais » clients. Il a affirmé qu'un tel fichier existait dans la plupart des pays européens. Il a indiqué que, selon les informations dont il disposait, la CNIL n'était pas favorable à la mise en place d'un tel fichier.

lui a suggéré d'auditionner la CNIL, afin d'obtenir des précisions à cet égard.
Après l'avoir remercié et félicité pour la grande qualité de son exposé, il s'est demandé si le développement du crédit hypothécaire ne risquait pas d'accentuer l'impact d'une baisse des prix de l'immobilier sur la consommation.

En réponse, M. Joël Bourdin a estimé que l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés était conçue de manière à limiter ce phénomène.

et Joël Bourdin, ont considéré qu'il était souhaitable de donner davantage de liberté aux banques en matière de crédit hypothécaire.

a recommandé d'étudier l'impact des phénomènes de « produit d'appel » et de subventions croisées dans le système de crédit sur l'accès des ménages au crédit et d'opérer un suivi régulier des pratiques d'offre de crédit aux particuliers. Il a jugé souhaitable de compléter la gamme de produits disponibles, en particulier en augmentant la liberté des banques et de leurs clients en matière de recharge hypothécaire et de viager hypothécaire. Il a proposé de définir le périmètre de la mutualisation des risques de crédit, en mettant en place des organismes financiers publics destinés à favoriser l'accès au crédit. Il a, en outre, recommandé d'évaluer plusieurs réglementations contestées, sur des bases objectives : renégociation des prêts, usure, « fichier positif ».
Un débat s'est alors instauré.

a estimé que le faible recours des Français à l'endettement provenait, en grande partie, d'une certaine forme de crainte de l'avenir. Il a souligné le contraste, en France, entre le faible endettement des ménages et le fort endettement de l'Etat.

En réponse, M. Joël Bourdin a jugé que le faible appel au crédit par les ménages français provenait, également, de la faiblesse de l'offre de crédit. Il a estimé que l'on avait trop tendance, en France, à considérer le seul endettement des ménages, alors qu'il convenait également de prendre en compte leurs actifs. Il a souligné l'importance, dans l'hypothèse d'un désendettement de l'Etat, que les ménages recourent plus au crédit.

s'est demandé si la tendance des banques à privilégier les prêts immobiliers par rapport aux prêts à la consommation pouvait également s'observer dans les autres pays européens.

En réponse, M. Joël Bourdin a indiqué que tel était effectivement le cas, mais que, dans les pays étrangers, le crédit à la consommation était nettement plus développé.

a considéré que les prêts immobiliers jouaient un rôle de « régulateur des achats d'impulsion » et a souhaité connaître le point de vue de M. Joël Bourdin sur cet aspect de la question.

En réponse, M. Joël Bourdin a estimé que, si les ménages ayant un revenu supérieur au revenu médian recouraient le plus au crédit immobilier, ceux recourant le plus au crédit à la consommation étaient ceux ayant un revenu inférieur au revenu médian, de sorte que ces deux types d'emprunt ne correspondaient pas aux mêmes catégories de ménages.

s'est étonné du faible nombre de ménages surendettés, estimé par les travaux de M. Joël Bourdin à 1,5 % du nombre total des ménages.

a félicité M. Joël Bourdin pour la qualité de son rapport d'information. Il a, de nouveau, affirmé qu'il n'existait pas en France, selon lui, de « bulle » immobilière.

En réponse, M. Joël Bourdin a considéré, citant un certain nombre d'exemples étrangers, que la durée des prêts immobiliers pouvait être encore allongée en France.

a indiqué que la fonction de représentant du Sénat au sein du conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance (EPRD) était vacante. Il a considéré que cet organisme prenant des décisions relevant du pouvoir exécutif, les représentants du Parlement n'y avaient pas leur place.
En conséquence, à l'initiative de son président, la commission a décidé de ne pas désigner de candidat proposé à la nomination du Sénat pour siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance.

Puis la commission a émis le souhait que M. Jean-Jacques Jégou puisse siéger au sein du Comité national de mise en oeuvre de l'Europe des moyens de paiement scripturaux à l'horizon 2010 (comité SEPA).
Erratum au bulletin des commissions n° 22 du 1er avril 2006
A la page n° 5385, au premier paragraphe, lire :
Il a précisé que le coût total de l'opération de désamiantage, du transport vers l'Inde et du remorquage vers la France de la coque Q 790 devrait atteindre 12,3 millions d'euros, ainsi répartis :
11 millions d'euros, comprenant entre 4,5 et 5 millions d'euros pour le désamiantage mené en France, divers frais et l'indemnité de rupture de contrat avec la société SID ;
1,3 million d'euros de remorquage vers la France ».