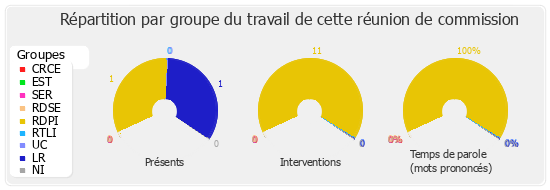Mission d'information Influences étatiques extra-européennes
Réunion du 7 septembre 2021 à 12h30
Sommaire
La réunion
Audition de M. James Paterson sénateur et président de la commission conjointe du parlement australien sur le renseignement et la sécurité
Audition de M. James Paterson sénateur et président de la commission conjointe du parlement australien sur le renseignement et la sécurité

Mes chers collègues, nous nous réunissons dans des conditions très particulières du fait des huit heures de décalage horaire qui nous séparent de notre interlocuteur en Australie. Je tiens donc à remercier M. James Paterson, sénateur de l'État de Victoria, d'avoir accepté notre invitation en sa qualité de président de la commission conjointe du Parlement australien sur le renseignement et la sécurité.
Au mois de novembre 2020, cette commission a lancé une enquête relative aux risques sur la sécurité nationale qui pourraient affecter les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Australie est en pointe dans la prise en compte des menaces étrangères pouvant concerner le secteur universitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons entendu le 21 juillet dernier Mme Gillian Bird, ambassadrice d'Australie en France.
L'exemple australien nous semble unique à ce jour en raison de la mobilisation de toutes les parties prenantes du pays - gouvernement, Parlement et universités - pour identifier les menaces et élaborer des recommandations.
Le Sénat français partage les mêmes préoccupations, puisqu'il a créé le 6 juillet dernier une mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français, mission que j'ai l'honneur de présider et dont le rapporteur est notre collègue André Gattolin.

Je remercie James Paterson d'avoir accepté notre invitation.
Comme l'a rappelé notre président, l'audition de Mme Bird s'est révélée très instructive. Il nous est évidemment apparu compréhensible que, sur le plan diplomatique, l'ambassadrice n'ait pas souhaité citer nommément les pays à l'origine des menaces nouvelles pesant sur les universités, mais nous ne sommes pas dupes : la Chine est souvent parmi les pays cités ici et là.
En Europe, le contexte est différent, mais nous devons déjà faire preuve de vigilance vis-à-vis de la Russie, notamment pour tout ce qui concerne ses campagnes de désinformation. Nous n'avons pris conscience que plus récemment des pratiques agressives de la Chine.
Entre parlementaires, la parole sera certainement plus libre pour désigner les risques et nommer les auteurs des menaces. La coordination entre gouvernement, Parlement et monde universitaire pour lutter contre ce danger me paraît en tout cas vertueuse et à prendre en exemple.
En 2019, le Parlement australien a créé une commission sur le renseignement et la sécurité. Celle-ci a lancé une enquête dont les conclusions étaient annoncées pour le mois de juillet 2021. Il semblerait que ses travaux se poursuivront après cette date. Aussi, même si votre rapport final reste à venir, monsieur Paterson, pouvez-vous nous éclairer sur la démarche de votre commission et sur votre premier diagnostic ?
Quelles ont été les raisons qui ont conduit votre commission à lancer une telle enquête sur les interférences étrangères sur votre système universitaire ?
D'après vos premières conclusions, comment ces interférences étrangères se caractérisent-elles ? Vous parlez d'influence, de captation de données et même d'espionnage. Les pressions sur les étudiants et les professeurs font-elles partie de ces menaces ?
L'autonomie des universités et les libertés académiques peuvent sembler en contradiction avec l'impératif de sécurité et de surveillance. Comment avez-vous réussi à mobiliser les universités australiennes sur un tel sujet ?
Enfin, quelles sont les recommandations, les bonnes pratiques ou les lois mises en oeuvre dans votre pays qui pourraient servir d'exemple à la France ?
Je vous remercie de votre invitation et suis flatté de l'intérêt que vous portez à l'expérience australienne. C'est un honneur pour moi que de vous répondre dans le cadre de vos travaux.
Vous l'avez dit dans vos propos introductifs, le Parlement australien enquête sur les interférences étrangères dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. L'enquête fait suite à plusieurs incidents qui ont conduit le gouvernement australien à se préoccuper de cette question.
Je vais citer un certain nombre d'exemples pour étayer mon propos.
Tout d'abord, j'évoquerai la situation de l'Australian National University de Canberra, qui a subi toute une série de cyberattaques ces dernières années. Nous avons découvert que les assaillants ciblaient non pas des données scientifiques, mais les dossiers personnels des étudiants. Or la plupart de ces futurs diplômés travailleront bientôt pour le gouvernement fédéral. Ces données peuvent donc avoir une très grande valeur pour une puissance étrangère.
Ensuite, j'aborderai le cas de ces jeunes étudiants de l'université du Queensland, qui ont lancé une action en faveur du mouvement pro-démocratie à Hong-Kong et qui ont été, de ce fait, molestés par des étudiants chinois nationalistes. Bizarrement, l'université du Queensland n'a ni réagi ni protesté.
En réalité, l'influence des instituts Confucius est directement en cause dans cette affaire. Nous avons en effet appris que l'université du Queensland avait permis au gouvernement chinois de financer directement un certain nombre de cours du premier cycle, notamment un cours sur la question des droits de l'homme en Chine. Nous avons également découvert en enquêtant que certains éléments de la rémunération du vice-chancelier de l'université dépendaient d'un indicateur basé sur le nombre d'étudiants chinois accueillis par l'établissement : plus ce nombre était élevé, plus son salaire augmentait... Pour nous, il est tout à fait clair que l'action des instituts Confucius ne doit en aucun cas conduire à la remise en cause de l'autonomie de nos universités ni de nos libertés académiques.
Enfin, dernier exemple, celui d'un chercheur d'université, également directeur de l'association Human Rights Watch (HRW), qui s'est vu censuré par l'université qui l'emploie pour un article très critique sur l'action de la Chine à Hong-Kong.
On le voit, les universités australiennes pratiquent volontiers l'autocensure, cédant ainsi à l'influence des étudiants chinois présents sur le territoire australien.
Nos travaux ont également montré que beaucoup d'universitaires, y compris des chercheurs de l'Australian Research Council, avaient été ouvertement ciblés par le programme chinois de recrutement « 1 000 talents ».
En matière de lutte contre les influences étrangères, l'Australie a heureusement accompli des progrès significatifs en cinq ans. D'abord, chacun reconnaît aujourd'hui que cette question est stratégique et plus personne ne minimise les incidents qui surviennent. Certaines universités ont développé des actions pour lutter contre ce type de menaces, notamment pour protéger les données sensibles qu'elles détiennent. Elles ont aussi mis en place des procédures d'approbation plus rigoureuses pour l'accueil des étudiants étrangers, notamment pour faire face au programme « 1 000 talents ».
J'ajoute qu'un groupe de travail conjoint entre les universités et le gouvernement australien a été créé pour promouvoir des standards censés protéger les universités. Il s'agit d'une avancée réellement positive. Le gouvernement a également voté l'an dernier l'Australia's Foreign Relations Act, qui autorise le ministre des affaires étrangères à annuler un accord si l'autonomie institutionnelle d'une université est en cause ou si cet accord n'est pas dans l'intérêt du pays.
Notre commission devrait publier son rapport final d'ici à la fin de l'année. Il comportera toute une série de recommandations pour l'université que je ne peux évidemment pour l'heure dévoiler.
Dans le contexte australien, même si d'autres pays nous préoccupent, l'influence la plus menaçante provient évidemment de Chine. C'est pourquoi nous sommes très intéressés par l'expérience française et la manière dont votre gouvernement entend également contrer la menace russe.

Dans le cadre de nos investigations, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux expériences australienne, britannique et tchèque. Dans ces pays, les politiques de lutte contre les menaces étrangères font l'objet de travaux approfondis. Je pense notamment à l'Australian Strategic Policy Institute (ASPI) : échangez-vous avec les chercheurs de cet institut ? Estimez-vous que le développement de ce type d'organisme soit utile ?
Par ailleurs, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est en train d'élaborer un rapport sur la transparence des influences étrangères au sein des principaux pays occidentaux en vue de recommander un certain nombre de règles communes. L'Australie est-elle consultée dans ce cadre ?
L'ASPI est un think tank australien indépendant dont l'utilité est attestée. En effet, nous sommes très préoccupés par l'influence que certains États étrangers peuvent avoir sur le débat public en Australie. Aussi, l'ASPI joue un rôle important en contribuant à créer une dynamique qui pousse le gouvernement à s'attaquer à ces problèmes.
Pour répondre à votre seconde question, je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement australien est consulté dans le cadre des travaux de l'OCDE. En revanche, je peux vous dire que nous collaborons régulièrement avec de nombreux États occidentaux pour échanger des informations et fournir un certain nombre de renseignements.

Vous avez évoqué le cas des instituts Confucius. Certains de ces instituts ont été fermés, comme aux États-Unis ou en Suède. En France, leur développement est aujourd'hui en perte de vitesse.
Aujourd'hui, quelle est la stratégie de votre pays vis-à-vis de ces organismes ?
Il existe dix instituts Confucius en Australie. Leurs rapports avec nos universités ont été récemment revus par le gouvernement. Actuellement, notre ministre des affaires étrangères examine cette question : il s'agit de déterminer si ces organismes agissent dans l'intérêt national australien ou s'il est préférable de les fermer. La décision n'a pas encore été prise, mais, de mon point de vue, toutes les universités devraient rester très prudentes à l'égard de structures directement liées à des États étrangers, surtout lorsque celles-ci ont vocation à financer certains de nos travaux de recherche.
Un exemple parmi d'autres : il y a quelques années, l'institut Confucius de l'université de Sydney est parvenu à empêcher le Dalaï-Lama de s'exprimer au sein du campus. Surtout, il faut savoir que nombre d'étudiants chinois hostiles au régime de Pékin, qui sont présents sur le territoire australien, se sentent menacés par ces instituts.

L'Australie a récemment fait l'objet d'importantes mesures de rétorsion commerciale de la part de la Chine, alors même que plus de 40 % de vos exportations sont destinées à ce pays. Dans quelle mesure pouvez-vous résister à ces pressions croissantes ?
L'Australie est l'un des pays occidentaux qui commercent le plus avec la Chine. La campagne menée par les Chinois contre notre pays concerne aussi le secteur de l'enseignement supérieur. Pékin cherche à porter préjudice à certaines universités australiennes, lesquelles sont de plus en plus dépendantes des frais de scolarité réglés par les étudiants étrangers, notamment chinois. Cette situation est évidemment dangereuse pour notre pays.
En matière d'échanges commerciaux, la situation s'est beaucoup dégradée au cours des trois dernières années.
Dernier point concernant la diaspora chinoise en Australie : sur 25 millions d'habitants, 1,5 million sont d'origine chinoise.

On parle beaucoup du rôle joué par les associations étudiantes chinoises, dont les dirigeants sont souvent liés aux autorités de Pékin. Ces associations ont-elles un statut officiel et font-elles l'objet d'une attention plus particulière des services de renseignement australiens aujourd'hui ?
L'activité de ces associations estudiantines m'inquiète en effet. Il a été démontré qu'elles avaient des liens très étroits avec le gouvernement chinois. À la suite des incidents à l'université du Queensland, le consul général chinois à Brisbane a félicité les étudiants nationalistes chinois pour le rôle qu'ils ont joué dans la répression des étudiants pro-Hong-Kong.
Nous essayons évidemment de lutter contre ce type d'influence. Depuis le vote de la loi de 2020, la règle est claire : lorsqu'une association, un organisme ou un institut agit au nom d'un gouvernement étranger, il doit le déclarer au gouvernement australien.

Au mois de novembre dernier, la commission conjointe du Parlement australien sur le renseignement et la sécurité lançait un appel à contribution. Êtes-vous satisfait du nombre de témoignages que vous avez obtenus ?
Dans un article publié dans The Guardian, votre collègue Kimberley Kitching faisait part des hésitations des étudiants chinois, membres de la diaspora, à livrer leur témoignage auprès des commissions officielles. Quel bilan quantitatif faites-vous de cet appel à témoignage, compte tenu des réticences et des pressions indirectes ou discrètes, renforcées par le fait que les familles de ces étudiants demeurent en Chine ?
L'engagement des universités elles-mêmes, d'experts indépendants et des professeurs d'université a été significatif. En revanche, nous avons reçu très peu de témoignages de la part d'étudiants. Les recherches menées par Human Rights Watch l'expliquent : les étudiants chinois ont décrit leurs craintes à s'exprimer en public sur leurs expériences et leurs opinions, de peur d'être espionnés par d'autres étudiants chinois proches du gouvernement. Certains étudiants, en raison de leurs activités en Australie, ont vu leur famille ou leurs connaissances résidant en Chine continentale recevoir la visite des autorités...
Cela préoccupe beaucoup le gouvernement australien et nos universités, qui souhaitent protéger ces étudiants. Cela doit faire partie du débat public en Australie, le gouvernement doit prendre ce problème à bras-le-corps.

Existe-t-il des procédures ou des lieux de réception des plaintes ? Y-a-t-il une coordination entre les universités et les services de sécurité ou de police ?
Ces sujets impliquent naturellement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais ils concernent aussi le ministère des affaires étrangères et le ministère des affaires intérieures. Dès lors, comment la coordination entre vos ministères fonctionne-t-elle ? Un ministère en particulier jouit-il d'un leadership ou est-ce la coopération interministérielle qui prévaut ?
La plupart des universités ont un système permettant aux étudiants de déposer plainte. Néanmoins, les étudiants concernés n'ont souvent pas confiance et estiment que leur université ne va pas donner suite à leur plainte... Les universités doivent faire davantage pour que les étudiants, en Australie, aient confiance et se sentent libres de témoigner.
Quant à la coordination entre les ministères, elle s'est beaucoup améliorée au cours des dernières années ; le groupe de travail dédié aux interférences étrangères a pris cette question très au sérieux. Auparavant, le ministère des affaires étrangères n'était pas représenté mais, compte tenu des nouvelles lois sur les relations avec les États étrangers, la coopération interministérielle a fini par s'imposer. Les universités ont aussi signalé l'engagement plus fort des agences de renseignement et de sécurité, lesquelles ont des programmes qui concernent aussi bien les entreprises que les universités. Bref, à l'heure actuelle, la communication est bien meilleure que par le passé.

Avez-vous des échanges avec les pays dont l'Australie est géographiquement proche, comme le Japon, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud ? Est-ce un sujet qui vous réunit ?
Les pays avec lesquels nous avons le plus discuté sur ces questions sont le Royaume-Uni et les États-Unis, en tant qu'ils possèdent le même type d'enseignement supérieur qu'en Australie et qu'ils sont structurés d'une manière similaire ; les universités, quoiqu'indépendantes de l'État, reçoivent de lui des financements.
En ce qui concerne les États plus proches géographiquement, le gouvernement australien a pris d'autres initiatives, notamment avec les pays de la zone indopacifique, laquelle demeure la plus exposée aux agissements chinois.

Pourriez-vous détailler les points faibles des dispositifs mis en oeuvre pour lutter contre ces influences ? S'agit-il d'un manque de moyens, de coordination, de leadership, ou bien est-ce le résultat de l'autonomie des universités - principe auquel les démocraties sont très attachées - et, partant, de leur diversité dans la façon de percevoir et de traiter les risques d'ingérence ?
Certaines universités n'ont pas mesuré l'importance de ces questions ; sans doute ont-elles été naïves ou ont-elles fermé les yeux. Si les universités ont mis du temps à se réveiller, c'est parce que bon nombre d'entre elles sont dépendantes financièrement des revenus en provenance d'étudiants étrangers, lesquels facilitent notamment leur recherche.
Est-ce à dire que le gouvernement australien ne finance pas suffisamment les universités ? C'est une question qu'il faut se poser... Cependant, il revient avant tout aux universités de gérer avec plus de prudence leur bilan financier, de telle sorte qu'elles ne dépendent plus des revenus des étudiants étrangers. Il est vrai que quelques universités particulièrement ambitieuses, souhaitant développer leur sphère de recherche, sont restées aveugles à certains risques.

Avez-vous une idée des secteurs académiques et des disciplines les plus visés par la Chine, en termes tant de nombres d'étudiants que de financements des laboratoires de recherche ? Historiquement, comme on l'a vu en France, la Chine a privilégié le domaine des sciences dures, des technologies, de la recherche fondamentale. Très récemment, on s'est aperçu de l'augmentation des demandes d'inscription d'étudiants chinois dans les écoles de journalisme et de communication, comme si la Chine souffrait là d'un déficit. On observe le même mouvement dans le domaine des sciences humaines et sociales, notamment en anthropologie, avec la volonté de montrer des filiations ethniques possibles entre les populations autochtones du grand Nord et les populations chinoises. En France, précisément, c'est aux écoles de commerce et de management que les étudiants chinois portent un intérêt croissant.
Quelles sont vos observations, tant en volume qu'en termes d'évolution dans le temps de la volonté de la Chine d'interférer dans un secteur académique, voire de se l'approprier ?
Ce sont les domaines scientifiques qui nous inquiètent le plus, en particulier l'ingénierie. Il est des domaines de recherche qui, a priori, n'ont pas d'application militaire, mais, comme la Chine a une philosophie d'intrusion, il faut se méfier même des tentatives d'interférences qui nous semblent innocentes : la Chine cherche souvent à trouver des applications militaires aux technologies civiles.
Nous devons donc penser d'une façon beaucoup plus large et surveiller les domaines qui pourraient être utilisés contre nous.

Avez-vous pu repérer des faiblesses dans les moyens et les réactions de la puissance publique lorsque ces interférences sont attestées ? Je pense par exemple au renvoi d'un étudiant qui use de son statut pour capter des données dans une université ou dans un laboratoire. En droit australien, les dispositifs publics vous semblent-ils suffisants ? Envisagez-vous, en votre qualité de sénateur, une loi qui pourrait les renforcer ou mieux les adapter aux interférences étrangères ?
Dans un monde parfait, on pourrait compter sur les universités seules pour protéger la recherche. Malheureusement, l'expérience a montré que laisser les universités décider, sans supervision, ne les conduit pas toujours à faire les choix les plus prudents, au détriment de leur intérêt propre et des intérêts nationaux. Seul le gouvernement fédéral est capable de définir les intérêts nationaux les plus importants à protéger.
Les universités ne sont pas mal intentionnées ; je ne pense pas qu'elles cherchent à nuire. Ce sont le plus souvent une certaine naïveté et un manque de renseignement qui les ont placées dans la mauvaise passe où elles se trouvent. Une législation supplémentaire et d'autres règlements sont sans doute nécessaires, en complément des mesures déjà mises en oeuvre. Toutefois, il ne faudrait pas qu'une nouvelle législation mine la créativité et l'ingéniosité des universités. Celles-ci doivent rester capables de mener à bien leur recherche et de former les étudiants, et ce avec le moins de restrictions possible.
En l'état, l'équilibre n'est pas bon.

En France, il existe des lois concernant les atteintes à la sûreté de l'État et visant les faits de collaboration avec une puissance étrangère ennemie. Or nous ne disposons que de moyens juridiques extrêmement lourds à mettre en oeuvre, qui nécessitent une instruction forte.
L'ambassadrice d'Australie en France, lorsque nous l'avons entendue, a signalé seulement quatre cas de sanctions effectives. C'est pourquoi nous posions la question de moyens intermédiaires qui ne correspondent pas à des actes coercitifs forts. Il nous manque un éventail de sanctions : en fin de compte, la puissance étrangère, surtout si elle est particulièrement influente, ne prend que le risque de l'impunité...
Dans bien des domaines, il faut faire plus pour porter un coup aux pays autoritaires lorsque ceux-ci cherchent à interférer dans notre façon de vivre. Faute de sanction, il n'existe aucun moyen incitant ces pays à se garder de telles actions, notamment lorsqu'ils les entreprennent à couvert.
Encore faut-il être capable d'identifier les interférences et de réagir. Récemment, nombre de nations, y compris la France, se sont unies pour attribuer au gouvernement chinois la responsabilité du piratage du Microsoft Exchange Server - il était impératif à ce moment-là d'envoyer un message très fort.
Plusieurs pays, dont l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l'Union européenne, disposent d'un cadre de sanctions en droit humanitaire. Ces sanctions - interdiction de stocker des avoirs dans les banques, refus d'inscription universitaire, interdiction d'entrée sur le territoire - ont des conséquences personnelles pour les officiels qui s'adonnent à divers abus, si bien qu'ils ne peuvent se réfugier derrière leur gouvernement.

Depuis trois ans, la législation australienne s'est renforcée d'une manière générale contre toutes les formes d'interférence dans l'économie, les choix et les orientations de l'Australie. Votre rapport parlementaire constitue un point d'étape pour mesurer l'efficacité des mesures prises.
Toutefois, l'adoption de nouvelles mesures conduit parfois le problème à changer de forme... Ainsi, considérez-vous que la situation s'est améliorée depuis la mise en place du nouveau cadre législatif ou bien les tentatives d'interférence ont-elles changé de nature et utilisent-elles des ressources qui n'avaient pas été prises en compte à l'origine ?
Je suis très optimiste, car les résultats ont été très positifs. Depuis que l'Australie a interdit les donations aux partis politiques et a adopté des lois visant à augmenter les pénalités concernant les faits d'espionnage et les interférences à couvert, on a observé un changement de comportement immédiat, notamment du côté des agents gouvernementaux qui essayaient d'influencer notre démocratie et de la corrompre.
La surveillance des investissements a été adaptée, pour être certain que l'intérêt national soit préservé. Un changement énorme dans les investissements s'est opéré, surtout dans les domaines sensibles - cela a déjà un impact positif sur les universités.
Il reste néanmoins beaucoup à faire... Nous devons désormais nous préoccuper des cyberattaques, qui ont été privilégiées depuis que d'autres domaines d'interférence ont été protégés. Beaucoup d'incursions contre les entreprises australiennes ont été menées, mais aussi contre le gouvernement - le Parlement et nos universités ont été hackés !
Le cyberdomaine est une vraie source de vulnérabilité. Une nation peut être endommagée via le piratage de ses infrastructures les plus importantes systémiquement : électricité, eau, alimentation, système de paiement, etc. Voilà un enjeu dont il faut se saisir, au moyen de propositions et de projets de loi. C'est un défi pour beaucoup de pays dans les années à venir.

Ces dernières années, à l'échelon européen, nous avons adopté des lois et des directives pour contrôler et filtrer les investissements étatiques extra-européens. Elles ont été plutôt efficaces, mais nous nous sommes rendu compte qu'entretemps certains pays, dont la Chine, ne réalisaient plus d'investissements directs, mais proposaient des prêts indirects à de grandes entreprises privées.
Ces prêts, aux conditions quasiment usuraires, s'adossent à des aides publiques nationales ou européennes. Au printemps dernier, une nouvelle proposition de directive européenne a vu le jour, dédiée à lutter contre ces aides publiques indirectes et cachées. L'influence a changé de nature, mais elle est tout aussi prégnante en termes d'impact sur nos économies.
C'est un point important, qui a pour thème sous-jacent le désir des pays autoritaires de contrôler et d'influencer les démocraties, renforcé par l'ouverture des marchés, qui offre nécessairement des perspectives d'interférence.
Les tentatives d'interférence auront toujours cours : tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous en tenir à nos principes, maintenir nos sociétés ouvertes, renforcer nos démocraties et laisser nos marchés libres, tout en nous protégeant de ceux qui essayent d'utiliser ces libertés contre nous. Une adaptation constante sera nécessaire. S'ils ne peuvent pas passer par la porte, ils passent par la fenêtre : les auteurs d'interférences trouvent à chaque fois les moyens de contourner les restrictions. Restons vigilants, de façon à maintenir notre souveraineté, notre démocratie et nos pays libres.

Monsieur Paterson, je vous remercie de cet échange particulièrement intéressant. L'ambassadrice d'Australie en France, lorsque nous l'avions entendue, avait souligné l'intérêt d'avoir des débats très nourris et des échanges d'expériences communes sur ce sujet. Tel fut le cas aujourd'hui.

Monsieur Paterson, je vous remercie également.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 13 h 25.