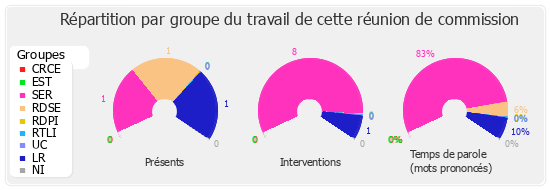Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage
Réunion du 28 mars 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. armand mégret médecin fédéral national de la fédération française de cyclisme (voir le dossier)
- Audition de m. philippe-jean parquet docteur en psychiatrie et addictologie président de l'institut régional du bien-être de la médecine et du sport santé de nord-pas-de-calais (voir le dossier)
La réunion

Monsieur Mégret, vous êtes le médecin fédéral national de la Fédération française de cyclisme. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Notre commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage a été constituée à l'initiative du groupe socialiste, en particulier de M. Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur.
Une commission d'enquête fait l'objet d'un encadrement juridique strict. Je signale au public présent que toute personne qui troublerait les débats serait exclue sur le champ.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Armand Mégret prête serment.
Je suis honoré par votre invitation.
La protection de la santé du sportif passe par deux types de surveillance. La lutte contre le dopage se réfère à l'éthique, à l'équité et à la santé : elle a pour cadre le code mondial antidopage et la loi française, l'AMA et les agences nationales ; située dans le disciplinaire, elle aboutit à des sanctions. À côté, la médecine d'aptitude, qui inclut la surveillance médicale et la médecine du travail, se réfère à la loi française. Lutte antidopage et protection de la santé du sportif répondent à des missions différentes ; il y a une étanchéité entre les deux.
La lutte antidopage relève du contrôle, elle recherche une preuve directe ou indirecte avec le passeport biologique, puis débouche sur le disciplinaire. La prise en charge médicale est plus complexe. La médecine de soins est assurée par les médecins d'équipes et de clubs ; médecins traitants du sportif, ils exercent une médecine curative, par opposition à la non-contre-indication, médecine préventive qui vérifie l'aptitude à pratiquer un sport -l'aptitude correspond à une médecine du travail qui existe seulement chez les professionnels. Il y a incompatibilité d'exercice entre ces types de médecine, ce qui n'exclut pas des échanges entre le médecin du travail et le médecin traitant. Enfin, l'avis de spécialistes peut être sollicité par l'un et l'autre ; ils établissent alors un compte rendu.
Si la déontologie nous interdit de donner des informations dans la lutte antidopage, il est arrivé que le docteur Françoise Lasne m'alerte sur une anomalie relevée dans les urines et qui faisait suspecter un cancer des testicules. Elle n'avait qu'un numéro, grâce auquel j'ai pu retrouver le nom de ce coureur pour le prendre en charge sur le plan médical.
Dans la Fédération, je suis indépendant : son organigramme montre que je ne rends de compte qu'à son président. J'avais mis en place un suivi médical longitudinal contrôlé dès 1998, avant la loi Buffet. La surveillance médicale réglementaire est régie par une loi de 2006, que nous appliquons au titre d'une délégation de service public. Elle impose une surveillance clinique et une exploration fonctionnelle ; un test d'effort préalable est requis tous les ans.
En 2013, nous avons réussi pour la première fois à avoir le même protocole sur nos quarante-sept plateaux techniques. C'est ce que nous réalisions depuis 1999 pour le suivi biologique : voilà quatorze ans que tous les cyclistes subissent de deux à quatre prélèvements annuels selon qu'ils sont juniors ou professionnels : tout le monde a les mêmes obligations et nous avons la même attitude envers tous. Nos prélèvements sanguins mesurent les mêmes paramètres que ceux du passeport hématologique qui mesure trois paramètres et décèle la prise d'EPO. Cette numération est inclue dans notre suivi.
Je dispose au siège d'une assistante. Elle adresse pour chaque prise, pour chaque examen, une lettre à chacun des 1 200 coureurs. Le sportif se rend dans un laboratoire d'analyses biologiques ou sur un plateau technique. Les résultats sont ensuite transmis sous forme numérique suivant des modalités sécurisées. Le médecin fédéral reçoit la totalité des résultats, le médecin régional ceux des amateurs et le médecin d'équipe ceux de la population dont il a la charge.
Je peux exploiter ces données sur mon ordinateur personnel. Je dispose pour chacun de ses résultats des valeurs sur plusieurs années, je peux ainsi les comparer aux valeurs normales, mesurer l'évolution des paramètres. Il faut parfois du temps pour que les profils se normalisent. Nous pouvons cibler, déterminer les conduites à tenir pour chaque anomalie et les modalités de prise en charge. Les contre-indications médicales sont à effet immédiat. Parce qu'une cortisolémie basse représente un risque sanitaire, que la prise de corticoïde ait été licite ou non, c'est un no start pour le coureur. Cela a été le cas lors des derniers 4 jours de Dunkerque comme lors des championnats de France professionnels 2012.
En 2012, nous avons suivi 1 200 coureurs dont 224 professionnels. La ligue professionnelle a demandé que ces derniers aient le même suivi que les amateurs - il n'en est pas de même dans tous les sports. La même année, nous avons répertorié 272 anomalies et il y a eu 68 contre-indications à effet immédiat, une mesure administrative qui impose au coureur de rendre sa licence au président de son comité ou de la fédération. Il ne la récupère qu'après des visites d'experts. L'individu qui ne respecte pas les obligations de suivi est lui aussi passible d'une contre-indication administrative.
Contrairement à ce qu'on dit, je ne suis absolument pas opposé au passeport biologique ou hématologique. Tous les prélèvements sanguins réalisés dans le cadre de la surveillance médicale règlementaire forment la sérothèque de la fédération, située dans les laboratoires Mérieux, devenus Biomnis, à Lyon : les coureurs ont donné leur accord pour que les tubes soient conservés cinq ans et que la sérothèque soit exploitée pour construire une base de données. Les prélèvements sont toujours réalisés dans les mêmes conditions, afin d'autoriser les comparaisons dans le temps. Je ne suis pas hostile aux preuves indirectes, à condition qu'elles soient efficientes
L'UCI a présenté son passeport hématologique en octobre 2007 ; il comprend des données sur les hématies, l'hémoglobine et les réticulocytes, conformément aux exigences de l'AMA, de l'UCI et de nos scientifiques.
Lorsqu'on réalise une numération sanguine, on détecte également les anomalies affectant d'autres éléments, globules blancs, plaquettes... Mais on n'en fait rien. Certains coureurs atteints de leucémie ont ainsi émis des plaintes car, s'ils avaient été informés de ces résultats, ils auraient pu être soignés plus tôt.
La preuve indirecte constitue une avancée incontestable, mais coûteuse. Le prix grand public d'une numération sanguine s'établit à 23 euros. Il est difficile de connaître précisément le coût annuel des 900 passeports réalisés chaque année par l'UCI : il est évalué entre 5 à 7 millions, pour 4 à 6 prélèvements par an et par coureur. En cinq ans, sept coureurs ont été suspendus pendant deux ans. Tous étaient de second plan, et l'un a été suspendu alors qu'il était déjà à la retraite... Et tout cela pour un coût global de 25 à 35 millions d'euros. En 2009 et 2010, Lance Armstrong, Frank Schleck et Alberto Contador ont été convaincus de dopage, mais ce n'est pas par le suivi biologique qu'ils ont été confondus. Soit dit en passant, ces 4 500 prélèvements auraient coûté 103 500 euros au prix grand public...
Je n'oppose pas le passeport et la surveillance médicale réglementaire, les deux n'ont pas la même finalité. Nous avons signé avec le ministère une convention d'objectifs pour les 1 000 coureurs amateurs ; les professionnels prennent eux-mêmes en charge le coût de la surveillance médicale. Chaque coureur a coûté 400 euros, plateau technique et échographie tous les deux ans compris. Depuis 2002, 2 173 anomalies ont été répertoriées, dont 468 contre-indications, et de nombreuses pathologies professionnelles ont été découvertes. Le ministère suit 15 000 sportifs, pour un coût de 3,3 millions par an.
Je rêve d'une révision du statut du sportif de haut niveau -avec des aides matérielles, voire des points de retraite- et d'une véritable médecine du travail. Cela freinerait les conséquences du dopage. Une mutualisation interfédérale, voire une externalisation de cette médecine, serait également souhaitable.
Les 14 500 sportifs sont soumis à la même numération pour le ministère et pour l'AFLD : pourquoi ne pas faire des prélèvements communs aux deux instances ? Les résultats bruts pourraient être donnés aux fédérations et à l'Agence, libre aux unes et à l'autre d'ordonner des examens complémentaires.
Je rêve également d'une entité interfédérale, avec un traitement administratif et logistique de la surveillance médicale réglementaire confié à une commission médicale d'expertise intersport.

S'agissant du Tour de France, vous avez évoqué des taux de 50 % du peloton touché par le dopage en 1999, 80 % en 2000, 70 % en 2002 ou encore en 2005. Et aujourd'hui ?
La position particulière que vous occupez au sein de la fédération doit-elle être inscrite dans la loi ? Vous ne dépendez que du président, non des entraîneurs, des clubs, etc.
Je rends des comptes au ministère !
Je n'ai pas cité les taux que vous mentionnez.
En 1999, 60 % du peloton souffrait d'hyperferritinémie, caractéristique de l'hémochromatose, une maladie dont la prévalence atteint seulement trois pour mille dans la population générale ! Cela était manifestement lié à la prise de fer injectable, essentiellement par voie intraveineuse, et, dans la grande majorité des cas, associé à de l'EPO (érythropoïétine).
L'hyperferritinémie a disparu du peloton. Mes fonctions concernent le volet sanitaire et je n'ai pas accès aux informations du volet antidopage, mais le diagnostic d'EPO est facile à faire, même devant le poste de télévision : quand je voyais Gianni Bugno et Miguel Indurain monter l'Alpe d'Huez côte à côte sans respirer, je n'avais pas beaucoup de doutes.
Quand une procédure est enclenchée, elle est directement adressée aux services juridiques de la fédération, en particulier à son président. Cependant, je le répète, ce sont des données auxquelles je n'ai pas accès.
Mon contrat avec la fédération est imposé par l'Ordre des médecins. Il précise mon indépendance, y compris vis-à-vis du président. En revanche, j'ai des comptes à rendre au ministère, notamment par un rapport annuel d'activité. Je n'ai jamais subi de pressions et j'ai toujours bénéficié de bonnes conditions de travail au sein de la fédération.

L'Ordre des médecins n'est-il pas le grand absent de la lutte antidopage, notamment sur la prévention ?
J'ai dû présenter mon contrat à l'Ordre des médecins, qui l'a validé sans la moindre difficulté. Lorsqu'a été créé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), nous avons créé, avec Michel Boyon et Michel Rieu, une commission médicale sur le statut du médecin, pour définir les missions, les incompatibilités... L'Ordre des médecins nous a beaucoup aidés.
Aucune. Je m'occupe de médecine, je ne suis pas concerné par le volet antidopage.
Armstrong a déclaré qu'il ne s'était pas dopé. Michael Rasmussen, qui avait aussi un passeport, a avoué. Ce sont les limites du passeport...

Les médecins fédéraux ne devraient-ils pas être concernés par la définition de la politique publique de lutte contre le dopage ?
Non. Ils ne le peuvent pas. Ils respectent leur code de déontologie. Je ne suis habilité à prendre des décisions que médicales ; si je vois des anomalies, je ne peux en informer personne. Une évolution serait souhaitable.

Il vous arrive tout de même de tirer la sonnette d'alarme. En 2012, vous avez souligné l'augmentation des anomalies constatées dans le cadre du suivi longitudinal des cyclistes professionnels...
Nous savons que le sport de haut niveau, surtout s'il est trop ou mal pratiqué, comporte des risques élevés pour la santé. Il déclenche des pathologies, souvent spécifiques, que le sportif combat notamment grâce à des produits dopants. C'est pourquoi je réclame une véritable médecine de protection, comme la médecine du travail. Quand des travailleurs étrangers travaillent dans une entreprise étrangère sur le sol français, ils doivent respecter le code de travail. Les cyclistes étrangers sont salariés de leur équipe, ils devraient également y être soumis. J'ai commencé à opérer des prélèvements inopinés dans le cadre de la médecine d'aptitude. Cela peut conduire à interdire à un coureur de s'aligner sur le départ, mais non déclencher des sanctions disciplinaires.
Cette année, j'ai réalisé 35 prélèvements sur le Paris-Nice, plus de 50 sur le Tour de France 2012.
Le secret médical. Dans le cadre d'une procédure judicaire, un juge a saisi deux de mes dossiers, en présence d'un représentant de l'Ordre des médecins. Les obligations du code déontologique ont été respectées.

Qu'y a-t-il de nouveau dans l'affaire Armstrong ? Avez-vous été surpris par l'ampleur du phénomène ?

Les produits n'étaient pas nouveaux. Les mêmes, du reste, que dans l'affaire Festina...
Il n'y rien de nouveau, si ce n'est que nous sommes passés d'un stade artisanal à la grande entreprise. De plus, il y a sans doute eu des protections, au moins passives.
La lutte antidopage est devenue efficace ; on détecte l'EPO. En conséquence, les cyclistes reviennent aux bonnes vieilles méthodes, singulièrement celle de Lasse Virén, un coureur de fond des années soixante-dix, qui pratiquait des autotransfusions sanguines : elles augmentent le transport d'oxygène vers les muscles et ne sont pas détectables.

Le domaine des transfusions sanguines n'a-t-il connu aucun perfectionnement ? Il est vrai qu'on parle de ces coureurs qui font attendre le contrôleur parce qu'ils sont occupés...
La transfusion d'une poche de sang prend un quart d'heure à vingt minutes. On n'a pas les moyens de détecter l'autotransfusion. Mais certains ont avoué.
C'est aux scientifiques de répondre et à la recherche de trouver le moyen de détecter les autotransfusions.

Le médecin que vous êtes a bien quelques connaissances. Combien de temps faudra-t-il attendre ce progrès ?
Je ne peux répondre à cette question, je n'ai pas la compétence scientifique pour.

Les autotransfusions ne sont-elles pas détectables dans le contrôle sanguin continu ?
L'UCI accorde aux cyclistes un délai de deux mois pour faire leur prise de sang. Ils choisissent le moment ! Je plaide pour une réduction de ces délais, mais la fédération est tributaire des règlements internationaux. Dans la surveillance médicale, aucun élément ne permet de répondre à la question. Il faudrait s'adresser aux hématologues.
Je participe de temps en temps aux réunions de l'AFLD. Il semblerait qu'apparaissent des ébauches de moyens pour détecter l'autotransfusion.

Un rapprochement entre le laboratoire d'analyse de l'AFLD et les laboratoires d'université, qui comprennent des spécialistes, y contribuerait-il ?
Nous mettons actuellement la sérothèque à disposition d'un projet de l'INRA de Toulouse sur le métabolome, auquel participe notamment le professeur Le Bouc de Paris. Ces personnes sont qualifiées pour nous dire si des preuves sont possibles. Je suis médecin rééducateur ; je me situe au bout de la chaîne.

Le cyclisme est-il trop exigeant physiquement pour être pratiqué à l'eau claire ?
Il peut l'être et je constate une nette amélioration avec la génération actuelle.

En tant que médecin fédéral, vous est-il arrivé de subir des pressions ?
Je n'ai jamais subi de pressions. J'ai eu d'excellentes conditions de travail au sein de la fédération.

Même en tant que médecin d'équipe ? De la part des employeurs ou des coureurs ?

Il existe deux listes de produits interdits, pendant ou hors la compétition. Trouvez-vous cela justifié ?
Non. Il devrait y avoir une seule liste. Les sportifs malades doivent arrêter la compétition et ne la reprendre qu'une fois le traitement terminé.

Pourquoi les autorités sportives - UCI ou AMA, je l'ignore - ont-elles relevé le seuil de corticoïdes admis lors des contrôles antidopage ?
La prise de corticoïdes fait baisser la production de l'hormone cortisol par l'organisme. Si je constate ce phénomène, je déclenche une contre-indication médicale. La prise de corticoïdes a été libéralisée. En janvier 2013, nous avons créé dans le règlement médical un chapitre relatif à l'usage des corticoïdes et restauré le carnet du coureur, grâce auquel nous suivons leur état de santé et leur consommation de médicaments. Le dispositif rentrera progressivement en application cette année.

Si, au niveau fédéral, le médecin n'est pas impliqué dans la lutte contre le dopage, qui le sera ?
Nous appliquons la loi. C'est l'AFLD qui décide des contrôles à effectuer. Lorsque l'un d'eux est positif, sont prévenus le président de la fédération, le médecin instructeur de la commission disciplinaire et le service juridique. En tant que médecin, je ne suis averti de rien. Je lis ces informations dans la presse. J'ignore si cette étanchéité est une bonne chose, mais elle fonctionne.

Nous sommes dans la période de renouvellement des conventions d'objectifs entre l'État et les fédérations. Les médecins fédéraux ne sont-ils pas associés aux discussions ?
Je travaille au volet médical du nouveau contrat et assiste à ce titre aux réunions, aux côtés du président de la fédération et de son trésorier. Il y a 1 200 coureurs à suivre sur le plan sanitaire, une éducation à faire - car les jeunes sportifs sont un peu des aventuriers. À nous de leur faire passer les messages importants et, le cas échéant, de prendre des décisions - strictement médicales.

Vous préconisez donc une meilleure prise en charge sanitaire des sportifs pour limiter le dopage ?
Oui. Il faut revoir le statut du sportif de haut niveau, je l'ai dit, et la prise en charge sanitaire. Comme tout médecin du travail, le médecin fédéral doit analyser les risques du poste de travail par discipline et par sport.

Merci. Nous sommes preneurs de la documentation que vous nous avez proposée.
Audition de M. Philippe-Jean Parquet docteur en psychiatrie et addictologie président de l'institut régional du bien-être de la médecine et du sport santé de nord-pas-de-calais
Audition de M. Philippe-Jean Parquet docteur en psychiatrie et addictologie président de l'institut régional du bien-être de la médecine et du sport santé de nord-pas-de-calais

Notre commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage a été constituée à l'initiative du groupe socialiste.
Une commission d'enquête fait l'objet d'un encadrement juridique strict. Je signale au public présent que toute personne qui troublerait les débats serait exclue sur le champ. Je vous informe en outre qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Philippe-Jean Parquet prête serment.
Merci de m'accueillir. Auditionné avec d'autres par la Haute Assemblée il y a quelques années, à une époque où le sujet n'était guère considéré, nous étions passés pour d'étranges individus... J'interprète votre invitation comme un premier signe d'efficacité.
Je m'intéresse à l'évaluation des politiques publiques et notamment aux questions de prévention. L'efficacité de l'action publique impose de définir le problème à traiter, les objectifs, les méthodes, de sélectionner les compétences nécessaires à la mise en oeuvre et, enfin, de concevoir des méthodes d'évaluation de la politique menée. L'évaluation est notre point faible : elle reste à construire. Par exemple, nous travaillons encore sur des données épidémiologiques d'institutions, c'est-à-dire découlant du fonctionnement des institutions existantes et non pas fondées sur la réalité des pratiques dopantes.
Je distingue le dopage sportif et les conduites dopantes. Ces dernières ne sont pas réservées aux sportifs de haut niveau, ni même aux sportifs licenciés ; elles connaissent un large écho dans la population. J'ai eu l'occasion de dire au Conseil de l'Europe que les conduites dopantes en entreprise étaient un problème considérable.
Le dopage sportif a une définition opératoire : il désigne l'utilisation d'un certain nombre de produits et de méthodes. La légitimité de ceux qui en dressent la liste est un problème en soi. À titre d'exemple, le cannabis sort et rentre à nouveau dans la liste, selon les pressions subies, selon les pays. La définition du dopage sportif varie donc selon les techniques, mais aussi selon des critères politiques et selon le poids de différents groupes d'influence. Ce qui pose la question du poids de notre pays dans les instances internationales.
Les conduites dopantes désignent l'ensemble des produits et méthodes destinées à accroître la performance, au sens large du terme. Elle peut être le fait de sportifs comme de salariés dans les entreprises du secteur privé. Elle touche particulièrement les salles de musculation. La fédération française d'haltérophilie travaille sur une charte des salles de remise en forme, afin de les soustraire à l'emprise du dopage. Une approche réaliste du problème impose de s'intéresser aux conduites dopantes en général.
Dès 1993, j'ai contribué à introduire en France la notion de conduites addictives pour désigner la consommation de substances qui modifient la façon de fonctionner d'un sujet, la vision qu'il a de lui-même et de son environnement. La loi Buffet, à laquelle j'ai participé, a été pionnière dans la traduction de cette notion en introduisant un volet sanitaire aux côtés des volets législatif et réglementaire - comme cela se fait pour la toxicomanie.
Ces notions s'articulent de manière cohérente. J'ai contribué à fonder le premier centre d'addictologie, à Lille. Dans ces établissements, nous voyons des consommateurs de substances illicites, sous l'emprise de l'alcool, qui ont été d'intenses pratiquants sportifs. La performance sportive préfigure les conduites addictives et dépendances ultérieures. Les politiques de lutte contre le dopage sont ainsi à replacer dans une politique de santé publique et d'éducation plus large.
La prévention peut être guidée par une approche réglementaire et législative. Le sportif qui prend une licence dans une fédération accepte un certain nombre de règles, auxquelles il se soumet lorsqu'il pratique son sport, participe à une manifestation sportive. La situation est de nature contractuelle. Les contrôles ont lieu au cours des compétitions, au moment de la performance - laquelle, au sens anglo-saxon, désigne ce qui est donné à voir à l'ensemble des spectateurs. Cette approche va de pair avec une rigueur particulière : qui contrôle quoi, comment, quelles sont les sanctions possibles et leur mode de contestation. Cette conception du sport est largement d'origine anglo-saxonne : le sportif respecte la parole donnée, non des valeurs sportives.
L'approche morale est une deuxième façon d'appréhender la prévention. J'étais intervenu sur le sujet lors d'une conférence organisée par le Comité international olympique à Lausanne : le président Juan Antonio Samaranch m'a dit que mon approche était utopique et que la question centrale était celle de l'image du sport. C'est ainsi que l'on voit fleurir des campagnes de communication du ministère des sports qui stigmatisent les sportifs dopés, qui se voient tatouer « tricherie » sur le front. J'ai quelque réticence face à cette approche et à la stigmatisation dans laquelle elle peut verser.
L'approche sanitaire, enfin : à cet égard, la loi Buffet a marqué un changement radical. Dans nos sociétés, la santé est devenue non plus seulement un concept défini par l'OMS mais une valeur qui mérite d'être respectée pour elle-même. Cette approche, quoique teintée de morale, conserve toute sa pertinence lorsqu'elle est rigoureusement appliquée.
Reste que la prévention dans le milieu sportif et la prévention dans la vie ordinaire sont deux choses assez différentes. Il faut définir des critères d'efficacité. Les listes de produits interdits, sur le modèle anglo-saxon, peuvent aider, à condition de garder à l'esprit que nous sommes dans le champ de l'épidémiologie d'institution. La prise de conscience, il y a quinze ans, de l'intérêt du sport pour développer la citoyenneté, la santé, le vivre-ensemble fut une révolution. Le choc n'en a été que plus grand lorsqu'on s'est aperçu que le sport de haut niveau pouvait être dommageable pour la santé. Il avait perdu la pureté originelle qu'on lui prêtait depuis Pierre de Coubertin.
L'évaluation de la politique de lutte contre le dopage est très difficile. On peut s'en tenir à une approche d'efficience : fait-on ce que l'on a annoncé ? Le problème réside dans l'attitude des citoyens : comment perçoivent-ils le dopage sportif et les conduites dopantes ? Le travail que je mène avec des directeurs des ressources humaines du secteur privé me conduit à penser que nombre de citoyens ont une conscience altérée du phénomène. Ils sont, pour employer un terme psychiatrique, dans le déni. Ce n'est pas une dénégation : ils savent que le dopage existe, mais ils font comme s'il n'existait pas. Les photos du Tour de France, en couleur comme en noir et blanc, qui ornent les grilles du jardin du Luxembourg en témoignent : les milliers de personnes amassées sur les routes pour voir passer leurs champions sont dans un déni absolu. La représentation nationale est particulièrement bien placée pour modifier le regard qu'il faut porter sur le phénomène.
Du point de vue des sportifs eux-mêmes, le problème est très délicat. Nous l'avons constaté à l'antenne de prévention du dopage que je préside dans le Nord-Pas-de-Calais : ils pensent que le dopage est nécessaire à la performance. Ils savent toutefois que leur contrat le leur interdit. Par conséquent, ils jouent au chat et à la souris. Tous ceux qui gravitent autour d'eux, médecins du sport, entraîneurs, organisateurs d'événements sportifs, entendent pour leur part faire leur métier en évitant les ennuis. Mme Marie-George Buffet m'a dit un jour que les fédérations étaient un État dans l'État. On a cherché à responsabiliser les fédérations. Or elles ont leurs propres objectifs et il est difficile de contrôler ce que l'on produit soi-même. Par exemple, les sportifs contrôlés positifs doivent être reçus par l'antenne régionale de prévention et de lutte contre le dopage où ils y reçoivent les informations et les aides personnalisées sur le dopage et les conduites dopantes. L'antenne leur donne un certificat règlementaire leur permettant de récupérer leur licence. En réalité, très peu s'y rendent. Les certificats de reprise de licence sont donc délivrés dans d'autres officines. Les cadres des fédérations sont dans une position très difficile, ils sont sans doute pleins de bonne volonté mais hiérarchisent leurs objectifs. Le travail de votre commission contribuera, je l'espère, à lutter contre cette hiérarchisation, car la santé et le respect des règles sont des objectifs d'égale importance.
Un mot sur la médecine du sport et les médecins placés auprès des fédérations. J'ai lutté pendant vingt ans dans mon CHU pour qu'il soit créé un service de médecine du sport. On envisage de le créer après mon départ et de lui donner mon nom... à titre posthume en quelque sorte ! Traduire des données médicales scientifiques à l'attention des sportifs est un travail singulier qui doit être mené. Le problème ne se limite pas aux sportifs de haut niveau. J'habite l'été un village dont le maire, également président d'une fédération sportive, organise des manifestations auxquelles participent à la fois des vedettes et les habitants, notamment les seniors. Je peux vous assurer que certains prennent du Guronsan pour améliorer leurs performances ! C'est ce que j'appelle le « dopage intime ».
Quant au dopage génétique, il témoigne avec éclat des effets néfastes de la production de connaissance. Voilà des progrès scientifiques mis au service du sport de façon tout à fait détournée, le plus souvent hors de toute maîtrise technique et de toute considération éthique.
Nous faisons beaucoup de choses en matière de prévention. Au sein de mon antenne, c'est ce qui marche le mieux. Nous intervenons dans les clubs, y compris ceux du troisième âge, les établissements scolaires. La prévention et la lutte contre le dopage ne s'opposent nullement, ce sont des politiques différenciées. Le nom de nos antennes, consacrées à la prévention « et » à la lutte contre le dopage, en témoigne.

Quelle est la spécificité du dopage sportif par rapport aux conduites dopantes ?
Dans le fond, il n'y a absolument aucune spécificité, mais une utilisation spécifique des méthodes de dopage. Premier cas de figure : le comportement de dépendance, qui laisse place à un état de sevrage lorsque la prise du produit s'interrompt. Le temps passé à la recherche et à l'administration du produit exclut toute autre activité. Je connais une lanceuse de marteau qui s'est vue contrainte d'interrompre son sport après une fracture du bras. Sujette à des troubles du comportement, de l'humeur, du sommeil, elle a résolu, avec l'aide d'un ami médecin, de changer son plâtre pour retrouver une liberté de mouvement autorisant l'entraînement.
Deuxième hypothèse : l'usage nocif. C'est un comportement qui ne conduit pas à une dépendance, mais qui crée des dommages. Les sportifs dépendants sont peu nombreux. Ceux qui utilisent des produits nocifs le sont davantage. Enfin, troisième cas de figure : l'usage occasionnel.
Toutes ces conduites conduisent à élaborer ce que j'appelle un bricolage chimique. Il est souvent intentionnel : dans le cas du toxicomane, il vise à procurer du plaisir, dans les autres cas, à augmenter la performance ou à supporter la douleur de l'entraînement.

Quelle est selon vous la principale explication du recours au dopage chez les sportifs ? L'appât du gain ? La pression familiale ou médiatique ? L'identification au champion ?
Stéphane Diagana m'a dit un jour que son entraîneur le motivait en l'incitant à « tuer » tous ses adversaires. « Avec qui est-ce que je vais courir ? » demandait celui-ci en retour. La volonté de faire une belle performance est une première explication. À mesure que le niveau s'élève, les sportifs sont animés de l'envie de faire mieux que les autres. Puis vient l'impératif de reproduire la performance, maintenir son niveau : car tous les sportifs sont sujets à l'angoisse de ne pas réitérer le résultat établi auparavant. À tout cela s'ajoute l'idée qu'il est logique de prendre des produits, parce que tout le monde le fait.
L'addiction au mouvement est rarement évoquée. Les marathoniens ou les haltérophiles, par exemple, ne peuvent bientôt plus se passer de l'activité physique, musculaire et intellectuelle à laquelle ils s'adonnent plusieurs heures par jour.
Deuxième problème, l'évacuation de toute vie extérieure, citoyenne ou familiale : hors l'activité sportive, plus rien n'a d'importance. C'est surtout vrai chez les sportifs de haut niveau, mais parfois également chez les amateurs, surtout ceux qui connaissent des difficultés de vie et trouvent un point d'ancrage dans un sport. Enfin, le dopage provoque parfois une altération de la liberté, à l'instar de ce que provoque la consommation de cocaïne ou d'héroïne.
C'est mon principal champ de compétence. Certains produits sont communs à la toxicomanie et aux conduites addictives. On sait par exemple que la cocaïne, qui améliore la perception du champ visuel et la rapidité de réaction, est très consommée dans les sports de raquette. De même, des études ont révélé que les élèves des grandes écoles consommaient des corticoïdes, à l'instar des sportifs de plus ou moins haut niveau.
Ceci est susceptible d'induire des troubles psychopathologiques, comme des états dépressifs en cas d'interruption de la prise des substances. Ces états ne sont toutefois pas toujours faciles à imputer à l'arrêt des produits plutôt qu'à l'arrêt de la pratique sportive.
La position iconique des sportifs de haut niveau est également source de risques sociétaux. Le bricolage chimique devient un modèle. C'est de ces icônes que les cadres du privé s'inspirent lorsqu'ils recherchent la performance.

Plus que l'appât du gain, c'est la gloriole qui anime les sportifs, la volonté d'être l'homme sur le pavois, quitte à employer des moyens pas très naturels. Cela vaut aussi bien pour les sportifs du dimanche, ceux qui feraient tout pour pouvoir dire qu'ils ont battu leur voisin de palier au tennis ou à la course de vélo...
Quelles actions de reconversion et d'accompagnement psychologique peut-on envisager pour les sportifs en fin de carrière ?
On accuse souvent l'argent. Il joue un rôle, indiscutablement. Mais pour un certain nombre de sportifs de haut niveau, il n'est qu'un marqueur de leur statut, de la réussite sociale acquise grâce à leurs exploits sportifs. L'aisance avec laquelle ils le dépensent l'atteste.
L'image d'eux-mêmes est un autre moteur, puissant. Certains sportifs ne cessent de se demander qui ils sont et ce qu'ils donnent à voir. Le processus est similaire à celui de l'anorexie mentale, dont le corps doit être montré dépourvu de signes de féminité. L'image sociale compte beaucoup. Aux Jeux olympiques de Londres, je me suis retrouvé un jour en compagnie de Marie-José Pérec et de Laura Flessel : au nombre de personnes qui m'en ont parlé ensuite, j'ai pu faire l'expérience de ce que produit la notoriété. Cet extraordinaire capital, comment ne pas vouloir le conserver ? La fin de carrière provoque chez les sportifs des dégâts somatiques importants. « Je m'arrête parce que je suis tout cassé » m'a dit l'un d'entre eux. « Que vais-je devenir ? » ne cessent-ils de se demander. « Je n'étais que cela », se plaignent-ils. Comme si toute leur personne était réduite à leur corps sportif. Il faut être très attentif à ces situations. Contrairement à ce que l'on dit, beaucoup de fédérations accompagnent les sportifs de haut niveau dans cette nouvelle phase de leur parcours.

Avez-vous le sentiment que les spécialistes de la psychologie de la performance sportive sont suffisamment associés à la lutte contre le dopage ?

Faut-il associer davantage les psychologues à la formation des jeunes sportifs ?
La préparation mentale a pour objectif de mettre celui qui s'y soumet en condition favorable à la pratique du sport, et non dommageable pour sa santé. C'est une première approche. Elle est répandue.
Nous sommes bien moins nombreux à nous pencher sur l'aspect psychologique des pratiques sportives, du sport de haut niveau et du quotidien. Cette pratique impose d'abord de produire des connaissances académiques. J'ai moi-même commis quelques travaux sur la question. Ils ne sont pas légion. Les appels d'offres sur le sujet sont incroyablement discrets, qui n'émanent que de deux ou trois laboratoires. Ensuite, la rencontre avec les sportifs est assez problématique, car ceux-ci ne sont pas demandeurs de notre expertise. Aucun d'entre eux ne dira qu'il souffre. Sollicités uniquement en aval, pour aborder des cas pathologiques, nous sommes souvent désemparés. J'ai suivi un trader qui me disait consommer de la cocaïne quand les marchés étaient en crise. Puis il s'est mis à en consommer hors périodes de crise. Il est venu nous voir parce qu'il voulait, non pas arrêter, mais se limiter à une consommation de crise. Mais quel est le seuil de la crise ? La demande des sportifs ne colle pas avec notre approche de la psychopathologie. Enfin, notre discipline traite des cas de troubles psychopathologiques confirmés. Plus le sport est pratiqué à haut niveau, plus les athlètes sont fragiles. Il faut comprendre les violences sexuelles dans ce cadre, car les sportifs, incapables qu'ils sont de gérer leur vie, sont totalement dépendants des personnes qui les entourent. L'un d'eux m'a dit un jour qu'il se sentait comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent et qui gagne au loto.
Je voudrais que vous compreniez la solitude dans laquelle nous sommes lorsque nous menons cette prévention et cette lutte. Nous sommes très peu nombreux. Beaucoup trouvent notre action positive, mais nous manquons toujours de moyens. L'antenne que je préside me prend une vacation par semaine et occupe un médecin et un psychologue à mi-temps, tout cela pour vérifier les autorisations d'usage des médicaments à des fins thérapeutiques (AUT), accueillir les gens qui ont été contrôlés et faire de la prévention. Et encore, je me sers du service d'addictologie dont je suis responsable et utilise le site dédié de l'institut régional de biologie et de médecine du sport dont je suis président. J'ai les plus grandes difficultés à gérer mon budget annexe, qui fait partie du budget de mon CHU. En outre, comme il n'est pas aisé pour tout le monde de se rendre à l'hôpital, j'ai été forcé de m'implanter dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps). Quand je pense que mon antenne fait partie des plus richement dotées !
Enfin, je veux insister sur le travail à mener avec l'ensemble des citoyens. L'interdiction de fumer dans les lieux publics a mis des années à s'imposer, après de multiples campagnes axées sur le tabagisme passif plutôt que sur le respect d'autrui. La représentation nationale et les médias ont peut-être ce pouvoir d'infléchir les représentations collectives, afin que les citoyens quittent leur position de déni. Aucun travail constructif ne peut être mené à long terme sans l'adhésion des citoyens.