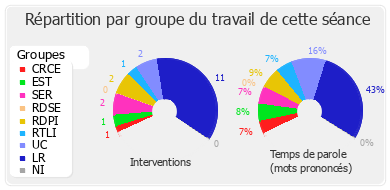Séance en hémicycle du 11 octobre 2023 à 22h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023.
Dans le débat, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’éprouve un immense plaisir à retrouver certains d’entre vous et à accueillir de nouveaux élus – j’adresse toutes mes félicitations aux intéressés – pour échanger, comme avant chaque Conseil européen, sur les principaux sujets qui y seront traités.
Avant tout, permettez-moi de rappeler que la France est pleinement solidaire d’Israël et se tient à ses côtés en ce moment tragique. Je tenais à adresser toutes mes condoléances aux familles touchées par ce drame effroyable et à leurs proches.
Le Président de la République a exprimé lundi dernier, avec ses homologues allemands, italiens, britanniques et américains, notre soutien ferme et uni à l’État d’Israël, ainsi que notre condamnation sans équivoque du Hamas et de ses effroyables actes de terrorisme.
Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne se sont réunis hier en urgence. Ils ont réaffirmé le droit d’Israël à l’autodéfense, dans le plein respect du droit international humanitaire. Les chefs d’État et de gouvernement reviendront évidemment sur la situation dans ce pays et sa région lors du Conseil européen.
Celui-ci se déroulera du 26 au 27 octobre prochain, trois semaines après le Conseil européen informel qui s’est tenu à Grenade le 6 octobre dernier, ville où avait aussi eu lieu, la veille, la troisième réunion de la Communauté politique européenne (CPE).
Vous le savez, l’actualité évolue vite. Aussi, les éléments et positions que je partagerai avec vous ce soir sont susceptibles d’évoluer d’ici au Conseil européen. Je serai, le cas échéant, à votre disposition pour échanger sur ces évolutions à l’occasion d’une audition en commission des affaires européennes.
Premièrement, les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur le sujet de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.
D’abord, ils rappelleront, dans la continuité de la réunion de la Communauté politique européenne à Grenade, leur engagement à soutenir l’Ukraine dans tous les domaines et aussi longtemps que nécessaire, y compris en matière financière, dans un contexte d’incertitudes au sujet de l’aide américaine.
Ensuite, ils évoqueront le soutien au plan de paix du président ukrainien et les moyens de renforcer nos efforts de conviction à l’égard des pays tiers.
De plus, les chefs d’État et de gouvernement discuteront des moyens de consolider les corridors de solidarité européens pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale en permettant aux exportations agricoles ukrainiennes d’atteindre les marchés sans entraves.
En outre, il s’agira d’ancrer notre soutien militaire dans le long terme, notamment au travers de la Facilité européenne pour la paix (FEP), afin d’appuyer l’Ukraine tout en renforçant la base industrielle de défense européenne. Pour cela, nous entendons également promouvoir les coopérations avec la base industrielle de défense ukrainienne, dans la continuité de la visite qu’a réalisée le ministre des armées à Kiev le 28 septembre dernier, en compagnie d’une importante délégation d’industriels français de défense.
De surcroît, les chefs d’État et de gouvernement reviendront sur les actions engagées par l’Union européenne et par les États membres en matière de lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis en Ukraine et de recours aux actifs russes gelés et immobilisés.
Enfin, ils discuteront en parallèle des moyens d’accroître la pression sur la machine de guerre russe et de lutter contre le contournement des sanctions, ce qui est pour nous une priorité.
Deuxièmement, les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur un point qui est désormais régulier lors des Conseils européens : les migrations.
Face aux drames successifs, comme récemment à Lampedusa, il faut se féliciter qu’un nombre croissant d’États soient convaincus de la nécessité d’avancer en Européens. Je n’en doute pas, vous aurez noté que Mme Meloni elle-même reconnaît que la solution ne peut être qu’européenne. Elle n’est toutefois pas encore parvenue à en convaincre ses partenaires polonais et hongrois, qui se sont – vous l’avez vu – opposés à l’adoption d’une déclaration commune à Grenade sur cette question.
Néanmoins, les échanges dans cette ville entre États membres de la CPE, puis entre États membres de l’Union européenne ont confirmé que les Européens partagent des objectifs communs.
D’abord, nous cherchons avant tout à prévenir les départs, bien entendu par des actions sur les causes profondes des migrations, mais également par une lutte contre les trafiquants et réseaux de passeurs. Nous changerons d’échelle dans notre coopération avec les pays d’origine et de transit pour nous diriger vers des partenariats plus opérationnels en déployant sur le terrain des experts de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dite Frontex, et d’Europol, afin de combattre ensemble les trafiquants d’êtres humains.
Ensuite, l’enjeu est de mieux organiser la gestion des personnes arrivant sur le territoire européen, grâce à une politique qui allie responsabilité des États membres dans la protection de nos frontières communes et solidarité et humanité dans le traitement des demandes d’asile.
Enfin, il convient d’accélérer les retours pour les personnes qui n’ont pas vocation à rester sur le territoire européen.
Il faut saluer plusieurs avancées sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps.
En premier lieu, le pacte sur la migration et l’asile a fait l’objet d’un accord au Conseil, la semaine dernière, sur l’ensemble de ses composantes avec l’adoption d’un mandat pour le règlement sur les situations de crise. La condition était indispensable pour que les négociations avec le Parlement puissent se poursuivre. Nous aurons un accord interinstitutionnel et l’adoption du pacte avant les élections européennes si nous maintenons cette dynamique, et la France y prendra toute sa part.
En second lieu, les enjeux de dimension extérieure, c’est-à-dire les actions à l’égard des pays d’origine et de transit, rassemblent la totalité des États membres, comme en témoigne le large soutien assuré au mémorandum d’entente signé avec la Tunisie au mois de juillet dernier. Il convient désormais d’en assurer la mise en œuvre avec un pilotage robuste qui s’appuie sur des objectifs précis et avec des contreparties clairement exprimées et vérifiées.
La conclusion de ces partenariats, mutuellement bénéfiques avec les États tiers, permettra de maîtriser les flux migratoires en traitant les causes profondes des migrations, en prévenant les départs pour éviter des drames humains et en renforçant la coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants. Nous restons vigilants quant à la mise en œuvre rapide du mémorandum avec la Tunisie, et nous participons activement avec d’autres États membres au renforcement de notre dialogue migratoire avec les États tiers. Concrètement, M. Schinas, vice-président de la Commission européenne, a déjà eu des entretiens constructifs en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, plus récemment poursuivis en Gambie et en Mauritanie.
Troisièmement, les chefs d’État et de gouvernement aborderont des sujets économiques.
Le premier sujet est la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. La France – vous le savez – se montre très vigilante quant à l’élaboration et au suivi du budget européen. Dans ce contexte, et en cohérence avec nos objectifs budgétaires nationaux, il nous faut trouver les bons équilibres entre la soutenabilité des finances publiques et les moyens à donner à nos priorités politiques.
La première de nos priorités est le soutien à notre voisin ukrainien pour assurer sa résilience, sa reconstruction et sa modernisation. La nouvelle facilité pour l’Ukraine proposée par la Commission européenne est, même si je vous épargne les chiffres, un signal fort : nous continuerons à soutenir politiquement, économiquement et financièrement ce pays, aussi longtemps que nécessaire.
La seconde priorité est celle de notre souveraineté industrielle. La prise de conscience est réelle face à la loi sur la réduction de l’inflation (IRA, Inflation Reduction Act) aux États-Unis. Elle doit désormais se traduire par un soutien résolu à la compétitivité de nos entreprises européennes. À cet égard, la plateforme, proposée par la Commission, Technologies stratégiques pour l’Europe, dite Step (Strategic Technologies for Europe Platform) devrait nous permettre d’encourager les investissements dans les technologies dites critiques, comme celles de rupture dans le digital, dans les clean-techs ou dans les biotechnologies, mais aussi, ce qui est important, d’améliorer la visibilité des financements de l’Union européenne pour nos entreprises européennes de pointe.
Par ailleurs, dans le contexte de pression migratoire que j’évoquais, la Commission européenne propose de renforcer les moyens existants consacrés à notre politique en la matière. Une partie de ces abondements doit accompagner la conclusion, puis la mise en œuvre du pacte, tandis que des financements seront également fléchés vers la coopération avec les pays tiers.
Ainsi, l’Union européenne doit bénéficier de moyens adéquats pour répondre aux crises actuelles et pour se renforcer durablement. La France est attachée au fait qu’un accord ambitieux intervienne sur la révision du CFP, mais nous sommes vigilants pour que les hausses proposées soient strictement nécessaires.
Nous sommes ainsi en faveur d’une priorité à donner aux redéploiements de fonds peu ou pas consommés avant d’envisager de nouvelles contributions des États membres. De même, nous ne pouvons pas accepter la proposition de la Commission d’augmenter les dépenses administratives de l’Union européenne.
Les discussions seront également denses autour des progrès à faire ou à poursuivre en matière de compétitivité économique.
Le premier volet en la matière est bien sûr celui de l’énergie ; nous en avons longuement discuté dans cet hémicycle. Quelques jours après la réunion des ministres concernés, les chefs d’État et de gouvernement échangeront ainsi sur les politiques en cours d’élaboration concernant les prix de l’énergie.
À ce titre, la réforme du marché de l’électricité représente un enjeu majeur pour l’ensemble de l’Union européenne. Alors que le niveau et la volatilité des prix sont amenés à s’accroître et que certains de nos partenaires assument une forme de protectionnisme, l’Europe doit se montrer réactive et forte en prenant les décisions qui s’imposent pour préserver sa compétitivité énergétique et son indépendance. Pour atteindre ces objectifs, la réforme du marché de l’électricité doit ainsi permettre de décorréler le prix de notre électricité des énergies fossiles et, en même temps, de créer un cadre plus incitatif pour accélérer le déploiement de moyens de production d’électricité décarbonée. Notre énergie sera ainsi plus fiable, plus abordable et plus verte, tout en restant dans le cadre d’un marché transfrontalier solidaire qui a montré toute sa pertinence ces derniers mois.
Le deuxième volet est la politique industrielle. Il faut se féliciter du fait que ce qui était perçu comme un concept français soit à présent unanimement reconnu par l’Europe. Le discours sur l’état de l’Union de la présidente de la Commission européenne, où la politique industrielle des transitions verte et numérique tenait une place centrale, a bien montré cette prise de conscience. Nous attendons d’ailleurs le résultat d’une première évaluation de la stratégie européenne en la matière, que la Commission européenne devrait publier prochainement et qui permettra de raffiner cette politique.
Nous avons déjà des avancées concrètes. D’une part, le dispositif prévu dans le règlement européen sur les semi-conducteurs (European Chips Act) est à présent une réalité. D’autre part, le règlement pour une industrie « zéro net », dit NZIA (Net-Zero Industry Act), favorisera l’implantation de capacités domestiques de production de technologies vertes et assurera un approvisionnement diversifié, résilient et durable en matières premières critiques. Les deux textes sont en cours de discussion. Les chefs d’État et de gouvernement devraient se prononcer pour leur adoption rapide.
Le troisième volet de la compétitivité est la sécurité économique.
La semaine dernière, la Commission européenne a établi la liste d’un certain nombre de technologies critiques, comme les semi-conducteurs de pointe, les technologies quantiques ou l’intelligence artificielle. Les Européens doivent désormais se coordonner pour mieux protéger ces technologies, de façon souveraine et indépendamment de ce que font les États-Unis.
La partie du Conseil européen réservée aux sujets divers sera consacrée aux préparatifs de la COP28 et au Sahel.
L’objectif de la COP28, qui aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023, est de mobiliser nos partenaires, notamment européens, afin d’obtenir des engagements forts de la part des grands émetteurs. Il s’agit en particulier de chercher à fixer une trajectoire de sortie des énergies fossiles.
Enfin, le Conseil européen abordera la question du Sahel. Nous devons tirer toutes les conséquences du cycle des coups d’État intervenus dans plusieurs pays et réfléchir collectivement à une nouvelle approche de l’Union européenne dans la région.
Cette approche doit être non pas punitive, mais réaliste : si ces États ne veulent pas travailler avec nous, pourquoi devrions-nous nous y maintenir ? Tant que les autorités de facto de ces trois États ne feront pas de gestes clairs – des actes et non pas des paroles –, nous n’aurons aucune raison de continuer à dépenser autant de ressources pour des partenaires qui ne veulent pas de nous.
Les événements au Niger, au Mali et au Burkina Faso montrent toute la pertinence d’un engagement accru de l’Union européenne au profit d’autres partenaires, demandeurs de coopération, comme les pays du golfe de Guinée. Nous devons concentrer nos efforts en direction de ces partenaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont, en quelques mots, les enjeux de ce Conseil européen. Je ne doute pas que, comme à l’accoutumée, vos interventions me permettront de préciser certains points.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Karine Daniel et M. Ahmed Laouedj applaudissent également.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens d’abord, au nom de l’ensemble des membres de la commission des affaires étrangères, à réaffirmer notre soutien au peuple israélien, victime d’attaques terroristes du Hamas d’une ampleur sans précédent depuis ce week-end, et à lui faire part de notre solidarité.
Nous partageons la souffrance des familles des victimes et celles des personnes qui sont encore, à l’heure où nous parlons, retenues captives par les terroristes.
Ces actes, dont le monde entier est le témoin horrifié, constituent une violence non seulement ignoble en soi, mais encore parfaitement sans issue, car nul ne saurait soutenir que les terroristes servent les intérêts des Palestiniens.
Dans ces circonstances d’épouvante, le soutien de la France à la démocratie israélienne, dont la sécurité n’est pas négociable, doit être sans faille. Au-delà, c’est toute l’Union européenne qui doit s’exprimer avec force en ce sens à l’occasion de la réunion du Conseil européen.
Notre pays, dont la blessure ouverte par le terrorisme islamiste n’est pas encore refermée, sait la difficulté de réagir à un tel drame.
Cette crise n’en est malheureusement qu’à ses débuts, mais nous croyons indispensable qu’Israël mette tout en œuvre pour s’assurer du respect du droit international humanitaire dans sa riposte.
Réunis hier après-midi, les ministres des affaires étrangères des Vingt-Sept ont décidé de maintenir l’aide financière versée par l’Union européenne à la Palestine. Nous en prenons acte, madame la secrétaire d’État, mais nous voulons aussi des garanties que ce soutien ne sert pas indirectement au financement du terrorisme, lequel est, à l’évidence, bien entretenu par certains acteurs régionaux.

J’en viens au programme initial du Conseil européen des 26 et 27 octobre prochain. Celui-ci a été précédé par le sommet de la Communauté politique européenne qui s’est tenu à Grenade le 5 octobre, préalablement au Conseil européen informel de la semaine dernière, dont les réflexions doivent préfigurer l’agenda stratégique pour la période 2024-2029.
Ceux que cette frénésie de cogitation étourdit un peu retrouveront leurs esprits en lisant le communiqué relatif à l’ordre du jour du sommet de Grenade : les décideurs de tout le continent ont discuté des moyens de « rendre l’Europe plus résiliente, prospère et géostratégique ».
En termes compréhensibles par tous, la stratégie européenne repose depuis le mois de février 2022 sur un triptyque : renforcer nos efforts de défense communs, réduire notre dépendance énergétique et rendre notre économie plus robuste.
Madame la secrétaire d’État, le bilan n’est guère rassurant !
Nos efforts de défense communs sont à la peine.
Au mois de mars dernier, le président Cambon vous interrogeait déjà sur le risque d’accroître notre dépendance à l’égard de l’industrie américaine.
Six mois plus tard, la coopération franco-allemande a subi de sérieux revers ; la Finlande, la Roumanie et la République tchèque ont annoncé l’achat de dix douzaines de chasseurs F-35, et la Pologne, qui a pour ambition de se doter de l’armée terrestre la plus puissante d’Europe, dépense plus de 4 % de son PIB en matériel principalement américain.
Dans le domaine énergétique, nous saluons l’ambition du plan REPowerEU, qui vise à se défaire de la dépendance au gaz russe.
Toutefois, à la lumière de ce que viennent de subir les Arméniens du Haut-Karabagh, il faut reconnaître que l’accord passé par la présidente von der Leyen avec le président d’Azerbaïdjan au mois de juillet 2022 pose d’inconfortables questions. Voilà pour la résilience !
Sur la prospérité, ayons le courage de la vérité : les indicateurs de croissance, de confiance et de robustesse industrielle européens sont plutôt mauvais.
Nous souhaitons, enfin, que vous nous précisiez l’analyse du Gouvernement sur les perspectives d’élargissement et, surtout, sur les conditions auxquelles cet élargissement serait envisageable. À quel horizon le voyez-vous ? Quels changements exigera-t-il ?
Par exemple, pouvez-vous nous dire quel jugement vous portez sur le rapport, publié par douze politologues à la mi-septembre, qui préconise une fédéralisation accrue ? L’adhésion des peuples fait-elle seulement partie du débat ouvert par ce rapport d’experts franco-allemands, lequel n’a été publié, dois-je le rappeler, qu’en anglais ?
Le temps manque pour évoquer le soutien à l’Ukraine, dans l’incertitude de l’appui américain, ou la question brûlante de la gestion des migrations en Méditerranée. Peut-être y reviendrez-vous dans votre réponse.
Madame la secrétaire d’État, de sombres nuages s’amoncellent au-dessus de notre monde. Nos concitoyens attendent que la France propose à nos partenaires européens un cap clair qui permette de défendre nos intérêts !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicai ns et sur des travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’aborderai pour ma part deux sujets : la révision du cadre financier pluriannuel, d’une part, la réforme des règles budgétaires européennes, d’autre part.
La révision du cadre financier pluriannuel me semble incontournable au regard, tout d’abord, de la progression des taux d’intérêt induite par l’inflation, ensuite, des nouvelles dépenses rendues nécessaires par la guerre en Ukraine.
Le projet proposé par la Commission européenne au mois de juin dernier comprend notamment une facilité pour l’Ukraine, une augmentation du budget européen pour faire face aux défis liés aux migrations et une nouvelle plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe, dite Step.
Madame la secrétaire d’État, ne craignez-vous pas que cette révision du budget de long terme de l’Union européenne ne se fasse au détriment d’autres politiques communes ?
Par ailleurs, afin de répondre à ces besoins de financement supplémentaires, cette révision du cadre financier serait accompagnée d’un nouveau paquet de ressources propres. Il est ainsi question d’une ressource propre fondée sur les bénéfices des entreprises, d’une révision du système d’échange des quotas d’émission et d’une modification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Les retards pris dans la mise en place du précédent panier de ressources devraient nous inciter à la prudence.
Madame la secrétaire d’État, quel est le calendrier de la mise en place de ces nouvelles ressources propres ? Celles-ci vous paraissent-elles à la hauteur de la révision du cadre financier ?
J’en viens à mon second point : la réforme des règles budgétaires européennes. La suspension du pacte de stabilité et de croissance décidée lors de la crise sanitaire prendra fin en 2024, que les États membres se mettent d’accord ou non sur un nouveau cadre.
Les imperfections du cadre budgétaire actuel sont bien connues. Tout d’abord, ces règles budgétaires sont très – voire trop – complexes, car elles reposent sur des variables économiques non observables. Ensuite, leur application trop uniforme ne prend probablement pas assez en compte les différences de situations entre les États membres. Enfin, elles ne sont pas suffisamment souples pour permettre de différencier les dépenses qui doivent évidemment être maîtrisées de celles qui sont nécessaires pour faire face aux défis d’avenir.
Dans sa communication du mois de novembre 2022, la Commission européenne a proposé que les États s’engagent sur des trajectoires pluriannuelles de moyen terme en décrivant leurs cibles budgétaires ainsi que les réformes et investissements envisagés, de tenir compte des investissements prévus pour la transition écologique, le numérique et la défense et de différencier les objectifs prévus pour chacun des États en fonction de la situation de leurs finances publiques.
Toutefois, dans ses propositions plus récentes d’avril 2023, la même Commission européenne, à la demande des États frugaux, dont fait partie l’Allemagne, a ajouté à ces orientations la mise en place de mesures de sauvegarde. Celles-ci intègrent notamment une réduction minimale du déficit à hauteur de 0, 5 % du PIB par an pour les États dont le déficit annuel est supérieur à 3 %, ce qui est le cas de notre pays.
Or les projections de l’application de ces nouvelles règles à la France montrent que, si elles étaient mises en œuvre dès 2024, la France devrait ajuster son solde primaire structurel de 1, 1 point de PIB par an entre 2025 et 2028, soit 30 milliards d’euros d’économies chaque année !
Dans ce contexte, madame la secrétaire d’État, je m’interroge sur la crédibilité de la France pour participer à la renégociation de ces règles. Je rappelle en effet que la dette publique de notre pays a dépassé en 2023 le montant de 3 000 milliards d’euros et que le déficit français ne devrait pas repasser sous la barre des 3 % du PIB avant 2027 au regard du prochain projet de loi de finances. La France est malheureusement à ce stade le plus mauvais élève de l’Europe. Il apparaît ainsi très probable qu’une procédure pour déficit public excessif sera – ou serait – ouverte contre la France au printemps prochain.
Madame la secrétaire d’État, partagez-vous cette analyse ? Pensez-vous que l’état de nos finances publiques nous permette de peser, de façon décisive, dans la renégociation des règles budgétaires européennes ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.
Applaudissements sur les travées des groupe s Les Républicains et UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre débat porte sur la prochaine réunion du Conseil européen, qui se tiendra dans plus de quinze jours et dont l’ordre du jour, qui peut encore évoluer, tient en quelques mots vagues.
Dans ces conditions, comment le Sénat peut-il exercer un contrôle politique effectif sur le pouvoir exécutif qui représente notre pays au Conseil européen ?
Je pose cette question au nom du bureau de la commission des affaires européennes issu du renouvellement sénatorial, qui, à peine reconstitué jeudi dernier, m’a interpellé sur ce sujet, ainsi que sur le déroulement de ce débat.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.

Pour l’heure, je soulèverai trois questions centrales à l’approche du Conseil européen : la première a trait au budget européen, la deuxième à la sécurité économique et la troisième à la politique migratoire.
Au début de l’été, la Commission européenne a proposé une révision inédite du cadre financier pluriannuel à mi-parcours. Il est vrai que, depuis la définition de ce cadre en 2020, la pandémie de covid-19, l’agression de l’Ukraine par la Russie et la crise énergétique ont complètement rebattu les cartes. Dans l’intervalle, le budget européen a mué avec la création d’un instrument de relance, Next Generation EU, fondé sur un emprunt commun. Il est devenu un outil de gestion de crise grâce à des redéploiements et à la mobilisation de toutes les flexibilités possibles.
Sans doute n’est-il plus à même de répondre aux nouvelles priorités politiques : Ukraine, compétitivité et défis externes ? Toutefois, avant d’envisager une rallonge, que la Commission européenne imagine être de l’ordre de 80 milliards d’euros, prêtons attention à l’opinion défavorable portée par la Cour des comptes européenne sur la légalité et la régularité des dépenses budgétaires.
En 2022, les erreurs dans les dépenses financées par le budget de l’Union européenne ont fortement augmenté pour atteindre 4, 2 %, et même 6 % pour les dépenses fondées sur des remboursements. Il faut mieux contrôler l’usage des fonds européens. La France entend-elle le faire valoir en préalable à la discussion sur le cadre financier ?
Nous devons aussi en tenir compte dans la controverse sur l’avenir de l’aide européenne à la Palestine, qui divise l’Union européenne après l’assaut criminel du Hamas contre Israël. Cette aide est principalement accordée au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde : la Cour des comptes a examiné de près cette rubrique, dont la Palestine est le quatrième bénéficiaire avec 120 millions d’euros en 2022.
Or la moitié des opérations examinées comportaient des erreurs. La Cour des comptes cite notamment l’exemple d’une opération destinée à promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles en Palestine : les fonds ont été versés sans que le projet ait jamais vu le jour, faute de vérification… Si nous devons continuer de soutenir les Palestiniens, qui ne peuvent être assimilés au Hamas – j’insiste sur ce point –, nous devons aussi absolument renforcer le contrôle sur l’usage qui est fait des fonds européens dans ce territoire.
De même, nous ne pouvons ignorer le risque que représentent, pour le budget européen, les 18 milliards d’euros de prêts consentis en décembre 2022 à l’Ukraine au titre du nouvel instrument « assistance macrofinancière + ». En effet, ces prêts ne sont assortis d’aucun provisionnement pour couvrir le risque de défaut, ce qui est inédit concernant un État tiers. Les pertes éventuelles seront donc à la charge du budget de l’Union européenne, ce qui l’expose de manière inquiétante. Aussi voudrions-nous savoir, madame la secrétaire d’État, si la France soulèvera également ce risque lors des discussions budgétaires prévues lors du Conseil européen.
Mon deuxième sujet de préoccupation a trait à la sécurité économique : les chefs d’État ou de gouvernement prévoient d’évaluer les progrès européens en la matière. La récente recommandation de la Commission européenne sur les technologies critiques identifie, à cet égard, sans discussion, quatre technologies stratégiques comme particulièrement sensibles, mais laisse ouverte la question pour plusieurs autres, dont la technologie de fusion nucléaire.
Madame la secrétaire d’État, la France entend-elle rappeler au Conseil européen l’importance stratégique du nucléaire et son caractère éminemment critique pour la sécurité économique de l’Union comme pour la transition verte ? Cela vaut aussi bien pour la législation « zéro net » en négociation.
Le troisième et dernier sujet sur lequel je souhaite insister est la politique migratoire. Le Conseil européen devrait avoir une discussion stratégique sur la dimension externe des migrations, notamment sur la coopération avec les pays tiers, le sommet de Grenade n’ayant rien donné à ce sujet.
De fait, l’Union n’est toujours pas en mesure de juguler la pression migratoire à ses frontières extérieures : depuis le début de l’année, un nombre record d’étrangers en situation irrégulière est arrivé par la mer en Italie, représentant déjà le double de toute l’année 2022 et près du triple de l’année 2021.
Je me rendrai en Italie dans deux semaines avec le président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Nous devons solidairement mieux contrôler ces flux, de nombreux migrants irréguliers se pressant à la frontière franco-italienne.
C’est dans ce contexte tendu, qui justifie le rétablissement temporaire par la France de contrôles à ses frontières intérieures, que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très préoccupant le mois dernier : celui-ci prive, en pratique, d’effet utile tout refus d’entrée que la France déciderait à l’égard d’un migrant.
Madame la secrétaire d’État, que reste-t-il de notre politique migratoire après cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ? La France compte-t-elle mettre le sujet sur la table lors du Conseil européen ?

M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Sur ces sujets régaliens – le budget, la sécurité, l’immigration –, nous ne pouvons laisser ainsi dériver l’Europe au risque d’alimenter encore l’euroscepticisme.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la date du prochain Conseil européen approche. Nous n’en connaissons pas encore l’ordre du jour, mais nous pouvons aisément imaginer qu’il serait dominé par la dramatique actualité internationale.
En effet, les conflits aux portes de l’Union européenne se multiplient : guerre depuis près de vingt mois dans sa marge orientale entre l’Ukraine et la Russie, drame humanitaire dans le Haut-Karabagh, très vives tensions entre le Kosovo et la Serbie, attaque terroriste du Hamas en Israël. Je tiens d’ailleurs à renouveler la plus ferme condamnation de cette attaque au nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Les foyers de déstabilisation se multiplient donc à la périphérie de l’Union européenne, alors que celle-ci a trouvé la voie de la paix pour elle-même. En effet, les pays qui la composent connaissent la plus longue période de paix de leur histoire. C’est aussi là que les libertés individuelles et collectives, que l’égalité entre les hommes et les femmes, que la solidarité entre individus et entre États sont les mieux garanties.
L’Union européenne est une réussite pour elle-même, mais elle se montre, dans le même temps, incapable de conduire les pays de son voisinage sur ce même chemin. Voulons-nous peser dans la conduite du monde, quitte à perdre de notre autonomie au profit de l’Union européenne ? Ou préférons-nous rester chacun de notre côté et regarder l’histoire s’écrire sans nous au bénéfice des grands acteurs que sont les États-Unis et la Chine ?
Depuis 2022, un nouvel outil de coopération internationale a été créé sur l’initiative du Président de la République : la Communauté politique européenne, la CPE, qui regroupe quarante-sept États du continent. Sa dernière réunion, qui s’est tenue le 5 octobre à Grenade, a été l’occasion pour les dirigeants présents de réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Europe. Dans une déclaration commune, ils se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’économie, de l’énergie et de la migration.
La CPE offrira-t-elle plus de marges de négociation, conférera-t-elle plus de poids pour résoudre les conflits ? Quelle peut être son utilité ? L’Union européenne peut-elle s’en servir pour accroître son influence ?
Pour l’heure, dans les faits, cet outil, certes encore balbutiant, n’a pas empêché l’Azerbaïdjan de rouvrir le conflit au Haut-Karabagh. Le fait marquant de la réunion du 5 octobre a été l’absence du président de l’Azerbaïdjan, qui a décidé au dernier moment de ne pas y participer, privant ainsi le sommet de l’un de ses objectifs, à savoir une rencontre avec son homologue arménien sous l’égide de l’Union européenne. Ainsi, malgré le rôle essentiel joué par cette dernière, la question de ses relations avec les pays tiers reste posée.
La question des futures adhésions à l’Union européenne sera aussi très certainement débattue au cours du prochain Conseil européen. L’Union européenne devrait accueillir jusqu’à neuf nouveaux membres au cours de la prochaine décennie : l’Ukraine, la Moldavie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, ainsi que la Géorgie et le Kosovo. Si l’adhésion de ces nouveaux membres, en particulier celle de l’Ukraine, recueille le vif assentiment des hauts responsables de l’Union européenne, tel n’est pas le cas dans tous les États membres. Qu’en est-il de la France, madame la secrétaire d’État ?
Une autre problématique prégnante, qui revient régulièrement depuis plusieurs années dans l’actualité, sera assurément abordée pendant le Conseil européen : la gestion des migrations. Le drame qui se joue au milieu de la Méditerranée devrait nous conduire à réfléchir à la valeur que l’on accorde à la vie et à notre humanité.
Le 4 octobre dernier, un accord a été trouvé entre les Vingt-Sept sur la répartition de la prise en charge des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. C’est un point de blocage en moins, qui ouvre la voie à l’adoption du futur pacte européen sur la migration et l’asile. Cela permettra non seulement de ne plus laisser l’Espagne, l’Italie et la Grèce seules face à l’afflux de migrants, mais également de mieux répartir les demandeurs d’asile, qui se trouvent aujourd’hui pour moitié en Allemagne, en France et en Espagne.
Ce plan stratégique d’urgence mis en place par l’Europe, dans lequel l’Italie joue le rôle de gestionnaire des flux, ne pourra pas durer longtemps. L’Allemagne a suspendu, depuis la fin du mois d’août, l’accueil volontaire des demandeurs d’asile et la France n’accueillera pas de migrants passés par Lampedusa, à l’exception des réfugiés politiques, ce qui représente entre 3 % et 7 % des personnes. Or, selon les ONG, la pression migratoire pourrait persister dans les mois à venir, voire s’aggraver, en raison de la concurrence entre les réseaux criminels de passeurs, qui baissent les prix de la traversée.
Il est donc urgent de mettre en œuvre ce futur pacte. Il ouvre la voie à une coopération plus grande avec les pays de départ. Mais ne nous y trompons pas : si nous voulons assécher les filières de passeurs et de traite des êtres humains, il nous faudra revoir notre politique de visa ; il faudra en accorder beaucoup plus.
N’est-il pas préférable de voir arriver en Europe, de manière légale et organisée, des personnes pour lesquelles nous pourrons mettre en place une véritable politique d’accueil – cours de langue, sensibilisation aux lois et à la culture du pays d’accueil, hébergement temporaire, contrat de travail signé avant le départ pour une durée déterminée, prise en charge du trajet aller et retour – plutôt que de continuer à subir cet afflux incontrôlé, qui jette des migrants, quand ils ne se sont pas noyés en Méditerranée, dans les rues et dans les bras de réseaux mafieux qui les exploitent, voire les réduisent en un esclavage moderne ?
La guerre en Ukraine a montré que l’Europe pouvait accueillir un grand nombre de réfugiés et que les frontières ouvertes ne laissaient pas forcément passer des trafiquants d’êtres humains.
L’histoire montre que les migrants, poussés par la misère, par l’espoir d’une vie digne et par le souhait d’offrir à leurs proches restés au pays des moyens de subsistance, font preuve d’une détermination qui leur permet de surmonter tous les obstacles, qu’il s’agisse de déserts, de montagnes ou de mers. Rien, aucun mur, aucune barrière, ne les arrête.
Alors combien de temps encore allons-nous laisser croire à nos concitoyens que l’on peut réguler le flux des migrants juste en fermant les frontières ? Ce discours fait le jeu des extrêmes, favorise une rhétorique toujours plus radicale, qui sape la confiance de la population dans notre capacité à agir et à trouver les véritables solutions.
En outre, au regard de l’évolution démographique de l’Europe, l’immigration deviendra un apport indispensable à notre économie et à notre modèle social. Les États-Unis ont historiquement construit leur dynamisme économique et leur prospérité grâce à l’afflux constant de populations immigrées. Dans une moindre mesure, la France en a également bénéficié dès le milieu du XIXe siècle.
Madame la secrétaire d’État, quand pensez-vous que le pacte européen sur la migration et l’asile pourra entrer en application ?
Je terminerai mon intervention en rappelant que, proportionnellement à leur population, ce sont la Guyane et Mayotte, deux territoires français, qui accueillent le plus d’immigrés et d’étrangers. Ces deux collectivités sont dans des situations complètement différentes du reste du territoire national. Selon le dernier recensement effectué en Guyane en 2020, plus de 30 % des habitants de ce territoire sont d’origine immigrée, pour un total de 56 % d’étrangers. Plus de la moitié de la population guyanaise est étrangère !

À Mayotte, selon des données un peu plus anciennes, la proportion d’étrangers dans la population est de 48 %.
Quels seront les effets de ce pacte en Guyane et à Mayotte ? Ces deux territoires ont-ils seulement été pris en compte ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à faire part de tout notre soutien au peuple israélien, touché par les insoutenables attentats terroristes du Hamas. Nous espérons que l’Union européenne sera à la hauteur de ce moment et de ce défi majeur.
Le Conseil européen des 26 et 27 octobre prochain abordera de nombreux dossiers, dont certains sont structurants pour l’avenir de l’Union européenne. Dans le temps qui m’est imparti, je concentrerai mon propos sur les volets énergétique et financier.
Guerre en Ukraine, inflation, entretien et renouvellement des infrastructures : l’énergie est au cœur de tous les débats. L’augmentation de son coût est une préoccupation majeure des Français, qui peinent à se chauffer, mais aussi de nos entreprises, qui voient leur compétitivité s’éroder.
Il nous faut prendre des décisions, et vite.
Seul l’échelon européen permettra de répondre à ces défis, car l’énergie est depuis toujours un enjeu central de la construction européenne, comme le montrent la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca), celle de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) ou encore les objectifs ambitieux qui figurent dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Pourtant, la gestion de ce bien commun a été laissée au seul marché, ce qui a eu les conséquences que l’on connaît aujourd’hui : les graves dysfonctionnements dus à l’envolée historique des prix du gaz et de l’électricité observés l’hiver dernier.
Le marché actuel de l’énergie libéralisé n’est, en réalité, ni à même de réguler les crises ni en mesure d’assurer une énergie bon marché. Il faut donc rapidement trouver une solution à ces graves et récurrentes défaillances du marché européen de l’énergie, qui plombent aujourd’hui la compétitivité de nos entreprises et grèvent le budget des services publics, de nos collectivités territoriales et de nos ménages.
Nous devons travailler à une politique énergétique qui garantisse notre souveraineté – c’est absolument essentiel – tout en associant décarbonation et prix bas de l’électricité. C’est l’ambition que nous devons avoir pour la prochaine réforme du marché européen de l’électricité.
Dans un rapport publié hier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) affirme que l’Europe pourrait manquer de gaz ou devoir en acheter à prix d’or si l’hiver était rigoureux. Il est urgent que nous réfléchissions à une réforme qui rapproche les tarifs de l’électricité de leur coût réel de production et assouplisse le couplage des prix entre électricité et gaz.
La réforme du marché de l’électricité présentée le 14 mars dernier par la Commission européenne relève finalement plus de l’ajustement que du changement en profondeur que nous souhaitions. Elle maintient les grands principes en vigueur, notamment le système de prix marginal.
Cette proposition de réforme avait pour but d’inciter les producteurs d’électricité à conclure des contrats de long terme et à prix fixe, afin que les prix de l’électricité soient moins exposés aux variations des prix du gaz, lequel peut devenir extrêmement onéreux à court terme. Elle révèle les fortes dissensions entre la France et l’Allemagne, qui, en la matière, défendent deux modèles différents. L’enjeu, c’est bien la compétitivité industrielle au sein de l’Union européenne. Ce sont aussi les risques de distorsions que les modèles énergétiques impliquent.
Selon les dernières informations dont nous disposons, la présidence espagnole vient de présenter un compromis : toutes les dispositions concernant les contrats de complément de rémunération appliqués aux centrales existantes seraient supprimées. En outre, une possibilité de dérogation resterait ouverte, permettant aux centrales à charbon dépassant les limites d’émission de gaz à effet de serre de bénéficier de mécanismes de soutien.
Madame la secrétaire d’État, comment la France compte-t-elle défendre sa position lors du prochain Conseil Énergie ? Le Président de la République a évoqué une régulation franco-française du marché de l’électricité avant la fin des discussions européennes. Cette régulation vous semble-t-elle envisageable ? Il nous faut des réponses, car ces enjeux sont essentiels.
La décarbonation de notre économie nécessitera des investissements massifs. Ces derniers sont indispensables si nous voulons modifier nos modes de production et de consommation énergétique et, ce faisant, mettre en œuvre l’accord de Paris.
Pour la seule transition énergétique, la Commission européenne a estimé que 379 milliards d’euros d’investissements étaient nécessaires chaque année pour la période courant de 2020 à 2030. Or nous sommes loin du compte si nous voulons déclencher l’effet de levier nécessaire.
À ce défi s’ajoutent d’autres besoins, que vous avez vous-même évoqués : le soutien financier à l’Ukraine, les intérêts de la dette
Mme la secrétaire d ’ État le confirme.

En conséquence, les élus du groupe socialiste soutiennent un cadre budgétaire ambitieux pour répondre à ces défis environnementaux, de cohésion, de solidarité et de compétitivité.
La réponse à ces besoins passe nécessairement par l’augmentation des ressources propres. Le cadre actuel ne permet déjà plus de disposer des financements nécessaires pour relever les défis immédiats ni d’atteindre les objectifs que l’Union européenne s’est fixés. Il est urgent de mettre en place la taxe sur les transactions financières, qui est dans les tuyaux depuis longtemps, mais n’est toujours pas en vigueur. Selon nous, il est également indispensable d’instaurer un impôt de solidarité sur la fortune vert.
Nous attendons dès lors de la France qu’elle défende une position forte. Quelle sera-t-elle ?
J’y insiste, il est indispensable de doter l’Union européenne de moyens financiers puissants. De même, il faut alléger les contraintes financières pesant sur les États membres afin qu’ils puissent jouer leur rôle en déployant les investissements publics nécessaires.
C’est l’enjeu de la réforme du pacte de stabilité et de croissance engagée cette année. La crise de 2020 a démontré que ce cadre n’était plus adapté aux défis rencontrés par les États membres et qu’il avait contribué à brider la croissance et l’investissement, faisant prendre à l’Europe un retard considérable face à la Chine ou aux États-Unis. Sa suspension a été l’illustration de cette prise de conscience.
En l’état actuel des finances publiques des pays de l’Union européenne, personne ne peut évidemment imaginer revenir aux règles fondatrices du pacte. Les investissements liés à la transition écologique doivent, selon nous, être exclus des règles de déficit, sans quoi nous nous exposons à des retards considérables. Il faut certes rassurer les marchés, mais il faut également répondre aux besoins de nos concitoyens.
Madame la secrétaire d’État, alors que la clause de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance arrive à échéance, quelles sont les perspectives de révision avant la fin de cette année…

Mme Florence Blatrix Contat. … et quelles seraient les conséquences d’une absence d’accord ?
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’agression russe contre l’Ukraine a marqué le retour de la guerre, une guerre totale, sur le continent européen. Nous assistons presque impuissants à l’essor d’une instabilité grandissante au pourtour de l’Union européenne et à l’affaiblissement des instances internationales de dialogue et de résolution des conflits.
Qu’en est-il, dans tout cela, de l’Union européenne ? Malgré les quelques mesures prises, les Européens font face à la convergence des autoritarismes, de régimes qui se soutiennent plus ou moins directement et tentent par tous moyens d’action ou d’opportunité de nous déstabiliser.
Il y a quelques jours, au début de ce mois, Vladimir Poutine a fait cette déclaration : la guerre en Ukraine est non pas « un conflit territorial », mais un événement qui doit déterminer les « principes sur lesquels le nouvel ordre mondial sera fondé ».
Je le relève à mon tour : la récente attaque de groupes terroristes liés à certaines puissances contre Israël est aussi un message adressé à ses alliés occidentaux. Il en est de même de l’évincement de la France en Afrique au profit de la Russie, de la Chine ou de la Turquie.
Dans un monde qui devient chaotique, la politique des sanctions n’a pas permis, pour l’instant, de faire fléchir les États visés par des mesures restrictives. En fait, les sanctions sont souvent vues comme un complot contre les puissances émergentes et vécues comme une fierté nationale : vont-elles assez loin ou sont-elles seulement symboliques ?
Faute de réelles solutions européennes sur divers sujets, nous nous sommes liés dangereusement avec la Turquie, sur les questions migratoires, et avec l’Azerbaïdjan, pour des raisons énergétiques. Chacun connaît pourtant les visées territoriales de ces deux pays et les liens historiques qui les unissent.
Madame la secrétaire d’État, dans ces conditions, comment envisagez-vous de dialoguer avec ces États, notamment après la prise de vive force du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan ? Pour mémoire, au cours des dernières décennies, le groupe de Minsk n’a pas été en mesure d’obtenir une solution pacifique et négociée à propos du Haut-Karabagh.
Quelles seront les conséquences, s’il y en a, de la guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan sur la politique européenne du Partenariat oriental, et quelles aides humanitaires met-on en place ?
Après le bannissement des productions pétrolières et gazières russes, envisageons-nous de réduire notre dépendance aux sources d’énergie de la Caspienne, dans le cadre d’une vision stratégique globale ?
Je souhaite aussi, à mon tour, appeler votre attention sur les questions migratoires.
L’intensification des flux en direction, non seulement de l’Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni – la géographie est têtue ! –, témoigne d’une crise migratoire porteuse de nombreux dangers.
Je pense tout d’abord au sort des migrants, qu’il convient de rappeler. Souvent moins bien traités que des marchandises, ces femmes, ces hommes et ces enfants périssent régulièrement en mer ou sur les routes.
Je pense ensuite au renforcement des organisations criminelles : le trafic d’êtres humains leur vaut des profits colossaux pour des risques très limités, du moins pour elles. En parallèle, on constate la saturation des dispositifs d’accueil des États et, in fine, la montée de l’inquiétude des Européens au sujet de l’immigration incontrôlée extra-européenne.
Nous savons aussi que certains États utilisent l’« arme migratoire » pour semer la discorde entre membres de l’Union et au sein des populations européennes. Cette stratégie de fracturation de l’intérieur commence malheureusement à porter ses fruits : les récents scrutins qui se sont tenus en Allemagne illustrent la percée de l’extrême droite et je crains que les résultats des prochaines élections européennes ne traduisent lourdement cette tendance.
Dès lors, envisage-t-on réellement de tarir ces flux ou seulement de les gérer et de les répartir ? C’est, à mon sens, la question centrale, face à laquelle les Européens attendent une réponse politique et non des mesures techniques.
Qu’en est-il de l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie, que les autorités locales rechignent à mettre en œuvre, et quelle fiabilité peut-on attendre de la Turquie, dont le pouvoir dit ne plus rien attendre de l’Europe ? Comment coopérer en Afrique avec certains des pays d’origine, dont les autorités – la France est bien placée pour le savoir – résultent de récents coups d’État militaires ?
Madame la secrétaire d’État, avant de conclure, je me dois de dire un mot de la Chine.
Une prise de conscience européenne tardive émerge à l’égard de cette puissance, sur le déséquilibre des échanges, le non-respect de la propriété intellectuelle, les différences de normes ou encore, évidemment, les visées géopolitiques chinoises.
Les autorités européennes ont récemment annoncé vouloir défendre les domaines stratégiques, qu’il s’agisse des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques ou de la biotech. Quand et comment ces mesures seront-elles mises en place ? Quelles dispositions va-t-on prendre pour lutter efficacement contre la concurrence déloyale et contrer la coercition économique menée par la Chine ? On a bien en tête les mesures économiques de la Chine à l’encontre de la Lituanie, qui soutient Taïwan.
Quelles mesures envisage-t-on en réponse aux nouvelles régulations approuvées récemment par la Chine en matière de cybersécurité, de contre-espionnage et de gestion des données ?
Enfin, il faudra suivre de près les évolutions de l’économie chinoise : une éventuelle aggravation de la crise que connaît ce pays présenterait un risque important pour le monde et notamment pour l’Europe – dépendance, quand tu nous tiens…
Telles sont les quelques observations dont je souhaitais vous faire part avant ce Conseil européen. Son ordre du jour peut encore évoluer, mais je crois pouvoir dire que la tâche est immense et je crains que vous n’ayez perdu beaucoup de temps.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après l’invasion de l’Ukraine, les événements au Proche-Orient nous alertent une fois encore sur la nécessaire cohésion de l’Union européenne face au terrorisme et à tous les ennemis de nos démocraties.
L’effroyable attaque terroriste du Hamas contre Israël et les affrontements qui perdurent nous laissent craindre le pire quant aux pertes humaines.
Ce déchaînement de haine et les exactions commises contre des enfants, des femmes, des populations innocentes, nous rappellent les pages les plus sombres de notre histoire. Il est regrettable que la classe politique française ne condamne pas un tel massacre d’une même voix.
Toutes nos pensées vont bien sûr aux victimes, aux otages, aux blessés, ainsi qu’à leurs familles et au peuple israélien tout entier.
Le fragile processus de paix entre Israël et la Palestine est à nouveau bien compromis et les espoirs de rapprochement d’Israël avec d’autres pays arabes, comme l’Arabie saoudite, vont être sérieusement ébranlés.
L’Union européenne était fortement impliquée dans ces processus. Malgré cette situation critique, restons mobilisés ; ne nous décourageons pas.
Madame la secrétaire d’État, hier s’est tenue une réunion d’urgence des ministres européens des affaires étrangères. Au-delà du rappel des règles de droit international humanitaire et de la nécessité d’une solution politique à cette crise, voie que semble privilégier la France, pouvez-vous nous parler plus précisément des prochaines étapes et des mesures envisagées ?
Quelle position l’Union européenne peut-elle et souhaite-t-elle prendre dans ce conflit ? Comment les États membres pourront-ils coordonner leurs actions ?
Sur un autre front, contrairement aux prévisions de Vladimir Poutine, l’agression de la Russie contre l’Ukraine s’est révélée un ciment fort pour les pays européens.
À cette occasion, les États membres ont montré leur volonté de consolider leurs capacités militaires et de se préparer à de futures crises géopolitiques. Toutefois, nos réflexions sont-elles suffisantes ? Avançons-nous assez vite ? Dans un tel contexte, comment envisager l’évolution de notre politique européenne extérieure ou encore la constitution d’une armée européenne ?
Concernant précisément la situation en Ukraine, deux questions me paraissent majeures. Premièrement, avez-vous prévu de nouvelles aides pour les prochaines phases de ce conflit ? Deuxièmement, qu’en est-il de l’embargo sur les céréales ? Nous avons tous présentes à l’esprit les conséquences migratoires d’un affamement du continent africain.
Cette question migratoire est également à l’agenda du Conseil européen. Or chacun a pu constater son absence dans la déclaration de Grenade. Le pacte européen sur la migration et l’asile a pourtant fait l’objet d’un accord, mais les divers blocages observés persistent. Qu’en est-il précisément ?
En France, les chiffres de l’aide médicale de l’État (AME) explosent pour cette année 2023. La Méditerranée reste malheureusement le théâtre de trop nombreux drames humains. Les conflits, les catastrophes naturelles et les tensions sur le continent africain nous laissent présager le pire.
L’Europe ne pourra pas accueillir toute la misère du monde, alors que certains de nos voisins, comme la Russie, insensible à tous ces drames, nous observent en se frottant les mains, sans faire le moindre geste altruiste.
Face aux flux migratoires, nous avons besoin d’une gestion et d’un cadre communs. Nous ne pouvons pas laisser la responsabilité de cette politique à d’autres pays.
Quelle position la France adoptera-t-elle afin de faire évoluer ce dossier ? Pensez-vous que le choix d’un cap fort pourrait être un atout avant les élections européennes de juin prochain ?
L’Union européenne vient de faire face à deux crises majeures et concomitantes : l’épidémie de covid et l’invasion de l’Ukraine. Déjouant tous les pronostics, nous sortons renforcés de ces deux épreuves, qui ont pourtant mis à mal notre système économique et provoqué une crise inflationniste sans précédent, dont tous les Européens paient aujourd’hui les conséquences.
Nous le savons, l’issue de cette crise viendra d’une réponse collective et solidaire impliquant les citoyens, les différentes collectivités territoriales et les gouvernements.
À Grenade, les dirigeants européens ont rappelé la promesse fondatrice de l’Union européenne : garantir la paix et la stabilité aux Européens. L’une des priorités relevées est notre résilience. Nous savons que de nombreuses réformes restent à définir ensemble et le temps presse.
La crise inflationniste, consécutive à l’invasion de l’Ukraine, nous a rappelé douloureusement les lacunes accumulées au fil des ans en matière de politique énergétique.
Aujourd’hui, nous avons fait des choix très différents de notre voisin allemand, en relançant notre filière nucléaire. Je ne pense pas que le charbon germanique soit une solution souhaitable et durable. Quoi qu’il en soit, nos divergences ne sauraient effacer l’intérêt collectif de l’Europe en matière énergétique. Nous devons continuer de prospecter et d’acheter ensemble sur les marchés mondiaux.
Alors que 2024 se profile déjà, notre cap doit être clair. Un effort tout particulier doit être accompli en faveur des énergies renouvelables.
On ne peut que saluer la décision du Gouvernement de relancer notre filière nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs. Il paraît maintenant évident que, si nous voulons sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, nous devrons très rapidement améliorer notre mix entre bas-carbone, nucléaire et énergies renouvelables. Les citoyens européens doivent avoir accès à une énergie durable, abordable et en quantité suffisante.
Madame la secrétaire d’État, sur ce volet, quelles sont vos ambitions précises, qu’il s’agisse du développement nucléaire ou de la réforme du marché européen de l’électricité ?
J’en viens à un autre enjeu de souveraineté essentiel pour notre continent : l’agriculture.
La France, par la voix de sa Première ministre, a enfin décidé l’arrêt des surtranspositions qui ont tant pénalisé notre filière agricole. Je m’en réjouis.
Concrètement, ne pensez-vous pas qu’il est nécessaire d’uniformiser plus rapidement les réglementations encadrant nos politiques agricoles ? Ainsi, l’Europe pourrait parler d’une seule voix en se donnant, par là même, une image plus crédible sur les marchés internationaux.
L’Union européenne doit poursuivre les réformes de simplification et d’uniformisation des politiques de tous ses membres : tel est le prix de notre souveraineté et de notre avenir commun.
Dans un tel contexte, le scrutin européen de 2024 revêt une importance primordiale. Conscients de la poussée populiste, tous les Européens convaincus devront se serrer les coudes et s’impliquer pleinement. Ne laissons pas la main aux eurosceptiques. Continuons à dissiper les ignorances et à déraciner les passions destructrices. La construction européenne mérite notre engagement total !
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes tous encore sous le choc de l’attaque terroriste inédite dont a été victime Israël ce week-end. Nous mesurons les risques d’un nouvel embrasement du Moyen-Orient, d’une recrudescence du terrorisme en Europe, et l’impact de ces graves événements pour nos sociétés, dont on a malheureusement constaté, ces dernières années, la fragmentation et la fragilité.
Je tiens bien entendu, comme l’a fait notre président de groupe, Hervé Marseille, cet après-midi, à réaffirmer notre soutien et notre solidarité à Israël et à sa population. Je redis notre ferme condamnation des actes d’une barbarie inqualifiable perpétrés par le Hamas, qui a volontairement ciblé et pris en otage des civils, dont des enfants et des personnes âgées.
Que faire pour venir en aide à ces otages, misérables boucliers humains parmi lesquels se trouvent des Français ? Que faire pour éviter, par une escalade de la violence déjà à l’œuvre, le pire aux populations civiles palestiniennes, dont les terroristes, loin d’être les représentants, sont d’une certaine manière les bourreaux ?
Le Hamas – on le sait – est une organisation fanatique terroriste qui a toujours été hostile à la recherche d’un compromis de paix.
On l’a dit à juste titre : nous devons être intraitables envers le Hamas, envers toutes les organisations terroristes et envers tous ceux qui, en sous-main, les financent, les organisent et les soutiennent. Ces pays, comme le Qatar et l’Iran, également évoqués cet après-midi, sont bien connus. Insidieusement, ils alimentent la haine et la désolation dans le monde.
Nous devons aussi veiller à ne pas confondre cette lutte avec le droit humanitaire applicable aux populations civiles. L’ONU a d’ailleurs appelé les États influents à engager des discussions de résolution du conflit avec les parties, pour obtenir la libération des otages et éviter un siège total de Gaza, qui serait contraire au droit international. Un tel siège aurait pour conséquence le déplacement des populations palestiniennes vers l’Égypte, qui est déjà sollicitée.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous préciser les propositions qu’a déjà faites la France lors de la réunion des vingt-sept ministres des affaires étrangères des États membres et, en conséquence, sa position lors du prochain Conseil ? Nous sommes évidemment dans l’urgence, mais, dans un second temps, il faudra œuvrer, avec la communauté internationale, à la résolution de ce conflit.
Cette terrible réalité ne doit pas nous faire oublier la tragédie qui se joue depuis plusieurs mois en Arménie. Toutefois, ce point n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen. C’est la preuve, si besoin en était, que les Arméniens, ce peuple résistant et courageux, ont bel et bien été abandonnés, malgré les appels répétés de parlementaires et de politiques de tous bords qui se sont rendus sur place.
Ce n’est pas comme si la Commission européenne ne connaissait pas la tragédie qui se profilait là-bas. Or elle a cyniquement abandonné – je pèse mes mots – les 120 000 Arméniens du Haut-Karabagh, cette petite République autonome d’Artsakh rattachée à l’Arménie. Elle a renvoyé les parties prenantes au dialogue, comme si l’on pouvait faire confiance au président de l’Azerbaïdjan, Aliyev et à son funeste complice, le président turc Erdogan !
Mes chers collègues, qu’on se le dise : ce triste tandem ne sera pas rassasié par le seul anéantissement de la République arménienne d’Artsakh. Il s’attaquera ensuite à la « grande » Arménie toute proche, pour finir le travail du génocide de 1915.
Le Président Aliyev s’est déjà inventé un mobile pour sa guerre : au mépris de l’histoire, il affirme sans scrupule qu’Erevan est un territoire azerbaïdjanais ! Puisque la communauté internationale est silencieuse – et qui ne dit mot consent –, après l’Arménie viendra peut-être le tour de la Grèce, l’autre obsession ottomane.
Pourquoi les puissances occidentales, qui ont su s’opposer à Poutine et immédiatement venir en aide à l’Ukraine indûment attaquée, n’ont-elles pas dénoncé la fermeture du corridor de Latchine ni empêché le terrible blocus dont les Arméniens ont souffert pendant des mois ? Ainsi, elles ont indirectement encouragé l’attaque brutale menée par les forces azerbaïdjanaises le 19 septembre dernier. Plus de 100 000 des 120 000 personnes vivant dans le Haut-Karabagh ont dû partir.
Faute d’avoir agi le 19 septembre dernier, en trois jours, on a laissé s’effacer 3 000 ans d’histoire. Car, là-bas, c’est non seulement aux populations que l’on s’en prend depuis le début, mais aussi aux traces d’une histoire multiséculaire, que l’on s’emploie à effacer.
Un patrimoine religieux d’une valeur inestimable est aujourd’hui très gravement menacé, comme nous l’a rappelé lors d’une audition la présidente de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph), notre ancienne collègue Bariza Khiari.
Les monastères seront-ils bientôt détruits, comme l’ont été au siècle dernier à peu près tous les monuments arméniens, telle l’extraordinaire cité médiévale d’Ani, à l’est de la Turquie ?
Je me demande pourquoi, au début des années 1990, le monde s’était engagé derrière la Bosnie musulmane et pourquoi aujourd’hui les Arméniens sont, eux, à ce point abandonnés. Est-ce parce qu’ils ne forment qu’une toute petite minorité chrétienne entourée de pays musulmans ?
On dit que les Russes protègent l’Arménie. On peut sérieusement en douter, car, empêtré dans son conflit avec l’Ukraine, Poutine a besoin de la Turquie et surtout de l’Azerbaïdjan, gros exportateur d’énergies fossiles. Ce pays lui permet de contourner les sanctions occidentales, tandis que l’Union européenne double ses importations de gaz en provenance de Bakou ! Voilà la triste raison de notre silence et de notre complaisance.
Madame la secrétaire d’État, je vous en conjure : faites en sorte que l’Europe se réveille face à ce qui apparaît clairement comme une nouvelle épuration ethnique et religieuse. Apportons l’aide militaire qu’il espère au ministre arménien Nikol Pachinian, que Bruno Retailleau, Gilbert-Luc Devinaz et moi-même, avec notre groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités du Moyen-Orient et les Kurdes, avons rencontré à Erevan le 25 avril dernier.
Mme Catherine Colonna a parlé cet après-midi des aides humanitaires récemment accordées par la France. Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU a, de son côté, lancé samedi dernier un appel aux dons d’un montant de 97 millions de dollars pour aider les habitants du Haut-Karabagh réfugiés en Arménie et ceux qui les hébergent. Mais cela ne suffit pas.
Il faut réexaminer les relations de l’Union européenne avec Bakou. Des sanctions sont nécessaires au regard des nombreux témoignages de violences et d’atteintes aux populations civiles. Selon la presse européenne, les États membres de l’Union européenne avaient demandé au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de proposer des options punitives si la situation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan venait à se détériorer. Qu’attendons-nous donc ?
Mes chers collègues, cette actualité déjà très lourde s’est encore aggravée au cours des derniers jours. J’espère que les dirigeants de l’Union européenne vont prendre la mesure de cette inquiétante démultiplication des crises et des guerres, qui sont toujours plus nombreuses, hélas ! aux portes de l’Europe.
Ces conflits armés procèdent de la folie des hommes, des velléités expansionnistes de dictateurs qui piétinent allègrement le droit international et menacent à terme nos démocraties.
L’Ukraine, le Haut-Karabagh, Israël : voilà, à tout le moins, une combinaison dangereuse. La concomitance de ces crises qui touchent l’Euroméditerranée doit être prise au sérieux. On le sait, elles redistribuent les relations entre États. Elles peuvent, du même coup, changer la donne globale et mettre en danger l’équilibre planétaire.
Madame la secrétaire d’État, sur l’ensemble de ces dossiers, nous comptons sur vous. La France et l’Europe doivent être au rendez-vous, à la hauteur des valeurs des droits de l’homme, dont nous sommes les défenseurs. C’est ainsi que nous pourrons contribuer au retour de la paix.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le débat européen ne peut effectivement pas faire abstraction de la sidération provoquée par le terrorisme massif du Hamas.
Ces crimes systématiques et ces enlèvements à grande échelle traduisent la volonté délibérée de déclencher un embrasement fatal, de réactiver puissamment un cycle de haine qui brise toute perspective d’apaisement et fasse basculer des pays des Proche et Moyen-Orient.
En face, on trouve un gouvernement d’extrême droite qui amalgame tous les Palestiniens, parle d’« animaux humains » et de « siège total de Gaza ». Ce choix serait celui de la punition collective, infligée à plus de deux millions de personnes. N’est-ce pas précisément la réaction qu’escompte le Hamas ?
Face à l’horreur, l’Union européenne doit soutenir et le droit à la sécurité d’Israël et les droits légitimes des Palestiniens. Elle ne peut pas sombrer dans une logique d’amalgame et de haine. C’est pourtant cette logique qui transpirait dans l’annonce faite lundi dernier par le commissaire hongrois Várhelyi. À en croire ce dernier, l’Union européenne entendait suspendre tout son programme d’aide aux Palestiniens : en évoquant une telle punition collective et indiscriminée, il laissait entendre que les millions de l’Europe étaient détournés, voire alimentaient le Hamas.
On sait que la Commission a rétrogradé. L’Union européenne a affirmé hier son opposition au siège total de Gaza et la Commission ne parle plus que de « revoir » le dispositif d’aide.
C’est le résultat, dit-on, des réactions de l’Espagne, du Luxembourg, de l’Irlande, du Danemark. En outre, pour être légale, la révision d’un programme de cet ordre nécessite tout de même une proposition de la Commission européenne et une majorité qualifiée des États.
Quel rôle la France a-t-elle joué dans cette séquence confuse. Y a-t-il eu une réaction et, si oui, laquelle ? Pour éviter cette confusion, n’aurait-il pas fallu décider une réunion immédiate du Conseil européen, qui aurait permis une expression à la hauteur des événements ?
Les Arméniens du Haut-Karabakh, victimes d’une épuration ethnique d’ampleur, attendent de nous que nous prenions nos responsabilités et que nous fassions preuve de solidarité.
La complaisance gazière avec l’Azerbaïdjan doit cesser. Il ne peut plus être question d’un « partenariat fiable et durable » avec Bakou, pour reprendre les termes de la présidente de la Commission européenne. TotalEnergies et Patrick Pouyanné ne peuvent continuer d’afficher leur entente avec Aliyev.
Le Parlement européen demande des sanctions et une enquête sur l’origine des exportations de l’Azerbaïdjan, qui est une plaque tournante, on le sait, des contournements des sanctions contre la Russie ; suivons-le !
Les Ukrainiens, eux aussi, attendent de nous que nous prenions nos responsabilités et que nous fassions preuve de solidarité, alors qu’ils vivent un cauchemar depuis l’invasion russe. Notre solidarité ne peut pas leur faire défaut. Les importations européennes de gaz liquéfié et de nucléaire en provenance de la Russie augmentent de nouveau.
Le gouvernement polonais a décidé de ne plus livrer d’armes à l’Ukraine et le soutien durable des États-Unis paraît incertain, à l’approche de l’élection présidentielle l’an prochain. L’Union européenne ne peut pas laisser se déliter notre soutien aux Ukrainiens ; tenons sur ce point !
Face à l’invasion russe, notre réponse consiste à offrir une perspective d’élargissement de l’Union aux Balkans occidentaux et à l’Ukraine, pays insécurisés par un lourd voisinage… Le sommet de Grenade de vendredi dernier s’en veut le point de départ.
L’élargissement est une nécessité au regard de la situation géopolitique, bien sûr, mais aussi souhaitable qu’il puisse être, il n’est ni réalisable ni crédible sans une réforme du fonctionnement européen. On ne peut s’embourber à plus de trente États dans les blocages et les limites du fonctionnement actuel, qui plus est avec un budget contraint par des contributions nationales sans cesse marchandées. Avançons sur la réforme du fonctionnement et sur le déploiement des ressources propres, qu’il faut arrêter de reporter sans cesse.
Dans une Union à vingt-sept, les sujets de désaccords et de tensions sont déjà nombreux. Parmi eux, on connaît les difficultés que soulève le pacte sur la migration et l’asile, en discussion depuis trois ans, alors même que les demandes d’asile augmentent, que la crise climatique entraîne de nouveaux flux de réfugiés et que la situation au Proche-Orient bascule. Une réforme de ce pacte n’a donc jamais été aussi urgente.
Pourtant, en l’état, ce texte de compromis voté par vingt et un pays, dont la France, suscite plus de malaise que de fierté. Les yeux sont certes rivés sur la Hongrie et la Pologne, qui refusent tout mécanisme de solidarité, mais, selon nous, c’est l’essence même du pacte sur la migration et l’asile qui est néfaste. Pourquoi adopter dans la précipitation un texte médiocre, qui, d’une certaine façon, tend à criminaliser les ONG qui sauvent des migrants en mer ? Les personnes fuyant la guerre, l’oppression ou la mort ne doivent être traitées ni comme des menaces ni comme des flux migratoires irréguliers !
Cette nécessité de construire collectivement, de réformer notre cadre commun va à contre-courant des réflexes de repli et de la tentation de faire cavalier seul, auxquels incitent les crises qui déferlent.
« Reprendre le contrôle » – take back control – tel a été le mot d’ordre du Brexit. La France ne peut pas entonner cet air-là ! Bruno Le Maire a dit hier en substance que sortir du marché européen de l’énergie, c’était sortir de l’Europe. Pourtant, c’est un autre son de cloche que l’on entend aujourd’hui, la France ayant annoncé, par la voix du Président, qu’elle s’apprête à « reprendre le contrôle – il a choisi ces mots – du prix de l’électricité ». Quel est le signal envoyé ? Est-ce que « l’Europe, ça commence à bien faire » ?
Madame la secrétaire d’État, vous nous envoyez ce soir un signal différent, en nous assurant qu’il faut rester, j’ai bien entendu, dans le cadre d’un marché solidaire transfrontalier. Oui ! C’est tout de même l’appartenance au marché européen qui a assuré notre approvisionnement cet hiver, quand notre parc nucléaire était défaillant !
Enfin, l’autre front sur lequel l’Union européenne ne doit pas reculer, c’est celui du pacte vert, le Green Deal. À cet égard, je pense au glyphosate, que la Commission européenne s’apprête à autoriser de nouveau pour dix ans, malgré des milliers de procès et les vies brisées, malgré la reconnaissance des liens entre malformations et exposition prénatale à ce désherbant. La France doit défendre la santé des agriculteurs, qui sont les premiers exposés ! Elle doit jouer sans ambiguïté un rôle moteur pour faire interdire le glyphosate dans l’Union européenne.
Oui, la période est rude : face au risque de recul, de régression, de repli et d’éclatement, l’Europe doit tenir sur ses valeurs, sur la solidarité, sur les politiques de transition. Pour cela, elle a besoin d’une France qui agisse pleinement en Européenne.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Ce débat intervient dans un contexte particulier, après les attentats terroristes du Hamas, aux conséquences insoutenables pour la population israélienne.
Je tiens à souligner que l’Union européenne a la responsabilité d’ouvrir la voie de la paix, qui, seule, permettra aux peuples israélien et palestinien de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité.
J’en viens à l’ordre du jour du prochain Conseil européen.
Devant la représentation nationale, le responsable de la direction du renseignement militaire a mis en garde sur le risque de prolongement de la guerre en Ukraine en 2024, voire en 2025.
La perspective d’une guerre d’usure est acceptée par les dirigeants européens, dont notre Président de la République. Le seul espoir d’enrayer cette guerre serait de livrer des armes toujours plus performantes et d’intensifier la production de munitions sur le continent européen.
Après dix-huit mois de conflit, alors que l’on dénombre 500 000 morts ou blessés et que le montant cumulé des aides versées à l’Ukraine atteint 165 milliards de dollars, quels sont les résultats ?
Il est vrai que la responsabilité de ce désastre incombe au Kremlin, mais je souligne avec gravité, comme l’ont toujours fait les membres de mon groupe, que l’escalade militaire peut entraîner la perte de contrôle du conflit.
Pour parvenir à une paix durable, on ne pourra faire l’impasse ni sur le respect de la souveraineté de l’Ukraine ni sur des garanties de sécurité pour l’ensemble des pays de la région, dont la Russie.
Accepter la perspective d’une guerre d’usure, c’est accepter de faire peser ses conséquences sur les citoyens européens, notamment la hausse du prix de l’énergie !
La diversification des partenaires énergétiques de l’Union européenne, aussi urgente soit-elle, ne doit pas se faire au détriment de notre peuple. En négociant un contrat énergétique avec l’Azerbaïdjan et en qualifiant ce pays de « partenaire de confiance », l’Union a garanti l’impunité au régime du dictateur Aliyev.
Alors que 120 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabagh pour rejoindre l’Arménie, il nous semble urgent que l’Union européenne dénonce cet accord énergétique et impose des sanctions diplomatiques à l’Azerbaïdjan.
Les citoyens européens, frappés par une paupérisation insoutenable, ont perdu en moyenne 4 % de leur salaire réel. L’année dernière, dans certains supermarchés, des antivols ont été apposés sur des steaks et le vol à l’étalage a augmenté de 15 % en France et de 25 % aux Pays-Bas. Les Européens ont faim et peinent à se chauffer. Près de 95 millions de personnes sont menacées de pauvreté.
Pourtant, l’Union européenne poursuit sa politique d’austérité et de réduction des dépenses, ce qui se traduit politiquement par une révision du cadre financier pluriannuel. À cet égard, les négociations mettent en concurrence le financement de la guerre en Ukraine et la bataille pour la réindustrialisation.
Fondée sur deux piliers, la stratégie de réindustrialisation a du plomb dans l’aile.
Le premier d’entre eux, la révision des aides d’État, est en vigueur et permet de tenir la Commission européenne à l’écart. Sur les 740 milliards d’euros d’aides approuvées, 50 % ont profité à l’Allemagne, 23, 5 % à la France, les autres États membres se partageant les miettes. Cette situation est d’autant plus regrettable que ce sont ces autres pays, de l’Est notamment, qui disposent des matériaux critiques, indispensables à l’industrie de l’Ouest.
Le second, le fonds de souveraineté, est abandonné. Nous devions pourtant voir ce que nous allions voir ! L’Union européenne allait répondre au fameux Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis, politique agressive de soutien public, financée à hauteur de 300 milliards d’euros au moins, sur fond de renforcement de l’industrie et de sa décarbonation. Le fonds de souveraineté européen devait, s’il n’avait pas été enterré avant même de voir le jour, compenser les investissements nord-américains colossaux.
Pour irriguer l’industrie française et éviter de voir le fossé avec l’Allemagne se creuser, il faudra désormais miser sur la coquille vide qu’est la plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe (Step). Recyclage de crédits en tout genre, champs extrêmement restrictifs en matière de technologies de rupture, et 10 milliards d’euros pour toute l’Union au maximum : disons-le clairement, la montagne a accouché d’une souris !
Madame la secrétaire d’État, le constat posé par le chercheur Nicolas Leron devrait nous rassembler : « Sans budget proprement européen et d’une taille suffisante, l’Union européenne arrive au bout de ce qu’elle peut fournir en termes de biens publics, dont font partie les industries stratégiques. »
Pour l’heure, les marchés financiers minent l’ambition européenne de réindustrialisation du territoire européen, de la France et du Pas-de-Calais, qui attendaient un ruissellement. Une fois n’est pas coutume, il ne se produira pas…
Négocié à la hâte, le plan de relance européen devait être le pilier de la reprise économique, mais les fonds européens tardent à irriguer notre économie.
Madame la secrétaire d’État, j’en profite pour vous demander quelle est votre position sur la condition posée pour percevoir des fonds européens. Près de 20 milliards d’euros – tout de même ! – seraient conditionnés à l’adoption du projet de loi de programmation des finances publiques, que nous examinerons au Sénat mardi prochain.
Mon groupe y voit un chantage exercé par le Gouvernement, pour qui il s’agit de légitimer le choix, politiquement insoutenable aujourd’hui, d’imposer une cure d’austérité à nos finances publiques et de les placer sous le joug des institutions européennes.
Notre soumission au marché européen est liée aux 800 milliards d’euros que nous devons emprunter, ce qui signifie de devoir rembourser 15 milliards d’euros par an jusqu’en 2058 !
Le dilemme est clair : soit l’on adopte de nouvelles ressources propres, soit l’on vote des réductions budgétaires. L’austérité n’est jamais une fatalité !
Le Parlement européen a malheureusement repoussé quelques-unes des contributions du capital au financement des politiques européennes, mais il a adopté une résolution enjoignant aux États membres et à la Commission de trouver de nouvelles ressources propres.
Pour garantir notre souveraineté budgétaire et éviter les égoïsmes nationaux, qui font de notre pays la banque de l’Union européenne, il faut choisir la voie de la taxation : taxe sur les cryptomonnaies, taxe sur les transactions financières, amendes pour les entreprises qui importent des biens dans l’Union européenne tout en rémunérant leurs travailleurs en dessous du seuil de pauvreté.
Madame la secrétaire d’État, la double soumission aux marchés et aux États frugaux n’a que trop duré. Vous êtes politiquement responsable d’avoir enterré le fonds de souveraineté en accordant d’abord l’assouplissement des règles relatives aux aides d’État. N’acceptez pas que la France augmente sa contribution ; exigez que le capital finance les transitions !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’agenda du Conseil européen se trouve en partie bousculé par la situation dramatique au Proche-Orient.
Cet après-midi, lors de la séance des questions d’actualité au Gouvernement, la présidente du groupe RDSE, ma collègue Maryse Carrère, a fermement condamné les attaques terroristes du Hamas contre les Israéliens, en rappelant que cette violence aveugle ouvrait une nouvelle et terrible page du conflit israélo-palestinien.
À chaud, alors que l’émoi nous saisit tous, il est difficile de se projeter, d’avoir l’espoir d’une réconciliation. Pourtant, face à la douleur immense et immédiate des Israéliens, victimes d’une barbarie sans nom, et face à celle des civils palestiniens, qui vont payer le prix de la folie du Hamas, le processus de paix devra rapidement être remis sur les rails.
En attendant, je salue les efforts des responsables européens pour tenter d’enrayer l’escalade. À Bruxelles, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell a rappelé, dès samedi, la nécessité de ne pas accroître les tensions sur le terrain. Bien entendu, le pari est difficile, entre le droit d’Israël de se défendre, conformément au droit international, et l’obligation du devoir humanitaire envers les civils palestiniens, qui subissent le feu de la riposte de Tsahal et un siège total.
Mon groupe adhère à la voie choisie par l’Union européenne, entre solidarité à l’égard du peuple israélien et volonté de limiter les drames humains, qui signeraient l’impossible retour à la paix.
Mes chers collègues, ce front rouvert au Proche-Orient ne doit pas nous faire oublier le conflit qui se poursuit aux portes de l’Europe, comme pourrait cyniquement le souhaiter Moscou. Vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, l’Ukraine a encore besoin de la mobilisation sans faille de l’Union européenne.
Le groupe RDSE a toujours demandé le maintien d’un soutien militaire. La lassitude qui peut gagner certains pays ou certaines opinions face à un conflit qui dure ne doit pas trouver sa place. Je me réjouis qu’à chaque Conseil européen les États membres de l’Union européenne appellent à redoubler les efforts en direction de Kiev.
Faut-il rappeler aux sceptiques que ce sont aussi les intérêts de l’Europe en matière de sécurité et de défense qui sont en jeu au travers de l’agression de l’Ukraine ?
Certes, le contexte politique américain complique la situation, surtout si le Congrès ferme les vannes des aides, à l’instar de ce qu’il vient de faire, pour un montant de 24 milliards de dollars. Madame la secrétaire d’État, on a bien entendu lors du sommet de Grenade que l’Europe n’allait pas les compenser.
En attendant, soutenez-vous les eurodéputés qui demandent l’octroi d’une aide macrofinancière de 50 milliards d’euros, dont deux tiers de prêts préférentiels à l’Ukraine jusqu’en 2027 ?
Le Parlement européen souhaiterait que cette aide à la reconstruction soit adoptée le plus tôt possible dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2021-2027. On peut partager cet objectif, tout en gardant à l’esprit les autres besoins humanitaires qui découleront nécessairement du conflit israélo-palestinien, mais aussi du drame au Haut-Karabagh.
J’en viens à présent à un autre point de l’agenda du prochain Conseil européen : la révision du cadre financier pluriannuel actuel. Nous le savons, plusieurs pays refusent d’abonder davantage encore le budget européen.
De son côté, mon groupe défend quelques principes assez simples. Il est important de trouver un équilibre entre la préservation des politiques fondatrices de l’Union européenne dites traditionnelles – je pense à la politique agricole commune (PAC), indispensable à la souveraineté alimentaire – et les besoins des politiques dites nouvelles, liées à des défis plus contemporains, en particulier dans les domaines climatiques et technologiques ou de la sécurité et de la défense. L’équation est difficile, je n’en doute pas.
Dans ces conditions, la question des ressources propres continue de se poser, d’autant plus que tous les instruments européens de flexibilité ont été mobilisés au cours de ces dernières années. Il reste peu de marges budgétaires pour absorber de nouvelles crises, alors que se profile également le remboursement de 450 milliards d’euros à compter de 2028.
Aussi, mes collègues du groupe RDSE ont toujours défendu l’urgente nécessité de diversifier les ressources propres. Je m’inscris dans leurs pas.
La Commission européenne a récemment déclaré que, sans nouvelles ressources propres, les programmes de financement de l’Union européenne devraient être réduits de 15 milliards d’euros par an ou que les contributions des États membres devaient augmenter. Faut-il prendre ce risque ?
Nous ne pourrons pas nous contenter des dernières mesures mises en œuvre, à l’instar de la taxe sur les plastiques. Bien qu’elle soit fondamentale – elle participe de la politique européenne de développement durable –, son rendement va mécaniquement décroître.
Je me réjouis aussi du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui est tout juste acté. Toutefois, lui non plus ne suffira pas à remplir les caisses de l’Union européenne.
Où en sont donc les autres propositions que la Commission européenne a présentées en 2021 ? Je pense en particulier à la redevance numérique ou à la taxe sur les transactions financières à grande échelle. Ces deux mesures ont le mérite d’en appeler à la solidarité financière et c’est pourquoi nous y sommes attachés. Au-delà des recettes qu’elles pourraient engendrer, ces taxes permettraient de mieux partager les richesses entre les différents agents économiques, de soutenir les politiques européennes nouvelles ou de gérer les crises.
Je terminerai en évoquant l’un des dossiers qui sera également discuté lors du Conseil européen les 26 et 27 octobre prochain, à savoir la politique migratoire.
Une fois encore, des tragédies se sont déroulées en mer Méditerranée. Ce sont des drames à répétition. Qu’on le veuille ou non, les flux migratoires vont durer et entraîner leurs cortèges de victimes.
L’Union européenne est parvenue à un accord au terme de trois ans de négociations. Cependant, il apparaît clairement en filigrane que le projet de pacte sur la migration et l’asile présenté la semaine dernière à Grenade, lequel tient compte des blocages de l’Italie et de la Hongrie en particulier, tend à durcir les conditions d’accueil.
Que penser en effet de l’extension de la durée de détention aux frontières extérieures et des procédures d’examen ramenées à cinq jours, qui sont donc plus expéditives ? Sans doute s’agit-il là de concessions faites à Giorgia Meloni…
Si elle ne peut pas ignorer les situations difficiles, comme celle de Lampedusa, l’Union européenne doit tout de même préserver ses valeurs fondatrices, au premier rang desquelles la solidarité et l’humanité. C’est en tout cas ce que souhaite mon groupe. J’en appelle à la vigilance du Parlement européen lorsqu’il sera saisi de ce sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Applaudissements su r les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Green Deal, lancé par la Commission européenne en 2019, est une réponse concrète et urgente aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’une feuille de route audacieuse visant à transformer l’Union européenne en une économie neutre en carbone d’ici à 2050, tout en garantissant une croissance économique durable. C’est un plan ambitieux, qui nécessite une réponse énergique et un engagement de la part de chaque État membre. Il est de notre devoir, en tant que législateurs, de contribuer à sa réussite.
Nous saluons l’initiative de la Commission européenne, qui a adopté une série de propositions visant à adapter les politiques de l’Union européenne en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité, pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Dans le flot des crises que traverse l’Union européenne – elles ont été beaucoup évoquées ce soir – et dans la perspective des choix budgétaires qu’il faudra effectuer, l’urgence climatique doit rester la priorité de notre agenda. Les rapports scientifiques nous alertent constamment sur les conséquences graves du changement climatique, telles que les vagues de chaleur mortelles, les incendies de forêt dévastateurs, les inondations catastrophiques et la montée du niveau de la mer menaçant nos côtes.
Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a réaffirmé ces menaces et a souligné l’importance cruciale de limiter le changement climatique à 1, 5 degré Celsius pour éviter des conséquences catastrophiques.
L’Union européenne a montré la voie en adoptant un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. Cependant, pour que le Green Deal soit une réussite, il est essentiel que tous les États membres s’engagent pleinement dans sa mise en œuvre. L’Union européenne doit s’efforcer de collaborer étroitement avec d’autres acteurs mondiaux.
La crise climatique est un défi global. Il est impératif que l’Union européenne travaille avec d’autres pays pour trouver des solutions durables. Il est important de noter que l’Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 32 % entre 1990 et 2020. L’Europe est ainsi responsable de 9, 8 % des émissions de CO2, contre près de 63 % pour l’Asie.
Cela signifie qu’il faut renforcer nos partenariats avec des Nations telles que les États-Unis, la Chine et l’Inde et jouer un rôle moteur dans les négociations internationales sur le climat.
Quelles initiatives le Gouvernement va-t-il prendre en ce sens ? Telle est la question qui s’impose à nous.
En tant que Nation au cœur de l’Europe, la France doit jouer un rôle de premier plan dans cette initiative.
Nous devons accélérer nos efforts pour respecter nos engagements en vertu de l’accord de Paris. Le gouvernement français doit ainsi continuer à investir dans les énergies renouvelables et promouvoir l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie, pour développer des transports publics écologiques et soutenir une agriculture durable. Ces mesures sont non seulement bonnes pour l’environnement, mais également créatrices d’emplois. De plus, elles stimulent l’innovation, dans laquelle nous devons investir.
Je ne reviens pas sur les enjeux budgétaires, que ma collègue Florence Blatrix Contat a évoqués : les financements devront être à la hauteur pour atteindre de tels objectifs.
Ensuite, l’éducation et la sensibilisation du public sont des éléments clés pour le succès des politiques environnementales de l’Union européenne. Nous devons expliquer, et réexpliquer, aux citoyens les enjeux de la crise climatique et les avantages d’une transition vers une économie verte.
Le Green Deal de l’Union européenne doit être rendu plus lisible dans les territoires afin que ces derniers puissent s’engager concrètement dans la transition écologique. Nous nous devons de soutenir ces territoires en élaborant des politiques nationales qui soient cohérentes avec les objectifs du Green Deal.
En outre, une coordination étroite avec les autorités locales et régionales est essentielle pour mettre en œuvre efficacement ces mesures et assurer une transition juste et équitable vers une économie plus respectueuse de l’environnement.
Cela signifie qu’il faut soutenir les travailleurs et les territoires qui seront les plus touchés par cette transformation, en les accompagnant dans leurs projets de recherche de financement.
Pourrons-nous offrir des opportunités de formation et de reconversion professionnelle, garantir des conditions de travail décentes dans les nouvelles industries vertes et veiller à ce qu’aucune personne ni aucun territoire ne soient laissés-pour-compte ?
En conclusion, l’Union européenne doit garder ses ambitions environnementales. En tant que membre de l’Union européenne, nous avons la responsabilité de soutenir ses efforts et ses initiatives, d’accélérer notre transition vers une économie verte et de garantir une transition juste pour toutes et tous. C’est une occasion unique de façonner un avenir plus durable pour nos concitoyens, nos économies et notre planète. En agissant avec détermination, en collaborant avec d’autres acteurs mondiaux et en investissant dans l’innovation, nous pouvons concrétiser cette vision d’un avenir meilleur pour toutes et tous.
Nous serons par ailleurs très attentifs à la position qu’adoptera la France vendredi prochain concernant la proposition de la Commission européenne de reconduire pour dix ans l’autorisation d’utilisation du glyphosate, malgré les dangers avérés de cet herbicide.
Plus globalement, il est inopportun de demander une pause réglementaire européenne sur les normes environnementales, ainsi que l’a fait le président Emmanuel Macron. Au contraire, nous devons conserver nos ambitions dans le but de rendre notre futur plus vert. N’est-ce pas notre devoir envers nos concitoyens, nos enfants et les générations futures ?
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de répondre à nos interrogations et à nos fortes préoccupations.
Applaudissements sur le s travées des groupes SER et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avec l’arrivée en quelques jours de plus de 200 embarcations, transportant près de 12 000 personnes, Lampedusa a récemment été le théâtre d’un énième épisode de chaos migratoire.
Une nouvelle fois, bien malgré elle, cette petite île italienne est apparue aux Européens comme un symbole : le symbole, d’abord, de l’ampleur d’un choc migratoire dont l’accélération, périodiquement documentée par les chiffres de Frontex, engendre une situation désormais intenable ; le symbole, ensuite, de l’échec des gouvernements nationaux et des institutions européennes à faire front pour prévenir, contenir et gérer efficacement les flux qui se pressent aux frontières de notre continent.
Si le mois dernier, le dialogue entre États membres s’est révélé peut-être un peu moins acrimonieux que lors des précédents débarquements massifs, nous n’en avons pas moins assisté au même scénario qu’à l’accoutumée.
Ainsi les mêmes appels à une solution européenne ont-ils été suivis des mêmes querelles entre gouvernements. Aux mêmes déclarations martiales et fallacieuses de l’extrême droite ont répondu les mêmes injonctions irresponsables de l’extrême gauche en faveur d’un accueil inconditionnel et illimité.
La Commission européenne, elle, a produit, comme toujours, le même plan d’urgence creux, glanant ici et là quelques millions d’euros dans les marges du budget communautaire et se contentant de recycler des axes d’action déjà énoncés maintes et maintes fois.
En réalité, ce genre de plan, élaboré pour donner l’illusion de l’action, reste condamné à la vacuité, tant que n’auront pas été posés les fondements d’une politique européenne adaptée aux réalités du XXIe siècle.
Or l’actualité récente, si désespérante par certains aspects, nous offre peut-être cette fois quelques raisons d’espérer. En effet, la semaine dernière, les ministres de l’intérieur des Vingt-Sept ont enfin mis la dernière main à leur version du pacte sur la migration et l’asile, trois ans après sa présentation par la Commission européenne, et même sept ans après que la Commission Juncker a fait ses premières propositions de réforme… Il était plus que temps !
Pour autant, si l’Europe n’a jamais été aussi près d’aboutir à un résultat tangible, tous les obstacles ne sont pas levés, il s’en faut. La négociation avec le Parlement européen, dont la copie diverge largement de celle du Conseil, promet assurément d’être ardue.
Naturellement, la Commission européenne se dit confiante dans le fait que le paquet puisse être bouclé rapidement, en tout cas, avant les élections européennes de l’année prochaine ; c’est le moins qu’elle puisse dire !
Madame la secrétaire d’État, en votre âme et conscience, au vu de vos discussions avec vos collègues et avec les parlementaires européens, partagez-vous réellement cet optimisme et pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Comme vous le savez, plusieurs États membres – Pologne et Hongrie en tête – expriment depuis 2016 de grandes réticences à l’égard des systèmes de relocalisation. Ces derniers se sont prononcés contre l’adoption du pacte et mènent depuis une campagne agressive à son encontre, en le qualifiant de « diktat », voire de « viol légal », et en assimilant à des amendes les contributions financières obligatoirement apportées aux pays de première ligne.
Cette rhétorique fait clairement planer le risque d’un défaut d’application de la législation communautaire ; or, en pareil cas, c’est le fonctionnement de l’ensemble du système tel qu’il est conçu qui, par réaction en chaîne, risque d’être rendu inopérant.
Madame la secrétaire d’État, ces États membres ayant déjà refusé par le passé de mettre en œuvre des mesures décidées à l’échelon européen sur la question migratoire, ne pensez-vous pas que cette question puisse de nouveau se poser pour la mise en œuvre du pacte ?
Je pense d’ailleurs que ces pays, après avoir vu – comme moi, comme vous –, tout récemment, des groupes de migrants retenus dans des centres de transit en Grèce se réjouir des massacres perpétrés ces derniers jours en Israël, ne manqueront pas d’être renforcés dans leur scepticisme concernant ces obligations de relocalisation.
Par ailleurs, les récents événements de Lampedusa nous invitent naturellement à nous interroger sur la dimension extérieure des migrations, notamment sur les partenariats conclus avec les pays du pourtour méditerranéen, hier la Turquie, aujourd’hui la Tunisie, demain l’Égypte ou le Maroc.
Ces accords, s’ils sont conclus et exécutés de bonne foi et avec sérieux, pourraient, à n’en pas douter, offrir des outils efficaces et avantageux à l’Europe pour la gestion des flux migratoires. Pour autant, ils soulignent en creux à quel point notre priorité absolue doit résider dans la mise en ordre de notre propre cadre juridique et de nos politiques européennes.
À défaut d’un tel aggiornamento, nous nous mettrons inévitablement dans la main de nos partenaires, qui pourront profiter à loisir de notre état de faiblesse collective sur ce sujet.
Comment, dès lors, ne pas voir dans le départ quasi simultané de centaines d’embarcations depuis la région de Sfax ou dans l’attitude récente du président Saïed, une sévère mise en garde à cet égard ?
Cela est d’autant plus flagrant que, plus au sud, la situation économique continue de se dégrader, avec la succession de coups d’État au Sahel et le départ consécutif des troupes françaises. La région connaît un fort regain de violence, les attaques terroristes s’y multiplient depuis plusieurs mois et viennent s’ajouter aux nombreuses crises que ces peuples, parmi les pauvres au monde, subissent déjà.
Or je doute que l’alliance des juntes qui se forme entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger soit en mesure d’apporter des progrès tangibles à leurs concitoyens, qui pourront, à n’en pas douter, être amenés à prendre plus massivement encore les routes de l’exil.
Le prochain Conseil européen devrait, si l’on se réfère au projet d’ordre du jour annoté, aborder également la question du Sahel.
Ce débat devrait être l’occasion, pour nos partenaires, de prendre davantage conscience de l’aspect stratégique de cette région, eux qui ont, il faut le dire, si peu soutenu la France dans les domaines politique, diplomatique et militaire tout au long de son engagement contre les groupes terroristes – bien que j’aie entendu dire l’inverse. Je souhaite que l’on s’interroge a posteriori sur ce qu’a véritablement fait l’Europe à ce sujet.
L’Europe, comme le réaffirmait récemment le haut représentant Josep Borrell, ne doit pas abandonner le Sahel, malgré les immenses difficultés qui se posent actuellement. Formons le vœu que cet appel soit entendu : il s’agit d’un impératif moral, mais il y va aussi de notre intérêt bien compris.
Enfin, j’ai une dernière interrogation, et non la moindre, sur l’agression terroriste du Hamas contre Israël.
Bien que ce sujet n’ait, bien entendu, pas été inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil, nul doute qu’il en sera question, au vu de l’ampleur de ce drame, dont nous avons parlé tout au long de la soirée.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer quelles actions précises et concrètes la France va proposer à ses collègues pour à la fois tirer les leçons des massacres perpétrés ce jour et éviter qu’ils ne se renouvellent à l’avenir ?
Comment va-t-on, par exemple, procéder au contrôle des financements européens directs attribués aux Palestiniens et aux associations qui encouragent le terrorisme ? Quand le ferons-nous ? D’autres questions se posent, comme celle de l’inscription de ces associations ou groupuscules qui encouragent le terrorisme sur la liste des organismes terroristes et des conséquences qu’il faudra en tirer.
Je vous remercie de vos réponses les plus claires et les plus complètes possible.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi en préambule d’exprimer à cette tribune tout mon soutien au peuple israélien et aux Européens victimes de la barbarie et du terrorisme. Je fais toute confiance à la présidence espagnole, issue d’un des pays qui a le plus souffert du terrorisme islamiste en Europe, pour garantir à Israël un soutien nécessaire et vital contre l’obscurantisme.
Le commissaire hongrois Olivér Várhelyi a souhaité suspendre immédiatement tous les paiements à destination de la Palestine et effectuer une analyse de tous les programmes de financement. La question de l’aide au développement est posée. Jusqu’où la France ira-t-elle pour empêcher le plus possible, et dans le détail, qu’une organisation terroriste, le Hamas, en bénéficie ?
Plus largement, madame la secrétaire d’État, je rappelle que des associations fréristes se sont implantées à Bruxelles, capitalisant sur une proximité avec les institutions européennes.
Le Conseil de l’Europe peut-il garantir que l’on mène une lutte acharnée contre l’islamisme, alors même qu’il promeut des slogans comme « Mon voile, mon choix » ou encore « La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab » ? S’approprier ces mots sans chercher à en mesurer les conséquences revient à prendre des risques !
Dans la série des atrocités où l’humanité perd de sa substance, il faut évoquer l’attaque du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan. Je renouvelle ici tout mon soutien à la cause arménienne, à la défense des chrétiens d’Orient victimes, eux aussi, d’actes innommables en Artsakh, que certains qualifient déjà de crimes contre l’humanité.
J’appelle Mme Ursula von der Leyen à garder l’Union européenne de toute hypocrisie à ce sujet concernant les accords de partenariat avec l’Azerbaïdjan, y compris dans le domaine de l’énergie.
Relevons au passage la lâcheté de Vladimir Poutine dans ce conflit arménien, lui qui fut présenté si longtemps comme un défenseur du cessez-le-feu.
Mes chers collègues, de la guerre en Ukraine dépend notre salut ; il faut la gagner pour l’Ukraine, mais aussi pour la Finlande, pour la Pologne, pour les pays baltes et, plus largement, pour la démocratie et pour les valeurs que nous défendons. Il y va de notre crédibilité.
Aujourd’hui, celle-ci repose sur l’Ukraine. Son peuple a fait montre de pugnacité, d’ingéniosité, de vivacité d’action et de réflexion, de souplesse et de finesse ; il s’est présenté au monde comme résistant, fort, moderne, malin ; il a démontré sa volonté de déjouer en bloc et en détail l’hypocrisie russe, mais aussi celle du bloc occidental.
Et nous voudrions aujourd’hui lui faire savoir que l’intégration à l’Europe se mérite, qu’elle se gagne, qu’elle doit résulter d’efforts et de sérieux ?
Il me semble que le peuple de Kiev répond au moins à cette exigence de valeurs morales et qu’il en fait chaque jour la démonstration. Un peuple dont les hommes sont capables d’avancer à travers des champs de mines peut emporter son pays où il le souhaite, y compris au sein de l’Union européenne !
La question de l’intégration de l’Ukraine a une saveur particulière et je prie le Conseil de l’Europe de faciliter le rapprochement de l’Ukraine avec les Vingt-Sept, sans nécessairement déjà parler d’intégration. Le chef de l’État français promeut une nouvelle manière d’envisager cette étape : il prône une approche d’ensemble et une union construite sur la base de projets ou de politiques communes.
Le Conseil de l’Europe des 26 et 27 octobre prochain suivra-t-il la position française en faveur d’une intégration progressive, projet par projet, sans attendre que les États concernés remplissent toutes les conditions pour commencer à cheminer vers l’Europe ?
Madame la secrétaire d’État, notre pays ne regarde pas assez à l’Est. Depuis le Brexit, la Pologne est devenue le point d’entrée des États-Unis et de l’Otan, le chantre occidental d’une Europe dont la force est en train de se déplacer vers l’Est. Sa montée en puissance, notamment militaire, mais aussi dans d’autres domaines, contribuera – j’en forme le vœu – à attirer les regards des Français au-delà de l’Allemagne.
Cette dernière, longtemps présentée comme un modèle, doit désormais revenir sur de nombreux aspects de sa politique intérieure et extérieure, en matière d’énergie comme sur les plans militaire et diplomatique.
S’agissant de la question migratoire, madame la secrétaire d’État, elle devient le principal sujet de préoccupation des peuples européens.
Sur nos frontières méridionales, l’arrivée de 10 000 migrants au mois de septembre sur l’île de Lampedusa, venus principalement d’Afrique, mais également du Moyen-Orient, fait ressurgir dans nos populations défiance, inquiétude et malaise, malgré l’appel chrétien, humaniste et universaliste du pape François. Nous devons établir une doctrine en matière migratoire.
Les différences entre les politiques menées au Danemark et en France témoignent à la fois de la possibilité d’agir souverainement, différemment, mais également du manque de vision consensuelle sur ces sujets.
Madame la secrétaire d’État, quelques mots, pour conclure, sur l’environnement. L’Union européenne est la partie du monde la plus avancée sur ces questions ; c’est notre honneur, cela doit devenir, demain, notre force.
La présidence espagnole a proposé une feuille de route répondant aux exigences de l’Agenda 2030 et nous nous en réjouissons. De même, félicitons-nous du choix de promouvoir le train ou encore de financer une aide à la promotion et à la valorisation d’une alimentation locale.
Permettez-moi de saluer tous ceux qui se battent au quotidien, au sein des instances européennes, pour notre planète, pour la biodiversité, pour le climat, contre des lobbies puissants et organisés. Pour autant, le travail doit s’intensifier.
Les accords de libre-échange sont aujourd’hui fondamentalement contradictoires avec la politique environnementale de l’Union européenne ; ils sont très critiqués pour l’étendue de leur champ et pour les atteintes fondamentales qu’ils portent à des principes qui devraient être considérés comme non négociables.
Madame la secrétaire d’État, quel est le bilan environnemental de ces traités ? Devons-nous dire stop, ou encore ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’ordre du jour du prochain Conseil européen indique que, face à des défis de plus en plus complexes, l’Union européenne façonne « une économie solide et à l’épreuve du temps », susceptible de « garantir une prospérité à long terme ».
Permettez-moi cependant d’en douter.
Face aux géants que sont Pékin et Washington, l’Union européenne lance une enquête afin de déterminer si la Chine subventionne ses véhicules électriques, d’un côté, et tente, de l’autre, d’évaluer l’impact de l’Inflation Reduction Act (IRA).
Outre le fait que ces études arrivent bien tardivement, nous pouvons déjà préjuger de leurs résultats : oui, les subventions chinoises sont massives ; oui l’impact de l’IRA est significatif et le restera.
Ainsi, face aux menaces pesant sur l’économie européenne, l’Union européenne, écartelée entre les intérêts propres de chaque État, multiplie études, enquêtes et évaluations, qui sont les seuls éléments sur lesquels les Vingt-Sept parviennent à se mettre d’accord. Une véritable politique de rupture stratégique devrait pourtant s’imposer pour éviter le naufrage et redonner de la compétitivité à notre économie.
Certains mettront en avant les quelques avancées obtenues. Certes, l’Union européenne n’est pas totalement immobile ; comme toujours, cependant, la politique des petits pas prévaut et les quelques efforts interventionnistes ne sont pas à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Les investissements massifs nécessaires à une souveraineté économique européenne n’adviendront pas si nous n’y consacrons que les moyens que nous mobilisons actuellement.
À ce rythme, nous sommes voués à demeurer une Union de la régulation plutôt qu’une véritable union économique, ce qui, rappelons-le, était pourtant l’un des objectifs premiers de la création des communautés européennes.
Alors que l’Union européenne rattrapait les États-Unis en termes de PIB par habitant jusqu’au début des années 2000, nous avons depuis décroché ; notre productivité est moindre, de même que notre croissance. Alors que nous étions le continent le plus riche, avec le PIB le plus élevé, nous avons été dépassés par les États-Unis. Cela traduit l’échec de la politique économique européenne, laquelle n’a pas évolué avec le temps et reste enfermée dans une doctrine datant du siècle dernier.
Les vantardises de la Commission européenne, dans son dernier discours sur l’état de l’Union, soulignant que le marché européen aime la concurrence, ne changeront rien à ce constat : elle doit rompre avec sa vision très largement libre-échangiste, ultra-concurrentielle et libérale, qui la rend peu encline à construire une véritable politique industrielle soutenant vigoureusement l’innovation.
Les aides aux entreprises sont extrêmement régulées, alors que nous devrions, au contraire, nous inspirer de la flexibilité de l’IRA pour accélérer leur distribution : elles mettent environ deux ans à voir le jour, quand le dispositif américain a été opérationnel en six mois.
De même, l’Union européenne doit se donner les moyens de son ambition. La plateforme des technologies stratégiques – le Net-Zero Industry Act (NZIA), affublé par certains du sobriquet Zero Industry Net Act – en est le parfait exemple.
L’Union européenne se fixe des objectifs, lance de nouvelles politiques, sans pour autant prévoir de véritables budgets dédiés pour les mener à bien. Elle se contente ainsi de recycler les fonds d’anciennes enveloppes, qui, bien que non décaissés, sont déjà bel et bien engagés. En outre, elle se concentre excessivement sur l’investissement et laisse de côté le soutien à la production ainsi qu’à la recherche et au développement, comme c’est le cas pour le NZIA.
L’IRA, quant à lui, subventionne jusqu’à 15 dollars par mégawattheure pour le nucléaire et 3 dollars par mégawattheure pour l’hydrogène. De surcroît, la hausse du coût de l’énergie en Europe mine encore davantage notre compétitivité.
Au-delà de l’IRA lui-même, l’attractivité des prix de l’énergie aux États-Unis provoque des délocalisations de l’Europe vers l’Amérique. Or la réforme du marché de l’électricité prévue par la Commission européenne est trop peu ambitieuse et ne permettra pas de corriger ce différentiel de prix. Cela m’apparaît comme une grave erreur, que la France devra corriger en pesant pour cela de tout son poids.
Par ailleurs, l’Union européenne fait le choix de discriminer les activités qu’elle juge incompatibles avec la poursuite de l’objectif zéro carbone en s’appuyant sur des interdictions plutôt que sur des incitations.
Ainsi, d’interminables listes d’activités pouvant bénéficier de telle ou telle politique sont édictées, favorisant le plus souvent des technologies non matures d’un point de vue industriel et pénalisant injustement, par la même occasion, certains secteurs, oubliés ou mis de côté de manière discutable.
C’est notamment régulièrement le cas du nucléaire, pour lequel la France doit batailler à chaque nouveau texte relatif aux énergies. Ce secteur n’est ainsi pas inclus à l’heure actuelle parmi les technologies stratégiques dans le cadre du Net-Zero Industry Act et ne pourra donc pas bénéficier des procédures accélérées d’octroi de permis.
De même, la Commission a fait le choix de ne rendre éligible au NZIA que le nucléaire de quatrième génération et les petits réacteurs modulaires, soit des technologies qui ne sont actuellement pas disponibles pour une production à court terme, tout en exigeant dans le même temps un niveau de maturité supérieur ou égal à 8 selon l’échelle TRL, pour Technology Readiness Level.
Ainsi, tout en faisant mine de l’inclure, le texte prévoit en réalité d’exclure la première source d’énergie bas-carbone de l’Union européenne, alors même qu’il est supposé soutenir les technologies qui permettront d’atteindre la neutralité carbone. C’est tout bonnement insensé !
Il faut rompre avec cette logique absurde et bureaucratique et l’Union européenne doit s’engager davantage dans la voie de l’incitation.
En outre, si je peux comprendre la décision de Bruxelles de ne pas porter plainte devant l’OMC contre les États-Unis au sujet de l’IRA, au regard des faibles chances de succès de cette procédure, je ne comprends pas ce qui empêche l’Union européenne d’étudier une préférence européenne. J’avais déjà évoqué ce point lors du précédent débat préalable à la réunion du Conseil européen.
Le Conseil européen est supposé fixer les orientations générales de l’Union européenne et donner les grandes impulsions. La construction d’une véritable politique industrielle, incitative plutôt que punitive, permettant de soutenir massivement et de façon souple l’investissement comme la production en Europe, centrée sur des activités pour lesquelles nous disposons déjà d’avantages comparatifs, devrait être l’une de ses priorités.
Nous devons cesser de nous congratuler et d’évaluer les quelques progrès obtenus, au risque de ne jamais avancer.
Aussi, madame la secrétaire d’État, je souhaite savoir si la France défendra une telle position devant le Conseil européen. Quels efforts sont faits pour convaincre les États membres les plus frileux, en particulier les pays du nord de l’Europe, de s’engager dans la construction d’une véritable politique industrielle ?
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, merci de ces interventions riches et complètes auxquelles je vais m’efforcer de répondre en détail. Si mes efforts ne suffisent pas, mon cabinet et moi-même nous tenons à votre disposition.
Merci de vos mots très forts en soutien à Israël. Face à l’horreur, il est très marquant de constater à quel point nous sommes ici unis, aux côtés d’Israël.
Messieurs les présidents Perrin et Rapin, messieurs les sénateurs Médevielle, Fernique et Laouedj, mesdames les sénatrices Devésa et Apourceau-Poly, vous m’avez notamment interrogée sur la suspension de l’aide européenne à la Palestine.
Il est vrai qu’une certaine confusion a pu régner sur la question et je vais donc m’efforcer de clarifier la situation : l’aide européenne n’a pas été suspendue ; les Palestiniens n’ont pas à souffrir des horreurs abjectes qui sont commises par le Hamas.
En revanche, la Commission européenne a lancé une revue pour s’assurer que l’aide européenne allait vers de bonnes mains. À ce sujet, monsieur le sénateur Fernique, il y aura bien une réunion immédiate du Conseil des ministres des affaires étrangères.
Vous m’avez ensuite questionnée sur le troisième sommet de la Communauté politique européenne à Grenade. Cet événement nous a tout d’abord offert l’occasion de renouveler l’expression de notre solidarité à l’égard de l’Ukraine.
Ensuite, il nous a permis d’évoquer notamment avec le premier ministre arménien, une prochaine réunion à Bruxelles avec Charles Michel et le président de l’Azerbaïdjan. Nous avons pu, surtout, discuter de l’organisation du soutien à l’Arménie, à son intégrité territoriale, ainsi, bien évidemment, qu’aux réfugiés. Comme vous le savez, 100 000 personnes ont été déplacées dans cette région.
Plus concrètement, cette réunion a permis de poursuivre l’agenda en matière de cybersécurité, notamment en étendant la future réserve cyber européenne aux pays tiers de la CPE.
Enfin, il importe de souligner, pour la continuité de la CPE, que le Royaume-Uni s’est emparé de ce format, en y voyant beaucoup de potentiel, notamment pour aborder les questions migratoires – j’y reviendrai dans un instant.
Nous avons également entamé des discussions sur les perspectives d’élargissement. Monsieur le sénateur Patient, vous avez abordé cette question en termes géopolitiques, monsieur le sénateur Allizard, vous avez évoqué des cercles concentriques, madame Devésa, vous l’avez resituée dans le contexte de la relation franco-allemande.
Le Conseil européen a pu débattre de deux questions et la France peut se féliciter d’avoir obtenu que le texte final encourage les pays candidats à aller plus vite sur la voie de l’adhésion et à accélérer le rythme des réformes, mais aborde également, en parallèle, la question de la réforme de l’Union européenne. Vous avez été plusieurs à souligner combien il était nécessaire d’être à la fois plus agiles et plus flexibles, en particulier dans la perspective d’une Union européenne plus large dans quelques années.
Le mandat qui a été confié aux ministres des affaires européennes pour les prochaines semaines nous conduit à travailler simultanément sur ces deux questions. Nous devrons en discuter dès le prochain Conseil consacré aux affaires générales, le 24 octobre prochain.
S’agissant du groupe des douze experts franco-allemands, il rassemble des spécialistes indépendants, à qui nous avons demandé de nous présenter des options afin de pouvoir étudier les ajustements à réaliser en vue d’être effectivement plus agiles et plus flexibles.
À cet égard, la ministre des affaires étrangères allemande organise le 2 novembre prochain à Berlin une conférence sur l’élargissement, à laquelle je me rendrai, la ministre Catherine Colonna se trouvant empêchée.
La question des migrations a été autant discutée dans cet hémicycle qu’à Grenade, je dois le reconnaître : vous en avez tous parlé.
La réunion organisée par le Royaume-Uni et l’Italie, à laquelle étaient associées l’Albanie et la France, a permis des avancées concernant la lutte contre les réseaux de passeurs. Ces pays sont unanimes pour considérer que nous devons parvenir à identifier et à démanteler les réseaux de passeurs, afin que les pays où ceux-ci se trouvent les punissent. Nous entendons également nous attaquer aux chaînes de production des embarcations, afin d’éviter autant que possible de nouveaux drames dans la Méditerranée.
L’objectif de toutes ces discussions est clair : il s’agit de maîtriser les flux migratoires. J’estime à ce titre que nous pouvons être fiers du compromis qui a été trouvé sur les différents textes qui composent le pacte asile et immigration.
Celui-ci reflète en effet notre devoir de solidarité et d’humanité en reconnaissant qu’il faut accueillir les demandeurs d’asile qui ont besoin de venir chez nous, qu’il convient de traiter plus rapidement les dossiers de ceux qui n’ont pas le droit à l’asile – ce point constitue un pilier de la procédure – et qu’il faut aider les pays de première entrée – les difficultés rencontrées à Lampedusa l’ont montré.
Le pacte précise aussi les modalités de la solidarité de fait qui s’exerce : chaque demandeur est enregistré, il se voit attribuer des documents d’identité et prodiguer des soins de santé. Après quoi, les demandeurs d’asile sont répartis sur le territoire européen.
Au regard des différentes positions qui se sont exprimées, j’estime que ce pacte constitue un bon équilibre entre la solidarité et l’humanité d’un côté, et la responsabilité au regard des frontières extérieures de l’autre côté.
En ce qui concerne les politiques de visas de travail, comme vous le savez, monsieur le sénateur Patient, elles relèvent non pas de l’Union européenne, mais des législations nationales. Nous pourrons peut-être réfléchir à l’élaboration d’un prochain programme européen en la matière, mais pour l’heure, les actions menées dans le cadre de la lutte contre les passeurs permettront d’améliorer la situation, notamment en Guyane et à Mayotte, que vous avez mentionnée. Quoi qu’il en soit, le Parlement européen est bien au travail, et j’ai bon espoir que nous parvenions à conclure un accord avant la fin de la mandature européenne.
J’en viens au récent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le contrôle aux frontières intérieures que vous avez évoqué, monsieur le président Rapin. Je vous rejoins pleinement : dans le contexte que nous connaissons, il est primordial que les services du ministère de l’intérieur disposent des moyens de protéger efficacement les frontières. C’est pourquoi nous sommes en train d’effectuer l’analyse des conséquences opérationnelles de la décision de la CJUE.
Pour l’heure, il convient toutefois de demeurer prudent, car je rappelle que ladite décision a été rendue dans le cadre d’une procédure qui est en cours devant le Conseil d’État. Dans la décision qu’il rendra au fond, le Conseil d’État précisera la portée de l’arrêt de la CJUE pour notre droit national. Dans l’intérim, et face au défi que vous connaissez, les contrôles aux frontières intérieures restent en vigueur.
Vous avez été nombreux à m’interroger sur les questions économiques, couvrant l’ensemble des points qui seront discutés au Conseil européen.
Je commencerai par la révision du cadre financier pluriannuel, qui a fait l’objet de nombreuses questions. En la matière, notre position est très ferme : si nous voulons disposer des moyens de financer nos ressources propres, notamment grâce à la taxe carbone aux frontières et aux recettes issues du marché du carbone, nous ne souhaitons pas que cette révision emporte une augmentation trop importante du budget européen.
L’impôt sur les bénéfices des entreprises, que vous avez évoqué, est effectivement temporaire. Il s’ajoute à l’impôt sur les multinationales instauré par l’OCDE.
Lors de la prochaine mandature – je crois que nous en sommes tous d’accord –, il faudra aller plus loin en matière de ressources propres si nous voulons étendre les politiques budgétaires de l’Union européenne.
En ce qui concerne la réforme de la gouvernance économique, au sujet de laquelle MM. Rapin et Husson ainsi que Mme Blatrix Contat m’ont interrogée, je le dis clairement : nous ne voulons pas de règles qui seraient complètement procycliques. Nous souhaitons que cette gouvernance tienne compte des positions initiales de chaque pays, de leurs spécificités en termes d’investissements et de réformes à venir. Nous tenons cette position très fermement dans les négociations, et comme elle est de bon sens, je ne doute pas que les États que vous nommez les « frugaux », monsieur Husson, finiront par s’y rallier.
Vous êtes également nombreux à avoir mentionné ce pilier de notre compétitivité qu’est la réforme du marché de l’électricité, sujet qui, comme vous savez, est très clivant au niveau du Conseil.
Je tiens tout d’abord à redire, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises dans cet hémicycle, que jamais nous ne transigerons sur le nucléaire.
Il convient ensuite de noter que, comme le Président de la République l’a annoncé à l’issue des rencontres franco-allemandes qui se sont tenues à Hambourg, nous commençons à avancer et à voir les positions bouger.
Nous sommes de ce fait assez confiants quant à la possibilité de parvenir à un accord qui permette aux Français d’accéder à des prix qui reflètent la réalité de notre mix électrique.
J’en viens aux aides d’État. Je tiens à préciser que les montants qui ont été évoqués correspondent aux montants qui ont été non pas déboursés, mais seulement demandés. La France a toujours considéré qu’il fallait des aides d’État, mais aussi un fonds de souveraineté au bénéfice des petits pays afin d’éviter que les différences de moyens avec les plus grands États ne conduisent à une fragmentation de l’Union européenne.
Monsieur le sénateur Pellevat, je vous trouve quelque peu sévère au sujet de la compétitivité.
Sourires.
Nous avons tout d’abord été plus rapides que d’habitude, puisque le Président de la République avait alerté au sujet de l’Inflation Reduction Act (IRA) dès le mois de décembre de l’année dernière et que nous avions des textes sur la table dès le mois de mars suivant.
Dans le cadre des négociations sur le Net-Zero Industry Act, nous nous battons ensuite pour le nucléaire, en particulier pour les petits réacteurs modulaires que vous avez mentionnés. Du reste, si la politique industrielle a fait figure de lubie française pendant de nombreuses années, je puis vous assurer que, parmi les Vingt-Sept, plus aucun ne néglige ce domaine, et que la politique industrielle est désormais un principe européen.
Enfin, comme je l’indiquais précédemment, il nous faudra revoir nos politiques et les budgets qui leur sont associés lors de la prochaine mandature.
Je terminerai en évoquant l’Arménie et le Haut-Karabagh, sujet qui est bien inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen.
La France entière partage l’émotion que vous avez exprimée, mesdames Morin-Desailly et Devésa, au regard de la situation absolument inqualifiable qui a conduit à l’exode organisé de plus de 100 000 Arméniens depuis le Haut-Karabagh – le Premier ministre arménien indiquait que seules trois familles, soit quinze personnes, étaient restées dans la région.
Le Président a évoqué le sujet lors de la réunion de la Communauté politique européenne, et il continuera à l’aborder. Une réunion se tiendra d’ici à la fin du mois à Bruxelles sous l’égide de Charles Michel. Nous serons extrêmement vigilants quant à l’attitude qui sera celle du président Aliyev. Ces discussions doivent permettre de parvenir à un accord de paix respectueux du droit international.
Le Président et le Gouvernement sont totalement mobilisés sur ce sujet qui relève d’une lutte des régimes autocratiques contre la démocratie qu’incarnent à la fois la France et l’Union européenne.

Pour conclure le débat, la parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Je vous remercie, mes chers collègues, d’être restés jusqu’au terme de ce débat, et vous, madame la secrétaire d’État, de votre souci de répondre à toutes les questions par thématiques.
Je constate avec tristesse l’importance croissante prise par la guerre : après l’Ukraine, puis l’Arménie, nous évoquons aujourd’hui le conflit israélo-palestinien, ou plutôt israélo-« hamasien ». Ces mauvaises nouvelles ternissent le paysage international, au sein duquel, et vos propos l’attestent, l’Europe est toujours bien présente, madame la secrétaire d’État.
Cela m’amène à revenir sur le sujet par lequel j’ai ouvert ce débat : nous sommes à quinze jours d’un Conseil européen dont l’ordre du jour peut encore évoluer en fonction de la situation internationale.
Madame la secrétaire d’État, vous n’êtes pas porte-parole du Gouvernement, ni même ministre chargée des relations avec le Parlement, mais sachez que j’ai interpellé M. le ministre Riester en conférence des présidents sur la nécessité de rapprocher, dans le temps, nos débats du Conseil, car il importe que nous disposions de visibilité tant sur l’ordre du jour que sur l’actualité. Je vous remercie donc de bien vouloir porter ce message auprès du Gouvernement, quitte à inscrire ce débat préalable au Conseil européen dans l’agenda gouvernemental.
Vous avez indiqué précédemment que vous participeriez prochainement à une conférence sur l’élargissement de l’Union européenne…

Il nous intéressera d’échanger avec vous après la tenue de cette conférence dans le cadre d’une audition. Je pense en effet que ce sujet débordera dans le temps, sans doute jusqu’aux élections européennes, dont il pourrait constituer un enjeu important.
Merci encore, et bonne nuit à tous !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Nous en avons terminé avec le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 12 octobre 2023 :
À dix heures trente :
Questions orales.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 12 octobre 2023, à zéro heure quinze.