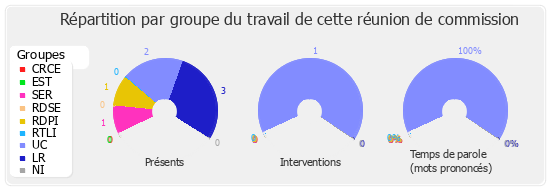Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 27 janvier 2010 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a procédé à l'audition de M. Lionel Collet, président de la Conférence des présidents d'université (CPU), sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Après avoir salué l'effort sans précédent que représente l'emprunt national pour les établissements d'enseignement supérieur et la recherche, M. Lionel Collet a soulevé plusieurs interrogations relatives aux modalités de sa mise en oeuvre.
Il a indiqué, tout d'abord, qu'une distinction était établie entre les campus d'excellence, dotés de 7,7 milliards d'euros, et les laboratoires d'excellence auxquels est attribué un milliard d'euros, la possibilité de candidater simultanément aux deux appels à projets étant exclue. Tout en rappelant l'objectif de 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur qui implique une carte des formations très étendue sur le territoire national, il a souligné la nécessité d'oeuvrer à l'émergence de campus d'excellence disposant d'une taille critique et d'une visibilité internationale mais aussi de promouvoir le développement de l'excellence au sein de l'ensemble du système d'enseignement supérieur et de recherche. Il a ainsi fait remarquer que les universités de petite taille disposaient généralement de laboratoires spécialisés reconnus internationalement et/ou de formations très attractives.
Il a relevé les modifications intervenues entre les propositions du rapport remis par MM. Alain Juppé et Michel Rocard et la déclaration du Président de la République sur le financement des projets en dehors des campus d'excellence. Il a estimé que d'autres spécialisations, notamment pédagogiques, devaient pouvoir faire l'objet de financements spécifiques.
Il s'est interrogé également sur le périmètre géographique des futurs instituts de recherche technologique, au nombre de quatre à six pour un montant de 2 milliards d'euros. Citant l'exemple du site de Saclay, il a fait remarquer que la recommandation du rapport de MM. Alain Juppé et Michel Rocard de regroupement sur un site unique dans un rayon d'un kilomètre ne correspondait pas à la réalité géographique française. Il a encouragé la logique de mise en réseau des compétences sans considération de masse critique ou de site restreint.
Il a mentionné le troisième appel à projet qui concerne les instituts hospitalo-universitaires. Il est prévu la création de cinq instituts pour un financement de 850 millions d'euros. Tout en soulignant l'importance d'un soutien à la reconnaissance de l'excellence clinique, il a évoqué des interrogations concernant les sites, qui conduisent également à encourager la mise en réseau des compétences. Il a ainsi illustré son propos en citant l'exemple de la transplantation, spécialité pour laquelle certaines villes françaises disposent de l'excellence hospitalière et clinique mais non de laboratoires de recherche, et inversement.
Enfin, il a abordé le volet numérique du projet de loi de finances rectificative, compte tenu du coût considérable que représente aujourd'hui la documentation électronique pour les établissements d'enseignement supérieur. Evoquant la position dominante des éditeurs en termes de tarification et l'insuffisante mutualisation des structures d'enseignement supérieur malgré l'existence d'un consortium, il a préconisé l'acquisition des licences de périodiques et le rachat des archives dont le coût s'élèverait entre 60 et 80 millions d'euros. Il a suggéré qu'une partie de l'enveloppe allouée au secteur du numérique prenne la forme d'un fonds placé, dont le produit des intérêts permettrait cette acquisition, le coût de la documentation électronique des organismes universitaires et de recherche étant estimé entre 30 et 40 millions d'euros par an.

a interrogé le président de la CPU sur les modalités de gouvernance du « grand emprunt » et de gestion des fonds prévues par le projet de loi. Il s'est inquiété des capacités internes et techniques des universités quant à la gestion des fonds qui leur seront affectés. Il a souhaité obtenir des précisions sur les indicateurs de mesure des résultats dans le cadre des conventions établies entre l'Etat et chaque organisme d'enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que sur la mise en réseau des compétences des universités de petite taille qui ne possèdent pas de laboratoire d'excellence mais mettent en oeuvre néanmoins des dispositions pédagogiques d'excellence.
Tout en notant que la France n'accusait pas de retard notable dans le domaine des publications de recherche, M. Jean-Claude Etienne, rapporteur pour avis, a relevé les difficultés de notre pays en matière de publications retenues sur le plan international et de dépôt de brevets en comparaison de certains pays, comme ceux de Scandinavie, la Corée du Sud ou les Etats-Unis, qui s'avèrent très performants. Il s'est interrogé sur les possibilités offertes par l'emprunt national pour inverser la situation actuelle de la France.
a approuvé la décision de renforcer les opérateurs existants au lieu de créer de nouvelles agences, tel que l'avait envisagé le rapport de MM. Alain Juppé et Michel Rocard. Toutefois, il a mentionné le défi que devra relever l'Agence nationale de la recherche (ANR) compte tenu de l'augmentation considérable, de un à 18 milliards d'euros, des fonds dont elle devra assurer la gestion.
Il a rappelé qu'une période probatoire de trois ans était instituée pour les campus d'excellence avant que les fonds puissent leur être délégués. Par ailleurs, il a appelé de ses voeux - à l'occasion du grand emprunt - le regroupement de fondations universitaires précédemment créées qui permettrait de disposer d'un outil de gouvernance spécifique à la gestion de ces fonds.
Citant l'exemple des universités de Perpignan, dans le domaine des études ibériques et de la biologie marine, et de Limoges pour la céramique, il a reconnu que, malgré l'existence de laboratoires d'excellence, un certain nombre d'universités ne disposait pas de la taille critique pour créer un campus d'excellence. A ce titre, il a considéré à nouveau comme insuffisant le milliard d'euros alloué aux laboratoires d'excellence en comparaison des 7,7 milliards d'euros destinés aux cinq à dix campus d'excellence.
Il a précisé que l'évaluation de la performance des campus d'excellence devrait reposer sur la production scientifique, la valorisation de la recherche et l'exploitation des brevets ainsi que sur l'attractivité du site au-delà du recrutement des enseignants et des chercheurs, notamment sa capacité à attirer les meilleurs étudiants.

Après avoir salué la qualité de l'intervention de M. Lionel Collet, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis pour l'enseignement supérieur, a considéré que la mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur pouvait contribuer à compenser toute forme de différenciation territoriale sur le plan de la carte universitaire. Par ailleurs, il s'est interrogé sur la méthodologie susceptible d'être mise en place pour éviter le risque de saupoudrage.
La charge d'intérêt de l'emprunt national devant être compensée par une réduction des dépenses de fonctionnement, il a souhaité savoir s'il existait de nouvelles sources de revenus ou d'économies pour les universités, liées par exemple à des politiques d'économie d'énergie ou de recyclage du papier.
a indiqué qu'un des objectifs du « plan campus » concernait la capacité de réorganisation et de valorisation des établissements d'enseignement supérieur, notamment en matière de maintenance ou de meilleure utilisation des bâtiments. Des dispositions relatives au recyclage de l'eau, par exemple, figurent déjà dans le cadre des écocampus.
Il s'est inquiété du sous-encadrement d'un grand nombre d'établissements universitaires français au regard des normes européennes. Il a précisé également que le ratio entre enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniciens, de l'ordre de deux pour un, était très inférieur à celui des grandes universités américaines qui disposent de plusieurs techniciens pour un enseignant. Il a fait remarquer que le temps consacré par les enseignants à des tâches administratives pèse sur l'organisation actuelle des universités.
Après avoir rappelé que le modèle d'allocation des moyens aux universités reposait partiellement sur la performance des établissements, il a regretté que le facteur d'efficience ne constitue pas plutôt un critère d'attribution des moyens. Il a rappelé que la prise en compte de ce critère était une revendication de la Conférence des présidents d'université.
Il a relevé que le montant du « grand emprunt » qui sera attribué aux campus d'excellence était de nature à constituer un élément correcteur de la situation actuelle en offrant la possibilité de recrutements complémentaires de qualité.
Il a déclaré que la CPU serait particulièrement attentive aux critères qui seront fixés par le cahier des charges pour les opérateurs souhaitant bénéficier de ces financements publics.

a fait remarquer, tout d'abord, que le modèle universitaire américain était très éloigné de l'état d'esprit qui prévalait en France. Il a relevé, par ailleurs, que les universités s'adressaient de plus en plus aux collectivités territoriales pour disposer de moyens supplémentaires, par exemple dans le secteur du logement afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement des étudiants.
Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'accueil d'étudiants étrangers en France, il a noté que la principale difficulté concernait la mobilité internationale des étudiants français qui leur offre l'opportunité de compléter leur formation.
Il a évoqué la stagnation du nombre d'enseignants dans l'enseignement supérieur et les besoins en la matière pour la réussite du « plan licence ». Puis il a souligné les difficultés liées au rapprochement d'établissements animés par des ambitions et des orientations différentes, l'un étant axé, par exemple, sur la mise en oeuvre du « plan licence », l'autre excellant dans le domaine de la recherche.
Il a encouragé l'Etat à doter les universités de moyens supplémentaires et l'a invité à inciter les collectivités territoriales à oeuvrer en ce sens à la condition qu'elles puissent mesurer les retombées de ces investissements en termes d'emplois et de création d'entreprises.
a déploré que la réduction du nombre de médecins décidée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conduise à un désengagement des praticiens hospitaliers dans le domaine de la recherche médicale. Il s'est interrogé sur la manière d'augmenter les capacités d'enseignement afin d'encourager les meilleurs étudiants à se diriger vers ces carrières.

a regretté que, désormais, l'entrée à l'université ne soit recommandée aux bacheliers qu'en second choix, indiquant que 55 % d'entre eux accédaient aux formations sélectives post-bac contre 45 % aux formations ouvertes. Puis, il a souhaité savoir comment, dans ce contexte de nouveaux moyens, la CPU envisageait, d'une part, la revalorisation de l'université et de sa capacité à attirer les jeunes et, d'autre part, le nécessaire rapprochement entre l'université et les grandes écoles. Il a conclu que le souci permanent est celui de la professionnalisation.

a souligné que la commission présidée par M. Christian Philip, à laquelle il a participé, semblait privilégier le niveau du pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) pour ce rapprochement.

a indiqué que le pôle européen de la céramique de Limoges, inscrit dans le plan université 2000 et dans deux contrats de plan successifs aidés par des fonds européens, n'est pas encore complètement opérationnel à ce jour. Elle a souligné la difficulté d'une université disposant de peu de moyens dans une région aux ressources budgétaires limitées et l'importance du temps nécessaire à la réalisation des projets. Elle a souhaité connaître l'évaluation par la CPU des besoins des campus d'excellence mais aussi des petites universités qui, ayant parfois quelques « pépites », méritent d'être aidées.

a souhaité obtenir une vision claire des différents modes de financement budgétaire des universités, de l'articulation de ces derniers, des modalités de consommation des crédits et de la répartition des dépenses entre investissement et fonctionnement. Il s'est dit ensuite préoccupé du taux d'échec à l'issue de la première année à l'université et favorable à l'examen de l'articulation entre le lycée et l'université, estimant nécessaire une réflexion sur cette question. Enfin, il s'est interrogé sur la durée annuelle de fonctionnement des universités.

Répondant à M. Yves Dauge, M. Jacques Legendre, président, a demandé au rapporteur pour avis au nom de la commission du projet de loi de finances rectificative pour 2010 de clarifier dans son rapport l'articulation des dispositions budgétaires existantes et des mesures nouvelles.

a regretté le manque de médecins en milieu rural, invoquant la trop grande difficulté du concours d'accès aux études médicales. Il a observé que les étudiants qui réussissent dans cette filière ont des ambitions légitimes au regard de leur grande compétence et ne souhaitent pas devenir des « médecins de campagne ». Estimant que la désertification des campagnes est partiellement liée au manque de structures médicales qui crée une insécurité, il a préconisé l'ouverture du numerus clausus afin de permettre l'accès d'étudiants au profil moins scientifique mais plus humaniste.

a estimé qu'il faudrait mettre en oeuvre un système de suivi de cohortes d'étudiants sur une période de dix ans afin étudier leur devenir à l'issue de cette période. Allant dans le même sens, M. Jean-Léonce Dupont a regretté la volonté inégale des universités de mettre en place ce type d'étude qui pourrait montrer le très faible taux d'insertion professionnelle de jeunes diplômés issus de certaines formations.

a déploré que des jeunes étudiants soient dirigés de façon persistante vers des filières dont on connaît pertinemment l'absence de débouchés professionnels.
a apporté aux orateurs les éléments de réponse suivants :
- le premier cycle d'enseignement supérieur qui conduit à la licence doit être conservé au sein de l'université française. L'université doit pouvoir proposer des formations de la licence jusqu'à la thèse. Un rapport remis à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'analyse comparative des systèmes universitaires internationaux montre que les universités américaines disposent en leur sein des trois cycles, licence, master et doctorat ;
- le remplacement des professeurs praticiens-hospitaliers devrait connaître des difficultés dans les années à venir, en raison de l'âge de plus en plus tardif de nomination au poste de professeur et du poids de la fonction de soins hospitaliers qui tend à réduire les activités d'enseignement et de recherche. La question du sous-encadrement se pose de façon différenciée selon les centres hospitalo-universitaires et a des répercussions sur le temps susceptible d'être consacré à la recherche par les jeunes médecins ;
- l'université souffre de cette image de choix par défaut. Dans notre pays, on revendique la formation de masse et, parallèlement, les jeunes étudiants s'orientent vers les filières sélectives, ceci d'autant plus quand les lycéens peuvent identifier un métier derrière la formation, pensant - parfois à tort - qu'elles offrent de réels débouchés. Il existe un engouement des nouvelles générations de lycéens pour les écoles qui, à la fois, pratiquent la sélection et proposent un métier. L'université reste un lieu de connaissance, de recherche et d'apprentissage, et dans bien des cas, une formation fondamentale doit être dispensée ; ainsi l'accès au master professionnel se fait par une licence générale ;
- la création de campus d'excellence est clairement l'occasion d'un rapprochement entre l'université et les grandes écoles mais des aménagements législatifs et réglementaires seront nécessaires à cette fin. Aujourd'hui, par exemple, un établissement tel qu'une école d'ingénieur ne souhaite pas perdre sa personnalité morale. Tout au plus, il envisagera d'être rattaché par convention à une université. L'enjeu de l'emprunt national est de favoriser ces rattachements à de nouveaux établissements qui ne sont pas des PRES, mais qui peuvent être des universités ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Le PRES se voit parfois reprocher d'être bâti non pas sur une relation de coopération mais sur un principe de pacte de non agression ;
- conformément à l'accord de 2007 entre le Premier ministre et la CPU afin de donner les moyens de leur autonomie aux universités, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a été augmenté d'un milliard d'euros par an et ce pour cinq années. Cela devrait permettre, à terme, de rattraper le niveau international. Néanmoins, sur le terrain, les difficultés demeurent pour certains établissements et il faudra du temps pour apprécier les résultats de l'emprunt national ;
- l'université française a vocation à accepter tous les bacheliers en première année ; tous les types de baccalauréat peuvent conduire à toutes les filières de l'enseignement supérieur. Mais tous les baccalauréats n'ont pas le même niveau et l'université s'honorerait à mettre en place des voies de formation et de remise à niveau pour les étudiants qui ne possèdent pas le bac le mieux adapté à la filière qu'ils ont choisie. C'est le modèle des universités britanniques. L'université de Savoie a mis en place un réseau d'enseignants référents dans les lycées pour aider à faire le lien entre le contenu de la formation et l'orientation. Ce type d'initiative constitue une excellente réponse pour réduire le taux d'échec en première année, qui est d'environ 50 % ;
- concernant les études de médecine, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit un décret, en préparation, qui doit donner la possibilité aux étudiants de s'engager à exercer au sein du service public en contrepartie d'une allocation pendant leurs études. C'est un élément de réponse mais ce n'est certainement pas le seul ;
- aujourd'hui la pression mise sur les universités porte sur le taux d'insertion professionnelle des diplômés et non sur le devenir de l'étudiant entrant en première année. A terme, ce taux sera un des critères pour l'allocation des moyens aux universités. Cela peut sembler pertinent mais ne tient pas compte du bassin local, de l'environnement socio-économique et de l'aspect territorial. Sur le devenir des étudiants de première année, de rares travaux portent seulement sur les réorientations dans les filières sélectives ;
- s'agissant de la durée annuelle de fonctionnement des universités, les laboratoires de recherche travaillent toute l'année et, pour l'enseignement, les locaux sont généralement occupés dix mois par an.