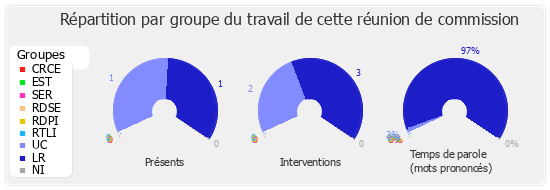Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé
Réunion du 21 juin 2006 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

a indiqué que, dans 6 % à 7 % des cas d'hospitalisation, en France, le malade développe une infection nosocomiale plus ou moins grave, soit 750.000 cas déplorés chaque année, avec des conséquences parfois dramatiques.
Ces infections peuvent provenir d'une bactérie endogène du patient : elles sont alors imprévisibles et souvent graves lorsqu'elles surviennent dans la zone anatomique opérée ; elles peuvent être aussi causées par une bactérie exogène présente dans l'établissement de santé, chez le personnel soignant, un autre patient ou un visiteur ; elles peuvent enfin, ce qui est alors souvent bénin, résulter d'un virus.
Les infections nosocomiales se traduisent le plus souvent par des infections urinaires (40 % des cas), des infections de la peau et des tissus (11 % des cas, notamment dans les services de long séjour et en psychiatrie), des pneumopathies (10 % des cas, souvent en réanimation) et des infections respiratoires hautes (9 %). Par ailleurs, les infections de l'organe opéré ou de la cicatrice et les bactériémies représentent respectivement 10 % et 4 % des infections nosocomiales.
La part des infections nosocomiales dans l'ensemble des accidents médicaux ne doit toutefois pas être surestimée dans la mesure où, si elles constituent 22 % des événements graves liés aux soins, les accidents médicamenteux, par exemple, en causent 27,5 %.
La survenance d'une infection nosocomiale est souvent liée à la pratique de soins invasifs, par exemple la pose d'une sonde ou d'un cathéter, à la réalisation d'un acte chirurgical, comme la pose d'une prothèse, et parfois au traitement lui-même, notamment lorsqu'il nécessite une transfusion ou une ventilation artificielle. Enfin, une immuno-dépression, un mauvais état général du patient, un âge avancé ou une pathologie menaçant le pronostic vital constituent des facteurs de risques majeurs.
La gravité de l'infection peut, par ailleurs, être exacerbée par l'utilisation d'antibiotiques qui sélectionnent des bactéries résistantes aux traitements. Or, la France détient, en Europe, le record du taux de résistance aux antibiotiques, notamment ceux utilisés pour combattre les principales bactéries à l'origine des infections nosocomiales.
a fait valoir que, du fait de leur origine endogène fréquente, il semble que 70 % des infections nosocomiales ne pourraient être évitées, même en faisant preuve d'une meilleure prévention.
Rappelant que la mesure précise du nombre de décès directement dus à une infection nosocomiale constitue un exercice délicat, dans la mesure où les patients entrent souvent à l'hôpital avec une pathologie grave et dans un état de fragilité générale, il a indiqué qu'environ 6,6 % des 136.000 décès qui interviennent chaque année à l'hôpital ou après une hospitalisation surviennent en présence d'une infection de ce type. Elle serait donc en cause pour environ 9.000 décès par an, dont 4.200 concernent des patients pour lesquels le pronostic vital n'était pas engagé à court terme à leur entrée à l'hôpital. Pour la moitié de ces 4.200 décès, aucune autre cause de décès n'a été identifiée.
Les infections nosocomiales sont également la cause de séquelles souvent considérables à moyen et long termes, notamment au niveau fonctionnel ; leur gravité dépend largement de la zone anatomique touchée par l'infection. Les infections abdominales, ostéo-articulaires, en particulier sur les prothèses, ou encore les infections suivant un acte de neurochirurgie sont susceptibles d'entraîner les conséquences sanitaires les plus dramatiques. Il a regretté, à cet égard, qu'aucune étude globale n'ait encore été menée sur les séquelles dues à une infection et sur leurs conséquences en termes sanitaires et économiques.
Puis M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur, a indiqué que les infections nosocomiales entraînent également un surcoût financier important, essentiellement dû à un allongement de la durée d'hospitalisation, qui atteint quatre jours en moyenne, au traitement anti-infectieux et aux examens de laboratoire nécessaires au diagnostic et à la surveillance de l'infection. La survenance d'une infection prolonge ainsi le séjour en chirurgie orthopédique de près de deux semaines et augmente les coûts de prise en charge de 300 %.
Les différentes études disponibles font état d'une échelle de coûts très large, allant de 340 euros en moyenne pour une infection urinaire à 40.000 euros pour une bactériémie sévère en réanimation. En appliquant une fourchette de surcoût moyen de 3.500 à 8.000 euros par infection aux 750.000 infections nosocomiales annuelles, on atteint un montant de dépenses de 2,4 à 6 milliards d'euros. Ainsi, une diminution de 10 % du nombre d'infections conduirait à une économie de 240 à 600 millions d'euros, soit jusqu'à six fois plus que l'effort de prévention, qui s'établit à 100 millions d'euros, consenti par les établissements hospitaliers.
Le calcul du coût des infections nosocomiales doit également prendre en compte celui de l'indemnisation du dommage. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les victimes d'infections nosocomiales postérieures au 5 septembre 2001 bénéficient d'un régime d'indemnisation plus favorable que celui applicable à la réparation des autres accidents médicaux. Ainsi, la responsabilité de l'établissement de santé est automatique, sauf à ce qu'il prouve lui-même que l'infection est due à une cause étrangère, et il revient à son assureur de prendre en charge la réparation.
La loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a complété ce dispositif en confiant à la solidarité nationale, via l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), la prise en charge de l'ensemble des infections, que l'établissement en soit ou non responsable, lorsqu'elles ont entraîné le décès du patient ou un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
Ce dispositif d'indemnisation protecteur des victimes pose deux difficultés : d'abord, il n'est pas applicable aux infections acquises en médecine de ville, pour lesquelles il revient au patient d'apporter la preuve de la faute du professionnel de santé ; ensuite, les infections graves survenues entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003 relèvent d'un régime juridique incertain : l'interrogation demeure sur leur prise en charge, par les assureurs ou par la solidarité nationale, en l'absence de rétroactivité claire de la loi du 30 décembre 2002 et du fait d'une jurisprudence contradictoire sur ce point.
a ensuite présenté la politique de lutte contre les infections nosocomiales. Il a rappelé que les premières structures de prévention ont été mises en place en 1988 avec la création obligatoire d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales dans chaque établissement de santé public ou participant au service public, avec pour mission d'organiser la surveillance des infections dans l'établissement, de former les personnels et de proposer toute recommandation utile à la prévention.
Cette première étape a été suivie, en 1992, par la création du comité national de lutte contre les infections nosocomiales et de cinq centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales, chargés notamment de la coordination des actions menées par les établissements qui ressortent de leur compétence régionale, ainsi que du recueil épidémiologique de prévalence et de la réalisation d'études épidémiologiques.
Puis la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a étendu le dispositif aux cliniques privées. Enfin, la surveillance épidémiologique a été améliorée à partir de 2001 par la mise en place du réseau d'alerte, d'investigation et de surveillance des infections nosocomiales (Raisin), en lien avec l'institut de veille sanitaire (InVS).
Cette politique a produit des résultats non négligeables en termes de prévalence des infections nosocomiales parmi les patients hospitalisés : entre 1996 et 2001, leur taux a été ramené de 8,3 % à 7,2 % dans les centres hospitaliers universitaires et de 6,5 % à 5 % dans les centres hospitaliers. La nouvelle enquête de prévalence, en cours, montrera si cette tendance se confirme.
Récemment, le dispositif de prévention a été renforcé et modernisé par la mise en place d'un programme de lutte contre les infections pour la période 2005-2008, qui a pour objectifs de renforcer les structures, d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient infecté, d'actualiser les recommandations, de renforcer la surveillance épidémiologique des infections, mais aussi de mieux informer les usagers sur le risque infectieux. La publication progressive d'indicateurs de qualité pour chaque établissement de santé a commencé avec la présentation, en février 2006, d'un indicateur composite d'évaluation des activités de prévention, qui sera suivie, dans les prochains mois, par la publication de quatre indicateurs supplémentaires : le taux d'infections par type d'acte opératoire, le volume annuel de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène des mains, le taux de staphylocoques dorés résistants à la méticilline et le suivi de la consommation d'antibiotiques.
Enfin, une mission nationale d'information et de développement de la médiation sur les infections nosocomiales (Idmin) a été créée au sein de la Haute Autorité de santé pour améliorer l'information des usagers.
a rappelé que, dans le cadre de son étude sur les infections nosocomiales, l'Opeps a confié à l'institut de sondages Ipsos une enquête sur la perception du risque d'infections nosocomiales à la fois par les professionnels de santé et par le grand public. Il en ressort que le risque d'infection à l'hôpital est désormais connu par la grande majorité des Français, qui ont pris conscience des conséquences possibles d'une hospitalisation, mais que l'information est encore trop partielle s'agissant des facteurs de risque et des conséquences sanitaires. De la même manière, les professionnels de santé doivent être davantage sensibilisés au mécanisme d'indemnisation, notamment pour être en mesure d'informer correctement leurs patients de son existence.
Il a estimé que la politique de lutte contre les infections nosocomiales doit désormais s'orienter dans trois directions pour assurer la réduction du taux de prévalence de ce type d'infections dans les hôpitaux français :
- la première piste concerne la poursuite de la politique d'hygiène et de prévention grâce à une meilleure reconnaissance des métiers de l'hygiène, infirmier hygiéniste et médecin hygiéniste, et au strict respect des mesures de prévention par les professionnels de santé, comme la désinfection systématique des mains ou l'observation des bonnes pratiques pour ce qui concerne les soins, en particulier ceux liés à un dispositif invasif. La politique de prévention doit aussi promouvoir le développement des examens de dépistage de la présence de bactéries endogènes chez le patient avant une opération à risques et l'application des pratiques de bon usage des antibiotiques nécessaires à la limitation de l'évolution constatée des bactéries multirésistantes ;
- la deuxième piste concerne la recherche des meilleurs traitements pour les patients atteints d'une infection. Il s'agit notamment d'accélérer la mise en place des unités spécialisées dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires prévues par le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 et destinées à éviter les complications graves liées à un traitement inadapté, ce qui suppose la formation d'équipes de soignants spécialisées en infectiologie et en chirurgie, en nombre insuffisant aujourd'hui. Par ailleurs, l'effort de recherche doit porter sur l'origine des infections nosocomiales, en particulier les raisons pour lesquelles les bactéries exogènes parviennent dans la plaie opératoire et les relations entre la présence de bactéries endogènes avant l'opération et la survenance d'une infection postopératoire, et sur les séquelles des infections et le suivi des patients susceptibles de développer une infection, grâce à la constitution d'un registre des patients porteurs de prothèses orthopédiques, pour réagir vite en cas d'alerte ;
- la troisième piste porte sur la clarification du dispositif juridique d'indemnisation afin de trancher sans tarder, au niveau législatif, la question de la rétroactivité, ou non, de la loi du 30 décembre 2002 pour les infections survenues entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003.

s'est étonné, au regard de la politique affichée par les pouvoirs publics d'intensification de la lutte contre les infections nosocomiales, que trois hôpitaux publics des environs d'Aix-en-Provence aient dû fermer leurs services de stérilisation, qui n'étaient plus aux normes, pour en confier l'activité à des entreprises extérieures. Il a estimé que cette décision n'est pas cohérente avec l'objectif de maîtrise du risque infectieux dans les établissements de santé. Il a souhaité, à cet égard, la mise en place d'une organisation nationale des services de stérilisation pour l'hôpital public.
a fait valoir que les décisions de fermeture de services sont souvent prises pour des raisons de gestion locale de l'organisation des soins. Il a considéré qu'il est préférable de fermer les services dangereux pour y investir les crédits nécessaires à leur mise aux normes.

a estimé qu'il convient au contraire d'aider les services des hôpitaux publics à assurer une prestation de qualité, avant que leur vétusté n'oblige à les fermer.
a rappelé qu'un groupe de travail existe à l'Assemblée nationale sur les infections nosocomiales, dont l'activité a été suspendue pendant la durée de l'étude de l'Opeps sur le même thème. Il a souhaité qu'il puisse suivre l'application des recommandations du rapport dans les prochains mois. Il a demandé combien d'hôpitaux sont équipés de livrets de bonnes pratiques sur les protocoles de soins.
s'est interrogée sur l'existence de données pour la légionellose.
Citant l'exemple de l'hôpital européen Georges Pompidou, M. Paul-Henri Cugnenc, député, a estimé que les cas de légionellose n'y ont pas été plus nombreux qu'ailleurs, mais que les médias s'y sont particulièrement intéressés en raison de sa réputation d'établissement modèle. Il a indiqué qu'après six ans de dysfonctionnements, le fonctionnement de cet hôpital est désormais conforme aux exigences de qualité.

En réponse aux intervenants, M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur, a indiqué que l'étude du centre national d'expertise hospitalière n'a pas traité particulièrement des cas de légionellose. Il a rappelé que ce type de données devrait être apprécié avec le retour des fiches de signalements des hôpitaux, qui doivent faire connaître les infections les plus graves ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre.
a considéré que le premier geste de prévention est celui d'un bon entretien des locaux hospitaliers. Rappelant que le nombre d'agents de service est en diminution constante, elle s'est interrogée sur le respect des protocoles d'hygiène par des équipes extérieures à l'établissement.
a estimé que les gestes d'hygiène résultent avant tout du bon sens, comme le nettoyage des mains et des locaux pour éviter le développement de germes.
a fait valoir qu'il est nécessaire de disposer d'un personnel soignant et d'entretien permanent pour assurer le bon respect de ces règles.

a rappelé, à cet égard, l'importance du rôle, insuffisamment reconnu, des infirmières hygiénistes dans les établissements de santé.
A l'issue de ce débat, l'Opeps a autorisé la publication du présent rapport d'information.
En préambule à la présentation de son rapport, Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a souligné que la consommation en médicaments psychotropes des Français est la plus importante de toutes celles des pays de l'Union européenne et que le montant des remboursements assurés par la sécurité sociale, pour cette catégorie de médicaments, s'est élevé à un milliard d'euros en 2004. Pour comprendre les raisons de cette consommation, l'Opeps a sollicité l'éclairage d'une expertise scientifique extérieure qui a été confiée par appel d'offres à une équipe pluridisciplinaire de scientifiques (dix experts), animée par le Professeur Verdoux de l'Inserm de Bordeaux et le Professeur Bégaud, président de l'Université de Bordeaux 2. Le rapport de l'équipe scientifique représente un important travail de synthèse prenant en compte de manière approfondie un très grand nombre de travaux scientifiques et intégrant les contributions directes de plus de vingt personnes en dehors de l'équipe proprement dite.
a ensuite rappelé la définition des psychotropes proposée par Jean Delay en 1957, selon laquelle un psychotrope est une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle, qui a un tropisme psychologique, c'est-à-dire susceptible de modifier l'activité mentale, sans préjuger du type de cette modification. Les médicaments psychotropes font partie de la prise en charge thérapeutique de la psychiatrie sans pour autant la résumer. La famille des psychotropes est divisée en plusieurs classes : les anxiolytiques ayant un effet sédatif et qui sont essentiellement à base de benzodiazépine, les hypnotiques, dont l'indication est l'induction du sommeil et les neuroleptiques, ou antipsychotiques, dont l'indication principale est le traitement des symptômes psychotiques dans la schizophrénie. Ces médicaments peuvent être utilisés pour le traitement des symptômes anxieux dans les dépressions sévères et la catégorie des antidépresseurs regroupe des produits tricycliques, découverts dans les années cinquante, ainsi que d'autres molécules plus récentes, les inhibiteurs sélectifs de recapturage de la sérotonine, qui ont pour atout d'induire des effets secondaires limités. Prescrits dans le traitement des épisodes dépressifs, un grand nombre de ces spécialités pharmaceutiques ont obtenu des autorisations de mise en marché pour le traitement des troubles anxieux et des troubles alimentaires. Il faut enfin citer la catégorie des psychostimulants, qui sont prescrits pour le traitement des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité de l'enfant de plus de six ans, et celle des sels de lithium, indiqués pour le traitement de la maladie maniaco-dépressive.
Puis Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a présenté les principales caractéristiques de la consommation de psychotropes en France. Le premier constat établi par l'étude scientifique est celui d'une banalisation du recours aux médicaments psychotropes dans notre pays. Un Français sur quatre déclare avoir consommé au moins un médicament psychotrope au cours des douze derniers mois, et un Français sur trois en a déjà consommé dans sa vie. Pour les tranches d'âges les plus élevées, le recours est plus massif : après soixante ans, la moitié des femmes et un tiers des hommes ont pris au moins un psychotrope dans l'année. Les personnes âgées sont particulièrement exposées à un usage chronique, mais la consommation des jeunes doit également être surveillée, car une fille sur quatre et un garçon sur cinq ont consommé au moins une fois un médicament psychotrope avant l'âge de dix-huit ans.
La durée de prise est un paramètre important de l'analyse de la consommation. Parmi les personnes déclarant consommer des psychotropes, 30 % sont engagées dans une consommation d'au moins deux ans et la même proportion en consommera pendant une durée supérieure à un an. Les consommateurs réguliers de psychotropes sont évalués à 11 % des personnes rattachées au régime général de sécurité sociale.
a souligné le constat relevé par l'étude, selon lequel 80 % des prescriptions de psychotropes émanent de médecins généralistes. Pour comprendre et juger l'usage qui est fait des médicaments psychotropes, il faut analyser les pratiques de prescription des médecins généralistes et l'adéquation des traitements qu'ils préconisent avec l'état de santé psychique des patients.
Par ailleurs, la consommation a fortement augmenté depuis 1990 sous l'influence de deux facteurs principaux. D'une part, la mise sur le marché de médicaments antidépresseurs aux effets secondaires, qui est à l'origine de la diffusion de ces médicaments en médecine générale, d'autre part, le champ d'utilisation des médicaments psychotropes, qui s'est considérablement étendu au fil des années. A partir des pathologies psychiatriques avérées, l'indication s'est élargie à la prise en charge de troubles psychiques plus légers, voire de simples troubles du sommeil.
En termes de santé publique, on est confronté à la fois à des problèmes de consommation pendant des durées excessivement longues et à des phénomènes tout aussi nombreux de traitements insuffisants. Par ailleurs, les traitements prescrits semblent fréquemment peu adaptés et les indications des traitements sont également peu respectées : moins d'une personne sur trois souffrant de dépression en France bénéficie d'un traitement antidépresseur approprié, tandis qu'on ne constate pas de troubles psychiatriques chez la moitié des personnes consommant des antidépresseurs, et plus des deux tiers de celles consommant des anxiolytiques et hypnotiques. Ces pratiques montrent un réel problème d'usage des médicaments psychotropes en France.
Une telle situation n'est pas sans risques. Un très grand nombre de personnes consomment des psychotropes de façon chronique pour un bénéfice thérapeutique parfois faible, sans une juste mesure des effets secondaires, alors que sur une population aussi importante de consommateurs, des effets secondaires, même peu fréquents, peuvent avoir des répercutions considérables en termes de santé publique. Ainsi, l'étude s'est attachée à évaluer les risques que les psychotropes font courir à la population dans trois domaines : risques de détérioration cognitive liés à l'usage prolongé des benzodiazépines, risques de suicide parmi les personnes traitées aux antidépresseurs et risques secondaires indirects résultant de l'usage des psychotropes, tels que les accident ou les chutes chez les personnes âgées.
Ces investigations ont également mis en évidence que l'absence de données pharmaco-épidémiologiques empêche d'évaluer le rapport bénéfices/risques des médicaments de façon suffisamment précise au regard des enjeux de santé publique. A cet égard, il est regrettable que l'évaluation médicale des médicaments en situation réelle n'en soit qu'à ses débuts en France. Un meilleur usage des médicaments psychotropes en France suppose d'assurer un suivi pharmaco-épidémiologique suffisamment précis de la consommation, dans le cadre du système de veille sanitaire, mais également d'aider les médecins généralistes à assurer une prise en charge plus adéquate des problèmes psychiques de leurs patients.
a ensuite présenté les recommandations dont elle propose l'adoption par l'office : il convient tout d'abord d'adapter le contenu de la formation initiale et continue des médecins afin d'assurer un meilleur respect des recommandations de bonnes pratiques en matière de prescription de médicaments. La formation en pharmacologie des étudiants en médecine est en effet passée de 160 heures dans les années 1970 à 80 heures aujourd'hui. Cette recommandation rejoint les conclusions du récent rapport de Mmes Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, sénatrices, sur la mise sur le marché des médicaments. Cette formation devrait également être mieux adaptée aux problèmes rencontrés par les praticiens car sur un ensemble de 3.000 références de médicaments actuellement disponibles, un médecin généraliste est amené à en utiliser plus de 500 dans sa pratique quotidienne. Par ailleurs, les formations continues dépendant encore trop souvent des laboratoires pharmaceutiques, il faudrait en confier la coordination et la validation à un organisme public dont la compétence scientifique est reconnue, telle que l'Université. La diffusion des recommandations de bonnes pratiques devrait être placée sous la responsabilité de la Haute Autorité de santé (HAS) et il faudrait affirmer clairement la compétence et la responsabilité de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssap) pour la réalisation des études post-AMM à finalité sanitaire, en complément des études post-AMM à finalité économique entreprises par les autres autorités sanitaires. Enfin, l'impact des mesures destinées à maîtriser la consommation de médicaments psychotropes devrait être systématiquement évalué, afin de vérifier non seulement que les objectifs poursuivis ont été atteints, mais aussi qu'il n'y a pas de report sur d'autres médicaments.
Le second axe des recommandations vise l'amélioration de la prise en charge des soins en santé mentale, conformément à l'objectif du plan « santé mentale » engagé l'année dernière par le gouvernement pour la période 2005-2008, dont un premier bilan d'application est en cours de préparation. Il convient aussi de réfléchir aux moyens de familiariser l'ensemble des étudiants de médecine avec la réalité de la pratique de la psychiatrie, sans oublier les autres professions de santé car, par exemple, depuis la refonte de la formation d'infirmière, des insuffisances ont également été relevées sur ce point. La coordination des médecins généralistes et des médecins psychiatres dans la prise en charge des troubles psychiatriques doit aussi être développée et dans ce but, il est proposé que, lors du renouvellement d'une prescription de psychotropes par un médecin généraliste, celui-ci envisage systématiquement la possibilité d'une consultation concomitante chez un psychothérapeute ou un médecin psychiatre, afin de vérifier la pertinence d'une prolongation du traitement.
Le troisième axe de recommandations concerne la mise en place d'instruments de suivi épidémiologique ainsi que l'information des prescripteurs et du grand public sur le bon usage des médicaments psychotropes. La surveillance pharmaco-épidémiologique des populations les plus exposées aux risques doit être renforcée, particulièrement celles des personnes âgées en institution, des jeunes enfants et des adolescents. La systématisation des études d'évaluation bénéfices/risques en situation réelle permettrait, par ailleurs, d'établir des recommandations pour des prescriptions plus adaptées de psychotropes et les prescripteurs devraient être mieux informés des manifestations du syndrome de sevrage et respecter les protocoles lors de l'arrêt d'un traitement. Les pouvoirs publics doivent également mettre en oeuvre des campagnes d'information sur le bon usage des médicaments psychotropes et il faut saluer l'initiative récente de l'Afssaps de publier deux livrets sur les psychotropes, le premier destiné aux patients, le second aux médecins généralistes. A cet égard, Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a rappelé la distinction, essentielle à ses yeux, entre usage thérapeutique et usage toxicomaniaque des psychotropes, la confusion entre les deux étant à l'origine d'un comportement paradoxal chez les Français : bien que globalement très consommateurs de médicaments, ils abandonnent souvent trop tôt leur traitement par antidépresseurs pouvant entraîner une dépendance et sont contraints à le reprendre pour stabiliser leur état de santé.
a enfin estimé qu'il faut évaluer la pertinence des décisions de déremboursement de certains produits pharmaceutiques à base de plantes, celui-ci pouvant induire des risques de report vers d'autres spécialités pharmaceutiques.
En conclusion, Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a considéré que si les médicaments psychotropes représentent un apport thérapeutique considérable pour la prise en charge des pathologies psychiatriques sévères, leur utilisation, lorsque les patients souffrent de troubles psychiques liés à des évènements de vie, doit rester ponctuelle et qu'il faut davantage s'appuyer sur les alternatives thérapeutiques pour éviter des effets secondaires non négligeables.

a remercié la rapporteure et regretté que les prescriptions ne respectent pas davantage les recommandations de bonnes pratiques, en particulier sur les durées de traitement.
ayant indiqué que, selon l'étude scientifique, le nombre de prescriptions effectuées par les médecins généralistes augmente à mesure qu'ils avancent en âge, M. Nicolas About, sénateur, président, a estimé que ce phénomène est peut-être lié à la croissance de la clientèle qui réduit leur disponibilité et leur temps d'écoute.
a félicité Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, pour son rapport, qui souligne bien les enjeux de santé publique attachés au bon usage des médicaments psychotropes. Il a indiqué qu'il fallait vérifier si l'Université n'avait pas déjà un rôle dans la validation des enseignements de formation médicale continue et a confirmé que le besoin d'approfondir les connaissances en psychiatrie au stade de la formation initiale ne se limite pas aux étudiants en médecine et concerne d'autres professions de santé, telles que les infirmières et les sages-femmes.

a demandé si les pratiques de prescription des médecins psychiatres sont différentes de celles des médecins généralistes pour ce qui est des durées de traitement.
a indiqué que pour les psychiatres, la conduite de psychothérapies impliquant de nombreuses séances sur une longue période, elle permet de se constituer une clientèle régulière et qu'en ce qui concerne les prescriptions, on peut penser que la meilleure capacité diagnostique des médecins psychiatres favorise un traitement approprié.

a relevé que les médecins généralistes se heurtent souvent à la réticence des patients à qui ils ont conseillé de consulter un médecin psychiatre, ceux-ci préférant se voir prescrire des médicaments psychotropes par leur médecin généraliste, plutôt que de laisser croire qu'ils sont atteints par une maladie mentale en allant consulter un psychiatre.
a souligné combien la peur d'une stigmatisation est un obstacle à la poursuite de traitements adaptés.

a estimé qu'il faut renforcer le rôle d'expertise des médecins psychiatres, auxquels les médecins généralistes peuvent adresser leurs patients pour un bilan.
a remarqué que la durée de la consultation chez un médecin généraliste ne donne pas toujours à ce dernier le temps nécessaire à une écoute approfondie de son patient.
A l'unanimité, l'office a autorisé le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.