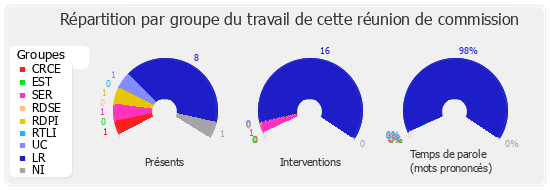Commission des affaires économiques
Réunion du 23 janvier 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède à l'audition de M. Bruno Sido et de Mme Catherine Procaccia sur le rapport « Les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne » fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre deux membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Catherine Procaccia et Bruno Sido, nous présenter leur rapport sur les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne.
Ce rapport résulte d'une saisine de notre commission en janvier 2012, et il me paraît très important de suivre les travaux de l'Office que nous avons sollicités.
Nous avons en cours deux saisines : l'une sur la filière hydrogène et l'autre sur les alternatives possibles à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Là encore, nous recevrons les auteurs des rapports en résultant.
Je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez ce rapport et les préconisations que vous faites, s'agissant de l'avenir de la politique spatiale européenne.
Vous pourrez aussi évoquer les résultats de la réunion ministérielle en charge de l'espace des États membres de l'Agence spatiale européenne qui a eu lieu fin novembre 2012. Je crois que l'on peut être satisfait des engagements pris qui vont dans le sens des propositions françaises pour une large part.

Le rapport que l'Office a adopté à l'unanimité en novembre dernier s'intitule « Europe spatiale : L'heure des choix », car nous l'avons élaboré dans la perspective de la réunion des ministres en charge de l'espace des pays membres de l'Agence spatiale européenne. Celle-ci s'est déroulée les 20 et 21 novembre à Naples et a constitué un tournant, avec des décisions importantes prises dans un contexte économique et financier ne permettant pas d'envisager un subventionnement massif du secteur spatial.
L'Europe, qui dépense six fois moins que les États-Unis pour l'espace, a su par le passé, faire les choix qui lui ont permis de devenir une grande puissance spatiale pour un coût maîtrisé. Sa capacité à conserver ou non son rang à l'avenir dépend directement des décisions récentes, qui doivent, pour plusieurs d'entre elles, être confirmées lors d'une prochaine réunion programmée en 2014.
J'aborderai d'abord les questions de gouvernance. La politique spatiale ne saurait être examinée dans un cadre strictement national. Mais il n'est pas possible, pour autant, d'identifier « une » politique spatiale européenne unique, dont découlerait l'ensemble des programmes mis en oeuvre sur le continent. Il existe aujourd'hui au moins deux politiques spatiales européennes :
- celle de l'Union européenne, que le traité de Lisbonne a dotée d'une compétence spatiale depuis 2009 ;
- celle de l'Agence spatiale européenne (ESA), première institution à avoir incarné l'Europe de l'espace, à sa création en 1975.
L'ESA elle-même ne s'est pas construite sur une « table rase », mais sur l'expérience de ses États membres, en premier lieu la France, premier État européen à avoir développé une politique spatiale, dans le cadre d'une politique d'indépendance nationale. La politique spatiale comporte trop d'enjeux de souveraineté nationale pour ne pas reposer, en dernier ressort, sur la volonté des États, dans le cadre d'organisations telles que l'ESA et l'UE ou dans un cadre national ou multinational, comme c'est le cas pour l'Europe de la défense.
Enfin il ne saurait y avoir de politique spatiale européenne sans industrie spatiale européenne, seule garante in fine de l'autonomie de l'Europe.
Ce « mille-feuille » spatial européen peut être source de confusion dans les objectifs et de dispersion des moyens. Dans ce contexte, nous formulons des propositions de nature à clarifier la gouvernance de la politique spatiale en France et en Europe :
- en France, il nous semble qu'il faudrait réintroduire l'espace dans l'intitulé d'un ministère chargé d'en valoriser l'utilité auprès du grand public. L'ambition spatiale est trop peu portée aux niveaux politiques et administratifs ; en conséquence, elle est peu partagée par l'ensemble des Français ;
- toujours en France, il serait souhaitable d'associer davantage le Parlement à la programmation spatiale. Nous avons été frappés, lors de notre déplacement aux États-Unis, par la place qu'y occupe le Congrès dans l'élaboration de la politique spatiale. La NASA est en constante négociation avec les deux chambres pour la définition des objectifs et des budgets de sa politique. Le secteur spatial n'est certes qu'une illustration parmi d'autres des différences d'approches entre parlements français et américain. Il nous paraîtrait néanmoins légitime qu'en France, le Parlement puisse être saisi à intervalles réguliers de la politique spatiale française et de la vision défendue au niveau européen par notre pays ;
- lors de nos auditions, les industriels ont exprimé le sentiment de ne pas être assez associés aux décisions prises. Sur la question de l'avenir d'Ariane, le CNES et les industriels ont par exemple défendu des points de vue différents. Un dialogue pérenne doit être organisé, grâce à la création d'une structure de concertation État-industrie, présidée par une personnalité indépendante ;
- quant à la politique spatiale de l'Union européenne, c'est un processus en devenir, dont les objectifs et le cadre de gouvernance demeurent pour le moment flous. Le budget de l'Union finance le programme de navigation-localisation-synchronisation Galileo, qui doit aboutir d'ici 2015, ainsi que le lancement du programme de surveillance pour l'environnement et la sécurité GMES, mais sans garantie de pérennité au-delà de 2014.
Si elle veut exercer pleinement la compétence que lui a confiée le traité de Lisbonne, l'Union devra élaborer un véritable programme spatial plus exhaustif dans ses ambitions.
Elle devra également élaborer un cadre juridique pour la gouvernance de cette politique spatiale, en faisant de l'ESA son agence spatiale, sans que cela ne remette en cause par ailleurs le fonctionnement intergouvernemental de l'agence. L'Union doit aussi pouvoir faire appel aux compétences des agences nationales, sans nécessairement recourir à ses procédures de droit commun, du type appel d'offres. Pour la gestion des applications spatiales, elle doit privilégier le recours aux organisations existantes, par exemple Eumetsat pour ce qui concerne l'observation de la Terre (GMES).
Il s'agit d'éviter que l'Union ne crée ses propres structures de gestion opérationnelle des programmes spatiaux, qui seraient redondantes par rapport aux compétences existant déjà sur le territoire européen.
Enfin, l'Union européenne doit reconnaître comme prioritaire l'application d'un principe de préférence européenne. Ce principe doit entraîner l'obligation de recourir à ses propres lanceurs. Ce n'est pas le cas actuellement, comme l'illustre le recours à un lanceur russe (Rockot) pour le lancement de certains satellites du programme GMES.
Quant à l'ESA, elle doit faire évoluer sa règle de « retour géographique », d'après laquelle plus un État contribue à un programme, plus son industrie reçoit de contrats pour la réalisation de ce programme. Suivant une logique inverse, une règle de « juste contribution » de chaque État, en fonction de l'implication de son industrie dans les projets, paraîtrait préférable.
La seconde partie de mon propos portera sur les conséquences de la concurrence croissante dans le secteur spatial. On assiste à l'émergence de nouveaux acteurs publics et privés. Cette concurrence est d'autant plus inquiétante pour l'Europe qu'elle a choisi de faire reposer son industrie spatiale, et notamment ses lanceurs, sur la demande commerciale. Le marché commercial est en effet le moteur principal de l'industrie spatiale, à défaut de commandes institutionnelles conséquentes.
Quand les budgets publics spatiaux américains sont de 48 milliards de dollars par an, les budgets publics européens sont de 6,5 milliards d'euros. La diminution des commandes militaires conduit les industriels américains à se tourner davantage vers le marché commercial. Par ailleurs, dans le domaine des lanceurs, la NASA favorise le développement d'entreprises commerciales telles que Space X - nous y reviendrons.
La Russie relance actuellement son activité spatiale en investissant massivement dans une nouvelle gamme de lanceurs et un nouveau port spatial. Les pays émergents, notamment ceux très peuplés comme la Chine ou l'Inde, misent aussi sur ce secteur, au service de leur développement et pour s'affirmer sur la scène internationale. Vous trouverez des développements sur les politiques spatiales russe et chinoise dans des notes annexées au rapport.
Dans ce contexte, il est indispensable d'aider l'industrie européenne à demeurer compétitive, en poursuivant le soutien apporté à la filière européenne de satellites de télécommunications par de grands programmes structurants, et en suscitant le développement d'une filière européenne de satellites à propulsion tout-électrique.
Le marché semble mûr pour cette technologie du « tout-électrique » : il s'agit d'utiliser la propulsion électrique non seulement pour des ajustements de la trajectoire des satellites, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais aussi pour les transférer après lancement vers leur orbite définitive. Boeing a pris de l'avance dans ce domaine grâce à une technologie développée pour des satellites de télécommunications militaires. Cette entreprise a vendu des satellites de ce type à des opérateurs asiatique et mexicain. Il s'agit de petits satellites (2 tonnes) dotés de la même capacité d'emport de charge utile qu'un satellite à propulsion chimique de 3 à 4 tonnes. Ce gain en termes de masse compense l'inconvénient lié à un délai allongé de mise en orbite du satellite.
Il faut également agir pour réduire la dépendance technologique de l'Europe, notamment dans le domaine des composants microélectroniques durcis. Cette dépendance est préjudiciable dans le contexte des règles d'exportation américaines ITAR, qui interdisent aux industriels européens d'exporter sans autorisation des produits qui comporteraient des composants ou technologies développés aux États-Unis. Thalès Alenia Space en a subi les conséquences, en étant l'objet d'une investigation du département d'État américain, en lien avec l'exportation d'un satellite en Chine. Mais ce sont, à vrai dire, les industriels américains qui sont, les premiers, victimes des règles d'exportation ITAR.
La question de la dépendance de l'Europe à l'égard de technologies importées ne se réduit pas à celle des règles ITAR. C'est une question de compétitivité, car la dépendance entraîne des difficultés d'accès aux technologies de dernière génération, ainsi qu'une limitation de l'accès à la documentation, entraînant des difficultés à gérer, par exemple, des anomalies. L'existence d'une source d'approvisionnement unique est en soi un facteur de risques.
Le concept de non dépendance implique donc une maîtrise des technologies et l'existence d'une double source, dont l'une au moins située en Europe. Mais elle implique aussi une maîtrise des coûts. Le maintien à tout prix en Europe de filières beaucoup plus coûteuses qu'aux États-Unis n'est pas viable. Il faut donc veiller à la rentabilité économique des filières développées et concentrer les moyens disponibles sur quelques priorités.
J'en viens maintenant à la question des lanceurs. C'est par l'intermédiaire d'Arianespace, créée en 1980, que l'Europe accède aujourd'hui de façon indépendante à l'espace. Arianespace exploite à ce jour trois lanceurs depuis le Centre spatial guyanais :
- tout d'abord, Ariane 5, dont la capacité d'emport (dans sa version ECA) est de 10 tonnes vers l'orbite géostationnaire, et qui se caractérise par des lancements doubles. Ariane 5 est le n° 1 des lancements en orbite géostationnaire, avec près de 50 % de parts de marché et, à ce jour, 53 succès d'affilé ;
- le deuxième lanceur d'Arianespace est Soyouz, exploité depuis Baïkonour, par l'intermédiaire de la filiale d'Arianespace - Starsem - créée en 1996. Depuis 2011, Soyouz est aussi lancé depuis la Guyane, en application d'un accord intergouvernemental franco-russe, signé en 2003. Ce lanceur moyen est complémentaire d'Ariane 5. Il a une capacité d'emport de 3,2 tonnes vers l'orbite de transfert géostationnaire (depuis le CSG, mais 1,7 tonne depuis Baïkonour, plus éloigné de l'équateur) ;
- enfin, le dernier né des lanceurs européens est Véga, financé majoritairement par l'Italie, dont la capacité d'emport est de 1,5 tonne en orbite basse, mais qui a vocation à monter en puissance. Véga est destiné à répondre à la demande institutionnelle, c'est-à-dire celle des agences spatiales, qui réalisent des satellites de plus en plus petits.
S'interroger sur l'avenir de cette gamme de lanceurs implique de s'interroger, en premier lieu, sur l'évolution prévisible des marchés.
Le nouveau lanceur devra d'abord répondre à la demande institutionnelle. A l'heure actuelle, Ariane 5 est surdimensionnée pour ce marché. L'Europe a donc recours à Soyouz, ce qui n'est pas complètement satisfaisant car il ne s'agit pas d'un lanceur développé par l'Europe, et parce que la coopération avec la Russie n'est assurée que jusqu'en 2020. La qualification du lanceur Véga devrait résoudre une partie du problème, en permettant à tout le moins d'éviter le recours aux lanceurs russes dérivés de missiles balistiques (Rockot, Dnepr). Il n'en reste pas moins qu'Ariane, conçu pour des objectifs de souveraineté, est en réalité peu utilisé pour le lancement de nos satellites gouvernementaux.
Le nouveau lanceur devra aussi répondre à la demande commerciale. Or ce marché se caractérise par l'émergence de nouveaux acteurs. L'américain Space X a remporté plusieurs contrats de lancement de satellites de télécommunications, alors même qu'il n'a pas encore procédé à des lancements en orbite géostationnaire. Mais le soutien que la NASA apporte à cette entreprise incite les clients à l'optimisme. Space X est en effet directement héritière du tournant pris par la politique spatiale sous la présidence Obama. Ce tournant consiste à recentrer la NASA sur sa mission de Recherche & Développement en vue de l'exploration lointaine, et à octroyer des subventions à des entreprises privées pour la reconquête de l'orbite basse - c'est-à-dire la desserte habitée de la Station spatiale.
Nous avons visité Space X lors de notre déplacement aux États-Unis. Cette entreprise est fondée sur un principe tiré a contrario des leçons de la navette spatiale : de la simplicité découlent à la fois la fiabilité et la modicité des coûts. Le lanceur Falcon 9 de Space X est un système modulable, fondé sur un étage de lanceur et un moteur kérosène - oxygène, combinés en tant que de besoin. L'organisation productive est simplifiée au maximum. Nous l'avons constaté dans l'usine californienne de Space X, qui frappe par la simplicité au moins apparente de son organisation.
Par ailleurs, la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie développent d'autres lanceurs potentiellement concurrents des nôtres.
Or cette concurrence croissante intervient sur un marché où la demande est appelée à demeurer stable, autour de 20 à 25 satellites de télécommunications par an. Dans ce contexte, deux projets de lanceur, conçus à l'origine comme complémentaires, sont devenus progressivement concurrents. Démarré après la conférence ministérielle de l'ESA de 2008, Ariane 5 ME est une évolution du lanceur actuel vers un lanceur plus performant (12 tonnes) et plus « versatile », c'est-à-dire doté d'un étage supérieur rallumable grâce au moteur Vinci, développé par Safran. Ariane 6 est un lanceur de nouvelle génération, doté du même moteur rallumable pour son étage supérieur, mais plus modulable (2 à 8 tonnes) et surtout susceptible de procéder à des lancements simples, c'est-à-dire mono-satellites. Le lancement double est en effet devenu très problématique pour Arianespace, car il implique l'appairage des satellites, susceptible de faire perdre du temps et donc de l'argent aux opérateurs.
Le rapport fait état de tous les arguments avancés au cours de nos auditions, en faveur de l'un ou l'autre de ces deux projets. Il nous a semblé qu'Ariane 6 apportait une réponse plus tardive qu'Ariane 5 ME, mais plus durable, aux évolutions en cours.
Procédant à des lancements « simples », Ariane 6 doit permettre d'accroître la cadence de production, afin de ne pas passer sous le seuil des cinq lanceurs par an, en deçà duquel il est unanimement reconnu que la fiabilité et la viabilité financière d'Ariane seraient remises en cause.
Dans sa version dite PPH, privilégiant la poudre, le lanceur de nouvelle génération serait complémentaire de Vega, puisqu'il réutiliserait son étage dit P80, en augmentant sa puissance. La poudre est une technologie en soi fiable et peu coûteuse, et cette configuration permettrait de produire en série un grand nombre de moteurs, donc de bénéficier d'effets de standardisation.
D'un coût de production moindre, ce lanceur est sans doute plus susceptible qu'Ariane 5 ME de réduire la subvention publique actuellement versée pour l'exploitation d'Ariane 5 (120 millions d'euros/an).
C'est pourquoi nous avons préconisé de développer aussi rapidement que possible ce lanceur de nouvelle génération modulable, à étage supérieur réallumable, en mettant la priorité sur la réduction des coûts afin de le rendre compétitif sur le marché.
Nous reviendrons sur les décisions prises par la réunion des ministres à ce sujet, après avoir évoqué les autres conclusions de notre rapport.

Nous avons souhaité mettre l'accent sur un enjeu trop méconnu : la durabilité des activités spatiales, aujourd'hui menacée par la multiplication des débris.
Le nombre d'objets de plus de 10 centimètres en orbite autour de la Terre est estimé à 20 000. Ce nombre s'accroît naturellement en conséquence de réactions en chaîne, ce que les scientifiques désignent sous le nom de syndrome de Kessler.
Le risque de collision n'est pas que théorique. La première collision répertoriée a eu lieu en 1996. Elle a affecté un satellite militaire français. En 2007, les Chinois ont détruit à l'aide d'un missile l'un de leurs satellites météorologiques, ce qui a engendré environ 2 500 débris de taille supérieur à 10 centimètres. Enfin, en 2009, la collision entre un satellite Iridium et un satellite inactif Kosmos a généré lui aussi de l'ordre de 2 000 gros débris.
La Station spatiale internationale (ISS) procède par exemple environ une fois par an à des réajustements de sa trajectoire pour éviter des collisions.
Par ailleurs, il existe aussi un risque de dommages au sol lors des rentrées atmosphériques. On estime à une tonne les retombées quotidiennes des débris, qui s'évaporent ou non dans l'atmosphère. Le risque est minoré du fait que 70 % de la surface de la Terre est océanique. Mais le risque de dommage voire de victimes au sol n'est pas négligeable.
Nous avons identifié trois types d'actions pour faire face aux risques que constituent les débris spatiaux :
- en premier lieu, il s'agit de promouvoir des règles de conduite renforcées. Il existe des règles au niveau international et en France, depuis la loi de 2008 relative aux opérations spatiales. Il existe également une proposition de code de conduite, émise par l'Union européenne, actuellement en cours de négociation sur le plan international. Des désaccords subsistent entre pays sur la forme - contraignante ou non - que devrait revêtir ce code de conduite. Il serait dommage d'attendre qu'un accident majeur se produise pour accélérer les négociations.
Pour l'Europe, l'arrivée d'un lanceur à étage supérieur réallumable sera une avancée, car cela permettra de désorbiter l'étage supérieur après réalisation de la mission. Ariane 5 est actuellement le seul lanceur commercial qui ne le permet pas ;
- en deuxième lieu, il est indispensable de mettre en place un système européen complet de surveillance de l'espace, fédérant et complétant les moyens existants. L'Europe dépend actuellement des États-Unis, qui possèdent le réseau de surveillance le plus vaste et le mieux distribué au monde. La coopération avec ce pays permet d'éviter un certain nombre de collisions - en déplaçant le véhicule concerné par une alerte, du moins lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsque ce véhicule est encore actif. Mais cette coopération ne garantit pas l'indépendance de l'Europe.
Pour garantir cette indépendance, il faut traiter les obsolescences prévisibles du radar français GRAVES et mettre en place des capteurs supplémentaires, afin d'améliorer l'identification de la nature des objectifs et de leur trajectoire.
L'ESA a lancé un programme de surveillance dit SSA (Space situational awareness), mais qui n'est pas pour le moment réellement opérationnel.
Par ailleurs, la surveillance de l'espace a une composante relative à l'espace lointain (objectifs géocroiseurs, « météorologie spatiale ») ;
- en troisième lieu, il faut développer des solutions technologiques innovantes pour le nettoyage des débris. D'après les modèles existants, il suffirait de retirer chaque année de l'ordre de 5 à 10 gros débris pour stabiliser le nombre de débris en orbite basse.
Nous nous sommes également intéressés à « l'espace pour la Terre » : la politique spatiale doit en effet être tournée en priorité vers les services aux citoyens et privilégier les retombées concrètes. Notre rapport évoque en particulier l'observation, en vue de la compréhension des mécanismes du fonctionnement terrestre, qui est aujourd'hui devenue un enjeu scientifique et économique majeur.
L'Europe doit se donner pour priorité de demeurer précurseur dans ce domaine, dans le prolongement de missions déjà réalisées par le CNES et par l'ESA, parfois en coopération avec d'autres pays.
L'Europe dispose d'une compétence reconnue dans ce que l'ESA nomme les « explorateurs de la Terre », c'est-à-dire les satellites d'observation dédiés à l'étude de domaines précis tels que l'océanographie, l'étude des sols, de l'eau, de la glace, de l'atmosphère ou encore du champ magnétique.
L'observation spatiale présente l'avantage d'offrir une vision globale et continue dans le temps, qui permet des progrès considérables de la recherche sur l'environnement et le climat. Elle sera un instrument essentiel à l'évaluation du changement global et de l'impact des activités humaines sur le fonctionnement du système terrestre. Pour l'avenir, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre deviendra notamment un enjeu international majeur, et les moyens de mesure seront un atout important pour ceux qui les maîtriseront.
Mais pour que l'observation spatiale soit efficace, encore faut-il qu'elle soit continue et produise des données homogènes. Or le mode de fonctionnement des agences, dont la vocation est d'innover, et non d'assurer la continuité de l'existant, n'est pas forcément propice à la poursuite de missions non pas en vue d'innover mais de prolonger en optimisant les coûts. Il faudrait, pour cette raison, garantir la continuité des missions dès leur conception.
Afin que l'Europe demeure une référence dans le domaine de l'observation de la Terre, et devienne incontournable dans l'évaluation du changement global, nous préconisons tout d'abord de poursuivre activement la mise en place des infrastructures du programme GMES de surveillance globale pour l'environnement et la sécurité.
Nous suggérons aussi de mettre en place le financement (dans le cadre financier pluriannuel de l'UE) et le pilotage nécessaire à l'entrée en phase opérationnelle des services de ce programme. Lors de notre déplacement à Bruxelles, nos interlocuteurs de la Commission nous ont en effet confié être « très en amont » de la réflexion à ce sujet...
Enfin, il nous semble nécessaire de réfléchir, plus largement, aux moyens à mettre en oeuvre pour que l'Europe soit indépendante pour procéder à la mesure des effets et des causes du changement climatique.
Notre rapport examine enfin la question de l'exploration spatiale.
Il nous paraît nécessaire de continuer à participer à la Station spatiale internationale jusqu'en 2020.
L'Europe doit apporter une contribution sur le plan technologique, comme elle le fait actuellement en fournissant le véhicule de ravitaillement de la Station, l'ATV. Cette contribution pourrait d'ailleurs participer plus tard au démantèlement de l'ISS, c'est-à-dire sa désorbitation. Ce démantèlement doit d'ores et déjà être envisagé. Ses modalités ne sont pas encore fixées. Son coût est évalué à 2 milliards de dollars - ce qui représente moins de 2 %, à vrai dire, du coût exorbitant de cette Station.
Pour l'avenir, l'Europe doit par ailleurs privilégier les missions robotiques remplissant des objectifs d'innovation scientifique, à coûts maîtrisés et autant que possible dans le cadre de coopérations internationales. C'est le cas par exemple du projet ExoMars : lancé dans un premier temps par l'ESA en partenariat avec la NASA, il est aujourd'hui envisagé avec l'agence russe Roskosmos, suite à la défection de la NASA.
Si l'exploration de Mars est prioritaire, c'est parce qu'on estime que cette planète a pu abriter la vie, et qu'une meilleure connaissance de son histoire pourrait être utile à la compréhension de l'évolution de notre propre planète.
Quant à l'exploration habitée de Mars, elle nécessiterait des ruptures technologiques et la fixation d'objectifs intermédiaires. Elle requerrait, surtout, un investissement massif puisque son coût est estimé à 600 voire 800 milliards d'euros. A contrario, le coût de la mission ExoMars est estimé à 1,2 milliard d'euros ; celui d'une mission de retour d'échantillons martiens, entre 3 et 5,3 milliards d'euros.
Par le passé, l'exploration habitée a toujours répondu à des objectifs d'abord politiques, plutôt que scientifiques. Si des objectifs politiques devaient réapparaître, à l'avenir, ce pourrait être pour répondre aux ambitions de la Chine. Dans l'immédiat, nos auditions nous conduisent toutefois à penser que ce pays s'intéresse à l'espace d'abord pour ses retombées socio-économiques.
Les conditions ne nous paraissant pas réunies pour le moment, et les montants financiers en jeu étant exorbitants, nous n'avons pas souhaité formuler de préconisations sur la question du vol habité, au-delà de l'orbite basse.
Nous vous renvoyons au rapport pour ce qui est d'autres questions - par exemple l'espace de défense, qui nous paraît exiger une relance de la coopération entre pays européens.
Pour terminer, quelques mots sur la récente réunion ministérielle des pays de l'ESA à Naples.
Cette réunion a acté plus de 10 milliards d'euros de souscriptions. L'Allemagne est le premier contributeur (pour la deuxième fois de l'histoire de l'ESA), avec 2,5 milliards d'euros et la France deuxième avec 2,2 milliards d'euros. Au troisième rang, le Royaume-Uni a devancé l'Italie, grâce à une progression très nette de sa souscription, notamment dans les programmes de télécommunications. Cette évolution aura des conséquences sur notre industrie puisqu'elle permettra probablement une montée en puissance de la branche britannique d'Astrium, au détriment du franco-italien Thalès Alenia Space pour qui la fragilisation de la contribution italienne constitue un handicap.
Concernant les lanceurs, la Ministérielle a ouvert la voie au développement des deux lanceurs Ariane 5 ME et Ariane 6, étant entendu qu'Ariane 5 ME devra être « adaptée », en synergie avec le lanceur de nouvelle génération.
L'idée est de développer un étage supérieur commun aux deux lanceurs. Le moteur de cet étage supérieur est déjà commun puisqu'il s'agit de Vinci, moteur développé par Safran depuis 2008. Au cours des prochains mois, les autres caractéristiques de cet étage supérieur commun doivent être définies.
Par ailleurs, l'option retenue pour Ariane 6 est celle préconisée par notre rapport, c'est-à-dire l'option « PPH » (comportant des étages à poudre et un étage supérieur à propulsion liquide hydrogène/oxygène). Les étages à poudre seront dérivés de l'étage P80 de Vega et bénéficieront de gains découlant de leur production à la chaîne (3 à 4 étages à poudre par lanceur).
La France, qui est le principal contributeur à ce nouveau lanceur, se donne trois objectifs, déclinés sous la forme d'un « triple 7 » : 7 ans de développement (2014-2021), 7 tonnes de performance en orbite de transfert géostationnaire et un coût de 70 millions d'euros par lanceur.
Pour parvenir à ce coût de 70 millions d'euros, un défi majeur reste à relever : celui de la réorganisation de la production industrielle du lanceur, actuellement trop éparpillée.
La décision définitive de développement d'Ariane 6 doit être prise lors d'une nouvelle Ministérielle en 2014.
Il nous semble que la représentation nationale devrait d'ici là rester vigilante quant aux conditions dans lesquelles seront développés parallèlement deux lanceurs, fussent-ils complémentaires, car de nombreux paramètres industriels et financiers restent à préciser.
Enfin, le plus gros programme souscrit lors de cette Ministérielle concerne la Station spatiale internationale. La France s'est engagée à financer 20 % de la contribution européenne de la Station. Après 2017, cette contribution européenne consistera à produire un module de service pour la capsule habitée Orion de la NASA, destinée à voler au-delà de l'orbite basse, mais sans objectif clairement fixé à ce jour. Là encore, il faudra rester attentif au réexamen de cette décision, prévu aussi en 2014.
Pour le reste, les décisions prises par la Ministérielle sont en ligne avec les préconisations de notre rapport : soutien à la compétitivité industrielle, notamment dans le secteur des télécommunications (avec le programme de plateforme de nouvelle génération NeoSat), poursuite des programmes de météorologie et d'observation de la terre, et réorganisation en cours des liens avec l'Union européenne.
Il nous semble toutefois que l'effort fait dans le domaine de la surveillance de l'espace demeure insuffisant, les pays membres de l'ESA ayant quelque peu laissé de côté le programme qu'ils avaient engagé en 2008, dit SSA.
Reste enfin la question du financement du programme GMES qui n'est pour le moment pas assuré. Cette question doit être traitée par les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, auxquelles il conviendra de rester attentif.
Voilà un bilan de cette Ministérielle à la lumière de notre rapport. Un tournant a été accompli, avec la décision de démarrer Ariane 6, mais de nombreux motifs de vigilance demeurent.

Vous n'avez pas évoqué le problème de l'apurement de la dette de la France à l'égard de l'ESA.

Elle est en cours de remboursement. Je rappelle que cette dette provient de l'échec d'un vol Ariane 5, mais que le programme Ariane 5 ECA est à présent une remarquable réussite.

La concurrence s'accroît et le budget européen est faible : parviendrons-nous à maintenir notre rang ? La durabilité des activités spatiales est menacée : quelles sont les techniques permettant de retirer les débris ? Pouvez-vous également expliciter vos propos sur le prix des fréquences ? Enfin, quels pays participent-ils à l'élaboration d'un code de conduite, ou au contraire le bloquent ?

Je partage l'inquiétude relative au risque de perte du rôle de leader de la France face à l'Allemagne. Compte tenu de l'accroissement de la concurrence, ne faudrait-il pas privilégier les lanceurs de petite dimension ? Quel est par ailleurs l'avenir de Kourou ? Face à l'évolution des usages de l'espace, la Station spatiale internationale a-t-elle toujours une justification ? Et le module de ravitaillement ATV fonctionne-t-il vraiment ?

Je partage votre appel à une consolidation du programme GMES. Faut-il rester généraliste ou se repositionner sur certains secteurs, notamment ceux qui sont liés à des ruptures technologiques ?

Face à la défiance de l'opinion publique par rapport à la construction européenne, l'Europe devrait mieux communiquer sur les programmes qui fonctionnent, tels que l'activité spatiale, et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne. L'état des finances ne devrait-il pas pousser, plutôt qu'à une concurrence systématique, à rechercher les complémentarités au niveau mondial, tout en prenant en compte les impératifs stratégiques ?

Le Parlement devrait permettre à la population de mieux comprendre les enjeux de la politique spatiale, car je ne suis pas sûr que la majorité de nos compatriotes perçoivent l'intérêt de cette activité. Si l'impératif financier ne nous permet plus de mener tous les fronts à la fois, nous devrions mettre l'accent sur les domaines où nous conservons une avance technologique. S'agissant enfin du différentiel entre les États-Unis et l'Europe, je rappelle que les États-Unis ont été autrefois poussés par leur opposition avec la Russie.

S'agissant de la problématique des vols habités, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils coûtent cent fois plus cher que des vols robotisés ; l'Europe, vu sa situation financière, ne devrait donc plus y recourir à l'avenir.

Les citoyens ont une vision de l'espace focalisée sur les vols habités ; or, il recouvre une dimension plus large et conditionne entièrement notre quotidien par ses nombreuses applications. C'est pourquoi nous insistons, dans notre rapport, sur la nécessité d'avoir un ministère dédié à cette problématique et de communiquer davantage vers le grand public.

Le programme américain Apollo avait était extraordinairement aventureux, un taux d'échec de 50 % ayant été accepté, ce qui aujourd'hui ne serait plus toléré ! Le budget des États-Unis consacré à l'espace est de 48 milliards d'euros, si l'on s'en rapporte du moins aux chiffres officiels. Nous n'avons pas les moyens de rivaliser et devrions en effet concentrer nos efforts sur certains programmes. Les américains estiment par exemple que nous ne sommes pas suffisamment compétents en matière de calcul.

Même si les supercalculateurs ont fait d'énormes progrès depuis quatre ou cinq ans !

Les américains méprisent l'Europe spatiale, alors qu'elle représente une puissance équivalente, avec bien moins de moyens.

Toutes les activités des États-Unis dans le domaine de l'espace sont duales. Les américains n'ont pas besoin, toutefois, d'avoir une activité commerciale pour continuer à faire vivre le secteur.
Il faut absolument que l'Europe possède un lanceur, synonyme d'indépendance dans l'accès à l'espace. Les Allemands n'ont pas forcément toujours eu le même avis, étant plus naturellement prêts à importer que nous. Ils tiennent au développement d'Ariane 5 ME, qui est fabriqué à Brème. L'Allemagne souhaite monter en puissance dans le secteur de l'espace et retrouver le rang qui était le sien.

Les États-Unis, qui ne possèdent plus de lanceurs, sont désormais très dépendants de l'extérieur. La Russie leur permet aujourd'hui d'accéder à l'ISS, mais l'avenir géopolitique est toujours incertain. Aussi nous estimons indispensable de conserver notre autonomie en la matière.

Les Allemands veulent continuer le programme Ariane 5 ME, plutôt que d'aller vers une Ariane 6. Mais cela implique de réaliser systématiquement des lancements doubles, obligeant les opérateurs de satellite à s'appareiller deux par deux.
La concurrence mondiale sur les lanceurs, notamment en provenance de pays émergents, va s'accroître. Le Brésil dispose, par exemple, d'une base de lancement, même si le dernier tir a été un échec.
Ariane 5 ME est comparable à l'actuelle version d'Ariane ECA : elle nécessite le lancement simultané de deux satellites, et donne donc lieu à deux fois moins de lancements. Or, il serait préférable de ne lancer qu'un satellite à la fois, au gré de la demande.

L'Europe est la seule à pratiquer les lancements doubles. Nous nous sommes interrogés sur le renforcement de la concurrence internationale sur ce secteur, et la tendance des satellites à devenir de plus en plus importants. Ariane 5, de même que la version ME, obligent à appareiller, en plus d'un satellite de grande taille, un plus petit, afin d'optimiser la charge, ce qui est compliqué. Aussi Ariane 6 correspond-elle davantage aux attentes du marché, en permettant des lancements simples et sans délai.

Ariane 5 risque de perdre des clients. En-dessous de cinq lancements par an, son modèle économique n'est plus assuré. Les Allemands résistent toutefois à nos propositions d'évolution vers Ariane 6, même s'ils ont compris l'importance d'être indépendants en matière de lanceurs. L'objectif de cette version est d'être la plus simple possible, ce qui explique la préférence donnée à la poudre comme combustible.

Destiné à ravitailler l'ISS, l'ATV, est une réussite, à laquelle ni les Américains ni les Russes ne croyaient.
Il pourrait être muni de bras et servir à ramener des débris, pour les détruire ou les re-larguer dans l'atmosphère, où ils se consumeraient. Personne, cependant, ne veut en assurer le financement pour cet usage. La commercialisation des orbites, aujourd'hui gratuites, serait une solution.

La coopération internationale est indispensable pour la gestion de ces débris. L'Europe est en retard : elle ne possède qu'un vieux radar, qui ne peut que repérer les déchets de plus d'un mètre de long. Or, ces derniers sont létaux dès 10 cm, et même moins. La difficulté provient du regroupement de l'ensemble des satellites sur périmètre restreint. Seuls les États-Unis sont capables de localiser précisément les débris et de nous prévenir de leur proximité, afin d'ajuster la trajectoire des satellites en conséquence. Leur motorisation électrique devrait permettre de les mouvoir plus facilement. L'idéal serait toutefois d'être plus indépendant dans le repérage des débris.
En matière de communication sur l'espace, il reste beaucoup à faire. Sans les satellites, on ne peut plus vivre au quotidien ! Il faudrait avoir un ministère dédié, ou au moins comportant l'espace dans son intitulé.

Pourquoi ne pas instaurer une journée des satellites ? Il est regrettable que l'on n'en parle pas davantage ...

Pourquoi l'Europe devrait-elle financer le ramassage des débris ? Il s'agit d'un problème mondial !

Malheureusement, seule une collision convaincra l'opinion internationale de la nécessité d'agir.

A 400 km d'altitude, les déchets spatiaux retombent naturellement sur terre dans l'année. A 800 km, dans le siècle. Au-delà, ils sont confinés quasiment pour l'éternité. C'est un problème qui devrait être traité dans un cadre onusien.

Merci, mes chers collègues, d'avoir su capter notre attention sur un sujet aussi complexe.
La commission a décidé de reporter la désignation des membres du groupe de travail sur la réforme du code minier.