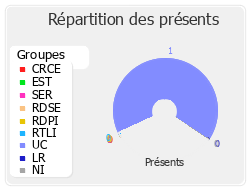Mission commune d'information sur la commande publique
Réunion du 16 juillet 2015 à 9h20
Sommaire
- Audition de m. thierry francq commissaire général adjoint à l'investissement (voir le dossier)
- Audition de m. nicolas jachiet président de syntec-ingénierie (voir le dossier)
- Audition de m. renaud marquié délégué général du syndicat national du second oeuvre (voir le dossier)
- Audition de m. hubert du mesnil président de l'institut de la gestion déléguée (voir le dossier)
La réunion

Notre mission commune d'information s'intéresse à la commande publique. Nous ne sommes pas une commission d'enquête, nous cherchons principalement à simplifier et rendre moins onéreuse la commande publique en France.
La transposition des directives européennes de 2014 est-elle bien faite ? N'y a-t-il pas, comme parfois, surtransposition ? Notre approche n'est pas essentiellement juridique : loin de nous l'idée de réécrire le code des marchés publics, ni les ordonnances de transposition, dont la première, sur les marchés publics, sera prise dans quelques jours et la deuxième, sur les concessions, à la fin de l'année.
Comment favoriser l'accès des PME à la commande publique ? Comment rendre celle-ci plus efficace, c'est-à-dire moins coûteuse pour la maison France, et génératrice de croissance ? Avez-vous repéré des goulets d'étranglement dans l'accès des PME à la commande publique ? Celle-ci rechigne-t-elle à faire appel aux start-up ? Nous vous recevons sans aucun a priori, dans un état d'esprit d'autant plus ouvert que nous ne sommes pas dans le cadre d'un travail législatif. C'est d'abord l'aspect économique qui nous intéresse. Nous souhaitons aussi un décloisonnement de la commande publique. Un marché public ne pourrait-il pas, à terme, être passé à la fois pour l'État, des hôpitaux, des collectivités territoriales, en réponse à un même besoin ?

Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Quels décaissements annuels effectifs des administrations publiques, considérées dans leur ensemble, les investissements d'avenir occasionnent-ils ? Sur ce montant, combien correspond à de la commande publique et non, par exemple, à des subventions ? Les investissements d'avenir financent-ils certains aspects de la réforme en cours des marchés publics, comme le dispositif de marchés publics simplifiés, notamment via le fonds consacré à la transition numérique de l'État et à la modernisation de l'action publique ?
Le Commissariat général à l'investissement (CGI) rend des avis sur les projets d'investissement de l'État et de ses établissements publics de plus de 100 millions d'euros. Ces avis sont-ils suivis en règle générale ? Faut-il lui donner davantage de moyens financiers ? Comment améliorer l'évaluation socio-économique des projets d'investissement ?
Dans son rapport annexé au projet de loi de finances pour 2015, le CGI évoque la mise en place d'une future « commission d'experts relative aux méthodes d'évaluation socioéconomique des investissements publics ». De quoi s'agit-il ? Où en est-on ?
L'État a comme objectif de réduire le prix de ses marchés publics de 2 % par an. Si l'ensemble des acheteurs publics faisaient la même chose, ne risquerait-on pas, au bout de quelques années, de réduire les marges des entreprises d'un montant analogue à celui du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), qui avait été mis en place, notamment, pour augmenter ces marges ?
Enfin, le droit de la commande publique vous semble-t-il adapté aux enjeux macroéconomiques actuels ?

Au vu de votre parcours professionnel, je pense que l'univers des statistiques ne vous est pas inconnu. Cela vous aidera à répondre !

L'allotissement, que le gouvernement prévoit de généraliser, peut-il causer des difficultés aux opérateurs de réseaux ?
Le CGI, avec une petite équipe de 37 personnes, remplit trois missions, dont les deux premières lui sont fixées par le décret qui l'a institué.
Il pilote le programme d'investissements d'avenir (PIA) et il réalise l'inventaire et la contre-expertise des investissements de l'État ou de ses établissements publics. À la demande du Premier Ministre, il coordonne aussi les efforts de la France pour bénéficier du plan Junker.
Bien sûr, 37 personnes pour gérer 47 milliards d'euros, c'est peu ! Aussi nous nous appuyons sur les opérateurs de l'État que sont BPI France, l'Agence nationale de la recherche (ANR), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera).
Au 31 mars 2015, nous avions décaissé 10,9 milliards d'euros, issus du PIA 1, de 35 milliards d'euros, ou du PIA 2, ajouté en 2013, de 12 milliards d'euros. La part maastrichtienne de ces décaissements s'élève à 8 milliards d'euros, dont 4 ont été décaissés en 2014 : nous arrivons au pic, et l'essentiel des sommes auront été engagées avant la fin du premier semestre 2017. Aussi le Commissaire général à l'investissement a-t-il formulé l'idée d'un troisième PIA. Ces décaissements financent-ils de l'investissement au sens de la comptabilité nationale ? C'est un chiffre que nous ne suivons pas : nous nous inscrivons dans l'univers budgétaire. Tous les prêts ou les prises de participation financent, en principe, de l'investissement - même si, dans une start-up, le capital utilisé pour du développement ne correspond pas à de la formation brute de capital fixe (FBCF). À l'inverse, les subventions peuvent parfaitement financer de la FCBF comme, par exemple, lorsque nous investissons dans le logement des apprentis.
La commande publique effectuée par nos opérateurs pour notre compte se limite en fait à de l'expertise et à de l'évaluation. Pour l'essentiel, nos sous-traitants sont des opérateurs publics, que nous ne mettons pas en concurrence puisqu'ils sont désignés par la loi. La plupart des opérations ne donnent pas lieu à de la commande publique directe, je songe par exemple à la recherche appliquée associant laboratoires publics et PME. On a sans doute également voulu privilégier les projets dégageant des synergies entre les ministères. Dans le domaine de l'énergie, c'est l'État qui structure la demande, via la Commission de régulation de l'énergie (CRE). La question de la commande publique se pose plus directement en matière d'urbanisme ou pour le programme de transition numérique de l'État.
Le PIA cherche à favoriser l'émergence d'une offre innovante. Aussi travaillons-nous davantage avec les offreurs qu'avec les demandeurs - même si, dans le domaine de l'urbanisme, les deux sont inextricablement liés. Un des aspects essentiels concernant la commande publique, à nos yeux, est donc la manière dont nous pouvons mieux intégrer l'innovation dans la commande grâce au partenariat d'innovation. Cela aurait un intérêt dans la santé, dans le traitement des eaux usées, etc. Mais le partenariat d'innovation pose des difficultés et, sans jurisprudence établie, les acteurs publics se tiennent sur leurs gardes. J'ai fait observer au ministre des finances qu'il importait de les familiariser avec ce dispositif. Cependant toutes les collectivités territoriales n'ont pas la capacité de le maîtriser. Nos travaux sur le plan Junker le montrent bien : le rôle de chef de file doit être assumé par la région, qui est la mieux placée pour mutualiser les expertises. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments publics comporte des aspects techniques et un enjeu de partage des gains : la région Rhône-Alpes a créé une société publique locale qui fournit aux communes une expertise technique, ce qui est essentiel pour que l'acheteur public ne soit pas paralysé par le risque juridique. Le partenariat d'innovation est mieux adapté aux cas où la collectivité territoriale investit elle-même dans l'innovation qu'à ceux où elle souhaite faire l'acquisition d'un produit ou d'un service innovant. Car alors, une entreprise le développe et le teste, mais s'il fonctionne, elle est ensuite mise en concurrence dans un appel d'offre !
Nous réalisons l'inventaire et la contre-expertise des projets d'investissement de l'État et de ses établissements publics - uniquement de ceux où la part publique dépasse 20 millions d'euros. Cet inventaire est incomplet car les investissements sont parfois mal répertoriés dans les ministères. Puis, où commence un projet ?

Connaissez-vous l'impact de ces projets d'investissement sur l'emploi local ?
Pas au début du projet. Nous diligentons des contre-expertises de l'évaluation socio-économique des investissements de l'État et de ses établissements publics, qui est obligatoire, lorsque leur part publique dépasse 100 millions d'euros. Cette contre-expertise est effectuée juste avant le lancement de l'opération - donc avant le point de non-retour. L'évaluation socio-économique prend bien sûr en compte l'impact sur l'emploi. Elle analyse tous les aspects positifs et négatifs du projet et en présente une synthèse, en incluant les incertitudes.

Quelle est votre méthode pour évaluer un projet ? Faites-vous, comme le juge administratif, la liste des avantages et des inconvénients ? Procédez-vous de manière plus scientifique ? Votre intervention vient-elle en amont ou en aval de des enquêtes publiques imposées, notamment, par le code de l'environnement? Quel est l'impact économique de nos investissements d'infrastructure ? Enfant du Tarn, je pense en particulier au projet de ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse. Nous tâchons également de convaincre l'État, qui s'y dit favorable, de lancer une concession autoroutière entre Castres et Toulouse...
Si un projet nécessite une enquête publique, le dossier doit comporter un rapport de contre-expertise. Nous diligentons ces contre-expertises mais ne décidons pas des méthodes d'évaluation, fixées par chaque ministère avec l'aide de France Stratégie. Dans les transports, la méthode est bien normée : il s'agit de la méthode dite « Quinet », du nom de l'ingénieur général des ponts et chaussées qui fait autorité en la matière. Dans d'autres domaines, comme pour les hôpitaux, il n'y a pas de méthode fixe. Un de nos objectifs est donc d'inciter à l'établissement d'une méthodologie.
Oui, sauf dans les transports. Il faudrait professionnaliser complètement la fonction d'investissement au sein de l'État, dans tous ses aspects.
Nous n'évaluons pas la qualité de la démarche suivie lors d'une commande publique mais pouvons examiner la pertinence de sa structuration financière.

Quelles sont vos préconisations en matière de commande publique ? Comment renforcer nos PME et nos start-up ? Quelles sont vos recommandations ?
Le partenariat d'innovation est souvent l'occasion d'associer des PME et des start-up à un projet. Il y a un effort de pédagogie à faire auprès des acheteurs publics ; et un enjeu de structuration au niveau des collectivités, car l'expertise ne peut être déléguée à tous les échelons locaux mais doit être mutualisée.

Nous faisons en quelque sorte le même métier : lorsque vous préconisez de professionnaliser la fonction d'investissement, nous recommandons de professionnaliser la commande publique. Pour déclencher un choc culturel qui améliore l'investissement en France, quelles seraient les priorités ?
La sécurisation des acheteurs publics est essentielle, principalement pour les procédures les plus complexes, et surtout aux échelons locaux les plus modestes.

Pensez-vous qu'en France, on s'est trop préoccupé des règles au détriment du fonctionnement de l'économie ? Ne devrait-on pas changer l'ordre des priorités ?
Tout est question de maturité. Le partenariat d'innovation ne représente jamais que quelques millièmes de la commande publique. L'assouplir est donc raisonnable. Et l'évolution européenne y incite.

Vous avez affaire à des appels d'offres européens. Quelle est leur valeur ajoutée territoriale ?
Je n'ai pas assez d'informations pour vous répondre. Il y a des modes dans la commande publique : actuellement, dans le domaine numérique, on cherche de plus en plus à faire des accords-cadres - pour ensuite en tirer des marchés subséquents. Mais qui ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Lorsque l'administration veut développer un nouveau site internet et lance un appel d'offres pour un accord-cadre, ce sont immanquablement de grandes entreprises qui répondent, avec un coût parfois cinq fois plus élevé que ce qu'aurait facturé une start-up. Il importe de renouveler constamment notre façon de penser car l'économie évolue très rapidement.

Pour vous, la fonction d'acheteur public est donc une fonction senior ?
L'achat public doit répondre à une procédure gagnant-gagnant pour l'économie et l'acheteur public. Nous avons le potentiel pour donner de l'activité aux PME, il nous manque une analyse économique de l'intérêt bien compris du côté de l'acheteur public.
Nous donnons beaucoup d'avis. Ils sont régulièrement suivis dans le cadre du PIA. Dans le cadre de notre mission de contre-expertise des projets d'investissement de l'État et de ses établissements publics, ce sont généralement des avis favorables assortis de réserves et de recommandations. Lorsqu'ils sont défavorables, ils sont rendus suffisamment en amont pour qu'il soit envisageable de remanier les projets. Je pense notamment à l'hôpital Nord Deux-Sèvres : notre avis était très négatif. Nos recommandations sont habituellement suivies d'effets. Nos contre-expertises concernent souvent des hôpitaux et viennent en appui des positions du ministère de la santé, qui a instauré un dispositif assez structuré avec les agences régionales de santé (ARS).
Nous évaluons surtout l'impact d'un projet sur la localisation des ménages et de l'emploi et sur les gains de productivité. Ainsi nous regardons par exemple si les emplois se diffusent ou se rapprochent des infrastructures construites pour le Grand Paris.

Êtes-vous favorable à cette concentration des emplois autour des infrastructures, ne craignez-vous pas une désertification ailleurs ?
La concentration a des effets positifs, avec certaines limites : il ne faut pas tout concentrer dans le centre de Paris ! Ici, nous sommes dans le cadre du Grand Paris, avec de nouveaux centres urbains. La concentration n'est pas la règle absolue !

Notre mission commune d'information adopte une vision très pragmatique.
Comment faire plus simple, mieux, plus rapide et moins cher en matière de commande publique ? Quels sont les éventuels pièges de la transposition des directives européennes ? Nous ne souhaitons pas réécrire la loi ni rédiger des amendements en masse sur le futur projet de loi de ratification. Mais aurait-on oublié un point qui serait utile au fonctionnement de notre économie et des PME en particulier ? On assimile souvent les marchés publics au BTP, mais leur part est surtout importante au niveau des collectivités territoriales...

Comment améliorer l'efficience de l'achat public pour les produits et services sur mesure, et quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques en la matière ? Quel jugement portez-vous sur les nombreuses innovations des directives 2014, susceptibles de modifier les conditions de l'achat public dans le domaine du « sur mesure », comme la procédure concurrentielle avec négociation ou les partenariats d'innovation ? Faut-il aller plus loin ? Comment faciliter l'accès des PME à la commande publique ?
Nous sommes heureux de nous exprimer devant vous sur ce sujet fondamental pour notre profession.
Les sociétés d'ingénierie réalisent des études de conception d'ouvrages, d'aménagements, d'équipements et supervisent leur réalisation. Traditionnellement elles assurent la maîtrise d'oeuvre, mais leur rôle se diversifie, avec de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou du conseil en maîtrise d'oeuvre. Elles interviennent en contrat de conception-réalisation, en partenariat public-privé (PPP) ou dans d'autres cadres. Selon l'Insee, le secteur réalise un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros et compte 350 000 salariés. Notre syndicat a 250 adhérents - pour moitié des entreprises de moins de 250 salariés - réalisant un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros et rassemblant 100 000 salariés. Toutes ne travaillent pas pour le secteur public, mais aussi pour l'industrie privée. Elles réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en répondant à des commandes publiques. Nous conseillons aussi les acheteurs publics sur la façon de conduire leurs marchés.
De plus en plus d'entreprises - grands groupes mais aussi PME - gagnent des marchés à l'international grâce à leurs références sur le marché national. Si celui-ci s'essouffle, le développement international peut être compromis. Le niveau de la commande publique est notre principal problème, plutôt que le droit des achats publics.

Je ne suis pas certain que notre mission puisse vous aider sur ce point !
La commande publique a diminué de 6% l'année dernière et les chiffres sont du même ordre pour cette année. Aux difficultés budgétaires s'ajoutent les cycles électoraux, ou la réforme ferroviaire qui a pour conséquence de limiter le recours à de l'ingénierie externe. Cette réduction atteint même 20 à 30% dans les secteurs de l'eau ou de l'aménagement urbain, avec une forte pression sur les prix des entreprises voulant conserver leur activité ou leurs emplois. C'est souvent le moins-disant qui l'emporte. Les projets d'ordonnances réaffirment clairement la règle du mieux-disant pour les acheteurs soumis aux règles européennes, c'est une bonne chose. D'autant que les critères d'attribution peuvent désormais englober tout le cycle de vie de l'ouvrage, et l'ensemble des coûts dans la durée. Autre point positif dans les ordonnances, l'évaluation des choix de procédure. Des règles plus solides sont également fixées concernant le recours au contrat de partenariat.
Néanmoins nous percevons une volonté de généraliser les contrats globaux, ce qui nous inquiète. Ils ne sont pas synonymes de simplification. Les PPP non plus. Ils supposent que le projet soit finalisé, intangible, lors de sa signature, afin d'éviter les risques de contentieux. Cette rigidité suppose de fixer des propositions de prix tenant compte de tous les risques et des facteurs susceptibles de renchérir le coût par des changements en cours de route, aussi légitimes soient-ils. C'est dans certains cas un facteur de renchérissement. Il donne une position de force aux grandes entreprises du BTP. La généralisation des contrats globaux n'est pas une bonne idée.
L'allotissement favorisera la place des PME dans les marchés publics : tant mieux !

Allons plus loin : de grandes entreprises - y compris nationales - considèrent que l'allotissement est cher et non souhaitable...
Certains accords-cadres sont trop allotis, avec des lots trop petits. Vérité d'un côté...
Ne soyons pas dogmatiques, nous parlons de travaux. L'allotissement doit répondre à une logique physique ou économique, pour un ouvrage simple qui peut facilement être divisé en lots, mais doit être évité lorsqu'il faut conserver une cohérence d'ensemble.

En tant que membre d'une commission d'appel d'offres et ancien président de conseil général, je connais ce sujet. Le mécanisme des avenants nuit depuis longtemps à la mise en oeuvre des opérations. Les contrats globaux en comportent d'innombrables, qui se traduisent par autant de dépassements. Avec l'allotissement, on colle mieux à l'objectif. Qu'en pensez-vous, vous qui pilotez l'ingénierie et évitez des erreurs à vos clients ?
Les avenants sont justifiés pour faire face à une évolution du projet, non pour compenser un prix initialement trop bas. En théorie, les contrats globaux ne comportent pas d'avenants car tout doit être prévu en amont pour éviter les risques de contentieux, avec un projet intangible à la signature - ce qui n'est pas toujours possible : des usagers importants font état tardivement de leurs besoins, dans la construction d'un hôpital.
On rencontre trois types d'avenants : ceux qui résultent d'une conception bâclée ; ceux dus à une évolution du programme voulue par le maître d'ouvrage lui-même - parfois en raison d'une mauvaise étude préalable ; ceux relatifs à des aléas géotechniques ou climatiques survenant en cours de chantier et imprévisibles. Mais on peut toujours réduire les risques par des études approfondies.
Pour limiter le nombre d'avenants, on peut intéresser la maîtrise d'oeuvre au coût final : elle obtient une prime si elle respecte les coûts prévus.
On nous donne souvent des pénalités, plus rarement des primes !

L'innovation dans vos métiers est-elle une vraie ou une fausse bonne idée ?
C'est une très bonne idée pour motiver les ingénieurs et apporter de nouvelles solutions, même si l'innovation peut être aussi facteur de risques - qui doivent être acceptés par le maître d'ouvrage. Malheureusement, si les outils juridiques existent pour encourager l'innovation, comme dans le domaine des routes, ils sont de moins en moins employés.

Vos adhérents vous font-ils remonter des remarques sur les prix, les modalités de paiement, les délais ?
Sur les prix, bien sûr. Les outils juridiques existent pour faire respecter les délais de paiement mais ils sont parfois détournés - des administrations demandent par exemple que la facture soit refaite, et le délai de paiement ne commence à courir que quand tel a été le cas... Assurons des pratiques loyales !

Nos voisins européens, qui doivent aussi transposer la directive, agissent-ils différemment ? En avez-vous de bons échos ?
Nos adhérents travaillent davantage, à l'international, dans les pays émergents, plus dynamiques, que dans les pays de l'Union européenne qui comptent déjà de nombreuses entreprises - même si nous avons des contacts avec les autres pays européens.
Les choix occidentaux sont souvent « quality-based », fondés sur la qualité. Au Royaume-Uni par exemple, l'analyse est rigoureuse et les offres étudiées selon leur qualité. Le dispositif est très structuré.

Les acheteurs ont-ils une plus grande expertise, ou les sociétés de conseil sont-elles plus performantes ?
Le conseil en ingénierie est développé, et la maîtrise d'ouvrage puissante.
Et plus qu'une organisation législative spécifique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ingénierie ferroviaire ? Nous avons parfois des échos contradictoires...
Revenons à l'historique : Réseau ferré de France (RFF) a été créé à la fin des années quatre-vingt-dix. Cette petite structure avait la maîtrise du réseau, tandis que les équipes demeurées dans SNCF Infra conservaient les travaux. La maîtrise d'oeuvre de nouvelles lignes était ouverte à la concurrence, comme la ligne à grande vitesse (LGV) Est. Nos adhérents sont intervenus pour l'ingénierie de l'infrastructure - les voies - puis sur la ligne Rhin-Rhône. L'ingénierie des travaux sur l'existant a ensuite été ouverte à la concurrence et certains de nos adhérents ont remporté des contrats - y compris de délégation de maîtrise d'ouvrage.
Depuis deux ans, avant même la réforme, M. Rapoport a dirigé le rapprochement entre la SNCF Infra et RFF. Les futurs projets concerneront presque uniquement la rénovation du réseau existant, sur laquelle nos adhérents ont développé des compétences mais que le corps social de la SNCF considère comme un domaine réservé. Les commandes à l'ingénierie privée diminuent.
Oui mais chez nos voisins, l'ingénierie est conduite par le secteur concurrentiel, sans davantage de problèmes de sécurité...

Une grande entreprise préfère généralement externaliser son ingénierie, qui lui coûterait plus cher en interne.
Mais les compétences existent au sein de la SNCF, même si celle-ci est un peu renfermée sur elle-même. La rénovation du réseau existant est un énorme enjeu, or des responsabilités trop dispersées posent des problèmes de sécurité et rallongent les délais - chacun souhaitant avoir son mot à dire. Nous dialoguons pourtant avec SNCF Réseau qui, pour répondre à des besoins ponctuels, n'a peut-être pas intérêt à embaucher des gens qui resteront quarante ans dans l'entreprise....
Nous travaillons pour les secteurs du nucléaire ou de l'aéronautique, où les questions de sécurité sont importantes également. Là encore, l'ingénierie externe est plus sollicitée dans des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, sans poser davantage de problèmes.
L'achat privé est souvent moins normé et certains contrats sont récurrents entre un client satisfait et son fournisseur, tandis que pour des raisons de transparence, l'achat public recourt plus régulièrement à une mise en concurrence.
Néanmoins les différences ne sont pas si importantes : j'entends mes collègues travaillant avec le secteur privé se plaindre du durcissement des prix, des conditions du contrat ou des difficultés de sous-traitance, pour lesquels on recourt à la médiation inter-entreprises.

Les procédures de marchés publics sont souvent considérées comme trop lourdes. Est-ce encore le cas ? Le document unique de marché européen (DUME) vous satisfait-il ou, parce qu'il est nouveau, engendre-t-il sa propre complexité ?
Cette réforme va dans le bon sens car les formalités sont toujours plus lourdes dans l'achat public. Il ne faut pas relâcher les efforts, nous devons être vigilants.

Avez-vous des relations avec la Commission européenne au travers de votre fédération européenne ?
Notre fédération en a directement, nous leur faisons confiance.
L'investissement public ne doit pas supporter l'intégralité de l'ajustement des finances publiques.

Les Français considèrent souvent qu'ils ont des infrastructures publiques très performantes, ce que ne corroborent pas les derniers classements internationaux. Quelle est la réalité du déclassement ? Quels pays ont une meilleure infrastructure publique ?
Nous ne reculons pas, ce sont les autres qui avancent. Une partie croissante de notre activité concernera la rénovation des infrastructures et des réseaux ferroviaires, autoroutiers, portuaires et aéroportuaires, même s'il reste quelques infrastructures à créer, comme le métro du Grand Paris, un enjeu important.
Les États-Unis sont en retard, alors que le Royaume-Uni, malgré une diminution de l'investissement public, en a fait une priorité, avec des lignes à grande vitesse ou de nouvelles autoroutes.

L'Espagne était très dynamique sur ce point : elle a bénéficié des fonds structurels européens pour construire des routes et des autoroutes, mais maintenant...
Les investissements sont arrêtés : le marché intérieur a chuté de 85% pour nos homologues espagnols.

Notre mission commune d'information sur la commande publique a une vision en grand angle. Nos travaux se veulent pragmatiques.
Alors que le Gouvernement s'apprête à transposer des directives européennes, nous souhaitons identifier ce qui nous aurait éventuellement échappé et l'alerter sur d'éventuels risques de surtransposition. Notre approche est plus économique que politique ou juridique. Avez-vous des préconisations ou des exemples de bonnes pratiques à nous transmettre ?
Le second oeuvre est un domaine privilégié de la sous-traitance : nous voudrions être certains de donner toutes leurs chances aux PME. Constate-t-on - comme certains l'affirment - des abus dans l'emploi de travailleurs détachés ? Ou bien les dispositifs législatifs apportent-ils toutes les garanties d'une saine concurrence ?
Notre syndicat a été créé dans les années soixante-dix par des dirigeants de PME pour faire entendre la voix des petites et moyennes entreprises. Il regroupe des entreprises de 20 à 200 salariés.
Nous avons largement participé aux débats de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et contribué à des avancées considérables comme l'introduction de l'allotissement dans le code des marchés publics et son élévation au rang de principe général. Pour développer son activité économique, les PME doivent accéder directement aux marchés publics dans des conditions acceptables. Il s'agit de véritables entreprises, qui emploient des bureaux d'études, des conducteurs de travaux et des ouvriers qualifiés, accueillent des apprentis et sont créatrices d'emplois. Leurs structures ont un coût. La sous-traitance se fait souvent dans des conditions que la morale réprouve. L'entreprise générale construit son offre à partir d'une première consultation des PME, mais si elle est retenue, elle n'hésite pas à procéder à une nouvelle, voire à une troisième mise en concurrence. Une entreprise qui a des frais généraux est incapable de s'aligner et son avenir est dès lors en jeu.
Il faut ajouter à cela l'arrivée massive de travailleurs détachés, face auxquels nos entreprises sont désarmées. C'est pourquoi nous défendons l'inscription dans l'ordonnance de l'allotissement, non comme un régime de faveur, mais pour permettre à des entreprises qui en ont la compétence et la capacité d'accéder directement à la commande publique. Prévoir des contrats globaux, des contrats de partenariat, pour des travaux que nos entreprises savent réaliser en allotissement, c'est inacceptable.
Les PME sont souvent des entreprises familiales qui ont vingt, trente, cinquante ans, taillées pour résister aux crises, engrangeant lors des années fastes de quoi résister aux périodes de vaches maigres. Mais aujourd'hui, la durée et la dureté de la crise les mettent en danger. C'est pourquoi nous avons lancé la pétition « Sauvons l'emploi dans nos territoires ».

Nous connaissons bien cette évolution économique. Y a-t-il dans les ordonnances des points qui vous semblent de bon sens ? Des problèmes ?

Votre organisation s'est montrée très réservée sur la réforme des marchés globaux : pourriez-vous préciser votre position ?
Avec la réforme du code des marchés publics en 2006, la France a été très en avance. Elle aurait pu au moins maintenir ces progrès ou même aller plus loin. Or la rédaction du projet d'ordonnance, tout en réaffirmant le principe de l'allotissement, l'assortit d'exceptions telles qu'elle donnera libre cours aux contrats de partenariats et aux marchés globaux. C'est le cas notamment dans les marchés sectoriels des HLM, des hôpitaux, de la Défense et de la Justice. Pour nos entreprises, le logement social est capital, car il se répartit sur tout le territoire. Les exceptions posées, que ce soit pour la conception réalisation ou la performance énergétique, sont beaucoup trop larges.
Aujourd'hui, seule la complexité peut justifier l'utilisation d'un contrat de partenariat. Cette limitation disparaît dans le projet d'ordonnance. La loi d'habilitation posait clairement le principe d'une limitation au recours aux contrats globaux, or il a disparu. Tout se passe comme si cette procédure était indispensable par exemple pour réaliser un bâtiment à énergie positive, alors que nous savons très bien en construire dans le cadre d'un allotissement. Le président du Conseil régional d'Aquitaine, M. Alain Rousset, exemplaire en ce domaine, a fait construire de la sorte un lycée à énergie positive dans le cadre d'un marché alloti.

Le contrat de performance énergétique - qui est un contrat global - n'est-il pas une faculté, plutôt qu'une obligation ?
C'est une tendance naturelle des collectivités à avoir recours à ce type de contrats, que ce texte favorise.

Nos collectivités allotissent très largement leurs marchés, et nous en sommes fiers. Nous avons la ferme volonté de faire travailler nos PME. Cela ne pose de problème que pour des marchés importants. La région Franche-Comté utilise cette possibilité d'allotissement comme l'Aquitaine.
D'autres collectivités n'ont pas cette vertu.
Le partenariat public-privé se justifie pour la construction de la Cité de la justice, pas pour un simple bâtiment de bureaux. L'autoriser, c'est accepter que nos entreprises n'accèdent aux marchés que par la sous-traitance, c'est-à-dire à travers des mises en concurrence répétées et des pressions à la baisse des prix. Si nous avons attaqué l'opération de la cité municipale de Bordeaux, c'est que les PME de la région auraient été fières de participer à un tel projet.

Sur les travailleurs détachés, que constatez-vous, que préconisez-vous ?
Ils ont un effet désastreux en habituant les acheteurs aux prix bas. Le chiffrage de bien des projets n'est réaliste qu'en y ayant recours. Nos entreprises en souffrent !

Nous, acheteurs publics, faisons pourtant attention à l'ingénierie financière et traquons les offres anormalement basses. Dire le contraire mettrait en cause notre probité.
Je ne généralise pas et suis prêt à nuancer mon propos. Mais le meilleur moyen reste l'allotissement, qui supprime un niveau de sous-traitance. Il faudrait aussi vérifier que les travailleurs étrangers paient leurs charges en France, car le décalage entre les charges élimine de fait les entreprises françaises. Il était récemment fait mention dans un journal national d'un contrôle du paiement des charges dans le pays d'origine, mais il est très difficile de vérifier à l'étranger que l'entreprise paye effectivement les charges.
Toute entreprise générale a tendance naturellement à maximiser ses profits, ce qu'elle peut faire en ayant recours à un sous-traitant qui a lui-même recours aux travailleurs détachés, voire au travail dissimulé.

Quelle différence de prix y a-t-il entre un marché où vous êtes sous-traitant et un marché où vous êtes titulaire ?
C'est difficile à dire avec le ralentissement de l'activité. Certains chefs d'entreprise me disent : je soumissionne à un prix si bas que je perds de l'argent, mais au moins je paye les salaires pendant un temps... Ils sont pleinement conscients que leur entreprise est menacée à terme.
Il y a eu une réelle amélioration dans le secteur public. Pour le reste, tout dépend de l'entreprise qui sous-traite.

La dématérialisation progresse-t-elle dans les PME ? Réduit-elle les délais ?
Cela dépend des cas. C'est un sujet important, mais au regard de la gravité de la crise du secteur, la priorité est l'allotissement

Vous prêchez des convaincus !
Obtenez-vous des avances de trésorerie de la part des acheteurs publics ?
Cela se fait. Le problème est plutôt au paiement du solde. Malgré la note publiée par le gouvernement qui prescrit le paiement à 100% des travaux terminés lorsque la retenue de garantie est restituée, certains continuent de ne payer que 90 ou 95%.

La dématérialisation permet d'accélérer le paiement final, après la réception des travaux, une fois les éventuels problèmes consignés, grâce à l'attestation du service fait. Cela améliore-t-il les choses de votre point de vue ?
La gravité de la crise nous fait craindre le pire. C'est pourquoi nous avons tenté de négocier, notamment sur le plan des exceptions sectorielles, demandant qu'au moins le logement social soit exclu de la possibilité d'utiliser les marchés globaux. Ce secteur est vraiment un marché très important pour les PME.

Bienvenue à M. Hubert du Mesnil, président de l'Institut de la gestion déléguée, et à M. Pierre Chabanne, délégué général.
Notre mission commune d'information n'est pas une commission d'enquête : il s'agit moins de contrôler que de proposer et d'examiner si la transposition des directives du 26 février 2014 se fait a minima ou si, comme souvent, on en profite pour ajouter de nouvelles règles.
Après nous être surtout concentrés sur les marchés publics, nous passons avec vous au volet « concessions ». Notre approche est pragmatique, plus économique et politique que législative. Y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiteriez nous alerter, en tant que représentants, notamment, des grands concessionnaires ? La directive « concessions » est-elle pertinente ? Change-t-elle les règles du jeu ? Son articulation avec la loi Sapin de 1993, que le projet d'ordonnance semble vouloir intégrer plutôt que remplacer, vous convient-elle ? Pensez-vous que nous aurions pu éviter de sacrifier à l'amitié franco-allemande la question de l'eau, ou était-ce un combat perdu d'avance ? Comment mettre cette réforme au service de l'économie française et quid des PME ? Quelle est l'action de l'Institut de la gestion déléguée envers ces dernières ?

Quels sont le nombre et le montant annuel des concessions ? Le chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros calculé par vos soins en 2011 est-il encore juste ? Comment est-il calculé ? Quelle est la valeur ajoutée pour les territoires, notamment en termes d'emplois ? Quelle est la durée moyenne des contrats ?
Quelles sont les principales conséquences pour les acheteurs français de la transposition de la directive « concessions » ? Le président a évoqué le secteur de l'eau potable : l'Allemagne a su défendre son point de vue auprès de l'Union européenne.
Les PME semblent peu représentées dans les concessions, du moins comme titulaires de marché, et les sous-traitants sont parfois soumis à des conditions épouvantables tant en termes de prix que de délais de paiement, à croire ce que nous disait tout à l'heure un de leurs représentants.
L'Institut de la gestion déléguée (IGD) n'est pas le porte-parole des grands groupes, mais une fondation réunissant l'ensemble des acteurs publics et privés de la gestion des services publics : l'État, l'Association des maires de France, l'Association des maires de grandes villes de France côtoient des acteurs industriels. L'Institut est né avec la loi Sapin, de la nécessité d'accompagner les dispositions législatives d'une instance de dialogue et de réflexion. Notre objet est la qualité, la performance des services publics, quel que soit le mode de gestion. Nous n'avons aucune religion en la matière, l'important étant de choisir le bon mode de gestion, dans une recherche d'optimisation des outils.
Dès le début, nous avons considéré que la négociation européenne sur la directive « concessions » constituait un enjeu majeur. Certains, qui y étaient opposés, ont pratiqué la politique de la chaise vide, ce qui était une erreur puisque la directive a abouti. Mieux vaut être dans la mêlée que sur la touche.
La directive ne nous satisfait pas pleinement, en raison de la faiblesse de notre position par rapport à l'Allemagne, et de la difficulté que constitue l'absence de notion européenne de concession de service public. Le langage utilisé par la Commission européenne était copié sur celui des marchés publics. L'enjeu était de faire émerger une idée de concession de service public européenne, dont il faudra assumer le décalage avec l'idée française.
L'exclusion de plusieurs secteurs du champ de la directive, typique des compromis politiques de fin de négociation, ne nous enchante pas non plus. Espérons qu'il sera possible de généraliser progressivement la notion de concession européenne une fois qu'elle sera entrée en pratique, et d'entraîner ceux qui sont restés au bord de la route.
En France, la loi Sapin donnait unanimement satisfaction. Personne n'était demandeur de modifications. Notre position, que l'État a d'abord accueillie positivement, était de transposer la directive a minima pour les secteurs concernés et de conserver la loi Sapin pour les autres secteurs ainsi que pour les montants inférieurs aux seuils. La position de l'État a toutefois évolué : son souci de simplification lui fait juger d'un mauvais oeil les réglementations parallèles et préférer le regroupement des outils dans un document unique, d'où l'idée d'intégrer la loi Sapin dans le texte transposant la directive. Nous retenons notre souffle car cette intégration au nom de la simplification pourrait provoquer des dommages.
Nous sommes attachés à la liberté de choix des acteurs publics entre tous les modes de gestion. Nous voudrions améliorer l'évaluation et la connaissance des différents outils pour rendre ce choix efficace. Mais nous avons senti dans l'attitude de l'État la tentation, au nom de la simplification, de réduire le champ des possibles en multipliant les contraintes, les règles et les prescriptions qui restreignent le choix. Certes, il y a pu avoir de mauvais choix, qui se sont traduits par des échecs, mais l'investissement public, malmené en France, ne sera pas favorisé par une restriction des choix de modes de gestion.
Pourquoi les contrats de concession seraient-ils réservés aux grandes entreprises ? Des entreprises modestes peuvent remporter des contrats modestes. L'instauration de seuils minimaux pour les collectivités territoriales ne va pas dans la bonne voie. Encore une fois, nous plaidons pour la liberté de choix et la diversité des outils.
L'accès des PME à la commande publique en général est difficile. Leur incapacité à maîtriser les risques constitue une difficulté supplémentaire en matière de concessions. Une petite entreprise à laquelle on demande de s'engager à une gestion pendant dix ans peut se sentir fragile, ou ne pas être suivie par sa banque. Nous y travaillons, car toutes les idées visant à faciliter l'accès des PME - par exemple, fixer un taux minimal de PME participant à un contrat - ne sont pas convaincantes, pour tentantes qu'elles peuvent être. Nous sommes partisans d'ouvrir le jeu au maximum pour que les PME aient des contrats à leur portée.
La transposition de la directive « concessions » pose plusieurs problèmes. Quel régime sera applicable aux concessions exclues du champ d'application de la directive ? Quelles seraient les conséquences pour elles si elles étaient soumises à des dispositions européennes dont leurs concurrents européens seraient exemptés ?
Les collectivités sont libres de choisir leur mode de gestion, y compris les contrats in house, c'est-à-dire la coopération public-public. Or l'Allemagne a obtenu l'inscription dans la directive d'exceptions qui viennent percuter le droit français. Par exemple, les sociétés d'économie mixte (SEM) sont soumises à concurrence en France (ce que consacre une décision de 1994 du Conseil constitutionnel). Les entreprises publiques locales pourront, sous certaines conditions, concurrencer les entreprises publiques et privées, dont les SEM. La régie Eaux de Nantes, achetée puis revendue par l'allemande Gelsenwasser, qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, aurait pu concurrencer les entreprises françaises dans la limite de 800 millions d'euros !
Une grande discussion a été menée à Bruxelles sur la durée des concessions sans investissement, qu'on appelle l'affermage. Le Conseil des ministres de l'Union européenne a donné une définition large de l'investissement, incluant l'immatériel, mais n'a pas été suivi : le texte prévoit donc que chaque pays donnera sa propre définition. Nous serons vigilants.
La question de l'impact pour les secteurs exclus de la directive ou en dessous du seuil reste entière, nous ignorons ce que compte faire le gouvernement.
Il n'existe pas de statistiques fiables sur le montant des concessions. L'IGD et l'État l'ont évalué à 130 milliards d'euros par an en France, soit la somme des parts du chiffre d'affaires des 48 membres publics et privés de l'IGD concernées par les concessions, et à 220 milliards d'euros dans le monde. Cela représente 7 % du PIB et 1,7 million d'emplois non délocalisables - l'équivalent de la fonction publique territoriale, d'État ou hospitalière - et 40 000 créations d'emplois en 2014.
La durée moyenne des concessions dépend beaucoup des secteurs d'activités. Elle est de 7 ans dans les transports publics urbains, de 25 ans dans les réseaux de chaleur, de 12 ans dans l'eau et l'assainissement, de 7 à 16 ans pour les aéroports, de 7 ans pour la restauration collective, de 8 ans dans les abattoirs.
La durée est liée au poids à amortir des investissements. Elle est plus longue quand des investissements très importants sont réalisés par le concessionnaire, comme pour les réseaux de chaleur.
Oui, sauf délibération spécifique et motivée du conseil municipal, selon l'arrêt « commune d'Olivet » du Conseil d'Etat en date du 8 avril 2009. Mais la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau affirme qu'il n'y a quasiment aucune prolongation au-delà de 20 ans.
Difficile de démontrer qu'il faut plus de 20 ans pour amortir l'investissement. Les durées atteignent 25 ou 30 ans dans le ferroviaire car les investissements y sont très lourds, mais 30 ans constitue un seuil quasiment indépassable.

Au-delà de la durée initiale de la concession - 20 ans par exemple -, faut-il relancer un appel d'offres ?
Oui, obligatoirement, sauf si la situation relève de l'arrêt « commune d'Olivet ».

L'idée selon laquelle les entreprises française seraient particulièrement performantes en matière de concessions est-elle avérée, ou assiste-t-on à une convergence mondiale avec l'irruption de nouveaux intervenants ?
La France a des opérateurs industriels qui sont leaders mondiaux dans leur secteur, et qui ont su s'adapter au contexte national comme international. Mais on observe une évolution : des opérateurs étrangers, notamment chinois, développent des activités sur les mêmes métiers et pourraient un jour venir attaquer le marché européen ou français. Notre position de leader sur l'entretien ou le transport peut être disputée, d'autant que la base nationale est fragilisée par la baisse des investissements publics.
Sept groupes français sont présents dans le trio de tête mondial de leurs secteurs respectifs. Ils développent des ingénieries contractuelles qu'ils voudraient rapatrier en France, sans le pouvoir ; c'est notamment le cas de Veolia ou de Vinci en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Les contrats de performance gagnant-gagnant instaurant un partage des gains ou des pertes éventuels se développent beaucoup à l'étranger.
La notion de partage des risques et des résultats n'est pas répandue dans la culture française. Nous n'avons pas la notion de partenariat dans la durée. Mais la culture du partage, d'origine anglo-saxonne, s'internationalise. Nos opérateurs la pratiquent sur d'autres continents. Nous pouvons rester dans notre culture, dont nous n'avons pas à rougir, ou nous poser la question du partage. Au lieu de dire à l'opérateur qui a pris des risques qu'on ne veut rien savoir et se plaindre qu'il s'enrichit sur notre dos s'il réussit, pourquoi ne pas expérimenter de nouvelles formes de contrats ?

Avez-vous réfléchi à la possibilité d'un contrat de partage entre grands groupes et PME ?
Là aussi, ce n'est pas dans la culture française. Les PME vivent leurs relations avec les grands groupes comme pleines de dangers, de menaces, de pressions. Nous sommes à la recherche d'un nouveau partenariat privé-privé sans partage symétrique des risques, puisque les PME ne peuvent pas encaisser les coups de la même manière que les groupes. Comment inscrire dans un contrat l'idée d'un partage des gains ou des pertes qui peuvent apparaitre au cours de son déroulement ?

Vous avez peu abordé les contrats globaux de partenariat public-privé. Qu'en pensez-vous ? Font-ils partie de la palette de solutions que vous préconisez ?
L'Institut, un des fondateurs des contrats de partenariat, a inscrit la promotion de cet outil à son programme.
Après une période d'emballement suivie d'une période de doute, à la suite de quelques échecs médiatisés, il aurait fallu poser un diagnostic et faire le bilan de cette première famille de contrats de partenariat conclus entre 2005 et 2010. L'État a tâtonné jusqu'à la transposition de la directive « marchés publics », qui a obligé la France à formuler de manière précise ses intentions sur cet outil, rebaptisé marché de partenariat, que nous continuons à considérer comme pertinent dans nombre de cas. Certains sont tout à fait accessibles aux PME, justement parce qu'ils ne font pas porter tous les risques sur le titulaire.
Prenons les contrats de performance énergétique. Une municipalité qui veut rénover l'éclairage public de sa commune peut avoir intérêt à passer commande à un opérateur dont c'est le métier, qui gérera l'installation et l'entretien. L'effet est différent de celui d'un marché public où la commune gère elle-même l'activité après avoir commandé les poteaux. Or, en introduisant des seuils, on empêcherait les petites communes de recourir à cet outil.
Un contrat de partenariat court à l'échec quand le projet n'est pas défini : il peut ne pas être adapté pour la construction d'un hôpital. Pour convenir, ses contours doivent être rigides. Nous nous sommes battus pour conserver cet outil dans la panoplie de l'acheteur public, car il ouvre des possibilités de financement des investissements. Il serait dommage d'apporter trop de restrictions dans la transposition.
Dans la version actuelle de l'ordonnance « marchés publics », les baux emphytéotiques administratifs (BEA), les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH), les autorisations d'occupation temporaire (AOT) et les locations avec option d'achat (LOA), seront fondus en un seul contrat, beaucoup moins accessible : le marché de partenariat.
L'État voulait instaurer un seuil en-dessous duquel on ne pouvait pas recourir au marché de partenariat, mais nous avons démontré que c'était contre-productif pour les PME. Sur les 137 contrats de partenariat, plus de la moitié sont inférieurs à 10 millions d'euros, dont 80 % étaient dévolus à de petites entreprises, notamment dans l'éclairage public. Le ministre de l'économie a annoncé que ce seuil serait supprimé.
Deux modes de contrôle a priori des collectivités sont mis en place, dont l'un est inquiétant. La DGFiP devra établir la soutenabilité budgétaire d'un projet d'investissement d'une commune, uniquement quand il s'agit d'un marché de partenariat. Un avis négatif interdirait l'investissement, ce qui remet en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales. Nous verrons si cette disposition résiste à l'analyse du Conseil d'État, voire du Conseil constitutionnel. Le contrôle par la mission d'appui aux partenariats public-privé (MAPPP) pose moins de difficultés.
Le BEA « aller-retour » serait proscrit, or il représente 90 % des BEA, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, 3 milliards sur dix ans.

Les collectivités sont très friandes de BEA, mais les risques de requalification sont importants.
Ils disparaîtraient avec la directive « marchés publics ». Le risque est de supprimer les alternatives au tout-marché public et au tout-concession, ce qui aurait un impact négatif sur l'investissement public.

En résumé, il faut faire attention à la perte de diversification et aux mécanismes qui verrouilleraient l'investissement.
Tout à fait.