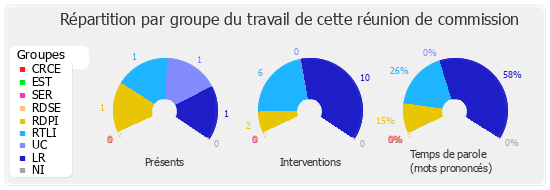Mission d'information Revenu de base
Réunion du 30 juin 2016 à 14h05
Sommaire
- Audition de m. baptiste mylondo enseignant-chercheur à l'école de commerce et de développement 3a de lyon chargé de cours à sciences-po lyon et à centrale paris (voir le dossier)
- Audition de m. lionel stoleru ancien ministre (voir le dossier)
- Audition de m. daniel cohen directeur du département d'économie de l'école normale supérieure (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Baptiste Mylondo enseignant-chercheur à l'école de commerce et de développement 3a de lyon chargé de cours à sciences-po lyon et à centrale paris
Audition de M. Baptiste Mylondo enseignant-chercheur à l'école de commerce et de développement 3a de lyon chargé de cours à sciences-po lyon et à centrale paris

Je vous prie d'excuser le président Jean-Marie Vanlerenberghe, retardé. M. Michel Rocard, souffrant, nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais nous espérons le recevoir en septembre. Merci à M. Baptiste Mylondo, économiste défenseur ardent du revenu de base, d'avoir bien voulu se libérer rapidement. Nous vous écoutons.
Merci de votre invitation. Je suis défenseur - ardent, je l'espère - du revenu inconditionnel contre le revenu de solidarité active (RSA) et la logique de l'assistanat. Ma position de principe est que le RSA est inefficace et injuste : une politique sociale censée lutter contre la pauvreté dont le résultat est un taux de pauvreté de 14 % est inefficace ; une politique stigmatisant et excluant par la pauvreté est injuste.
On présente le RSA comme une main tendue vers les exclus ; avec 524 euros et 68 centimes, ce serait plutôt une main tendue par les bénéficiaires, qui ont parfois tellement honte qu'ils ne font pas la démarche de le demander.
À l'assistanat, je préfère la logique de la reconnaissance. L'assistanat répond en effet à une logique de défiance, qui préjuge que les bénéficiaires sont inactifs. Je veux donc sortir du RSA non seulement parce que son montant est insuffisant mais aussi parce que sa logique est mauvaise.
Le revenu inconditionnel est un revenu versé en échange de la participation de tous à la richesse collective.
Si l'on s'accorde pour juger que la pauvreté est inacceptable et intolérable, on ne peut pas se contenter du montant actuel, qui ne correspond qu'à 30 % du niveau de vie médian et à la moitié du seuil de pauvreté.
La société doit reconnaître à chacun de ses membres un revenu décent permettant une vie digne, en reconnaissance de sa participation active à la vie sociale. Pour échapper à la pauvreté, ce revenu doit être au moins de 1 000 euros pour une personne seule ; pour supprimer l'exclusion, il doit garantir l'accès des biens et services essentiels ; pour lutter contre l'exploitation, il doit permettre à chacun de se passer durablement de l'emploi - cela dans le but d'améliorer les conditions de vie dans l'emploi.
C'est un minimum. Faire moins, c'est ne pas être à la hauteur de l'enjeu. Il est scandaleux de tolérer la pauvreté.
On peut aller au-delà et reconnaître le travail de tous : changer de registre par rapport au RSA. Ne plus parler de revenu minimum, mais d'un revenu forfaitaire versé à tous car tout le monde travaille : le travail ne peut en effet se limiter à l'emploi.
Pour Anthony Atkinson, par exemple, sept critères devraient donner droit à la perception d'un revenu de participation : avoir un emploi, rechercher un emploi, poursuivre des études, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents âgés, être bénévole ou être dans une situation de handicap interdisant d'exercer les six activités précédentes. Qui ne répond pas à au moins à un de ces critères ? Ma conviction, c'est que personne n'est dans ce cas, et donc que tout le monde a droit à un revenu.
N'est-il pas juste de verser une subvention, une indemnité à tous les bénévoles ? Or, nous sommes tous bénévoles, nous entretenons tous la vie sociale. Il faut reconnaître le travail, le faciliter, donner à tous la possibilité de travailler. Le revenu inconditionnel est nécessaire non pas à cause du chômage, ni à cause des robots, de la révolution numérique ou de l'impossibilité dans laquelle se trouve la société de fournir un emploi à tous. Ces éléments ajoutent à l'urgence mais le fond de l'affaire, c'est la nécessité de reconnaître le travail de tous.

Vous avez beaucoup d'assurance et de conviction. Cela coûterait quand même quelques centaines de milliards d'euros. Il faudra que vous esquissiez des pistes pour parvenir au financement d'une telle dépense.

Parmi les demandeurs d'emploi, je sais par expérience qu'il y en a qui ne souhaitent pas travailler. Que se passe-t-il pour eux ?

Que se passe-t-il pour ceux qui ne répondent à aucun des sept critères ? Vous parlez d'une indemnisation du bénévolat : les termes sont antinomiques ; s'il est indemnisé, peut-on encore parler de bénévole ? Qui décide de la pertinence de son action ?
Le travail ne se réduit pas à l'emploi. Si nous appelons travail toute activité qui contribue à l'utilité collective, une bonne part ne s'exerce pas dans le cadre de l'emploi. C'est pour cela qu'il faut instaurer un revenu inconditionnel. Au lieu de considérer que ceux qui travaillent versent généreusement un revenu aux autres, il s'agit de reconnaître toutes les activités qui s'exercent hors de l'emploi.

Je vous le certifie, certains des chômeurs à qui on propose un emploi aidé ne viennent pas, ou viennent le premier jour et ne reviennent pas le lendemain.
Peut-être pour mieux travailler autrement ? On peut refuser un emploi pour s'engager dans une association, par exemple.

Je vous garantis que certains refusent l'emploi sans s'engager dans une association.
Tout le monde rentre dans un critère, si nous avons une vision large du bénévolat, au-delà des seules associations déclarées. Nous sommes tous bénévoles dans une grande association, la société : cet engagement doit être reconnu. Cela peut passer par des heures au service des Restos du coeur, ou par les services rendus à un voisin dans le besoin : ce n'est pas moins utile. Tout le monde entretient la vie sociale en réalisant une activité.
S'il y a des passagers clandestins - ce dont je doute - il est de toutes manières préférable de leur tendre la main pour les inviter à participer à la construction de la société. La confiance est préférable à la défiance.

Je suis favorable à un revenu pour ceux qui veulent se former et cherchent un travail. Il faut bien des critères de l'utilité sociale. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas laisser des gens sur le bord du chemin, mais enfin... faire la cuisine tout seul chez soi ou nettoyer son appartement, est-ce un travail ?
Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui se contentent de nettoyer leur appartement.
Dans cette logique, la personne ne remplissant pas les critères n'a droit à rien. Les critères excluent. La pauvreté est-elle acceptable ? Peut-on mériter d'être pauvre ?

Non, mais une personne à qui vous proposez un travail ou une formation doit l'accepter. Comment faites-vous pour amener les personnes à accepter un emploi ?
Mon but est différent : je veux leur donner la possibilité de travailler, sous quelque forme que ce soit. La pauvreté est intolérable. Les contreparties, les critères donnent le droit d'exclure des bénéficiaires.

Donc, vous proposez de faire passer le RSA à 1 000 euros. C'est une position qu'on peut accepter ; il faudra juste en trouver les moyens.
Le travail doit être défini non par le critère de pénibilité, mais par celui de l'utilité sociale, vue largement : est utile tout ce qui n'est pas nuisible. Je refuse de qualifier une activité d'inutile, car définir l'inutile, c'est rendre possible l'exclusion de certains du droit à un revenu. Qui juge de ce qui est utile ? La majorité ? Quid de la minorité dans ce cas ? Si nous acceptons de qualifier une activité d'inutile, les minoritaires seront jugés inutiles et seront exclus.
Pour le financement, plusieurs propositions existent. Le revenu inconditionnel ne doit pas avoir d'impact sur la protection sociale ou sur les services publics : il ne doit pas se traduire par un recul de la dépense publique. Nous proposons donc de conserver toute la protection sociale, sauf le RSA et les allocations familiales - le revenu inconditionnel versé dès la naissance peut en effet s'y substituer.
J'imagine une source de financement fiscale : un impôt sur le revenu plus progressif et augmenté, plutôt que la TVA, qui ferait augmenter les prix - ce qui pourrait être perçu comme un marché de dupes. La TVA n'est pas l'impôt le plus juste qui soit : c'est une taxe proportionnelle, qui peut être progressive, mais très faiblement, et est donc incompatible avec le nouveau partage des richesses que nous souhaitons.
Marc de Basquiat a fait une simulation : pour verser 1 000 euros par majeur et 250 euros par mineur, un impôt moyen de 57,9 % serait nécessaire. Cela aurait pour effet une augmentation du niveau de vie des huit premiers déciles et une diminution de celui des deux derniers. Le premier décile gagnerait environ 87,5 %, le deuxième 50 %, le troisième 27 %, et ainsi de suite jusqu'au huitième, pour qui cela ne changerait rien ; le neuvième perdrait 5,5 % de niveau de vie et le dixième 15,9 %. Reconnaître le travail de tous implique un autre partage de la valeur.

Karl Marx devait être comme vous au début. ! Mais c'est un compliment que je vous adresse ! Vous savez que 10 % des ménages paient 70 % de l'impôt sur le revenu, qui produit 75 milliards d'euros contre 175 milliards pour la TVA. Celle-ci pèse sur les importations et elle est plus progressive que la légende ne le dit. Miser sur l'impôt sur le revenu ouvrirait un débat très tendu dans le pays en ciblant les classes moyennes.
Elles ne sont pas affectées, selon les chiffres que je vous ai donnés.

Les 57 % des personnes qui ne paient pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui deviendraient imposables. Un débat tendu dans les classes moyennes se changera en malentendu dans les classes populaires. Si vous leur dites qu'elles paieront l'impôt sur le revenu grâce à votre revenu universel, elles y verront un marché de dupes, pour reprendre votre expression, et la caricature ne sera pas loin. Il faut être très prudent.
Pas si cela se traduit par une augmentation sensible de leur niveau de vie.

Je ne vous parle pas de la cohérence de vos chiffres, mais du débat tel qu'il a eu lieu au Royaume-Uni ou pourrait avoir lieu en France ; je ne parle pas de la Sorbonne, mais des arrière-salles de bistrot, de la télé ou des préaux, là où on simplifie, où on grossit le trait et où peut être tenté déformer. Votre propos, quoique cohérent, prend le pays à bras-le-corps dans ce qui pourrait devenir un débat fondamental.

Si tout le monde touche ce revenu, quel est l'intérêt des sept critères ?
Il n'y en a pas ; tout le monde doit en bénéficier.

Vous refusez de définir ce qui est utile, soit ; mais qui définit ce qui est nuisible ? Je veux bien qu'on déplace le curseur, mais vous butez toujours sur la même difficulté.
J'en reste à un critère légal : si la loi interdit une activité, c'est qu'elle la considère comme nuisible.

Réduire la contemplation à de l'oisiveté me semble tout à fait réducteur !
Je ne pense pas que l'inactivité totale existe. Il y a des taux modulés de TVA, certes ; mais moins on a de revenu, moins la part dépensée du revenu est forte, et donc plus la base d'imposition est élevée. Pour rendre la TVA proportionnelle, il faudrait augmenter fortement le taux sur les biens de luxe... Je ne crois pas de toutes manières que la désincitation à consommer soit un bon signal.

Je ne suis pas opposé à ce a qu'on cherche des solutions idéales, comme celle que vous défendez admirablement. Mais on peut aussi chercher à les apprivoiser - ce que vous ne faites vraiment pas. Jean-Jacques Rousseau et Maximilien Robespierre seraient fiers de vous. Mais, vous savez, comme à la Convention, il y a toujours une Plaine, au milieu des débats idéologiques, qui cherche pragmatiquement des solutions. Ce que vous proposez fonctionnerait comme la sécurité sociale, où la liberté totale de choix des soins de l'assuré débouche sur la socialisation de la dépense devenue totale depuis quelques mois - avec le tiers payant. Vous connaissez le mot d'un député de l'Est : la sécurité sociale est un supermarché sans caissière - tout est dit ! M. Alain Minc l'avait déjà dénoncé il y a 40 ans : la sécurité sociale favorise les cadres, qui ont une espérance de vie plus longue et une consommation de soins plus élevée.
Il faut apprivoiser votre solution. Je vis dans des cités minières. Lorsqu'une rue abrite en majorité des chômeurs de longue durée, elle se radicalise et les votes ne vont pas vers les solutions sages, mais vers les solutions simples.
D'où l'importance de la reconnaissance, et de cesser d'opposer les actifs et les assistés.

Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut au moins 1 000 euros pour vivre. Mais les personnes en emploi qui toucheront 1 200 euros et devront utiliser leur voiture pour aller travailler percevront moins pour vivre que les personnes qui font du bénévolat.
Non : elles toucheront 1 000 euros de revenu inconditionnel et toucheront en plus leur salaire de 1 200 euros, dont 57,7 % auront été retranchés par l'impôt sur le revenu. Qui veut augmenter son revenu est donc bien incité à trouver un emploi.

Le seul poste d'économie que votre système réserve est l'activité de Pôle Emploi autrefois gérée par l'ANPE.
Plus les allocations familiales et les politiques de l'emploi, comme les contrats aidés. Mon propos n'est pas de faire des économies, mais de traiter la pauvreté.

Avez-vous des exemples concrets de pays où un tel système a été mis en place ?
Non, mais il y a eu des expérimentations à travers le monde. De toute façon, la protection sociale ne demande qu'à être étendue.

Vous le savez, la France est la nation la plus socialement performante avec 34 % du PIB, devant l'Allemagne et le Danemark, qui y consacrent 30 %. Son contrat social est le plus complet dans les pays à économie de marché.
Vous voulez respecter l'intégralité du contrat, en y ajoutant le revenu universel. Les 34 % du PIB représentent 700 milliards d'euros. Si vous ne supprimez que le RSA et les allocations familiales, il faudra donc trouver 650 milliards d'euros d'impôt sur le revenu.

La majorité sénatoriale, dans le débat budgétaire, avec toute son imagination, n'a fait bouger le budget que de 4 à 5 milliards d'euros. On est loin des 650 milliards ! Ce sont des chiffres révolutionnaires, qui peuvent provoquer la révolution - ce qui ne serait peut-être pas pour vous déplaire...
Je préfère parler de transformation sociale. La France n'est pas performante socialement.
Quantitativement, nous ne pouvons pas accepter 14 % de pauvreté.

Vous comprendrez qu'un social-démocrate s'arrête à un certain niveau du PIB... À 34 %, un parti de gouvernement peut considérer qu'il a rempli un contrat social honorable.
Les moyens sont peut-être importants, mais les dispositifs sont inefficaces.

Quand, à l'injonction d'un CRS, vous vous rangez sur le côté pour laisser passer une ambulance se frayant un passage vers le centre hospitalier de proximité, où une salle de réanimation à 2 000 euros par jour attend un sans-domicile fixe, un salarié ou un patron, il y a quand même une certaine efficacité ! Entendez la voix du réformiste, dans toute sa médiocrité...
En matière de pauvreté, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. On ne doit pas avoir peur d'une hausse d'impôt.
Je propose un impôt sur le revenu dès le premier euro gagné hors revenu inconditionnel, mais avec pour effet une augmentation du niveau de vie des 80 % les moins riches et une augmentation raisonnable de l'impôt des 20 % les plus riches.
Ceux qui n'ont que ces 1 000 euros n'en paieraient pas.

Pour percevoir un impôt, il faut qu'il y ait un revenu ; il faut donc bien produire de la richesse. Ne craignez-vous pas que tout le monde fuie ? Nous vivons dans un système marchand qui a le mérite de créer des richesses. Comment veillez au grain, pour qu'il y ait toujours une minorité de gens suffisamment riches pour financer votre système ?
Vous considérez donc que s'il existe un revenu inconditionnel, plus personne ne voudra avoir un emploi ?

Vous aurez un emploi, mais pas forcément intérêt à gagner beaucoup d'argent. Par ailleurs, nous vivons dans un monde d'échanges commerciaux et sociaux. Comment fonctionner dans une économie mondialisée ? Qu'on le regrette ou non, celle-ci est une réalité.
Quelqu'un qui gagne le Smic bénéficierait d'une augmentation de son niveau de vie de 280 euros. La désincitation ne peut venir que les conditions de l'emploi. C'est d'ailleurs l'un des avantages du revenu inconditionnel : cela devrait être une incitation à améliorer ces conditions.
Quant à la mondialisation, le revenu inconditionnel n'est ni plus ni moins problématique que notre protection sociale : elle garantit des travailleurs de bonne qualité, bien formés, bien soignés, extrêmement productifs.

Nous remercions cet économiste ardent d'être venu de Lyon en TGV pour nous faire part de ses convictions. Nous lui avons donné des idées sur la prudence dont doit faire preuve une assemblée représentative.
Vous présentez le revenu inconditionnel de manière abrupte, sympathique mais trop directe, au vu de l'état actuel du pays. Cette très belle idée qui éclot çà et là dans tous les pays développés n'en mérite pas moins d'avoir toute sa place dans notre réflexion. Merci.
Faudrait-il donc s'interdire certaines propositions dans le débat ?

Certainement pas. Mais nous autres parlementaires sommes confrontés à ce qui monte des profondeurs d'un pays, notamment des bassins de chômage, à savoir le besoin d'une solution. Tout continue et tout bouge. Généralement les Français ont ce qu'ils veulent : on l'a vu pour la sécurité sociale, mais c'est aussi vrai pour la retraite : les retraités français sont seuls au monde à avoir un niveau de revenus supérieur à celui des actifs - puisqu'il en représente 102 %. L'égoïsme du troisième et du quatrième âge peut ainsi s'exprimer dans un relatif consensus.
Que nous cherchons à améliorer, plutôt.
-- Présidence de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, président -

Monsieur Stoleru, vous avez été ministre. Vous avez surtout milité pour l'institution d'un revenu minimum en France. Cela s'est concrétisé en 1988, avec la création de ce que l'on pourrait considérer comme l'allocation généralisée de l'époque, le RMI ou revenu minimum d'insertion. Cela fait plus de vingt-cinq ans que vous avez eu l'intuition de ce qui est aujourd'hui devenu le RSA, qui reste un outil important pour lutter contre la précarité et permettre à certains de bénéficier d'un revenu.
Vous êtes un ardent partisan du revenu universel. Vous l'avez récemment rappelé dans une tribune du Figaro. Le revenu de base recouvre une grande diversité de projets, de visions de la société. Ce débat traverse l'ensemble des formations politiques. Vous vous êtes prononcé à titre personnel pour un revenu fixé à 500 euros par mois, qui prendrait la forme d'un crédit d'impôt.
Le problème principal qui ressort de nos premières auditions, c'est le financement de ce revenu. Sur le principe même, des discussions perdurent. Ainsi, la question se pose en termes philosophiques et éthiques par rapport au travail : comment financer ce revenu, si le travail n'est plus premier ? À notre sens, c'est une difficulté. Si ce financement se fait par l'impôt, il faut des revenus, qu'il s'agisse de revenus sur le capital ou de revenus salariaux.
Nous attendons donc vos idées en la matière ; mais je laisse au préalable la parole au rapporteur.

Je commencerai par un souvenir, celui des jours heureux ! En 1988, vous préconisiez le RMI - c'était la seule grande proposition de François Mitterrand -, financé par le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. Tout le monde comprenait cette corrélation.
Avez-vous la même simplicité à nous proposer aujourd'hui pour le revenu universel ?
Madame, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre invitation.
Nous allons nous évader de l'actualité et parler de la condition humaine. Monsieur le président, vous avez vous-même parlé de la dimension philosophique de cette question.
Les philosophes qui nous expliquent que la condition humaine est différente de la condition animale ont de quoi manger en se levant. Ce n'est pas le cas pour une grande partie de la planète, c'est-à-dire pour les 2 ou 3 milliards d'habitants, en Asie ou en Afrique Noire, qui ont pour seul souci en se levant le matin de se demander ce qu'ils mangeront dans la journée - comme les animaux.
Selon certains, la France et plus généralement les pays développés n'auraient pas ce souci. Grave erreur ! Plus d'un million de repas sont servis par les Restos du coeur. Coluche mérite un prix Nobel : il a réalisé une oeuvre admirable. Vous voyez comme moi des images de détresse de femmes, d'enfants qui font les poubelles, les déchets des supermarchés, qui se rendent sur les marchés vers quatorze heures. Tout cela est intolérable !
Il faut d'abord discuter du revenu universel en termes non pas techniques, mais philosophiques. Quelle idée se fait-on d'une société développée dans laquelle les citoyens ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux ? Ceux-ci sont au nombre de trois : manger, se soigner, se loger.
Je commencerai par ce dernier besoin, se loger. Il n'est pas dans notre sujet et, de l'abbé Pierre à aujourd'hui, personne ne sait comment le traiter. Les lois économiques du marché sont celles de l'offre et de la demande : quand on donne une aide personnalité au logement (APL) de 200 euros à un étudiant, le prix de sa chambre de bonne augmente d'autant ; le prêt à taux zéro a pour seule conséquence de faire augmenter le prix de l'immobilier.
À mon avis, le problème du logement est le plus difficile des trois besoins à régler. C'est le plus coûteux - 15 à 20 milliards d'euros d'allocations logement - pour des résultats très mauvais. Le revenu universel ne résout pas ce problème pour l'instant, mais il faudra bien l'intégrer un jour ou l'autre.
Le deuxième besoin, c'est se soigner. En France, le problème est résolu : le système de couverture sanitaire permet à peu près à tout citoyen d'avoir un accès aux soins quels que soient ses revenus.
J'en viens au premier besoin, manger. Sur ce sujet, l'histoire nous invite à pas mal de modestie. En Angleterre, on emprisonnait les pauvres ; aux Pays-Bas, ce n'était pas mieux. En France, la tradition catholique a été très ambiguë, en affirmant« heureux les pauvres d'ici-bas, puisqu'ils seront les riches dans l'au-delà ». C'est commode, cela permet de patienter, mais ce n'est pas une réponse au problème.
Certes, on peut avoir recours à des allocations en nature, mais ce n'est pas satisfaisant. Les tickets, comme cela se pratique aux États-Unis, n'ont jamais bien résolu le problème. Confucius disait : « Donne un poisson à un pauvre, tu le nourriras un jour ; apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toujours. » Il faut compléter la formule : tu le nourriras toujours... de poissons ! Mais l'économie de marché permet d'échanger le poisson contre d'autres aliments. La solution au problème fondamental de manger, c'est de donner de l'argent.
Ce sujet me préoccupe depuis longtemps. Je suis un enfant de la guerre, issu d'une famille juive immigrée qui a vécu dans le dénuement total pendant la période nazie. Voir que le problème de l'alimentation n'est pas résolu aujourd'hui est pour moi intolérable.
Lorsque j'étais au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des finances, je lui ai demandé d'aller à Washington étudier pendant trois mois l'impôt négatif de Milton Friedman. Des tentatives avaient été lancées, après Kennedy, pour mettre en place l'impôt négatif, c'est-à-dire donner de l'argent à ceux qui n'en avaient pas. Une expérience a été menée à échelle réelle dans le New Jersey : on a distribué de l'argent à un groupe test et à un groupe neutre pour voir si cela suscitait des motivations différentes pour le travail.
Devant le Congrès américain, l'idée ne passait pas trop mal, jusqu'à ce que le président de la commission des affaires sociales du Sénat, opposé au système, réussisse à trouver un cas particulier : quelqu'un touchant la prestation du nouveau système gagnait plus en ne faisant rien qu'en travaillant. Le projet a été retoqué de peu.
Je suis rentré des États-Unis avec une forte connaissance économique, technique et politique du sujet et ai écrit un livre ; Vaincre la pauvreté dans les pays riches.
Je suis devenu le conseiller économique de Valéry Giscard d'Estaing, une fois celui-ci élu Président de la République. Son opinion était celle du Sénat américain : il estimait qu'il n'avait pas de majorité pour faire accepter que l'on paie des gens à ne rien faire, que l'incitation à la paresse ne passerait pas, etc. Or, sans que j'y sois pour rien, il a créé le minimum vieillesse. Cette décision ne posait pas de problème politique, puisque l'on ne pouvait accuser les retraités d'être des fainéants. Cela faisait partie du programme social. En outre, à l'époque, la France était un pays d'inflation, et l'inflation avait ruiné les rentiers. Le minimum vieillesse permettait de donner à manger aux retraités qui avaient tout perdu.
En 1981 a eu lieu le bouleversement politique que l'on sait. J'ai recommencé à donner des cours et continué à faire la promotion d'un revenu minimum, sans grand succès.
En 1988, François Mitterrand s'est présenté pour un second mandat. Il a écrit sa Lettre à tous les Français, que l'on trouvait dans tous les journaux et les magazines. On y lisait notamment : « Si je suis élu, je mettrai en oeuvre le RMI proposé par M. Stoleru. » Or je ne l'avais jamais rencontré ! Il a été élu, a nommé M. Rocard Premier ministre, lequel a constitué un gouvernement d'ouverture qu'il m'a demandé d'intégrer, afin de créer le RMI.
Pendant quinze ans, entre 1974 et 1988, ce dispositif était impossible. Tout à coup, cela devenait possible ! Il a fallu seulement trois semaines pour élaborer la loi sur le RMI, qui a été votée à l'unanimité. Quand on a une volonté, on fait les choses : c'est cela, la politique !
Nous avons créé le RMI, ce dont j'étais satisfait aux trois quarts seulement. En effet, le RMI est extrêmement simpliste : il s'agit de donner 460 euros à quelqu'un qui n'a rien du tout et, quand celui-ci gagne 100 euros, il perd 100 euros de RMI, de sorte qu'il n'a rien gagné du tout. Ce n'est pas du tout incitatif au travail.
J'ai conseillé à M. Rocard de rendre le dispositif dégressif, pour inciter les gens à travailler et à gagner de l'argent. Il n'a pas voulu, objectant que tout le monde comprenait le dispositif en l'état. En effet, cela concernait une tranche de la population qui n'était pas considérable et la somme versée n'était pas énorme. En outre, le RMI ne coûtait rien - 3 ou 4 milliards d'euros par an. Sur le plan politique, l'impôt sur les grandes fortunes rapportait autant, ce qui équilibrait les choses, même de façon hypocrite.
Une mesure simple votée à l'unanimité et qui ne coûtait rien : que demander de plus ? Or l'économie a ses lois : un système qui n'incite pas au travail n'est pas bon, surtout lorsque l'on entre dans des périodes de chômage de masse.
Le « I » de RMI signifie « insertion », mais ce n'était qu'un mot : personne ne pensait qu'il aurait un contenu, car on ne savait pas comment faire. Reste que, politiquement, cela faisait bien.
On s'est ensuite rendu compte des insuffisances du RMI. Martin Hirsch, qui venait de la gauche et travaillait pour Nicolas Sarkozy, comme je venais de la droite et avais travaillé pour François Mitterrand, a dynamisé le système avec le RSA. En effet, le revenu de solidarité active est un RMI dynamique : celui qui commence à gagner de l'argent ne se voit pas retirer du montant de son allocation la totalité de ce qu'il a gagné.
Un taux de dégressivité du RSA a été fixé. À ma grande surprise, Bercy a accepté celui de 62 %. Ainsi, celui qui gagne 100 euros voit son RSA diminuer seulement de 38 euros, il garde 62 euros. C'est beaucoup. Pourquoi Bercy a-t-il fait preuve d'une telle générosité ? J'en reste tout à la fois émerveillé et mécontent.
Le résultat mathématique de ce choix, c'est que cela coûte beaucoup plus cher, 10 milliards d'euros. En effet, cela concerne de plus en plus de personnes. En outre - c'est le reproche que je fais au système -, cela va trop loin. Si l'on retire 38 euros chaque fois que l'on gagne 100 euros, pour atteindre un RSA de zéro euro, il faut gagner un peu plus que le SMIC.
De fait, le RSA donne de l'argent non seulement à ceux qui n'ont rien, mais aussi aux travailleurs pauvres. Or ce n'est pas le sujet. C'est un mélange des genres très malsain. Les salaires, c'est une chose, la protection sociale contre la pauvreté et la misère, c'en est une autre.
Avec ce taux très généreux de 62 %, le RSA crée une confusion des genres dont on voit les conséquences aujourd'hui, notamment dans ce débat politique insupportable entre assistanat et assistance, surtout à droite. On a donc créé un débat sur un sujet qui n'en est pas un. Je continue à me demander pourquoi ce taux a été retenu. D'ailleurs, aucun citoyen concerné n'y comprend rien. Pour ma part, si j'avais été en charge de ce dossier, j'aurais proposé un système à 50-50, qui a le mérite de la simplicité : quand on gagne 1 000 euros, donc en dessous du SMIC, le RSA n'est plus versé.
La répartition 38-62 est tombée du ciel. Elle fausse les discussions actuelles et soulève un débat où l'on repose des questions que je pensais révolues sur l'assistanat et l'assistance.
Dans le RSA, le « A » d'« activité » n'a pas plus de contenu que le « I » de RMI. Là encore, cela fait bien dans le débat politique.
Martin Hirsch aurait pu faire voter le RSA à l'unanimité. Je n'ai toujours pas compris pourquoi la majorité de droite a tout fait pour que la gauche ne le vote pas, alors que celle-ci n'était pas du tout hostile à la transformation du RMI en RSA. On ne peut pas dire que l'on ait encouragé un vote consensuel sur ce sujet.
Je ne m'attarde pas sur la prime d'activité, qui regroupe le RSA et la prime pour l'emploi. C'est une bonne chose d'avoir supprimé la prime pour l'emploi, qui était totalement incompréhensible. La prime d'activité est le système actuel.
Le dernier rapport de Christophe Sirugue, dont j'apprécie beaucoup les travaux, a constitué une nouvelle péripétie. Voilà un député qui connaît à fond son sujet et qui accomplit un travail très approfondi et documenté. Son deuxième rapport est tout aussi remarquable que le premier : il fait un pas de plus et propose de fusionner la dizaine de minima sociaux dans le scénario n° 3, scénario qui me paraît très bien. La presse n'a parlé que de l'intégration des jeunes. Certes, cela fait partie du rapport et c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas l'essentiel. Pourquoi, en laissant de côté le problème des jeunes, faudrait-il attendre deux ans pour mettre en oeuvre ce qu'il préconise ?
L'étape suivante, c'est le revenu de base ou revenu universel. De Milton Friedman au RMI, il s'est passé une quinzaine d'années ; du RMI ou RSA, vingt ans se sont écoulés ; du RSA au revenu universel, comptons de quinze à vingt ans. L'histoire est en marche ; elle ne s'arrêtera pas. En effet, le revenu universel est le débouché final normal dans les sociétés développées.
Le RMI a apporté une innovation importante en donnant de l'argent à n'importe qui, quel que soit son statut. Il n'y a pas de critères, contrairement aux prestations sociales. On perçoit le RMI quand on n'a pas de revenu. Le RMI est déjà universel, tout comme le RSA.
Le revenu universel va plus loin dans plusieurs domaines.
D'abord, le revenu universel est individualisé. C'est important. Alors que le RMI et le RSA sont familiaux, le revenu universel est individuel : on ne tient pas compte du fait que son bénéficiaire est marié ou pas. Chaque individu reçoit par exemple 500 euros. C'est plus généreux que le RSA, puisque, dans ce dernier cas, un couple ne perçoit pas deux fois 500 euros.
Ensuite - c'est une différence majeure -, on ne demande pas si l'on a des revenus. Il suffit d'être un citoyen français d'un certain âge - disons de vingt ans à la mort -, quels que soient ses revenus.
Ce débat a fait naître deux controverses fondamentales.
La première m'étonne toujours : on va donner de l'argent à ceux qui ne font rien ? Moi, contribuable, je vais travailler pour que les gens ne fassent rien ? On le fait pourtant déjà depuis 1988 avec le RMI, c'est-à-dire depuis vingt-huit ans. Je croyais le débat terminé et exorcisé depuis cette date ! À cette époque, on a accepté que les gens qui n'avaient rien aient de quoi manger : avec 500 euros, soit 15 euros par jour, on ne meurt pas de faim. Cette polémique resurgit. C'est assez déprimant.
Derrière ce débat, il y a une réflexion intéressante sur deux aspects de la condition humaine. D'une part, il s'agit de satisfaire un besoin fondamental : manger. D'autre part se pose la question du libre arbitre, et l'on peut raisonner ainsi : « Avec 500 euros par mois, j'ai de quoi manger. Pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est de peindre des paysages. Si je n'ai pas de quoi me loger, tant pis. Je me contenterai d'une cabane. Cela me suffit. » Ou alors : « Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire de la poésie et des livres, peu importe qu'ils se vendent. » Pour ma part, je n'ai rien contre ces choix, d'autant que ceux qui ont une passion telle qu'ils acceptent de vivre ainsi ne forment pas foule. Peut-être que Van Gogh ne se serait pas suicidé s'il avait perçu le RMI. Misère et génie ne font pas forcément bon ménage. Quoi qu'il en soit, on peut supprimer la misère.
La seconde controverse, c'est le chèque à Mme Bettencourt : on donnerait 500 euros par mois à Mme Bettencourt ? Eh oui ! Mais personne ne voterait pour un candidat qui le proposerait ! À cette question, la réponse rationnelle, pour autant que l'on soit dans le pays de Descartes, serait : que voulez-vous que cela me fasse ? Mme Bettencourt paie X euros d'impôt sur le revenu. Elle en paiera X moins 500 euros par mois. Si cela vous choque tant que cela, on peut même créer une dernière tranche augmentée de 500 euros pour récupérer les 500 euros de Mme Bettencourt !
La réponse technique est facile ; la réponse politique l'est moins. Moi qui ai vécu la réponse politique pour des gens qui se trouvaient au bas de l'échelle, c'est-à-dire donner de l'argent à des gens qui ne font rien et encourager la paresse, je me rends compte que le débat sur le revenu universel attribué à des personnes appartenant à des classes socialement supérieures promet d'être intéressant ! C'est un débat 100 % politicien, puisque les solutions fiscales sont très faciles.
Pour vous, madame, messieurs les sénateurs, l'important, c'est ce qui se passe entre zéro - c'est-à-dire celui qui n'a rien et est dans la misère - et l'infini, c'est-à-dire Mme Bettencourt et les hauts revenus.
Pour ma part, cela ne me choque pas que M. Carlos Ghosn gagne un million d'euros par mois. S'il veut bien payer ses impôts en France, c'est très bien. J'ai professé l'économie de marché et écrit de nombreux livres sur le sujet : l'économie de marché s'accommode très bien d'un plancher de revenus ; en revanche, elle ne s'accommode pas du tout d'un plafond de revenus. Cela revient à la tuer, car elle est fondée sur l'enrichissement, notamment en économie ouverte.
Laissons Mme Bettencourt à sa fortune et Carlos Ghosn à son million d'euros mensuel et regardons ce qui se passe pour l'ensemble des Français.
Par rapport au RMI, au RSA et à la prime d'activité, le revenu universel a pour autre caractéristique majeure d'être fiscal. On sort du système social, composé en France des partenaires sociaux, des collectivités territoriales, des associations, de la gestion paritaire, etc. - vous le savez mieux que moi, c'est très compliqué et très cher en gestion. On balaie tout cela et il y a uniquement un système fiscal. En France, celui-ci fonctionne plutôt bien, comme dans la plupart des pays développés.
J'ai évoqué le système de soins. En France, il suffit d'aller sur internet pour consulter l'état de son compte santé.
Pour les impôts, on a maintenant un compte fiscal : la déclaration se fait en principe obligatoirement en ligne. Les revenus sont enregistrés, tout comme le montant des impôts. Chacun connaît donc l'état de ses comptes et ce qu'il doit, sous la forme soit d'une mensualisation soit du tiers provisionnel selon le système choisi. Le compte fiscal est donné en temps réel.
Pour le revenu universel, ce serait la même chose.
Chaque mois, on aurait + 500, comme si on percevait une rente sur son compte bancaire. À celui qui ne perçoit aucun revenu, le Trésor public enverrait un chèque de 500 euros à la fin du mois - c'est déjà ce qui se passe en cas de remboursement d'impôt. Pour celui qui perçoit des revenus, le montant du revenu universel varierait en fonction du taux de dégressivité du barème fiscal. Une fois atteint un certain niveau de revenus, par exemple 1 000 euros, le revenu universel de 500 euros deviendrait zéro. Ensuite, on paierait des impôts.
Il s'agit donc d'un barème continu d'impôt avec un crédit d'impôt qui est versé par chèque quand le solde net est négatif. Quand on a des revenus, le crédit d'impôt diminue et disparaît. Reste alors à payer aux impôts la contribution fiscale. C'est donc d'une parfaite simplicité.
Certes, ce n'est pas aussi simple que je le décris. Le revenu à la source est du même acabit et s'inscrit dans le même schéma : même si, chaque mois, on ne connaît pas le montant exact des recettes et des dépenses, on prélève en fonction du taux de l'année précédente et on régularise en fin d'année. Des solutions existent déjà pour que le compte fiscal soit adapté à la réalité à peu près chaque mois.
Et c'est la fin des allocations de toute nature, par exemple des allocations familiales. C'est la fin des disputes entre les départements, les régions et l'État pour savoir qui paye le RSA, etc. Il y a uniquement un barème fiscal négatif au début, qui devient zéro, puis qui devient positif.
Je termine en répondant à la question : combien cela coûte-t-il ?
Monsieur le président, ce n'est pas la question essentielle ! Il n'est qu'à voir le référendum suisse. Les Suisses se sont prononcés sur la question humaine et sur le principe philosophique - on aide ou on n'aide pas. Vous devriez d'ailleurs inviter un responsable suisse : il vous expliquera que le chiffrage n'a pas été un élément déterminant du vote.
Je suis convaincu que ce serait pareil en France. Le chèque à Mme Bettencourt occuperait beaucoup plus de place dans le débat que le coût budgétaire. Il n'y a pas de problème de coût budgétaire. C'est une question de curseur : il faut établir un barème fiscal avec un point zéro de sorte que l'impact budgétaire soit nul. On paye suffisamment d'impôts en France : en 2017, il faudra plutôt baisser le taux d'imposition que l'augmenter.
Qui gagne ? Qui perd ? Sur la totalité du barème fiscal, de zéro à l'infini, sauf à faire une usine à gaz, avec un barème fiscal progressif raisonnable à deux ou trois taux et tranches, il est sûr que certains individus, des ménages et des familles gagneront et que d'autres perdront. D'après les chiffrages, cela n'a pas l'air dramatique : il n'y a pas un point où une catastrophe se produirait pour tel ou tel niveau de classe moyenne.
Pour résumer, monsieur le président, le coût du revenu universel est ce que l'on voudra en faire.

Monsieur Stoleru, je vous remercie de cet exposé passionnant et limpide dans ses conclusions. Pour autant, on ne peut pas dire que tout est résolu ! Vous avez apporté un éclairage complémentaire, notamment au regard des auditions précédentes, car vous avez replacé cette question dans son contexte essentiel, c'est-à-dire existentiel. C'est ce que j'attendais.
En revanche, sur la conclusion - comment on paie ? -, des interrogations demeurent.

C'était une fable de La Fontaine ! La simplicité, la limpidité et la morale apparemment inéluctable et abordable rappelaient ces textes incomparables qui ont enchanté notre jeunesse.
La fiscalité est en France d'une complexité redoutable ; vous l'avez simplifiée à l'extrême. Les débats promettent d'être intenses.

Cet exposé très clair tranche quelque peu avec l'exposé précédent.
Ma question est technique : quelle différence existe-t-il entre votre dispositif et le crédit d'impôt ou l'impôt négatif ?
Il n'y en a pas vraiment. On retrouve l'idée simple de Milton Friedman cinquante ans après. Ce système est d'abord un impôt négatif, c'est-à-dire un crédit d'impôt : quand vous n'avez pas de revenu, le Trésor vous envoie un chèque chaque mois. Son montant diminue au fur et à mesure que vous percevez des revenus. Quand la tendance s'inverse, c'est vous qui envoyez le chèque. C'est un continuum de barème fiscal qui commence par un crédit d'impôt et qui se termine par des perceptions d'impôt.
C'est intéressant de sortir du système social pour entrer dans le système fiscal. Sur le plan sociologique, être dans un système fiscal pour tous est très différent et c'est mieux que d'être dans un système social où l'on veut bien vous verser de l'argent. Le système social crée des humiliations, notamment parce qu'il faut faire des démarches. Pour le revenu universel en revanche, aucune démarche n'est nécessaire, c'est un droit. Recevoir une allocation est aussi un droit, mais d'une manière différente : on vous le fait sentir...

Votre démonstration est presque parfaite ! On arrive à une simplicité extrême : cela ne coûte pas plus que les sommes que l'on consacre aujourd'hui à la gestion des affaires sociales.
Le dispositif que vous proposez exclut-il l'ensemble des autres aides qui accompagnent nos concitoyens, aides au logement, protection sociale, allocations familiales, etc. ? Se confondent-elles dans le modèle que vous nous avez présenté ?
Santé, chômage, retraite sont en dehors.
Le logement est une épine dans le système : les aides sociales actuelles coûtent très cher, ne sont pas efficaces et on ne sait pas comment les intégrer. Le débat n'est pas terminé pour ceux qui réfléchissent au système du revenu universel.
Le rapport Sirugue fait le tour de toutes les formes d'assistance. Reste ce qui est donné ici et là, le transport gratuit dans certaines villes, le cinéma ou le théâtre, le chèque de rentrée scolaire, les entrées dans les musées... ; bref, tous les petits avantages qui ne sont pas toujours négligeables. Ce n'est pas dans le revenu universel.

Le supprimez-vous ? Au regard de la simplicité du système que vous prônez, il ne peut être que supprimé...
En principe, oui. À partir du moment où le revenu universel est individuel, rien ne justifie qu'il y ait un avantage pour un couple...
Je n'ai pas caché que certains gagneraient et que d'autres perdraient.

Ce revenu est-il versé dès la naissance ? Vous ne l'avez pas évoqué. Or c'est une question importante.
Je n'ai pas parlé des jeunes ni pour le rapport Sirugue ni pour le revenu universel. Cela fait partie du débat politique qui pourrait avoir lieu.
Que n'entend-on pas déjà sur la proposition du rapport Sirugue d'étendre la prime d'activité aux jeunes ! Que n'entendrait-on pas si l'on versait le revenu universel dès la naissance ! Cela se négocie. On peut verser le revenu universel à dix ans, quinze ans, dix-huit ans, vingt ans...

Vous proposez de passer du « tout social » au « tout fiscal ». Est-ce à dire que le « tout social » doit disparaître une fois le revenu universel instauré ? Ou est-il toujours nécessaire d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi ou qui sont dans la plus grande difficulté ? Le revenu universel ne va pas sortir cette catégorie de public de ses difficultés et de cet enfermement que certains appellent l'assistanat.
Le système santé est en dehors, tout comme le système retraite et le système chômage.
Avec le revenu universel, on donne aux gens de quoi manger. Il faut regarder la réalité en face : un million de personnes vont aux Restos du coeur. Est-ce normal dans un pays comme la France ? Non ! Après, il faut leur donner les moyens de se réinsérer dans la société. Le « I » du RMI ne l'a pas fait, le « A » du RSA ne le fait pas plus. Dans ce domaine, certains pays font mieux que la France.
Depuis toujours, je m'occupe du problème des prisons. J'ai créé il y a quarante ans le GENEPI, groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées : 1 300 étudiants se rendent chaque semaine dans toutes les prisons de France à la rencontre des jeunes détenus. Pour participer à l'action expérimentale « Justice deuxième chance », le retour à l'emploi à la sortie de prison, je sais que ce n'est pas le revenu universel qui réglera le problème ; cela demande un accompagnement spécifique. Il y a place pour un système social qui ne soit pas un système financier.

Il faut dissocier l'aspect financier et budgétaire du problème de l'activité. En voulant résoudre cette équation, Martin Hirsch a compliqué le système. Au Sénat, nous avions étudié cette question sans parvenir aux mêmes conclusions ; un rapport d'information avait été rendu par notre collègue Valérie Létard.
Pour beaucoup, il n'est pas normal de pouvoir gagner plus avec toutes les aides et les prestations que celui qui travaille. Il est vrai que de tels cas existent. De ce constat de départ, nous sommes arrivés au RSA, qui ne résolvait rien, qui était un RMI amélioré, avec une dégressivité qui n'était pas simple. Nous n'avons pas résolu le problème : est-il seulement soluble ?
Une dégressivité de 50 % éviterait le télescopage avec les travailleurs pauvres. Suggérez-la : vous auriez le soutien de Bercy !

Reste qu'il faut remettre les gens dans le circuit du travail. Et là, la cause première, c'est l'éducatif. Cela ne se résume pas à l'apprentissage, il faut les fondamentaux : lire, écrire, compter, etc. Autrement, comment espérer trouver un travail durablement ?

Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, mais, pour moi, c'est la vraie question. C'est un autre problème politique, qui n'est pas de subsistance, mais d'existence.
Monsieur Stoleru, nous vous remercions de cet exposé particulièrement riche et de cet échange.
Oui et non. Je n'imagine pas un quelconque candidat à la présidence de la République en 2017 déclarer, à l'instar de François Mitterrand en 1988, qu'il mettra en oeuvre le revenu universel s'il est élu.

Il pourra peut-être proposer de l'expérimenter, sur la base du volontariat.

Le crédit d'impôt est plus simple à expérimenter que d'autres systèmes.

Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions avec M. Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
Monsieur le professeur, nous avons souhaité vous entendre pour bénéficier de votre lecture économique acérée sur ce nouveau débat d'actualité : l'allocation universelle. Pour ses promoteurs, le revenu de base n'est pas une réforme simplement technique dont l'ambition se résumerait à la simplification du paysage des minima sociaux. Cette vision est concevable, mais nous entendons la dépasser.
Le revenu de base est souvent présenté comme une réponse à une mutation profonde de la société, avec notamment la révolution numérique et la remise en cause de centaines de milliers, voire de millions, d'emplois, mais encore avec l'irruption de nouveaux vecteurs de création de richesse hors de l'entreprise. Le revenu de base serait alors un moyen de rétribuer une création de valeur que le marché serait incapable de rémunérer.
Compte tenu de vos travaux, monsieur le professeur, en particulier ceux qui ont porté sur la mutation de nos sociétés sous l'effet du numérique, nous souhaiterions que vous nous éclairiez en dressant un panorama des transformations auxquelles nous sommes confrontés et des difficultés qu'elles font naître au regard de notre relation actuelle au travail.
Dans ce contexte, le revenu de base peut-il être un recours, étant entendu que cette notion recouvre des modalités différentes, mais qu'elle traverse toutes les tendances et sensibilités de la société, de droite comme de gauche ?
Vous le savez, je ne suis expert ni de fiscalité ni de la lutte contre la pauvreté ; fondamentalement, je suis macro-économiste, je considère les choses, comme la croissance ou l'emploi, de haut. C'est donc à ce niveau-là que je me situerai ; cela dit, je n'esquiverai pas la façon dont ces idées peuvent concrètement aboutir à une solution qui ne détruise pas l'équilibre de nos finances publiques.
L'idée du revenu de base, du revenu universel ou de l'allocation universelle - les formules varient - n'est certainement pas nouvelle. On en trouve des traces au moins depuis les débats relatifs à l'avènement du capitalisme. Pour se cantonner à l'histoire la plus récente, l'un des protagonistes de cette question est évidemment Milton Friedman, avec son idée d'impôt négatif. Or l'un des paradoxes de ce débat est que l'on en trouve des partisans tant à droite qu'à gauche et, symétriquement, des oppositions de droite et de gauche. Ainsi, James Tobin, grand opposant des idées de Milton Friedman dans les années 1950 et 1960, y était également favorable.
Évidemment, leurs interprétations de ce revenu étaient très différentes. Pour Friedman, il s'agissait de créer une allocation de base dispensant la société de faire d'autres efforts vers les plus pauvres. Il proposait d'accompagner cette mesure d'un impôt fixe constant - une flat tax - dès le premier dollar et la progressivité du système de revenu se serait alors trouvée dans l'articulation entre la fiscalité constante et l'impôt négatif. Pour Tobin, au contraire, il s'agit d'un minimum garanti à tout le monde et ne se substituant évidemment pas aux autres prestations de l'État providence.
Ici se trouvent donc une base du malentendu et une raison pour laquelle on peut voir converger des courants de pensées différents autour de cette idée. Cette ambiguïté me semble plutôt positive que négative, même si chacun doit préciser ce qu'il a en tête lorsqu'il parle de ce sujet.
On retrouve cette transversalité dans les critiques du revenu universel ; à droite, on déplore la subvention des oisifs, la prime à l'assistanat, qui est inacceptable dans une société où le travail est une valeur cardinale justifiant la place de chacun. Il existe aussi, à gauche, des critiques de cette mesure, qui favoriserait la précarité en permettant aux employeurs de bénéficier d'une subvention implicite incitant au travail précaire. Les deux arguments sont donc en miroir l'un de l'autre.
Je n'ai pas l'intention d'entrer dans ce débat ; il faut avancer, comprendre ce que l'on veut faire et répondre à ces différentes critiques.
Cela dit, la principale critique à cette idée n'est pas philosophique ni politique mais quantitative : quels sont les ordres de grandeur en jeu ? En faisant un calcul un peu idiot - et on verra qu'il l'est effectivement - qu'on lit régulièrement pour rendre ce débat impossible, c'est-à-dire en fixant ce revenu minimal à 700 euros et en le multipliant par le nombre de Français, on atteint très vite des chiffres d'environ 500 milliards d'euros, soit un gros quart du PIB français.
D'ailleurs, pour les libertariens - je pense en particulier à mon ami Jacques Marseille, qui défendait cette idée -, cela tombe bien parce que ce montant correspond à peu près aux dépenses sociales en France. Donc, selon eux, on donne ces 700 euros et, ensuite, les gens se débrouillent. Toutefois, ces ordres de grandeur sont trompeurs parce que ce revenu ne viendrait pas en plus des dispositions existantes, mais jouerait comme un plancher. Le calcul est donc plus complexe à faire pour en estimer le coût net.
Je reviendrai sur cette question du chiffrage, seule façon pragmatique d'avancer, en faisant des propositions pratiques, réalistes et permettant au débat de prendre plus d'ampleur.
Pourquoi cette idée reprend-elle aujourd'hui une certaine actualité ? Lionel Stoleru, que j'ai croisé à l'instant au sortir de son audition devant vous, pense que ce sujet revient tous les vingt ans - RMI, puis RSA et maintenant le revenu de base. Pourquoi pas ? Cela dit, la révolution numérique nous oblige encore une fois à repenser la sécurité sociale du XXIe siècle ; le rapport de Bruno Mettling au ministre du travail, intitulé Transformation numérique et vie au travail, faisait d'ailleurs aussi référence à cette question.
De fait, nous entrons dans un monde très incertain, dans lequel la révolution industrielle, ou plutôt post-industrielle, du numérique pose des questions tout à fait différentes de celles qui s'étaient posées un siècle plus tôt avec la révolution du tout-électrique. Le tout-numérique, notre révolution technologique, n'a pas du tout les mêmes propriétés que le tout-électrique et on sait comment mesurer ces différences.
La seconde révolution industrielle, celle du tout-électrique, a été inclusive : elle réduisait les inégalités et rendait productifs les éléments les moins productifs de la société - ouvriers non qualifiés ou travailleurs à la chaîne. Toute l'ergonomie du travail a permis à cette main-d'oeuvre non qualifiée de devenir productive, de bénéficier des avantages du fordisme ou du taylorisme et d'être les acteurs d'une transformation du monde économique profitant à tous. Cette révolution électrique a donc donné lieu à une réduction des inégalités.
Le monde nouveau de la révolution numérique, depuis le début des années 1980, est très différent. Les travaux de Thomas Piketty et d'Emmanuel Saez montrent, à partir de l'exemple emblématique des États-Unis, ce que cette révolution numérique est en train de produire. Une statistique notamment est éclairante : au cours des trente dernières années, 90 % de la population américaine n'a connu aucune progression de son pouvoir d'achat. C'est une mutation spectaculaire par rapport à ce que l'on connaissait auparavant, lorsque les classes populaires et moyennes bénéficiaient, comme les autres segments de la société, de la croissance économique.
Ainsi, 10 % de la population seulement a capté la totalité de la croissance économique et, au sein de ces 10 %, la moitié de cette croissance est revenue à 1 % de la population. Il s'agit là d'une propriété fractale parce que la moitié de ce qui va à ce centième est captée par 0,1 % de la population, et ainsi de suite. La force d'entraînement de la révolution numérique n'a donc absolument rien à voir avec celle de la révolution précédente.
Ces chiffres sont inédits dans l'histoire du capitalisme depuis un siècle et demi. Ce constat nous oblige à réfléchir en profondeur à ce qu'il se passe, à comprendre les raisons de ce manque d'inclusivité et à en déterminer les remèdes, pour construire la nouvelle sécurité sociale du XXIe siècle et pour corriger les effets, pour l'instant inégalitaires, de cette révolution numérique.
Pourquoi cette situation ? Pourquoi cette révolution numérique est-elle aussi décevante ? Il y a, parmi les économistes, deux écoles pour répondre à cette question, ce qui révèle, soit dit en passant, l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons concernant les mécanismes à l'oeuvre.
La première école, très optimiste - celle de la croissance endogène, notamment représentée par Philippe Aghion -, affirme que le potentiel de croissance de nos économies est supérieur à ce qu'il était il y a un siècle. Selon elle, le potentiel de croissance ne cesse de progresser, mais il y a toujours un décalage dans le temps entre les innovations radicales - internet il y a vingt ans, la révolution digitale au tournant des années 1960 et 1970 - et le moment où cela se retrouve chez les consommateurs.
Un célèbre article d'un historien de Stanford, Paul David, fait une analogie avec le moteur électrique : 50 ans se sont passés entre la maîtrise technique de ses mécanismes et le moment où il s'est retrouvé dans les foyers américains. Selon cette analogie, on verrait tous les bénéfices, pour le pouvoir d'achat, de cette révolution numérique dans les années 2020.
La seconde école - celle de la stagnation séculaire, avec notamment Larry Summers et Robert Gordon - dit le contraire. Selon ce courant de pensée, le potentiel de croissance du numérique est faible parce que le numérique ne révolutionne pas en profondeur la société de consommation, contrairement à ce qui s'est passé lors de la précédente révolution industrielle. Gordon invite ainsi à comparer la période 1870-1970 à la période actuelle.
De 1870 à 1970, on a changé de monde - électricité, automobile, métro, air conditionné, tout-à-l'égout, aviation, télévision - et l'on a quitté la société rurale et agraire. Aujourd'hui, la révolution tient, pour les consommateurs, en un seul instrument : le smartphone. Tout ce qui s'est inventé depuis 30 ans se résume dans cette invention, qui a déjà un taux d'équipement de 100 % dans les pays avancés et atteint même le point des rendements décroissants - la sortie d'un nouvel iPhone n'est pas vécue comme un miracle mais plutôt comme un inconvénient. Ce petit boum aura duré 3 ans, tout le monde s'est équipé et tout est maintenant terminé...
J'essaie, dans mon dernier livre, de réconcilier ces deux écoles. Gordon sous-estime la puissance du numérique, mais son observation selon laquelle le taux de croissance des économies ne cesse de décliner pour atteindre des étiages durablement plus bas que ceux des années 1980 est juste. Le constat est valable aussi au Japon et même aux États-Unis. Les capacités de croissance de cette révolution sont donc très différentes de la précédente.
En me fondant sur les travaux des économistes qui ont étudié les mutations du marché de l'emploi, je suggère une interprétation de cette situation : pour un très grand nombre d'emplois, à la différence des technologies de l'électricité et de l'organisation du travail à la chaîne, les technologies n'entretiennent pas un rapport de complémentarité, mais de substituabilité avec le travail humain.
Dans bien des emplois, le numérique remplace le travail humain et ne le rend pas plus productif. Dès lors, quel est le potentiel de croissance ? Dans un rapport de complémentarité, un intrant de technologie de 10 et un intrant de travail humain de 10 aboutissent à [10 x 10], soit 100. Dans un rapport de substituabilité, on obtient [10 + 10], soit 20, car on n'utilise pas le capital humain pour faire tourner des machines.
On réconcilie ainsi deux points de vue apparemment contradictoires, puisque les technologies tendent à remplacer le travail humain, en tout cas actuellement. Pour parler comme Schumpeter, la force destructrice est aujourd'hui - on ne peut pas s'engager sur le futur - plus forte que la dimension créatrice. Aussi, pour bien des gens, le numérique représente plus une menace qu'une promesse.
Quand les technologies du numérique ont apparu dans les années 1980, on a constaté que la force de destruction était importante, mais les économistes de l'époque ont parlé de technologies biaisées en faveur du travail qualifié. On pensait que les technologies sanctionneraient les emplois non qualifiés - les interphones remplaceraient les concierges, par exemple - mais que la population qualifiée serait épargnée. Par conséquent, la leçon était enthousiasmante : il s'agissait de translater la population vers un travail plus qualifié - d'où l'objectif de 80 % d'une classe d'âge titulaire du baccalauréat -, de requalifier le travail pour échapper à l'impact des nouvelles technologies.
Aujourd'hui, l'analyse des effets destructeurs du numérique sur l'emploi est d'une nature différente. On ne retient plus la grille travail qualifié-travail non qualifié, mais l'opposition entre travail routinier et travail non routinier, soulignée par David Autor. Le travail routinier a vocation à être numérisé ; ainsi, les informaticiens ont coutume de dire que, si l'on fait deux fois de suite la même tâche, on doit penser au logiciel qui le fera une troisième fois. A contrario, le travail qui survivra sera le travail non routinier.
À cet égard, les statistiques montrent que le travail du bas de l'échelle sociale, le travail non qualifié, n'est pas forcément menacé par la numérisation : il faudra toujours des gros bras pour transporter des caisses ou des assistantes maternelles pour s'occuper des enfants. Ce ne sont pas des emplois très rémunérés, mais ils ne sont pas numérisables parce qu'ils reposent sur des compétences étrangères aux ordinateurs - capacité à monter des escaliers, contact humain.
Symétriquement, en haut de la hiérarchie sociale, des gens très qualifiés peuvent entretenir un rapport de complémentarité très forte avec le numérique. Ainsi, on peut faire l'expérience du nombre considérable de messages et d'instructions envoyés depuis un taxi. Joseph Stiglitz prenait d'ailleurs l'exemple du courrier électronique, qui démultiplie la productivité de celui qui envoie le message sans augmenter celle du lecteur ; plus on est haut dans l'échelle sociale, plus on envoie de messages, mais plus on est bas, plus on reçoit d'instructions, alors qu'il n'y a pas de technologie pour les lire à notre place.
Cela fournit une explication simple et directe au fait que, aux États-Unis, c'est le haut de la distribution qui profite plus que proportionnellement de ces technologies numériques. Selon cette analyse, c'est plutôt le milieu de la distribution qui pâtit du numérique, d'où un affaissement de la classe moyenne. Pour le dire de manière caricaturale, il y a beaucoup d'argent en haut, un effacement du milieu et beaucoup d'emplois en bas, mais celui-ci ne profite pas de gains de pouvoir d'achat.
Le bas de la distribution sociale subsiste non parce que le numérique le rend plus productif mais parce qu'il n'est pas affecté par lui. Il ne profite donc pas, à la différence du travailleur à la chaîne, des nouvelles technologies.
Aussi, si l'on adopte cette grille travail routinier-travail non routinier, on peut constater que la menace jaillit de partout. On n'est jamais à l'abri d'une numérisation, y compris les traders remplacés par des logiciels de haute fréquence. C'est peut-être pourquoi il y a un consensus de droite et de gauche pour trouver des formules couvrant les gens en situation d'incertitude, à la place du vieux débat sur l'augmentation de l'efficacité de l'assistanat vers les personnes non qualifiées. L'assise de ce débat est à la proportion de la menace que le numérique fait peser.
Dans ce contexte, il faut penser une nouvelle sécurité sociale professionnelle, pour traiter les questions que cette incertitude nouvelle pesant sur le travail est en train de provoquer.
Avant d'aborder à proprement parler le revenu de base, il faut être au clair sur l'objectif de ce mécanisme. Ce mécanisme ne doit pas, selon moi, constituer une alternative aux dispositifs existants, il ne s'agit pas de donner 700 euros pour solde de tout compte. Ce dispositif s'ajouterait aux mécanismes existants visant à aider les plus démunis. Il ne doit pas dispenser la société de réfléchir au fonctionnement des dispositifs actuels.
Il faut ainsi réfléchir aux politiques actives comme celles des pays scandinaves pour former, requalifier, aider les chômeurs qui peinent à retrouver un emploi ; une allocation monétaire ne peut certainement pas se substituer aux efforts à développer pour les qualifier.
Je suis attaché également à l'épanouissement de la démocratie sociale, pour que les ajustements des entreprises respectent le destin professionnel des personnes. Ce mécanisme ne doit donc en aucune manière se substituer aux dispositifs existants, qui doivent eux-mêmes être largement améliorés.
Néanmoins, l'idée d'un socle de droits transférables lié à l'individu plutôt qu'à l'emploi, défendue par Alain Supiot avec ses « droits de tirage sociaux » et que l'on retrouve dans le compte personnel d'activité du projet de loi Travail, doit aussi avoir sa place. Quel que soit l'attachement de chacun à la démocratie sociale, on doit reconnaître que la tendance du capitalisme contemporain consiste, dans une certaine mesure, à créer des entreprises sans usine et des usines sans travailleur, c'est-à-dire à favoriser l'externalisation, l'« ubérisation » indiscutable des tâches, même si ce mouvement reste à mon avis minoritaire.
En effet, sur ce sujet, il faut tout de même garder raison ; je me souviens que, voilà quelques années, on voyait le télétravail comme l'avenir du travail mais cela ne s'est pas du tout produit, parce que travailler signifie aussi évoluer dans un collectif ; on veut aussi travailler pour satisfaire un besoin de sociabilité. Je ne crois donc pas que l'« ubérisation » soit l'avenir du travail ; cela dit, cette réalité existe pour beaucoup de personnes.
À l'intersection de ces deux sujets - l'incertitude nouvelle sur le monde du travail et le besoin d'une réflexion centrée sur l'individu autant que sur l'emploi - repose le besoin d'une réflexion sur le revenu universel.
Dans ce contexte, passons à la question centrale, celle du chiffrage, car tous ces jolis principes sont intéressants mais, si l'on n'atterrit pas dans le domaine des finances publiques, votre mission d'information ne servirait à rien sinon à nourrir le travail des philosophes du XXIe siècle.
Je vais vous faire une proposition peu coûteuse - 1 milliard d'euros -, mais auparavant, je souhaite vous présenter mon schéma idéal, qui consisterait en l'individualisation des droits et de l'impôt, couplée au prélèvement à la source, pour faire advenir le système d'impôt négatif de Friedman. Dans ce schéma idyllique, on saurait chaque mois combien gagne chacun et l'on pourrait calculer les droits sociaux lui échéant, en s'assurant qu'on ne gagne jamais moins de, par exemple, 700 euros.
Un tel mécanisme est possible, mais il suppose une réflexion profonde sur notre fiscalité, notamment sur l'individualisation de l'impôt, parce que c'est moins la justice sociale qui est en jeu que la question du rapport de chacun au travail. Le travail est aujourd'hui plus éphémère, plus difficile, plus précaire et c'est la complémentarité entre le système de protection sociale et le rapport au travail qui est indispensable. L'individualisation est la bonne façon d'entrer dans le débat, car une personne exclue du travail, mais ne touchant aucune aide parce que son conjoint touche beaucoup d'argent subit une injustice - on touche d'ailleurs ici à l'égalité entre hommes et femmes et à l'asymétrie de notre système.
Voilà le schéma idéal, qu'il faudrait désormais chiffrer. Je porte à ce sujet une pétition devant vous : il conviendrait de permettre aux chercheurs de disposer des données nécessaires pour évaluer les modalités de telle ou telle réforme. La loi pour une République numérique permettra en principe aux chercheurs de disposer des données de la Caisse nationale des allocations familiales mais on attend les décrets d'application et il y a urgence, car on voudrait publier des éléments chiffrés et précis d'ici à janvier ou février 2017.
En attendant la remise à plat de l'ensemble de la fiscalité française, qui n'est manifestement pas à l'ordre du jour, je vous propose ma formule à 1 milliard d'euros. Cette formule se fonde sur une étude de chercheurs de l'École d'économie de Paris, que j'ai eu l'honneur d'éditer. Il s'agit d'une proposition de réforme simple, mais radicale de l'aide personnelle au logement, l'APL, que je propose de fusionner avec le revenu de solidarité active, le RSA. Le rapport de Christophe Sirugue - beaucoup d'entre vous doivent l'avoir lu - fait beaucoup de propositions, mais celle-là n'y figure pas. Or je pense que c'est la plus intéressante.
Je vais brièvement exposer les conclusions de cette étude d'Antoine Bozio, Gabrielle Fack et Julien Grenet, chercheurs de l'École d'économie de Paris et associés à l'Institut des politiques publiques.
L'APL coûte très cher, environ 18 milliards d'euros par an, et elle a des effets inflationnistes considérables. Les logeurs intègrent en effet l'APL et proposent un loyer correspondant à l'APL auquel ils ajoutent un complément. Ainsi, dans 80 % des cas, l'APL est en réalité forfaitaire ; elle est supposée aider à se loger, mais elle est en réalité au plafond et elle fonctionne de facto comme une prestation forfaitaire et non comme une façon d'aider à payer une part du loyer.
Cette étude propose plusieurs choses intéressantes, mais celle qui me semble la plus intéressante et la plus prometteuse consiste à fusionner le RSA et l'APL. Les auteurs ont exclu du champ de la mesure ceux qui ne sont pas éligibles au RSA, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 25 ans, qui conservent l'APL dans sa forme actuelle, et les personnes âgées, qui bénéficient du minimum vieillesse.
Il s'agit donc d'une mesure touchant les personnes de 25 à 65 ans, pour qui les ressources de l'APL et du RSA sont maintenues à l'identique - cela n'entraîne aucun coût additionnel - mais sont redistribuées sous la forme d'une dotation forfaitaire et d'un impôt au premier euro gagné. Cet impôt repose sur un taux de 32 %, ce qui est un peu inférieur à l'impôt actuellement applicable aux allocataires du RSA, fixé à 38 % du revenu touché. En cumulant les deux, on obtiendrait un revenu de 624 euros.
Pour résumer, cela signifie qu'on est aujourd'hui capable, à coût constant, de donner à une personne seule 624 euros dont on défalque 32 % du revenu touché par ailleurs, jusqu'à un plafond de 1 950 euros. Cette mesure ne coûte donc rien.
Cela dit, le système actuel pose problème : le RSA provoque une asymétrie entre deux personnes seules et un couple. Parmi les 2,6 millions de bénéficiaires du RSA, il y a 450 000 couples. La décision d'attribuer à un couple deux fois l'allocation d'une personne seule coûterait 1 milliard d'euros de plus.
Pour résumer, je propose d'une part une allocation de 624 euros par tête dont on défalque 32 % du revenu et, d'autre part, l'application de ce principe une fois pour une personne et deux pour deux personnes. On garde par ailleurs tous les autres mécanismes du RSA, notamment la majoration de 30 % par enfant. Cette proposition coûterait 1,1 milliard d'euros, tandis que la première, sans l'individualisation, est à budget constant. Selon moi, c'est faisable et cela vaut le coup.
Au-delà, si l'on souhaite que cette mesure couvre aussi les jeunes de 18 à 25 ans, cela coûterait 4 milliards d'euros supplémentaires. Ainsi, pour 5 milliards d'euros, on a quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce que vous cherchez, et cela ne coûte pas 500 milliards, mais 5 milliards d'euros !
Si vous me le permettez, je propose que vous y alliez lentement et que vous mettiez en place cette réforme à coût constant, ou éventuellement pour un coût de 1 milliard d'euros si l'on aligne le traitement des couples sur celui des personnes seules.
J'ajoute que le montant de 624 euros correspond à l'allocation des personnes vivant en zone 3, où le loyer est le plus faible. En effet, une proposition de l'étude consiste à différencier le revenu en fonction des lieux de résidence ; trois zones sont ainsi définies, la zone 1 étant la plus chère et la zone 3, la moins chère. Ce montant de 624 euros correspondrait donc au minimum minimorum auquel auraient droit les personnes seules vivant dans les régions où le niveau de loyer est le plus faible. Une prime additionnelle serait attribuée dans les régions où le loyer est plus fort pour garder l'esprit de l'APL, qui vise à indexer l'allocation aux conditions d'habitation, un principe fondamental.
En quoi est-ce que cette formule individualisée diffère de revenu universel ? Les femmes qui vivent dans un foyer non éligible au RSA en raison de la situation de leur conjoint n'en bénéficieraient pas ; cela concerne environ 2,1 millions de femmes. Cela dit, pour mémoire, si l'on souhaitait les intégrer dans le dispositif, cela coûterait 10 à 15 milliards d'euros en sus.
Je propose de n'en pas parler pour l'instant parce que cela suffirait à tuer cette proposition, mais cela pourrait constituer l'étape suivante, qui pourrait être associée à une réforme en profondeur de la fiscalité et de l'individualisation. Ce débat de société n'aura probablement pas lieu pour la campagne de 2017, mais peut-être pour celle de 2022...
Je conclus en répétant que cette idée présente un grand intérêt compte tenu des évolutions de la société, et qu'elle a des partisans tant à droite qu'à gauche. Il existe une manière de rationaliser les dispositifs existants en France tout en contribuant à une plus grande justice sociale.
C'est à cela que je vous invite.

Merci beaucoup de cette contribution intéressante, qui replace le débat dans un contexte économique auquel on ne peut échapper, même si beaucoup d'incertitudes demeurent.
Nous avons entendu, dans le cadre de cette mission d'information, des propositions très utopiques ; vous demeurez, pour votre part, très réaliste dans vos propositions, ce qui est méritoire.
J'ai une question à vous poser. Vous proposez de fusionner l'APL et le RSA ; toutefois, certaines personnes touchent l'une mais pas l'autre.
Effectivement. On fusionnerait ces allocations représentant respectivement 18 et 10 milliards d'euros. Les bénéficiaires seraient potentiellement tous éligibles et, dans la formule à 1 milliard d'euros, de manière individuelle.
Aujourd'hui, 3 millions de personnes sont allocataires du RSA et 6 millions de personnes touchent l'APL. Le public potentiel serait donc de 6 millions de personnes, pour moitié les mêmes qu'aujourd'hui. Cela dit, 80 % des allocataires du RSA sont éligibles à l'APL. En outre, on ne commence qu'à 25 ans, donc cela concerne potentiellement des personnes sur le marché du travail.
Tout à fait, mais, bizarrement, son rapport ne mentionne pas du tout cette idée.

Il serait difficile de procéder à cette fusion en tenant à l'écart les jeunes de certains territoires.

On sait qu'un obstacle au travail des jeunes est le manque de mobilité, faute de ressources.
En effet, ils manquent de ressources pour se rendre à l'entretien, s'habiller, se loger. Donc cela constituerait l'étape suivante.
Néanmoins, il faut dissocier, me semble-t-il, les deux. Il ne faut pas annoncer une mesure à 5 milliards d'euros. Il faut présenter les choses en annonçant une mesure clefs en main, simple, à 1 milliard d'euros, qui ne change pas le cadre pour les 18-25 ans. Quand on veut trop faire, on ne fait rien.
Je préconiserais plutôt que l'on commence, à peu de frais, par mettre en oeuvre cette fusion, puis, quand elle sera faite, que l'on réfléchisse au coût additionnel de l'extension aux 18-25 ans. On peut avancer ainsi très vite vers une mesure utile.
J'ajoute que le RSA est pensé pour rendre le retour à l'emploi non dissuasif, mais, comme il n'est pas intégré à la prime pour l'emploi, le cumul des deux dispositifs est finalement dissuasif. Les simulations de cette étude montrent que la taxation du retour à l'emploi s'élève à 73 % pour un allocataire du RSA et de l'APL. Une personne qui retrouve un emploi rémunéré 100 ne touche donc en réalité qu'un surcroît de 27. C'est là une pathologie majeure.
Par ailleurs, je suis très attaché à l'individualisation des allocations. Il faut mettre fin à cette règle selon laquelle un couple égale une personne et demie.

Pour que les choses soient claires, monsieur le professeur, la fusion du RSA et de l'APL n'améliorerait pas la situation de l'allocataire à la fin du mois, n'est-ce pas ? Ce qui l'améliorerait, ce serait l'individualisation de l'allocation.
Vous proposez la fusion de ces mécanismes, mais l'élément fort de votre proposition réside dans l'individualisation. Aussi, toute chose égale par ailleurs, et sans remettre en cause l'intérêt de cette fusion, la simple individualisation du RSA coûterait 1 milliard d'euros, c'est bien cela ?
Clarifions bien les choses. La formule hors individualisation est un exercice à budget constant. C'est arithmétique : s'il est à budget constant, cela ne peut pas améliorer globalement la situation des personnes concernées. L'immense avantage de cette fusion à budget constant résiderait dans le fait de rendre claire, simple et unique la fiscalité implicite s'appliquant aux personnes en difficulté qui reprennent un emploi.
Dans le dispositif actuel, cette fiscalité peut être expropriatoire : une taxe de 73 % quand on reprend un emploi ne me paraît pas juste, indépendamment du fait que ce n'est pas très incitatif. Ce mécanisme serait plus simple et transparent. Cela représente donc un socle à budget constant à partir duquel on peut raisonner.
J'ai ainsi pris le parti opposé à celui des grandes règles de trois, qui aboutissent à quelques centaines de milliards d'euros, et au découragement ! J'ai fait le chemin inverse, parce que je tiens à ce que ces idées avancent : je suis parti d'une solution à coût 0, qui, par définition, n'améliore pas la situation des bénéficiaires, mais qui la rend plus simple.
Puis, j'ajoute des pièces : l'individualisation, qui augmente de 1 milliard d'euros le pouvoir d'achat des personnes concernées, et l'extension aux 18-25 ans.
Par conséquent, pour répondre à votre question, oui, c'était l'exercice auquel nos chercheurs se sont astreints, proposer une réforme à coût inchangé. Cela n'améliore donc pas globalement la situation des gens, mais il y aura forcément des gagnants et des perdants. L'individualisation permet de ne pas avoir trop de perdants.

Votre formule permet de lancer le débat de la protection sociale et de l'État providence, et de ne pas nous trouver face au mur de la dépense publique, que nous ne franchirions pas.

Je me permets d'ajouter que je ne crois pas trop à une réforme sans perdants, surtout à budget constant. Il en va de cette réforme comme de celle de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités territoriales...

Par comparaison avec le rapport Sirugue, qui a tout de même sensibilisé l'opinion à l'État providence, à sa cohérence et à sa simplification, ces chiffres permettent de lancer le débat sur le système de protection sociale en France, l'un des plus complets du monde.

Finalement, avec un montant de 624 euros par personne, et le double pour un couple, eu égard au montant moyen actuel de l'APL, un couple gagnerait à la mise en place de cette réforme.
Et un célibataire perdrait un peu. En effet, selon nos calculs, le célibataire qui touche toutes les prestations peut percevoir jusqu'à 720 euros par mois, donc il perdrait potentiellement un peu.
C'est pour cela que je souhaiterais disposer d'éléments empiriques plus fiables pour simuler en temps réel les différents revenus possibles et le coût global.
En attendant, en effet, une autre campagne électorale, car cela n'aura pas lieu en 2017, me semble-t-il.

Nous devrons organiser une audition avec les administrations concernées.

En effet, monsieur le président.Merci de votre passion, monsieur le professeur.
Je voulais vous convaincre que nous avons à notre disposition un mécanisme qui peut véritablement changer les choses.

L'expérimentation que j'envisage est peut-être une homéopathie nécessaire. Il y a des territoires où le chômage des jeunes atteint 46 % !
Je crois pour ma part, comme vous, que l'idée selon laquelle un revenu d'existence de cette nature dissuaderait de reprendre un emploi est fondamentalement fausse.

En ce sens, l'impôt de 32 % que vous suggériez est raisonnable.
Nous vous remercions, monsieur le professeur, de cette ouverture, qui ponctue bien nos auditions, lesquelles se sont toutes terminées sur des interrogations concernant les modalités concrètes.

On ne se pose plus la question du financement quand on parle de 1 milliard d'euros, et non plus de 600 milliards d'euros...
J'insiste une dernière fois sur la nécessité de publier le décret d'application de la loi pour une République numérique, car on sait que les données existent et on sait comment les utiliser.
La réunion est levée à 17 h 30.