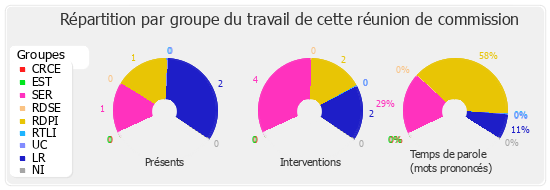Délégation sénatoriale aux outre-mer
Réunion du 24 mai 2018 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, dans le cadre de notre étude relative à la jeunesse des outre-mer et du sport, nous partons ce matin à Mayotte.
Nous avons dû différer cette visioconférence du fait des événements qui ont paralysé le département pendant plusieurs semaines, et nous nous félicitons qu'une situation apaisée soit désormais rétablie avec une feuille de route qui permette un véritable rattrapage et réponde aux espoirs suscités par la départementalisation.
À maints égards, qu'il s'agisse de politique éducative et de cohésion sociale, d'enjeux sanitaires ou de rayonnement des territoires, le sport, nous le savons tous, joue un rôle central. C'est ce qui a motivé notre choix de ce sujet d'étude pour lequel nous avons désigné un quatuor féminin de rapporteures afin de représenter les trois bassins océaniques ainsi que l'hexagone.
Sur ce quatuor féminin, deux des rapporteures sont à mes côtés, ici, à ma gauche, Viviane Malet qui est sénatrice de La Réunion, et à ma droite, Gisèle Jourda, qui est sénatrice de l'Aude. Deux des rapporteures sont absentes, Lana Tetuanui qui est actuellement en Polynésie puisqu'elle vient d'être réélue et qu'elle participait ces jours-ci au renouvellement des instances du gouvernement polynésien, et Catherine Conconne qui était en Martinique pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Nous avons ici présent le sénateur de Mayotte, vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi, et l'un des Sénateurs de Nouvelle-Calédonie, M. Gérard Poadja.
Nous adressons un salut particulier à Monsieur le président du conseil départemental - nous avons siégé longtemps sur les mêmes bancs du Sénat tous les deux - ainsi qu'à Monsieur le préfet Dominique Sorain, que vous représentez aujourd'hui Monsieur le sous-préfet. Nous vous remercions toutes et tous de vous être rendus disponibles pour cette visioconférence qui sera la dernière sur ce thème avec les territoires. Nous avons en effet parcouru tous les territoires et nous nous sommes rendus physiquement dans les Antilles et en Guyane il y a deux semaines.
Avant de vous céder la parole, je veux juste souligner qu'il y a peu nous avons entendu l'Association nationale des élus en charge du sport (ANDES), avec la présence du référent de Mayotte qui est intervenu, et nous avons auditionné hier toutes les instances nationales, c'est-à-dire le Comité national olympique et sportif (CNOS), mais aussi les présidents des fédérations sportives ; dans ces auditions nous évoquons la totalité des territoires et singulièrement le vôtre. Dans une heure et demie nous recevrons les ambassadeurs délégués à la coopération des trois zones océaniques, dont M. Luc Hallade pour l'océan Indien, ainsi que l'ambassadeur délégué pour le sport.
Je vais donc sans plus tarder vous passer la parole.
Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis Dominique Fossat, le sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse et je représente Dominique Sorain, le préfet de Mayotte, qui est empêché.
Je vous propose de vous donner tout d'abord quelques éléments sur le contexte mahorais, d'autant qu'ils ont été rappelés dans le plan pour l'avenir de Mayotte présenté par la ministre des outre-mer très récemment.
Le développement du sport à Mayotte s'inscrit dans un contexte particulier caractérisé par une évolution démographique très spécifique puisque la population mahoraise a augmenté de 20 % en l'espace de 5 ans et la natalité de 43 % depuis 2015. Mayotte a la plus importante maternité de France avec 10 000 naissances par an. Environ 50 % de la population a moins de 18 ans, ce qui est absolument remarquable et pose des questions importantes, tant en matière de scolarisation qu'en matière de pratique sportive notamment et de cohésion sociale. Il faut ajouter qu'un peu plus de 40 % de la population est étrangère, que le taux d'illettrisme est supérieur à 40 % et que 6 logements sur 10 sont dépourvus des éléments de confort minimum, que ce soit l'eau courante, des sanitaires de base, toilettes et lavabos, etc... Le taux de chômage est également le plus élevé de France et 84 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Mayotte a ainsi à faire face à des difficultés considérables en termes de développement économique et social et, dans ce contexte, eu égard à l'importance de la jeunesse, le sport peut et doit jouer un rôle essentiel.
Les infrastructures en matière sportive sont pour l'instant relativement frustes, voire indigentes ; le taux d'équipements sportifs à Mayotte doit être le plus faible de France avec moins de 15 équipements pour 10 000 habitants. Je parle sous le contrôle de ma camarade de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) : je crois que la moyenne nationale est de 50 pour 10 000 habitants. Les équipements sont pour l'instant relativement embryonnaires, avec seulement deux gymnases couverts, une dizaine de stades qui comportent des gradins ou des vestiaires mais aucun avec ces deux types d'équipements. Par ailleurs, on a une multitude de petits plateaux sportifs au sein des villages mais ils sont vétustes. Il faudrait donc à la fois augmenter le nombre de plateaux et réhabiliter l'existant.
Mayotte est une île et il y a pourtant un gros problème de pratique de la natation car il n'y a pas de piscine. L'apprentissage de la natation passe donc par le développement soit de piscines classiques, soit éventuellement de piscine lagunaire.
Concernant le financement de ces équipements, plusieurs ressources d'État sont mobilisées, les crédits du Centre national pour le développement du sport (CNDS) naturellement mais également, en complément, ceux du fonds exceptionnel d'investissement (FEI) du ministère des outre-mer ainsi que ceux du contrat de plan État-région. À titre d'exemple, en 2017, 4 millions d'euros d'investissement ont été financés par l'État pour les équipements sportifs, compte non tenu des crédits de l'éducation nationale qui mène cependant une politique très dynamique d'investissement public sur les infrastructures scolaires. L'éducation nationale, dans le cadre de la construction des lycées et des collèges, est un pourvoyeur majeur d'infrastructures sportives et finance notamment les grosses infrastructures sportives : je pense à celles de Koungou ou à certains plateaux sportifs importants qui sont en train de se mettre en place dans le département.
Les priorités de l'État sont le rattrapage en termes d'équipements bien sûr, mais aussi le sport pour tous et l'égalité homme-femme dans la pratique sportive, le sport-santé. Compte tenu des indicateurs socio-économiques indiqués précédemment, c'est également l'insertion par le sport et la pratique du sport pour lutter contre le désoeuvrement et prévenir la délinquance. Mayotte se singularise par le nombre très important de mineurs isolés, de mineurs non accompagnés : selon l'observatoire des mineurs non accompagnés, ils seraient entre 3 000 et 4 000, ce qui est énorme. Peut-être 300 se trouvent même sans référent adulte. De fait, une part non négligeable de jeunes n'est pas, peu ou mal scolarisée et, dans ces conditions, le sport joue un rôle très important pour assurer une présence, une animation sociale dans les zones les plus difficiles.
Enfin, j'ajouterai qu'une importance particulière est donnée au développement des sports nature. Mayotte a un vrai potentiel dans ce domaine-là, du fait de la présence d'un magnifique lagon, mais également les sports liés à la randonnée et à la course en pleine nature ; ces sports sont en plein développement et présentent un réel potentiel économique.
Voilà pour les axes principaux ; je pense qu'une attention importante doit également être donnée à la structuration de la gouvernance en matière sportive. Un travail important a été engagé en coordination avec le Département et le CROS sur la mise en place d'un schéma territorial de développement du sport : je crois que c'est un cadre indispensable qui permettra de donner des lignes directrices plus précises aux actions qui seront menées et la coordination des différents acteurs.

Merci pour ce tour d'horizon et cette présentation qui confirme les réalités dépeintes par vos sénateurs sur la situation du territoire. Je vous propose de continuer le tour de table.
Je représente le président du conseil départemental qui n'est pas sur le territoire aujourd'hui. Certes, nous souffrons d'un déficit d'équipements et le peu qui existe ne répond pas aux normes ; ainsi, beaucoup de jeunes préfèrent s'abstenir plutôt que de risquer de se blesser. Le Département travaille avec le mouvement sportif et les communes pour essayer de mettre aux normes ces équipements. Je laisse la parole aux représentants du mouvement sportif car ce sont eux qui vivent au quotidien avec les jeunes et doivent s'accommoder de ces équipements. Ils sont les mieux placés pour en parler.

Nous sommes heureux de pouvoir entendre à la fois des représentants de l'État, du Département, des communes et du mouvement sportif car vos témoignages sont complémentaires.
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, j'ai tendance à dire que si l'on veut améliorer la situation du sport à Mayotte, il faut partir d'un constat. Élu depuis 2001, celui que je fais se caractérise par une certaine régression. En effet, lorsque j'étais président du conseil départemental, nous avions fait venir à Mayotte l'équipe de France qui a gagné la coupe du monde avec Zidane et Djorkaeff. Il y avait alors des équipements qui permettaient de pratiquer le football et ils ont fait un match à Kavani. Je ne comprends pas que nous ayons également construit un stade à Chiconi, qui aujourd'hui se retrouve délabré. La coupe de France se jouait à Mayotte et les réunionnais venaient jouer ici ; on avait donné aux jeunes mahorais envie de progresser. De ce fait, des jeunes se faisaient remarquer par des recruteurs. Mais depuis 2008, les équipements qui étaient aux normes sont tombés presque en ruines et nous devons repartir de zéro. Je pense qu'il faut désormais éviter le saupoudrage financier et raisonner en termes d'intercommunalité plutôt que de mener la réflexion dans le cadre de chaque village. Cela permettrait de créer davantage de cohésion sociale. La ministre des outre-mer a annoncé pour Mayotte, dès cette année, 4 millions d'euros pour des réalisations et 40 000 euros pour effectuer des études, sommes qu'il faudra faire fructifier.

La question de la mutualisation des moyens est revenue dans toutes les auditions que nous avons menées et c'est vrai que l'échelle de l'intercommunalité est celle qui revient le plus souvent. Cependant, si l'échelon intercommunal peut être pertinent, il n'est pas adapté à tous les territoires ; il faut notamment tenir compte du besoin de proximité permettant à chaque commune de fédérer sa population, en particulier sa jeunesse, ainsi que des difficultés de déplacement.
Je suis chargé spécialement de la professionnalisation. La politique du CROS s'articule autour de 5 domaines, dont le sport-santé bien-être, l'éducation et la citoyenneté, la professionnalisation et aussi les politiques publiques, auxquels on peut ajouter les jeux des îles de l'océan Indien. Notre priorité est la mise en place d'installations sportives dignes de ce nom parce qu'aucune n'est aux normes. Ici quand on parle d'un stade, c'est un terrain de football et s'il y a le confort c'est qu'il est entouré d'un grillage, voilà tout.
Pour le mouvement sportif, la priorité est la mise en place d'installations dignes de ce nom, l'encadrement professionnel et des dirigeants compétents. Mais sans infrastructures, il est difficile d'avoir des formations de qualité ou un suivi médical ; aujourd'hui Mayotte s'apparente effectivement à un désert médical. Par exemple, sur les 300 arbitres du championnat de football qui vient de commencer, une centaine seulement a pu effectuer les visites médicales adéquates ; les 200 autres sont en attente de rendez-vous. Le défaut d'infrastructures et l'absence de conformité aux normes de celles qui existent complexifient également l'organisation du sport féminin et de nombreux jeunes ne peuvent accéder aux sports qu'ils souhaiteraient pratiquer car ils ne font pas partie de l'offre mahoraise. Notamment, il n'existe pas de piscine alors que l'apprentissage de la natation devrait être obligatoire, a fortiori sur une île. Il n'y a pas non plus de stade d'athlétisme. Si sont proposés des sports de combat, des arts martiaux, il n'y a pas de dojo et ces disciplines se pratiquent dans la nature, c'est vraiment la « débrouille ».
Le mouvement sportif, au-delà du sport de performance, veut oeuvrer en faveur de la santé et de la cohésion sociale, mais aussi pour le développement du tourisme via les sports de nature permettant de découvrir notre merveilleuse île de Mayotte. Ce sont les grands axes du mouvement sportif. Il faut cependant commencer par restaurer les infrastructures car aucune, même les stades, n'est aux normes et les fédérations donnent des dérogations pour la pratique des différents sports. Rien n'est aux normes, que ce soit pour la sécurité ou même l'hygiène. Et concernant les moyens, les années qui passent s'accompagnent de la réduction des dotations qui sont très insuffisantes. Les financements du CNDS sont fléchés en fonction d'axes prioritaires définis pour l'hexagone et notre situation est en total décalage. Nous avons le sentiment que le délabrement de la situation mahoraise reste méconnu au niveau national. Il est également plus difficile pour nous d'émarger aux subventions du CNDS car nos collectivités n'ont pas vraiment les moyens de contribuer au financement des projets. Il faudrait que le mouvement sportif à Mayotte puisse bénéficier de modalités spécifiques et dérogatoires. Les communes ont des liens plus étroits avec les associations et les clubs qu'avec le CROS lui-même. Si les relations avec l'État, notamment le CNDS, sont bonnes et même très bonnes, en revanche, s'agissant des compétitions comme les Jeux des îles des jeunes de l'océan Indien, nous avons le sentiment d'une incompréhension lorsqu'on nous refuse la possibilité de s'afficher en tant que sportifs mahorais. Nous aspirons à ce que cette question soit réglée une fois pour toutes au plan politique car le sujet est récurrent. Nous observons que les autres départements, notamment aux Antilles avec la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), participent aux compétitions régionales sous la bannière nationale sans que cela pose de problème.

Cette difficulté de représentation éprouvée par Mayotte aux Jeux de l'océan Indien est-elle exclusivement le fait de l'État, duquel dépend l'autorisation d'arborer le drapeau français, ou résulte-t-elle des territoires organisateurs ? À quel niveau se situe le blocage ?
Le problème est celui des relations entre la France et les Comores. Quand nous participons à des compétitions de clubs de l'océan Indien, en football, basket ou encore en volley, le problème du drapeau se pose chaque fois que les Comores sont représentées, sinon il n'y a pas de problème lorsque seules sont en lice La Réunion, Mayotte, Maurice et Madagascar. Il faut que cette question soit réglée au niveau étatique.

Pouvez-vous participer à la coupe de France de football et à quel moment de la compétition ?
L'entrée dans la compétition se fait au 7e tour mais, en l'absence d'installations aux normes, nous ne recevons plus les rencontres. En basket, handball et volley, Mayotte participe au championnat de nationale 3, mais pas en football pour le moment. En basket, on reçoit nos amis réunionnais, mais grâce à des dérogations.
Concernant les installations sportives, il faudrait carrément lancer un plan Marshall, notamment pour que nos jeunes filles puissent pratiquer le sport dans des conditions convenables. Le suivi médical en particulier pose un vrai problème.
Concernant le sport de haut niveau, nous ne disposons ni des installations ni, à défaut de formation adaptée sur place, de l'encadrement professionnel ou de dirigeants compétents. Dans tous les départements ou régions existent un centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) ou un pôle espoirs pour amener les jeunes vers le haut niveau. Ici, nous n'avons rien. Nos amis réunionnais, dans certaines disciplines, accueillent nos jeunes mais à concurrence de deux maximum ce qui est pénalisant. Si l'on prend l'exemple en basket, les deux jeunes intégrés au pôle de La Réunion sont partis l'année suivante en métropole dans un centre de formation ; il y en a même une à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP).
L'accueil des compétitions pose aussi problème ; nous ne disposons pas des infrastructures pour accueillir plusieurs équipes et organiser un tournoi et l'hébergement hôtelier est trop onéreux. Il nous faudrait un centre de formation incluant une capacité d'hébergement. Le CROS a pour projet de créer un centre de formation d'apprentis (CFA) afin de proposer un brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport (BP JEPS). Il faudrait une action massive car la proportion de jeunes à Mayotte est très élevée puisque plus de la moitié de la population a moins de vingt ans.

Votre message sur la nécessité de mettre en place une structure dédiée pour permettre aux jeunes d'accéder au haut niveau est parfaitement clair. Comment procédez-vous à la détection des talents dans les différentes disciplines ? J'ai compris que le pôle espoirs dont vous dépendez est celui de La Réunion.
Je laisse la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale vous répondre.
Sur la question de la détection des talents, et comme le vice-président du CROS l'a rappelé, nous n'avons pas localement de structure dédiée à la performance et au sport de haut niveau, mais je tiens à préciser que cela fait tout de même partie de nos priorités d'action depuis de nombreuses années, ce qui nous pousse à être inventifs et innovants. Il nous faut adopter une vision pragmatique pour ouvrir aux jeunes mahorais d'aujourd'hui des filières et des passerelles vers les structures qui existent à La Réunion, qui dispose d'un CREPS et de pôles sur certaines disciplines, ou en métropole. Depuis cinq ans et demi, nous avons donc mis en place un dispositif ad hoc dénommé Jeunes talents mahorais (JTM), qui permet d'organiser annuellement des sélections à Mayotte dans diverses disciplines sur la base de critères qui dépassent le niveau local. Ce sont donc vraiment les meilleurs parmi les meilleurs qui sont retenus dans ces sélections. Cette année, nous avons ainsi 9 jeunes qui ont intégré ces pôles d'excellence. Pour les suivre dans leur parcours, la DJSCS a mis en place un dispositif original : un professeur de sport de l'État accompagne individuellement ces jeunes ; il est en contact permanent avec eux et les rencontre trois fois par an sur place dans leur organisme de formation. La fédération concernée s'associe parfois à ce suivi : une mission de la fédération de football s'est ainsi rendue récemment à La Réunion. Sur financement de l'État principalement au départ, cette action englobe également aujourd'hui la coopération du rectorat de La Réunion et celle du conseil départemental. Il est très important pour les jeunes ultramarins qui partent dans ces structures de bénéficier d'un accompagnement individualisé. Depuis deux ans et demi, nous réfléchissons avec le vice-rectorat et les collectivités de Mayotte à développer des sections sportives à horaires aménagés dans des établissements scolaires et cela a d'ores et déjà démarré à Passamaïnty. Ces classes sportives ont vocation à développer un vivier et la jeunesse mahoraise présente des qualités sportives spécifiques, ce qui est très encourageant. Il y a un fort enjeu de coordination entre le sport scolaire et l'activité fédérale avec un développement des parcours entre Mayotte, La Réunion et la métropole et l'accompagnement nécessaire corrélatif pour soutenir les jeunes qui doivent faire face à des difficultés nombreuses. Je pense notamment à la question de la séparation avec la famille et à celle du niveau scolaire - puisqu'on exige des sportifs de haut niveau un excellent niveau scolaire.
En ce qui concerne les moyens financiers, l'enveloppe territoriale du Centre national pour le développement du sport (CNDS), est effectivement en baisse en 2018, pour la première fois. Depuis la création de la DJSCS, on était plutôt sur une pente ascendante avec des augmentations conséquentes d'année en année, qui nous ont amenés ces deux dernières années à plus d'1,1 million d'euros. En 2018, dans un contexte national de reconfiguration du CNDS, il y a eu une baisse pour toutes les régions ; il est vrai que nous espérions échapper à ce reflux. Sur les moyens de l'État, nous disposons de petites enveloppes des budgets opérationnels de programme (BOP) qui continuent de croître d'année en année et nous bénéficions, outre des moyens du ministère des sports et du soutien du ministère des outre-mer via le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), de l'apport du fonds d'échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) pour tout ce qui concerne la mobilité, soit 140 000 euros cette année.

Si j'ai bien compris le propos de M. le préfet tout à l'heure, le montant global des aides en provenance de l'État s'élève à environ 4 millions d'euros ?
Sur l'investissement.
Pour le fonctionnement, nous avons cette année une dotation du CNDS de 1 042 647 euros.
Un dernier point et je laisserai ensuite la parole aux ligues et comités qui, je pense, ont beaucoup de choses à dire. Sur la question difficile, pour nous également, des drapeaux et des hymnes, qui est récurrente, je souhaite apporter une précision en ce qui concerne la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien (CJSOI). Lors de la création de cette commission, Mayotte ne faisait pas partie des membres fondateurs et a adhéré par la suite à cette organisation de la Commission de l'Océan Indien (COI). Elle a été acceptée comme membre sans droit de vote, précision inscrite dans la charte de la CJSOI, ce qui implique de ne pas se prévaloir du drapeau ou de l'hymne national. C'est cette inscription dans les actes fondateurs qui est aujourd'hui bloquante : il y a eu des négociations diplomatiques pour tenter d'obtenir une modification de la charte, mais la France n'a pas eu gain de cause et, effectivement, cette question du drapeau a vraiment posé problème lors des derniers jeux à Madagascar. On s'est alors orienté vers une solution un peu différente : une délégation unique France-océan Indien pour Mayotte et La Réunion. Cette solution a été proposée mais n'a pas été retenue. Aux jeux de Djibouti, dont les jeunes de Mayotte reviennent à peine, tout s'est bien passé malgré ces difficultés d'ordre politique ; les valeurs du sport, de concorde et de fraternité, ont prévalu.

Avant de céder la parole aux délégués des comités, je voulais vous interroger sur la formation. Le représentant du CROS a évoqué la qualification professionnelle et le BP JEPS. Avez-vous un programme de formation d'éducateurs, d'animateurs ?
Je vous confirme que nous avons un axe de travail en ce sens. Il y a un travail de fond à réaliser avant d'obtenir un niveau d'encadrement normalisé de type BP JEPS. Les formations aux métiers du sport sont aujourd'hui portées par deux organismes, le CROS et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP), qui proposent tout un éventail de formations avec un certain nombre de certifications professionnelles, notamment un certificat de qualification professionnelle animateur de loisirs sportifs (CQP ALS). Cette formation est bien adaptée au territoire et débouche sur un bon taux d'insertion. On a aujourd'hui un accompagnement de nos services pour les habilitations et la coordination de ces structures porteuses. Sur le volet professionnalisation, le dispositif Sésame d'aide au mérite et à la mobilité internationale est déployé à Mayotte, pour des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires et qui sont accompagnés dans ces formations. Enfin, depuis quelques années, une association sports-loisirs s'est développée, qui propose de l'emploi sportif constituant des débouchés pour ces jeunes diplômés.

Avant de passer la parole aux représentants des ligues et comités, je demande à mes collègues rapporteures si elles n'ont pas de précisions à vous demander sur ce qui a été dit précédemment. Parce que je regarde la montre que je vois avancer et je veux leur donner la parole, que je mobilise un petit peu trop de ce côté de l'écran.

Je vous remercie pour vos présentations qui nous ont fait appréhender le sport à Mayotte et nous montrent bien la nécessité de mettre en place d'un plan Marshall, axé notamment sur les équipements et les grandes infrastructures sportives dont ont besoin les sportifs pour pouvoir pratiquer leur discipline et faire rayonner leur territoire. Vous avez parlé du sport-santé et du développement du sport dans les quartiers : je souhaite savoir s'il y a une réflexion sur les politiques d'installations sportives de proximité pour le sport de masse, pour intéresser les femmes au sport, ou encore pour pouvoir lutter contre la délinquance ? Quelles sont les priorités puisqu'il faut hiérarchiser les objectifs ? Y a-t-il un calendrier de mise en oeuvre du schéma du développement du sport ? L'intercommunalité peut-elle contribuer à régler la question de mise à niveau des infrastructures et comment en est-on arrivé à cet état de délabrement des équipements ?

Merci de toutes ces précisions. Vous organisez des formations avec le CROS, l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) et les associations sports-loisirs se développent ; je voulais savoir qui, pendant les vacances, porte les activités sportives dans les centres de loisirs ?

Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de cette rencontre qui a dû être plusieurs fois reportée du fait des événements sur notre territoire. Je remercie la délégation d'avoir insisté pour entendre la voix de Mayotte.
Le sujet est important et à l'instar de l'étude de la délégation sur le foncier, nous espérons qu'à la suite de l'excellent rapport qui sera rendu par mes collègues les préconisations émises pourront cheminer et parvenir à des solutions concrètes. Eu égard à la situation de Mayotte, l'idée d'un plan Marshall me paraît pertinente. Je retiens aussi la suggestion de mutualisation à l'échelon intercommunal des moyens développée par le président de l'association des maires ; cela mérite effectivement d'être soigneusement examiné car, même si notre île est petite, les questions de transport et de mobilité se posent de façon aiguë. Les relations entre les villages sont également complexes et ne doivent pas être sous-estimées.
Sur la question des Jeux au sein de l'océan Indien, il revient à l'État de trouver une solution pour mettre un terme à la frustration de nos jeunes sportifs. Il convient de souligner leurs performances plus qu'honorables au regard des faibles moyens mis à leur disposition, mais cette situation ne saurait perdurer. Le basket club de M'Tsapéré se trouve ainsi aujourd'hui en déplacement dans l'hexagone. Il ne faudrait pas décourager ces jeunes. La Réunion, notre cousine de l'océan Indien qui entretient des rapports privilégiés avec Maurice, doit aussi nous venir en aide et exercer une pression amicale pour obtenir gain de cause face aux Comores et qu'une solution pérenne et digne pour nos jeunes sportifs se dégage. Si nos amis Réunionnais ne jouaient pas ce jeu, je pourrais penser que c'est parce que nous emportons trop de victoires sur eux en ce moment et qu'ils veulent se débarrasser de compétiteurs sérieux !
Voici quelques éléments de réponse. S'agissant de la question de la cohérence qu'il doit y avoir entre un niveau de pratique sportive de compétition, qui suppose des infrastructures aux normes lourdes, et la pratique de proximité indispensable à la cohésion sociale et à la prévention de la délinquance pour lesquelles le sport joue un rôle majeur, il y a lieu de prioriser des infrastructures structurantes mais il faut aussi de petits plateaux sportifs de villages, soit l'équivalent d'un terrain de hand en termes de superficie dans la plupart des cas. On voit bien sur les opérations un peu emblématiques qui ont pu être menées dans les quartiers, comme à Kawéni souvent qualifié de plus grand bidonville de France mais qui fait preuve d'un vrai dynamisme, que le travail mené dans le cadre de la politique de la ville tourne souvent autour du plateau sportif, avec des associations bien structurées du type associations sports-loisirs qui interviennent auprès des jeunes et mobilisent efficacement.
Concernant l'idée d'une mutualisation des moyens dans un cadre intercommunal, si l'échelon paraît pertinent, il faut tenir compte du fait que l'intercommunalité est seulement émergente à Mayotte.
En dépit de l'importance de la population scolarisée à Mayotte, quelque 100 000 jeunes dans les primaire et secondaire sur une population de 260 000 habitants selon le dernier recensement de l'Insee, je crois qu'il y a seulement 10 000 pratiquants dans le cadre l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) alors que ce chiffre pourrait être largement supérieur. Cela s'explique largement par le problème des difficultés de déplacement des jeunes et de concentration géographique des structures scolaires et des équipements sportifs. Je viens d'ailleurs de tenir une réunion avec les services du Département et l'UNSS pour essayer de trouver des solutions.
Sur le volet de la gouvernance, le Département a engagé l'élaboration du schéma territorial et la ministre de l'outre-mer a annoncé un soutien en ingénierie spécifique évalué à 40 000 euros.
Si l'intercommunalité est effectivement nouvelle à Mayotte, l'observation de la façon dont elle s'est implantée ailleurs doit nous éviter de commettre certaines erreurs. Comme l'a rappelé le sénateur Thani Mohamed Soilihi, Mayotte se caractérise par l'importance des villages ; or, cette réalité engendre des rivalités qui débouchent parfois sur des rixes entre les jeunes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Et les difficultés de transport favorisent cette violence car les jeunes ne se connaissent pas. Il faut leur permettre de se fréquenter et de jouer ensemble ; pour cela, de petits équipements au niveau communal sont nécessaires. Le sport est un moyen de s'ouvrir à l'autre ; il est porteur des valeurs du vivre ensemble, les valeurs de tolérance, lesquelles ont tendance à s'étioler actuellement à Mayotte.
Seules des structures intercommunales nous permettront d'avancer sur la question des équipements sportifs et de transport pour emmener les enfants s'entraîner ensemble. Rien que dans ma commune, j'ai au moins 50 clubs : comment avoir la capacité de les aider à fonctionner ? C'est impossible et il faut se donner une capacité d'action par un maillage du territoire. Il faut que nous soyons inventifs et que nous devenions un modèle pour le traitement des banlieues. Le sur-mesure doit éviter de reproduire les erreurs commises ailleurs, c'est pourquoi votre démarche d'écoute des acteurs locaux me satisfait.

Je vous remercie pour la sagesse de votre propos et surtout d'avoir mis en évidence les valeurs qui sont véhiculées par le sport, éducatives, sociales, intégratrices... et surtout les valeurs humaines. Le moment est arrivé de passer la parole aux représentants des ligues et comités.
Je suis président du comité territorial de rugby de Mayotte et vice-président de la Fédération française de rugby en charge des outre-mer. J'ai donc une double casquette, locale et fédérale, et siège au bureau fédéral. M. Ahmada a dressé un panorama du sport à Mayotte, soulignant le manque d'infrastructures, de vestiaires sur les stades, le déficit en suivi médical, et je voudrais ajouter un point qui me paraît aussi important : la pratique d'un sport nécessite de rencontrer des locaux et de la région ; or, cela suppose pour nous des déplacements aériens, donc onéreux, d'autant que les rencontres ont souvent lieu pendant les vacances scolaires alors que les prix sont au plus haut. Nous sommes à la merci des compagnies aériennes. Une réflexion sur la problématique de la continuité territoriale pour les équipes sportives serait donc la bienvenue afin de faciliter les échanges. Sur un autre aspect, j'ajouterai que nos associations sportives, rugby ou autres, sont un facteur important de cohésion sociale et je tiens à souligner l'implication d'un grand nombre de bénévoles ; à une époque de budgets contraints, le bénévolat doit être valorisé plus qu'il ne l'est actuellement. Aider les structures animées par des bénévoles coûtera toujours moins cher que financer des structures professionnelles.
Je commencerai par la question des jeunes talents de Mayotte (JTM). Nous avons des relations difficiles avec la ligue de La Réunion, qui gère le CREPS. L'année dernière, le pôle espoir de La Réunion a refusé de prendre nos jeunes alors même que lors des compétitions les jeunes Mahorais ont souvent le dessus, ce qui suscite une certaine jalousie. Pour remédier à cette situation et faciliter la détection des jeunes talents, nous avons pensé à créer un centre de perfectionnement à Mayotte constituant un tremplin vers la métropole sans passer par La Réunion. Mais pour réaliser ce projet, il faut que notre ligue soit accompagnée localement.
Pour le reste, nous sommes confrontés à l'éternel problème du manque de structures et d'équipements. Rien qu'à Mamoudzou, la disponibilité du plateau est partagée entre cinq équipes, ce qui crée des conflits pour l'organisation des entraînements. La formation des cadres est également problématique : le formateur, conseiller technique sportif (CTS), est basé à La Réunion et il fait rarement le déplacement à Mayotte bien qu'il soit censé couvrir les deux territoires. Or, si l'on essaie de former nous-mêmes des cadres, la validation appartient au CTS.
Pour le développement de la pratique du basket, nous essayons de créer des écoles et de former des arbitres ; mais encore une fois les équipements font défaut ou sont délabrés. C'est vraiment dommage car il y a un véritable vivier de jeunes talents à Mayotte.

Avant de poursuivre, juste deux mots pour vous dire que la problématique du CREPS se retrouve aux Antilles : nous l'avons perçue lors de notre déplacement en Guadeloupe. En effet, le CREPS Antilles-Guyane, établi en Guadeloupe, accueille très peu de Martiniquais ou de Guyanais. Par ailleurs, concernant la formation des cadres, nous semblons malheureusement nous diriger, y compris dans l'hexagone, vers une réduction des effectifs de CTS et cela est préoccupant.
Je voudrais tout d'abord souligner que le football est le sport le plus répandu dans les outre-mer. Pour autant, les moyens disponibles restent médiocres et non conformes aux normes en vigueur, au point que la fédération n'a même pas classé les terrains qui sont de simples terrains de jeu et généralement pas clôturés. Il y a pourtant 12 000 licenciés, ce qui nous place au deuxième ou troisième rang des départements d'outre-mer, et nous disposons d'un répertoire informatisé. Nous avons près de 400 arbitres à Mayotte mais les difficultés, cette année, à obtenir les visites médicales nous contraignent à fonctionner avec seulement une centaine d'arbitres pour l'ensemble des matchs. On observe un mouvement de féminisation car on est passé de 300 licenciées à plus de 1 080 licenciées pour le recensement 2017, avec trois clubs à Mayotte labellisés par la Fédération française de football (FFF). Nous participons à la Coupe de France en entrant dans la compétition au 7e tour sur l'hexagone, à défaut de stade homologué à Mayotte. Depuis déjà quatre ans, nous ne pouvons plus recevoir de matchs officiels à Mayotte, faute d'infrastructures adéquates en termes de qualité et de normes. Malgré ces plus de 1 000 licenciées féminines, il n'y a aucun vestiaire pour elles, même pas de bloc sanitaire. À l'exception du stade de Kawéni actuellement en réfection, les stades ne sont pas pourvus de vestiaires. Du fait du grand nombre de licenciés, des matchs sont organisés jusque vers 17 à 18 heures, moment où la nuit tombe et les projecteurs, lorsqu'ils existent, procurent un piètre éclairage car ils sont beaucoup moins nombreux que pour un stade homologué.
J'en reviens à la sélection des jeunes talents : la direction du pôle de La Réunion en prélève deux par an à Mayotte pour se former pendant deux années au CREPS de La Réunion ; la prochaine sélection aura lieu les 9 et 10 juin. Mais ce n'est pas suffisant et il faudrait un centre doté de capacités d'hébergement à Mayotte même pour faciliter l'éclosion des jeunes talents et leur sélection autrement qu'en un ou deux jours, et développer le haut niveau.
Je représente ici le président, M. Issouf Mouhamadi, qui n'a pu venir. Un état des lieux complet a été déjà dressé par les précédents intervenants et j'ajouterai simplement quelques éléments concrets concernant le handball. On joue sur des plateaux où les limites du terrain sont simplement constituées par le grillage, sans zone de sécurité. Je ne reviens pas sur les problèmes de vestiaires, de points d'eau, car tout cela est commun à l'ensemble des disciplines. Il faudrait que nos collectivités locales soient accompagnées lorsqu'on met en place un plateau, et qu'on pense à installer des plateaux couverts conformes aux exigences fédérales. Actuellement, l'ordinateur qu'on utilise au bord du terrain est exposé à la pluie et il est difficile de faire jouer certains matchs. Il faudrait déjà couvrir l'existant pour protéger du soleil et des intempéries. Notre faiblesse au niveau des infrastructures nous fait perdre des licenciés chaque année, surtout dans le vivier féminin ; nous avons aujourd'hui environ 2 800 licenciées. Nous manquons de formateurs, d'éducateurs, en dépit de l'accompagnement du conseil départemental pour l'organisation des sélections. Malgré tout, le handball se porte bien à Mayotte et a rapporté des médailles aux Jeux des jeunes de l'océan Indien qui ont eu lieu à Djibouti. Si nos demandes étaient exaucées, nous pourrions sans doute avoir des Mahorais en sélection nationale.

Vous avez grand mérite à obtenir de tels résultats en pratiquant dans des conditions aussi minimalistes.

Je m'adresse au représentant de la ligue de rugby pour connaître le nombre de licenciés et s'il y a des équipes féminines.
En tout cas, on ne joue pas à 13 à Mayotte.
Actuellement, nous avons près de 600 licenciés, avec une grosse difficulté cette année, la nouvelle obligation d'effectuer un électrocardiogramme. Il y a actuellement deux équipes féminines à Mayotte. Le rugby pratiqué est un rugby de loisir. J'ajoute que nous pratiquons le rugby sur des terrains de foot ; nous souhaiterions bien sûr disposer d'au moins un véritable terrain de rugby.
J'aurais aimé répondre à l'étonnement exprimé par Madame la sénatrice de l'Aude concernant l'usure des équipements entre 2008 et aujourd'hui. Il faut voir que la population mahoraise comporte plus de 60 % de jeunes de moins de 20 ans et qu'il y a une sur-utilisation des équipements sportifs entre les scolaires, les équipes de quartiers et de villages, les épreuves de sélection ; en outre, les collectivités qui sont propriétaires de ces équipements ne parviennent pas à les entretenir car elles sont confrontées à des difficultés financières. Tout cela explique la difficulté d'avoir des équipements aux normes et adaptés à la pratique des différentes disciplines sportives.
Comme cela a déjà été exprimé, nous souhaiterions disposer à Mayotte d'un centre de formation, sans que ce soit nécessairement un CREPS, qui réponde aux besoins des clubs et des ligues pour développer le sport de haut niveau et organiser la formation des encadrants. Il nous faut un accompagnement des services de l'État pour avancer sur ce projet.

Je vous remercie pour ce témoignage ; sachez que nous sommes très heureux de vous avoir entendu ce matin. Il est très important pour nous d'écouter, de prendre la mesure des réalités qui sont les vôtres. Nous en livrerons un compte rendu fidèle pour relayer vos préoccupations. Nous sommes bien conscients que Mayotte est un jeune département aux difficultés bien spécifiques qui nécessitent l'aide des pouvoirs publics.
Monsieur le président, juste un dernier mot pour vous dire que lorsqu'on parle de Mayotte aujourd'hui c'est pour évoquer la violence et le phénomène migratoire. Il faut se souvenir que c'est le sport qui a contribué à pacifier l'Afrique du Sud, grâce au rugby. J'aspire à diffuser une image positive de Mayotte à travers les performances sportives et je vous invite à regarder le film « Invictus ».

Après nos échanges très riches avec les autorités institutionnelles et les acteurs du sport de Mayotte, nous souhaitions recevoir les ambassadeurs délégués à la coopération régionale des trois régions océaniques ainsi que l'ambassadeur délégué pour le sport. Bienvenue au Sénat ! Je dois cependant vous présenter les excuses de M. Bernard Nilam, retenu par une réunion franco-néerlandaise qui a eu lieu hier à Saint-Martin, ce qui ne lui a pas permis de rejoindre Paris à temps du fait du décalage horaire. Il se fait donc représenter aujourd'hui par M. Guillaume Lagrée, chef de la mission du droit européen et international à la direction générale des outre-mer (DGOM), accompagné de Mme Stéphanie Froger, référente sport à cette direction.
Je salue la présence de Messieurs les ambassadeurs Luc Hallade et Christian Lechervy que nous avons grand plaisir à retrouver car ils répondent toujours favorablement à nos sollicitations et ont en particulier prêté avec brio leur concours aux travaux de notre délégation lors des conférences économiques que nous avions organisées en 2015 pour le Pacifique et l'an passé pour l'océan Indien.
Je remercie enfin M. Philippe Vinogradoff d'avoir accepté de quitter prématurément, pour participer à l'audition de ce jour, les Jeux mondiaux du sport en entreprise qui se tiennent actuellement à La Baule.
Je suis entouré de deux de nos quatre rapporteures : Gisèle Jourda et Viviane Malet ; les deux autres rapporteures sont excusées : Catherine Conconne commémorait l'abolition de l'esclavage dans son département et Lana Tetuanui, qui vient d'être réélue, participe à la mise en place du nouveau gouvernement de son territoire.
Notre séance est consacrée au rôle joué par le sport comme facteur de rayonnement et d'insertion régionale des territoires, mais aussi aux enjeux diplomatiques liés au sport en matière de coopération ou à travers les compétitions. Le positionnement des outre-mer sur trois océans est également un atout lorsque les grandes compétitions internationales se déroulent loin de l'hexagone ; mais cet atout est-il suffisamment pris en compte ?
Merci de votre invitation. J'aurais eu beaucoup d'intérêt à écouter les responsables de Mayotte. Le sport est une des problématiques importantes pour l'insertion de cette île dans son environnement régional.
La coopération sportive régionale s'appuie sur deux manifestations : les Jeux des îles de l'océan Indien et les Jeux des jeunes de l'océan Indien, qui rassemblent les États ou territoires membres de la Commission de l'océan Indien - La Réunion, Mayotte, Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar - plus les Maldives pour les jeux des îles et Djibouti et pour les jeux des jeunes. Autres différences : les Jeux des jeunes sont organisés par une commission des jeux, tandis que les Jeux des îles le sont par les comités olympiques de chaque État ou territoire ; les Jeux des jeunes ont lieu tous les deux ans tandis que les Jeux des îles ont lieu tous les quatre ans.
Ces compétitions ont un coût non négligeable, du fait des distances. Le déplacement des sportifs eux-mêmes pose souvent problème. Concernant les infrastructures, la situation est différente selon les territoires ou pays. Cela avait suscité un débat pour les jeux de 2019 : les Comores étaient candidates à leur organisation, mais on a dû le leur refuser, faute d'infrastructures convenables ; les Comoriens, vexés, ont été jusqu'à dire : « vous n'avez qu'à décider une fois pour toutes d'organiser les jeux alternativement à Maurice et à La Réunion ! »
L'autre problème est la participation des athlètes mahorais. J'ai vécu ce drame lors des jeux de 2015 à La Réunion - le préfet Dominique Sorain l'a aussi vécu dans la douleur...
Vous me connaissez, je ne suis pas adepte de la langue de bois diplomatique. Manuel Valls, alors Premier ministre, s'était rendu à Mayotte et avait pris l'engagement que Mayotte participerait sous le drapeau français aux jeux des îles. Du point de vue mahorais, cela va de soi - sauf que les chartes des jeux prévoient que Mayotte défile sous le drapeau des jeux ; cet arrangement avait été trouvé initialement afin que les Comores acceptent la participation de Mayotte. Or, cette charte n'a pas été modifiée et l'engagement pris envers les Mahorais l'avait été sans concertation internationale préalable. Quand le défilé a eu lieu, la délégation comorienne s'est retirée. Les autres ont hésité et après des négociations compliquées, ils ont accepté de rester. Quant aux athlètes comoriens, une cinquantaine d'entre eux en ont profité pour rester sur le territoire de La Réunion - un grand classique...
Nous avons essayé de faire modifier la charte des jeux, mais sans succès, nous heurtant à une réticence très forte des États membres - moins les Comores que les autres, paradoxalement. Le problème s'est posé à nouveau aux jeux des jeunes qui se sont tenus récemment à Djibouti. Après moult discussions, les Mahorais ont accepté de se conformer au règlement. Cela a été moins compliqué car le drapeau des jeux des jeunes est plus utilisé que celui des jeux des îles.
Nous avions proposé - ce que les Comoriens semblaient accepter - de faire une seule délégation française rassemblant Réunionnais et Mahorais. Cela a d'abord été refusé par les deux départements ; puis les Réunionnais ont accepté, mais les Mahorais ont continué à s'y opposer de façon catégorique, préférant défiler sous le drapeau des jeux des jeunes. Cette difficulté est forte et récurrente. Bien d'autres États sont composés de plusieurs îles et n'ont pourtant qu'une seule délégation. Ils se demandent pourquoi les Français n'y parviennent pas. Nous aurons ce problème pour les jeux des îles l'année prochaine.
Les fédérations sportives, les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont d'accord. Ce sont les politiques qui bloquent, et peut-être les opinions publiques... Je crains qu'avec la meilleure volonté du monde, on ne parvienne jamais à faire modifier les chartes et cette solution d'une seule équipe serait plus facilement atteignable. Nous ne sommes pas dans une période particulièrement favorable ces dernières semaines, avec la crise bilatérale forte entre les Comores et la France à propos des Comoriens séjournant irrégulièrement en France.
Je souhaiterais partager avec vous trois idées forces sur ces sujets : d'abord, ce n'est pas en imposant nos propres règles ou décisions qu'on trouvera une solution, mais en négociant. On ne peut pas forcer les choses, cela provoque des réactions épidermiques des autres pays. Ensuite, c'est à nous de proposer de manière concertée des solutions. C'est notre problème, car les autres se satisfont de la solution actuelle. Enfin, la solidarité et la complémentarité ultramarine devraient toujours être recherchées ; or elles n'ont pas été au rendez-vous.

Merci pour votre franchise. Rassurez-vous : la situation dans la Caraïbe est également délicate car la Guadeloupe et la Martinique veulent elles aussi participer aux jeux avec chacune une délégation...
Merci de votre invitation, qui vient à un moment où l'on peut s'interroger sur l'émergence d'une diplomatie sportive océanienne des territoires français du Pacifique. Les événements sportifs font vibrer les sociétés, galvanisent les fiertés nationales, remplissent les hôtels et marquent les mémoires des participants. Le sport constitue un élément du rayonnement international et océanien de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et du Territoire des îles Wallis et Futuna. Il s'exprime dans des enceintes multilatérales et à l'occasion d'événements intra-régionaux - notamment mélanésiens - océaniens, ou au niveau de l'Asie-Pacifique ou du monde. Il est le fruit des politiques de chaque territoire, des soutiens récurrents de l'État et des mouvements sportifs nationaux ou internationaux.
Dès la fin des années 1950, les puissances tutélaires du Pacifique insulaire ont estimé que le sport pouvait être une voie de rapprochement entre les peuples océaniens et de leur politique de développement. Afin de développer les échanges et les infrastructures sportives du Pacifique, la Communauté du Pacifique, dont le siège est à Nouméa depuis 1947, décida d'instaurer des Jeux du Pacifique sud. Ils devinrent une réalité en 1963 à Fidji. Cette initiative portée par l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la France se tint pour la première fois alors qu'aucun des douze territoires concourant n'étaient encore indépendant.
À mesure que les États océaniens sont devenus indépendants dans la deuxième moitié du XXe siècle, les puissances tutélaires se sont retirées de l'espace des compétitions sportives. Celles-ci sont donc orchestrées selon les règles des États indépendants, y compris pour les territoires non souverains. Les délégations ont commencé à défiler derrière leurs drapeaux et à entonner leurs hymnes. Une affirmation nationale qui s'est imposée également aux territoires non souverains. Si les délégations néocalédoniennes défilent avec le drapeau français, l'hymne joué est « Soyons unis, devenons frères ». De même, la Polynésie française dispose de son drapeau et de son hymne propre, « Ia ora 'o Tahiti Nui ».
Depuis un demi-siècle, l'intégration régionale est incarnée par les Jeux du Pacifique. S'ils se sont succédé dans un premier temps à un rythme irrégulier, ils sont disputés depuis les Jeux de Papeete de 1971 sur un rythme quadriennal. D'abord connus sous le nom de Jeux du Pacifique sud, ils sont devenus depuis 2011 à Nouméa les Jeux du Pacifique. Ce changement de dénomination traduit aussi une lente reconfiguration géopolitique du Pacifique. Aujourd'hui, ce sont 22 États et territoires qui sont autorisés à participer à l'ensemble des épreuves.
À ce régionalisme océanien sont venus s'ajouter des événements ordonnancés au nom des micro-régionalismes. Les distances l'obligent mais aussi les identités politiques. Le Groupe du fer de lance mélanésien (GFLM) - qui a la caractéristique de compter dans ses membres un parti, le Front de libération nationale Kanak et socialiste (FLNKS), ce qui ne simplifie par les choses - a décidé en 2011 de coordonner les politiques sportives de ses membres, d'organiser des jeux mélanésiens et d'inscrire le sport dans sa politique de long terme, le plan de prospérité pour 2038. Les leaders voient dans les pratiques sportives un facteur d'unification communautaire, pour ne pas dire ethno-politique.
Ils le déclinent à travers des compétitions mais aussi par des instruments administratifs comme une charte des jeux de la Mélanésie, à laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été associé. Mais ces ambitions peinent à prendre corps, tout comme les compétitions. Se pose notamment la question de la participation de la partie occidentale de la Papouasie occidentale, sous souveraineté indonésienne.
Une intégration sous-régionale fonctionne : les jeux micronésiens ou MicroGames, qui se tiennent depuis 1969 et sur une base quadriennale depuis 1990. Ils rassemblent des délégations d'États souverains comme Kiribati, Marshall, Nauru, Palaos, des territoires rattachés aux États-Unis comme Guam ou les Mariannes du Nord, mais aussi des athlètes concourant non pas au nom de leur pays mais des territoires constitutifs de celui-ci comme Chuuk, Pohnpei, Kosrae et Yap pour les États fédérés de Micronésie.
On notera par ailleurs que la géographie « compétitive » ainsi esquissée n'est pas juxtaposée à celle des institutions politiques micronésiennes. Non seulement les compétitions se multiplient, mais aussi les épreuves avec l'introduction de compétitions identitaires, qui valorisent les savoirs traditionnels comme aux MicroGames les jeux all around, comprenant la montée de cocotier, le décorticage de noix de coco, le jet de lance sur noix de coco, la pêche sous-marine ou la plongée - souvent les plus populaires et les moins onéreuses puisqu'elles ne nécessitent pas d'infrastructures spécifiques.
Avec la multiplication des compétitions et des épreuves et les coûts liés aux distances, les États ont eu de plus en plus besoin de soutiens extérieurs sous la forme de dons ou de financements - générant de la dette. Ces aides externes proviennent généralement d'un tout petit nombre de pays, la Chine et Taïwan pour l'essentiel, et malheureusement sans beaucoup se soucier du futur des infrastructures installées, en termes d'entretien ou d'usage. En dépit de ces appuis, les États océaniens peinent à tenir leurs engagements et renoncent de plus en plus souvent devant les échéances ; ainsi les îles Marshall ont-elles renoncé aux MicroGames ou Tonga aux Jeux du Pacifique de 2019. Ces ajustements sont d'autant plus problématiques que des solutions alternatives « immédiates » n'existent pas nécessairement, y compris dans les pays et territoires les plus développés. En juillet 2017 en faisant savoir son refus de se substituer aux Tonga pour les jeux du Pacifique de 2019, la Polynésie française a rappelé que, pour se préparer pour un tel événement, il fallait de quatre à sept ans pour être aux normes ou construire de nouvelles installations - dans son cas, il s'agissait d'augmenter le nombre de couloirs d'athlétisme, de construire un nouveau stade de foot et de rénover une piscine olympique. Au-delà des défaillances d'États, il y a des défaillances sportives ; aux MicroGames, une compétition de voile fut annulée faute de compétiteurs suffisamment nombreux pour remplir le quota.
Si les États et territoires peinent à être des organisateurs fiables, ils ne veulent pas renoncer, même pour les plus petits d'entre eux, à accueillir ces événements. Depuis 1981 de nouvelles compétitions ont vu le jour, tels les Mini-jeux, qui sont disputés tous les quatre ans et permettent aux États et territoires les moins développés d'être des lieux d'accueil - comme Wallis-et-Futuna. Au-delà de la fierté légitime d'accueillir de tels événements, il ne faut pas sous-estimer leur impact macroéconomique : à Wallis-et-Futuna, le secteur de la construction a profité de l'organisation en 2011 des Mini-jeux, et sa crise correspond à la fin de ces jeux.
Les grands événements semblent confisqués par un petit nombre d'acteurs, parmi lesquels nos territoires : 60 % des Jeux du Pacifique ont été organisés par Fidji, la Papouasie Nouvelle Guinée et la Nouvelle-Calédonie. En 55 ans, 46,6 % des épreuves ont été organisées sur les sols américain et français. Une statistique que nous devons garder en mémoire puisque un tiers des jeux organisés jusqu'ici l'ont été en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Un poids d'autant plus prégnant que les territoires français sont de très gros pourvoyeurs de médailles avec 39,4 % des podiums - 27,3 % pour la Nouvelle-Calédonie, 10,1 % pour la Polynésie française et 2 % pour Wallis-et-Futuna. Une domination encore plus perceptible lors des Mini-jeux. Sur les dix occurrences, la Nouvelle-Calédonie a terminé trois fois 1ère, quatre fois 2e, deux fois 3e et la Polynésie française a été trois fois 2e et quatre fois 3e en neuf participations.
Cette domination des territoires français et américains interroge. Certains États se demandent s'il ne faudrait pas adapter les compétitions. L'emprise calédonienne sur les jeux a même été un argument des Îles Salomon pour acquérir les jeux en 2011. Il n'y aura pas de remise en cause formelle de la participation de la Nouvelle-Calédonie, mais des demandes d'adaptation, comme cela a été fait pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Exclus jusqu'en 2015 ils peuvent aujourd'hui concourir, mais seulement dans des disciplines où les autres nations sont aptes à se mesurer à elles : haltérophilie, rugby à sept, Taekwondo et voile.
Le sport est aussi facteur institutionnel d'intégration. Le monde du Pacifique est issu des décolonisations britannique et française, ce qui implique des pratiques différentes selon les cas : dans les anciennes colonies britanniques, c'est le rugby à treize qui est structurant, dans les anciennes colonies françaises, c'est le football. Il existe aussi des points de rencontre parfois étonnants, tel que la pratique, notamment féminine, du cricket en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Les États participent ainsi à d'autres événements intercontinentaux comme les jeux du Commonwealth ou ceux de la Francophonie - ce sera le cas pour la Nouvelle-Calédonie qui vient d'y adhérer - ce qui, compte tenu de la distance, a un coût bien plus élevé.
Cela conduit à s'interroger sur les modèles d'organisation des jeux. Les territoires peuvent vouloir se concentrer sur quelques événements mondiaux plus occasionnels, comme les championnats du monde de pétanque ou de pirogue polynésienne en Polynésie française, la coupe du monde de beach soccer à Tahiti en 2013 - d'autant plus que les Tikis ont été deux fois finalistes en 2015 et 2017 - ou une étape de la coupe du monde de kitesurf freestyle en Nouvelle-Calédonie en décembre 2016.
Concernant les processus purement politiques, les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française participent aux réunions des ministres des sports du Pacifique, qui permettent de parler des compétitions, mais aussi de lutte contre le dopage - il faudra se pencher sur l'adhésion de la France à l'organisation antidopage océanienne. Il faudrait encourager la coopération entre nos territoires, et faire participer les fédérations de nos territoires dans les fédérations régionales. Or, il y a très peu de fédérations océaniennes ou l'on trouve les trois territoires représentés.
Il ne faut pas oublier la dimension entrepreneuriale : de très petites entreprises fournissent des capacités pour les événements sportifs, non seulement pour les infrastructures, mais aussi par exemple en Polynésie Française pour la construction de pirogues de compétition exportables par voie aérienne à des prix compétitifs. Or même des compétitions d'essence polynésienne, comme le va'a, ont été très largement diffusées au-delà de cet espace. Les derniers championnats du monde à Papeete ont ainsi réuni des équipes d'État océaniens comme le Maroc ou la Turquie... Ces pratiques cherchent leur place dans les fédérations internationales - il y a un certain malaise avec la fédération de canoë-kayak, mais elles sont à la source d'un potentiel non négligeable d'exportation à partir de nos territoires.

Merci pour ce magnifique exposé qui m'interpelle personnellement. En 1963, la France s'est rendu compte qu'elle possédait deux îles au nord de la Guadeloupe qui risquaient de lui échapper, et a créé deux sous-préfectures.
Diplomate, vous nous avez éclairés sur les influences géopolitiques et économiques et les compétitions entre les pays. Lors de notre déplacement dans le Pacifique, notre délégation a été interpellée sur l'influence de la Chine et de Taïwan, qui s'impliquent dans le développement local. Les États-Unis sont revenus dans la région, la France a appris à y retourner, compte tenu de l'importance de la zone économique exclusive (ZEE) et de l'économie bleue.
La lutte antidopage relève de la sécurité, et donc de la compétence de l'État. Je centrerai mon propos sur la zone Antilles-Guyane, où la question primordiale des visas concerne aussi le sport. Conseiller en droit international, je fais le lien entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des outre-mer et les collectivités locales pour les politiques d'insertion régionale. Représentant de l'État, j'ai toujours le souci de la sécurité, en sus du rayonnement de ces territoires. Ces deux injonctions sont contradictoires puisque, pour assurer la sécurité, il faut contrôler les flux et donc instaurer une politique de visas.
La Guyane est le seul territoire français pour lequel un Brésilien doit demander un visa - le flux est moindre vers les autres territoires. C'est devenu un sujet vexant pour les Brésiliens, même si cela n'empêche pas des coopérations. En 2015, lors de la dernière réforme de l'arrêté sur les visas, le consulat a reçu la consigne de regarder avec bienveillance les demandes de certains catégories sociales : artistes, hommes d'affaires, étudiants, chercheurs et sportifs. Les Guyanais jouent au football, et il y a désormais un pont entre la Guyane et le Brésil. La préfecture établit des listes nominatives de personnes pouvant circuler librement entre la Guyane et le Brésil. Le problème est récurrent, et nous en débattrons lors du prochain comité transfrontalier France-Brésil qui se tiendra en juillet à Cayenne.
En raison de la réduction du nombre d'ambassades et de postes consulaires, il n'y a plus de services de délivrance de visas dans certaines îles des Antilles. Ainsi, la Jamaïque - grande puissance sportive des Caraïbes, pays d'Usain Bolt - n'a plus de consulat. Les sportifs voulant se rendre en Guadeloupe doivent demander un visa à Panama... Il existe un système de valise diplomatique géré par une entreprise privée avec une prise des empreintes digitales sécurisée. Le même problème existe dans le Pacifique avec les îles Fidji, nation essentielle du Top 14 de rugby et dont certains ressortissants, naturalisés français, jouent dans le XV de France. Le service consulaire le plus proche est à Vanuatu or, pour un contrat professionnel, il faut un visa de long séjour. Nous avons signalé le problème ; mais je n'ai pas encore eu d'appel de clubs furieux de ne pouvoir accueillir un joueur...

Cette question est centrale, et nous avons été interpellés à ce sujet en Guyane.
Mon bureau essaie de régler ces difficultés. Je n'ai jamais entendu parler des jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe et des jeux de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) : je suppose qu'il n'y a pas de problème.
Les territoires d'outre-mer sont hors zone Schengen ; il est nécessaire d'obtenir des visas spécifiques pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour la Nouvelle-Calédonie, pour Wallis-et-Futuna et pour la Polynésie. La Jamaïque n'est pas considérée comme un État fiable pour la zone Schengen, et le seul État européen ayant gardé un service consulaire en Jamaïque est le Royaume-Uni... La solution du service privé de la valise diplomatique coûte plus cher que le service consulaire mais moins cher qu'un double aller-retour Jamaïque-Panama...

Le sujet des visas dépasse le champ sportif mais c'est une vraie question. Nous voulions obtenir l'abrogation de l'arrêté sur les visas, complexe, qui doit être simplifié. Auparavant, pour me rendre aux États-Unis, je devais aller chercher mon visa à la Barbade ! Désormais, il y a la procédure ESTA (Electronic System for Travel Authorization) en ligne.
Depuis que Saint-Barthélemy est une collectivité d'outre-mer, les arrivants sans visa sont renvoyés à Saint-Martin où se trouve le préfet. C'est loin d'être simple. Cela représente un vrai handicap pour le sport, même si les conditions sont assouplies pour la participation des équipes de Guadeloupe et de Martinique dans tous les événements de la Caraïbe. Désormais, l'adhésion des deux îles françaises à l'Association des États de la Caraïbe (AEC) et à l'Association des États de la Caraïbe orientale (AECO) facilite la circulation. L'accès au travail est une compétence transférée à la collectivité alors que la compétence d'accès au territoire relève de l'État.
Je vous remercie de votre invitation, d'autant que l'outre-mer ne relève pas directement de ma compétence. L'ambassadeur pour le sport a un double rôle. Il aide à l'obtention, par la France, de grands événements sportifs internationaux comme les Jeux olympiques (JO) en 2024 ou la coupe du monde de rugby en 2023, et à la maximisation du profit - financier, image, tourisme - tiré de ces grands événements ; et il essaie de placer l'expertise française en matière de grands événements sportifs sur des événements organisés à l'étranger, comme les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 ou la coupe du monde de rugby en 2019 au Japon.
L'obtention par la France des Jeux olympiques en 2024 est une opportunité pour la France d'outre-mer. Aussi bien le Comité d'organisation des jeux olympiques (Cojo) que le ministère des sports tiennent à ce que ces jeux soient ceux de toute la France et non de Paris ou de la région parisienne. Toutes les régions, dont les outre-mer, devront bénéficier du souffle de Paris 2024. Plusieurs moyens sont possibles.
J'ai assisté aux jeux de Rio. Des jeux olympiques nécessitent de nombreux volontaires : plusieurs dizaines de milliers de bénévoles seront nécessaires avant, pendant et un peu après les jeux olympiques et paralympiques. Ce programme est central, et il est essentiel que les départements et territoires d'outre-mer ne soient pas oubliés. Nous en sommes aux balbutiements. Le Cojo ne rassemble que 25 personnes actuellement. Mais une convention a déjà été signée entre le Cojo et l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
Autre aspect, nous pouvons aider, les années précédant l'organisation des jeux, les pays n'ayant pas eu beaucoup de médailles. Les départements et territoires d'outre-mer peuvent être des lieux d'accueil et d'entraînement de leurs athlètes. Durant la campagne de candidature de Paris 2024, le comité de candidature s'est rendu dans les Caraïbes et le Pacifique pour proposer que les infrastructures soient mises à la disposition des pays de la région pour préparer les JO. C'est une manière d'intégrer ces régions françaises dans les JO.
Une politique de haut niveau est mise en place à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) pour accueillir des athlètes des départements et territoires d'outre-mer, car le rayonnement de ces espaces passe par de bonnes performances aux JO. La ministre des sports a formulé l'objectif ambitieux de 80 médailles - soit le double de Rio - pour les JO de Paris. Les athlètes d'outre-mer doivent avoir toute leur place dans la formation et l'entraînement à haut niveau.
Il est plus compliqué de créer des bases avancées en outre-mer pour les jeux de Paris, car les délégations ne veulent pas être trop éloignées des lieux de compétition. Mais ces bases avancées peuvent l'être dans le temps pour que les athlètes s'entraînent en amont....
Le Comité international olympique (CIO) a entamé une réflexion sur la limitation des coûts des JO - l'inflation des coûts des événements sportifs est générale. Les compétitions dans les différentes zones doivent attirer l'attention du public et des médias : les droits de retransmission sont fondamentaux. Cela nécessite que les compétitions aient de l'intérêt, et soient en nombre limité et coordonnées. Sinon, leur niveau baisse. Faisons un effort pour coordonner les compétitions régionales. Par exemple, les Jeux de la francophonie ne sont pas coordonnés avec les calendriers sportifs internationaux.
Il reste de nombreux progrès à faire entre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et les CNO régionaux : le CNO de Nouvelle-Calédonie n'a pas le même statut que celui de la Polynésie, et ils ont différents degrés d'autonomie par rapport au CNO central. Plus les acteurs sont coordonnés, plus la diplomatie sportive est efficace.
Paris 2024 est une opportunité pour remettre de l'ordre, notamment dans la politique de visas. La valise de recueil de données biométriques fait partie des solutions - je n'ose espérer une augmentation du budget du ministère des affaires étrangères pour rouvrir des consulats... La France va accueillir le monde entier, et pas seulement durant les JO. Nous devons accroître notre agilité sans remettre en cause la sécurité. Les JO sont l'occasion d'accélérer certaines politiques publiques et de trouver des solutions pour faciliter la vie des sportifs étrangers et des sportifs d'outre-mer.

Tous les territoires d'outre-mer se demandent comment tirer profit des retombées des JO. La solution de base d'entraînement a été fréquemment évoquée du fait des meilleures conditions climatiques. Des bassins à ciel ouvert sont disponibles en Guyane et en Martinique, alors que ceux de Guadeloupe sont en mauvais état. Le président de la Fédération française de voile, ancien champion olympique, s'entraînait à Saint-Barthélemy sur Tornado.
Le recrutement de volontaires pour les JO est une bonne idée, pensons-y dès maintenant.

Ce sujet du sport en outre-mer est extrêmement important pour chaque territoire - nous l'avons vu pour Mayotte. Vous avez évoqué la solidarité ultramarine, qu'on exhorte continuellement, mais les distances, les vécus culturels sont tellement différents - et je le vois comme hexagonale parachutée dans cette délégation depuis trois ans...

Et je souhaite y rester le plus longtemps possible. Cette découverte des outre-mer est extrêmement positive. Il est difficile d'avoir un regard embrassant la totalité des outre-mer. Il y a une convergence des outre-mer avec les problématiques vécues par les sportifs de l'hexagone et des spécificités à respecter. Nous devons travailler ensemble pour bâtir ces solidarités et pour que les populations prennent ces spécificités à bras le corps pour sortir les outre-mer de leur nuit - manque d'équipements sportifs, accompagnement des jeunes via le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) ou l'INSEP. Les difficultés sont nombreuses.

Merci pour ces excellents rapports. C'est notre dernière audition avant celle de la ministre des outre-mer. Vous nous avez fait découvrir une autre facette du sport. Nous avons travaillé sur les sportifs et les ligues, vous nous avez parlé de diplomatie. Les Jeux des îles de l'océan Indien ont lieu tous les quatre ans, les derniers à La Réunion, et on ne perçoit pas tout le travail que vous réalisez pour le rayonnement de la France à travers les océans.

Merci pour la qualité de votre exposé. M. Hallade, arrêtons de jouer au poker menteur sur les modalités de participation des jeunes Mahorais dans les Jeux des îles et les Jeux des jeunes de l'océan Indien. Élus locaux et sportifs se renvoient la balle. Jusqu'à présent, le monde sportif était opposé à une participation conjointe avec nos amis réunionnais : cela poserait des difficultés de composition des équipes, de quotas, de participation, de préparation... Les sportifs des deux îles n'arrivent pas à s'accorder, et je me suis laissé convaincre par ces arguments très précis.
Il est faux de dire que les élus insistent pour une participation autonome des Mahorais avec le drapeau et l'hymne de Mayotte. Modeste représentant des collectivités locales, je n'ai pas à afficher une opinion personnelle différente de celle de ces collectivités que je représente. Organisez une rencontre à Mayotte avec les sportifs et les élus politiques, puis dans un deuxième temps une autre réunion avec nos amis réunionnais pour éclaircir la situation.
J'en ai assez de voir les élus et les sportifs qui se renvoient la balle par commodité. Si les sportifs sont unanimes pour une solution ne posant aucun problème diplomatique, je ne vois aucun obstacle à aller dans ce sens. Les relations entre les Comores et Mayotte sont suffisamment graves pour ne pas contaminer le sport avec ces considérations. Les îles participant à ces jeux ne doivent pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas.
Vous avez repris un argument des Comores, qui ne veulent pas que la France leur impose sa règle. S'il y a des équipes compétentes pour concurrencer d'autres équipes des îles, où est le problème ? Ce sont des jeux des îles et non des pays ! Si chaque île remplit certaines conditions minimales pour y participer, plus il y aura de monde, mieux ce sera. À ce stade, ce sont des arguties qui ne font pas avancer la question de la participation des jeunes Mahorais avec l'hymne et les couleurs de la France. Ne pas y répondre est une manière d'éviter les questions...

Nous avons reçu le CNOS et les présidents de fédérations nationales, et nous nous sommes rendus à l'INSEP pour mesurer l'accueil fait aux ultramarins. Vous êtes incontournables dans ce processus. Nous rendrons un rapport précis sur la jeunesse et le sport dans nos territoires, que nous agrémenterons de préconisations avec, nous l'espérons, des retombées importantes. C'était le cas de nos précédents rapports sur le foncier, dont les préconisations ont été reprises dans la loi sur l'égalité réelle outre-mer, et sur les normes, dont les propositions ont été reprises par la Commission européenne. Nous espérons que notre rapport sur le sport donnera lieu à des améliorations - législatives, réglementaires ou autres. Nous ferons de notre mieux pour que les outre-mer avancent et qu'ils occupent une vraie place dans l'organisation du sport en France.