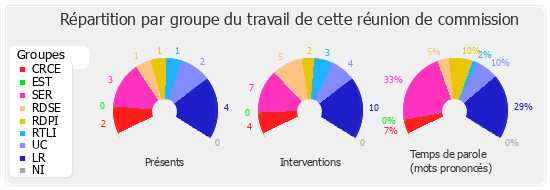Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 28 novembre 2018 à 9h30
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, je me suis rendue, hier, à Londres afin de représenter le Sénat à la réunion de la « grande commission internationale » sur la désinformation et les « fake news », constituée à l'initiative de nos homologues de la Chambre des communes, membres de la commission du numérique, de la culture, de la communication et du sport, rejoints depuis par les Parlements de huit autres pays dont la France (Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Irlande, Lettonie et Singapour). Il s'agissait, faute d'entendre Mark Zuckerberg, président de Facebook, de réfléchir ensemble aux moyens de lutter contre la désinformation. Aujourd'hui ce phénomène touche tous les pays au coeur de leurs systèmes politiques et il est fondamental qu'ils restent unis de sorte de pouvoir définir les principes d'une véritable régulation mondiale.
À cet égard, notre réunion a confirmé la dimension mondiale de cette préoccupation ainsi que les limites et le caractère inadapté de la réponse que le gouvernement a essayé d'apporter avec la loi relative à la manipulation de l'information.
Je vous propose de poursuivre nos travaux en procédant à l'audition de parlementaires étrangers, ce qui permettrait également de croiser les points de vue.

Il m'appartient de rapporter les crédits du programme 175 « Patrimoines ». Il s'agit du patrimoine, de l'architecture, mais aussi, des musées, des archives, et du patrimoine archéologique.
L'année 2018 a été incontestablement une année particulière. En effet, c'était l'année européenne du patrimoine culturel, qui a donné lieu à la labellisation d'un grand nombre de projets à travers le territoire. En outre, en France, elle a été marquée par une politique en faveur du patrimoine ambitieuse et nouvelle. Notre commission a connu des années où le patrimoine était sacrifié. Nous nous étions d'ailleurs mobilisés avec beaucoup de force à cette époque. À d'autres moments, la situation était beaucoup plus favorable. Cette année, de manière incontestable, entre le budget et l'opération « Loto du patrimoine » sur laquelle je reviendrai, a été particulièrement bonne, après un certain nombre d'années difficiles en raison de baisse des financements croisés - nous connaissons les difficultés financières des communes et départements. D'ailleurs, de nombreux départements ont dû se retirer du financement du patrimoine. Il était donc essentiel qu'un sursaut se produise. Celui-ci a eu lieu cette année.
Nous sommes tous convaincus de l'importance du patrimoine, en termes d'attractivité - touristique et économique -, de cohésion sociale - c'est notre mémoire collective qui est en jeu -, de maintien des savoir-faire et des entreprises. D'ailleurs, nous avons auditionné, comme chaque année, le groupement des monuments historiques qui regroupe toutes les entreprises spécialisées. Il est très inquiet de voir disparaître à jamais des savoir-faire et des métiers : des stucateurs ou des tailleurs de pierre par exemple. C'est une perte terrible pour la restauration du patrimoine.
Le patrimoine peut également être un outil au service de la revitalisation des centres historiques dégradés. C'était le but de la loi Malraux il y a plusieurs décennies. Je crois qu'il convient de le rappeler plus que jamais.
À l'examen des crédits, on constate des chiffres paradoxaux. Les crédits « patrimoines » augmentent en autorisations d'engagement de 10,9 %, mais baissent de 0,4 % en crédits de paiement. Cela s'explique par le transfert de l'action « patrimoine linguistique » du programme 175 vers un autre programme, pour un montant de 3,22 millions d'euros. Si les crédits apparaissent en baisse, ce n'est pas le cas en réalité.
On constate, pour les musées, une baisse des crédits de paiement. Cela est dû à l'évolution de l'échéancier des travaux du centre Georges-Pompidou. Les subventions des opérateurs sont stables. Les crédits pour l'enrichissement des collections publiques à Paris et en province sont préservés. L'État encourage d'ailleurs les opérateurs à développer leurs ressources propres. Or, à ce jour, seuls quelques établissements parviennent à dégager un autofinancement supérieur à 50 %, comme Versailles, le Louvre, le musée Picasso, et le musée d'Orsay. Les autres musées restent tributaires des subventions de l'État et, le cas échéant, des collectivités.
On constate une diminution des crédits pour les archives de 7 % en autorisations d'engagement et de 17 % en crédits de paiement, liée à l'évolution des échéanciers de travaux. Cette année correspond à la fin des travaux sur les sites des archives nationales, de Paris comme de Pierrefitte-sur-Seine.
Les crédits déconcentrés pour l'archéologie préventive et les fouilles en région sont revalorisés de cinq millions d'euros dans un souci de sincérité budgétaire. En effet, les années précédentes, on constatait une insuffisance des crédits en faveur de l'archéologie préventive dans le courant de l'année, qu'il fallait financer en prélevant sur les crédits du patrimoine, au détriment des travaux sur les monuments historiques. C'est la raison pour laquelle cinq millions d'euros ont été ajoutés au programme « patrimoine archéologique », qui augmente ainsi de 3,4 %. On peut espérer que ce sera suffisant. Mais il est arrivé certaines années qu'il faille abonder de plus de dix millions d'euros cette action.
Cette année encore, on constate une certaine inquiétude vis-à-vis d'une sous-consommation des crédits. Le ministre s'est engagé - et il nous l'a dit - à ce que l'intégralité des crédits soit exécutée d'ici à la fin de l'année. La sous-consommation est préoccupante. Elle entraîne la suspension de certains chantiers, d'où les conséquences catastrophiques pour les entreprises spécialisées dans les monuments historiques et les difficultés en matière d'emplois, d'apprentissage et de formation. Cette année, on peut espérer que ces crédits soient consommés compte tenu de l'effort consenti en faveur du patrimoine.
Les crédits consacrés au patrimoine et aux monuments historiques en 2019 augmentent en autorisations d'engagement de 25,1 % et de 4 % en crédits de paiement. L'augmentation très importante s'explique par deux grands projets : d'une part, la restauration du château de Villers-Cotterêts - le président de la République souhaite y installer un laboratoire mondial de la francophonie alors qu'il est aujourd'hui dans un état pathétique. Pour l'anecdote, ce château a abrité, pendant un siècle et demi, le « dépôt de mendicité » de la ville de Paris. Outre l'aspect humain qui est effroyable, le bâtiment a été totalement dégradé. L'autre projet est la rénovation du Grand Palais, dont le montant est estimé à 450 millions d'euros. D'autres opérateurs que l'État participent au financement de ces deux projets. Même ces deux grands projets mis à part, les crédits progressent fortement, notamment pour renforcer le fonds incitatif pour les monuments historiques des petites communes à faible potentiel financier mis en place l'an dernier. Quatre critères doivent être remplis pour son intervention : la taille de la commune - moins de 10 000 habitants avec une priorité pour les communes de moins de 2 000 habitants -, les ressources des communes, le type d'opération - il s'agit d'opérations portant surtout sur des monuments en péril ou en mauvais état, dont plus de 10 000 sont répertoriés - , enfin le type d'édifices : il s'agit des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Il y a une seule condition : la région doit financer le projet à hauteur d'au moins 15 %. À ce jour, toutes les régions en France financent le patrimoine, sauf deux : la Normandie - où les départements sont très investis sur ce sujet - et Centre-Val de Loire. Ce fonds a permis de financer 151 opérations dans 12 régions.
Chaque année dans le rapport, je déplorais que Paris et la région parisienne drainent l'essentiel des crédits. Cette année, on constate un effort de régionalisation.
Il faut ajouter aux crédits du programme les 21 millions d'euros débloqués en compensation des taxes sur les recettes du Loto du patrimoine. Après la polémique, l'État a décidé de dégeler l'intégralité des crédits du programme 175 en 2018. Ces crédits transiteront par le budget de l'État mais seront affectés prioritairement à des projets sélectionnés dans le cadre du Loto du patrimoine, dont la gestion relève d'un opérateur de l'État, à l'image du centre des monuments nationaux (CMN). Trois projets vont être privilégiés : le château de Bussy-Rabutin en Côte d'Or, l'abbaye de Montmajour dans les Bouches-du-Rhône, et le château de Castelnau-Bretenoux dans le Lot. Ces crédits doivent être dépensés avant la fin de l'année 2018, annualité budgétaire oblige. C'est pourquoi seront privilégiées des opérations en cours.
Un mot sur la mission Bern et la première édition du Loto du patrimoine. Il y a une quinzaine d'années, notre commission avait créé une mission d'information que je présidais, et dont Philippe Richert était rapporteur. Nous avions conclu à la nécessité de mettre en place en France, sur le modèle de ce qui existait dans d'autres pays, une loterie en faveur du patrimoine. Bien que séduisante, l'idée avait été jugée compliquée à mettre en oeuvre pour des raisons budgétaires et techniques. La fourchette haute des estimations du Loto du patrimoine devrait être atteinte, grâce notamment aux jeux de grattage, dont la commercialisation se poursuit. Ils abonderont de 20 millions d'euros le financement de la protection du patrimoine, hors budget, à travers la Fondation du patrimoine. Celle-ci a sélectionné 269 projets dans toute la France, dont vous trouverez la liste en annexe du rapport. Elle est très équilibrée entre la métropole et l'outre-mer. L'opération sera pérennisée en 2019 et 2020. Conformément à la convention signée pour trois ans entre la Fondation du patrimoine et la Française des jeux. Il faut souhaiter qu'elle soit définitivement pérennisée, à l'issue de l'évaluation qui sera faite au terme de cette période. Le montant total des travaux sur les sites en péril signalés - 2 000 - est évalué à 2,5 milliards d'euros. L'intérêt du Loto est donc moins dans les crédits qu'il rapporte, que dans l'élan qu'il a permis de donner en France. La présidente de la Française des jeux m'a indiqué que de très nombreux tickets avaient été achetés par de nouveaux joueurs. Trouver des moyens nouveaux était nécessaire, alors que certaines sources financières pour le patrimoine se sont taries, tels la réserve parlementaire, qui a beaucoup servi pour le petit patrimoine rural, et le mécénat. Les dons des particuliers ont beaucoup baissé cette année, en raison de l'incertitude liée au prochain démarrage du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et de la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. En outre, le mécénat pourrait être menacé : vous avez tous vu le rapport de la Cour des comptes, ainsi que les polémiques autour de certaines opérations de mécénat. Dans le rapport qu'il a fait au nom de la mission d'information de note commission, notre collègue Alain Schmitz a pourtant montré l'importance de ce financement privé pour le patrimoine. Il y a de réels doutes aujourd'hui sur la capacité de l'État à financer dans la durée la protection du patrimoine, surtout dans une période où il se lance dans de grands travaux. Le CMN a été amené à reporter certaines opérations sur le Panthéon, à Saint-Cloud, au Mont-Saint-Michel, faute de crédits suffisants. Nous devons donc faire preuve de vigilance, afin que l'effort qui est fait ne s'arrête pas.

Avant de donner la parole à mes collègues, permettez-moi de donner quelques éléments d'information expliquant pourquoi la région Normandie ne cofinance pas les opérations susceptibles d'être soutenues par le fonds incitatif pour les petites communes. Certes, il est très positif que l'État se préoccupe du patrimoine dans les zones rurales. Mais, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, l'État peut-il obliger certaines d'entre elles à intervenir, en fixant jusqu'au pourcentage minimum de leur intervention ? En Normandie, le projet nous a été très mal présenté : aucun choix ne nous a été donné sur la liste des projets susceptibles d'être concernés et cette liste ne nous a même pas été communiquée, de peur que nous ne puissions en faire un objet de communication ! Voilà pourquoi nous n'avons pas souscrit au dispositif.
L'État décentralisé ne fait pas toujours son travail avec subtilité de façon à créer du lien, du débat et de la co-construction. Par ailleurs, les départements de notre région sont très investis sur ce sujet. Nous avons engagé un plan « patrimoine » ambitieux. Ce dossier illustre le problème des compétences partagées. Il faut qu'elles le soient vraiment.

En effet, la méthode, en Normandie, n'était pas la bonne. Dans la région Grand-Est, où je m'occupe du patrimoine, dès la première année d'exercice du mandat de Philippe Richert, la région a mis en place un programme d'aide au patrimoine. Lorsque l'État a lancé son fonds, il s'est coulé dans le moule du programme initié par la région, et cela s'est passé dans les meilleures conditions possibles avec le préfet de région.

On constate, cette année, une stabilité des crédits de la mission Culture, qui se situent juste en dessous de la barre du 1 % symbolique du budget de l'État. Vous l'avez dit, l'effort est important. Vous avez évoqué le Loto du patrimoine ; la fréquentation des établissements culturels est très satisfaisante. Mais cet effort est contrasté. Un certain nombre de questions demeure - le financement de certains projets immobiliers par exemple. Je reviendrai sur ce sujet dans le cadre de l'examen du rapport pour avis sur la création artistique.

Si on regarde globalement le budget du programme 175, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais dans le détail, cette analyse mérite d'être nuancée.
L'action 1 « monuments historiques et patrimoine monumental » est en hausse, mais après trois années de stagnation des crédits. La situation de ce secteur est critique depuis 15 ans. Le rattrapage de 2019 est-il suffisant ? Les crédits destinés aux monuments historiques sont en légère augmentation, mais ce n'est peut-être pas suffisant au regard des besoins. D'ailleurs, le groupement des monuments historiques estime toujours nécessaire un engagement de 400 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, afin d'avoir une restauration et un entretien conséquents des monuments historiques.
L'action 9 « patrimoine archéologique » connait une amélioration par rapport aux années précédentes. Pendant longtemps, le financement de l'INRAP a été aléatoire, en fonction des perceptions effectives ou non de la redevance d'archéologie préventive (RAP). Depuis la budgétisation de la RAP en 2016, les budgets sont presque à l'équilibre, surtout depuis que l'INRAP bénéficie aussi du crédit impôt recherche (CIR). Cet octroi a permis d'assainir les finances de l'institut. Il y a eu un rattrapage sur les années antérieures, mais qui n'existera plus dans les années futures. Ses activités dans le secteur non concurrentiel sont toujours difficiles à équilibrer. L'INRAP reste préoccupé par l'avenir. Pour 2019, le déficit sera tout de même de dix millions d'euros.
L'action 3 « patrimoine des musées de France » prévoit une baisse des crédits, due à l'évolution des travaux au centre Pompidou. Mais, les dépenses d'intervention destinées aux actions en région - avec 25,804 millions d'euros en crédits de paiement en 2019 - sont en baisse de 1,7 %. Le rééquilibrage des crédits en faveur des musées de province amorcé en 2015 pâtit de la baisse globale et récurrente de cette action. La capacité d'investissement et de fonctionnement des musées de province serait ainsi tout juste maintenue. Cette baisse va les impacter. Or, ces musées sont indispensables pour l'accès de tous à la culture. Ils constituent un atout important pour le développement touristique et un évènement essentiel du développement économique de ces communes et territoires. Il est important de préserver les crédits de l'action 3.
J'ai auditionné les architectes des bâtiments de France (ABF). Ils sont inquiets pour plusieurs raisons. Nous avons évoqué la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Pour eux, nous sommes revenus, à la situation d'avant la loi Malraux. Ils ne sont pas sollicités quand, avec ces dispositions, il y a des problèmes d'insalubrité sur les bâtiments - ce sont plutôt les services en charge du logement qui s'en occupent. Nous avions tous souligné dans cette commission lors des débats. Ils ont évoqué le rapport sur l'organisation de la direction générale des Patrimoines rendu par Philippe Belaval le 15 septembre dernier, qui dénonce un manque de personnels dans les départements. Or, des suppressions de postes vont encore intervenir. Cette situation complique et affaiblit le travail des ABF, dont l'avis conforme est pourtant essentiel pour la protection du patrimoine.

En 2017, nos collègues André Gattolin et Vincent Éblé avaient remis un rapport d'information sur les archives, dans lequel ils appelaient à des investissements, notamment pour permettre l'accueil des archives jusqu'ici stockées à Fontainebleau sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Il avait été prévu de construire très rapidement une extension à cette fin. Lorsque j'ai questionné le ministre de la Culture sur la baisse de 17 % de l'action « patrimoine archéologique », il a expliqué que l'on arrivait à la fin du projet de Pierrefitte. J'en conclus donc que l'extension indispensable pour faire vivre les archives est abandonnée. Je crains que la bonne santé relative du budget de la culture s'explique par le report d'investissements majeurs. Ce n'est pas une bonne politique.
La gestion de l'archéologie préventive est incohérente. Elle fonctionnait avec une taxe affectée. Aujourd'hui, elle a été rebudgétisée. On comprend que pour arriver à un budget équilibré pour l'INRAP, on fait appel au CIR, qui est une dépense fiscale gérée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui vient compenser le manque à gagner de la redevance d'archéologie préventive. Il n'y a plus aucune lisibilité politique sur ce budget. Or, on sait que de tels rafistolages ne durent jamais très longtemps. Il suffit qu'il y ait un problème avec le CIR pour que l'on retombe sur les mêmes difficultés. Il est plus sain de regarder ce que coûte l'archéologie préventive et d'essayer de mettre des ressources budgétaires pérennes et politiquement identifiées en face.

Globalement, ce budget est plutôt positif. Nous sommes dans une situation de hiatus entre l'absence de prise de position forte du ministère de la culture sur les sujets patrimoniaux, que ce soit sur la revitalisation des centres-villes ou à l'occasion de l'examen du projet de loi ELAN, et une surcommunication à travers le Loto du patrimoine, et les citoyens qui se sont emparés du sujet.
L'État attend des entreprises et des citoyens, à travers le Loto du patrimoine, qu'ils l'aident à financer les besoins. Mais ce nouvel apport lui-même n'est pas suffisant. Il va falloir trouver un modèle économique stabilisé. Nous n'avons aucune garantie que l'engouement pour le Loto du patrimoine sera le même l'année prochaine.
Nous devons nous interroger sur la manière dont les crédits sont répartis entre les territoires. Le territoire francilien, car il concentre beaucoup d'opérateurs, se voit affecter une grande partie des budgets. Or, le patrimoine, est principalement constitué par le petit patrimoine, classé ou non. Au-delà de la déconcentration des crédits, et d'un accompagnement par les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) des collectivités territoriales, l'État doit afficher sa vision de la prise en charge du patrimoine classé ou non sur les territoires. Cela ne doit pas obligatoirement passer par le filtre d'une labellisation.
Le dernier sujet important concerne l'évolution des dons et du mécénat. Elle ne sera pas compensée par le Loto du patrimoine. Cette diminution des dons pose la question du devenir du mécénat.
Il me semblerait utile de disposer d'une cartographie des besoins en ce qui concerne le patrimoine protégé et le petit patrimoine, pas seulement la liste de monuments sélectionnés, pour bien comprendre les besoins, cerner les priorités et, sur cette base, fixer un budget en adéquation avec les besoins.

Ce budget, reconnaissons-le, est conséquent. Dans le domaine de la culture, on nous promet depuis des années le 1 %. Depuis le début des années 1980, on était vers 0,98 %.
Il faut souligner le succès du Loto du patrimoine. Près de 30 % des joueurs était des joueurs spécifiques à cette cause. La Française des jeux s'est engagée à reproduire cette opération. Je pense aux doutes de certaines personnes au moment où cela a été envisagé, qui le voyait comme un gadget. Cela a plutôt bien fonctionné, et je m'en réjouis.
La rénovation du château de Villers-Cotterêts n'est pas une décision présidentielle sans fondement. Il y a une association qui se bat localement depuis dix ans : l'édit de Villers-Cotterêts est considéré comme le premier acte de politique publique de la culture en France. En faire un lieu consacré à la francophonie et plus encore à la langue française est essentiel. La rapporteure du budget à l'Assemblée nationale a estimé que ce projet était vague. Or, il ne l'est pas. Il vient des territoires. D'ailleurs, s'il est appuyé, c'est parce qu'il répond à des objectifs de politique du patrimoine, de déconcentration, mais aussi d'hommage à la structuration de la langue française devenue indépendante du latin ou des différents patois instables qui étaient utilisés.
Le rapport sur les archives nationales que j'ai commis l'an dernier, explique pourquoi les archives de Fontainebleau ont dû être déménagées à Pierrefitte-sur-Seine, après les inondations intervenues dans l'arrière bâtiment de l'OTAN, inadapté au stockage des archives, dans lesquelles elles avaient été entreposées. Certains documents ont pu être restaurés mais d'autres ont été dégradés de manière irrémédiable. L'intérêt de ce rapport est aussi de pointer du doigt les erreurs de conception du bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine, où de vastes salles de consultation des documents ont été prévues, sans prendre en compte le fait que l'on était désormais au numérique et que la consultation des archives avait désormais vocation à intervenir depuis son domicile. À peine fini, le centre de Pierrefitte-sur-Seine doit déjà être réaménagé pour mieux répondre aux besoins.
Enfin, je conclurai en indiquant que le groupe de la République en marche suivra le rapporteur en donnant un avis favorable à l'adoption des crédits.

On ne peut que se réjouir de ce budget en augmentation très significative. Depuis des années, nous n'avions pas eu un tel budget.
La mise en place du Loto du patrimoine a permis de sensibiliser les citoyens aux nécessités de restauration du patrimoine. Cela a été un grand succès. On ne peut que souhaiter sa pérennisation.
Fontainebleau se situe dans mon département. Je me suis intéressée de près au sujet du devenir du centre des archives nationales. Ce bâtiment est inexploitable. On ne pouvait pas en reconstruire un nouveau en raison des contraintes géologiques du terrain. Cela a été un sujet difficile pour les personnels. La situation s'est apaisée.
Nous donnerons un avis favorable à l'adoption de ces crédits.

Nous ne pouvons qu'apprécier le maintien de l'effort pour le patrimoine. Le budget est très correct. Mais cela n'empêchera pas la vigilance, sur les musées en province ou sur les grands chantiers. Il ne faut pas que Villers-Cotterêts et le Grand Palais empêchent le lancement d'autres chantiers ou entraînent une dérive des coûts, comme cela a été le cas par le passé.
Je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites sur les conséquences de la baisse du mécénat, de la baisse des dons des particuliers et de la suppression de la réserve parlementaire. Je serai peut-être moins optimiste l'année prochaine. Mais cette année, nous sommes confiants.

Je souhaite exprimer à la fois une satisfaction et une inquiétude. Jamais on n'a autant parlé du patrimoine. Je rappelle que lors des Journées du patrimoine, ce sont 12 millions de visiteurs qui se pressent, soit un Français sur cinq. Dans ce cadre, ce n'est donc pas une surprise que le Loto du patrimoine ait rencontré un grand succès populaire.
En revanche, et là se trouve mon inquiétude, je ne voudrais pas que cela donne bonne conscience à l'État, qu'il se décharge sur les régions ou les départements, et a fortiori sur les particuliers. Il faut que l'augmentation des crédits en faveur du patrimoine s'inscrive dans la durée. Il ne faut pas non plus que le budget du patrimoine soit obéré par de grandes opérations très spectaculaires, dont nous savons par expérience qu'elles peuvent comporter des dérives considérables sur le plan financier. La rénovation du Grand Palais devrait coûter 450 millions d'euros. Cette somme doit être comparée aux 297 millions d'euros inscrits pour les monuments historiques hors grands projets en 2018. Enfin, 2 000 sites sont en péril en France, dont le coût de restauration est évalué à 2,5 milliards d'euros. Les besoins sont énormes. L'État ne doit pas relâcher ses efforts au motif de l'apport fourni par le Loto du patrimoine ou par l'engagement renforcé des régions.

Je remercie Madame Monier d'avoir recontextualisé le vote de ce budget. Il arrive au terme d'une année où des dispositions législatives importantes au regard du patrimoine ont été adoptées. La loi ELAN a été promulguée il y a quelques jours. Je continue à regretter le silence de la ministre de la culture tout au long de l'examen de ce texte. Je pense que le nouveau ministre, Franck Riester, reprendra la main sur ces sujets. Nous le soutiendrons. Nous aurions alors pu évoquer le nouveau rôle des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture (CRPA). Lors d'une table ronde que nous avons organisée en octobre, leurs présidents ont confirmé que les nouvelles dispositions prévues par la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui les a dotés d'un pouvoir d'auto-saisine, et a rendu obligatoire leur consultation en cas de recours contre l'avis conforme émis par un ABF, avaient permis, dans de nombreux cas, la reprise du dialogue entre élus et ABF et l'élaboration de compromis. Je regrette que l'excellent travail de ces commissions régionales, désormais présidées par des élus, n'ait pas été pris en compte.
Les ABF sont confrontés à des difficultés budgétaires importantes. La Seine-Maritime compte 740 communes au patrimoine très riche. Pourtant, seulement 1,5 ABF nous sont affectés en ETP. On ne peut pas leur reprocher leurs délais, lorsqu'ils sont si peu nombreux, et que les postes ne sont pas pourvus.
Il m'a été remonté, notamment par le délégué régional de la Fondation du patrimoine dans ma région, le manque de transparence et de méthodologie dans le choix des sites retenus pour bénéficier des crédits du Loto du patrimoine. Il y a des disparités, à due proportion du nombre de sites en péril selon les départements et l'influence de tel ou tel élu. Je souhaite que notre commission auditionne très officiellement Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du Patrimoine - je charge Dominique Vérien, qui représente le Sénat en son sein, de le sensibiliser, et Stéphane Bern, afin qu'ils viennent nous expliquer les critères de sélection. On ne peut pas être confronté à la même opacité l'année prochaine.
Je souhaite rappeler que le Loto est une idée de notre collègue député François de Mazières. Il faut que les Français aient le sentiment que les quinze euros qu'ils mettent dans l'achat d'un ticket aillent bien au patrimoine. La politique autour des taxes perçues sur ces billets de loterie, avant le salon du patrimoine au carrousel du Louvre, a démontré la nécessité de rester vigilants. On ne peut que se réjouir qu'une solution ait été trouvée cette année pour compenser le montant des taxes. On sait que beaucoup de taxes aujourd'hui sont détournées pour aller réalimenter les caisses de Bercy.
Je vous propose également d'auditionner prochainement Philippe Belaval.

Le choix des sites s'est fait en liaison avec les DRAC pour le patrimoine protégé et les délégués départementaux et régionaux de la Fondation du patrimoine pour le patrimoine non protégé. La répartition des 269 sites sélectionnés est la suivante : 2/3 de monuments historiques et 1/3 de petit patrimoine. Ils représentent la diversité de notre patrimoine : 34 % d'édifices religieux, 23 % de châteaux, 13 % de patrimoine agricole et vernaculaire, 9 % de patrimoine industriel et artisanal. Je répercuterai vos demandes, car on ne peut pas se réjouir du succès du Loto du patrimoine, sans souligner ses faiblesses. Pour rencontrer dans ma région les délégués de la Fondation du patrimoine, je peux dire qu'ils ont été étroitement associés aux opérations. Il faut qu'à l'échelle du pays, il y ait une pratique unique au nom de l'équité. Il faut une plus grande concertation dans toutes les régions de France.
Ce budget est un rattrapage des années précédentes. Je m'en réjouis, mais ce n'est que cela. En effet, pendant plusieurs années, le budget du patrimoine a été sacrifié. Certes, on peut estimer que le budget nécessaire est colossal en raison des besoins - je le rappelle, 2 000 sites sont aujourd'hui en péril - et ne sera jamais suffisant. Mais, il est nécessaire de le pérenniser. De plus, souvent les travaux s'échelonnent sur plusieurs années. Or, nous votons un budget dont la règle est l'annualité.
Le crédit d'impôt recherche représente une bouffée d'oxygène, aussi bien pour l'INRAP que pour les archéologues privés.
Concernant Pierrefitte-sur-Seine, le ministère indique simplement que les premières études de programmation vont être lancées sur le quinquennat, en vue de la construction d'une première extension sur la réserve foncière prévue à cet effet. Il faudra questionner le ministre sur ce point.
Je partage l'avis de plusieurs d'entre vous sur la nécessité d'être vigilant. C'est d'ailleurs la mission première du rapporteur du budget « patrimoine » et de notre commission dans son ensemble. Je rappelle qu'elle s'était collectivement insurgée contre certaines mesures. À l'époque où elle était présidée par Maurice Schumann, la commission s'était violemment insurgée, par conférence de presse, contre la suspension en cours d'année des chantiers sur les monuments historiques de l'État. On allait enlever les échafaudages pour les remonter l'année suivante. La mobilisation extrêmement virulente de la commission a permis d'arrêter cette hérésie.
Le Loto sera reconduit pendant deux années. Il faudra s'assurer l'année prochaine que la partie TVA, qui n'est pas dans les produits de la Française des jeux, soit bien destinée à abonder le budget du ministère. Je ne pense pas que l'État ose faire autrement, après la polémique de cet automne, mais il faudra le vérifier.
Enfin, pour les critères de choix des bâtiments financés par le Loto, je suggère d'associer l'inventaire du patrimoine. Il dépend maintenant des régions. Il fait un travail remarquable, commune par commune. Personne ne connaît mieux que les responsables de l'inventaire du patrimoine l'état de celui-ci, et les choix à faire pour son financement.
En conclusion, je vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de ces crédits.

Je donne maintenant la parole à notre collègue Sylvie Robert pour les programmes 131 relatif à la création artistique, et 224 qui a trait à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture.

Les points de vigilance que j'avais évoqués l'année dernière dans mon rapport n'ont globalement pas été levés : le Pass culture, le Fonpeps (Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle), les conservatoires et les écoles d'art. Les différents chantiers n'ont pas beaucoup progressé.
Toutefois, ce budget est un budget consolidé, stabilisé, avec une baisse des autorisations d'engagement, mais qui s'explique principalement par l'évolution d'un certain nombre d'échéanciers de travaux. Je pense à la relocalisation du Centre national des arts plastiques (CNAP) à Pantin et d'un certain nombre d'établissements de l'enseignement supérieur culture. En revanche, les crédits de paiement sont à peu près stables, avec certaines évolutions positives.
Le niveau de crédits de chacune des actions a été ajusté au plus près de la consommation des années précédentes. Je pense notamment aux bourses de l'enseignement supérieur, au Fonpeps. Le gouvernement le justifie par une volonté de sincérité budgétaire. Mais, le risque - et on le verra l'année prochaine - est qu'il n'y ait plus aucune marge de manoeuvre, alors qu'un certain nombre de chantiers, que j'évoquais précédemment, doivent être relancés l'année prochaine. Dans le même temps, et cela a été flagrant lors de l'audition du ministre, on nous parle des crédits de gestion. Lorsqu'on l'interroge sur l'origine des cinq millions d'euros qu'il a promis pour le Centre national de la musique (CNM) et qu'il nous répond qu'ils seront dégagés en gestion - il en est de même pour les 800 000 euros pour les écoles d'art -, il nous indique clairement disposer de marges de manoeuvre. Au final, la lisibilité du bleu budgétaire, mais aussi du budget de ces deux programmes va nous demander beaucoup plus de vigilance et de contrôle sur la mise en place des différentes actions car, traditionnellement, les crédits de gestion échappent au contrôle du Parlement.
Les collectivités territoriales sont mises à contribution, et ceci de plus en plus. Je pense notamment à l'éducation artistique et culturelle. Nous avons, cette année, auditionné les grandes associations d'élus. Elles nous ont indiqué que le capage à 1,2 % des dépenses de fonctionnement est une situation ubuesque. Le ministère leur demande d'intervenir avec lui dans le cadre d'un partenariat sur un certain nombre d'actions. Le plafonnement des dépenses à 1,2 % va les empêcher de le faire.
Les augmentations de crédits répondent à trois priorités. D'abord, le renforcement de l'équité territoriale qui se traduit par une augmentation des crédits déconcentrés. C'est un aspect intéressant. Je vous conseille d'interroger les DRAC de votre région afin de s'assurer qu'elles disposent bien de budgets en hausse. En matière d'arts visuels, les nouveaux crédits sont destinés à faciliter l'adoption des schémas d'orientation pour le développement des arts visuels (SODAVI) et à accompagner les Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) et les centres d'art en régions. Je veux simplement, comme je l'ai fait l'année dernière, souligner que les crédits destinés aux arts visuels restent faibles. C'est le parent pauvre du budget de la culture. Il y a peu d'efforts en direction des collectifs d'artistes et des lieux intermédiaires. Or ces lieux sont en plein développement et structurants pour nos territoires. La création du conseil national des professions des arts visuels, dont nous appelons à la création depuis plusieurs années pour permettre au secteur de se structurer, notamment sur son volet social, est annoncée pour la fin de l'année. J'espère que cela va se faire.
En matière d'accès de la jeunesse à la culture, les crédits sont en augmentation et de manière assez importante. L'implication des deux ministères - de la culture et de l'éducation nationale - est assez forte. Mais je remarque que l'engagement du ministère de l'éducation nationale en termes de crédits n'est pas encore à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer. Beaucoup des actions d'éducation artistique et culturelle reposent sur l'investissement des collectivités territoriales.
J'attire votre vigilance sur plusieurs crédits : ceux destinés à réduire les inégalités territoriales dans l'accès à la culture et ceux destinés au développement des pratiques amateurs sont en baisse. On nous explique que l'accompagnement de ces projets sera fait par l'éducation artistique et culturelle. Je n'en suis pas certaine. C'est une question qu'il nous faudra suivre avec attention.
En ce qui concerne la promotion de la diversité culturelle, le Gouvernement met en exergue le rôle joué par le Centre national de la musique et le Fonpeps. Le projet du CNM est ancien. Il a désormais près de dix ans. L'idée est de retrouver au sein d'un même centre l'ensemble des esthétiques musicales, avoir un centre de ressources, un observatoire de la filière,... Il est vrai que les députés Pascal Bois et Emilie Cariou ont rendu leur rapport pour permettre le lancement du CNM. Mais comme je l'avais évoqué lors de l'audition du ministre, aucun crédit pour sa mise en place n'est inscrit au budget, alors qu'elle est attendue et que le Gouvernement a fait une promesse en ce sens. Le ministre rétorque que cinq millions d'euros seront consacrés sur la base de crédits de gestion. Je vous proposerai d'abonder ces crédits à hauteur de cinq millions d'euros supplémentaires et de demander au ministre de commencer à le mettre effectivement en place.
Je souhaite revenir sur les crédits d'impôt. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'Assemblée nationale le crédit d'impôt spectacle vivant a été repérimétré par le Gouvernement via un amendement qui le fragilise considérablement. Nous devons prendre des décisions qui permettraient à la fois de revenir à un crédit d'impôt moins strict, tout en fixant de nouveaux critères pour qu'il joue mieux son rôle de soutien à l'émergence.
Le Fonpeps a été prorogé au-delà de 2018, mais les crédits sont en baisse en 2019. Je trouve qu'il était prématuré de réduire tout de suite les crédits avant même d'avoir véritablement expérimenté les effets de cette réforme. Si l'année prochaine, il faut les augmenter en raison de l'apparition de nouveaux besoins, l'État aura-t-il la capacité de le faire ?
La compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les artistes-auteurs, pour un montant de 18 millions d'euros, est inscrite au programme 224. Le problème, c'est que le décret du 15 mai 2018 n'a pas prévu un mécanisme de compensation, mais simplement de soutien du pouvoir d'achat. Il n'existe aujourd'hui aucune proposition négociée et validée par les artistes et le Gouvernement sur la question des artistes-auteurs pour assurer la pérennité de la compensation. Par ailleurs, à ma connaissance, aucun versement n'a été effectué au titre de 2018, alors que nous sommes fin novembre.
Enfin, comme le sport, la culture a été impactée par la baisse des emplois aidés. Les associations sur nos territoires ont pour certaines disparu. Cela contribue à la fragilisation du secteur artistique. Au total, si le budget est stable, le secteur est touché par de nombreux facteurs exogènes et connexes qui le fragilisent.
C'est pourquoi nous allons devoir suivre, au sein de cette commission, plusieurs sujets préoccupants. Je commencerai par le Pass culture. Nous avons, hier, avec notre collègue Jean-Raymond Hugonet, président du groupe de travail dédié, et Sonia de la Provôté, auditionné assez longuement la start-up d'État sur le Pass culture - notamment Éric Garandeau et ses collaborateurs. J'ai l'impression qu'il y a eu une reprise en main politique par le ministère de ce dossier, soucieux d'éviter les différents écueils que nous avions identifiés. Très clairement, le projet allait jusque-là dans le mur, avec un manque de clarté sur ses objectifs. Il y a désormais une volonté de bien faire, ce qui ne doit pas nous empêcher d'être extrêmement vigilants. Je vous propose que le groupe de travail présidé par M. Hugonet soit l'instance de suivi de très près de la mise en oeuvre de ce pass. L'expérimentation qui devait commencer à l'automne dernier n'a toujours pas débuté. Elle n'aura lieu qu'au début de l'année 2019. Ce retard n'est pas dû à une question financière, mais de cadrage de l'expérimentation. Ils doivent trouver un panel de 10 000 jeunes. Or, les profils des candidats sont trop homogènes : il n'y a presque que des étudiants dans le Finistère. De la même façon, un travail doit être fait envers les offreurs. Dans un certain nombre de départements, trop peu d'offreurs se sont déclarés intéressés pour participer à ce pass. 34 millions d'euros sont inscrits en 2019 pour mettre en place l'expérimentation. Mais il n'y a aucune ventilation précise des crédits. L'estimation a été faite, si vous me permettez l'expression, « au doigt mouillé ».
Un autre point de vigilance concerne les écoles d'art dans nos territoires ; un alignement du statut des enseignants des écoles d'art territoriales sur celui des écoles d'art nationales est nécessaire. J'avais évoqué ce sujet l'année dernière. Une négociation devait être lancée à ce sujet, mais le chantier n'a guère progressé. Seuls 800 000 euros ont été annoncés pour revaloriser la grille indiciaire de ces enseignants, ce qui ne constitue qu'une partie de la question du statut. Ils ne sont, une nouvelle fois, pas inscrits dans le bleu budgétaire. On ne sait d'ailleurs pas bien comment ils vont être ventilés entre les différentes écoles d'art. Ces enseignants ont besoin de voir leur statut consolidé. Il en va de l'avenir de nos écoles d'art territoriales. En outre, l'année prochaine, les écoles d'art territoriales vont entrer dans la plateforme « Parcoursup ». Il faudra être vigilant pour que leurs spécificités soient préservées.
Enfin, je terminerai par la sécurité. Cela concerne tous nos événements. Le fonds d'urgence a octroyé plus de 18 millions d'euros d'aide depuis sa création en 2015. Il va disparaître en fin d'année, pour être remplacé par un fonds doté, en 2019, de 2 millions d'euros, au bénéfice de l'ensemble des opérateurs culturels hors opérateurs nationaux. Le ministère de la culture indique que les entreprises de spectacle doivent désormais internaliser les coûts de sécurité. Notre vigilance doit s'exercer particulièrement en ce qui concerne les festivals. Les préfets ont pour consigne de regarder avec discernement si certains festivals peuvent ou non internaliser ces coûts de « sécurité ». Ces derniers vont augmenter en raison de la circulaire dite « Collomb » sur l'indemnisation des services d'ordre. Cela va avoir des impacts très forts sur le modèle économique des structures, mais aussi l'événementiel. Je ne souhaiterais pas que ce soit in fine les collectivités territoriales qui doivent compenser ces coûts. Il y a un vrai danger en la matière.
En conclusion, vous avez compris que les points de vigilance sont les mêmes que l'année dernière. Par rapport à un budget que je considère peu lisible car il noie des transferts de crédits, notre suivi et notre contrôle doivent être renforcés. C'est à ce moment-là que l'on pourra vérifier si les bons choix ont été faits. Mais, globalement le budget est stabilisé. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de donner un avis favorable aux crédits de ces deux programmes.

Je souhaite souligner les compétences et la passion de notre rapporteure. Ce rapport montre des points positifs, mais il met l'accent sur la vigilance dont nous devons faire preuve. Les parlementaires sont là pour jouer leur rôle de contrôle. D'une part, on nous indique que ce budget est consolidé et stabilisé. On nous annonce une sincérité budgétaire. Mais, d'autre part, on constate l'existence de crédits « cachés » à travers les crédits de gestion. On se demande où ces crédits vont être pris.
Il faut surveiller les crédits déconcentrés. Enfin, je pense que le principal point de discussion est le crédit d'impôt spectacle vivant, que l'Assemblée nationale a fragilisé. Le ministre nous a indiqué être très attaché aux crédits d'impôt. Il y a donc un hiatus.
Afin de compenser la CSG, la ministre nous avait promis 18 millions d'euros. Certes, nous ne sommes pas encore le 31 décembre, mais ils n'ont pas encore été versés.
En ce qui concerne les festivals, nous avons travaillé sur cette question avec les membres du groupe d'études rattaché à notre commission. Lorsque la circulaire indique que les préfets doivent regarder avec discernement la situation de chacun des festivals, cela a fait sourire jaune un certain nombre de collectivités. On a vu que le discernement était à la carte en fonction du préfet et de sa sensibilité culturelle. La hausse des coûts de sécurité réduit d'autant les enveloppes consacrées par les organisateurs à la création. Prenons-y garde. La création et nos artistes en région vont en pâtir.
Je reconnais l'aspect positif de ce budget et le groupe RDSE donnera un avis favorable à l'adoption des crédits. Nous devons exercer notre mission de contrôle tout au long de l'année.

C'est le deuxième budget que j'examine. Étant donné l'état financier de notre pays, la culture s'en sort plutôt bien. Mais, il s'agit d'une façade. Ce qui est en trompe-l'oeil est beaucoup plus important. On parle de crédits de gestion, de gels de crédits. Il faudra être attentif tout au long de l'exercice budgétaire, et notamment lors d'un exercice qui ne passionne pas les foules : l'examen du projet de loi de règlement. Il est adopté dans l'indifférence générale, alors qu'il est d'une importance capitale. Dans nos communes, le compte administratif est plus important que le budget.
Au demeurant, on sent qu'il y a désormais un autre pilote dans l'avion au ministère de la culture.

Il s'agit maintenant de voir le pouvoir du nouveau ministre vis-à-vis de Bercy.
Le Pass culture est symbolique de la politique culturelle du chef de l'État. 34 millions d'euros ont été inscrits au budget. On voit qu'il y a aujourd'hui une grande volonté de le développer, avec une ampleur qui peut rapidement devenir exponentielle. Nous avons la certitude que les personnes que nous avons rencontrées sont compétentes. C'est la différence entre cette grande compétence, l'ambition affichée et la réalité de terrain qui m'inquiète davantage. Ce ne sont pas trois personnes qui vont diffuser sur l'intégralité du territoire national une opération emblématique pour le Président de la République. J'adhère ainsi à la proposition de Sylvie Robert de pouvoir suivre de près la réalisation des expérimentations dans les cinq départements tests.

J'ai retenu deux mots : vigilance et ajustement plutôt que stabilité. Il est parfois difficile de s'y retrouver dans ce nouveau périmètre des missions.
En ce qui concerne le Pass culture, dans le Finistère, il n'y a eu aucune évolution, aucune nouvelle depuis son annonce, alors qu'il s'agit d'un des territoires d'expérimentation. Il y a eu un travail sur le choix des jeunes afin d'essayer de ne pas avoir des profils de jeunes identiques mais de viser des publics éloignés de la culture. Cela n'a pas abouti pour l'instant. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce dossier.
Un autre point de vigilance pour notre groupe concerne la sécurisation des spectacles et les conséquences de la circulaire Collomb du mois de mai dernier. J'avais eu l'occasion d'interpeller le ministre sur ce point. Le syndicat des musiques actuelles et le Prodiss ont déposé un recours contre ce texte. Ils en demandent l'annulation. Il est fortement préjudiciable pour la pérennité des spectacles et des festivals, dont l'équilibre économique est menacé.
Je constate, de manière générale, qu'il n'y a pas de culture sans artiste, sans auteur, sans emploi. Les artistes sont en grande fragilité. Le Fonpeps a été mis en place en 2016. Il se trouve dans une situation très délicate. Aucune évaluation n'en a été faite et le budget 2019, en baisse, s'est aligné sur le budget de l'année dernière où les différentes mesures n'étaient pas encore entrées en vigueur alors qu'une nouvelle mesure s'applique depuis l'été dernier concernant les salles de petite jauge. La baisse des crédits intervient beaucoup trop tôt.
Le Centre national de la musique est un serpent de mer. On a besoin d'un centre d'observation et de ressources pour le secteur de la musique. La première fois que ce projet a été évoqué, c'était sous Nicolas Sarkozy. Je me demande pourquoi les crédits destinés à sa création n'ont pas véritablement été inscrits mais doivent être dégagés en gestion.
Un mot sur l'emploi des artistes et la révision des accords collectifs avec le MEDEF : les annexes 8 et 10 de la convention d'assurance-chômage sont intégrées dans ces négociations. Une lettre de cadrage a été envoyée demandant 3 à 4 milliards d'euros d'économie pour l'ensemble de ces accords. Nous allons être sollicités pour soutenir les intermittents du spectacle.
Enfin, je regrette l'absence de débat sur les langues de France. On a beaucoup parlé de la francophonie. Mais il existe un riche patrimoine immatériel : le patrimoine des langues des France, au nombre de 75. On se mobilise pour sauver un château. On doit se mobiliser pour sauver une langue également. Une langue contient toute la communication, l'histoire et la culture.

Je voudrais revenir sur le problème de lisibilité du budget. Cette difficulté n'est pas nouvelle. Mais, deux faits doivent être notés : tout d'abord le gouvernement a fait en sorte que le taux de mise en réserve soit abaissé de 8 à 3 % depuis l'an dernier. Cela a un effet très significatif. Nous avons connu ces dernières années des rabots et des décrets d'avance que nous ne pouvions pas étudier dans les faits. Cela renvoie au projet de loi de règlement. Avec Vincent Éblé, j'ai été rapporteur spécial des crédits de la mission culture pendant trois ans. On voyait de vraies différences liées à ces rabots qui arrivaient au dernier moment. Ce budget 2019 a une volonté de sincérité : il y aura moins d'écart entre le budget initial et le budget réalisé.
Pour la première fois, et nous le demandions à la commission des finances, un agrégat a été constitué. Le gouvernement, à travers la mission culture, a choisi de communiquer sur le montant total des financements en faveur du secteur culturel. On s'aperçoit qu'il atteint 10 milliards d'euros. On oublie en effet la dépense fiscale. Nous sommes aujourd'hui à 0,98 % du budget de l'État. Mais si on inclut la dépense fiscale, c'est-à-dire les crédits d'impôt, l'effort est important. Cela fait partie de la lisibilité budgétaire.
Certaines remarques et critiques de la rapporteure sont tout à fait justifiées. Il y a ainsi eu une erreur sur le Pass culture. On a commencé par créer la plateforme avant de se poser la question de la méthodologie, de la tarification, de son contenu, de la place à octroyer aux différents acteurs culturels (lieux, plateformes ...) en son sein. Je suis content de savoir que le nouveau ministre s'attaque à cette question.
La critique sur la baisse du crédit d'impôt pour le spectacle vivant est fondée. Ce crédit d'impôt est essentiel. S'agissant du fonds d'urgence, créé suite aux attentats de 2015, je rappelle qu'il ne devait fonctionner à l'origine qu'un an. Il est cofinancé par l'Etat, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), la Ville de Paris et les sociétés de gestion de droits. Nous avions obtenu, à la commission des finances, qu'il soit prorogé et élargi pour tenir compte de certains acteurs qui en étaient exclus, notamment les festivals. Lorsque l'on auditionne les représentants du Prodiss, ils reconnaissent que la fréquentation est revenue et que les ressources de billetterie sont en hausse. Certes, les coûts de sécurité demeurent. Mais je serai un peu plus mesuré. Il n'est pas question pour l'État de payer tous les coûts de sécurité. Je ne vois pas pourquoi l'État payerait à la place d'un département qui a beaucoup de ressources - celui des Hauts-de-Seine par exemple - pour des manifestations culturelles organisées par ce dernier. Il est intéressant de faire un examen au cas par cas. L'État doit intervenir quand les collectivités territoriales ou les organisateurs ne peuvent pas le faire, même si, au total, la question des coûts de sécurité est importante, car elle a un effet qui n'est pas compensé par le redémarrage de la billetterie.
Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, qui a une phobie des crédits d'impôt, a la volonté de les réduire. Il a publié un rapport à ce sujet en juillet. Toutefois, je note que le cinéma est totalement épargné, alors que c'est le plus gros crédit d'impôt. Bien sûr il y a peut-être trop de dépenses fiscales. Mais il y a de bonnes dépenses fiscales, qui sont importantes. Je pense à celles concernant le spectacle musical vivant. On les coupe avant même de les évaluer. Je pense aussi au crédit d'impôt pour les jeux vidéo. Couper ces dispositifs fiscaux qui sont plutôt efficaces et permettent de maintenir des emplois en France pose question. Il va falloir expliquer à l'Assemblée nationale et à son rapporteur général que tous les crédits d'impôt ne sont pas mauvais. Il faudrait qu'il cherche des économies ailleurs.
Enfin, je souhaite évoquer la question du handicap. Je rappelle qu'ont été mises en place des unités localisées pour l'enseignement scolaire (ULIS) permettant de scolariser des élèves présentant des troubles compatibles. Ils ont pu bénéficier des résidences d'artistes implantées dans les établissements scolaires.
Bien évidemment, je donnerai un avis favorable à l'adoption de ces crédits.

Globalement, on peut considérer que la stabilité des crédits est de bon aloi. En ce qui concerne la sincérité budgétaire et la volonté d'ajuster au mieux les bourses d'enseignement supérieur ou le fonpeps, on peut l'entendre dans une période de sincérité affichée. Mais c'est en contradiction avec les crédits de gestion. Si on est sincère, on intègre toutes les dépenses. On ne donne pas l'impression qu'il y a des crédits cachés que l'on peut utiliser au gré des projets en cours d'année.
En matière de politique déconcentrée, je note l'absence de transparence sur les éléments de péréquation et la répartition concrète d'un territoire à l'autre. On sait que le budget consacré à la culture par habitant n'est pas le même d'une région à l'autre. Il faudrait pouvoir disposer de données précises. S'il y a des injustices, elles mériteraient d'être réparées. En outre, une partie des crédits relève d'appels à projet en cours d'année. Très clairement, c'est celui qui entend l'appel qui y répond. Cela pose une question en termes d'équité territoriale.
Je partage les points de vigilance évoqués par notre rapporteure. Le Pass culture a été largement évoqué tout comme la compétence des nouveaux intervenants. Il faut toutefois avoir conscience des objectifs parfois divergents des partenaires de ce Pass culture. Prenons garde à ce que les objectifs louables des ministères ne soient pas dévoyés.
La question des conservatoires avait été soulevée l'année dernière. Le ministre a affirmé son soutien. Il n'en reste pas moins qu'il y a un hiatus entre le coeur de métier des conservatoires et les nouvelles missions qu'on leur confie, d'autant que cette évolution n'a pas de traduction budgétaire.
Il faut accompagner les artistes et les créateurs. Par essence, ce sont des métiers faits d'aléas, de passions, de parcours erratiques, d'opportunités ou de creux d'activité. Tout ce qui peut contribuer à les sécuriser est propice à l'effervescence et à la création culturelles. Lorsque l'on aide les artistes, on aide notre production culturelle dans sa diversité.
Je suis très attentive aux arts visuels. Même dans la pratique artistique à l'école et hors de l'école, on n'en parle pas. Ces arts sont une filière sur laquelle tout est quasiment à construire ou à mettre en ordre.
Enfin, quelques mots sur l'éducation artistique et culturelle et le soutien à la démocratisation. J'insiste sur l'engagement qui doit être réel des deux ministères concernés par cette politique. Il faudrait que le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse prenne davantage sa part dans le financement. Les actions ne sont pas forcément complémentaires.
Il y a une contradiction entre la manière dont les collectivités territoriales sont mises à contribution et l'encadrement de l'augmentation de leurs dépenses des collectivités. Il est souhaitable que les politiques culturelles soient co-construites avec les territoires, car les collectivités sont au plus près de la réalité du terrain et des besoins, mais l'encadrement des dépenses des collectivités va poser un problème. Des choix de politiques publiques locales devront être faits.
Enfin, le fonds handicap, nouvelle dépense en 2018, n'apparaît plus en 2019. L'équité doit concerner et les territoires et les citoyens. On retrouve certainement ce fonds ailleurs, mais, lorsqu'il n'est plus identifié, on n'a plus le sentiment qu'il s'agit d'un objectif en soi.

Nous partageons bon nombre des remarques exprimées. Ce budget est en apparence stabilisé. Il semblerait, en outre, qu'il y ait désormais un pilote dans l'avion. Mais de nombreuses contradictions demeurent. Plusieurs ont été relevées. La politique de l'État en matière de culture s'appuie sur de plus en plus de partenaires qui ne sont pas forcément en situation d'assurer ce partenariat, ou qui n'ont pas les mêmes ambitions ou la même philosophie que la puissance publique. Les collectivités n'ont plus les mêmes moyens et voient leurs dépenses de fonctionnement encadrées. Or, on sait que les budgets culturels sont souvent les premiers touchés par ces réductions de moyens. En effet, ces budgets n'apparaissent pas, y compris dans l'opinion publique, comme une intervention prioritaire.
Je ne reviens pas sur la baisse du nombre des emplois aidés qui a fait beaucoup de mal dans les associations et le monde culturel comme dans le monde sportif.
Je rejoins également ce qui a été dit sur le Pass culture. Au-delà de l'improbable logique dans laquelle s'est engagée cette affaire, il reste beaucoup d'interrogations sur les partenaires qui vont s'engager, mais aussi sur les raisons qui vont les inciter à le faire.
Il faut également prendre en compte les incertitudes et les inquiétudes qui traversent le monde de la culture - les écoles d'art ont été évoquées. Je rejoins ce qui a été dit sur les intermittents du spectacle. Plusieurs annonces ont été faites, y compris sur la réforme des retraites. Elles ne peuvent que les inquiéter.
Je terminerai par la suppression du fonds d'urgence. Cela peut avoir des effets extrêmement graves. Certes, on est sur une autre échelle, mais j'ai constaté que dans mon département qu'au mois de juin des manifestations comme des fêtes de fin d'année dans les écoles ont été remises en cause pour des raisons sécuritaires. Cela a suscité un émoi terrible parmi les parents d'élèves et les enseignants. Dans le climat actuel, alors que ces animations sont des outils de cohésion sociale et territoriale, nous aurions beaucoup de souci à nous faire si elles disparaissaient.
Vous ne serez donc pas surpris : nous donnerons un avis défavorable à l'adoption de ces crédits.

Beaucoup de sujets ont été évoqués. Le groupe Les Indépendants donnera un avis favorable, mais avec quelques points de vigilance, notamment pour le Pass culture. Je me joins à ce qui a été dit sur les coûts de sécurité. Ils ne doivent pas pénaliser les communes, avec les réserves qu'a émises M. Gattolin sur les différences entre collectivités.
Exception faite de ces points de vigilance, je donne un avis favorable à ces crédits.

Je souhaite aborder un projet immobilier d'envergure, porté par le programme « création », la création de la cité du Théâtre aux ateliers Berthier. Ces ateliers ont été créés par Charles Garnier pour accueillir les décors de l'opéra de Paris. Ils vont céder la place à une cité du théâtre sur 20 000 mètres carrés. C'est un fait assez rare pour être souligné : nous avons réussi à rassembler les intérêts de quatre grandes institutions culturelles - l'Opéra de Paris, l'Odéon théâtre, la Comédie française et le Conservatoire supérieur d'art dramatique. Par ailleurs, sa situation sur le boulevard des Maréchaux permettra d'en faire profiter tout le Grand Paris.

En ce qui concerne le Pass culture, comment se fait son articulation avec les dispositifs de même nature qui existent parfois dans les régions ?
Nous sommes tous sensibles à la question des moyens alloués pour les actions en direction des publics spécifiques. Je rappelle que nous avons voté des droits culturels dans la loi NOTRe et la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Comment garantir que ces dispositifs persistent et soient même renforcés ?

J'ai indiqué que les crédits pour les politiques territoriales étaient en baisse. Pour être très précise, les crédits en direction des quartiers de la politique de la ville et des pratiques artistiques amateurs sont en baisse. Les crédits spécifiques culture-justice et culture-handicap sont stables. Il faut sur ce point demeurer vigilant.
L'articulation avec les pass culture territoriaux fait partie des questions que nous avons identifiées au sein du groupe de travail. Le Pass culture va parfois percuter des dispositifs existants et qui ont fait leurs preuves dans des régions ou départements. C'est un des points de vigilance.
En 2020, le concours de maîtrise d'oeuvre de la cité du théâtre doit être lancé, pour, semble-t-il, une livraison en 2023 - avec toutes les réserves qui s'attachent aux dates d'exécution des grands chantiers.
Nous serons vigilants sur la question de l'emploi à tous les niveaux. Il faudra également regarder les éléments de péréquation entre les régions et les crédits des DRAC. Il sera intéressant d'étudier la manière dont la répartition se fait. Je rejoins notre collègue sur les appels à projet : les collectivités qui sont prêtes peuvent y répondre, mais avec le capage à 1,2 % elles ne pourront plus le faire.

Avant d'examiner les deux amendements, on peut souligner les points positifs de ces crédits : une consolidation du budget, et la présence d'un pilote dans l'avion des politiques publiques de la culture. À la suite de l'audition de Franck Riester, nous avons été rassurés sur la méthode que souhaite mettre en place le ministre. Il souhaite travailler en lien avec les collectivités territoriales. Il a clairement affiché ce désir de dialogue constant avec les différents niveaux de collectivités. Au cabinet l'a d'ailleurs rejoint l'ancienne présidente de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), Déborah Münzer. Cela témoigne de ce souci des territoires.
À l'issue de la période budgétaire, nous allons engager un travail de bilan de l'application de la loi NOTRe. Je souhaite qu'à cette occasion on puisse faire le bilan des commissions cultures des commissions territoriales de l'action publique, où les différents niveaux des collectivités territoriales sont censés s'être réunis pour évoquer des sujets de politique culturelle.
Le groupe de travail Pass culture va poursuivre ses travaux. Il faudra évaluer les expérimentations. Dans le département de l'Hérault, les retours sont plutôt mitigés. Il est vrai qu'on revient de loin.
J'aimerais que nous aboutissions sur deux sujets qui pourraient être la marque de fabrique de notre commission : les écoles d'art et les conservatoires. Il s'agit de formation. En outre les collectivités sont très impliquées. Ces deux chantiers traînent depuis des années. Je constate que, s'agissant des écoles territoriales d'art - pourtant établissements d'enseignement supérieur -, l'État est financièrement peu présent. Ce sont les villes qui se sont associées en établissement public de coopération culturelle pour se mettre en conformité avec le système licence, master, doctorat (LMD).

S'agissant du nouveau ministre de la culture, j'ai entendu à plusieurs reprises qu'il y avait un pilote dans l'avion. De prime abord, il me semble qu'il a son brevet de pilote. Mais personnellement, je juge de la qualité d'un pilote pendant et à la fin du vol. Pour rependre un mot répété plusieurs fois ce matin, il faudra faire preuve de vigilance.

Nous pourrons également juger de sa capacité à s'imposer face à Bercy. Mais, il aura peut-être besoin de notre soutien à cette fin.

Nous allons voir comment le ministre se positionne sur les deux amendements.
Le premier concerne le CNM. Lors de son audition par notre commission, le ministre s'est engagé à débloquer cinq millions d'euros en crédits de gestion pour la création de cette nouvelle institution. Or, la filière a indiqué que 10 millions d'euros sont nécessaires pour franchir la première étape et permettre la mise en place de l'observatoire de la musique que nous avons créé dans la loi LCAP. Aussi, je vous propose de prendre cinq millions d'euros sur le Pass culture pour les affecter à la mise en place du CNM, auxquels s'ajouteront les cinq millions de crédits de gestion. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi les crédits prévus pour le Pass culture vont être utilisés. Cela peut d'ailleurs être l'occasion pour le ministre de se positionner sur ce dossier.

Par principe, nous préférons ne pas participer au vote. Mais, vous aurez sur cet amendement notre soutien moral.

Sur cet amendement, je suis tiraillé à titre personnel - et je n'engage pas le groupe politique dans cette réflexion - étant à la fois président du groupe de travail sur le Pass culture, mais ayant exercé professionnellement dans le domaine de la musique. Nous verrons la réponse du ministre de la culture. Mais l'amendement me paraît sage.

Je trouve cette proposition intéressante. Lors de notre intervention pour le groupe l'année dernière, nous avions évoqué une réorientation d'une partie des budgets vers les conservatoires. Nous avions déjà suggéré que ces crédits dont on ne connaît pas forcément l'usage - je crois savoir que les crédits destinés au Pass culture de l'année dernière n'ont pas été consommés dans leur intégralité - soient partiellement reventilés. En effet, la somme consacrée est suffisamment importante et peu précise pour pouvoir le faire. Cela permet également de montrer nos priorités dans ce budget pour la culture.

Cet amendement est une bonne idée. Je suis très favorable à donner des crédits supplémentaires au CNM. Toutefois, je m'abstiendrai car il faut réfléchir aux conséquences de cette reventilation.

Nous voterons cet amendement, puisque le Pass culture est actuellement en expérimentation sur cinq départements. Il est donc possible de prendre une certaine somme afin de favoriser un autre budget.
L'amendement n° II-336 est adopté.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Culture du projet de loi de finances pour 2019.

L'amendement n° II-335 concerne le crédit d'impôt spectacle vivant. Tout comme moi, vous avez lu dans la presse que le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale veut clairement en réduire le nombre. Il s'est fait partiellement reprendre par le Gouvernement, mais il continue cette bataille, pour mettre fin aux crédits d'impôt consacrés à la culture notamment. Pour reprendre ses propos, il considère que l'évaluation dans le domaine de la culture des crédits d'impôt est « accablante ».
Nous allons voir la position du ministre. En effet, c'est le Gouvernement qui a déposé un amendement sur le crédit d'impôt spectacle vivant. Il est assez récent puisqu'il date de 2016. On a très peu de recul en termes d'évaluation. Celle réalisée par un cabinet de conseil privé à la demande du Prodiss (Syndicat national du spectacle musical et de variété) montre qu'il est intéressant : il a permis de créer de l'emploi et a des effets bénéfiques pour la filière. Il est vrai qu'un peu plus de recul aurait été de bon aloi.
Le Gouvernement souhaite modifier ce crédit d'impôt à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il en a privé du bénéfice - et je ne sais pas pourquoi - les spectacles de variétés, et notamment les spectacles d'humour et de comédies musicales. Or, ces derniers rapportent beaucoup d'argent, et vous savez qu'une partie de la recette remonte au CNV par le biais de la taxe parafiscale et est ensuite redistribuée à l'ensemble de la filière. C'est un signal particulier qui est envoyé, car dans le même temps, l'Assemblée nationale a étendu à la téléréalité le bénéficie du crédit d'impôt audiovisuel. En outre, je trouve qu'il y a des spectacles d'humour de grande qualité aujourd'hui. Aussi, je vous proposerai de les maintenir dans le champ du crédit d'impôt.
Par ailleurs, un amendement du rapporteur général a demandé une évaluation du dispositif en 2022. Nous ne pouvons que souscrire à cette évaluation. Il est important de contrôler l'impact des crédits d'impôt.
En revanche, la seconde partie de l'amendement gouvernemental vise à durcir considérablement les critères pour favoriser davantage l'émergence des artistes. Mais les critères retenus ont des effets contreproductifs, et par ailleurs, ils n'ont pas été travaillés avec la filière. J'ai pris l'attache de l'ensemble de la filière musicale. Je ne voulais pas que l'on soit dans une situation où l'on rejette de manière brutale l'amendement du Gouvernement. Je préfère vous proposer des nouveaux critères qui ont été négociés, validés et travaillés par la filière elle-même. Elle a réfléchi à la manière de favoriser véritablement l'émergence. Pour considérer qu'un artiste est un artiste émergent, le présent amendement maintient le critère jusqu'ici en vigueur prévoyant qu'aucun spectacle de l'artiste concerné ne doit avoir réalisé plus de 12 000 entrées payantes. En outre, je vous propose un nouveau critère, excluant du bénéfice du crédit d'impôt tout artiste dont le spectacle aurait été présenté plus de quatre fois dans des salles d'une jauge de 6 000 personnes. Cet ajout permet d'éviter que des grands artistes reconnus bénéficient de ce crédit d'impôt qui n'est pas fait pour eux. Je vous propose que l'entrée en vigueur de ce nouveau crédit d'impôt remanié soit reportée à avril 2019. L'amendement gouvernemental prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2019. La loi va être promulguée fin décembre. Il paraît impossible juridiquement de le mettre en place dans un délai aussi court.
Je vais voir comment le ministre réagit à cette proposition d'amendement rédigé en concertation avec la filière.

Il s'agit d'un article non rattaché de la seconde partie du projet de loi.

Comment faites-vous pour vous exonérer de l'article 40 de la Constitution ?

Nous ne créons pas de charge nouvelle par rapport au droit en vigueur aujourd'hui. Nous proposons des améliorations à l'amendement du Gouvernement.

Nous n'allons pas entamer ici le débat de l'intérêt des crédits d'impôt, mais il me semble que la visibilité est plus importante lorsque l'on met des ressources budgétaires. Je m'intéresse beaucoup au crédit d'impôt recherche - 6,5 milliards d'euros - pour lequel il n'existe aucun bilan. Je trouve scandaleux d'attaquer les dispositifs culturels alors que ceux-ci s'appuient sur des arguments forts. Même le crédit d'impôt pour le cinéma, qui est le plus important, a des effets visibles sur l'offre cinématographique française. Dans le bleu budgétaire sur le crédit d'impôt recherche, on vous explique depuis dix ans que son avantage pour la recherche et le développement privé est autour de 1. Et, lorsque vous demandez un bilan, on vous oppose le secret fiscal. Il n'y a pas de possibilité de faire une évaluation concrète. C'est ma crainte par rapport à ce type de dépense : on oppose systématiquement le secret fiscal auquel s'ajoute désormais le secret des affaires.

Cet amendement est intéressant et nous le soutiendrons. Un crédit d'impôt créé en 2016 ne peut pas s'arrêter sans évaluation. Nous avions été sollicités par la filière pour des modifications du texte. Pensez-vous qu'elles sont intégrées dans votre rédaction ?

Nous avons travaillé avec la filière. Elles sont donc prises en compte.

Dans l'hémicycle j'évoquerai les arts du cirque qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt spectacle vivant alors même que le cirque constitue l'une des esthétiques du spectacle vivant. Nous les avons reçus dans le cadre du groupe d'études arts de la scène, arts de la rue et festivals en régions.

Cet amendement est nécessaire. En matière de crédits d'impôt, nous sommes confrontés à une situation paradoxale : nous n'avons aucune visibilité s'agissant de crédit d'impôt recherche, sans doute parce qu'il profite à des grandes entreprises, qui cumulent cet avantage et le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). À l'inverse, les crédits d'impôt du secteur de la culture sont évalués. Et nous savons, par exemple pour les crédits d'impôt qui bénéficient au cinéma, quel est leur impact positif en termes d'emploi et de dépenses supplémentaires réalisées en France.

Cet amendement est en effet nécessaire. Il est important de favoriser l'émergence des nouvelles formes de création, dont le statut est précaire. Il s'agit de remettre un peu de justice au milieu du village car notre réflexion doit être globale. Quelle est donc la logique budgétaire de faire un sort particulier à l'humour et à la téléréalité ?

cJe ne vois pas, au sein du projet de loi de finances, de réforme structurelle. C'est pourquoi le saltimbanque que je suis et que je resterai souscrit des deux mains à cet amendement.
L'amendement n° II-335 est adopté.
La réunion est close à 11 h 50.