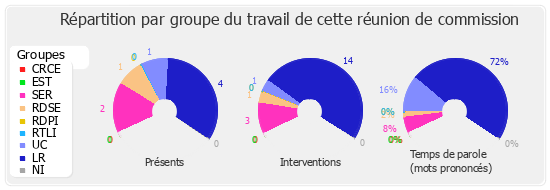Ce site est une archive.
Il reflète uniquement l'activité des sénateurs sur la période d'octobre 2004 à mars 2023.
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du 3 février 2022 à 9h05
Sommaire
La réunion
Je souhaite la bienvenue à tous les parlementaires assidus qui se retrouvent ce matin pour une nouvelle réunion de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et je donne immédiatement la parole à notre collègue Philippe Bolo, dont on connaît l'implication dans les travaux de l'Office et qui va nous présenter une note scientifique sur un thème tout à fait inscrit dans l'actualité : le microbiote intestinal.
Nous sommes effectivement réunis ce matin pour examiner une note scientifique sur le microbiote intestinal. Il s'agit, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le président, d'un sujet qui apparaît de plus en plus dans l'actualité scientifique et dans les médias. Il entrait donc dans la vocation de l'Office de se pencher dessus afin de distinguer certitudes et incertitudes.
Je commencerai logiquement mon exposé par une présentation de ce qu'est le microbiote, avant de vous expliquer les liens découverts entre le microbiote et la santé et de partager avec vous quelques interrogations sur son traitement législatif et réglementaire. J'essaierai en conclusion de répondre à la question de savoir s'il s'agit d'un simple effet de mode ou d'une tendance structurelle.
Vous le savez, nous sommes les hôtes de micro-organismes qui colonisent différents compartiments de notre corps, dont les parties en contact avec le milieu extérieur, telles que la peau et diverses muqueuses, notamment respiratoires.
L'intestin est la partie du corps humain qui héberge le plus de micro-organismes, avec un écosystème riche et diversifié, composé notamment de nombreuses bactéries, dont on parle fréquemment car elles sont peut-être les mieux connues et les plus utilisées. On estime à 1,5 kg la masse des micro-organismes présents dans l'intestin d'un individu et à quelque 100 milliards le nombre de micro-organismes dans un gramme de matière fécale.
Il est important de s'intéresser à ces micro-organismes sur un plan génétique, car ceci va permettre de comprendre la synthèse de certaines protéines et d'éclairer l'une des formes d'interaction entre ces micro-organismes et le corps humain. Il apparaît ainsi que 600 000 gènes composent le génome « moyen » du microbiote, soit 25 fois plus que dans notre propre génome.
Le microbiote n'est pas composé uniquement de bactéries, mais compte aussi des archées, des virus, des champignons, qui tous cohabitent à l'intérieur de notre corps.
La colonisation du corps par ces micro-organismes s'effectue au moment de la naissance, puis cette communauté évolue tout au long de la vie de l'individu sous l'influence de différents facteurs, parmi lesquels les maladies, les interactions sociales, l'alimentation, l'activité physique et le milieu de vie. Chacun de ces paramètres externes peut avoir des effets, positifs ou négatifs, sur ces communautés de bactéries, en apportant des populations nouvelles ou en en faisant disparaître.
L'observation des interactions entre les bactéries que nous hébergeons et notre milieu de vie, au travers par exemple d'une mise en contact avec certains produits chimiques, des maladies qui peuvent nous infecter ou encore de notre alimentation, montre que l'environnement influence la communauté des micro-organismes et peut par conséquent avoir un impact sur notre santé. Ces interactions ont conduit au concept de « One health », dont vous avez tous entendu parler et qui mériterait d'être un jour étudié par l'Office.
Comme toute autre, cette communauté des micro-organismes, composée notamment de bactéries, est le théâtre de concurrences - certaines bactéries essayant de prendre l'ascendant sur d'autres -, de synergies, d'antagonismes. Ainsi, certaines populations croissent, tandis que d'autres diminuent, en fonction de facteurs qui les favorisent ou les défavorisent.
Nous entretenons ainsi avec les populations de micro-organismes que nous hébergeons dans notre intestin une symbiose, qui peut être en équilibre (« eubiose ») ou en déséquilibre (« dysbiose »). Je vais surtout m'intéresser ici à la dysbiose, dans la mesure où elle est révélatrice d'un certain nombre d'impacts sur la santé.
La communauté micro-organique présente la particularité de produire des métabolites. Elle est en effet constituée d'organismes vivants dont les gènes vont être transcrits pour donner naissance à des protéines. De plus, lorsqu'elles meurent, les bactéries donnent naissance à des coproduits. Il existe ainsi une chimie organique liée à l'écosystème du microbiote, qui va pénétrer dans notre système sanguin, donc influencer notre santé.
L'équilibre symbiotique joue sur la perméabilité de la barrière intestinale, sur le système immunitaire et le métabolisme, notamment via les métabolites en circulation dans le sang. Les auditions que j'ai conduites ont mis en lumière le fait que 30 % des éléments détectés lors d'une prise de sang sont des molécules qui, à un moment donné, ont été synthétisées ou transformées par les bactéries symbiotiques, ce qui montre clairement l'incidence que ceci peut avoir sur notre santé.
Une dysbiose se traduit par une baisse de la diversité des organismes hébergés, notamment des bactéries ayant un rôle anti-inflammatoire. La science a mis en évidence un certain nombre de conséquences de ces dysbioses, que vous trouverez précisément expliquées dans la note. On y trouve des maladies cardiométaboliques comme le diabète et l'obésité, ainsi que des maladies cardiovasculaires et des pathologies intestinales. Un professeur du CNRS, spécialiste de la relation entre intestin et cerveau, nous a montré que le système sanguin et les métabolites qui y circulent sont un vecteur important de la régulation de l'intestin sur le cerveau.
Outre les produits chimiques présents dans notre environnement, l'alimentation figure au premier rang des responsables de la modification du microbiote. Certains aliments, parmi lesquels les aliments fermentés et les fibres, favorisent les « bonnes » bactéries, d'autres les défavorisent. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'évolution de l'apparition des maladies chroniques au regard de notre consommation de fibres et ont constaté qu'il existait une corrélation entre les deux : plus le bol alimentaire est pauvre en fibres végétales, plus les conséquences sur les dysbioses sont importantes. Parmi les aliments défavorables au microbiote figurent notamment les additifs alimentaires. Notre collègue Angèle Préville pourra nous en dire plus à ce sujet dans quelques semaines, ce qui permettra de faire le lien entre nos travaux.
J'en arrive aux aspects réglementaires et aux approches thérapeutiques. Confrontée aux divers éléments que je viens de décrire, la communauté scientifique et médicale a considéré qu'elle était en présence de voies nouvelles pour une médecine différente. Un certain nombre de traitements inspirés de ces découvertes commencent à apparaître. Or il semble que le cadre législatif et réglementaire soit insuffisamment précis pour bien encadrer leur usage et sécuriser la santé des patients susceptibles d'en bénéficier.
De nouveaux paradigmes, de nouvelles pistes de recherche s'ouvrent et posent la question de la position de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur ces sujets. Permettez-moi de prendre deux exemples révélateurs.
Le premier concerne la transplantation de matière fécale (TMF), technique utilisée avec succès pour traiter une infection récidivante et mortelle, dite « Clostridioides difficile ». Ce sont des bactéries présentes dans notre microbiote qui, chez certains patients, à la suite notamment de dérèglements ou de traitements antibiotiques, dominent et provoquent des désordres intestinaux pouvant aller jusqu'à la mort. La TMF consiste à prélever des éléments de microbiote chez un individu donneur et à les transplanter chez le patient. Cette opération contribue à rééquilibrer la communauté bactérienne du patient en y réintroduisant des « bonnes » bactéries, avec un résultat que d'autres solutions thérapeutiques ne permettraient pas d'obtenir. Cette piste est donc très prometteuse. L'ANSM indique aujourd'hui que ce médicament (je reviendrai ultérieurement sur ce terme) peut être utilisé, mais uniquement à titre expérimental, dans le cadre d'essais cliniques et d'autorisations d'accès compassionnel. Vient par ailleurs s'ajouter l'existence de start-up qui développent cette technique. Vous imaginez l'impasse dans laquelle on va se trouver rapidement. Les auditions ont clairement montré qu'il existait une réelle difficulté avec, d'un côté, la recherche publique, les cliniciens et les médecins envisageant les choses d'une certaine façon, avec un volume et un domaine d'interaction, de l'autre les start-up qui pensent pouvoir agir plus largement et venir en appui des quelques expérimentations en cours. L'ANSM travaille sur le sujet et établit un cadre de bonnes pratiques. Mais il reste encore quelques étapes à franchir. L'article 35 de la loi de bioéthique récemment adoptée prévoit quelques avancées, mais il reste beaucoup de travail à accomplir.
Le deuxième exemple concerne les probiotiques. Ce sont des micro-organismes proposés à l'ingestion car jugés bénéfiques pour la santé. La définition en est toutefois extrêmement floue, les quantités ne sont pas précisées, pas plus que les types de produits dans lesquels on pourrait les trouver, le bénéfice attendu ou les potentiels bénéficiaires. Dans ce domaine aussi, on observe que des entreprises se développent, dans une logique de bien-être plus que dans une perspective médicale.
Au vu de ces éléments, il apparaît absolument nécessaire de mieux encadrer les usages autour du microbiote intestinal. Je rappelle qu'il existe trois grandes catégories pour le classement des spécialités pharmaceutiques : le don du sang, de cellules et de tissus ; la biologie ; le médicament. L'Europe essaie aujourd'hui de travailler sur ce sujet et considère par exemple que la TMF relève du bloc « don de sang, de cellules et de tissus », les bactéries présentes dans les matières fécales du bloc « biologie » et les métabolites produits par les bactéries elles-mêmes du bloc « médicament », puisqu'il s'agit clairement de chimie organique. Ceci permet de toucher du doigt la complexité et le flou qui entourent ce sujet. S'y ajoute le fait que les pays européens n'agissent pas de manière homogène. Il va donc falloir réguler ce secteur de l'activité médicale, pour la simple raison que si le cadre n'est pas précis et qu'il existe ailleurs des environnements législatifs et réglementaires plus favorables, les start-up qui développent ces produits s'installeront à l'étranger où elles pourront plus facilement passer de la recherche à la mise en place d'un traitement.
Quels sont les enjeux pour notre pays ? La France avait jusqu'à présent un rôle de leader, mais celui-ci est aujourd'hui clairement remis en cause.
La France dispose pourtant de nombreux atouts. Elle est tout d'abord la patrie de Pasteur, qui fut l'un des premiers scientifiques à étudier de façon précise ces micro-organismes. Elle a également la chance de bénéficier de la présence d'un organisme de recherche agronomique, l'Inrae, qui a occupé un rôle de premier plan dans les recherches sur les micro-organismes. L'héritage gastronomique français a par ailleurs contribué à structurer une sorte de conscience et de culture autour de ce sujet.
Tous ces éléments ont constitué un terreau favorable à la création de start-up et à la réorientation d'entreprises existantes vers ce secteur, pour produire des probiotiques ou des bactériophages, développer la TMF, travailler sur les métabolites des bactéries pour en extraire des molécules chimiques, proposer des analyses de microbiote, etc.
Il convient toutefois de ne pas considérer cette position comme acquise à jamais. Les entretiens et les auditions que j'ai conduits ont en effet révélé que le manque de moyens pouvait rendre difficile le recrutement de ressources humaines, notamment de bio-informaticiens, et la nécessité de se doter d'animaleries stériles, éléments indispensables à la chaîne de compréhension du microbiote. Les procédures d'essais cliniques sont par ailleurs très longues, ce qui peut démotiver certains acteurs économiques. La France est ainsi concurrencée aujourd'hui par des pays comme les États-Unis ou la Corée du sud.
Notre pays dispose malgré tout de quelques belles perspectives, avec notamment les dispositifs fiscaux incitant à la recherche, le crédit d'impôt recherche et le plan Innovation Santé 2030.
L'intérêt actuel pour le microbiote est-il un effet de mode ou au contraire une tendance structurelle majeure ? Le microbiote apparaît en effet comme une source potentielle de traitements médicaux nouveaux, il fait le lien entre nutrition et santé, et constitue un élément d'une médecine plus préventive et prédictive.
Deux approches du phénomène s'opposent toutefois aujourd'hui. D'aucuns, s'appuyant sur les aspects relatifs à la santé, aux dysbioses, aux phénomènes d'antibiorésistance susceptibles d'être éclairés par l'étude du microbiote, à l'existence de nouvelles technologies facilitant la caractérisation du microbiote (biologie moléculaire, métagénomique, intelligence artificielle), considèrent que l'émergence du microbiote est un élément structurel de la médecine. L'augmentation du nombre de publications consacrées à ce sujet, tout comme la hausse des investissements publics et privés dans le domaine, militent également en ce sens.
D'autres, en revanche, y voient un effet de mode et estiment qu'il ne faut pas considérer le microbiote comme une explication à tout. Certaines publications affirment par exemple que chaque maladie humaine pourrait trouver une explication dans le microbiote. Or les médecins auditionnés ont expliqué que ce n'était vraisemblablement pas le cas. Il convient également de se méfier de la communication excessive de certains médias et d'une offre commerciale proposant des analyses de microbiote, dont les médecins ont clairement dit qu'en plus d'être très coûteuses, elles ne servaient à rien dans la mesure où, chaque entreprise développant ses propres protocoles, les résultats sont inexploitables sur un plan médical.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où se dessinent des pistes très prometteuses qui ouvrent la perspective de nouvelles voies thérapeutiques. Cependant, il faudra très vite parvenir à distinguer celles qui seront des réalités des autres. De nombreuses connaissances restent encore à acquérir.
Merci beaucoup, cher collègue, pour cette présentation et cette étude, comme toujours extrêmement fouillée, qui fait le pont entre un sujet d'actualité, des connaissances scientifiques, des pistes de recherche et des éléments relatifs aux politiques publiques.

Merci pour cette présentation. Je suis très intéressée par ce sujet, car le Sénat a engagé un travail d'information sur l'obésité et sa prévention. Or le sujet du microbiote a déjà été évoqué à deux reprises lors des auditions conduites dans ce cadre. Il me semblerait donc très intéressant que le travail réalisé par Philippe Bolo puisse être présenté à la mission d'information du Sénat.
J'ai relevé au passage l'ouverture vers le concept « One health », auquel je souscris tout à fait. Je pense que l'Office est tout à fait compétent pour mener un travail sur ce sujet.

La lecture de la note et l'exposé qui vient de nous être présenté m'inspirent deux remarques sur le volet réglementaire.
La première est que les difficultés rencontrées en la matière rejoignent celles que j'avais évoquées devant l'Office à propos des phages. L'enjeu consiste, pour un sujet comme pour l'autre, à trouver une réglementation adaptée à une approche non totalement conventionnelle.
Les deux sujets ne sont, sur le fond, pas complètement indépendants, puisque le lien entre microbiote et antibiotiques a été établi, tout comme celui entre antibiotiques et phages, dans le sens où l'un pourrait être le successeur de l'autre dans certains cas.

Ma deuxième remarque concerne le fait que la note n'aborde pas la question de l'herboristerie. Or il se trouve qu'un médecin du Val-de-Marne écrit des ouvrages sur le fait que l'on peut entretenir et rétablir son microbiote avec des plantes. Je voudrais savoir si cet aspect a été évoqué.
Permettez-moi, chers collègues, d'ajouter mes questions aux vôtres.
Certains changements de mode de vie sont évoqués à la page 1, qui concernent le développement des accouchements par césarienne, le moindre recours à l'allaitement, l'exposition accrue à des polluants chimiques, etc. Or il semblerait que la pratique de l'allaitement ait connu un regain d'intérêt au cours des dernières années dans les pays occidentaux. Serait-il possible de brièvement rappeler, pour chacun des facteurs évoqués, l'impact des évolutions constatées ?
On comprend bien que la diversité est une notion clé en matière de microbiote. Quels sont les grands paramètres qui la gouvernent ? Pour en avoir discuté avec les responsables d'une start-up israélienne basée à Haïfa et travaillant sur le sujet du microbiote et de l'intelligence artificielle, il semble que l'on puisse classer les microbiotes en catégories, en fonction desquelles le terrain serait plus ou moins favorable au développement de telle ou telle pathologie. De la même façon que la médecine prédictive essaie d'établir des corrélations entre des caractéristiques du génome, des pathologies et des traitements possibles, il existe un champ dans lequel, en fonction de la catégorie de microbiote d'une personne, il serait possible de savoir qu'elle présente une prédisposition à telle maladie et pourrait répondre plus ou moins bien à un traitement donné. Les représentants de la start-up israélienne m'avaient expliqué que le décryptage et la classification du microbiote étaient à la fois plus simples que ceux du génotype et, par certains aspects, avaient un impact plus grand, car ils aideraient davantage à certaines décisions thérapeutiques. Pourriez-vous préciser cela ?

Mon interrogation, qui se situe peut-être en marge de cette note, concerne les relations entre notre cerveau et notre intestin, au-delà de l'analogie des formes. Existe-t-il des études montrant l'impact du stress, et plus généralement des peurs, sur le microbiote, sachant qu'il est avéré que le stress agit sur l'appareil digestif ?

Merci pour cette note extrêmement intéressante.
Je constate que vous avez réuni une table ronde avec des entreprises et reçu dans ce cadre Hervé Affagard, directeur général de MaaT Pharma, qui travaillait auparavant dans un laboratoire de l'Inrae sur le plateau de Saclay et m'avait sollicitée en 2018-2019. Cette personne n'a malheureusement pas trouvé en France de soutien pour la maturation de son projet et a dû se tourner vers les États-Unis. Ce sujet dépasse le cadre de cette note et renvoie plus globalement aux difficultés rencontrées en France par les porteurs de projets au moment d'investir plusieurs millions d'euros, et donc de franchir un cap. Cette situation m'avait vraiment désespérée, car ce projet me paraissait extrêmement innovant. J'ai eu beau frapper à toutes les portes, je n'ai pas pu l'aider à trouver en France le financement nécessaire. Avez-vous observé cette réaction typiquement française, plutôt frileuse à l'égard de ce type de projet ?
Dans une perspective connexe, je souligne qu'en attendant l'émergence de projets innovants, les patients souffrant de la maladie de Crohn étaient traités, de façon extrêmement classique, avec de l'Ercéfuryl. Ce médicament permettait en effet d'éviter des inflammations récurrentes de l'intestin. Or l'Ercéfuryl a aujourd'hui disparu et aucun médicament ne le remplace, si bien que les gastroentérologues se trouvent démunis. On est donc frileux en matière d'innovation thérapeutique sur le microbiote et en même temps, des médicaments traditionnels que les gastroentérologues pouvaient prescrire régulièrement ont disparu du marché. J'en ai parlé à plusieurs médecins, qui n'en comprennent pas la raison.
Ce sujet me paraît vraiment important. J'imagine que vous avez tous lu le best-seller intitulé L'intestin, notre deuxième cerveau, qui a révolutionné la vision que l'on avait de l'intestin. Or on a l'impression que la France est en train de tout faire à l'envers. Votre note m'intéresse donc d'autant plus.
Merci pour ce témoignage concernant à la fois le financement de l'innovation et une situation précise très éclairante.

Merci pour cette note qui va éclairer le travail que je m'apprête à conduire sur les additifs alimentaires, dont il semblerait qu'ils altèrent le microbiote. Ceci rejoint le travail sur l'obésité auquel participe Michelle Meunier au Sénat. Il existe plusieurs catégories d'additifs (colorants, émulsifiants, etc.) : certains ont-ils plus d'impact que d'autres ?

Je souhaiterais savoir si la recherche sur le microbiote a été affectée positivement par des découvertes technologiques. Je pense par exemple aux capacités d'analyse apportées par l'intelligence artificielle ou, d'une façon générale, aux technologies permettant de mieux saisir l'activité du microbiote. Y a-t-il eu de vraies révolutions expliquant cet intérêt ou se situe-t-on dans une logique d'évolution classique, sans réel saut qualitatif ?
La liste des personnes auditionnées, qui figure en annexe de la note, présente des noms susceptibles de renseigner Michelle Meunier sur le sujet qui l'intéresse. Je pense notamment à Karine Clément, spécialiste de la nutrition et du métabolisme, et aux deux chercheurs de l'Inrae que j'ai rencontrés. Je viendrai par ailleurs avec plaisir, dans la mesure de mes capacités, répondre à vos questions.
S'agissant des questions de Catherine Procaccia, j'ai effectivement souvent songé, lors de cette étude, au travail qu'elle a effectué sur les phages. Des liens sont clairement apparus, notamment lorsque j'ai rencontré deux chercheurs de l'Institut Pasteur, Romain Koszul et Martial Marbouty, qui avaient une approche de métagénomique absolument remarquable. En regardant la capacité que possèdent des protéines, d'un point de vue géométrique, à se lier à d'autres molécules, ils parviennent à dresser des cartographies des antibiorésistances. Il existe donc très clairement un lien entre phages et microbiote. Tout ne figure évidemment pas dans cette note de quatre pages, mais vous trouverez dans les notes de fin de nombreux éléments complémentaires, dont des liens cliquables vers des articles intéressants.
Concernant l'herboristerie, je dois avouer que cette question fait écho à une certaine frustration relative au fait que notre capacité à explorer le périmètre de réflexion le plus vaste possible est largement conditionnée par le temps qui nous est imparti et les contraintes associées à notre mandat. Pour autant, aucune personne auditionnée n'a évoqué le sujet de l'herboristerie, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe aucun lien.
C'est lors de la naissance que s'effectue la colonisation du corps par les micro-organismes. Ainsi, la naissance par voie basse ne va pas produire le même effet qu'une naissance par césarienne, intervenant en milieu plus stérile afin d'éviter toute infection lors de l'acte chirurgical.
En termes de paramètres, il est important de souligner qu'en l'état actuel des connaissances et des technologies, ce ne sont pas tant les bactéries, leur espèce, leur catégorie ou leur population que l'on regarde - car leur variété est importante et la possibilité de les observer est contrainte par le fait qu'il s'agit souvent de bactéries anaérobies - que leur capacité à produire un effet. Ainsi, les conclusions concernent davantage la diversité des gènes présents que les types de bactéries ou leur nombre. Néanmoins, certains travaux qui m'ont été présentés notamment par Joël Doré, de l'Inrae, et Karine Clément, montrent clairement la relation existant entre la fréquence et l'abondance des différentes bactéries dans le microbiote, et divers paramètres extérieurs, dont le régime alimentaire et tout particulièrement l'apport en fibres. Cette perspective avait, me semble-t-il, permis à l'Inrae de déterminer la recette d'un pain riche en fibres permettant de rééquilibrer le microbiote. La quantité de fibres contenues dans la ration alimentaire consommée par l'homme a en effet considérablement diminué entre le début du XXe siècle et aujourd'hui.
La question posée par André Guiol concerne la relation entre cerveau et intestin. Le spécialiste du sujet est Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neurosciences de l'Institut Pasteur et d'une unité CNRS « Gènes, synapses et cognition », ancien vice-président du conseil scientifique de l'Institut Pasteur. Il m'a expliqué, de façon très pédagogique, les liens existant entre les bactéries présentes dans l'estomac et le cerveau, au travers des métabolites fabriqués et transformés par les bactéries, qui passent dans le compartiment sanguin, arrivent dans le cerveau et peuvent, via des récepteurs ad hoc, influencer des phénomènes comme la satiété ou la faim. Ces liens sont clairement documentés par les travaux de M. Lledo, dont les références figurent dans les annexes de la note.
Laure Darcos a évoqué la situation de M. Affagard et MaaT Pharma. J'ai appris, lors de la table ronde à laquelle il a été convié, qu'il bénéficiait de financements de la BPI, avec une introduction en bourse, ce qui montre une évolution favorable. Ceci étant, il reste sans doute des avancées législatives et réglementaires à accomplir dans le domaine du financement de l'innovation. Le passage du stade expérimental à la phase de développement, qui doit permettre à une start-up de dégager des revenus, pose en effet souvent problème. Au-delà du financement, de nombreux autres paramètres doivent être pris en considération.
Il semble que le retrait de l'Ercéfuryl par l'ANSM ait été lié aux effets néfastes observés dans le cas de mésusages.
Angèle Préville a posé une question sur les additifs alimentaires. Je l'invite à contacter Joël Doré, de l'Inrae, qui a abordé lors de son audition le sujet des émulsifiants. La population des micro-organismes composant le microbiote comptant de nombreuses espèces, certaines peuvent être touchées plus que d'autres par l'action des émulsifiants. L'élément à considérer est donc essentiellement le résultat final.
Gérard Longuet s'interrogeait sur le rôle des évolutions technologiques dans la recherche en matière de microbiote. Tout ce qui touche à la caractérisation du génome et à la métagénomique est essentiel. On se trouve en effet face à une quantité de micro-organismes incroyablement importante dont le patrimoine génétique global compte environ 600 000 gènes. Vous imaginez bien que l'étude de ces gènes requiert un minimum de technologie pour être en mesure de gérer l'information correspondante. La bio-informatique, la gestion des big data, la data-analyse et l'intelligence artificielle sont des technologies de traitement de la donnée qui ont une véritable utilité en la matière. De nombreuses technologies vont aujourd'hui de pair avec une intégration structurelle du microbiote dans le paysage de la médecine et de l'alimentation.
Ceci soulève des questions assez vertigineuses. Qui, finalement, dirige notre corps ? Est-ce notre cerveau, notre coeur ou tous ces micro-organismes que nous hébergeons, qui produisent 30 % de notre fluide sanguin et sont capables de réguler notre métabolisme ?
Merci beaucoup, cher collègue, pour ce travail remarquable. Je souligne l'importance de faire le lien avec les autres travaux parlementaires mentionnés au cours de notre échange, à savoir la note sur les phages, présentée par Catherine Procaccia, les travaux du Sénat évoqués par Michelle Meunier, la note préparée par Angèle Préville et l'ensemble des réflexions liées à la santé environnementale. Tout ceci me paraît très pertinent.
Nous pouvons être fiers que cette nouvelle réalisation de l'Office vienne parfaitement compléter l'ensemble de ces travaux et conforter notre présence sur un sujet qui est un point d'intérêt autant pour le grand public que pour la science. C'est pourquoi je vous propose d'autoriser la publication de la note.
L'Office adopte à l'unanimité la note scientifique « Le microbiote intestinal » et en autorise la publication.
Audition publique sur l'évolution du virus sars-cov-2 et de l'immunité jean-françois eliaou gérard leseul florence lassarade sonia de la provôté rapporteurs
Audition publique sur l'évolution du virus sars-cov-2 et de l'immunité jean-françois eliaou gérard leseul florence lassarade sonia de la provôté rapporteurs
Je vous souhaite la bienvenue à cette audition publique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), où nous allons nous pencher une fois encore sur la pandémie de Covid. En effet, celle-ci reste très présente dans l'actualité et connaît des évolutions dans plusieurs directions. Nous avons vécu ces derniers mois au rythme des vagues successives, des différents variants, des avis du Conseil scientifique, des nombreux débats sur les règles à suivre et sur la loi. Au Parlement, le début de l'année 2022 a ainsi été marqué par des débats extrêmement tendus et parfois confus.
L'OPECST poursuit le travail qui lui a été confié par les instances parlementaires sur l'évaluation de la stratégie vaccinale contre la pandémie de Covid et, plus généralement, sur les moyens et méthodes mis en oeuvre pour lutter contre cette pandémie, en se fondant sur une analyse scientifique et technologique.
C'est dans ce cadre que l'Office accueille pour cette nouvelle audition publique des invités reconnus pour leurs compétences et représentant une diversité d'expertises et de points de vue.
Je passe sans plus tarder la parole aux rapporteurs, qui suivent la pandémie depuis plusieurs mois, pour l'Office et qui vont animer les débats.

Nous travaillons en effet sur le sujet depuis le mois de juin 2020, date depuis laquelle plusieurs phases de la pandémie se sont succédées, au point que l'on se demande si l'on en verra un jour l'issue.
Nos travaux ont déjà abordé plusieurs sujets, dont celui de la stratégie vaccinale, avec toutes les interrogations soulevées par l'hésitation vaccinale, mais aussi le Covid long et les démarches thérapeutiques susceptibles d'être mises en oeuvre. D'autres questions se posent désormais : sommes-nous à la fin de l'épidémie ? Faut-il craindre l'apparition d'autres variants ? Quelle stratégie adopter à l'égard des populations qui se révèlent réticentes à l'instauration de nouvelles contraintes ?
Je remercie les intervenants d'avoir accepté notre invitation afin de nous éclairer, et à travers nous l'ensemble de la représentation nationale et des Français. Je précise que cette audition est publique, diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que nous rendrons compte de nos échanges.
Comme l'a indiqué notre collègue Florence Lassarade, de nombreuses questions se posent quant à l'évolution du virus. Pouvons-nous aujourd'hui faire la prospective de cette évolution ? Existe-t-il des modélisations permettant de mieux la comprendre ? Allons-nous passer d'une pandémie à une installation endémique du virus dans nos sociétés ? Dans quelle mesure et comment de nouveaux variants pourraient-ils émerger ? Le variant Omicron va-t-il être l'occasion de passer cette situation difficile ou bien faut-il s'attendre à vivre encore dans la durée avec des masques ? Autant d'interrogations que nous vous soumettons aujourd'hui.

Nous recevons ce matin Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS, et Mircea Sofonea, maître de conférences à l'université de Montpellier, chercheurs au laboratoire «Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle», ainsi que Florence Débarre, chargée de recherche au CNRS dans l'équipe «Écologie et évolution des réseaux d'interactions» de Sorbonne-Université, et Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique Covid-19.
PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELLES ÉVOLUTIONS DU VIRUS SARS-COV-2 ?
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, chers membres de l'Office, nous vous remercions pour cette invitation à présenter les travaux de notre équipe, qui portent principalement sur la modélisation de l'épidémie et de l'évolution des maladies infectieuses. Ces travaux ont été réalisés en grande partie à Montpellier.
Je souhaite en préambule à notre exposé déclarer nos conflits d'intérêts potentiels et les financements dont nous avons bénéficié pour mener ces travaux. Nous avons à ce jour reçu un soutien de la Région Occitanie au travers du projet PHYEPI et, plus informellement, de l'université de Montpellier. Nous souhaitons ainsi remercier toute l'équipe ETE et en particulier deux jeunes chercheurs, Bastien Reyné, qui a réalisé le modèle de projection sur le temps long que nous allons vous présenter, et Gonché Danesh, qui a effectué une analyse phylogénétique que nous évoquerons également.
Bonjour, Mesdames et Messieurs les parlementaires. L'une des premières figures de modélisation auxquelles vous avez pu être confrontés est celle qui a été élaborée par l'équipe de Neil Ferguson à l'Imperial College. Il s'agissait, à la veille du premier confinement en France, le 16 mars 2020, d'une simulation de temps long, couvrant la période mars 2020-décembre 2021, sur la potentielle épidémie à laquelle pouvait être confronté le Royaume-Uni. À l'époque, cette équipe était, à notre connaissance, la seule à aller aussi loin dans les simulations. Ce modèle faisait apparaître sept vagues. Bien évidemment, des différences sont à noter entre la situation actuelle et cette simulation. Il ne faut pas en déduire que la qualité prédictive des travaux est insuffisante, dans la mesure où l'on ne peut prévoir l'avenir au-delà de quelques jours, mais ceci montre le potentiel d'anticipation sur le temps long des modèles en épidémiologie. Il est donc important de continuer à explorer les modèles, en utilisant des données de terrain qui doivent être de qualité.
En France, nous nous sommes rapidement essayés à reconstituer l'épidémie en population générale à partir des données fiables du moment. Tout début avril 2020, nous avons ainsi mis en ligne l'une des premières versions de notre modèle, CovidSIM, qui permettait de construire l'épidémie en population générale sur la base des données hospitalières et en particulier des admissions en soins critiques. Ce modèle dit « compartimental » permet, en suivant la trajectoire des données en soins critiques et de la mortalité hospitalière, d'inférer la situation en population générale et d'anticiper la date et la hauteur des pics hospitaliers. Nous avons continué à procéder ainsi tout au long de la pandémie. La dernière modélisation produite concerne la double vague Delta et Omicron, qui n'est toujours pas achevée. En nous appuyant sur les données disponibles au 22 décembre 2021, nous avons mis en ligne l'impact potentiel de cette double vague sur les soins critiques. Cette modélisation ne se voulait pas prédictive, dans la mesure où, à cette date, de nombreuses inconnues subsistaient. Il s'agissait de prendre des valeurs de paramètres optimistes, afin d'avoir une borne inférieure du capacitaire nécessaire dans les services de soins critiques au niveau national et de se préparer pour les mois à venir. Plus de 43 jours après, cette modélisation n'est toujours pas mise en défaut : selon le jour, elle se situe soit au-dessus soit au niveau du scénario le plus optimiste. Ceci montre que les modèles permettent d'anticiper, non pour prévoir stricto sensu, mais au moins pour avoir une idée et permettre de s'organiser et de prévenir les différentes tensions.
Quel sera l'avenir de la dynamique du SARS-CoV-2 en France - qu'il convient de distinguer du Covid-19 critique dans la mesure où la situation changera avec la mise en place, déjà en cours, de thérapeutiques ?
Bien sûr, ceci dépendra de la durée de l'immunisation biologique, qui deviendra de plus en plus hybride. Pour le moment, la moitié environ de la population française n'a toujours pas rencontré le SARS-CoV-2. La couverture vaccinale et l'immunité post-infectieuse font que l'immunité globale se consolide, mais l'on sait que celle-ci décline malheureusement au regard de l'infection et de la succession des variants.
Les variants sont soumis à une pression de sélection qui filtre de facto les mutants apparaissant à chaque infection, qui présentent des antigènes différents. On connaît bien ce phénomène d'échappement immunitaire, de « dérive » antigénique : il est analogue à celui que nous vivons chaque année avec la grippe saisonnière.
Le troisième point est probablement le plus anxiogène mais il est potentiellement de plus en plus éloigné : il s'agit de l'émergence de variants préoccupants, c'est-à-dire ceux qui présentent des changements phénotypiques importants sur le plan de la virulence ou de la contagiosité. Plus l'épidémie dure, plus la fréquence de ces variants risque de diminuer. Bien sûr, des épidémies non contrôlées dans divers endroits du monde ou des événements extrêmement rares peuvent être à l'origine de tels variants ; mais la préoccupation majeure ne sera pas celle-ci et concernera essentiellement la dérive antigénique du virus, c'est-à-dire l'échappement immunitaire.
Il est donc important de modéliser cet aspect le plus finement possible. Bastien Reyné, doctorant dans l'équipe, a construit un modèle original, prenant en considération non seulement l'âge des individus, mais aussi l'infection et la vaccination, au moyen d'équations aux dérivées partielles, avec différents niveaux d'immunisation - on peut par exemple prendre en compte des situations telles qu'une infection post-vaccination, qui confère une immunité supplémentaire. Si l'on intègre dans le modèle des phénomènes tels que la différence d'efficacité vaccinale en fonction des variants (élément qui est aujourd'hui bien documenté) et l'érosion progressive de cette efficacité, on peut élaborer une modélisation sur le temps long, c'est-à-dire sur plusieurs années. Par exemple, en faisant l'hypothèse d'une saisonnalité de l'épidémie, d'une amplitude totale de 20 %, de rappels annuels pour certaines personnes, d'une baisse de la transmission de 50 % due au vaccin et d'un déclin de l'immunité vis-à-vis d'Omicron, alors on aboutit, si l'on estime que la létalité d'Omicron est un dixième de celle de Delta, à des vagues annuelles d'admissions hospitalières de faible amplitude. Si en revanche la létalité d'Omicron est divisée seulement par cinq par rapport à Delta, alors ces vagues seraient de plus grande amplitude, bien qu'inférieures au maximum déjà atteint.
Les tendances présentées sont évidemment des projections qui reprennent les notions d'effritement de l'immunité et de dérive antigénique.
À cela peut s'ajouter l'émergence de variants préoccupants. La diapositive qui vous est maintenant présentée montre une représentation phylogénétique réalisée par Gonché Danesh en sélectionnant dix séquences par région française et par mois. Ceci fait apparaître la chronologie de l'émergence des variants, avec au tout début le variant Alpha en orange, puis ultérieurement le variant Delta en violet et enfin le variant Omicron. Ces émergences ont été imprévisibles, mais si l'on pousse plus loin l'analyse en étudiant les propriétés des divers variants, il est intéressant d'observer les différences en ce qui concerne la virulence, que l'on peut interpréter comme le risque de décéder de l'infection si l'on n'est pas vacciné, et la contagiosité. On a constaté que plus les variants étaient contagieux - ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent -, plus ils étaient virulents : Alpha était plus virulent et plus contagieux que les souches initiales, et Delta l'est plus qu'Alpha. Cette relation entre virulence et contagiosité est un phénomène observé pour d'autres virus tels que le VIH. Il est assez inquiétant d'avoir vu une augmentation au cours du temps, Delta étant le plus virulent des variants connus. La bonne nouvelle est qu'il existe une forte immunité croisée pour tous ces variants.
Plus récemment, l'émergence d'Omicron a quelque peu rebattu les cartes, puisque ce variant a une virulence plus faible que Delta, mais une contagiosité plus élevée. Ce phénomène tient au fait qu'Omicron explore une autre dimension des possibles, via un fort échappement immunitaire. On pourrait ainsi considérer, en caricaturant, que ceci correspond à la colonisation d'une nouvelle « niche écologique » dans les voies respiratoires supérieures, qui se traduit par une contagiosité plus élevée, une virulence plus faible et un échappement immunitaire plus prononcé que pour les variants précédents. L'interrogation majeure est de savoir dans quelle mesure il peut y avoir une coexistence entre différents variants, ceux colonisant respectivement les voies respiratoires supérieures et inférieures, sachant que dans les deux cas une corrélation entre virulence et contagiosité peut subsister.
En conclusion, au vu des données immunologiques actuelles, on peut craindre une nouvelle vague d'hospitalisations courant 2022. L'ampleur des futures vagues dépendra de nombreuses inconnues, parmi lesquelles la virulence précise du variant, l'efficacité des traitements, l'évolution de la résistance au traitement et plus généralement la robustesse de l'immunité.
L'émergence de variants préoccupants est enfin à prendre en compte. Elle a jusqu'alors été imprévisible et a engendré des vagues d'hospitalisations très rapidement, en un ou deux mois.
Merci beaucoup pour cette invitation et merci à Samuel Alizon pour son excellente transition avec ma présentation.
Durant la première partie de l'épidémie de Covid, on a pu ignorer l'évolution du virus. Mais dès la fin 2020, elle s'est imposée à nous, avec l'apparition de variants préoccupants qui ont donné lieu à de nouvelles vagues épidémiques.
Alors que la décrue de la vague Omicron semble annoncée, se pose la question de la dynamique évolutive future du virus. Nous ne sommes pas devins. Pour anticiper l'avenir, il faut comprendre l'évolution passée et présente de SARS-CoV-2. Pour ce faire, les entrailles dans lesquelles lisent les chercheurs en biologie évolutive sont les séquences génétiques du virus. Que nous disent-elles ?
Un premier constat s'impose : jusqu'à aujourd'hui, aucun des variants déclarés préoccupants par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), désignés par une lettre de l'alphabet grec, ne descend d'un autre variant préoccupant. Le schéma projeté représente les relations de parenté entre les différents variants, à la façon d'un arbre généalogique. On observe que les variants jugés préoccupants sont des cousins parfois proches, parfois très éloignés comme Delta et Omicron. Une première conséquence importante de ce constat est que certaines des propriétés de ces variants sont largement indépendantes les unes des autres. Si nous avons la chance qu'Omicron soit bien moins virulent que Delta, il n'y a aucune garantie que ce soit le cas pour un prochain variant préoccupant, si ce dernier ne descend pas du variant majoritaire.
À l'automne dernier cependant, beaucoup s'attendaient à ce que le variant préoccupant suivant descende de Delta. On peut aujourd'hui essayer d'expliquer d'où venait cette erreur d'appréciation. La diapositive projetée est un arbre phylogénétique, dont chaque point correspond à un virus séquencé et chaque couleur à un variant différent. Les relations de parenté sont identifiées par des lignes, comme sur un arbre généalogique, et les séquences disposées de gauche à droite sur l'axe horizontal en fonction de la date de collecte des échantillons. On peut estimer, grâce à des méthodes phylogénétiques, les dates de branchement des lignées ayant conduit aux virus séquencés ultérieurement. Nous n'avons pas étudié les ancêtres des virus actuels, mais nous essayons grâce à ces méthodes de comprendre quand les divergences de branche sont apparues. Cette figure montre non seulement que Delta et Omicron sont des cousins éloignés, mais aussi que la divergence entre les deux s'est produite tôt dans l'épidémie.
Ceci signifie qu'une diversité virale, dont on n'avait pas totalement conscience, a été maintenue au cours de l'épidémie. Pourquoi est-ce le cas ? L'une des raisons vient peut-être de ce que l'intérêt du monde scientifique s'est trop souvent tourné vers le monde occidental. Vous voyez ici des cartes extraites du bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'OMS du 23 novembre 2021, date à laquelle Omicron a été identifié. Ces cartes montrent la distribution des différents variants préoccupants dans le monde. Dans certains pays, des variants non Delta circulaient encore largement, mais de nombreux pays, représentés en orange et en blanc, soit avaient trop peu de séquences pour que l'on puisse estimer la proportion des divers variants, soit n'avaient pas rapporté de nouveaux variants récents à l'OMS, soit n'avaient rapporté aucun variant. Ceci signifie qu'il existait donc de nombreuses régions du monde avec peu de surveillance génomique, voire épidémiologique, et qu'il n'était donc pas possible d'avoir une idée de la diversité virale en circulation. Ce manque de données à l'échelle internationale n'a pas permis d'anticiper l'émergence d'Omicron.
Omicron a surpris non seulement parce qu'il ne descendait pas de Delta, mais aussi en raison des mutations qu'il porte. Le schéma projeté représente la protéine spike (spicule en français) d'Omicron, qui correspond à la « décoration » présente sur la couronne des coronavirus : elle interagit avec les cellules humaines, elle permet l'entrée du virus dans ces cellules et elle est la cible des anticorps. Les billes qui apparaissent sur le dessin correspondent aux mutations d'Omicron, colorées en fonction de l'effet anticipé de ces mutations avant l'émergence d'Omicron. Ces effets ont été estimés à partir de mutations observées dans les virus séquencés auparavant. On supposait ainsi que si des mutations étaient observées très rarement, ceci témoignait du fait qu'elles étaient mal-adaptatives, c'est-à-dire néfastes pour le virus. Or de telles mutations, représentées en bleu marine, sont très nombreuses dans la spike d'Omicron. Ainsi, ces mutations sont individuellement mal-adaptatives pour le virus, mais elles peuvent lui conférer un bénéfice lorsqu'elles sont présentes en combinaison. Comme ces combinaisons n'avaient pas encore été observées, il n'était pas possible d'anticiper que ce serait le cas. Ceci témoigne des limites de l'anticipation, basée sur la considération de mutations vues indépendamment les unes des autres ou par paire. Ceci nous indique par ailleurs que la carte restant à explorer pour le coronavirus est encore potentiellement très vaste.
Si j'ai bien compris, vous dites que les modifications représentées en bleu marine, dont chacune prise séparément était identifiée comme plutôt handicapante pour le virus, sont en fait avantageuses lorsqu'elles sont combinées ?
On suppose que cette combinaison est avantageuse dans la mesure où elles sont présentes et maintenues dans la spike d'Omicron. On imagine en outre qu'elles se compensent les unes les autres, notamment parce qu'elles sont localisées en trois groupes.
Ceci est tout à fait vertigineux en termes de combinatoire à explorer.
Absolument. Comme je l'ai dit précédemment, la spike est à la fois impliquée dans l'interaction avec les cellules humaines et la cible des anticorps. Son évolution doit donc répondre à des compromis, entre être suffisamment différente pour échapper aux anticorps et ne pas être trop différente pour pouvoir infecter les cellules humaines. La question devient alors celle de caractériser le degré de liberté offert à la spike.
Une autre surprise réservée par Omicron réside dans l'échappement immunitaire dont il fait l'objet. Vous voyez à l'écran une carte antigénique, c'est-à-dire une projection en deux dimensions des liens existant entre les différents variants vis-à-vis de notre système immunitaire, publiée voici cinq jours. Plus deux variants sont éloignés sur la carte, moins les anticorps produits du fait de l'infection par l'un sont efficaces pour neutraliser l'autre. On observe qu'Omicron est le plus éloigné de tous, ce qui témoigne de sa capacité d'échappement immunitaire. Cette figure est une projection en deux dimensions, obtenue en testant le potentiel de neutralisation des sérums obtenus suite à une infection par un variant vis-à-vis des autres variants. Chaque grille correspond à une diminution d'un facteur fixe des capacités de neutralisation.
Les variants d'échappement peuvent apparaître parce que la population d'humains rencontrés par le virus est maintenant largement immunisée. Il faut savoir que les pressions exercées sur le virus ont fortement changé en deux ans. On est en effet passé d'une population immunologiquement naïve à une population largement immunisée, grâce aux infections antérieures et au déploiement massif de la vaccination. Ce qui fait le succès d'un variant aujourd'hui n'est plus ce qui faisait le succès d'un virus il y a deux ans. Pour se faire une idée de ce à quoi s'attendre dans une population largement immunisée, on peut regarder du côté des autres coronavirus humains, à savoir les coronavirus saisonniers. Des études de 2021 ont ainsi montré que certains étaient sujets à une dérive antigénique, dans la mesure où des réinfections étaient en partie dues à l'évolution des virus, qui échappaient à l'immunité développée contre leurs versions antérieures. Ce phénomène apparaît également sur les arbres phylogénétiques, avec leur structure en échelle. Il est possible que ceci existe de même pour SARS-CoV-2, le virus de la Covid.
Ainsi, prédire les prochains changements évolutifs est difficile, mais une bonne surveillance génomique en France et dans le monde nous évitera d'être trop surpris. Ceci passe par un plan de surveillance génomique, avec des tests, des séquençages aléatoires, un partage de données rapide sur des plateformes internationales pour mutualiser l'analyse au niveau mondial et une surveillance qui ne soit pas limitée au compartiment humain mais soit aussi environnementale et considère les réservoirs d'animaux non humains.
J'insiste sur le fait que même si surveillance et recherche sont parfois considérées séparément en France, les deux dimensions vont de pair sur un nouveau pathogène.
Je souhaiterais clore cette présentation avec la note d'humilité exprimée par mon collègue Jesse Bloom dans un entretien publié dans Nature : « Omicron really shows us the need for humility in thinking about our ability to understand the processes that are shaping the evolution of viruses like SARS-CoV-2 » (« Omicron nous montre vraiment la nécessité de faire preuve d'humilité face à ce que nous comprenons des processus qui façonnent l'évolution de virus comme SARS-CoV-2 »).
Merci beaucoup. Monsieur Lina, peut-être allez-vous essayer de nous rassurer. Je trouve en effet ces exposés très préoccupants, car ils mettent l'accent sur le caractère imprévisible de l'évolution du virus, donc de la pandémie. J'ai ainsi noté que des mutants échappant à l'immunité pouvaient continuer à émerger et qu'il fallait, pour essayer d'y faire face au mieux, mettre en oeuvre une bonne surveillance génomique en France et dans le monde. Or les cartes que Mme Débarre nous a présentées montrent précisément que cette surveillance n'est pas homogène à l'échelle du monde, et en vérité qu'elle est loin d'être parfaite. N'allons-nous pas par conséquent voir apparaître de nouveaux variants et devoir subir de nouveaux épisodes pandémiques, par vagues successives ?
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vais essayer de vous proposer une présentation complémentaire des précédentes et je ne pourrai malheureusement pas vous rassurer au-delà de ce qu'il sera possible d'expliquer.
Je suis virologue et je vais donc parler du virus et de son évolution, notamment des conséquences de l'évolution moléculaire sur la biologie du virus, dans la mesure où ceci conditionne l'évolution de son pouvoir pathogène. La partie du virus la plus surveillée est, comme ceci a été dit précédemment, la protéine de spicule, qui est à la surface du virus et joue un rôle clé dans l'infection et son contrôle. C'est en effet grâce à cette protéine que le virus entre dans la cellule. On peut dire qu'avec Omicron, il est actuellement en train d'explorer différentes voies d'entrée dans les cellules : là réside probablement la différence entre la biologie d'Omicron et celle des autres virus. Cette protéine est la cible essentielle de la réponse immunitaire, aussi bien humorale que cellulaire. Ceci montre combien il est important de disposer d'une connaissance des phénomènes qui l'entourent.
Le virus a considérablement évolué depuis son émergence. La première apparition d'un variant a été passée relativement sous silence parce que l'on ne connaissait pas très bien la biologie du virus. Sa protéine de spicule est un trimère, présent à raison d'environ une trentaine de molécules à la surface de chaque virus et qui interagit avec le récepteur cellulaire ACE2. Il existe entre les deux un domaine d'interaction, appelé « receptor binding domain » ou RBD, structure très importante pour faciliter l'attachement du virus. Or dans la version initiale de la molécule de spicule, le RBD était replié à l'intérieur de la molécule et n'était que très rarement mis en position haute, qui permet l'attachement au récepteur. La première modification sur la molécule de spicule, qui a eu lieu en février 2020, a concerné un acide aminé qui a été modifié en position 614 : ceci a permis à la partie RBD de la protéine spike de se présenter plus facilement en position haute et entraîné une ouverture de l'ensemble du trimère, permettant à ses trois RBD de se présenter en position haute. Cette première modification a montré le chemin qu'allait suivre le virus, consistant à augmenter progressivement la capacité d'attachement par la libération de cette partie spécifique de la molécule.
Vous avez déjà de nombreuses informations sur la séquence des variants. Il est très intéressant de voir que ces variants ont émergé à l'échelle mondiale à des moments assez proches et avec certaines similarités évolutives à l'origine de capacités partagées, alors même qu'ils étaient apparus à des endroits différents. La capacité partagée la plus importante ne concerne pas tant la virulence que la transmissibilité. Le schéma suivant montre le taux de reproduction des différents variants identifiés au fil du temps, en mettant en évidence les variants Beta, Alpha, Gamma et Delta, selon la dénomination que les virologues utilisent. Il montre que chaque fois que ces variants sont apparus, l'élément moteur a été essentiellement la capacité de transmission. Ainsi, le variant Beta avait un R effectif supérieur de 60 % à celui du virus initial. Progressivement, les virus émergents ont donc été de plus en plus transmissibles. Ceci s'explique en partie par des modifications intervenues dans la protéine de spicule, en particulier dans le receptor binding domain.
Je reviens sur l'évolution du RBD. Il est en effet important de regarder dans la molécule de spicule la zone qui interagit avec le récepteur ACE2. Toutes les parties colorées en vert sont en interaction avec le récepteur pour permettre l'attachement du virus. Pour les variants Alpha et Beta, on observe que la mutation en position 501, lorsqu'on l'analyse au regard de l'affinité vis-à-vis du récepteur, permet d'augmenter de façon très significative la capacité d'attachement. Du point de vue du virus, ceci permet au RBD d'être plus affin au récepteur ACE2, comme si l'aimant entre les deux était plus puissant.
Certaines évolutions, observées dans d'autres variants, ont plutôt tendance à réduire l'affinité. Ainsi, l'une des modifications du virus Beta, en position 417, entraîne normalement une réduction d'affinité lorsqu'elle est isolée ; mais lorsqu'elle est combinée à deux autres mutations, son impact est atténué et l'attachement est malgré tout très fort.
Dans le variant Delta, le RBD diffère par l'ajout de deux acides aminés qui ne participaient pas auparavant à l'attachement. Ces mutations ont permis une augmentation de la surface d'interaction entre le récepteur ACE2 et le RBD, donc une augmentation du potentiel d'attachement à ACE2.
C'est avec des mécanismes de ce type que les variants ont progressivement accru leur affinité.
Puis Omicron a émergé. Sa mécanique de diffusion s'est avérée extrêmement performante. En effet, l'étude du taux de remplacement des variants circulant dans le monde montre la rapidité avec laquelle Omicron a supplanté les autres variants, ce qui témoigne du fait qu'il a un avantage considérable. Cet avantage résulte en partie d'une augmentation de la transmission : Omicron a une capacité d'affinité sur le récepteur ACE2 nettement supérieure à celle des autres variants. Les changements intervenus à la surface du virus sont considérables. L'une des combinaisons est extrêmement importante : il s'agit de la combinaison des mutations 498 et 501. La mutation 498 avait été identifiée comme un marqueur de perte d'affinité avec le récepteur. Mais dans un contexte d'évolution dit « épistasique » - c'est-à-dire où des modifications intervenant à différents endroits du génome conduisent à ce que l'expression d'un gène masque celle d'un autre gène, ce qui entraîne la modification des protéines fabriquées par la cellule -, l'introduction dans le processus évolutif de la mutation 501, puis de la mutation 498 permet d'observer qu'au lieu que cette dernière devienne délétère, elle procure un avantage. Cette temporalité d'apparition des mutations permet la sélection d'un certain nombre de variants susceptibles d'avoir des affinités, des capacités biologiques modifiées. Ceci correspond très précisément aux observations effectuées sur Omicron.
Je rappelle que dans le virus de la souche initiale, le RBD était replié dans une poche, qui a été partiellement ouverte du fait de la mutation intervenue très précocement en position 614. Chez Omicron, trois mutations survenues sur la partie latérale de la molécule ont entraîné le glissement d'une partie d'une hélice alpha qui favorisait le blocage en version basse du RBD ; ceci a favorisé le passage du récepteur en position haute. Aujourd'hui, on sait que les molécules spike du variant Omicron sont spontanément en position haute, ce qui augmente l'affinité du virus au récepteur ACE2 et potentiellement sa capacité à utiliser d'autres récepteurs que ACE2.
En termes évolutifs, l'ensemble des descendants d'Omicron présentent cette caractéristique. L'arbre phylogénétique des virus qui est actuellement projeté propose une représentation différente de celles montrées précédemment et reprend les quelque 7 millions de séquences disponibles aujourd'hui dans la base de données ouverte GISAID, qui sert de support à la compréhension de l'évolution des virus. Il montre que la racine d'émergence du variant Omicron se trouve bien sur les virus initiaux, tandis que la racine d'émergence de BA.2 se trouve sur le virus Omicron. Ainsi, en termes de potentiel évolutif, Omicron présente clairement un avantage biologique, réplicatif et d'échappement immunitaire, mais est aussi capable de générer de la descendance.
Je vais à présent essayer d'expliquer le concept de distance antigénique. L'image projetée maintenant ressemble à une cible, dont le centre est occupé par le virus initial et correspond à la réponse immunitaire induite avec une vaccination utilisant la souche Wuhan ; lorsqu'on considère les variants apparus depuis, plus ils sont éloignés du centre, plus le niveau de protection obtenu avec la même vaccination est faible. Lorsque l'on positionne Omicron sur cette cartographie en deux dimensions, on observe que la distance antigénique, c'est-à-dire la quantité d'anticorps nécessaire pour assurer une neutralisation performante d'Omicron, nécessite des taux d'anticorps beaucoup plus élevés que pour neutraliser Delta ou Beta, qui était le virus le plus excentré avant l'apparition d'Omicron. Il est intéressant de voir que cette distance est potentiellement le point d'émergence de la nouvelle racine évolutive du virus. La question qui se pose aujourd'hui est donc celle de savoir si l'évolution des virus se fera désormais à partir de l'émergence qui a donné naissance à Omicron. Malheureusement, il est très compliqué, pour des raisons tenant au mode de culture des virus, de placer le BA.2 dans cette cartographie et de savoir s'il est encore plus excentré ou s'il reste à proximité de la souche Omicron actuelle. L'ensemble des autres variants est placé de façon assez concentrique autour du virus initial. Il n'y avait jusqu'à présent pas vraiment eu de pas évolutif pouvant conduire à l'apparition de « variants de variants ».
Le second concept qu'il est important d'appréhender est ce que les Anglais qualifient d'« antibody landscape ». Il s'agit d'ajouter à la cartographie présentée précédemment une troisième dimension correspondant à la capacité de neutralisation du virus par le taux d'anticorps moyen présent chez un sujet vacciné un mois après avoir reçu deux ou trois doses d'ARN messager. Lorsque l'on effectue la moyenne de sept études publiées et que l'on observe à la verticale du point représentant Omicron, il apparaît clairement que deux doses d'ARN messager ne protègent pas, ce qui est très cohérent au regard de la distance antigénique existant avec le virus initial. Par contre, un mois après la vaccination à trois doses d'ARN messager, on voit que les taux d'anticorps restent protecteurs. Cette couverture en anticorps permet de protéger des formes graves, mais non de la transmissibilité. En effet, pour contrôler la transmissibilité, il faudrait avoir essentiellement des IgA sécrétoires.
Pour conclure, la crise de la Covid-19 est sans précédent dans le monde de la virologie moderne et elle illustre de façon extrêmement riche le potentiel évolutif d'un virus dans un contexte de pandémie. Les scientifiques avaient jusqu'ici une connaissance très parcellaire de l'évolution des coronavirus ; elle s'est considérablement renforcée à la faveur de cette crise. Il existe désormais des données, relativement récentes, sur les coronavirus saisonniers. Il apparaît que l'évolution des virus est due, en début de pandémie, d'une part, à des modifications sélectionnées de caractéristiques importantes pour la biologie du virus, phénomène que j'ai décrit lorsque j'ai évoqué la co-évolution épistasique d'un certain nombre de positions moléculaires sur le génome viral, d'autre part, à la capacité d'échappement à la pression immunitaire. En période post-pandémique, lorsque le virus se saisonnalisera, son évolution sera essentiellement pilotée par la sélection de variants d'échappement immunitaire.
Je me garderai bien de prédire ce que va devenir le SARS-CoV-2. Il est néanmoins certain qu'il va se maintenir dans la population : nous serons exposés à ce virus durant des dizaines et des dizaines d'années. Nous ignorons en revanche quand s'effectuera la bascule du mode pandémique vers le mode endémique.
Le virus conserve un potentiel évolutif extrêmement important. Le premier facteur est sa capacité à connaître une dérive antigénique, favorisée à la fois par la diversité intra-hôte - il faudra donc surveiller la situation des personnes immunodéprimées - et la diversité inter-hôte - ce qui nécessitera une surveillance internationale. Comme les autres coronavirus, le SARS-CoV-2 dispose d'un potentiel de recombinaison extrêmement important. Divers betacoronavirus circulent chez l'homme : on pense notamment au OC43, avec lequel une recombinaison du SARS-CoV-2 est possible, ce qui pourrait conférer à ce dernier un pas évolutif supplémentaire. J'insiste enfin sur le risque de rétrozoonose. On sait en effet que ce virus a contaminé des animaux, chez lesquels il peut évoluer avant de revenir chez l'homme ; il peut y acquérir des caractéristiques qu'il n'aurait pas pu acquérir chez un hôte humain et qui pourraient lui conférer un avantage d'affinité ou de dangerosité. J'ajoute que ces trois risques peuvent se combiner. Il convient donc d'être extrêmement vigilant dans la surveillance de tous ces virus.
Je termine cet exposé en remerciant mon équipe, grâce à laquelle j'ai pu présenter toutes ces données.

Merci, professeur Lina, pour cet exposé vertigineux et inquiétant, digne d'un film de science-fiction.
Au début de la pandémie, il avait été dit que les enfants, dans la mesure où ils étaient déjà porteurs de nombreux coronavirus hivernaux, n'étaient pas vecteurs du SARS-CoV-2. Aujourd'hui, on affirme le contraire. Qu'en est-il ? Et que peut-on dire de la gravité de l'infection ?
La biologie du virus a complètement changé depuis le début de la pandémie. Ceci est directement corrélé à l'apparition d'Omicron qui, en modifiant son RBD, a modifié sa biologie. C'est pourquoi il est responsable d'infections des voies aériennes supérieures beaucoup plus que des voies aériennes inférieures. En d'autres termes, il est moins performant pour infecter les voies aériennes inférieures que ne l'étaient les variants précédents. En revanche, il a une capacité réplicative accrue et la dose infectante du virus est plus faible : auparavant, il fallait être exposé à mille virus pour être infecté, avec Omicron cinquante suffisent probablement. C'est la raison pour laquelle la transmission est plus forte. Or dès lors qu'un virus se transmet mieux dans les voies aériennes supérieures et change sa biologie, il élargit son spectre et les enfants, qui étaient épargnés, deviennent maintenant des vecteurs. La reprise épidémique avec le virus Omicron est très clairement passée par les enfants, chez lesquels l'incidence a atteint des niveaux inconnus jusqu'alors, au moins dix fois supérieurs à ceux observés avec les autres variants.
Le virus n'est pas devenu plus dangereux pour les enfants, mais la quantité d'enfants contaminés fait que le nombre d'enfants développant des formes graves est, en valeur absolue, significatif. Un certain nombre d'enfants sont par exemple aujourd'hui en réanimation du fait d'atteintes cardiaques liées au Covid, les PIMS. Je pense qu'il faut y voir, là encore, le signe d'un pas évolutif du virus, qui rejoint ce que l'on connaît d'autres virus, dont celui de la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS), dont la dynamique épidémique hivernale est portée par les enfants. Les épidémies de grippe et de VRS commencent en effet chez les enfants, avant de toucher les personnes plus âgées. Une même dynamique est probablement en train de s'installer avec Omicron. J'ignore toutefois si ceci s'inscrira dans la durée.
Les virus saisonniers de type coronavirus sont bénins, puisqu'ils donnent le rhume banal. Il n'y a que chez les personnes immunodéprimées que l'on observe des formes graves, heureusement très rares. À mon avis, le devenir évolutif de SARS-CoV-2 est le même que celui d'OC43 et de 229E, c'est-à-dire une évolution lente, conduisant à un pouvoir pathogène faible et à un risque très limité de développer des formes graves. Cependant, le virus est apparu trop récemment pour que l'on puisse raisonnablement imaginer que l'on se situe déjà dans ce temps de bascule vers des infections bénignes. Il faut être vigilant, car le potentiel évolutif du virus reste considérable.
Il faut préciser que le SARS-CoV-2 est issu d'une famille différente de celle des coronavirus saisonniers. Il existe en effet les betacoronavirus, très dangereux et inquiétants, dont le SARS-CoV-2 et auparavant le MERS et le SRAS sont des représentants connus, et les alphacoronavirus, qui appartiennent à une autre famille.
En tant qu'épidémiologiste, je dirais que la circulation virale n'a pas énormément changé, contrairement au R0, c'est-à-dire au nombre moyen de personnes infectées par une personne porteuse, qui est beaucoup plus élevé maintenant qu'auparavant. La circulation chez les enfants s'est amplifiée de ce fait-là, et s'y ajoute le fait que la couverture vaccinale est faible dans cette population. De fait, les enfants sont aujourd'hui extrêmement exposés, mais de la même manière que le serait toute population immunologiquement peu préparée et peu vaccinée.
Je souhaiterais, Monsieur Lina, que vous puissiez revenir brièvement sur le risque de rétrozoonose auquel vous avez fait allusion.
Ce phénomène s'est déjà produit. Des rétrozoonoses à partir d'infections chez le vison ont été observées à plusieurs reprises en Europe, avec le variant Alpha. Plusieurs élevages de visons, extrêmement sensibles à ce virus comme tous les mustélidés, ont été contaminés. Le virus s'y est multiplié, ce qui a entraîné des modifications adaptatives sur la protéine spike. Une ou deux personnes ont ensuite été infectées à partir d'un vison contaminé qui avait acquis des mutations. Nous savons donc que ceci peut arriver. Dans le périmètre des virus zoonotiques, chacun connaît la grippe aviaire et la grippe porcine. On observe qu'un certain nombre d'animaux sont aujourd'hui contaminés, dont des hamsters dorés venant de Chine et des cervidés en Amérique du nord. Des réservoirs animaux sont apparus, et le virus a la capacité de se répliquer très facilement dans la faune sauvage. Il est donc nécessaire, comme on le fait pour d'autres virus, de mettre en place une surveillance. En effet, la rétrozoonose n'est pas une fatalité : on peut la prévenir grâce à une surveillance et à des mesures de prévention de nature à protéger la population humaine.
Ceci rejoint le concept de « One Health », qui veut que protéger tout le monde implique de considérer ce qu'il advient dans la faune, dans l'environnement et chez l'humain.
Merci beaucoup. Les interventions qui se sont succédées sont à la fois remarquablement pédagogiques et assez vertigineuses, autour des mots-clés que sont l'incertitude, la variabilité et la nécessaire vigilance.
Pourriez-vous évoquer les variations du paramètre R0 observées au cours de la pandémie en population générale non vaccinée - je parle donc du R0 intrinsèque au virus ?
Les simulations présentées par Samuel Alizon et Mircea Sofonea ont bien montré la difficulté de prédire les développements de l'épidémie, du fait notamment, lors de l'émergence de nouveaux variants, de la superposition, de la rencontre ou de la compensation des différentes courbes et oscillations. Vos exposés donnent le sentiment que les prédictions sont beaucoup plus régulières que ce qui a été observé en pratique, avec l'apparition de différents variants. Votre intervention suggère cependant qu'au milieu de l'incertitude, le scénario le plus probable est celui d'une nouvelle vague annuelle, vraisemblablement à l'automne prochain, et ce même en tenant compte de l'immunité acquise naturellement ou grâce à la vaccination par une grande partie de la population. Pouvez-vous confirmer ceci ?
Les études présentées par Bruno Lina montrent que trois doses de vaccin à ARN messager confèrent une bonne protection contre les formes graves du virus. J'imagine toutefois que cette protection va elle aussi baisser au bout de quelques mois. Si c'est le cas, à quelle échéance cette baisse devient-elle significative ?
Bruno Lina a aussi mis en relation, de façon parfois assez vertigineuse, l'agencement des différentes protéines, leur forme et leur capacité à se lier aux récepteurs cellulaires. Existe-t-il une relation entre la forme du virus et sa virulence ?
Des débats ont enfin eu lieu quant à la pertinence des modèles à compartiments. Ils se basent sur le fait que ces modèles utilisent des équations différentielles et des approximations, parfois battues en brèche ou contestées. Ces modèles ne seraient pas les plus pertinents sur le temps court. Que pouvez-vous dire des méthodes alternatives de modélisation ? Les résultats sont-ils convergents avec ceux des modèles à compartiments ? Je me souviens d'échanges techniques dans lesquels étaient contestées les échelles de temps induites par le modèle. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Il est extrêmement difficile d'estimer le nombre de reproduction de base R0 pour un nouveau variant. La façon la plus empirique et naturelle serait d'observer ce qu'il advient dans les pays à faible couverture vaccinale, à faible taux d'attaque et à faibles mesures de freinage non pharmaceutiques. De fait, il s'agit de pays ayant un niveau de surveillance épidémiologique faible, pour lesquels on n'observe pas de R0 supérieurs à 2. Le nombre de reproduction dépend évidemment du contexte. Le nombre mesuré à Wuhan était de 2,2, tandis qu'il était de 3 en France. Ceci tient à la composante propre à la structure de la population, aux habitudes. De même, au sein de la France, R0 était plus grand en Île-de-France que dans le Sud-ouest. On ne peut effectuer que des approximations à partir des remplacements successifs de variants, le problème résidant alors dans la superposition entre l'avantage de contagiosité et l'échappement immunitaire. On pense que Delta a un nombre de reproduction de base de 6 et Omicron de 9, voire 10. En termes de virus humains, seuls ceux de la rougeole, de la rubéole, de la varicelle et des oreillons ont un nombre de reproduction plus élevé. On ignore si Omicron a un nombre de reproduction de base de 15 ou si cette valeur parfois estimée est due à des effets locaux qui font qu'il se « débrouille mieux » que Delta. Je pense que l'on gagnerait beaucoup à mesurer précisément ce nombre de reproduction de base ; pour l'instant, nous n'y parvenons pas.
S'agissant des éventuelles vagues futures, les discours consistant à dire que la pandémie est derrière nous sont évidemment farfelus. Il faut toutefois faire la différence entre la permanence du SARS-CoV-2, sa circulation qui ne risque pas de s'arrêter, et l'épidémie par vagues mettant en tension le système de santé, en particulier hospitalier. Ces deux dimensions, qui étaient jusqu'à présent fortement intriquées et corrélées, vont diverger au fur et à mesure que l'immunité sera plus importante dans la population, que le diagnostic, la thérapeutique et la prise en charge seront plus efficaces. On vivra alors avec un virus qui circulera comme les virus respiratoires saisonniers, avec une plus grande incidence au cours de la mauvaise saison due à une transmission favorisée. En effet, lorsque les jours sont plus courts et plus froids, on reste davantage en intérieur, ce qui joue fortement lorsque le virus se transmet par aérosol. La grippe cause chaque année entre 5 000 et 15 000 décès en France. Depuis le début de l'automne, on compte 20 000 décès par SARS-CoV-2, ce qui risque de se produire chaque année. Il s'agira donc d'un virus respiratoire supplémentaire avec une mortalité essentiellement associée à une population vulnérable, mais que l'on saura prévenir et anticiper de plus en plus tant que l'évolution sera de type antigénique et que la surveillance épidémiologique, génomique et immunologique de ce virus pourra donc être rapprochée de celle de la grippe. Cependant, on courra toujours le risque de voir apparaître ce que l'on qualifie de « monstre prometteur », phénomène que l'on observe dans les grippes endémiques avec une récurrence de 20 à 30 ans et qui se caractérise par des modifications très importantes qui rebattent les cartes.
Il est vrai que les modèles compartimentaux sont limités. De façon générale, les modèles sont une simplification de la réalité qui a vocation à répondre à une question donnée. Les modèles compartimentaux permettent de tester des hypothèses s'il existe un décalage entre les données et le modèle. Pour le moment, nos simulations ont montré leur utilité vis-à-vis du système hospitalier, avec une capacité d'anticipation de plus d'un mois. Il faut bien sûr y ajouter les modèles issus des approches statistiques et d'apprentissage machine. Il convient en effet de ne jamais prendre une décision sur la base d'une seule modélisation, mais de considérer un ensemble de modèles et de confronter leurs résultats aux données de terrain.
La question du R0 est difficile, car cet indicateur se rapporte à une population immunologiquement naïve, qui n'existe plus aujourd'hui pour ce qui est du SARS-CoV-2.
Le R0 ne suffit pas à faire le succès d'un virus, qui relève d'une interaction entre cet élément et l'intervalle de génération, c'est-à-dire le laps de temps qui s'écoule entre une infection et la suivante. Les virus favorisés, qui se transmettent mieux, ne sont pas forcément les mêmes selon que l'on se situe dans une dynamique ascendante ou descendante de l'épidémie. Sachez que je travaille par ailleurs sur de tels modèles, en collaboration avec François Blanquart et Simon Cauchemez.
Je confirme les propos de Mircea Sofonea portant sur les modèles à compartiments et je précise que la qualité des anticipations permises par les modèles dépend de la qualité des données utilisées. J'insiste à nouveau sur l'importance du partage des données. Durant cette crise, nous avons été confrontés à des difficultés d'accès aux données. Peut-être faudrait-il y réfléchir pour l'avenir, dans la perspective de l'interaction entre surveillance et recherche à laquelle j'ai fait allusion en conclusion de mon exposé. Une meilleure collaboration entre le monde de la surveillance épidémiologique et celui de la recherche serait très fructueuse. Nous en voyons des exemples dans d'autres pays, notamment outre-Manche où l'agence sanitaire britannique UKHSA a des groupes de travail dans lesquels le monde académique est très présent. Or ce type de démarche n'existe malheureusement pas en France. On ne peut que le déplorer, car il existe dans notre pays de nombreuses compétences dans le monde académique, disponibles et volontaires pour aider, mais sous-utilisées. Il s'agit assurément d'une logique perdant-perdant. Du point de vue de la recherche par exemple, le travail que j'ai mentionné utilise des données issues d'autres pays car nous n'avons pas eu accès à suffisamment de données françaises. Dans une vision de long terme de l'épidémie, il serait nécessaire d'améliorer les interactions entre monde de la surveillance épidémiologique et celui de la recherche académique.
Comment expliquez-vous ces difficultés d'accès aux données françaises ?
Certaines ARS utilisent un système d'information appelé SORMAS, qui permet de suivre les cas contacts et l'analyse de clusters ; ce système contient donc énormément d'informations contextuelles. Chaque fois qu'apparaît un nouveau variant, peut en effet se poser la question de savoir si les clusters relèvent de transmissions intra-foyer ou de transmissions fortuites dans le cadre du travail, de l'école, etc. Ces données sont donc potentiellement très intéressantes, mais impliquent un travail d'analyse très important, que les ARS n'ont pas nécessairement le temps d'effectuer. Or il se trouve que ces données ne sont disponibles qu'auprès de Santé publique France et que l'accès en est verrouillé pour les équipes.
Les seules données de criblage auxquelles nous avons accès sont les jeux de données publics, qui sont parfois grand public... Or sous prétexte que ces jeux de données existent, l'accès à des données plus détaillées n'est pas facilité.
Ceci concerne-t-il seulement Santé publique France ou d'autres organismes ?
Ceci méritera d'être signalé par l'OPECST aux autorités et administrations compétentes.

Quelles sont les limites du vaccin actuel ? Est-on prêt à vacciner la population tous les ans, comme dans le cas de la grippe ? Faut-il vacciner les enfants ? Existe-il des vaccins intranasaux ? Le nouveau virus s'ajoute-t-il à celui de la grippe ou le remplace-t-il au moins en partie, la population la plus fragile étant quasiment la même dans les deux cas ?

Merci pour vos présentations très éclairantes et en effet quelque peu vertigineuses.
Vous avez mentionné l'émergence possible de variants préoccupants et imprévisibles. Pourrait-il s'agir de « variants de variant » provenant d'Omicron, dans la mesure où vous avez indiqué que ce dernier pourrait avoir une descendance ? L'émergence d'Omicron prouve-t-elle au contraire que des variants totalement indépendants et très contagieux, comme lui, pourraient émerger ?

Je préside le groupe d'amitié sénatorial France-Vanuatu-Iles du Pacifique. Celles-ci sont quasiment toutes fermées depuis deux ans. Les Kiribati par exemple n'ont recensé en tout et pour tout que deux cas en deux ans. Quelques contaminations sont intervenues après le rétablissement des liens avec la Nouvelle-Zélande. Ne pourrait-on considérer ces populations des îles du Pacifique comme des « populations naïves » et mener en leur sein des études permettant d'avancer par rapport à cette notion ?
Le virus SARS-CoV2 ne remplacera pas la grippe, mais va circuler parallèlement aux autres virus. Circuleront ainsi en hiver le rhinovirus, puis le virus respiratoire syncytial, le coronavirus et la grippe. Il s'agit en fait d'un risque additionnel.
Je souscris totalement aux propos concernant la bascule évolutive : il faut s'attendre sur le moyen terme à la mise en place d'une saisonnalité.
Concernant la relation entre l'évolution de spike et la virulence, il faut savoir que la spike est déjà sous un format de virulence augmentée, puisqu'elle présente un facteur de clivage polybasique. Dès l'apparition du virus, cette molécule a été optimisée pour faciliter son entrée dans la cellule. Ce mécanisme a par la suite été renforcé dans un certain nombre de variants, ce qui permet au virus de basculer parfois directement de cellule à cellule sans passer par le milieu extérieur ; ceci favorise la transmission du virus à l'intérieur d'un organisme infecté. En matière de virulence, nous sommes aujourd'hui davantage intéressés par certains gènes du virus dont on parle moins mais qui concernent le contrôle de la réponse interféron. Des mutations survenues sur ces gènes permettent au virus d'avoir une éclipse interféron, ce qui favorise sa multiplication donc augmente potentiellement sa virulence. Je rappelle que l'interféron est la réponse immunitaire innée qui permet de contrôler un certain nombre d'infections en interférant avec la réplication virale dans les cellules de l'hôte. Le fait qu'un virus maîtrise ou contourne cette réponse innée favorise la survenue d'infections plus graves. C'est sur ce phénomène que nous nous penchons aujourd'hui pour comprendre le potentiel évolutif du virus.
On pourrait effectivement considérer les populations des îles du Pacifique comme immunologiquement naïves, à condition toutefois que personne n'y ait été vacciné. Le R0 concerne en effet les personnes ni infectées, ni vaccinées. Or j'espère que personne ne s'y trouve dans cette situation.
Le virus ayant déjà été performant dans l'exploration de voies permettant d'accroître sa transmission, avec des spicules de mieux en mieux présentées, des mutations facilitant l'attachement, peut-on imaginer qu'il ait déjà atteint la « meilleure » configuration possible, si bien que la contagiosité n'aurait pas de raison d'augmenter, ou peut-on envisager que d'autres mécanismes viennent encore accroître le potentiel contagieux ?
Je me garderai bien de tout pronostic.
Cette question rejoint celle de la prédictibilité. Nous savons faire des expériences in vitro, générer et étudier des mutants, mais nous ne maîtrisons pas très bien, pour les raisons avancées par Bruno Lina, la prévision de la virulence liée à ces mutations. En revanche, nous savons assez bien étudier dans quelle mesure les protéines produites par les mutants se lient bien aux protéines humaines ou échappent aux anticorps. Des expériences in vitro ont montré qu'il était possible de fabriquer des protéines spike avec une affinité 600 fois supérieure à celle de la souche originelle, c'est-à-dire des virus qui se lient beaucoup mieux au récepteur ACE2 ; mais ceci reste de la théorie.
Il existe également des travaux d'évolution expérimentale in vitro, consistant à laisser évoluer le virus. Ceci pourrait nous en dire plus sur les risques. Mais il n'est pas possible à ce jour d'anticiper, car certaines lignées nous sont encore inconnues.
L'une des hypothèses expliquant l'émergence des nouveaux variants, en particulier d'Omicron, met en avant le rôle des personnes immunodéprimées porteuses d'infections chroniques. Une personne immunodéprimée peut en effet être infectée pendant plusieurs mois, voire une année, durée durant laquelle plusieurs centaines de milliards de virus sont produits. Lors de la circulation en population générale ou dans un réservoir animal, un goulet d'étranglement se produit à chaque transmission, où seuls quelques virus sont transmis. Au cours d'une infection chronique, au contraire, on se trouve face à des milliards de virus, avec une sélection continuelle. Ceci souligne l'importance de la protection et du suivi des personnes immunodéprimées, mais rend les anticipations assez délicates à l'heure actuelle.
Globalement, les deux risques envisagés actuellement sont soit un variant apparaissant avec un embranchement très précoce, comme les précédents, soit un virus connu (le variant Delta par exemple) acquérant des mutations d'échappement immunitaire.
Il faut savoir que l'on décide d'appeler par exemple « Delta » tous les virus présentant certaines caractéristiques. Il existe de ce fait de nombreuses séquences et des virus différents au sein d'un même variant. On entend beaucoup parler ces dernières semaines du variant BA.2 comme sous-variant d'Omicron, mais plus d'une centaine de sous-lignées ont été définies au sein de Delta. Un variant n'est pas uniforme et inclut de la diversité génomique. Savoir si le prochain variant descendra d'Omicron ou de Delta dépend donc en premier lieu de ce que l'on choisit de qualifier de variant et de variant préoccupant. De plus, il ne s'agit pas d'une vérité définitive : on pourrait décider par exemple de considérer BA.2 comme un variant préoccupant à part entière et d'en avoir un autre plus tard descendant de Delta ou d'une autre branche. L'éventail des possibilités est large.
Merci beaucoup pour cette mise au point. Il est particulièrement important, dans cette crise, de savoir exprimer l'incertitude, de souligner les éventuelles difficultés de prédiction. Je vous suis très reconnaissant d'avoir, au cours de cette audition, répondu à cette attente.

Merci pour ces interventions très riches et les précisions que vous nous avez apportées, assez nouvelles par rapport à ce que nous avons pu entendre jusqu'à présent.
Nous allons continuer à travailler avec vous, tout en souhaitant que ce soit le moins longtemps possible et que nous puissions sortir de cette épidémie tous ensemble.
SECONDE TABLE RONDE : FACE À CES ÉVOLUTIONS, FAUT-IL CHANGER DE STRATÉGIE VIS-À-VIS DU VIRUS ?
Je salue les professeurs Mueller, Fischer et Delfraissy, intervenants de cette seconde table ronde. Face à ces évolutions et cette imprévisibilité, quelle stratégie faut-il adopter, quelle réponse faut-il apporter ? Cette seconde table ronde va-t-elle nous rassurer ?
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, merci de m'avoir invitée à cette table ronde. Je suis médecin épidémiologiste, professeure à l'École des Hautes études en santé publique et affiliée à l'Institut Pasteur. Je suis aussi membre de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé (HAS), mais m'exprimerai ici uniquement à titre individuel. Je précise que je n'ai pas d'autre conflit d'intérêts.
Je vais exposer cinq aspects scientifiques qu'il me semble important de mentionner pour répondre à la question posée, dans une perspective de santé publique. Je n'ai pas préparé de diapositives, mais je pourrai si vous le souhaitez-vous transmettre les études sur lesquelles je me fonde.
Nous avons mené en novembre 2020, c'est-à-dire après le deuxième confinement, une étude sur les préférences (au sens économique du terme) de la population adulte. Il est apparu que la quasi-totalité des arbitrages hypothétiques faits par les participants de cet échantillon représentatif donnaient la préférence au fait d'éviter la saturation des hôpitaux, avec une position de référence consistant à prendre des mesures pour disposer de suffisamment de personnel de soins. En revanche, s'agissant des restrictions visant à éviter cette saturation (fermeture des espaces publics, école à la maison, auto-confinement des personnes à risque), les utilités relevées lors des arbitrages étaient dispersées autour de la valeur zéro et peu corrélées aux tranches d'âges ou aux groupes socio-économiques. Cette étude date de plus d'un an, mais ses résultats me semblent illustrer l'avantage que peut apporter la vaccination de façon générale, lorsqu'elle est acceptée par une grande partie de la population : elle évite d'avoir à faire des arbitrages entre des mesures pour lesquelles aucun consensus ne se dégage dans la population sur le plan des préférences économiques.
Le deuxième point concerne les connaissances sur les vaccins. Selon des estimations anglaises récentes, tous les vaccins contre la Covid-19 utilisés en France au cours des derniers mois réduisent autant le risque d'hospitalisation en cas d'infection à Omicron qu'en cas d'infection à Delta. Même en l'absence de rappel, la réduction du risque persiste à 70 ou 75 %, ce qui est un bon niveau. Je rappelle ces données car on a souvent entendu dire que les vaccins perdaient leur efficacité au fil du temps et avec Omicron. Ces chiffres indiquent que l'on peut faire confiance à la protection contre les formes sévères apportée par les différents vaccins, même avec l'émergence des variants actuellement observés. Le rappel réduit le risque d'être infecté et permet une efficacité de 75 % à 100 %, ce qui est très important pour les personnes à partir de 50 ans et permet de réduire la force de la vague épidémique actuelle. Ce complément de protection pourrait toutefois ne pas perdurer ; nous manquons encore de données à ce sujet. La protection contre l'infection n'est pas au coeur de l'efficacité des vaccins, en général : la majorité des vaccins offrent en effet une protection contre la maladie, et l'impact sur l'infection et la transmission n'est observé qu'ultérieurement, lorsque leur usage se répand. Ceci n'est pas un problème dans la mesure où le fait d'éviter la maladie permet aussi d'éviter les symptômes qui facilitent la transmission du pathogène. Il existe néanmoins quelques exceptions, notamment le vaccin contre le papillomavirus, qui a pour objectif d'éviter l'infection, et à un moindre degré les vaccins conjugués contre les bactéries encapsulées responsables des méningites et des pneumonies (méningocoques et pneumocoques), ainsi que le vaccin contre la rougeole.
Peut-on, avec ces éléments, atteindre « l'immunité collective » ? Ce terme désigne une situation dans laquelle le pourcentage de la population protégée contre l'infection et la transmission est tel que le pathogène ne peut plus circuler. Or, dans le cas du SARS-CoV-2, ni la vaccination ni l'infection n'entraînent une protection parfaite et durable. Comme ce virus est par ailleurs très infectieux, le seuil d'immunité collective peut être estimé à 100 %, si bien qu'en fin de compte le concept même d'immunité collective ne s'applique pas à la Covid-19. Cibler l'élimination du virus est peu réaliste, en raison de l'existence de formes d'infection asymptomatiques donc sources de transmission, de l'interdépendance mondiale et éventuellement d'un réservoir animal. La vaccination et l'infection permettent toutefois d'atteindre dans la population une forte prévalence d'immunité individuelle contre la maladie sévère, ce qui permet de contrôler l'épidémie, avec un nombre d'hospitalisations limité dans la durée. Ceci permettra une transition vers une situation endémique, dont les modélisations présentées précédemment indiquaient qu'elle se produirait par vagues.
J'en arrive au troisième point de mon exposé, consacré à la stratégie vaccinale, entendue dans le sens de « schéma » et non de « mise en oeuvre ». Cette stratégie sur le moyen et le long terme devra bien évidemment être fondée sur la preuve scientifique, mais aussi tenir compte de l'efficacité vaccinale contre les formes sévères et de la durée de cette efficacité, y compris contre les variants futurs, ainsi que du poids de la maladie par tranche d'âge. En effet, l'efficacité vaccinale, si elle est bonne dans toutes les tranches d'âge, ne peut à elle seule guider la stratégie. Il faut également prendre en considération les principes éthiques et l'acceptabilité du principe de protection indirecte consistant à cibler en priorité les sujets transmetteurs pour lesquels le bénéfice individuel de la vaccination est faible. Pour les futurs rappels, il faudra connaître la durée de protection apportée, l'intervalle souhaitable entre les doses et le moment optimal pour procéder à la vaccination - par exemple avant la saison hivernale ou une vague annoncée. Idéalement, il conviendrait aussi de graduer la force de la recommandation, en allant jusqu'à poser une obligation pour certaines personnes lorsque ceci est justifié.
Dans les programmes vaccinaux à visée de santé publique, on peut aussi décider de ne pas vacciner davantage, par exemple de ne pas utiliser un nouveau vaccin, de ne pas ajouter de rappels, de ne pas élargir à des groupes plus jeunes. Ceci arrive régulièrement. Les éléments à prendre en compte sont d'éventuels effets indésirables, le coût du vaccin et du programme de mise en oeuvre, l'apparition d'autres priorités, notamment en termes de prévention et de promotion de la santé, mais aussi l'acceptabilité de la vaccination en général.
Ceci me conduit au quatrième point, concernant l'adhésion aux mesures. Une étude conduite en août 2021 sur un échantillon représentatif en population adulte a montré que parmi les individus qui n'avaient pas pour seule motivation à se faire vacciner la réponse à des contraintes (pass sanitaire ou obligations professionnelles), lesquels représentaient deux tiers de la population, seuls 81 % indiquaient qu'ils accepteraient à nouveau le vaccin sur recommandation de leur médecin. En revanche, parmi les 20 % d'individus vaccinés principalement en raison d'une contrainte, 17 % disaient qu'ils accepteraient à nouveau le vaccin sur recommandation de leur médecin. Ces résultats illustrent bien le fait que l'adhésion à la vaccination n'est ni acquise, ni perdue. Il s'agit de décisions individuelles, dynamiques, pour lesquelles la santé publique doit oeuvrer de façon permanente.
Les facteurs associés de façon indépendante à l'intention vaccinale et au fait de réfléchir à la vaccination au lieu de la refuser sont décrits dans la littérature scientifique. Leur nombre est compris entre cinq et sept, en fonction de la manière dont on se positionne. On y trouve notamment la conviction que le vaccin aura plus de bénéfices que de risques pour soi ; ceci apparaît comme un trait personnel, mais réagit probablement également à la communication que l'on reçoit. Y figure aussi la confiance dans le système, qui peut prendre la forme d'une confiance en termes de gestion de la crise par les autorités, mais aussi d'une relation avec l'employeur, d'un sentiment global de faire partie du système. Cette confiance est corrélée entre autres avec la perception d'une cohérence et d'une adéquation des mesures prises. Tout ceci suggère qu'il ne faut peut-être pas trop politiser la vaccination et, pour une partie au moins de la population, inscrire cela dans un contexte de décision partagée avec le médecin traitant. D'autres facteurs relèvent de l'environnement privé, comme la motivation pour le fait collectif ou la peur des effets indésirables.
Mon dernier point porte sur la question de savoir comment procéder en cas de nouvelles vagues - nous avons entendu qu'elles étaient possibles, voire probables, en fonction des saisons, des variants, etc. L'on peut supposer que la préférence continuerait à aller vers le fait de privilégier une non saturation des services de soins. Il faudra utiliser le savoir acquis jusqu'ici pour adopter des mesures graduées, dont les effets ont été estimés dans les modèles mathématiques : port du masque, télétravail, protocoles sanitaires, fermeture des sites où les mesures barrières ne peuvent pas être respectées, etc. Il s'agit d'éléments susceptibles d'être maintenus ou de revenir. Il faut préparer la population à cette éventualité.
Ceci peut également prendre la forme de tests de masse, c'est-à-dire de dépistage en l'absence de suspicion clinique : d'un point de vue épidémiologique, ceci me semble adéquat seulement s'il est explicitement accepté d'isoler de nombreuses personnes qui ne sont pas réellement infectées. Ceci renvoie au problème de la fréquence de faux positifs si la prévalence de l'infection dans la population ciblée par les tests est faible.
La réponse vaccinale est bien sûr une possibilité, avec une vaccination à large échelle, y compris dans les tranches d'âge plus jeunes afin de freiner la circulation virale. Toutefois, l'effet aura probablement une durée limitée et il conviendra d'expliquer clairement cette stratégie à la population.
En conclusion, il me semble important d'insister sur le fait que la communication doit toujours être cohérente et anticiper sur d'éventuelles futures incertitudes, mais aussi sur le besoin de revenir potentiellement sur certaines mesures dans l'avenir.
pédiatre immunologiste à l'hôpital Necker-enfants malades, professeur en immunologie pédiatrique au Collège de France, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. - Bonjour à tous et merci à Mme Mueller d'avoir parfaitement situé le contexte.
Je rappelle que la vaccination a pour objectif premier de prévenir des formes sévères de la maladie, de façon directe par la protection individuelle des personnes concernées, et indirecte, sachant que plus la vaccination est large dans la population, plus on a de chances de réduire la transmission du virus. Même si l'on sait, avec le variant circulant actuellement, que l'on ne peut pas l'abolir, ceci peut néanmoins bénéficier aux personnes à risque de développer des formes sévères de la maladie.
La couverture vaccinale en France se situe à un niveau assez élevé, puisque la primo-vaccination concerne plus de 80 % de l'ensemble de la population, tous âges confondus. On ne peut toutefois se satisfaire totalement de cette situation.
Les éléments de préoccupation tiennent notamment au fait que seuls 81 % des personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu le rappel, dont on sait qu'il est absolument indispensable pour obtenir une efficacité optimale contre les formes graves de la maladie liées à Omicron. 19 % des plus de 65 ans ne sont ainsi pas protégés de façon optimale. Or ce sont précisément ces personnes qui, à côté des personnes non vaccinées et des sujets très immunodéprimés, sont aujourd'hui hospitalisées pour des Covid graves.
La primo-vaccination est elle aussi un élément du problème, puisque 4,5 millions de Français ne sont pas vaccinés du tout. Ceci concerne entre autres des personnes très âgées ou atteintes de maladies chroniques, et des personnes en situation de précarité.
Je souhaite aussi mentionner brièvement, même si ceci ne renvoie pas à une projection de moyen terme, le fait que la vaccination des enfants, qui est pleinement justifiée - j'y reviendrai si vous le souhaitez -, n'a pour l'instant pas démarré de façon satisfaisante : en France, seuls 4 % à 5 % des enfants éligibles sont vaccinés, bien moins que dans les pays européens voisins.
Un mot enfin sur la situation des femmes enceintes : leur couverture vaccinale est très insuffisante, estimée à 60 % seulement en fin de grossesse. Or de nombreuses publications scientifiques récentes, venant notamment d'Écosse, montrent pourtant que la morbidité, voire la mortalité, des femmes et de leur bébé est très significative, alors que le vaccin est parfaitement sûr. Il s'agit vraiment d'un sujet d'actualité sérieux.
J'aborde maintenant la question de la durée de la protection contre les formes graves conférée par le vaccin et le rappel, dans le contexte actuel d'Omicron. On sait aujourd'hui que la protection perdure trois à quatre mois après le rappel. On ignore ce qu'il en sera dans les deux ou trois mois qui suivent. Je pense en particulier aux personnes les plus fragiles, parmi lesquelles les plus âgées. Il n'est pas exclu qu'une quatrième dose, c'est-à-dire un deuxième rappel, soit préconisée à relativement court terme pour ces personnes, avec le vaccin actuel fondé sur la séquence de la spike de la souche initiale Wuhan. Je rappelle que cette politique de deuxième rappel a été mise en oeuvre en Israël à partir d'une inquiétude, sans qu'il y ait eu d'arguments fondés scientifiquement quant à une baisse de la protection conférée par le rappel. Aucun autre pays au monde n'a pris de décision similaire pour le moment, même si chacun observe cela attentivement. La question se pose donc ; elle n'est pas encore tranchée.
Au-delà, commence la réflexion pour la suite : quel type de vaccination faut-il envisager pour continuer à protéger la population dans les contextes d'évolution du virus évoqués lors de la table ronde précédente ? Nous savons aujourd'hui que ce virus ne disparaîtra pas et que de nouveaux variants apparaîtront, dont nous ne connaissons ni la nature, ni le degré de virulence. Par définition, les types de vaccin et leurs indications dépendront des variants, de leur virulence, de leur circulation et de la durée de l'immunité. De nombreux paramètres, que nous ne pouvons pas cerner aujourd'hui, conditionnent ce que devrait être la politique de vaccination à venir. Il s'agit donc d'une affaire complexe, dans la mesure où il faut anticiper sur des paramètres dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la nature précise.
On peut simplement dire que le vaccin idéal de l'avenir sera un vaccin à large spectre, couvrant un maximum de variants, éventuellement au-delà même des coronavirus beta auxquels appartient le SARS-CoV-2. Il existe des voies de recherche en ce sens. L'idée, qui est en train d'être testée sur le plan clinique, est de composer des vaccins contenant plusieurs spikes, par exemple Omicron, Delta et Wuhan. Plusieurs combinaisons sont en cours de test. L'avantage de cette approche est d'induire une réponse immune secondaire ou tertiaire, compte tenu de l'histoire vaccinale et infectieuse des personnes concernées, qui soit plus large et concerne un maximum de variants. L'inconvénient tient au fait que l'on réduit, par définition, la dose de matériel antigénique susceptible d'induire une réponse immunitaire, donc potentiellement l'efficacité du vaccin. Il s'agit d'un choix difficile.
Une autre approche, techniquement plus complexe, consiste à définir des vaccins universels en utilisant des séquences de virus conservées entre les différents variants. Ces séquences sont très bien identifiées, mais la difficulté réside dans la connaissance de l'immunogénicité de ces séquences et, surtout, du niveau de protection induit à l'égard de ces antigènes partagés par les différents variants. Voilà ce que l'on peut dire à ce stade sur le spectre d'efficacité du vaccin.
Un second point d'intérêt serait de pouvoir induire, à côté de l'immunité dite « systémique » que l'on obtient par l'intermédiaire des injections intramusculaires de vaccin, une immunité locale au niveau du nez et de la gorge, où l'infection débute et où se situent les cellules les plus facilement infectables, en particulier par Omicron. Disposer d'une immunité locale, fondée sur la production d'IgA et la présence de lymphocytes produisant des anticorps et de lymphocytes T mémoires, serait efficace pour protéger contre l'infection, en complément de la protection contre la sévérité de la maladie reposant aussi sur l'immunité cellulaire. Des travaux de recherche et des essais cliniques sont en cours afin de développer des vaccins muqueux en spray nasal. La difficulté intrinsèque de cette approche, même si elle est très élégante théoriquement, est que l'on sait que l'immunité muqueuse est de courte durée : l'effet obtenu, si l'on y parvient, sera donc relativement limité dans le temps et probablement circonscrit à la sphère ORL (nez, gorge, oreilles), ce qui signifie qu'il faudra combiner ce vaccin à des vaccins systémiques. Une utilisation d'un vaccin de ce type à bon escient, dans un système saisonnier est toutefois une approche intéressante ; je rappelle que de tels vaccins existent contre la grippe et sont utilisés chez l'enfant aux États-Unis.
Le troisième point, essentiel, réside dans le souhait que ces vaccins soient persistants. Pour l'instant, notre connaissance de la réponse immunitaire et de sa capacité de protéger à long terme contre l'infection n'est pas suffisamment précise. Il existe encore beaucoup d'inconnues, si bien qu'il est très difficile de prendre aujourd'hui des options sur le type de vaccin, sur le spike ou la combinaison de spikes à cibler, sur l'éventuelle combinaison entre vaccins muqueux et systémique, etc.
La question suivante sera de savoir à qui destiner ces vaccins. Faudra-t-il revacciner l'ensemble de la population ou passer au modèle « grippe » en vaccinant préférentiellement les personnes à risque et celles travaillant au contact des sujets à risque, dont les professionnels de santé ? Ce point est ouvert et dépend du niveau de virulence et de circulation des variants futurs.
Je vais arrêter là cette intervention visant à présenter l'état des connaissances et des réflexions à ce jour, en ayant bien conscience d'avoir apporté plus de questions que de réponses.

Merci professeur. Il est vrai que vous soulevez de nombreuses questions, que nous aurions souhaité vous poser. Peut-être le professeur Delfraissy va-t-il nous éclairer davantage.
Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais évoquer certains éléments qui ne me semblent pas avoir été traités précédemment, avec également, je dois l'avouer, de nombreux points d'interrogation et l'humilité qui s'impose. La pandémie dure en effet depuis deux ans et nous avons tous, à des niveaux divers, été très surpris par son évolution.
J'ai trouvé la première table ronde vraiment passionnante et je remercie l'ensemble des participants pour leurs interventions. Vous avez beaucoup insisté sur les aspects d'évolution, de transmissibilité et d'échappement, et peut-être insuffisamment à mes yeux sur les notions de pathogénicité, de virulence et de gravité. Pour quelles raisons, intrinsèquement, indépendamment de l'extérieur, un variant va-t-il être plus virulent qu'un autre ? Omicron change complètement la donne à cet égard, avec des niveaux de contamination qui ont explosé et une gravité moindre. Pardonnez-moi d'être un peu direct, mais au fond, on se moque qu'un virus circule beaucoup s'il est très peu pathogène ou plus exactement si l'on est en capacité, en fonction du niveau de pathogénicité, de mettre en place un certain nombre de réponses et de marqueurs de suivi adaptés. J'exagère bien évidemment, dans la mesure où la circulation globale finit par toucher l'ensemble de la population et en particulier les personnes les plus fragiles, susceptibles de développer des formes sévères. La prise en compte de la gravité des symptômes change néanmoins fondamentalement la donne. À cet égard, Omicron est totalement différent de ce que nous avons pu observer jusqu'à présent.
Pour la suite, quel sera le prochain variant ? Il s'agira vraisemblablement d'un variant plus transmissible, qui prendra le pas sur le variant précédent. Mais va-t-il se situer dans le prolongement d'Omicron et être moins grave, ou au contraire, s'il est issu d'un autre variant, avoir une pathogénicité similaire à celle observée auparavant ? La réponse à cette question changera complètement la donne en termes d'impact sur notre système de soin et de vision de l'épidémie par nos concitoyens.
Les marqueurs de suivi de l'épidémie sont eux aussi très dépendants de la gravité des infections. Le nombre de contaminations s'élève actuellement à plusieurs centaines de milliers par jour ; mais l'impact sur le système de soins est totalement différent de ce qu'il a été lors des vagues précédentes, dans la mesure où le niveau de gravité est moindre. Les marqueurs de suivi en termes de nombre de contaminations doivent donc être relativisés.
L'un des marqueurs les plus solides est assurément l'impact sur le système de soins, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations et surtout le nombre d'admissions en soins intensifs et en réanimation. Jusqu'à quel point ce que l'on a déjà vécu nous permet-il de prédire la suite ? 7 000 lits de réanimation ont été occupés en mars 2020, avec deux zones très touchées, la région parisienne et le Grand-Est. Nous connaissons actuellement avec Omicron un plateau situé à environ 3 700 lits de réanimation occupés, qui va probablement rester stable pendant un certain temps. Ceci s'inscrit dans un contexte caractérisé par une forme moins grave et une vaccination large. En revanche, le nombre d'hospitalisations, dont on parle finalement peu, est de 32 000, qui correspond à peu de choses près aux chiffres observés en 2020 dans les deux grandes régions les plus touchées.
Sur cette base, peut-on déduire jusqu'à quel point le système de soins serait capable de résister en cas d'apparition d'un nouveau variant ? Le marqueur probablement le plus robuste est celui des réanimations. Je rappelle que lorsque 7 000 lits de réanimation étaient occupés, l'activité hospitalière hors Covid avait totalement cessé. La France manque de lits de réanimation et il serait nécessaire d'agir sur ce point si l'on voulait anticiper un dispositif suffisamment solide pour faire face à ce nouveau type de menace. Il faut avoir cela à l'esprit.
Ceci soulève une deuxième question, relative au niveau de mortalité : n'allons-nous pas être amenés à réfléchir au nombre de morts que nous pouvons accepter sociétalement, tous ensemble, dans une communauté ? Il est important de souligner que les choses évoluent à cet égard. Souvenez-vous de l'égrènement du nombre de décès dans les médias lors de la première vague. Aujourd'hui, le nombre total de décès liés au Covid est d'environ 130 000, dont 11 000 à 12 000 depuis l'automne 2021, ce qui est loin d'être négligeable. Si l'on considère que la situation va rester relativement sévère jusqu'à mi-mars, le nombre total de décès causés par la cinquième vague sera lui aussi conséquent. Quel niveau de mortalité sommes-nous capables d'anticiper et d'admettre, par rapport au nombre de décès causés par exemple par la grippe ? Ceci conditionnera notamment l'estimation de la capacité en soins intensifs nécessaire pour y faire face. Sur cette base, il est possible d'envisager une équation dont découle la réponse à mettre en place, visant à éviter des mesures générales de restriction qui ne seraient probablement plus acceptables aujourd'hui. Comme l'ont souligné les précédents intervenants, Cette démarche doit évidemment tenir compte de l'immense intérêt des vaccins, mais aussi de leurs limites. On n'évitera pas, me semble-t-il, une forme de débat extrêmement difficile - qui doit le mener ? je l'ignore -, sur la capacité de notre système de soins et l'acceptabilité du nombre de décès lors d'une pandémie, par comparaison avec la grippe.
Les échanges de ce matin ont logiquement beaucoup porté sur le virus et en fait assez peu sur la réponse immunitaire. Globalement, l'immunité post-infectieuse vis-à-vis de ce type de virus est très particulière et relativement labile. On infère parfois du fait que 12 à 15 millions de nos concitoyens auront été infectés par Omicron l'idée que ceci permettra d'atteindre une immunité en population relativement élevée, qui viendra s'additionner à l'immunité obtenue par la vaccination. Or j'ignore ce que vaut l'immunité post-infection par Omicron. Je ne connais pas le potentiel réel de la réponse en anticorps, indépendamment d'un croisement vis-à-vis d'un nouveau variant. J'ignore quelle sera sa labilité : sera-t-elle par exemple plus importante en fonction de la gravité et de la pathogénicité ? Nous ne disposons actuellement d'aucune donnée solide à ce sujet. J'avoue par conséquent être très interrogatif à l'égard des annonces indiquant que l'on va pouvoir s'appuyer sur l'immunité extrêmement large liée aux contaminations par Omicron pour constituer une immunité en population. Il est urgent que des études soient conduites à ce sujet.
Nous sommes tous d'accord pour dire que les vaccins induisent une protection forte, bien que plus ou moins durable, contre les formes sévères et graves de la maladie. Quelle est la signification de cette observation en termes de physiopathogénie ? Quel est le type de réponse immunitaire induite ? Certains d'entre nous, qui avaient reçu leur troisième dose de vaccin, ont été contaminés par Omicron sans faire de forme sévère ou grave. Quel est le mécanisme physiopathogénique exact dans l'immunité induite par le vaccin qui protège contre ces formes sévères ou graves ? Nous n'avons que peu d'éléments de réponse. L'immunité T est probablement un élément majeur de ce mécanisme. Mieux le comprendre serait utile dans le cadre de l'élaboration du vaccin.
Enfin, l'apparition de traitements, sous la forme d'antiviraux à action directe contre le virus, est-elle susceptible de changer la donne ? Comme vous le savez, plusieurs anticorps monoclonaux ont été développés, qui ont été actifs contre certains variants mais dont la plupart ont vu cette activité réduite à la suite des phénomènes d'échappement immunitaire liés à Omicron. Un seul semble conserver une certaine forme d'efficacité, bien que cela soit l'objet de discussions. Les antiviraux à action directe par voie orale ont été un échec jusqu'à l'arrivée du Paxlovid, qui sera disponible en pharmacie dans les tout prochains jours. Cet inhibiteur de protéases, boosté par du ritonavir, réduirait de 80 % ou 85 % la survenue de formes sévères ou graves chez les personnes vaccinées ou non vaccinées qui le prendraient de façon précoce après l'infection. Ceci permettrait de mettre en oeuvre une stratégie de type « test and treat », déjà développée dans d'autres grandes pathologies virales. Il va toutefois falloir observer attentivement les résultats obtenus en vie réelle, afin de voir s'ils sont au niveau attendu. De manière générale, il faut savoir que les résultats constatés sur le terrain sont légèrement moins bons que ceux obtenus lors des essais thérapeutiques. J'insiste sur le fait que ce traitement n'a d'intérêt que s'il est administré de façon extrêmement précoce. Ceci implique la mise en place d'un circuit entre la personne qui se fait tester, le médecin qui prescrit et le pharmacien. Le nombre de doses disponibles va en outre être relativement limité dans les quinze jours à venir, et des carences pourraient apparaître compte tenu du niveau actuel de circulation virale. À moyen terme, ce traitement peut néanmoins introduire un nouvel élément dans la lutte contre la pandémie. Il est dirigé contre la protéase, qui n'a a priori pas été impactée de façon significative jusqu'à présent lors des mutations associées aux variants d'intérêt, et permettrait par conséquent d'être actif contre l'une des enzymes entrant en jeu dans la construction du virus. Des phénomènes de résistance vont-ils apparaître ? La réponse est affirmative, par définition. Il faut toutefois souligner qu'il s'agit d'un traitement court, d'une durée de cinq jours seulement. On peut néanmoins tout imaginer en termes d'adhérence au traitement. Il est en outre important de ne pas opposer ce traitement à la vaccination, mais de le considérer comme un complément.
Je conclus en insistant moi aussi sur la population très particulière que constituent les personnes immunodéprimées, à la fois pour elles-mêmes, puisqu'elles répondent mal au vaccin et représentent 15 % à 18 % des personnes hospitalisées actuellement en réanimation, mais aussi au regard de la surveillance du virus, car c'est probablement là que peut apparaître la capacité à construire un nouveau variant. Or nous n'avons pas encore mis en place de réflexion particulière autour de cette population. Probablement faut-il aller un peu plus loin sur la politique de séquençage.
Merci beaucoup pour ces analyses approfondies. Nous espérions des réponses définitives et rassurantes quant aux incertitudes et imprévisibilités relevées lors de la première table ronde ; force est de constater que la seconde soulève elle aussi de nombreuses questions.

sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Merci beaucoup pour ces explications et précisions, qui laissent effectivement subsister beaucoup d'incertitudes et ouvrent de nouvelles questions. Ceci montre combien il est important de faire le point très régulièrement, puisque la situation évolue très vite.
Plusieurs facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie susceptible de conduire en réanimation ont été mentionnés, comme l'âge. Mais a-t-on identifié les raisons pour lesquelles certaines personnes développent une forme grave entraînant notamment une atteinte pulmonaire sévère ? Ceci permettrait de mettre en oeuvre une surveillance spécifique dans la population définie à risque et d'administrer le traitement de façon précoce. Il semble en effet difficile de surveiller très attentivement l'ensemble des personnes de plus de 65 ans.
Ma deuxième question porte sur la pharmacovigilance. Il existe des alertes en matière de maladies auto-immunes ou de risques liés à la vaccination. Dès lors qu'est évoquée la possibilité d'une quatrième dose, il faut étudier très précisément ce sujet. Il ne me paraît en effet pas totalement déplacé de penser que le fait de stimuler régulièrement l'immunité de façon artificielle n'est pas naturel. Où en est-on sur ces sujets ? Ceci fait-il partie des risques désormais pris en compte dans l'élaboration d'une future stratégie ?
Les remontées de pharmacovigilance relatives à la perturbation du cycle menstruel sont très importantes, même si ceci n'a pas occupé le devant de la scène scientifique. Ce phénomène suggère que la vaccination peut avoir des conséquences hormonales et il a fondé, outre le risque de thrombopénie, le conseil donné aux femmes enceintes d'éviter la vaccination, qui a très largement circulé. Il faudrait clarifier ce sujet, dans la mesure où de nombreuses femmes enceintes hésitent, pour ces raisons, à se faire vacciner.
En matière de tests, le risque de faux positifs a été évoqué. Nous savons qu'il existe des astuces pour provoquer une fausse positivité. A-t-on identifié d'autres raisons ? Quelle est finalement la part estimée des faux positifs dans l'ensemble des tests effectués actuellement ? Bien que la stratégie mise en place soit rigoureuse et scientifique, il est désormais clair que divers éléments permettent d'échapper à la règle et que la photographie de l'épidémie n'est de ce fait pas tout à fait conforme à la réalité.
D'un point de vue épidémiologique, les données relatives aux formes graves sont maintenant très solides. L'âge est un facteur de risque très important, tout comme certaines comorbidités. Une forme grave peut en effet être liée à l'infection par le Covid lui-même, mais également au fait que le Covid peut faire décompenser une pathologie sous-jacente.
En termes physiopathogéniques, il existe chez les sujets les plus âgés une forme d'immunosénescence provoquant une réponse immunitaire insuffisante, d'où l'intérêt fondamental de la vaccination. La réponse immunitaire peut également être inadaptée : c'est le cas chez un certain nombre d'individus qui, pour des raisons génétiques, produisent une réponse immunitaire conduisant à un état inflammatoire massif à l'origine de formes graves.
Existe-t-il un biomarqueur ? En d'autres termes, est-on capable de repérer les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave ? À ma connaissance, non. Le meilleur des biomarqueurs est l'âge. Les facteurs de comorbidité procèdent par ailleurs de données épidémiologiques, cliniques et de bon sens. S'y ajoute la situation des personnes immunodéprimées.
J'insiste sur le fait que la donne a changé. Il faut bien séparer ce qui relève de l'hospitalisation liée à Omicron - le virus induisant une forme plus ou moins sévère de la maladie - et avec Omicron - auquel cas le virus conduit, chez des sujets souffrant d'une pathologie respiratoire antérieure, à une décompensation. L'âge et les facteurs de risques que je viens de décrire sont des critères solides.

Les groupes sanguins jouent-ils un rôle ? L'idée a en effet circulé selon laquelle les personnes du groupe O seraient protégées contre les formes graves.
Il est vrai que l'on peut trouver, à l'échelle populationnelle, des éléments suggérant une capacité à développer une forme plus ou moins sévère en fonction de tel ou tel biomarqueur, dont celui que vous mentionnez. Au niveau individuel, ce n'est pas le cas : on peut parfaitement être du groupe O et développer une forme sévère du Covid. La question sous-jacente est certainement de parvenir à individualiser dans une population, indépendamment de l'âge et des autres facteurs de risque connus, des personnes plus à risque, en particulier chez les sujets jeunes. Je rappelle que certains marqueurs épidémiologiques cliniques, comme l'obésité, sont déjà identifiés de façon robuste. Mais à ma connaissance, l'utilisation de tels éléments à l'échelle individuelle, pour essayer en particulier de gérer l'arrivée du Paxlovid, n'est pas envisagée.
Ma réponse concerne la question de la pharmacovigilance et des maladies auto-immunes. Il faut savoir qu'en France, trois millions de personnes environ ont une maladie auto-immune, soit quelque 5 % de la population adulte, ce qui est considérable. Il existe toutes sortes de maladies auto-immunes : polyarthrite, sclérose en plaques, lupus, etc. Entre 85 % et 90 % des personnes concernées sont heureusement vaccinées contre le Covid ; j'emploie cet adverbe à dessein car elles sont plus à risque de formes de Covid sévère que la population générale. Il y a donc une indication formelle de vacciner les personnes atteintes de maladies auto-immunes.
Bien évidemment, le fait qu'une telle personne, trois, huit ou quinze jours après le vaccin, connaisse une poussée de maladie auto-immune remonte dans le dispositif de pharmacovigilance. Statistiquement, il est absolument évident qu'à partir du moment où une population de 3 millions de personnes est atteinte de ce type de maladie et où l'on vaccine chaque jour plusieurs centaines de milliers d'individus, on observe par concomitance dans les jours suivants qu'un certain nombre des personnes ainsi vaccinées développent une poussée de maladie auto-immune. Une fois ces signalements effectués, il est très important de faire la part des choses entre ce qui est du domaine de la concomitance et ce qui relève de la corrélation, voire de la causalité. À ce jour, il n'apparaît aucun signal significatif sur une relation de cause à effet entre vaccination et poussée de maladie auto-immune, sur la base des données de centaines de millions de personnes disponibles à l'échelle mondiale et au-delà de la pharmacovigilance par ailleurs fort bien réalisée en France, dans les pays d'Europe occidentale et en Amérique du nord. Il faut d'autant plus rassurer les personnes concernées qu'il est très important qu'elles soient vaccinées. Ceci rejoint le débat, malheureusement excessif sur le plan médiatique, qui a concerné voici plus de vingt ans le lien entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Il y avait eu alors des concomitances, mais de nombreuses études ont montré que le vaccin contre l'hépatite B ne déclenchait pas de poussée de sclérose en plaques. Il faut donc rassurer les personnes concernées, tout en soulignant l'importance de continuer les signalements en pharmacovigilance, qui permettraient éventuellement d'établir, pour certaines complications non auto-immunes, une relation entre le vaccin et un événement médical indésirable.
Il me semble important de distinguer la question des femmes enceintes et celle des modifications de cycle menstruel. Il est vrai qu'ont été reçus, en France comme à l'étranger, un certain nombre de signalements de la part de jeunes femmes indiquant des perturbations de leur cycle menstruel. Ceci a déjà été signalé avec d'autres vaccins. Il n'est pas facile d'établir l'existence ou l'absence d'une relation de cause à effet. Dans le doute, ceci n'est pas totalement à exclure. Il est toutefois très important de souligner que cette perturbation est limitée, temporaire, concerne un cycle, exceptionnellement davantage, et n'a aucune conséquence ni sur la vie de la femme concernée, ni sur sa régulation hormonale, ni sur sa fécondité. Il est important de rassurer les jeunes femmes qui auraient des craintes à ce sujet. Le risque ne se situe absolument pas dans la même dimension que le bénéfice apporté par la vaccination.
Les femmes enceintes ne sont quant à elles pas suffisamment vaccinées. Des collègues obstétriciens m'ont communiqué voici 48 heures des chiffres émanant de six maternités de l'AP-HP indiquant que la couverture vaccinale des femmes enceintes en fin de grossesse ne dépassait pas 60 %, ce qui est très en-deçà de la couverture vaccinale des personnes du même âge. Ceci n'est pas satisfaisant, car le fait de ne pas être vaccinées expose ces femmes à des risques très importants, désormais rapportés dans de nombreuses études scientifiques, dont je pourrai vous fournir les références si vous le souhaitez. Sachez par exemple que le fait pour une femme enceinte non vaccinée d'attraper le Covid, qui plus est en fin de grossesse, multiplie par 18 le risque d'aller en réanimation, avec une pneumonie aggravée par la gêne mécanique ou par des complications vasculaires. Or la vaccination protège contre ces complications, qui peuvent être graves et aboutir à la mort. Certaines jeunes femmes, en pleine santé par ailleurs, sont ainsi mortes du Covid pendant leur grossesse. Ce sont des drames possibles, mais parfaitement évitables dans la mesure où la vaccination complète évite plus de 95 % de ces complications.
Il faut aussi savoir que l'infection au Covid a un retentissement sur les bébés : une femme atteinte du Covid a deux fois plus de risques de voir naître un enfant né prématuré. Le risque de fausse couche, de retard de croissance intra-utérin et de pathologies de l'enfant est également accru. Actuellement en France, quelque 150 nouveau-nés de mères positives sont hospitalisés car ils souffrent indirectement, sans être eux-mêmes infectés - ou rarement - des conséquences de la maladie contractée par leur mère pendant sa grossesse. La vaccination des femmes avant et pendant la grossesse est donc indispensable, et l'on sait par ailleurs, sur la base de données issues de multiples cohortes suivies dans de nombreux pays, qu'elle est sûre, n'entraîne pas de fausse couche ni de malformation et n'a aucune conséquence négative sur la grossesse. Je me permets donc d'insister très fortement sur l'importance de recommander cette vaccination et de l'expliquer aux femmes concernées.
Concernant les maladies auto-immunes, il faut évidemment poursuivre la surveillance, comme ceci a été indiqué. Par le passé, pour d'autres vaccins, une relation a pu être établie : je pense par exemple au lien entre la narcolepsie et l'un des vaccins utilisés pendant la pandémie de grippe H1N1 ; le signal est intervenu dans les six à douze mois suivant la vaccination. Pour ce qui concerne les vaccins à ARN messager, nous sommes aujourd'hui au-delà de cette fenêtre temporelle. Il faut prendre l'hypothèse que l'on connaît vraiment bien ces vaccins et leurs effets sur le système immunitaire.
L'une des questions concernait les potentiels effets d'une vaccination répétée. Si l'on regarde ce que représente une infection dite naturelle, marquée par une réplication non contrôlée du virus, le stress pour le corps est beaucoup plus important alors que la « reconstruction » de l'infection qu'est la vaccination est beaucoup plus respectueuse du corps.
Pour ce qui est des perturbations du cycle menstruel, il est exact qu'aucun effet négatif sur la fertilité ou les grossesses n'a été confirmé. La conclusion est claire sur un plan scientifique. Il faut cependant reconnaître que certaines pratiques de contraception ont une efficacité réduite pendant ce cycle. Il me semble important d'aborder ce point dans la communication à l'attention de la population, car ceci peut avoir un impact important sur la qualité de vie, pour les femmes et les couples.
Vous avez enfin abordé la question des faux positifs aux tests. En général, il est surtout question des faux négatifs, qui semblent être actuellement un problème avec Omicron. Dès lors que l'on teste une population, que l'on pratique un dépistage dans un groupe qui n'a pas de suspicion de la maladie et ne présente pas de symptômes, on se trouve confronté à des faux positifs. C'est la raison pour laquelle, en médecine, on utilise en principe les tests uniquement en présence de symptômes, lorsque la personne est cas contact ou sujette à une histoire familiale particulière. C'est une problématique des programmes de dépistage, que l'on retrouve aujourd'hui avec la Covid et les débats sur les dépistages massifs.
Je partage totalement ce qui vient d'être dit à propos des tests. Il existe effectivement un risque de faux positifs extrêmement élevé lors de tout test non contextualisé. Dans le cas où un dispositif a une spécificité et détecte les personnes positives à 99,9 %, ceci signifie que chaque fois que l'on effectue 100 tests dans une population non ciblée, on obtiendra un faux positif. Lorsque ceci se répète tous les jours et que de très nombreuses personnes sont testées, notamment en autonomie comme ceci est le cas avec les autotests, dans lesquels les conditions de manipulation ne sont pas nécessairement respectées, alors on augmente le risque de faux positifs et de faux négatifs, si bien que la performance des tests baisse.
Les conditions d'utilisation des tests sont importantes. Par exemple, lorsque des barnums sont installés en extérieur, il se peut que les analyses soient effectuées à des températures trop basses, ce qui peut conduire à des faux positifs ou des faux négatifs. En effet, des bandelettes trop sèches ou trop froides ne permettent pas au test d'être correctement réalisé. On sait en outre qu'en fonction de l'acidité du milieu, on peut obtenir des faux positifs. Il est donc possible de tricher sur un test ; mais je ne vous indiquerai pas comment procéder.

sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Les étudiants la connaissent et se la transmettent...

Je souhaite tout d'abord remercier les intervenants des deux tables rondes, ainsi que nos collègues Gérard Leseul, Florence Lassarade, Sonia de la Provôté et Jean-François Eliaou, qui sont passionnés par ce sujet.
Nous sommes un office parlementaire : notre mission n'est donc pas vraiment, contrairement à vous, de faire progresser la science, mais plutôt de transmettre à des gens qui seront amenés à prendre des décisions des informations suffisamment solides pour qu'ils puissent agir en connaissance de cause. Pour être très franc, j'avoue avoir eu, en écoutant la première table ronde, un sentiment d'angoisse lié à l'idée que, finalement, on ne savait rien ou plus exactement que je ne serais pas en mesure de rassurer mes collègues à l'issue de cette audition. Puis j'ai écouté la seconde table ronde et fait la synthèse des deux sur le plan politique. J'ai trouvé tout cela très cohérent. Nous disposons de vaccins, pertinents dans la mesure où ils évitent les formes graves. En revanche, le sujet des virus est un sujet ouvert, et ce d'autant plus que chaque connaissance nouvelle génère des interrogations inédites et nous oblige à aller plus loin. Les vaccins ne suffiront donc pas à régler le problème de la Covid, comme cela a pu être le cas par le passé avec d'autres maladies, dont certaines d'ailleurs, comme la tuberculose, reviennent aujourd'hui.
Nous avons ainsi à la fois une recherche scientifique très forte et des points d'interrogation sérieux et solides, avec toutefois la certitude que si le vaccin ne règle pas tout, il évite au moins les formes sévères. L'information relative à la vaccination des enfants, évoquée par le professeur Fischer, est de ce point de vue très intéressante pour les élus, car elle répond à une question que se posent les parents. La majorité de nos compatriotes pensent en effet que la vaccination est intéressante pour les adultes, mais ne savent pas trop comment procéder pour ce qui concerne les enfants - je parle ici en tant que père et grand-père. Or le message que vous avez délivré est parfaitement clair.
La seconde table ronde est particulièrement utile pour les parlementaires, car si la première invite à la modestie en insistant sur le fait qu'il reste encore beaucoup à étudier, à découvrir et à comprendre, la seconde apporte une réponse sur ce que nous devons faire, quoi qu'il arrive, à court terme, à savoir une vaccination généralisée.
Ces deux tables rondes sont scientifiques, avec le lot de doute et d'interrogations légitimes qu'engendre toute démarche scientifique, mais pour nous, elles sont aussi politiques, dans la mesure où elles nous indiquent avec une grande clarté ce qu'il convient de faire dans l'immédiat.
En s'interrogeant sur le nombre de morts qu'une société peut accepter, le professeur Delfraissy m'a rappelé plusieurs évidences. La première est qu'avant ce coronavirus, on ne se posait pas cette question ou on la découvrait après coup. J'ai par exemple connu, au cours de ma longue vie, la grippe de Hong-Kong, la grippe asiatique ; la question du nombre de décès n'avait alors pas été posée. Des études ont été menées, le décompte des décès a été établi, mais l'actualité ne s'en est jamais fait l'écho et la société n'avait pas cette hypersensibilité au sujet.
En tant qu'ancien ministre de la défense, je répondrai au professeur Delfraissy que tout le monde rêve d'une société dont la mort serait exclue, ce qui est malheureusement improbable. Pour ce qui est de la maladie, le bon critère, opérationnel sur le plan politique, est la capacité de la société à gérer, dans son système hospitalier, les cas qui en relèvent. Au-delà, nous avons vocation, les uns et les autres, à disparaître un jour, le plus tard possible. Il est important d'accepter la perspective que nous ne sommes pas éternels. Ceci étant dit, la feuille de route est simple : vaccinons, vaccinons, vaccinons, en dénonçant comme vous nous aidez à le faire les supercheries et les mensonges patentés.
Je ne vous poserai aucune question, dans la mesure où je ne suis pas sûr de pouvoir en comprendre la réponse, mais je souhaite pour conclure vous apporter la certitude que ces deux tables rondes ont été, pour nous décideurs, extraordinairement utiles.
La seconde table ronde a, tout comme la première, posé un certain nombre de questions et de constats. Je garde tout particulièrement en tête les propos de Mme Mueller sur l'importance, au-delà de la science, de la confiance des citoyens dans le système, politique, social, professionnel, etc. Il est essentiel de bien comprendre ceci pour envisager les réponses et les discours que nous, politiques, devons avoir.

Je pense très profondément que les deux aspects sont liés : si les hommes politiques ne comprennent pas la science et ne parviennent pas à l'expliquer à leurs compatriotes, alors ceci est de nature à entretenir un désaccord, un désamour, une incompréhension qui serait meurtrière, alors qu'il existe de la bonne volonté manifeste chez tout le monde et le désir de prendre la mesure à la fois de ce que l'on est capable de faire et de ce que l'on a encore à accomplir.
Voilà de belles et fortes paroles.
J'ai apprécié que Jean-François Delfraissy mette l'accent sur le sujet des traitements, qui pour l'instant n'ont joué qu'un rôle mineur dans la lutte contre la pandémie, mais dont on peut espérer qu'ils seront bientôt porteurs de bonnes nouvelles. On entend en effet dire depuis longtemps que les traitements sont sur le point d'arriver. Disposer de médicaments pourrait changer la donne par rapport aux prédictions et projections données par les différents modèles.
Il appartient à présent au président de l'Office de conclure cette audition publique.
Je souhaite au préalable remercier au nom de tous les rapporteurs l'ensemble des participants pour leurs explications, leurs questions et leurs apports précieux à notre réflexion politique.
Cette audition fut par moments vertigineuse, aussi bien du fait des informations scientifiques très détaillées que l'on a rarement l'occasion de discuter dans un cadre parlementaire - je pense à la configuration de certaines protéines, aux mécanismes de modélisation ou encore aux évolutions induites par certaines mutations -, que par l'ampleur des incertitudes qui pèsent sur la suite de l'épidémie et l'évolution du virus lui-même. Bien malin qui serait capable de prédire l'avenir. Il apparaît néanmoins que tout discours prétendant que nous sommes sortis de la pandémie serait farfelu : rien aujourd'hui ne permet d'étayer de tels propos.
Malgré ces nombreuses incertitudes, nous disposons aujourd'hui d'une vision plus claire de la panoplie des réponses envisageables et des différents réflexes qu'il conviendra d'avoir.
Nous avons bien noté l'alerte que vous avez formulée sur l'accessibilité des données et sur le fait que certains mécanismes de vigilance et d'observation ne sont aujourd'hui pas disponibles en temps et en heure.
Nous avons apprécié également le fait que vous avez tous insisté sur les observations faites, les leçons qui en ont été tirées, l'ampleur de l'incertitude qui subsiste et les éléments se dégageant de façon forte.
Il apparaît par ailleurs que certains concepts qui s'étaient imposés dans le débat public au début de la pandémie ont perdu de leur importance. Je pense par exemple au fait que le R0, paramètre dont tout le monde parlait au début, n'est plus vraiment opérationnel. De la même manière, l'idée de l'immunité collective, qui apparaissait parfois comme un graal, n'est plus vraiment un sujet, puisqu'il faudrait avoir désormais un taux de couverture de 100 %.
Le débat s'est déplacé. Le paramètre critique pour la puissance publique reste le taux d'hospitalisation en réanimation et en soins critiques, mais les critères selon lesquels il convient d'apprécier l'épidémie sont devenus beaucoup plus riches et complexes.
Je vois comme conclusion générale de cette audition l'importance d'une vigilance globale et du respect des différentes institutions. Les projections présentées lors de l'audition de décembre dernier étaient beaucoup plus pessimistes que ce que l'on a observé par la suite. Certes les projections basses présentées par Mircea Sofonea et Samuel Alizon ont été respectées, mais je rappelle qu'un avis du Conseil scientifique pointait crûment une possibilité de désorganisation complète du système hospitalier vers la mi-janvier, à une époque où l'on ignorait quelle serait la virulence d'Omicron et où existaient certaines incertitudes sur des développements épidémiques à venir. Ceci ne s'est pas produit et il y a tout lieu d'être confiant quant à la sortie sinon de la pandémie, du moins de cette double vague d'Omicron et de Delta, même si l'on sait que l'épidémie peut redémarrer.
Les intervenants ont également présenté des éléments permettant de s'y préparer, avec les outils dont nous disposons. Je note le besoin impérieux pour la société de ne pas rester obsédée par cette pandémie, dont les effets économiques et psychologiques sont délétères. Le fait de garder le sujet sur la table a de réels et graves inconvénients.
Il est très important que l'OPECST reste en alerte et garde le contact avec l'ensemble de la communauté de la recherche et du monde médical que vous avez représenté aujourd'hui. L'exercice cognitif qui nous est demandé, consistant à la fois à se rassurer en considérant que la vague actuelle est en train de s'estomper, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'être prêt à se mettre en état d'alerte maximum au cas où une nouvelle vague surviendrait, est particulièrement difficile.
Je vous remercie à nouveau pour la qualité de ces échanges.
La réunion est close à 12 h 45.