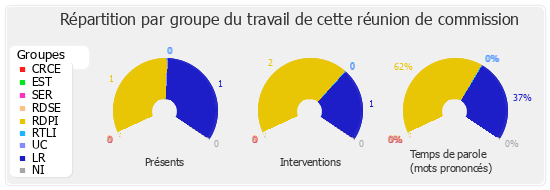Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 25 février 2014 : 1ère réunion
Sommaire
- État d'avancement et perspectives d'évolution de l'union bancaire
- Audition conjointe de mm. corso bavagnoli sous-directeur des banques et du financement d'intérêt général à la direction générale du trésor frédéric visnovsky secrétaire général adjoint de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution acpr karel lannoo directeur général du centre for european policy studies ceps pierre de lauzun directeur général délégué de la fédération bancaire française et mme laurence scialom professeure d'économie à l'université paris-x (voir le dossier)
La réunion
État d'avancement et perspectives d'évolution de l'union bancaire
Audition conjointe de Mm. Corso Bavagnoli sous-directeur des banques et du financement d'intérêt général à la direction générale du trésor frédéric visnovsky secrétaire général adjoint de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution acpr karel lannoo directeur général du centre for european policy studies ceps pierre de lauzun directeur général délégué de la fédération bancaire française et Mme Laurence Scialom professeure d'économie à l'université paris-x
Au cours d'une première réunion, la commission procède à l'audition conjointe de MM. Corso Bavagnoli, sous-directeur des banques et du financement d'intérêt général à la direction générale du Trésor, Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Karel Lannoo, directeur général du Centre for European Policy Studies (CEPS), Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la Fédération bancaire française, et Mme Laurence Scialom, professeure d'économie à l'Université Paris-X, sur l'état d'avancement et les perspectives d'évolution de l'union bancaire.

Je vous prie d'excuser l'absence de notre rapporteur général François Marc, retenu dans son département du Finistère par les obsèques d'un parlementaire exemplaire, Alphonse Arzel. Je poserai ses questions en son nom.
Les auditions de ce matin portent sur l'état d'avancement et les perspectives d'évolution de l'union bancaire. Depuis le Conseil européen de juin 2012, plusieurs étapes importantes ont été franchies : le mécanisme de surveillance unique (MSU) a été adopté à l'automne 2013 et entrera en vigueur progressivement courant 2014. La Banque centrale européenne (BCE) sera, à la fin de l'année, responsable de la supervision de l'ensemble des établissements de crédit de la zone euro, et assurera cette supervision directement pour les plus importants d'entre eux, soit, en France, leur quasi-totalité.
Le lancement d'un superviseur unique s'accompagne d'une sorte d'opération vérité sur le secteur bancaire européen. La BCE procède en effet à une revue de la qualité des actifs bancaires - ou asset quality review - qui mesurera la solidité des établissements et leur résistance aux crises. L'objectif est de « faire sortir les cadavres des placards » où les superviseurs nationaux les avaient peut-être opportunément laissés depuis le début de la crise. Où en est cet exercice ? Que doivent en attendre les banques européennes en général, et françaises en particulier ? Quelles en seront les conséquences pour les établissements jugés trop fragiles ?
Le second volet de l'union bancaire consiste en un mécanisme de résolution unique (MRU), censé encadrer le démantèlement ou la restructuration ordonnée des banques en crise. Les négociations entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission portent d'abord sur les procédures de décision. La Commission souhaite jouer un rôle principal. Les États membres entendent conserver certaines prérogatives. Comment garantir la rapidité et l'efficacité du mécanisme ? Quel financement des recapitalisations faut-il prévoir ? Selon quelles modalités les banques alimenteront-elles le fonds de résolution européen, dont la capacité devrait atteindre 55 milliards d'euros ? À quelle vitesse les contributions des différents secteurs bancaires nationaux seront-elles mutualisées ? Si les ressources privées sont insuffisantes, y aura-t-il une garantie publique ?
Ces questions, d'apparence technique, sont politiques et institutionnelles. Les États membres estiment qu'un nouvel accord intergouvernemental est nécessaire. Pour la Commission, un acte de droit communautaire dérivé suffit. L'enjeu reste, pour nous, dans la perspective de l'examen, dès demain, du rapport de François Marc sur la proposition de résolution européenne déposée par Richard Yung, de comprendre dans quelle mesure les évolutions en cours seront de nature à couper tout lien entre risque bancaire et risque souverain, donc à protéger le budget des États membres et la monnaie unique ? En d'autres termes, sommes-nous complètement tirés d'affaire de la crise des dettes souveraines ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous entendons Corso Bavagnoli, sous-directeur des banques et du financement d'intérêt général à la direction générale du Trésor ; Karel Lannoo, directeur général du Centre for European Policy Studies (CEPS), qui avait été le premier à proposer de donner une licence bancaire au Fonds européen de stabilité financière, proposition formulée par nos soins dans le projet de loi de finances rectificative de septembre 2011 et devenue position du gouvernement français ; Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la Fédération bancaire française ; et Laurence Scialom, professeure d'économie à l'Université Paris-X.
M. Bavagnoli, quels sont les enjeux de ces évolutions ? Quelle est la position française, ainsi que celle des autres États membres sur ces questions ? L'Allemagne et la France ont-elles les mêmes intérêts, les mêmes positions ? La France doit-elle craindre le lourd tribut que ses banques risquent de verser dont les petites banques allemandes les plus fragiles pourraient être les premières bénéficiaires - une position à fronts renversés, pour ainsi dire ?
Ma première intervention sera brève et laissera certaines questions en suspens en attendant la fin du tour de table. Depuis juin 2012, la mise en place de l'union bancaire est une priorité de l'agenda européen. En mettant fin au cercle vicieux entre risque souverain et risque bancaire, surtout dans les États périphériques de la zone euro, elle est indispensable à la reprise de l'activité économique.
L'union bancaire était déjà en filigrane dans le traité de Maastricht, qui envisageait de doter la BCE, le moment venu, de compétences de supervision. Début 2011, sur les préconisations du rapport de Jacques de Larosière, une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des marchés financiers et une autorité européenne des assurances ont été mises en place, et le paquet CRD4/CRR a instauré un corpus unique de règles en matière de surveillance bancaire. Une étape décisive a été franchie en juin 2012, lorsque le Conseil européen a pris une position de principe en faveur de la création de mécanismes de supervision et de résolution uniques, ainsi que de la mise en place d'un système unifié de garantie des dépôts.
Les marchés européens sont, en effet, de plus en plus intégrés, mais la responsabilité de la supervision et de la résolution est demeurée essentiellement nationale. Il était urgent d'agir sur le canal par lequel l'érosion de la confiance des marchés aboutissait à exporter les difficultés de financement aux États souverains, comme ce fut le cas en Espagne avant le Conseil européen de juin 2012. Ce cercle vicieux a conduit à renationaliser les marchés financiers et compliqué, en dernière instance, les conditions de financement de l'économie réelle en périphérie de la zone euro. En juin 2012, les chefs d'États et de gouvernements ont décidé d'autoriser le mécanisme européen de stabilité (MES) à recapitaliser directement les banques de la zone euro lorsqu'un mécanisme de supervision unique (MSU) aura été établi car, dès lors que les ressources des contribuables européens étaient sollicitées, il fallait simultanément créer une responsabilité commune de prévention des risques bancaires.
Sur le fondement du règlement adopté à l'automne 2013, le MSU est en cours de mise en oeuvre, et devrait être opérationnel en novembre 2014. Les responsables de son conseil de supervision ont été nommés. Les chantiers prioritaires seront la revue des actifs conduite par le MSU et les tests de résistance, menés par l'Autorité bancaire européenne. À terme, la BCE sera responsable de la supervision de toutes les banques européennes. Cette supervision sera directe pour les 128 plus grands établissements, qui ne sont pas tous systémiques, représentant 85 % des actifs de la zone euro, et indirecte pour les autres. Le secteur bancaire français, plus concentré que dans les autres pays, sera contrôlé directement à 95 %.
Le deuxième étage du système est constitué du mécanisme de résolution unique (MRU), encore en discussion. Un règlement européen et un accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au fonds unique de résolution formeront sa base juridique. Le Conseil européen a trouvé un accord, le 18 décembre dernier, sur un projet de règlement, et les discussions avec le Parlement européen ont commencé. Son périmètre sera plus large que celui du MSU, car la responsabilité directe de l'autorité européenne de résolution concernera toutes les banques de la zone euro, dès lors qu'elles ont une activité transfrontalière. Le MRU sera administré par un conseil de résolution restreint, afin d'assurer la rapidité de ses décisions, qui associera étroitement les autorités nationales concernées. Les décisions prises seront soumises sur proposition de la Commission européenne à l'approbation du Conseil européen, qui disposera de vingt-quatre heures pour rendre sa décision.
Le fonds unique de résolution européen de 55 milliards d'euros, soit 1 % des dépôts garantis de la zone euro, sera créé au sein du MRU, et financé par les établissements de crédit sur une période transitoire de dix ans. Des compartiments nationaux seront utilisés en résolution, mais de manière dégressive, à mesure que progressera la mutualisation. Au bout de dix ans, le fonds unique, totalement mutualisé, bénéficiera d'un filet de sécurité public européen commun. Le système sera alors totalement fédéralisé.
Ces instruments résultent de compromis, mais il ne faut pas sous-estimer leur ambition. Le champ du MRU est large, ce qui incitera la BCE à étendre celui de sa supervision. Le fonds unique sera opérationnel dès 2015, sa mutualisation progressive et sa capacité, importante, permettra de faire payer au secteur bancaire ses propres crises.
Le mécanisme européen de garantie des dépôts sera le dernier pilier de l'union bancaire. Des progrès importants ont déjà été accomplis, puisqu'une nouvelle directive d'harmonisation sera adoptée en trilogue au printemps, après accord du Conseil Ecofin. Elle unifiera le mode de financement des garanties des dépôts en Europe, et accélèrera le remboursement des particuliers et des entreprises bénéficiaires. À terme, il faudra aller plus loin, et mettre en place une mutualisation de la garantie des dépôts pour tous les États membres participant à l'union bancaire. Cela permettra d'obtenir un même niveau de protection pour tous les déposants au sein de l'union bancaire.
L'union bancaire, qui est un défi considérable a, pour l'heure, fait l'objet de progrès extraordinairement rapides. Il reste à conclure, d'ici au printemps, les négociations sur l'accord intergouvernemental et, avec le Parlement européen, sur le règlement où ce dernier a un pouvoir de codécision, afin que le mécanisme soit opérationnel dès 2015.

M. Lannoo, l'union bancaire coupera-t-elle tout lien entre risque bancaire et risque souverain ? Vu de Bruxelles, quels en sont les enjeux ? Comment voyez-vous la stratégie des différents acteurs, dont la France et l'Allemagne ?
C'est un plaisir de m'exprimer devant vous. J'étudie ces questions depuis vingt ans. L'union bancaire est une étape critique pour l'intégration européenne, aussi critique, pour certains, que l'était l'union économique et monétaire. Ce n'est pas faux. L'ampleur de la crise qui a frappé le secteur bancaire imposait de créer urgemment un système plus intégré. La décision n'a été prise qu'en octobre 2013. Donnons à la BCE le temps de réaliser ce travail titanesque. Humainement d'abord : elle a déjà prévu d'embaucher près de 800 personnes. Méthodologiquement ensuite : l'harmonisation des données bancaires, dont les définitions sont encore nationales, sera un chantier majeur. La création de la BCE elle-même a pris cinq années. Si cela ne tenait qu'à moi, je lui donnerais davantage qu'un an pour mettre en place l'union bancaire.
En effet, beaucoup reste à faire. Le marché intérieur fonctionne depuis vingt ans, mais certaines questions n'ont toujours pas été tranchées. L'harmonisation des règles prudentielles n'est pas totale - certaines règles issues de la directive CRD4 unifiant les définitions du capital des banques ne sont connues que depuis août dernier. De même pour les règles de reporting par les banques, ou celles relatives aux prêts non performants ou douteux, dont la définition repose sur la durée d'impayé - trois, six ou neuf mois selon les pays. La BCE ne pourrait harmoniser ces règles unilatéralement, car l'impact sur le cycle du crédit serait trop brutal et pénaliserait les entreprises.
Autre source de difficultés pour la BCE : de nombreuses compétences sont restées dans les mains des États membres, les ratios de capital par exemple. La BCE a affirmé il y a deux semaines que les autorités de régulation nationales participant au MSU devaient la solliciter sur toute mesure prise dans ce domaine : nous verrons comment cela s'applique. Les normes comptables sont également de la compétence des États membres, comme la fiscalité ou la réglementation des prix de transfert. La BCE devra relever le défi d'imposer son système de supervision. Cela durera sans doute un certain temps.
À long terme, l'ambition est de créer une culture européenne de supervision bancaire. Pour ce faire, la BCE constituera des équipes multinationales, afin d'écarter tout risque de biais dans ses contrôles. A raison de quarante ou cinquante personnes par équipe, la supervision de 130 banques sollicitera des effectifs énormes. Là encore, cela demandera du temps.
Avons-nous découplé le risque bancaire et le risque souverain ? Nous avons d'abord renforcé la réglementation sur les fonds propres des banques. Si ces fonds propres ne suffisent pas, le mécanisme de résolution prévoit ensuite une procédure de renflouement - ou bail-in - obligatoire jusqu'à 8 % du passif des banques, ce qui est énorme et n'existe pour l'heure qu'en Suisse. En outre, chaque État membre doit constituer un fonds de résolution national, doté à hauteur de 0,8 % de ses dépôts bancaires. Enfin, le mécanisme de garantie des dépôts disposera également d'un montant égal à 0,8 % des dépôts. Les États membres disposaient déjà d'un mécanisme de garantie, mais il n'était financé, pour certains, qu'a posteriori.
À Bruxelles, les critiques portent essentiellement sur la complexité de la procédure de décision, sur l'insuffisance du fonds et sur le fait qu'il ne sera opérationnel qu'en 2026. Je ne suis toutefois pas inquiet. Le MES fait office de prêteur en dernier ressort. En attendant le MRU, la contagion du risque bancaire au risque souverain n'est pas exclue, mais dans dix ou douze ans, le système sera beaucoup plus intégré et le risque amoindri.

En somme, et pour paraphraser Lord Keynes, à long terme nous serons tous guéris... M. Visnovsky, à quoi servira, à terme, l'ACPR ? Ne faudrait-il pas réduire ses moyens ? La procédure nationale de résolution créée par la loi de séparation bancaire de juillet 2013 est-elle déjà désuète ?
La compétence de supervision est partagée entre la BCE, qui contrôle directement les grands établissements, et les autorités nationales pour les autres. C'est en effet un grand chantier, mais les travaux préparatoires durent depuis de nombreux mois. Nous pouvons envisager la mise en place de ces mécanismes avec optimisme.
Six chantiers ont été lancés. La gouvernance du dispositif d'abord. Depuis la nomination de sa présidente, Danièle Nouy, le conseil de supervision, qui se réunit tous les quinze jours, a tenu deux réunions et prépare la troisième, prévue ce jeudi. Il est en train d'adopter, comme toute nouvelle structure, son règlement intérieur et le code de conduite de ses membres. Bref, l'organisation fonctionne.
Deuxième chantier : le cadre juridique dans lequel la BCE conduira ses missions. Publié le 7 février, il est en consultation jusqu'au 7 mars. Il définit les pouvoirs de l'institution et ses relations avec les autres acteurs.
Ses compétences étant pour partie partagées, des équipes de surveillance conjointes devront être mises en place. Les moyens de chaque autorité nationale pour le contrôle de ceux des 128 groupes dont elle a la responsabilité ont été évalués. Incidemment, ceux de l'ACPR sont nettement inférieurs à ceux de ses homologues allemand, italien ou espagnol, parfois du simple au double. Ces équipes commenceront à travailler dès le mois d'avril, en fonction d'une méthodologie commune à tous les établissements.
Quatrième chantier, la mise en place des services au sein de la BCE, qui comprendront quatre directions générales : deux chargées de la supervision des 128 établissements directement contrôlés, une chargée de la surveillance indirecte, et une des contrôles horizontaux et transversaux. Près de 770 personnes seront recrutées.
J'ignore quel sera leur statut.
Sans doute davantage que celui des personnels de l'ACPR !
Cinquième chantier : l'élaboration des outils nécessaires à ces nouvelles missions, au-delà des exigences méthodologiques. La BCE appliquera les standards de reporting définis par l'autorité bancaire européenne. Les prêts non performants, par exemple, font l'objet d'une définition unique qui s'imposera dans l'ensemble de l'Union européenne, non à la seule BCE. Quant au financement de celle-ci, un projet de règlement sera finalisé d'ici l'été, qui précisera le mode de financement des dépenses occasionnées par l'activité de supervision.
Enfin, d'ici le 4 novembre, seront conduits : l'évaluation prudentielle de l'ensemble des risques des 128 établissements, au printemps ; la revue de la qualité des actifs, afin de « sortir d'éventuels cadavres des placards », mais surtout d'assurer la transparence de l'information disponible au marché pour redonner confiance dans le système bancaire européen ; enfin, les tests de résistance, conduits par l'autorité bancaire européenne. Nous tenons demain une réunion à ce propos, afin d'en définir les modalités. Ces opérations seront menées avec une extrême rigueur et dans le respect des échéances fixées.
Le Gouvernement, en élaborant le projet de loi de séparation bancaire, n'ignorait rien des chantiers en préparation au niveau européen. Si l'ACPR appliquera bien sûr le droit en vigueur, des adaptations seront nécessaires. Le collège de résolution a tenu une première séance ; une seconde, opérationnelle, est prévue début mars. Une direction de la résolution a été créée au sein du secrétariat général. Les plans de rétablissement exigés des grands groupes bancaires français illustrent cette activité de résolution, préventive et curative.

M. de Lauzun, par quoi se traduiront ces évolutions pour les banques ? Devront-elles accorder plus de temps au contrôle et aux contrôleurs, et donc moins au financement de l'économie ?
La Fédération bancaire française a été d'emblée très favorable à l'union bancaire. La supervision commune est un changement majeur pour les établissements, dont les interlocuteurs seront ceux de la BCE, et non plus de l'ACPR. Au lieu d'être contrôlées par des équipes françaises dans un cadre français, les banques le seront par des équipes de dix-huit pays, et un conseil composé de représentants de ces dix-huit pays.

Voulez-vous dire que les contrôles étaient plus complaisants dans un cadre franco-français ?
Les décisions prises par des équipes moins intégrées au sein d'une structure culturellement homogène seront nécessairement plus formalisées. Notre régulateur n'était à l'évidence pas laxiste, les résultats le prouvent. Le changement principal réside dans la vision paneuropéenne du secteur qui sera ainsi fournie, nécessaire dès lors que nos groupes sont eux aussi paneuropéens.
La revue de qualité des actifs n'est pas une grosse opération, c'est une opération colossale. La définition de méthodes communes, préalable à ce travail gigantesque, sera capitale. Les marchés européens ont chacun leurs caractéristiques. En matière de crédits immobilier par exemple, le taux de sinistralité est négligeable en France car la distribution du crédit est relativement sévère, mais ce n'est pas le cas partout. La méthode harmonisée devra tenir compte de ces réalités variables, sans faire de favoritisme. En toute hypothèse, adopter des planchers ou des plafonds communs risque de fausser l'analyse des situations. Nous ne pouvons, sur ce point, qu'exprimer notre confiance a priori. Cette démarche pourrait avoir le mérite de faire ressortir les problèmes de certains pays, les banques françaises sont confiantes en la matière. Or les mécanismes de résolution ne seront pas nécessairement en place : il est vital que le système européen soit en état d'aider les banques concernées.
En matière de résolution, distinguons deux choses : la directive « renflouement interne des banques » sur le redressement et la résolution n'a rien à voir avec l'union bancaire, elle s'applique aux vingt-huit États membres de l'Union européenne. Elle prévoit une procédure de renflouement interne, ou bail-in, permettant de faire porter les pertes non sur les contribuables, mais sur la banque elle-même, ses actionnaires ou ses partenaires créanciers. C'est une réforme extrêmement positive. Il n'est pas normal que les contribuables interviennent dans le sauvetage d'établissements privés responsables de leur faillite. Nous sommes plus réservés sur le seuil de 8 %. Nous pensons qu'il fallait aller au bout de la logique de renflouement interne en faisant porter sa responsabilité sur les créanciers de la banque en faillite, qui devaient apprécier le risque au moment d'entrer en relation avec elle, plutôt que sur d'autres banques.
Faire intervenir le fonds de résolution précocement imposait de lui conférer une certaine crédibilité. Rapportés aux chiffres évoqués pendant la crise, celui de 55 milliards d'euros peut sembler une somme modeste, mais elle est énorme. Le fonds sera abondé par toutes les banques de la zone. Les nôtres sont sans doute les moins risquées, et ce seront sans doute celles qui paieront le plus.
Je rappelle que nous payons déjà 900 millions d'euros au titre de la taxe systémique, cette taxe fondée sur l'idée que les banques devaient contribuer à leur propre sauvetage par la puissance publique. Si l'on ajoute les contributions au fonds de résolution et au fonds de garantie des dépôts, nous arrivons à une participation située entre 2,7 et 2,8 milliards d'euros par an.
La somme de 17 ou 18 milliards d'euros, qui serait atteinte après dix ans, représente 170 à 180 milliards d'euros de crédits en moins, soit quatre fois le volume que la banque publique d'investissement (BPI) apportera.

Voilà qui mérite d'être dit ! Une BPI de créée, quatre de supprimées... Cela fait trois BPI en moins !
Chacun veut faire payer les banques sans toujours en mesurer les conséquences. Nous aurions préféré un fonds plus modeste, et l'utilisation systématique du renflouement interne, qui épargne le contribuable.
Les modalités de calcul de la répartition à dix-huit pénalisent les banques françaises par rapport aux règles nationales, pour un montant d'environ 3 milliards d'euros, soit 30 milliards d'euros de crédits. Il faut mieux tenir compte des risques et se fonder sur les encours pondérés, comme le recommande, à juste titre, la proposition de résolution de Richard Yung.
Pardonnez-moi d'aligner ainsi les chiffres, mais le secteur bancaire français s'étant révélé le plus stable d'Europe, il serait anormal qu'il soit le principal contributeur au fonds de résolution, en lieu et place de son homologue allemand.

Mme Scialom, ce dispositif est-il malthusien ? Restreint-il la distribution du crédit ? L'uniformisation européenne des critères de prêt fera-t-elle des gagnants et des perdants ? En France, le crédit immobilier se fait en fonction de la solvabilité de l'emprunteur. Dans les pays anglo-saxons, seule la valeur hypothécaire du bien entre en ligne de compte. Comment unifier ces pratiques ? Tout ceci vise-t-il à rassurer nos concitoyens en édifiant une sorte de ligne Maginot bancaire contre le retour de la crise, ou ces évolutions aboutiront-elles à une réelle consolidation du système ?
L'importance du projet d'union bancaire ne vient pas seulement des raisons couramment évoquées : lutte contre la fragmentation de l'espace financier, rupture du lien entre dette souveraine et fragilité bancaire, prévention et gestion des crises bancaires. Il s'agit, avant tout, de compléter l'euro en réparant les graves déficiences qui l'affectent depuis sa création. Ses fondateurs avaient en effet oublié, semble-t-il, que 80 % de la monnaie était émise par les banques, dont ils ont organisé la supervision en appliquant le principe de subsidiarité. Du coup, en période de crise institutionnelle, un euro émis par une banque allemande risque de ne plus être considéré comme de même valeur qu'un euro émis par une banque portugaise, ou grecque. L'union bancaire est susceptible de pallier ces inconvénients, pourvu que les États ne la tronquent pas et acceptent de faire le saut fédéral qu'elle implique.
Elle se met en place par séquences, malheureusement disjointes alors qu'elles devraient être imbriquées, et comporte trois piliers indissociables. La mise en place du MSU, d'abord, ouvre une phase très délicate pour la BCE, qui joue sa crédibilité sur le succès de la revue de qualité des actifs et celui des tests de résistance : elle a été préférée à l'autorité bancaire européenne en raison de l'échec des tests de résistance conduits par celle-ci, qui n'avaient pas empêché l'effondrement du système bancaire irlandais et, chez nous, de Dexia. Il s'agit d'unifier la surveillance des risques en Europe et de réduire les distorsions en mettant le superviseur à l'abri des pressions nationales. Le MSU est donc un puissant instrument de lutte contre la fragmentation de l'espace financier, à condition toutefois que le MRU soit instauré afin d'organiser, en cas de défaillance d'une banque, l'allocation des pertes, et de structurer son renflouement. La rapidité de son intervention sera déterminante pour limiter le risque de contagion. Cela dit, l'accord de décembre 2013 ne donne une idée précise de ce dispositif qu'à l'horizon 2025 : bail-in, fonds de résolution et, uniquement en dernier ressort, argent public. C'est séduisant, mais les risques n'attendront pas 2025 ! Les gouvernements ont souhaité garder la main sur le processus de résolution, ce qui est une erreur majeure car l'objectif du MRU est la réduction des délais, qui réduira fortement les coûts des résolutions. Tous les grands sauvetages de banques se sont effectués en l'espace de vingt-quatre ou quarante-huit heures, entre vendredi soir et lundi matin...
Et créent surtout un risque de contagion massif ! La prééminence de l'intergouvernemental dans l'accord actuel diminuera la réactivité du MRU, ce qui est fâcheux pour un mécanisme prévu pour faire face à une crise. Il faut maîtriser ses effets redistributifs en l'isolant de toute pression. Le Conseil ne doit donc pas avoir le dernier mot. Le Parlement européen et la Commission ont d'ailleurs protesté contre le dispositif retenu.
Pour l'heure, aucune garantie publique n'a été prévue pour la période qui s'ouvrira avec la fin des tests menés par la BCE, et le bail-in ne sera opérationnel qu'en janvier 2016. Le lien entre les banques et la dette souveraine n'est donc pas rompu... Terra Nova va publier une note proposant qu'une règle de partage des pertes entre tous les États impliqués soit prévue dans les testaments bancaires. Comme l'a écrit Mervyn King, les banques internationales redeviennent nationales quand elles meurent, alors que leur sauvetage bénéficie à tous les pays où elles sont implantées.
L'opacité des groupes bancaires européens est une source importante de conflits juridictionnels, ce qui entrave la résolution des faillites les concernant. Une réforme est indispensable : les groupes bancaires doivent pouvoir être démantelés de manière ordonnée. À cet égard, tout est dit dans le rapport Liikanen remis le 30 janvier 2013 à Michel Barnier. Les filiales implantées à l'étranger doivent pouvoir être séparées en quarante-huit heures au maximum pour réduire les risques de contagion au sein d'un groupe. Une telle règle existe en Nouvelle-Zélande, par exemple. Les filiales doivent donc être en mesure d'assurer, indépendamment de la maison-mère, le fonctionnement des systèmes d'information, l'accès aux moyens de paiement et aux dépôts. Un système d'assurance des dépôts fédéral est également nécessaire.

Plus il y a de fonds propres cantonnés, moins la banque peut accorder de crédits.
C'est très discuté. De nombreuses études montrent le contraire. Ainsi, selon Martin Hellwig, une meilleure capitalisation des banques accroît le volume de crédit. Une part du rationnement du crédit vient du fait qu'une banque est universelle : les travaux de Boot et Ratnovski, ceux de Posner, montrent que le fait de coupler activités de marché et activités de crédit aboutit à une allocation sous-optimale pour la société. Les activités de marché évincent les activités de crédits, notamment dès lors que prévaut une règle de pondération des actifs par les risques. Une véritable filialisation pourrait comporter des règles de capitalisation séparées qui ne pénaliseraient pas le financement des PME.

Je donne la parole à Richard Yung, qui a été rapporteur de la loi de régulation bancaire et financière, et est à l'origine de plusieurs résolutions européennes sur ce sujet.

Saluons d'abord le progrès formidable accompli. C'est la réponse à la crise de 2008. Le Parlement européen a raison de dire que la dimension intergouvernementale est malvenue dans le dispositif. Mais il faut être réaliste : l'accord a été signé, nous ne pouvons guère que l'aménager. Il répond à une demande de l'Allemagne, qui souhaitait que le Bundestag soit saisi. Du coup, le Sénat le sera aussi !

Laurence Scialom a critiqué le rôle du Conseil dans le dispositif. Remarquons toutefois que les États sont, jusqu'en 2026, garants du système. Il est donc normal que les ministres des finances aient leur mot à dire. Éventuellement, leur poids pourrait être diminué à mesure que le fonds se constituera...
Un délai de dix ans semble, pour beaucoup, une manière de botter en touche. Pourquoi ne pas accélérer la mutualisation, sans toucher au rythme de contribution ? Est-ce possible ? Il est paradoxal que la France doive payer davantage que l'Allemagne : 15 ou 16 milliards d'euros contre 11 milliards d'euros. Cela résulte du choix d'une clé de répartition reposant sur le nombre de capitaux de renflouement. Or, plus une banque en a, plus elle peut participer au renflouement ! Un meilleur critère serait celui des risques pondérés. Y a-t-il une chance pour qu'on y revienne ?
Il n'y a pas, pour l'heure, de garantie publique ultime de recapitalisation des banques, car l'Allemagne refuse que le MES soit utilisé. Que faire ? Faut-il donner une capacité d'emprunt, garantie par les États, au MRU ?

Michel Barnier déclare fréquemment que la Commission a des problèmes avec certains États, dont la France. En particulier, la France s'oppose à son projet de renforcement des séparations entre banques d'affaires et banques de dépôt. Pourtant, il s'agissait d'un des engagements forts du Président de la République. Que pensez-vous de ce projet ? A-t-il une chance d'aboutir ? La loi rapportée par Richard Yung a renforcé le conseil de résolution, au détriment - quoi qu'on en dise - de la Banque de France, qui se trouve ainsi remplacée par quatre ou cinq hauts fonctionnaires, auxquels reviennent de très importants pouvoirs : recapitalisation, restructuration, et surtout utilisation du fonds de garantie des dépôts. Un système européen de ce type est-il à l'étude ? Le fonds de garantie doit monter en puissance. Quelle est la destination finale des sommes qu'il rassemble ?

Je vous pose à présent les questions préparées par François Marc, rapporteur général
La recapitalisation directe des banques en difficulté par le MES a été au coeur de l'actualité lors de la crise espagnole. Une modification du traité est-elle nécessaire ? Quelles sont les positions respectives de la France et de l'Allemagne à cet égard ? Le fonds de résolution, au sein du fonds de garantie des dépôts, a été alimenté, selon la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013, à hauteur de 500 millions d'euros en 2013. L'Allemagne, elle, dispose d'un fonds spécifique de résolution créé en 2011 et dont le montant atteint 1,8 milliard d'euros. Comment s'articuleront le fonds français et le fonds européen ? La France va-t-elle mutualiser une partie du fonds de garantie des dépôts et de résolution ? La mission du fonds français est-elle déjà dépassée ? Par ailleurs, les montants de contribution des banques au fonds de résolution évoqués par Pierre de Lauzun correspondront-ils à une perte fiscale pour l'État, qui contribuerait ainsi, en quelque sorte, à ces versements ? Faut-il faire contribuer davantage les banques présentant les risques les plus importants ?
J'ajoute, pour ma part, une question sur les procédures en cours : comment les dossiers de Dexia et du Crédit immobilier de France vont-ils être traités ? Seront-ils soumis à la procédure de résolution unique ? Quid des dossiers analogues dans d'autres pays ?
Le Parlement européen s'interroge aussi sur l'opportunité d'accélérer la montée en puissance de la mutualisation au sein du fonds unique de résolution. La France n'y est pas opposée, d'autant que cela n'irait pas forcément de pair avec une augmentation du rythme des contributions.
Deux paramètres existent pour déterminer la contribution des banques : leur taille, et le risque qu'elles présentent. La France estime que le second, exprimé par la pondération par les risques au sens des Risk Weighted Assets (RWA) des banques, est le plus important.
Les chiffres avancés par la Fédération bancaire française cumulent garantie des dépôts et fonds de résolution, et il est trop tôt pour prévoir le résultat des discussions sur le règlement, mais nous veillerons à ce que les contributions soient proportionnées à la taille de notre secteur bancaire et aux risques qui pèsent sur lui.
Le ministre avait annoncé, lors des débats sur la loi bancaire, que la France se doterait d'un fonds de résolution doté de 10 milliards d'euros d'ici 2020. Le sujet des contributions bancaires était donc déjà sur le table et accepté. La question est aujourd'hui de savoir s'il faut aller plus loin dans le montant et si l'équilibre entre les différents États européens est respecté.
J'insiste sur le fait que, contrairement à ce qui a été dit, un mécanisme est prévu avant 2025. La France plaide depuis longtemps pour que le MES puisse procéder à des recapitalisations directes. Un projet en ce sens sera finalisé début mars, qui devra être ratifié par les États. En Allemagne, un vote du Parlement sera nécessaire. Il s'agit d'un élément essentiel de séparation entre risque souverain et risque bancaire.
La France a choisi de fusionner garantie des dépôts et fonds de résolution. Ce n'est pas le choix européen, car les Allemands se sont opposés à la mutualisation de la garantie des dépôts. Il nous faudra donc dissocier les deux. Le fonds de garantie des dépôts restera donc national, tandis que le fonds de résolution sera le compartiment français du fonds de résolution unique, avec lequel il sera progressivement fusionné. Il y aura donc bien deux fonds.
La France estime qu'une modification du traité n'est pas nécessaire : l'article 19 du traité sur le MES permet déjà la création de nouveaux instruments.
Il y a en effet une discussion sur ce point, mais nos arguments sont solides. S'agissant des banques actuellement en restructuration que vous avez évoquées, les procédures de résolution ont été lancées avant que les règles nouvelles, notamment de bail-in, n'entrent en vigueur ; elles continueront donc de se poursuivre selon les règles en vigueur au moment de leur mise en place.
Dans sa communication de juillet, la Direction générale de la concurrence a indiqué que toutes les règles, notamment le bail-in, seraient appliquées, même si elles ne sont pas complètement entrées en vigueur.
La séparation des banques les fragilise. D'après nos études, les banques universelles et diversifiées, financées par des dépôts, comme BNP Paribas ou Santander, sont celles qui résistent le mieux aux crises. Les banques les plus fragiles sont celles qui, comme Northern Rock ou certaines caisses d'épargnes espagnoles, sont spécialisées sur certains types d'actifs, ou les banques d'investissement uniquement financées sur les marchés. De plus, en séparant les fonds propres, la séparation rend plus difficile l'intervention du superviseur en vue d'un renforcement de ces derniers.
La garantie des dépôts restera nationale, je crois. Le cas des grandes banques transfrontalières, notamment, n'est pas réglé.
Le ratio de levier n'est pas encore disponible. Aujourd'hui, on mesure donc l'actif selon le risque qu'il présente. L'inconvénient de ce système est que, lorsque les grandes banques utilisent leur propre modèle de calcul des risques, elles peuvent réduire le capital nécessaire par rapport à un modèle de calcul standard : les banques européennes ont ainsi un capital qui représente 33 % de ce qu'il devrait selon un modèle standard, contre 58 % pour les banques américaines. Il est donc urgent d'introduire un ratio de levier.
La loi bancaire a fixé un bon équilibre dans la séparation des activités spéculatives de celles de tenue de marché. L'ACPR contrôlera la mise en oeuvre de ses textes d'application. Michel Barnier propose d'aller jusqu'à séparer des banques les activités de tenue de marché. Cela aurait un impact sur le financement de l'économie.
Aussi n'approuvons-nous pas cette proposition. Les cadres nationaux actuels suffisent. La réglementation prudentielle, d'inspiration anglo-saxonne, pousse au financement de marché. Si les banques ne peuvent pas accompagner les entreprises dans la recherche de ces financements, cela posera un problème de cohérence.
Le critère du RWA n'est pas bon : la plupart des banques qui ont fait faillite respectaient parfaitement leurs ratios de capitalisation au sens des RW, à tel point que la FSA britannique a autorisé la Northern Rock à utiliser un modèle avancé ! Toutes, en revanche, avaient un ratio de levier simple excessivement élevé. Il faut donc se fonder sur ce critère, couplé avec un critère de taille, pour calculer les contributions des banques au fonds. De nombreuses études montrent que le critère de RWA est manipulable. Ce critère pose aussi le problème de la valorisation des portefeuilles de dérivés.
J'espère que dans la revue de qualité des actifs, la BCE testera aussi la qualité et la soutenabilité du passif. Les crises de solvabilité sont venues de crises de liquidité.
Réformer la structure des banques est la seule manière de rendre crédible le MRU. Des banques universelles, dont le bilan dépasse parfois le PIB du pays où elles sont implantées, ne peuvent faire l'objet d'une résolution rapide si elles ne sont pas filialisées.
La séparation entraînerait des coûts supplémentaires, certes. Mais il ne faut pas vouloir, à tout crin, baisser le coût du crédit. La crise est venue d'un excès d'endettement. L'enjeu est de s'assurer que les risques sont bien discernés. Or, dans nos cycles financiers, lorsque les bulles se créent, les prix baissent pour tous, et pendant les crises, ils s'élèvent aussi pour tous, sans discrimination. Le risque a un coût. Si celui-ci est trop bas, cela signifie que des subventions implicites font baisser son prix. Qui les paie ? Vous et moi.

Le système financier français, avec ses grandes banques universelles, a bien résisté à la crise, grâce aux leçons tirées des épisodes des années quatre-vingt-dix et à une législation protectrice. Or, il semble que les banques françaises doivent être les principales contributrices au système fédéral que vous nous décrivez avec enthousiasme.
Mes chiffres sont ceux de la Commission européenne. Certes, la négociation n'est pas achevée, mais nous savons déjà que nous serons les plus gros contributeurs, et souhaitons donc que ce surcoût soit minimisé. La taxe systémique de 900 millions d'euros n'a plus de sens, dès lors qu'un fonds de résolution existe. Bien sûr, le surcoût annuel de 1,7 milliard d'euros qui nous est imposé coûtera environ 600 millions d'euros par an de recettes fiscales à l'État. Le contribuable, qui croyait échapper par la porte, est rattrapé par la fenêtre !
Le critère des RWA pondère les risques, quand le critère des ratios leviers, qui était en usage avant 2007, place au même niveau ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas, ce qui incite les banques à mettre leur capital sur des produits risqués, qui sont les plus rentables. Abandonner l'idée de pondérer les actifs serait criminel. Il faut veiller à ce que les méthodes d'évaluation soient homogènes. Aux États-Unis, l'économie est financée aux trois quarts par le marché. Les bilans bancaires y concentrent les produits risqués et illiquides. Il est donc normal que les pondérations y soient plus lourdes. En France, cinquante ans d'expérience justifient que les encours immobiliers soient beaucoup plus faiblement pondérés qu'aux États-Unis.
Les projets de séparation de Michel Barnier livreraient le marché financier européen aux banques américaines, sans véritablement atteindre son objectif, qui réclamerait une action plus radicale. Il importe, au contraire, de développer une activité de marché significative, car les nouveaux ratios donnent aux marchés financiers un rôle accru dans le financement de l'économie.
Les grandes crises, c'est vrai, ne sont pas causées par les marchés financiers, mais par l'endettement. Attention, pour autant, à ne pas diminuer brutalement l'activité des banques. Il faut pondérer correctement les encours pour que la pression du capital s'exerce de manière adaptée : lourdement sur les activités à risque, faiblement sur l'immobilier ou le financement des PME, qui n'ont pas à pâtir de mesures décidées pour d'autres secteurs.

Merci de vos contributions.
La réunion est levée à 17 h 08.
- Présidence de M. Philippe Marini, président -
La réunion est ouverte à 18 heures 05.