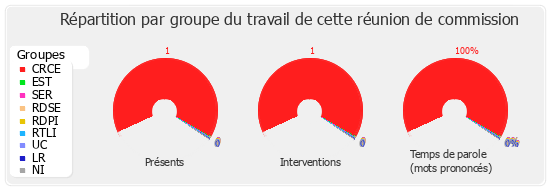Commission des affaires économiques
Réunion du 17 juin 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission examine les amendements au texte de la commission sur la proposition de loi n° 310 (2013-2014), relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
La réunion est ouverte à 15h05.
Les avis de la commission sont retracés dans le tableau suivant :
La réunion est ouverte à 16h10.

Nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur l'Administrateur général, dans le cadre des auditions préalables au débat parlementaire sur le projet de loi relatif à la transition énergétique.
Dans ce contexte, nous aimerions vous entendre plus particulièrement sur la contribution du CEA à la recherche sur l'énergie nucléaire et les énergies alternatives.
Après un point d'actualité sur le CEA, j'aimerais ainsi que vous précisiez la position que vous avez prise s'agissant de l'impossibilité d'atteindre l'objectif de réduction à 50 % en 2025 de la part du nucléaire dans la production d'électricité.
Il serait intéressant ensuite de faire le point sur l'état d'avancement du programme ASTRID. Je souligne à ce sujet que je regrette fortement l'arrêt du programme Superphénix intervenu il y a quelques années.
Enfin, pouvez-vous nous indiquer où en sont les travaux du CEA sur le stockage de l'énergie - solution pour résoudre les problèmes d'intermittence et le caractère aléatoire des énergies renouvelables ?
J'ai découvert à l'occasion d'un travail pour le compte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur les nanotechnologies, que le département Sciences du vivant du CEA était l'un des plus en pointe sur les bio-technologies : il gagnerait à être reconnu au même titre que le CNRS et l'INSERM sur ces questions.
A l'issue de votre intervention, mes collègues pourront vous interroger, et notamment les co-présidents du groupe d'études de l'énergie.
Je rebondis d'emblée sur votre remarque concernant le département Sciences du vivant. Nous travaillons en effet en étroite collaboration avec l'INSERM et le CNRS, chacun apportant sa contribution dans le domaine des nanosciences. Il va de notre responsabilité de travailler en bonne intelligence sur ces sujets essentiels.
Nous constatons aujourd'hui une évolution profonde du contexte énergétique sous l'effet de trois forces majeures.
Tout d'abord il faut préserver notre indépendance énergétique, dont l'importance nous est rappelée par les récents événements en Ukraine. Nous dépendons encore à plus des deux tiers des énergies fossiles pour notre consommation finale d'énergie, ce qui nous place dans une position de fragilité incontestable qu'il faut limiter au maximum.
Ensuite, les coûts d'alimentation en combustibles fossiles ont triplé entre 2005 et 2014, passant de 23 milliards à près de 70 milliards d'euros annuels pour une même quantité d'énergie importée.
Enfin, la consommation d'énergies fossiles produit des gaz à effet de serre qui ont un impact important sur notre planète - tant sur le climat et l'environnement que sur la santé - qu'il est aujourd'hui urgent de réduire.
Il est donc nécessaire d'envisager une transition énergétique visant à diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles, ne serait-ce que pour faire perdurer les ressources existantes.
Nous bénéficions aujourd'hui en France d'un socle d'énergie nucléaire important. La stratégie du CEA consiste à préserver cette technologie, à la fois en améliorant la sûreté des installations et en assurant son fonctionnement dans des conditions économiques optimisées. Pour ce faire, nous avons fixé quatre enjeux :
- la préservation de l'outil industriel, en assurant les meilleures conditions de sûreté et de fonctionnement des 58 réacteurs ;
- une vision consolidée du cycle de vie des installations : nous devons pouvoir démanteler, assainir, et gérer les combustibles usés ;
- le renouvellement des compétences humaines, avec la transmission du savoir accumulé aux nouvelles générations, afin d'éviter une perte de connaissances lors des départs à la retraite ;
- la préparation du futur, via l'optimisation des ressources et la minimisation des déchets, notamment grâce aux réacteurs de quatrième génération.
Cependant, le nucléaire ne saurait se substituer intégralement aux énergies fossiles, d'autant que les progrès technologiques de ces dernières années rendent aujourd'hui possible la transition énergétique grâce à l'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables.
L'électron est au coeur de la stratégie du CEA, qui se décline en trois axes : tout d'abord le développement de l'énergie solaire, sous forme d'électricité ou de chaleur. Cette dernière, en particulier, est une ressource encore sous-exploitée, malgré les nombreuses applications dont elle peut faire l'objet. Le couplage à un stockage local permettrait de réduire les besoins en réseaux, qui sont aujourd'hui un facteur limitant le développement de ces solutions.
Le deuxième axe de notre politique concerne l'utilisation d'énergie électrique renouvelable - solaire, éolienne, maritime - sous forme de stockage chimique. L'hydrogène est une piste prometteuse, car il peut être aisément mélangé au gaz naturel jusqu'à 25 %, et donc distribué via les réseaux existants, ou bien utilisé directement dans des moteurs thermiques. Nous travaillons également sur le développement de piles à combustible qui, grâce à la reconversion d'hydrogène en électricité, permettront d'accroître les distances pouvant être parcourues avec des véhicules électriques. On peut imaginer un système hybride dans lequel les déplacements urbains et péri-urbains seraient réalisés grâce aux batteries électriques, et les longues distances grâce à un kit avec réservoir d'hydrogène. Nous serions alors plus dans une logique de service, avec location des piles à combustible en fonction des besoins, que dans l'équipement systématique des véhicules. Enfin, l'hydrogène pourra servir à la production des bio-carburants de deuxième génération, car l'apport d'hydrogène permet d'améliorer le rendement de la conversion des matières organiques en hydrocarbures utilisables comme carburants.
Le troisième axe développé par le CEA est le stockage sous forme de batteries. Nous cherchons à améliorer les performances de celles-ci, notamment sur le point de la sécurité. En effet, l'extrême proximité des réactifs chimiques composant les batteries les rend dangereuses, car le moindre choc déclencherait une énergie équivalente à l'explosion de 60 litres de pétrole : nous travaillons donc à améliorer leur fiabilité. L'optimisation des performances en fonction des conditions environnementales de fonctionnement - température, notamment - nécessite également des systèmes de plus en plus complexes sur lesquels nous réfléchissons.
Le CEA possède des compétences variées, aussi bien dans le domaine de l'énergie que dans le domaine des technologies de l'information, des matériaux et de la modélisation. Il s'agit d'une vraie richesse, et nous souhaitons mobiliser l'ensemble de ces savoirs au profit de la recherche.
Je souhaite également souligner que nos modes de vie et notre géographie sont adaptés au développement du véhicule électrique. En France, 85 % des véhicules roulent moins de 150 kilomètres par jour. C'est une distance sur laquelle le véhicule électrique prendrait tout son intérêt. Le parc automobile existant présente une élasticité qu'il faut exploiter : le fonctionnement de ces véhicules ne représenterait que 15 % de notre production d'électricité... Lorsqu'ils ne roulent pas - ce qui peut représenter jusqu'à 20 heures par jour -, ces véhicules peuvent stocker de l'énergie. Nous pourrions stocker 9 gigawatts, soit un septième seulement de notre capacité de production nucléaire.
Par ailleurs, la mobilité va complexifier les réseaux existants : aujourd'hui, nous pouvons programmer les besoins en électricité, car nous fournissons des points fixes (bâtiments, bornes) et nous connaissons les pratiques de chacun. Si l'on s'oriente vers le stockage mobile, il sera nécessaire de développer l'intelligence des systèmes.
Concernant mes déclarations dans la presse au sujet de notre capacité à réduire de 50 % la part de nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025, je précise que j'ai exprimé un avis d'expert : tout est toujours possible, mais à quel prix ? Actuellement, les prix de l'électricité augmentent de quelques pourcents seulement par an et les charges d'investissements restent supportables.
La capacité de production d'énergie nucléaire dédiée à l'électricité est aujourd'hui de 63 GW. Pour atteindre l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire, il faudrait remplacer 20 GW par une autre source d'énergie d'ici 2025. Or les rendements du photovoltaïque (14 %) comme de l'éolien (22 %) sont faibles : il faudrait donc installer en moins de dix ans environ 100 GW de nouvelles capacités pour espérer combler avec des énergies renouvelables la diminution de la production d'origine nucléaire. C'est un objectif extrêmement difficile à atteindre, d'autant plus qu'il s'agit de calculs théoriques sur les quantités : il faut ensuite assurer la disponibilité de l'énergie produite, ce qui nécessite sans doute de 5 à 15 GW de moyens de production supplémentaires, sans doute au gaz, pour pallier le problème de l'intermittence.
C'est un raisonnement de physicien, mais il vous démontre que si nous voulons tenir l'objectif annoncé, nous devrons fournir un effort considérable.
Concernant le projet ASTRID, démonstrateur technologique de réacteur de quatrième génération, je souhaite tout d'abord rappeler que le combustible usé est réutilisable à 95 %, et même 96 % si on inclut le plutonium. Nous avons accumulé de grandes quantités de ce combustible usé, qui est réutilisable. Son stockage définitif serait complexe et demanderait beaucoup plus de place que le stockage des produits de fission non réutilisables, qui font l'objet d'un procédé de vitrification. De plus cela ne serait pas une utilisation optimale d'une ressource qui n'est pas renouvelable !
Les réacteurs à neutrons rapides comme ASTRID doivent donc apporter la preuve qu'il est possible de consommer ce plutonium et, dans une moindre mesure, l'uranium de retraitement. Ils seront utilisés dans un premier temps en parallèle aux réacteurs à eau que nous possédons aujourd'hui ; une fois démontrés leur intérêt et leur capacité à fonctionner, le pays pourra décider, souverainement, du moment où l'on fera croître le parc. L'objectif premier est donc de faire la démonstration du multi-recyclage sécurisé des combustibles usés.

L'hydrogène est une bombe en puissance et ses molécules fuient facilement. Pourquoi ne pas l'utiliser plutôt sous forme d'hydrure ? S'agissant d'Astrid, quelle est la part d'uranium et de plutonium dans les déchets ?
L'énergie contenue dans l'hydrogène est la même que celle qui est dans le pétrole. Il existe aujourd'hui de réservoirs qui résistent aux chocs, avec des détecteurs d'hydrogène qui permettent de prendre les mesures appropriées contre les fuites. Le stockage sous forme d'hydrure est possible, mais avec un surcroît de poids.
Dans la situation actuelle, le combustible usagé comprend 95 % d'uranium non utilisé et 5 % de produits de fission, dont 1 % de plutonium. Dans les réacteurs à neutrons rapides, tels qu'Astrid, il y aura en entrée près de 20 % de plutonium et 80 % d'uranium 238 ; en sortie, il restera environ 15 % de plutonium, ce qui revient à accélérer le processus de transformation mais dans certaines limites.

Où en est la recherche sur les biocarburants de troisième génération produits avec des micro-algues ? Pourront-ils se substituer au pétrole ?

Le nom du CEA ne devrait-il pas mieux refléter la variété de ses missions afin de favoriser l'adhésion collective à ses actions ? S'agissant du projet ITER, envisage-t-on toujours d'utiliser la technique de la transmutation pour réduire la quantité de déchets ?
Par ailleurs, il faut clarifier pour les décideurs la diversité des domaines d'application de l'hydrogène, filière dans laquelle nous pouvons être leader. Concernant les batteries, comment le CEA participe-t-il à l'industrialisation des technologies émergentes ? C'est l'une des grandes questions qui se posent au pays.
Enfin, quelles sont les énergies renouvelables les plus prometteuses dont l'intermittence ne produise pas un impact trop grand sur les réseaux ?

On est bien en avance en Allemagne sur l'utilisation de l'hydrogène. La voiture électrique présente un problème de poids par rapport aux voitures à pétrole : quelles sont les perspectives ? Par ailleurs, où en sont les projets de stockage de CO2 ? Enfin, comment désamorcer notre peur du gaz naturel ?
Le CEA travaille sur les micro-algues : nous avons trouvé une nouvelle souche deux fois plus productive que les autres. Les algues ont de multiples usages et peuvent absorber du CO2, mais ce n'est pas la solution unique car elles nécessitent un espace considérable.
S'agissant du nom du CEA, je rappelle que la mission Rocard-Juppé, qui avait préparé les investissements d'avenir, avait proposé de créer un Commissariat aux énergies renouvelables ; j'ai suggéré de confier cette mission au CEA afin d'éviter les délais nécessaires à la création d'un nouvel organisme à partir de rien. Selon moi, il vaut mieux parler tout simplement du CEA, sans utiliser le nom complet.
Le projet ITER est fort de promesses. Il réunit sept partenaires internationaux. Les 140 tonnes d'uranium utilisées dans un réacteur actuel pourront être remplacées par quelques grammes d'hydrogène, avec de l'hélium comme déchet ; la ressource est illimitée, sans risque d'emballement. Le défi technologique est considérable, puisqu'il faudra faire voisiner un plasma à 150 millions de degrés avec une paroi au zéro absolu. Les perspectives justifient l'effort, mais la démonstration de production nette d'énergie par fusion ne devrait pas survenir avant 2025 ou 2030.
La transmutation permet de casser les atomes sans libérer l'énergie contenue. On peut consommer le plutonium, donc la transmutation concernerait l'americium, qui ne représente que 0,1 % du combustible usé mais avec une durée de vie de l'ordre d'un million d'années. Toutefois il faut avoir d'abord mis en place le recyclage multiple du plutonium. Donc on pourra envisager de passer à la transmutation après avoir mis en place Astrid.
L'hydrogène devrait d'abord être utilisé là où le risque est minimal : production de biocarburants, mélange avec du gaz... Il existe déjà des réseaux de distribution d'hydrogène industriel dans le nord et l'est de la France, sans problème particulier.
Les performances des batteries nickel-zinc ne sont pas suffisantes pour les véhicules électriques, mais elles conviennent à des flottes captives, par exemple dans des hangars. C'est un vrai problème dans notre pays : comment financer non pas la startup, mais le passage de celle-ci à l'étape industrielle. Le CEA dépose des brevets et crée des entreprises, mais on rencontre des difficultés pour trouver en France des investisseurs afin de développer l'activité jusqu'au stade de l'entreprise de taille intermédiaire (ETI) : ce sont des grands fonds américains qui viennent.
Personne ne peut dire quelles sont les énergies renouvelables les plus prometteuses : il faut donc garder des systèmes ouverts en réalisant des démonstrateurs technologiques à la bonne échelle. En mettant l'accent sur la recherche fondamentale, on travaille aussi pour les autres si on ne sait pas passer soi-même au stade de l'industrialisation ! Il faut diriger une part de l'épargne française, qui est abondante, vers le développement industriel.
Il ne faut pas confondre les véhicules électrifiés, dans lesquels un moteur électrique a été inséré dans un chassis classique, avec les véhicules électriques qui sont conçus spécifiquement pour cela : un modèle couramment utilisé, par exemple, utilise une carrosserie en aluminium plus légère et économise même 40 kilogrammes sur le poids de la peinture. Car le poids est l'ennemi numéro un : alors qu'un véhicule thermique parcourt 500 kilomètres avec 60 kilogrammes de pétrole, un véhicule électrique ne fait que 200 à 250 kilomètres avec une batterie de 250 kilogrammes. L'optimisation permet de réduire ce poids.
Au stockage du CO2, je préfère son recyclage : il peut être utilisé pour produire du carburant ou des matières premières.
En conclusion, il faut redonner confiance à notre pays : la science peut apporter des solutions. Les risques existent, mais les dispositifs de contrôle, d'anticipation et de formation nous permettent de les minimiser, plutôt que de les craindre.

La formation et l'information du public sont essentiels. La mauvaise information a malheureusement pour effet une désaffection des jeunes à l'égard des filières scientifiques et technologiques.