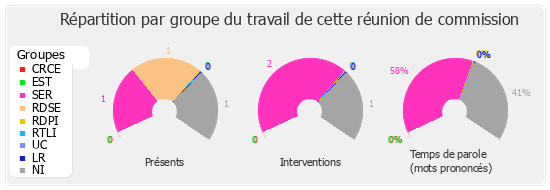Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 29 janvier 2015 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La délégation procède tout d'abord à la désignation de rapporteur-e-s sur l'étude qui sera consacrée à l'accueil des jeunes enfants dans une perspective d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mes chers collègues, avant d'auditionner M. Luc Frémiot, nous devons procéder à la désignation du rapporteur qui aura la charge de travailler sur les solutions d'accueil des jeunes enfants. Comme vous le savez, la délégation organise prochainement une table ronde qui nous permettra d'entendre les principaux acteurs de ce sujet crucial pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Chantal Jouanno a reçu la candidature de notre collègue Cyril Pellevat qui a rejoint notre délégation après les dernières élections sénatoriales. Approuvez-vous cette candidature ?
Cyril Pellevat est donc officiellement notre rapporteur.
Puis la délégation auditionne M. Luc Frémiot, avocat général à la Cour d'appel de Douai, dans le prolongement de la visite effectuée le 25 novembre 2014 au Home des Rosati.

Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Luc Frémiot, avocat général à la Cour d'appel de Douai.
Cette audition s'inscrit dans la suite du déplacement que certains membres de notre délégation ont effectué à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2014 au « Home des Rosati » à Arras. Je rappelle que l'objectif de cette visite était d'aborder le sujet des violences conjugales sous l'angle non pas seulement de la prise en charge des victimes mais aussi de la prise en charge des auteurs de ces violences.
Hasard du calendrier, notre réunion ce matin a lieu trois jours après la diffusion du téléfilm « L'emprise », adaptation de l'histoire d'Alexandra Lange, mère de quatre enfants, qui s'est retrouvée en mars 2012 dans le box des accusés, aux Assises de Douai, pour le meurtre de son mari.
Or c'est précisément Luc Frémiot qui a requis l'acquittement dans cette affaire difficile, dont il a fait en quelque sorte le symbole des violences conjugales.
Monsieur Frémiot, je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui.
Quand vous étiez procureur de Douai, entre 2003 et 2010, vous avez mis en place des mesures innovantes pour lutter contre les violences conjugales, plus particulièrement par l'éviction des auteurs de ces violences.
Votre travail a trouvé un écho dans le fait que les violences contre les femmes ont été déclarées « grande cause nationale » en 2010 et dans le plan triennal contre les violences faites aux femmes mis en place par Najat Vallaud Belkacem, alors ministre des droits des femmes.
Votre livre intitulé « Je vous laisse juges... Confidences d'un magistrat qui voulait être libre », publié en 2014, retrace vos combats que vous qualifiez vous-même de « solitaires ».
Votre point de vue sur le sujet crucial des violences conjugales est pour nous très important et nous allons vous écouter avec grand intérêt.
Vous avez la parole, puis nous aurons ensemble un temps d'échanges.
Madame la Présidente, je vous remercie très sincèrement de votre accueil. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui.
Le problème de la prise en charge des auteurs de violence est de plus en plus crucial. Les statistiques révèlent aujourd'hui que le lieu où une femme se trouve le plus en danger, c'est à son domicile. C'est une réalité effrayante, qui mérite que l'on s'en saisisse de la manière qui convient. Ce qui me frappe depuis maintenant plusieurs années, c'est de voir que les choses donnent l'impression de changer : nous disposons effectivement de tout un arsenal juridique, grâce aux différentes propositions de loi qui se sont succédé et qui nous donnent, sur le terrain, de nouveaux outils. Il est, à cet égard, remarquable que ces avancées soient toutes issues d'initiatives parlementaires... Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses ne changent pas, notamment le fait qu'un même traitement soit toujours réservé aux problèmes conjugaux, alors qu'il faut réfléchir en amont, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs de violence. On ne peut pas se contenter, comme on l'a fait depuis des années, « d'abonder la chaîne alimentaire des tribunaux correctionnels », en renvoyant les auteurs devant les juridictions, qui les condamneront à des peines allant du sursis à l'emprisonnement, en attendant et en priant le ciel pour que les choses s'arrêtent.
Il faut travailler sur le fond, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs. Que faire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence est un phénomène dynamique. Plus on attend pour la traiter, plus celle-ci va prendre des proportions telles qu'à un moment donné, plus personne ne pourra la maîtriser. Cela se soldera toujours par les mêmes conséquences, c'est-à-dire des années de prison, avec des auteurs qui, dans la grande majorité des cas, récidivent, avec le risque d'homicides que cela implique.
Il faut donc, dès le départ, dès que l'on a connaissance d'un phénomène de violence, intervenir. La politique que j'ai conduite dans ce domaine m'a exposé à beaucoup de critiques de la part de mes collègues pour qui « une gifle, une bousculade ou des cheveux tirés, ce n'est pas bien grave ». Pour beaucoup d'entre eux, il faut attendre que la situation se solde par une incapacité totale de travail pour commencer à s'en préoccuper. Selon moi, c'est une conception aberrante et inacceptable. Intervenir dès les premiers coups est certes très difficile, parce que cela suppose de libérer la parole des victimes et donc de fournir un travail important de communication et de pédagogie. Dans ce contexte, un film comme « L'emprise » joue un rôle déterminant, raison pour laquelle je m'y suis fortement impliqué.
Si on intervient dès le départ, on va pouvoir casser cette chaîne de violences. Il faut amener les femmes à s'exprimer. C'est très compliqué, en particulier parce que le concours des services de police et de gendarmerie est un passage obligé, et la parole des femmes n'est pas toujours bien perçue lorsqu'elles font état des violences qu'elles subissent. Je suis partisan de la suppression des « mains courantes ». Cette procédure laisse accréditer l'idée chez les victimes qu'elles ont déposé plainte en vain. Ce sont des appels au secours qui restent sans écho.
Une fois que les victimes ont parlé, que ce soit dans un commissariat ou dans une association servant de relais, il faut traiter le problème sans délai. L'essentiel est le maintien de la victime à son domicile. À l'heure actuelle, beaucoup d'argent est investi dans des centres d'accueil pour victimes, pour des femmes qui quittent le domicile dans des conditions épouvantables, parfois la nuit, avec des enfants. Le film sur l'affaire Alexandra Lange l'a montré : ces femmes se retrouvent véritablement « à la rue » ou dans des foyers, confrontées à d'immenses difficultés.
J'ai rencontré il y a quinze jours une personne qui a vécu cette expérience. Elle m'expliquait que les femmes y sont parfois l'objet de racket et autres violences. Les sortir d'une situation de violence pour les replonger dans une telle situation est à mon avis destructeur. Ce n'est certes pas le cas de tous les foyers mais, d'après mes informations, ce phénomène est plus fréquent qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est aux auteurs de violence de sortir du foyer conjugal, où doivent rester la femme et les enfants.
Se pose la question de savoir où loger ces auteurs, car trouver des structures d'accueil adaptées reste problématique. La « Maison Rosati » que vous avez pu visiter, initiée par une jeune femme substitut du procureur à Douai, reste une exception. On ne compte que deux ou trois structures de ce genre en France. Tant que les auteurs resteront l'extérieur, sans prise en charge par une structure, c'est-à-dire chez des amis, dans la famille ou à l'hôtel, il n'existera pas de véritable prise en charge de leur violence.
À Douai, j'avais réussi à faire baisser le taux de récidive à 6 %. C'est une proportion favorable, mais la moitié de ces auteurs n'étaient pas passés par le centre où je les plaçais habituellement, c'est-à-dire le foyer Emmaüs de Douai. Ils étaient logés dans leur famille ou chez des amis où ils ne bénéficiaient d'aucune prise en charge psychologique. C'est même l'inverse qui se produit : la famille ou les amis leur tiennent parfois un discours plutôt compatissant. On passe alors à côté du traitement.
En plaçant les auteurs dans des centres adaptés, on va pouvoir engager avec eux une thérapie psychologique. À Douai, j'avais choisi Emmaüs parce que je n'avais pas d'autres solutions de logement. Force est de constater que cela a bien fonctionné, même si j'ai bien conscience que cette formule relevait de l'expédient. Un foyer comme Emmaüs a vocation à recevoir des sans domiciles fixes (SDF) : l'avantage était de faire se côtoyer des auteurs de violence qui, en général, ont une famille, une maison, un emploi, avec des gens qui n'ont plus rien. La confrontation donne de très bons résultats. Au bout de quelques jours, si les auteurs de violence sont interpellés par les SDF sur la raison de leur présence, ils sont très mal à l'aise pour parler de leur passage à l'acte. Ce « choc psychologique » amorce dans le meilleur des cas une prise de conscience. C'est à ce moment-là que doit intervenir la prise en charge psychologique.
Quand on aborde un sujet comme les violences conjugales, les mots ont beaucoup d'importance. Prenons le cas des groupes de paroles qui se multiplient dans la région parisienne, notamment près de Bobigny. C'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut que les auteurs de violence soient véritablement encadrés par des protocoles stricts.
À Douai, j'avais recours à une association présidée par un psychiatre avec qui nous avions établi un protocole. Je souhaitais pouvoir faire réfléchir les auteurs de ces violences sur les modalités de leur passage à l'acte et ses raisons.
Au Québec, de nombreux psychiatres et psychologues se sont penchés sur la question. Un travail a donc été effectué entre l'association dont je parlais à l'instant et des psychologues québécois. Ce travail a conduit à la mise en place non pas de groupes de parole, mais de « groupes de responsabilisation » d'une dizaine de personnes. En général, huit d'entre eux allaient être présentés à un tribunal correctionnel ou se trouvaient sous contrôle judiciaire (ces groupes se réunissaient trois heures par semaine, dans une petite salle mise à disposition par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), avec la participation d'un psychiatre et d'un psychologue). Les deux autres participants venaient de la « patientèle privée » de ce psychiatre et étaient volontaires pour participer à l'expérience. Les modules ont été proposés à raison de plusieurs séances par semaine, permettant à chacun d'y participer en fonction de son emploi du temps. Très rapidement, on s'est rendu compte de l'implication des personnes.
Il est clair que lorsqu'on est face à des multirécidivistes, qui ont déjà connu la prison, on arrive trop tard. Les inclure dans ce type de dispositif est inutile. En revanche, s'il s'agit de primo-délinquants qui acceptent de reconnaître leur part de responsabilité, l'efficacité de cette démarche est prouvée. Or une très large majorité des affaires qui nous sont soumises correspondent à des personnes n'ayant pas de casier judiciaire sur ce point : on peut donc effectuer un travail sur ces personnes.
Progressivement, ces « groupes de responsabilité » ont permis de faire évoluer les auteurs de violence. Après la prise de conscience, ils sont en mesure de réfléchir au processus du passage à l'acte. Bien souvent, les premiers coups sont portés à la suite de faits anodins (mauvaise journée, mauvaise humeur, repas, problème avec les enfants, etc.). Au départ, les cycles de violences alternent avec des phases d'accalmie, désignée sous le nom de « lune de miel ». Petit à petit, l'alternance des phases se raccourcit et les phases de violence sont de plus en plus importantes. Il faut donc pouvoir rompre ce cycle très rapidement. Lorsque ces hommes y réfléchissent, ils sont complètement sidérés eux-mêmes par les raisons de leur passage à l'acte. L'origine des violences résulte bien souvent de l'absence de communication dans le couple, sur le plan psychologique, sexuel ou familial. Tous les milieux sociaux sont concernés, que les auteurs soient issus de milieux très défavorisés, des classes moyennes ou même de milieux très favorisés.
L'auteur et la victime sont liés par un dénominateur commun : le déni. Pour la victime, se reconnaître en tant que femme battue revient à remettre en cause à la fois son identité et le choix de son compagnon. C'est d'autant plus difficile qu'elle est sous emprise. Quant aux auteurs, beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils ne sont pas violents mais que ce sont leurs femmes qui les poussent à commettre certains actes, qu'ils qualifient de « bousculades » ou de « comportements réactionnels ».
Pour travailler de façon efficace, il faut s'assurer du placement de ces auteurs dans des structures appropriées, telle que la « Maison Rosati » ou dans des structures similaires permettant une réelle prise en charge. Les auteurs y sont placés en « présentenciel », avant que le tribunal correctionnel ne statue. La condamnation sera une peine de sursis avec mise à l'épreuve, qui consiste à continuer à suivre ces modules de responsabilité. Le besoin en structures d'accueil est réel, dans la mesure où il ne sera pas toujours possible de se servir de foyers comme Emmaüs, en particulier en hiver. Il faut donc dégager de l'argent pour créer ce type de structures.
Je voudrais évoquer un projet relatif à la création d'un centre d'observation judiciaire, élaboré en 2006 avec le responsable d'une association qui suivait à la fois les auteurs et les victimes de violences conjugales. Ce projet n'a jamais connu d'application concrète. Aujourd'hui, la justice ne traite pas ce sujet à fond, comme il le mériterait. On justifie, par exemple, le placement sous contrôle judiciaire par le fait qu'il faut éviter le recours à la détention provisoire. Et c'est une bonne chose, mais à condition qu'il y ait une prise en charge efficace. Or les contrôleurs judiciaires sont aujourd'hui dépassés par le nombre des dossiers qu'ils ont à suivre. Faute de moyens, le contrôle n'est pas aussi approfondi qu'il le faudrait.
J'ai donc travaillé sur des projets de contrôle judiciaire renforcé, toujours avec l'association dont je parlais tout à l'heure et qui intervient à la fois sur les auteurs et les victimes, ce qui est considéré par beaucoup comme incongru.
Pour ma part, je suis complètement opposé à la dichotomie auteur/victime dans le traitement de ces violences. À mon avis, un seul organisme, une seule association, avec des intervenants multiples, qui permettent de façon pyramidale une appréciation des progrès réalisés, me paraît être la bonne solution. Sur le terrain, la difficulté à obtenir les subventions explique parfois des rivalités entre associations. Ce sont les structures qui revêtent les deux « casquettes » (traitement des victimes et des auteurs) qui offrent la prise en charge la plus intéressante, me semble-t-il.
Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des contrôles judiciaires renforcés et des structures d'accueil spécifiques. Quels en sont les avantages ? Tout d'abord, éviter le recours à la détention provisoire et à une peine d'emprisonnement ferme, et éviter aux auteurs d'être désocialisés. Ensuite, suivre l'évolution des auteurs : les auteurs sont libres, durant la journée, lorsqu'ils ont un emploi ; ils sont pris en charge, le soir, par ces foyers d'hébergement.
Le suivi psychologique, assuré par un psychiatre, un psychologue et un infirmier psychiatrique, fait partie du dispositif. Ce type de structures nécessite également la présence d'un personnel dédié à la sécurité et à la discipline. Au total, le coût d'une journée en foyer, évalué à 63 euros, est beaucoup moins élevé non seulement qu'une journée de détention mais aussi qu'une journée dans un centre d'accueil pour les victimes, où les femmes séjournent avec des enfants. À Liège, la création de ce type de structures pour auteurs de violences fonctionne. La procureure de Liège est venue à Douai prendre connaissance de notre expérience. En Belgique, des structures d'accueil similaires d'une vingtaine de lits ont été mises sur pied et fonctionnent toujours très bien aujourd'hui.
Évidemment, on ne peut pas parler de prise en charge des auteurs sans envisager parallèlement celle des victimes, afin de restaurer leur dignité. N'oublions pas qu'elles vivent sous l'emprise des auteurs. Mais l'assistance matérielle est tout aussi cruciale : il arrive souvent, par exemple, que les auteurs placés en garde à vue conservent les clés de la voiture ou le livret de famille. C'est aux travailleurs sociaux qu'il revient d'aller récupérer ces objets. Les centres juridiques jouent un rôle crucial pour aider les victimes à se constituer partie civile. Les « groupes de parole » sont importants aussi : ils diffèrent bien sûr des « groupes de responsabilisation ». Pour libérer la parole de ces femmes, le dessin peut avoir une influence intéressante. Lorsqu'une victime s'exprime, cela suscite des réactions des autres participantes au groupe de parole.
Enfin, je veux insister sur le fait que, lorsqu'on travaille sur les violences faites aux femmes, on travaille pour l'avenir, et d'abord pour l'avenir des enfants, qui sont à la fois des témoins, des otages et des victimes.

Un précédent rapport de la délégation sur les violences conjugales avait alors donné lieu à de nombreux échanges avec des associations et des professionnels. Nous avions soulevé la question de savoir qui, de l'auteur ou de la victime, devait quitter le domicile conjugal dans ce contexte. Votre présence à l'époque aurait permis d'animer et d'enrichir ces débats !
Par ailleurs, le téléfilm « L'emprise » que j'ai pu voir lundi soir nous rappelle que de nombreuses femmes subissent des violences au quotidien, mais qu'elles gardent le silence souvent, comme vous l'avez dit, par déni. Hélas, les violences qu'elles endurent peuvent les conduire, parfois, à la mort.
Le téléfilm auquel vous avez participé, ainsi que votre intervention, peuvent nous aider à porter vos convictions.

À mon tour, je veux vous remercier pour votre intervention. Nous avions été en contact à l'occasion de la préparation de la loi du 4 avril 2006 et de celle du 9 juillet 2010. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, tant nous apprécions les actions que vous conduisez.
Je suis convaincu, et vous l'avez démontré, qu'un grand nombre d'auteurs de violences conjugales pourraient être soignés. Lorsqu'ils le sont, le taux de récidive tombe - vous l'avez évoqué - à un niveau particulièrement bas. Ainsi, au cours de l'élaboration de la loi du 4 avril 2006, nous avions pris soin de prévoir la mention que les auteurs pourraient faire l'objet d'une prise en charge à la fois psychologique et sociale. Toutefois, les centres de soins pour les auteurs de violence étaient inexistants, d'où mon d'amendement visant à en créer un auprès de tous les TGI de France. En 2006, ce projet, considéré comme trop onéreux, n'a pu aboutir. Or, d'après les informations dont je dispose, le coût des violences s'élèverait à 3 milliards d'euros par an. Avec un tel budget, la création de ces centres aurait pu être envisagée, évitant ainsi de nombreux cas de récidives.
Je rappellerai aussi que l'article 13 de la loi de 2006 prévoit la remise d'un rapport, tous les deux ans, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour présenter le bilan à la fois des besoins en structures de soins pour les auteurs et des besoins en structures d'hébergement pour les victimes. Or, depuis 2006, date de promulgation de la loi, un seul rapport a été publié. Cette situation est regrettable, d'autant plus que ce rapport avait été présenté comme un outil d'information important pour les parlementaires. J'ai d'ailleurs soulevé cette question avec la ministre en charge des Droits des femmes à ce sujet.
La loi de 2010 met en place un nouveau délit de violences psychologiques. C'est, j'en conviens, un point problématique. Avez-vous eu connaissance, en France, de sanctions à l'encontre d'auteurs de violences psychologiques ?
Effectivement, les tribunaux ont prononcé quelques condamnations. Mais ce qui est, avant tout, très important, c'est la consécration d'un délit de violences et de harcèlement psychologiques. J'avais d'ailleurs été amené à défendre cette idée devant l'Assemblée nationale, alors même que la Chancellerie, comme la plupart des magistrats de la chambre criminelle et des syndicats de magistrats, alléguaient la trop grande complexité de l'application de ce délit. Or le délit de harcèlement psychologique existait déjà dans le cadre de l'entreprise. Dès lors qu'il était possible d'engager des poursuites dans ce cadre - poursuites que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de diligenter en tant que procureur - pourquoi faire obstacle à leur mise en oeuvre dans la sphère privée ? En effet, l'entreprise se caractérise par des rapports hiérarchiques : des pressions peuvent être exercées sur les témoins. Malgré ces grandes difficultés, nul ne se hasarde aujourd'hui à remettre en cause le principe de harcèlement psychologique.
Pourquoi cette opposition à la transposition de ce principe dans la sphère privée ? Les violences psychologiques, certes, sont plus difficiles à établir que des violences physiques. Toutefois, les témoignages périphériques (les amis et les voisins par exemple) peuvent toujours être recueillis. De même, les messages d'insultes échangés entre les parties ainsi que les certificats réalisés par des psychologues ou des psychiatres peuvent permettre d'établir le délit. S'il reste difficile à mettre en oeuvre, un tel instrument est néanmoins indispensable. Tout d'abord, symboliquement, parce qu'il rappelle que les violences psychologiques sont autant des violences que les violences physiques. Ensuite, concrètement, parce que les violences psychologiques mènent souvent à des violences physiques.

Pour avoir été militante associative, notamment au Planning familial, je me souviens que nous avions eu des débats douloureux sur la question de la prise en charge des hommes auteurs de violence. Certains militants contestaient que l'on consacre des moyens au traitement des auteurs au détriment de la prise en charge des victimes qui devaient, selon eux, dans un contexte budgétaire difficile, rester prioritaires.
Ce qui m'avait également frappée en tant que personnel de direction de l'Éducation nationale dans un collège de centre-ville, c'est que pour les victimes de milieux populaires ou celles qui avaient accès aux travailleurs sociaux, la collaboration avec la justice était tout à fait aisée. Les choses étaient beaucoup moins faciles pour les femmes appartenant à un milieu favorisé, du fait d'une certaine complaisance à l'égard des auteurs de violence.
Avez-vous vous déjà été confronté à ce type de problème dans votre carrière ? Le cas échéant, que préconisez-vous ?
À mon sens, l'une des raisons pour lesquelles le législateur ne s'est pas préoccupé de ce sujet est liée au fait que notre représentation nationale demeure à 75 % masculine, et rares sont les parlementaires qui, comme notre excellent collègue Roland Courteau, sont très investis dans ce combat.
Le traitement d'un auteur doit être le même quelle que soit sa classe sociale. À Douai, le foyer Emmaüs accueillait des médecins, des chefs d'entreprise, des professeurs : ils étaient tous traités de la même façon.
Lors d'une mission de formation, j'avais invité une victime issue d'un milieu très favorisé : fille d'officier, elle avait épousé un chef d'entreprise. Selon son témoignage, le milieu social empêche bien souvent les femmes de s'exprimer parce qu'elles ressentent un sentiment de honte. La seconde difficulté relève de la persistance du mythe selon lequel la violence épargnerait certains milieux, ce qui est absolument faux.
Je ne peux pas vous confirmer qu'il y aurait une disparité de traitement en fonction du milieu social de l'auteur de violence. Je pense, toutefois, qu'il est difficile d'amener les femmes à s'exprimer lorsqu'elles évoluent dans un milieu favorisé. Un travail important de psychologie doit être mené sur ce point, ce que font d'ailleurs très bien les associations.
Votre remarque sur les dissensions existant sur le terrain entre les associations rejoint mes propos liminaires. Je comprends que les associations craignent de diluer leurs moyens. En revanche, je persiste à dire qu'il faut prendre le problème par le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux origines de la violence. Ne pas traiter les causes, c'est se condamner à perpétuité à traiter les conséquences.

Il est toujours intéressant de vous entendre. C'est vrai, il faut d'abord traiter les causes du problème : les violences conjugales s'inscrivent dans ce qu'on appelle le « continuum de la chaîne des violences ». La dynamique qui s'opère l'est toujours au détriment de la victime.
Sur un autre plan, j'ai eu à traiter aussi de la question de la violence faite aux enfants et j'ai pu observer qu'elle obéissait à la même logique.
Votre discours suscite beaucoup d'espoir, mais comment expliquez-vous que la plupart des TGI refusent toujours de travailler dans un esprit de pluridisciplinarité, pour repérer et dépister les auteurs et, surtout, pour prendre soin des victimes ? Sans nier les difficultés économiques, il faut reconnaître qu'il s'agit surtout d'un sujet que vos collègues ne traitent pas toujours en priorité, d'où le fait que les ordonnances de protection ne soient pas délivrées parfois avant de trop longs délais.
Ce sujet est dramatique mais il n'est pas toujours pris en considération. Comment expliquez-vous ces résistances ? Les lois que nous votons ne semblent pas complètement appliquées.
Une circulaire récente enjoint aux parquets d'appliquer le dispositif que j'avais expérimenté à Douai, auquel s'ajoute l'édition d'un guide des bonnes pratiques. Ceci montre que la Chancellerie se préoccupe désormais de ce sujet. D'ailleurs, le rapport de politique pénale, qui est remis chaque année par les procureurs généraux, consacre un volet aux violences faites aux femmes.
Je partage votre inquiétude concernant les difficultés rencontrées sur le terrain. Je reçois régulièrement des courriers dans lesquels les victimes se plaignent que leurs plaintes ne soient pas enregistrées dans les commissariats et les gendarmeries. J'espère que les nouvelles dispositions législatives permettront de lever cette difficulté, mais jusqu'à présent le recours aux « mains courantes » demeure la règle.
Face aux violences faites aux femmes, les réactions des parquets (simple classement sans suite, classement sans suite avec rappel à la loi) ne sont pas toujours appropriées. La procédure du rappel à la loi est couramment utilisée parce qu'elle permet d'éviter un « classement sec », ce qui permet de conserver de bonnes statistiques pénales.
Cependant, la procédure du « rappel à la loi » signifie concrètement que, durant l'audition, l'officier de police judiciaire qui a traité l'enquête se contentera de « faire les gros yeux », exhortant l'auteur à ne pas recommencer. Cela n'a pas vraiment d'impact sur la plupart des auteurs de violence. D'autre part, la médiation pénale n'est pas non plus envisageable dans ce type d'affaires, dans la mesure où il semble inacceptable de laisser la victime et l'auteur repartir ensemble à la fin de l'audition.
Je dénonce, depuis des années, un état d'esprit ambiant conduisant à une sanctuarisation du couple. Il faut absolument casser l'idée selon laquelle les pouvoirs publics n'ont pas à s'« immiscer » dans l'intimité des couples. Dès lors que la violence pénètre la sphère privée, les institutions doivent agir. Toutefois, il faut noter que, très souvent, les magistrats, en particulier les juges aux affaires familiales, sont réticents à prendre des ordonnances de protection, par crainte de se faire manipuler à l'occasion de divorces.
Les juges aux affaires familiales ne disposent pas des mêmes moyens d'enquête que le parquet. Les avocats des demandeurs et des défendeurs fournissent chacun des attestations contraires. C'est alors la parole de l'un contre celle de l'autre. Il est nécessaire de permettre au parquet et aux juges aux affaires familiales de communiquer sur les procédures en cours. À ce sujet, je dois dire que je me suis retrouvé confronté, des années après le travail que j'ai effectué à Douai, à des affaires jugées en Assises dans lesquelles il apparaissait que les services de police et de gendarmerie n'avaient pas respecté les instructions que j'avais données. Il faut donc pouvoir mettre en oeuvre des contrôles stricts et efficaces.

J'ai écouté avec intérêt votre position concernant le double rôle des associations à l'égard des victimes et des auteurs. Le sujet est délicat parce que les associations comptent dans leur rang beaucoup de femmes engagées qui ont alors tendance à s'occuper en priorité des victimes femmes plutôt que des auteurs de violence. Toutefois, il faut noter que les hommes peuvent, eux aussi, subir des violences !
Je souhaite par ailleurs revenir sur un point qui avait soulevé une polémique : les gardes alternées. Ces dernières, à mon sens, ne sont pas obligatoires : les gardes peuvent être aménagées.
Le risque de manipulation pesant sur les magistrats dans des cas, par exemple, de divorces, m'interpelle aussi en tant que législateur. Il est vrai que des cas d'attouchements d'enfants semblent parfois apparaître au moment du divorce. Est-ce vrai ?
Enfin, je suis étonnée que vous n'ayez pas abordé le point particulier de l'alcool qui, à mon sens, est un détonateur de violence.
Je n'ai pas abordé le sujet de l'alcool parce que je veux sortir de l'image qui consiste à penser que tous les auteurs de violence sont forcément alcooliques. S'agissant des problèmes de divorce que vous évoquiez, on note que, de plus en plus, des pères se mobilisent par l'intermédiaire d'associations car ils s'estiment pénalisés par rapport aux mères lors des divorces. Il est aujourd'hui facile de manipuler l'opinion par le biais des réseaux sociaux mais je pense que les magistrats doivent rester « droits dans leurs bottes ».
Un pédopsychiatre m'a demandé un jour : « De quoi, selon vous, un enfant a-t-il le plus besoin ? ». Contrairement à ce que je pensais, la réponse n'était pas l'amour, mais la protection. Le droit de garde doit être confié en fonction de ce critère principal, ce qui pourrait peut-être rendre de plus en plus difficiles les gardes alternées à l'avenir. Le nouveau statut revendiqué aujourd'hui par les pères n'est parfois qu'une fiction : je ne suis pas persuadé que les choses aient véritablement changé dans le fond. Certes, les pères bénéficient d'un ensemble de jours de congés, en particulier au moment de la naissance de l'enfant, mais cela n'est pas suffisant pour que la structure familiale en soit profondément modifiée.
La prudence est de mise en matière de garde. À cet égard, ce même pédopsychiatre m'avait alerté sur le fait que des IRM pratiquées sur des nourrissons exposés à des violences familiales montrent les effets de la sécrétion, en cas d'angoisse, d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Ces dégâts sont très importants sur le plan psychologique et physiologique.
Dans un ouvrage intitulé « Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême », le professeur Maurice Berger remet en cause divers poncifs auxquels tient pourtant l'institution judiciaire :
- le premier grand principe relève de la croyance selon laquelle un mari violent peut être aussi un bon père : c'est un non-sens ;
- le deuxième grand principe consiste à affirmer que le maintien du lien serait indispensable entre les enfants et les parents, quel que soit le contexte. Même si les enfants ont fait l'objet de violences terribles, les juridictions refusent encore de prononcer la déchéance de l'autorité parentale.
Il faut donc à mon avis remettre en cause ces certitudes.

Je vous remercie pour vos réponses. Vous confirmez des convictions que nous avons exprimées à l'occasion du rapport de 2010 sur les violences conjugales.

Je souhaiterais profiter de votre présence pour sortir du cadre de cette rencontre et m'informer sur différents points.
L'ordonnance de protection est destinée à mettre la victime à l'abri en cas de danger. Dans l'esprit du législateur, la délivrance devait intervenir dans un délai raisonnable de 72 heures. Or, dans la pratique, les juges sont réticents à la délivrer ou la délivrent, mais avec un délai de l'ordre de plusieurs semaines. L'ordonnance de protection ne remplit donc plus son objectif.
La loi de 2014 a donc allongé le délai de l'ordonnance de protection à six mois, cette ordonnance devant être délivrée par le juge aux affaires familiales, dans des délais raisonnables. Avez-vous des éléments à nous apporter à ce sujet ?
J'aimerais aborder le sujet des formations, notamment celle des gendarmes, pour mieux accueillir les victimes, et celle des médecins, pour mieux dépister les violences. En 2006, la mise en place d'une formation avait été écartée en raison de son coût, avant d'être reconnue par la loi de 2010. Cette formation est-elle vraiment mise en oeuvre ?
Enfin, je souhaiterais faire une dernière remarque, qui concerne cette fois les enfants : selon une étude canadienne, 40 % des enfants délinquants sont des enfants ayant été exposés à des violences conjugales.
L'application des ordonnances de protection varie d'un TGI à l'autre. Il est vrai que certains professionnels sont réticents à la mettre en oeuvre. L'ordonnance de protection relève à l'origine d'une mesure de référé, c'est-à-dire une mesure urgente par nature. Or, le magistrat n'aime pas statuer rapidement car il a peur d'occulter des renseignements. À l'origine, je pensais que c'était une excellente chose, d'autant plus que l'ordonnance de protection s'applique également aux concubins. Toutefois, force est de reconnaître que le dispositif souffre de faiblesses et risque d'aboutir, à terme, à une disparité de traitement entre justiciables.
S'agissant de la formation des médecins, le professeur Henrion1(*) effectue un travail remarquable. Des modules destinés aux étudiants ont été créés dans les facultés de médecine. J'ai d'ailleurs ressenti de la part des académiciens un très vif intérêt pour la question, lorsque le professeur Henrion m'avait fait l'honneur de m'inviter pour présenter une conférence.
Au niveau de la police et de la gendarmerie, la formation existe depuis longtemps. Si les cadres y sont sensibilisés, la difficulté qui se pose est toujours la même : la déclinaison de cette politique sur le terrain. Cela nécessite un effort de contrôle par les personnels encadrants.
S'agissant des enfants, ce que vous dites correspond à la réalité. Le professeur Berger, que j'évoquais tout à l'heure, accueille dans son unité de recherche et de soins des enfants qualifiés d' « ultraviolents » de dix ou douze ans. Afin de les maîtriser, lors de crises de rage ou de colère, pas moins de deux ou trois médecins et infirmiers sont nécessaires. Ces enfants ont tous grandis dans un milieu familial violent.
Certaines dérives m'inquiètent, notamment la revendication par certaines associations et avocats d'une présomption de légitime défense en ce qui concerne les femmes. Une femme qui tue son mari n'agit pas nécessairement dans un cadre de légitime défense. Or, admettre cette présomption implique que la charge de la preuve revient au Parquet. N'oublions pas que, à l'origine, la légitime défense était une présomption. Ce principe a été remis en cause à la suite d'une affaire judiciaire. Restaurer une présomption de légitime défense au profit des femmes serait le pire service qu'on puisse leur rendre.

Les aspects médicaux sont importants parce le médecin peut être témoin de violences dans son cabinet, même si, comme l'affirme votre collègue Édouard Durand2(*), « le plus dur est de voir ce que l'on voit ». Redoutant une procédure de diffamation, il peut être réticent à interroger directement sa patiente au sujet de ses blessures. De plus, la femme affirme venir consulter pour des douleurs abdominales, des problèmes de cervicales, à la suite d'une chute dans l'escalier... Il est donc essentiel de sensibiliser et de former les médecins à ce repérage. Je lirai avec attention ce qu'a écrit le professeur Henrion.
Un important travail de formation reste à fournir. Il est indispensable de créer des unités de médecine légale au sein des juridictions, comme je l'avais fait à Douai.

Votre remarque sur la présomption de légitime défense m'amène à une question en lien avec le téléfilm « l'Emprise », dont nous avons déjà parlé ce matin. Au début du procès, vous semblez très agressif, puis un changement d'attitude intervient à l'égard d'Alexandra Lange. Ce n'est qu'un film mais je voulais en savoir un peu plus à ce sujet.
Enfin, je me demandais, toujours en lien avec ce film, si les cinéastes - notamment les auteurs de séries télé - n'avaient pas un rôle à jouer dans la libération de la parole ?
Je vous rejoins sur l'intérêt pédagogique des séries télé. S'agissant du film, plusieurs personnes m'ont effectivement posé la question. Il s'agissait en réalité d'un choix du réalisateur, pour préserver le « suspense » du réquisitoire.

Je vous remercie au nom de la délégation, votre témoignage nous est précieux.
* 1 Membre de l'Académie nationale de médecine, auteur en 2001 d'un rapport sur les violences conjugales demandé par le secrétaire d'État à la santé.
* 2 Magistrat, coordinateur de formation à l'ENM, auteur de Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, L'Harmattan, 2013.