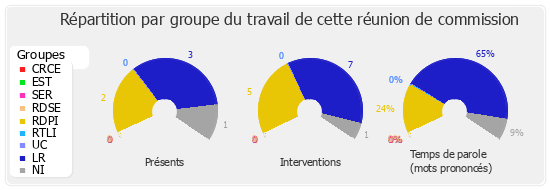Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 17 mars 2016 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Après une suspension de nos travaux pendant quelques semaines au cours desquelles nos collègues rapporteurs sur les questions foncières et moi-même avons sillonné le Pacifique, nous reprenons aujourd'hui les auditions pour évoquer une grande culture de nos outre-mer : la banane.
Avec la canne à sucre, à laquelle nous nous intéresserons la semaine prochaine, la banane constitue une production majeure pour la Guadeloupe et la Martinique : la récolte est presque totalement écoulée sur le marché européen et ce secteur agricole représente le premier employeur privé des territoires. L'enjeu des différentiels de compétitivité est donc considérable, ce qui nous conduit à entendre aujourd'hui les experts sur les contraintes normatives applicables à la filière.
Nous avons le plaisir d'accueillir, pour l'UGPBAN, Monsieur Sébastien Zanoletti, directeur Innovation et développement durable, également consultant pour l'Institut technique tropical, ainsi que Madame Chloé Bourgoin, responsable santé végétale de cet institut ; pour Eurodom, Madame Laetitia de La Maisonneuve, accompagnée de Monsieur Emmanuel Detter, consultant ; pour le cabinet Blezat Consulting, chargé de l'évaluation du plan banane durable, Madame Olivia Meiffren.
Je rappelle que Monsieur Éric Doligé est le rapporteur coordonnateur de cette étude qui comportera plusieurs volets. Madame Catherine Procaccia et Monsieur Jacques Gillot sont les rapporteurs pour le premier thème consacré aux normes sanitaires et phytosanitaires applicables à l'agriculture dans les outre-mer.
Madame, Messieurs les rapporteurs souhaitez-vous intervenir avant que nous ne cédions la parole à nos interlocuteurs, sur la base de la trame thématique qui leur a été adressée.

Je remercie les personnes présentes qui nous éclaireront sur le sujet.
Un certain nombre d'entre nous ont assisté hier à la présentation du rapport de Monsieur Victorin Lurel sur l'égalité réelle en outre-mer. Il ne me semble pas que ce document ait abordé la thématique des normes. En s'y intéressant, notre délégation essaie de voir comment elle pourrait contribuer à améliorer la situation des outre-mer en matière de développement économique. Le poids des normes, la sur-normalisation des contraintes européennes par la France sont souvent mis en cause de manière trop globale et j'aimerais vraiment que nous entrions maintenant dans le concret, que vous illustriez votre exposé d'exemples de terrain. Comment les normes pèsent-elles sur l'accès au marché européen de nos outre-mer par rapport à leurs concurrents régionaux, qui ne sont pas forcément soumis aux mêmes contraintes normatives ?

En 2009, dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, j'ai présenté conjointement avec Jean-Yves Le Déault un rapport sur les impacts de l'utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles. Nous avions mis en valeur la problématique des normes phytosanitaires. Pourriez-vous nous dire ce qui a changé depuis cette époque en matière de normes et de prise en compte de la problématique par l'Union européenne, à l'époque particulièrement fermée à toute évolution ?

Lors de la réunion de la commission des affaires économiques de ce mercredi, il a été clairement annoncé que si nous n'appliquions que les seules normes européennes le corpus normatif serait allégé d'un tiers.
Merci monsieur le président de nous donner la parole sur cette question des normes, fondamentale pour les outre-mer. À Eurodom, nous soulevons cette problématique depuis de nombreuses années et nous sommes très contents de voir le Sénat s'y intéresser de près. Qu'il s'agisse des normes sanitaires, phytosanitaires, sociales ou environnementales, les normes françaises et européennes sont toutes plus contraignantes que celles qui s'appliquent chez nos concurrents, dans les pays de la Caraïbe, d'Amérique centrale ou d'Afrique, qui produisent de la banane pour le marché européen.
L'Union européenne autorise une liste de produits phytosanitaires et leur cadre d'utilisation. Chaque État impose ensuite son cadre d'homologation. La France sur-interprète parfois les règles phytosanitaires, ce qui induit des surcoûts. Il est difficile mais possible d'évaluer les différentiels de compétitivité avec les concurrents régionaux qui exportent vers nos marchés.
La problématique des normes, notamment phytosanitaires, se traduit un chiffre : nous avons aujourd'hui en France continentale une couverture de 95 % des besoins liés aux attaques phytosanitaires. Cette couverture est de l'ordre de 20 % pour les départements d'outre-mer.
Cette situation résulte d'une double contrainte. La première vient de Bruxelles qui définit les molécules autorisées et le mécanisme qui encadre la façon dont les États membres vont autoriser les produits phytosanitaires pour les cultures données. C'est ce cadre communautaire qui, du fait de l'absence de rentabilité économique tenant à l'étroitesse des marchés, ultramarins dissuasive pour les laboratoires, ne permettra jamais aux régions ultrapériphériques françaises de disposer d'une couverture équivalente à celle du continent. Il faut ajouter à cela que les autorisations de mise sur le marché doivent être périodiquement renouvelées, la décision dépendant chaque fois de l'état de la science et des connaissances. Ces dernières années, la rigueur s'est renforcée avec le transfert de la responsabilité des autorisations de mises sur le marché (AMM) à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), précédemment dévolue au ministre de l'agriculture. Or, l'ANSES s'aperçoit que les études scientifiques qui étaient à l'époque nécessaires pour pouvoir autoriser des molécules sur les territoires ultramarins sont parfois dépassées ou ne répondent plus aux nouveaux critères de sécurité. Elle peut alors décider de supprimer des molécules au risque de déstabiliser gravement des productions. Nous sommes confrontés à un dispositif profondément inégalitaire au détriment de nos outre-mer, pour des raisons structurelles. Cela va provoquer de graves problèmes dans la gestion de l'agriculture, sauf à parvenir à développer le bio, ce qui est particulièrement difficile en milieu tropical.
La seconde contrainte est liée à la distorsion de la concurrence entre produits de nos DOM et produits relevant de la même catégorie de label provenant de pays tiers, qui nuit à l'information du consommateur. Nous vendons aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire continental européen, des productions tropicales avec des labels bio ou fair trade qui sont moins bio, moins fair trade que celles que nous produisons chez nous. La sur-valorisation que nous accordons à ces productions de pays tiers n'est pas mineure. La caisse de bananes de 18,5 kilogrammes, au standard international, est vendue aux alentours de 12 euros sur le marché français. Le revenu du producteur représente un peu moins d'un euro. La caisse de bananes bio est vendue 4 euros de plus. Cela représente 25 % de chiffre d'affaires supplémentaire, 4 fois le revenu du producteur.
La main d'oeuvre est le principal facteur du surcoût de la production de bananes des Antilles, compensé par le dispositif communautaire du Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI). Les surcoûts liés aux normes phytosanitaires, calculés par déduction lorsque l'on a enlevé les surcoûts dus à la main d'oeuvre, représentent 15 à 20 % du prix de vente.
Les concurrents de la banane de la Martinique et de la Guadeloupe sur le marché européen sont principalement les pays d'Amérique centrale (Costa Rica, Colombie et Équateur) et d'Afrique (Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana). L'essentiel de la différence de compétitivité tient au coût de la main-d'oeuvre. 90 % des salariés des Antilles sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Ils sont payés au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), soit environ 90 euros par jour. En Afrique ou en Amérique centrale, le salaire varie entre 200 et 300 dollars par mois. Même s'il est compensé par le POSEI évoqué par Monsieur Detter, le différentiel est énorme.
Il y a également un différentiel de compétitivité lié aux normes. Ces normes, qui s'appliquent également à l'agriculture métropolitaine, concernent à la fois la partie « production », mais aussi le stockage et le transport, les stations de conditionnement.
Dans les champs, s'appliquent les normes environnementales et les normes relatives à la protection des salariés, aux matériels et aux équipements. Ces normes évoluent régulièrement. C'est le cas des exigences relatives aux tenues vestimentaires ou aux tracteurs qu'il va falloir changer car les cabines doivent dorénavant être hermétiques.
Ensuite, les bananes arrivent dans les stations de conditionnement où les régimes sont découpés en bouquets puis lavés et mis en cartons. Des normes spécifiques s'appliquent de l'entrée à la sortie de la station. Je pense notamment aux déchets, qu'ils soient organiques ou composés de plastique. Tous les déchets en plastique sont recyclés ou compressés. Faute de moyens adaptés sur place pour les traiter, certains déchets doivent être envoyés en métropole.
Toutes ces normes ne s'appliquent pas chez nos concurrents. Même s'il mériterait d'être affiné, j'ai estimé le surcoût lié aux normes à environ 150 euros par tonne.
Ces normes ont leur sens et nous ne les remettons pas en cause, même si, pensées pour la métropole, elles s'appliquent parfois mal à l'outre-mer. Le domaine phytosanitaire est celui pour lequel l'inadéquation normative est la plus importante. On estime aujourd'hui que 30 % des besoins phytosanitaires sont couverts en moyenne pour toutes les cultures d'outre-mer. En métropole, le taux était de 85 % et a été ramené à 80 % récemment. Le différentiel de produits autorisés pour les cultures d'outre-mer est énorme. La banane n'est pas la moins bien pourvue puisque le taux de couverture est de 60 %. Des cultures comme l'ananas ou l'igname ne disposent que d'un seul produit phytosanitaire autorisé. La production d'ananas a ainsi connu une chute vertigineuse en Guadeloupe et en Martinique.
Ces cultures des zones tropicales humides sont touchées par de nombreuses maladies. Si vous ne disposez pas des produits de traitement adaptés, la culture ne peut pas se développer, elle est condamnée.
Pour la banane, nous sommes en limite de possibilité de produire. La maladie principale est la cercosporiose, une maladie des feuilles. Depuis deux ou trois ans, nous réalisons environ sept traitements par an. Le Costa Rica en applique 65, soit un tous les 5 jours, l'Afrique et l'Équateur, une quarantaine. Alors que toutes les bananes du monde sont traitées par épandage aérien, même pour le bio, celui-ci a été arrêté chez nous et remplacé par des traitements terrestres, avec des coûts supplémentaires et un matériel qui devra encore évoluer.
Nos concurrents peuvent utiliser entre 50 et 100 produits autorisés. Ils ont un accès total à tout ce qui existe dans le monde. Nous disposons principalement de deux produits de traitement, issus d'un laboratoire suisse. Ces produits sont homologués pour dix ans puis réévalués. La semaine dernière, la firme nous a annoncé qu'en raison de la complication des procédures résultant de la nouvelle réglementation européenne 1107-2009 et du coût des études nécessaires, elle ne redéposera pas de dossier pour au moins l'un d'entre eux. Devant redéposer des dossiers pour de nombreux autres produits portant sur des grandes cultures françaises ou européennes, il n'y a pas d'équipe disponible pour travailler sur un marché considéré comme mineur. Or, le retrait de ce produit à horizon 2017 mettrait en danger la culture de la banane. Le même phénomène s'est produit pour la canne. À la suite du retrait d'un produit, une chute très importante des rendements avait été observée et seule la réintroduction du produit avait permis d'éviter la catastrophe. La toxicité du produit n'est pas en cause. C'est d'abord un problème économique.

Lors de notre rapport, en 2009, il n'existait aucun produit phytosanitaire pour lutter contre la cercosporiose. L'inquiétude était forte car la maladie était déclarée dans la région. Est-ce que depuis 2009 des produits nouveaux ont été homologués ? L'autorisation pour l'un des deux produits pourrait ne pas être renouvelée pour des raisons économiques de rentabilité insuffisante liée à l'étroitesse du marché de la banane. Ce produit est-il commercialisé dans d'autres parties du monde ?
Les produits disponibles aujourd'hui sont à peu près ceux qui existaient en 2009. Avant 2009, la cercosporiose jaune était traitée par 5 ou 6 produits, principalement 2 plus efficaces. Quand la cercosporiose noire est arrivée en 2009, certains craignaient que ces produits ne fussent pas opérants. Ils l'ont été. Désormais, ils doivent être ré-homologués. Ils sont vendus ailleurs et font partie d'une liste de 50 produits chez nos concurrents.

Les concurrents africains et d'Amérique latine traitent leurs bananes davantage que nous et vendent sur nos marchés.
C'est effectivement une source d'irritation pour nous. Il y a des tolérances pour ces pays qui pratiquent des traitements non-homologués en Europe et introduisent leur production sur le marché européen.

Une analyse précise devrait démontrer qu'il y a là une anomalie flagrante.
Monsieur le sénateur, vous soulevez un problème majeur qui relève de l'action du Gouvernement et de Bruxelles.
L'ODEADOM a demandé au cabinet AND-International de réaliser une étude sur la banane bio, en comparant les productions de la République dominicaine et des Antilles. Les résultats sont spectaculaires. Une liste en fin de rapport établit que la République dominicaine peut utiliser 33 produits pour la banane bio. Seuls trois produits sont autorisés aux Antilles car aucun laboratoire n'a pris le risque de dépenser beaucoup d'argent en recherche pour une AMM. 14 produits sur les 33 ne sont pas autorisés par la liste communautaire en agriculture conventionnelle. Nous avons des productions, étiquetées bio en raison d'un accord commercial, qui utilisent 19 produits et qui, de plus, utilisent des produits que nous ne pouvons pas même utiliser en agriculture conventionnelle.
Depuis l'interdiction des traitements phytosanitaires aériens, nos avions et nos hélicoptères ont été achetés par nos concurrents de la République dominicaine qui les utilisent pour leurs propres traitements bio !
Cette tromperie du consommateur est inquiétante car elle cause un préjudice à nos producteurs. De plus, si le consommateur européen prend conscience que ce qui provient des pays tiers n'a plus de label sérieux, il perdra confiance.
J'attire votre attention sur le fait que le sujet est particulièrement d'actualité. À Bruxelles, le règlement sur l'étiquetage des produits bio fait l'objet de discussions, difficiles, sous présidence néerlandaise, dans le cadre de trilogues. Nous avons fait notre part de travail d'alerte. Depuis le début, la Commission a plutôt l'intention d'aller vers la conformité : elle demande que la réglementation bio communautaire s'applique aux pays tiers d'ici cinq ans. Tout le monde s'est aperçu que ce sera impossible pour des productions tropicales sur lesquelles il n'y a pas d'équivalence. La conformité sur les pommes de terre est concevable, mais pas sur les bananes. Nous avions obtenu du Parlement européen que l'octroi de l'équivalence ait pour contrepartie le respect du principe de loyauté des échanges et que la Commission doive adapter en conséquence la réglementation communautaire. Cet amendement avait été adopté dans le cadre du trilogue mais il a été modifié. L'amendement en cours de discussion reprend l'exigence de conformité à 5 ans et prévoit que la Commission puisse accorder des dérogations pour l'importation de produits bio venant de pays tiers sur le territoire communautaire, avec la précision que, pour les régions ultrapériphériques, les dérogations ne seront possibles que dans 5 ans. Nous avons un vrai problème car le commissaire Hogan est allé en Colombie et a annoncé un grand accord sur le bio.
Dans les productions communautaires tropicales, notre savoir-faire pour le bio est supérieur à tout ce qui se fait dans le monde. Si Bruxelles en était convaincu, nous aurions la possibilité de commencer à définir un standard européen du bio. Les problèmes économiques des grands laboratoires que nous évoquions en début d'audition seraient réglés si le standard européen bio s'appliquait au marché communautaire. Le laboratoire ne ferait pas valider ses produits uniquement pour la Guadeloupe ou la Martinique, mais pour l'ensemble du monde qui voudrait accéder au marché communautaire.
La question du standard européen du bio a été soulevée par les producteurs à Bruxelles. Nous en avons parlé à Monsieur Joost Korte, directeur général adjoint de la DG Agri et au chef de cabinet adjoint de Madame Anna Cecilia Malmström, commissaire en charge du commerce, qui ont bien pris conscience de la situation. Cependant, lors des discussions en trilogue en présence du Conseil, de la Commission et du Parlement, on s'est à nouveau écarté d'une solution satisfaisante pour nos productions qui consisterait à reconnaître que nous avons une agriculture tropicale dans l'Union européenne et à rechercher, au moins pour le bio, une solution adaptée.
Il faudrait une volonté communautaire, portée par une demande française, de modifier la réglementation pour définir un standard européen du bio, qui s'appliquerait progressivement à nos partenaires commerciaux des pays tiers. Permettons à ceux qui font la meilleure banane de disposer de labels valorisants et donnons 5 ans aux autres producteurs pour se conformer à nos standards plutôt que de nous enfermer dans une logique où le bio de chez nous serait un bio continental, jamais appliqué dans l'agriculture tropicale, et d'autoriser à peu près n'importe quoi pour les pays tiers.

Pensez-vous que l'opposition à la démarche que vous préconisez tienne au lobbying des laboratoires phytosanitaires ?
Madame la sénatrice, je ne le crois pas.

Vous évoquez le différentiel de compétitivité lié aux normes. En Guadeloupe, il existe des produits de traitement à base d'extraits d'huiles essentielles, comme en Floride ou en Californie. Les spécialistes du Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) me disent qu'ils ont besoin de souplesse pour développer leurs produits dans le cadre du dispositif européen. Ils constatent qu'il y a des freins au niveau de la législation européenne et de la législation française.
Lors des débats sur le projet de loi de reconquête de la biodiversité de la nature, il a été rappelé que les essences d'origine représentaient l'avenir.
En effet, il existe de nombreuses décoctions locales, issues d'un savoir-faire ancien, à base d'extraits de plantes qui pourraient être utilisables, comme les décoctions à base d'arbre à pain, d'abricot pei ou de feuilles de manguier. Néanmoins, à l'heure actuelle, elles ne peuvent pas être utilisées pour des productions en agriculture biologique à cause de la réglementation européenne qui ne les reconnaît pas. Ces substances devraient d'abord être inscrites comme substances de base au niveau européen. Le dépôt d'une demande d'homologation pour des plantes qui n'existent que dans les départements d'outre-mer nécessiterait de lourds investissements. De ce fait, personne ne déposera de dossier et on n'aura jamais accès à ces solutions naturelles qui, a priori, ne présentent aucun risque pour la personne qui les applique, le consommateur ou l'environnement.
Il existe une liste européenne d'une vingtaine de produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique. C'est le règlement 889-2008. Mais il faut homologuer chaque produit pour son application à la banane et, comme le marché est trop petit pour que cela intéresse un laboratoire, seuls trois produits sont sur le marché. Parallèlement, des pays comme la République dominicaine fournissent le marché européen en agriculture biologique, avec le label AB, et utilisent tous les produits autorisés auxquels s'ajoutent 14 produits qui ne sont pas autorisés en Europe. Il y a tromperie du consommateur. On n'a pas expertisé ces produits et on ne sait pas s'ils sont toxiques ou dangereux. Il y a une double distorsion de la concurrence : nous n'avons pas accès à notre propre liste européenne pour des raisons économiques et nos concurrents ont accès à toute la liste et à des produits qui n'y figurent pas. Ces productions bio sont vendues 30 % plus cher.

Il y a une inégalité dans l'accès aux produits phytosanitaires. Vous êtes seuls à vous battre, à aller à Bruxelles. J'ai le sentiment que l'État français n'est pas suffisamment actif. Que faisons-nous en tant qu'État membre ? Il me semble que d'autres États sont plus présents que le nôtre.

Nous voyons bien que la question déborde indiscutablement sur la politique européenne de signature d'accords commerciaux de libre-échange avec le monde entier. La France oublie trop souvent qu'elle n'est pas qu'hexagonale et les problématiques de ses outre-mer ne sont pas correctement prises en compte.
Lorsque ces accords sont en préparation, la France donne un mandat de négociation et confie la rédaction des textes à des personnes qui ne connaissent pas les réalités ultramarines. Quand la France reçoit le projet d'accord, elle considère qu'il est bon à 90 %, mais les 10 % qui restent correspondent exactement aux problématiques ultramarines des régions ultrapériphériques.
J'ai le sentiment que l'Union européenne considère qu'elle ne pourra pas aider les régions ultramarines et maintient en survie leurs économies, avec des compensations au titre du POSEI, au lieu de les aider à développer une économie durable et concurrentielle. La compensation financière n'est pas ce qui motive les producteurs.
J'entends à travers ce que vous dites la nécessité de développer un programme de recherche et de développement des produits d'origine locale. Compte tenu de l'exiguïté du marché, ce ne sont pas les producteurs privés qui financeront les AMM.
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vos propos vous conduisent à vous interroger sur l'action de l'État. Mais, à la base, pour qu'une autorisation soit délivrée, il faut que la demande soit initiée par une démarche privée. Dans le cadre de la réglementation actuelle, qui génère des procédures longues et coûteuses, personne n'en voit l'intérêt économique.
Il y a des lobbies à Bruxelles mais, sur des sujets aussi sensibles que la protection des consommateurs, le bon sens devrait l'emporter. À partir du moment où la France sera déterminée, parce qu'elle a des productions communautaires en milieu tropical, à obtenir un juste traitement, comme le traité le prévoit, la Commission ne pourra pas s'y opposer. Sur un sujet aussi sensible que le bio nous pourrions obtenir le soutien des parlementaires allemands. Il ne s'agit pas d'obtenir une révolution mais de faire accepter le fait qu'à la suite du scandale de la chlordécone en 2007 - et votre rapport a été utile - notre production est devenue la meilleure du monde, que nous avons développé dans les départements d'outre-mer des solutions qui permettent d'avoir une agriculture durable. Il faut en effet une vraie volonté politique.

Comme lors de nos auditions pour le sucre de canne, je renouvelle ma demande d'un déplacement de la délégation à Bruxelles pour rencontrer la Commission. Il faut montrer que les parlementaires français s'intéressent à la question. Notre délégation devrait exercer un réel lobbying sur les thèmes touchant les départements d'outre-mer et les régions ultrapériphériques.

Après la résolution sur le sucre, en association avec la commission des affaires européennes, nous travaillons sur un projet de déplacement conjoint sur des thématiques précises. Si nous décidons de nous mobiliser, nous devrons faire régulièrement des déplacements et suivre les dossiers. Il faudrait que la France défende davantage ses intérêts. Comme le disait le président Gillot, d'autres États membres font mieux que nous en la matière.

Mme Bourgoin a évoqué des traitements locaux naturels qui permettent de lutter contre certaines maladies.
Il y a deux ans, j'avais rencontré des représentants d'un syndicat d'agriculteurs de La Réunion qui utilisaient des méthodes naturelles. Quel parcours réglementaire faudrait-il mettre en place pour que ces produits puissent être utilisés ?
Vous avez dit que si nous faisions tout en bio les difficultés économiques seraient moindres. Cela résoudrait-il tous les problèmes ?
Compte tenu de la spécificité de ces territoires, ne pourrait-on pas envisager un label bio général qui valoriserait la production. Avez-vous travaillé sur ce modèle ?
Depuis le scandale du chlordécone, avec le plan banane durable de 2009, nous avons entrepris une démarche volontariste afin de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques. De 2006 à 2013, l'utilisation des pesticides a diminué de 50 %. Compte tenu du fait que nous n'utilisons presque plus de produits chimiques, nos productions se sont rapprochées des productions bio. Aujourd'hui, nos productions traditionnelles sont plus bio que celles de la République dominicaine ou de l'Équateur qui produisent du faux bio.
Pour avoir accès aux produits phytosanitaires bio, il faudrait une homologation. Il n'y a qu'un seul producteur bio en Martinique. Il traite sa production avec une décoction qu'il fabrique lui-même. Mais il ne peut être juridiquement prétendu au label bio sans déposer un dossier, demander une AMM pour la banane, démarches qui prendraient 5 à 10 ans et seraient très onéreuses. Notre filière ne peut pas se lancer dans un processus qui ne serait pas parfaitement conforme aux exigences règlementaires.
Comme nous nous sommes rapprochés de la production bio, nous aimerions développer un vrai label qui deviendrait la référence internationale, obligeant ainsi les autres producteurs à s'y conformer.

J'ai le sentiment que l'Europe produit de la norme qu'elle impose aux États membres et aux régions ultrapériphériques dans le même temps qu'elle signe des accords de libre-échange qui tolèrent des introductions sur son territoire de produits qui ne respectent pas les normes qu'elle a elle-même fixées.

Lors du rapport sur le chlordécone, nous avions intitulé un chapitre « À la recherche de la chlordécone perdue ». Nous nous doutions bien qu'il ne pouvait être uniquement produit pour un marché aussi étroit que celui de l'outre-mer. Ce produit ne concerne pas que les outre-mer. Les USA avaient décentralisé leur production au Brésil. Si nos outre-mer utilisaient 15 ou 20 % de la chlordécone produite, les 80 % restant étaient utilisés en Europe, sur la pomme de terre en Allemagne, en Pologne et dans les Pays de l'Est. J'ai cru qu'en allant voir les Verts allemands, très actifs en 2009, pour leur expliquer que leurs terres étaient imprégnées de chlordécone, nous parviendrions, avec l'aide des chercheurs, à trouver une solution pour nous débarrasser de cette molécule. La préoccupation première des écologistes était de sauvegarder leur agriculture. Je suis également allée au Parlement européen. Personne n'a bougé ! Compte tenu de mon expérience, je ne crois malheureusement pas qu'une action en faveur des normes bio pourra faire bouger les choses.
La DG Trade nous dit que, si nous voulons exporter nos pommes bio en Colombie, nous devons accepter les bananes des pays tiers. C'est la règle de la réciprocité.
Madame la sénatrice, je suis d'accord avec vous. Une démarche qui ne partirait pas de la Commission n'aurait que peu de chance d'aboutir.
Nos cultures ont démontré qu'elles sont les meilleures du monde. Si la Commission prenait conscience que nous disposons d'un modèle de culture susceptible d'être proposé aux autres agricultures mondiales, nous aurions un standard bio qui pourrait s'imposer à tous.
Quand vous disiez que nous ne pourrons pas nous opposer aux agriculteurs, vous avez raison pour la pomme de terre. Mais le consommateur allemand est friand de bananes bio que l'Allemagne ne produit pas. Sur tout ce qui est spécifique chez nous, nous avons une marge de manoeuvre. Il faut convaincre la Commission, ce qui signifie qu'il faut, à Paris, avoir une position très claire.
Pour la banane, nous avons probablement l'agriculture tropicale la mieux-disante du monde. Les rapports sur la biodiversité dans les bananeraies depuis 2007 en attestent. Nous n'utilisons plus du tout d'insecticides ni de nématicides et tendons vers la suppression du traitement avec des herbicides en utilisant des plantes de couverture.
Les chiffres peuvent être diversement interprétés mais ils sont calculés à partir de la quantité de matière active par hectares. Des personnalités du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), du Muséum d'histoire naturelle et de l'Université des Antilles ont noté dans une étude le retour des espèces animales dans les bananeraies. C'est la preuve incontestable de la bonne santé écologique de nos bananeraies. Nous assistons au retour massif de la biodiversité. Je ne crois pas que l'on trouverait autant d'espèces dans les bananeraies de la République dominicaine.

Avez-vous présenté cette étude à la Commission européenne ? Quelles démarches ont été faites en faveur de l'application de ce standard ?
Comme je l'indiquais précédemment, nous avons rencontré le directeur général adjoint de la DG agri, Monsieur Korte, et le chef de cabinet adjoint de la DG Trade pour présenter ces résultats. Nous les avons rencontrés, mais ce sont les autorités françaises qui doivent être l'interlocuteur de la Commission.

Il faut aller à Bruxelles. Ce n'est pas simplement la délégation, c'est le Sénat, le Parlement qui doit s'impliquer dans le dossier. Il faut une démarche de nature politique.
Nous avons beaucoup sollicité les ministères de l'agriculture et de l'outre-mer sur ces questions. Ils ont créé récemment un groupe de travail. Le ministre de l'agriculture considère que nous nous inscrivons dans une démarche agro-écologique qu'il soutient mais son accord ne se traduit pas par des avancées concrètes.
Si le produit de traitement de la cercosporiose n'était plus homologué, qu'il soit bio ou pas, la filière disparaitrait. Il en serait de même pour la canne si on enlevait l'herbicide. Pour les autres normes qui génèrent des surcoûts, la nature du débat est différente ; il porte sur des problématiques de rentabilité économique et englobe la question des aides et compensations financières.

Vous appliquez un principe bien connu dans nos îles : pour réussir dans le domaine économique, il faut innover.
La deuxième règle est que l'on n'est jamais mieux défendu que par soi--même, et vos actions de lobbying à Bruxelles sont tout à fait nécessaires même si, comme le président Gillot, j'appelle à un soutien plus marqué de l'État français aux territoires ultramarins.
Vous approuvez l'existence de normes européennes mais demandez que la règle soit la même pour tout le monde. Nous voulons démontrer que les normes qui pèsent sur les outre-mer déséquilibrent leurs économies.
Si nous disons que nous voulons la conformité, c'est-à-dire la même règle pour tous, nous savons que toute la production tropicale ne rentrera pas en bio sur le marché communautaire. Nous ne sommes pas dans une logique de demander l'impossible. La Commission souhaite aller vers la conformité dans un délai de 5 ans. Tout le monde dit qu'on n'y arrivera pas. Des voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas grave et que dans 5 ans on reportera le délai. Nous demandons à la Commission et à la France de s'entendre pour nous accorder les labels les plus prestigieux reconnaissant la qualité de nos productions, et de laisser le temps aux autres pays - par exemple 5 ans - pour se mettre à niveau.

L'Europe a défini la norme de la courbure de la banane. Est-ce vous qui l'avez demandée ? Cette norme vous pose-t-elle problème ?
Nous courbons nous-mêmes nos bananes à la main ! Les normes sur la courbure et la taille sont définies très largement et, dès lors, ne visent pas un objectif de meilleure qualité ; ces normes sont en outre différentes en droit français et en droit européen et un processus d'harmonisation est engagé.
Elles ne servent à rien.

Avez-vous, en tant que professionnels, une liste des normes avec leur impact ?
Une liste non exhaustive pourrait être établie.
consultante agriculture, bioressources et territoire, Blezat Consulting. - Notre cabinet a été mandaté par les ministères de l'agriculture et de l'outre-mer fin 2013 pour évaluer le plan banane durable sur la période 2007-2013. Le contexte de la crise du chlordécone, qui a également constitué un électrochoc pour les producteurs, a joué en faveur du plan banane durable. Ce plan, qui a bénéficié de gros moyens financiers, est exemplaire dans le sens où il a intégré des actions sur l'ensemble de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Il y a eu de la recherche et du développement, les producteurs ont été accompagnés, des actions sur la communication et la commercialisation ont été menées. On peut citer la création de l'Institut technique tropical (IT2) ou les 525 000 heures de formation des producteurs et des salariés. C'est un plan intégrateur comme il en existe peu dans les filières agricoles françaises. Fin 2013, les efforts se sont traduits par une forte baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires, insecticides et nématicides, et une réduction plus faible sur les herbicides. Nous avons constaté un léger retard de la Guadeloupe par rapport à la Martinique sur la diffusion et le transfert des pratiques mais la dynamique était identique. Des pratiques culturales plus durables ont été relevées comme la lutte bio sur certains insectes, l'effeuillage des bananiers pour maîtriser la cercosporiose, la jachère pour assainir les parcelles, l'utilisation de plantes de couverture pour limiter les herbicides ou en matière de conditions de travail dans les exploitations, notamment liées à la certification.
Notre étude s'achève sur le constat du retour de la biodiversité dans les exploitations, du maintien de la production et des emplois, avec cependant une baisse certaine bien que modérée du rendement.
Malgré tous ces efforts et ces résultats, il faut constater qu'en dehors des labels visibles comme le label bio il est très difficile de valoriser commercialement les effets environnementaux auprès des consommateurs.

Le producteur français, et notamment ultramarin, s'attache à respecter au mieux tout ce qu'on lui demande. Contrôlez-vous a posteriori, à leur arrivée en Europe, le respect des normes par vos produits ?
L'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique (UGPBAN) a un service qualité qui contrôle les bananes à leur arrivée en métropole. Une série d'analyses sur les pesticides est réalisée. L'UGPBAN qui, au sein de son réseau Fruidor, commercialise aussi des bananes d'autres origines, fait également ces analyses pour des bananes bio qui viennent de République dominicaine ou d'Afrique. Mais comme la banane est un fruit à peau épaisse, on ne retrouve que les produits de post-récolte. Ce sont les mêmes produits qui sont utilisés aux Antilles et dans les autres pays, hors République dominicaine.
Ces analyses de pesticides ne permettent pas de comparer les pratiques qui sont faites au champ, en amont. La différence entre la soixantaine de traitements qui sont effectués ailleurs et les 7 à 10 que nous pratiquons n'est pas visible.

Vous poursuivez votre démarche qualité en allant jusqu'à contrôler vos propres produits à l'entrée sur le marché européen pour pouvoir dire que vous respectez bien les règles.
Tous les conteneurs qui partent de Martinique sont contrôlés dans un entrepôt à Dunkerque. On ne le fait pas uniquement pour montrer notre respect des normes mais aussi parce que les bananes passent par la même coopérative et que tous les producteurs touchent le même prix. Il faut donc que le niveau de qualité soit comparable.
Les contrôles de conformité, de résidus de pesticides, sont effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Mais la banane est un fruit qui produit peu de résidus, même si vous faites 60 traitements. C'est une chance pour le consommateur et une difficulté quand nous voulons démontrer notre différence. La DGCCRF fait très peu de contrôles sur la banane.

Les contrôles ne seraient-ils pas plus utiles en amont, avant l'exportation ?
Nous voyons des choses incroyables quand nous regardons certaines productions étrangères, parfois même homologuées bio ou fair trade.
Comme il y a de nombreux labels, le message vers le consommateur est tellement confus que nous n'arrivons pas à nous démarquer. Nous avons valorisé notre démarche environnementale avec une stratégie qui consiste à dire que les bananes françaises répondent à des normes élevées. Nous les entourons d'un ruban Bleu Blanc Rouge, ce qui évite aussi que les clients les manipulent trop. Elles sont vendues à la pièce plutôt qu'au kilogramme, avec un prix équivalent à celui du bio, soit environ 20 % plus cher que la banane classique. Nous sommes au début d'un processus qui fonctionne assez bien. Cette banane représente environ 2 % de la production. C'est un début mais aussi une nécessité car tout augmente, qu'il s'agisse du poids des normes ou du poids salarial. Dans le même temps, le POSEI évolue peu, de même que les gains de productivité, qui ont déjà considérablement progressé. Nos marges de manoeuvre sont donc étroites et jouent sur le marketing.
La banane française est notre seul espoir pour nous en sortir économiquement. Nous visons 20 à 25 % de notre production en 2018, avec une valorisation supérieure de 20 à 30 % par rapport au marché de la banane basique.

Peut-on dire que la filière de la banane se porte bien ? Écoulez-vous votre production ? Avez-vous une marge de progression possible ? Dans quelle mesure les normes pèsent-elles sur votre production ?
Notre filière se porte à peu près bien mais nos marges sont très faibles. Nous sommes à un point d'équilibre.
Les coûts de production augmentent. Les aides n'ont pas augmenté depuis 2007 et il est très peu probable qu'elles augmentent. Les gains de productivité resteront faibles. Donc si nous voulons survivre à court terme, nous devons valoriser les efforts environnementaux au niveau de la vente et retourner la contrainte des normes à notre avantage en disant que nous respectons les normes françaises, les plus élevées du monde. Nous disons au consommateur français « Achetez la banane française, produite en respectant la meilleure norme sociale, supérieure aux normes du commerce équitable fair trade ou Max Havelaar ». Les produits français sont meilleurs que le bio des pays étrangers.
La menace phytosanitaire est une autre chose. Soit nous disposons des produits pour lutter contre la cercosporiose, soit nous disparaissons. La catastrophe peut être imminente.

Nous voyons bien la menace sur cette filière qui risque de disparaître. L'assouplissement des normes pourrait-il constituer une orientation ?
Il ne faut pas avoir, pour les régions ultrapériphériques, des normes qui seraient des sous-normes phytosanitaires. La question est celle de l'adaptation, autorisée par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous avons obtenu avec de grandes difficultés une réglementation spécifique en matière agricole pour la politique agricole commune (PAC), c'est le POSEI. Nous avons eu énormément de mal sur la pêche. L'océan Indien n'est pas la Manche ! Et nous avons obtenu le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Il faut prendre en compte la diversité de nos territoires. Nous avons une réalité géographique qui nécessite des normes spécifiques. Produire en agriculture tropicale n'est pas produire en agriculture continentale car il n'y a pas d'hiver.
Cela fait 25 ans qu'Eurodom se bat pour le secteur de la pêche à Bruxelles. Grâce au traité de Lisbonne, des avancées pour 2020 viennent d'être obtenues. Maintenant, quand les députés européens vont voir la Commission, celle-ci les écoute. C'est une évolution fondamentale !
Pourquoi sommes-nous au bord du précipice pour la filière banane ? Le président de la filière pour la Guadeloupe et la Martinique, Éric de Lucy, dit que depuis 2009 nous sommes menacés gravement par la baisse des droits de douane décidée à Genève pour permettre l'accord de Doha qui n'a finalement pas été conclu. Depuis 2009, cet accord menace la production de banane. Nous survivons grâce à deux miracles :
- la baisse de l'euro par rapport au dollar, de 1,40 à environ 1,10 dollar. C'est un gain de productivité contra-cyclique que nous ne pouvions pas prévoir ;
- la croissance du marché communautaire, passé de 5,1 à 5,7 millions de tonnes.
La conjonction de ces deux facteurs a permis d'absorber l'augmentation de la production des pays tiers, sans affecter notre volume de vente.
Dans le même temps, la baisse des droits de douane, passés de 176 à 75 euros, représente 1 euro par caisse de banane, montant supérieur au revenu de nos producteurs. Nous donnons un avantage compétitif à nos concurrents immédiats, aux dépens du budget de l'Union européenne. Deux épées de Damoclès nous menacent : la parité euro-dollar et celle de l'évolution du marché.
Il y a enfin une troisième menace : quand la molécule Asulox a été retirée de la liste des produits autorisés par Bruxelles à la suite du non-renouvellement de la demande d'AMM par un laboratoire indien pour qui notre production de canne à sucre représentait un tout petit marché, les herbes se sont mises à pousser dans les plantations de canne à sucre. On a observé la première année une baisse du rendement de la canne de 50 % pour la Martinique et de 25 % pour la Guadeloupe. Cela voulait dire que la deuxième année il n'y aurait eu que de l'herbe. Nous sommes allés voir le ministre et avons obtenu de la Direction générale de l'alimentation (DGAL) le rétablissement provisoire de l'Asulox. Avec la transmission des AMM de la DGAL à l'ANSES un tel accord ne sera plus possible. Le directeur de l'ANSES ne signera jamais une AMM pour un produit qui n'est pas autorisé par Bruxelles.

Votre audition a été passionnante. À travers la banane, nous comprenons la problématique de l'outre-mer qui est de parvenir à produire, à vendre et à être compétitif. La question des normes se pose, mais elle met en évidence le problème de la volonté politique de défendre le développement des économies ultramarines.
Je regardais les recommandations du rapport pour favoriser l'égalité réelle au bénéfice des outre-mer. La problématique des normes n'est pas abordée. L'auteur propose des pansements, sous forme d'augmentation des aides et des compensations financières, alors qu'une solution pérenne consiste à aider l'outre-mer à se développer, en évitant que la concurrence soit toujours davantage poussée à l'avantage des pays tiers.
J'aimerais que vous nous indiquiez un ordre d'urgence des mesures à prendre et des interventions qu'il nous faudrait entreprendre. Faut-il commencer par les produits phytosanitaires ou la défense de notre production bio ?

J'apprécie votre position qui consiste à souhaiter une adaptation des normes et disposer des moyens de lutter contre la concurrence non par l'abaissement des coûts mais par l'augmentation de la qualité.